|
|
| LACÉDÉMONE | (Géog.) voilà cette ville si célebre de l'ancienne Grece, au Péloponnèse, située sur la rive droite ou occidentale de l'Eurotas. C'est dans cette ville, dit Terpandre, que regne la valeur, mere de la victoire, la musique mâle qui l'inspire, & la justice qui soutient la gloire de ses armes. Quoiqu'elle fût quatre fois moins grande qu'Athènes, elle l'égaloit en puissance, & la surpassoit en vertu ; elle demeura six cent ans sans murailles, & se crut assez fortifiée par le courage de ses habitans. On la nomma d'abord Sparte, & ensuite Lacédémone. Homere distingue ces deux noms : par Lacédémone, il entend la Laconie ; & par Sparte, il entend la capitale de ce pays-là. Voyez donc SPARTE, où nous entrerons dans les détails.
Nous marquerons l'état présent de cette ville au mot, MISITRA, qui est le nom moderne, & nous aurons peut-être bien des choses à y rapporter.
Consultez, si vous voulez, sur l'ancien état du pays le mot LACONIE, & sur son état actuel, le mot MAINA (Brazo di.).
Enfin, pour ce qui regarde la république de Lacédémone, son gouvernement, ses lois, le caractere, le génie, les moeurs & le mérite de ses citoyens, on verra dans l'article suivant, combien nous en sommes admirateurs. (D.J.)
LACEDEMONE, république de, (Hist. de Grèce) république merveilleuse, qui fut l'effroi des Perses, la vénération des Grecs, & pour dire quelque chose de plus, devint l'admiration de la posterité, qui portera sa gloire dans le monde, aussi loin & aussi long-tems que pourra s'étendre l'amour des grandes & belles choses.
Il semble que la nature n'ait jamais produit des hommes qu'à Lacédémone. Par tout le reste de l'univers, le secours des sciences ou des lumieres de la religion, ont contribué à discerner l'homme de la bête. A Lacédémone on apportoit en naissant, si l'on peut parler ainsi, des semences de l'exacte droiture & de la véritable intrépidité. On venoit au monde avec un caractere de philosophe & de citoyen, & le seul air natal y faisoit des sages & des braves. C'est-là que, par une morale purement naturelle, on voyoit des hommes assujettis à la raison, qui, par leur propre choix, se rangeoient sous une austere discipline, & qui soumettant les autres peuples à la force des armes, se soumettoient eux-mêmes à la vertu : un seul Lycurgue leur en traça le chemin, & les Spartiates y marcherent sans s'égarer pendant sept ou huit cent ans : aussi je déclare avec Procope, que je suis tout lacédémonien. Lycurgue me tient lieu de toutes choses ; plus de Solon ni d'Athènes.
Lycurgue étoit de la race des Héraclides ; l'on sait assez précisément le tems où il fleurissoit, s'il est sûr, comme le prétend Aristote, qu'une inscription gravée sur une planche de cuivre à Olympie, marquoit qu'il avoit été contemporain d'Iphitus & qu'il avoit contribué à la surséance d'armes qui s'observoit durant la fête des jeux olympiques. Les Lacédémoniens vivoient encore alors comme des peuples barbares ; Lycurgue entreprit de les policer, de les éclairer & de leur donner un éclat durable.
Après la mort de son frere Polydecte, roi de Lacédémone, il refusa la couronne que lui offroit la veuve, qui s'engageoit de se faire avorter de l'enfant dont elle étoit grosse, pourvu qu'il voulût l'épouser. Pensant bien différemment que sa belle-soeur, il la conjura de conserver son enfant, qui fut Léobotés ou Labotés ; &, selon Plutarque Charilaüs ; il le prit sous sa tutele, & lui remit la couronne quand il eut atteint l'âge de majorité.
Mais dès le commencement de sa régence il exécuta le projet qu'il avoit formé, de changer toute la face du gouvernement de Lacédémone, dans la police, la guerre, les finances, la religion & l'éducation ; dans la possession des biens, dans les magistrats, dans les particuliers, en un mot, dans les personnes des deux sexes de tout âge & de toute condition. J'ébaucherai le plus soigneusement que je pourrai ces choses admirables en elles-mêmes & dans leurs suites, & j'emprunterai quelquefois des traits d'ouvrages trop connus pour avoir besoin d'en nommer les auteurs.
Le premier soin de Licurgue, & le plus important, fut d'établir un sénat de 28 membres, qui, joints aux deux rois, composoient un conseil de 30 personnes, entre les mains desquels fut déposée la puissance de la mort & de la vie, de l'ignominie & de la gloire des citoyens. On nomma gérontes les 28 sénateurs de Lacédémone ; & Platon dit qu'ils étoient les modérateurs du peuple & de l'autorité royale, tenant l'équilibre entre les uns & les autres, ainsi qu'entre les deux rois, dont l'autorité étoit égale. Voyez GERONTE.
Lycurgue, après avoir formé le sénat des personnes les plus capables d'occuper ce poste, & les plus initiées dans la connoissance de ses secrets, ordonna que les places qui viendroient à vaquer fussent remplies d'abord après la mort, & que pour cet effet le peuple éliroit, à la pluralité des suffrages, les plus gens de bien de ceux de Sparte qui auroient atteint 60 ans.
Plutarque vous détaillera la maniere dont se faisoit l'élection. Je dirai seulement qu'on couronnoit sur le champ le nouveau sénateur d'un chapeau de fleurs, & qu'il se rendoit dans les temples, suivi d'une foule de peuple, pour remercier les dieux. A son retour ses parens lui présentoient une collation, en lui disant : la ville t'honore de ce festin. Ensuite il alloit souper dans la salle des repas publics, dont nous parlerons, & on lui donnoit ce jour-là deux portions. Après le repas il en remettoit une à la parente qu'il estimoit davantage, & lui disoit, je vous offre le prix de l'honneur que je viens de recevoir. Alors toutes les parentes & amies la reconduisoient chez elle au milieu des acclamations, des voeux & des bénédictions.
Le peuple tenoit ses assemblées générales & particulieres dans un lieu nud, où il n'y avoit ni statues, ni tableaux, ni lambris, pour que rien ne détournât son attention des sujets qu'il devoit traiter. Tous les habitans de la Laconie assistoient aux assemblées générales, & les seuls citoyens de Sparte composoient les assemblées particulieres. Le droit de publier les assemblées & d'y proposer les matieres, n'appartenoit qu'aux rois & aux gérontes : les éphores l'usurperent ensuite.
On y délibéroit de la paix, de la guerre, des alliances, des grandes affaires de l'état, & de l'élection des magistrats. Après les propositions faites, ceux de l'assemblée qui tenoient une opinion, se rangeoient d'un côté, & ceux de l'opinion contraire se rangeoient de l'autre ; ainsi le grand nombre étant connu, décidoit la contestation.
Le peuple se divisoit en tribus ou lignées ; les principales étoient celles des Héraclides & des Pitanates, dont sortit Ménélas, & celle des Egides, différente de la tribu de ce nom à Athènes.
Les rois des Lacédémoniens s'appelloient archagètes, d'un nom différent de celui que prenoient les autres rois de la Grece, comme pour montrer qu'ils n'étoient que les premiers magistrats à vie de la république, semblables aux deux consuls de Rome. Ils étoient les généraux des armées pendant la guerre ; présidoient aux assemblées, aux sacrifices publics pendant la paix ; pouvoient proposer tout ce qu'ils croyoient avantageux à l'état, & avoient la liberté de dissoudre les assemblées qu'ils avoient convoquées, mais non pas de rien conclure sans le consentement de la nation ; enfin il ne leur étoit pas permis d'épouser une femme étrangere. Xénophon vous instruira de leurs autres prérogatives ; Hérodote & Pausanias vous donneront la liste de leur succession : c'est assez pour moi d'observer, que dans la forme du gouvernement, Lycurgue se proposa de fondre les trois pouvoirs en un seul, pour qu'ils se servissent l'un à l'autre de balance & de contrepoids ; & l'évenement justifia la sublimité de cette idée.
Ce grand homme ne procéda point aux autres changemens qu'il méditoit, par une marche insensible & lente. Echauffé de la passion de la vertu, & voulant faire de sa patrie une république de héros, il profita du premier instant de ferveur de ses concitoyens à s'y prêter, pour leur inspirer, par des oracles & par son génie, les mêmes vûes dont il étoit enflammé. Il sentit " que les passions sont semblables aux volcans, dont l'éruption soudaine change tout-à-coup le lit d'un fleuve, que l'art ne pourroit détourner qu'en lui creusant un nouveau lit. Il mit donc en usage des passions fortes pour produire une révolution subite, & porter dans le coeur du peuple l'enthousiasme, &, si l'on peut le dire, la fievre de la vertu ". C'est ainsi qu'il réussit dans son plan de législation, le plus hardi, le plus beau & le mieux lié qui ait jamais été conçu par aucun mortel.
Après avoir fondu ensemble les trois pouvoirs du gouvernement, afin que l'un ne pût pas empiéter sur l'autre, il brisa tous les liens de la parenté, en déclarant tous les citoyens de Lacédémone enfans nés de l'état. C'est, dit un beau génie de ce siecle, l'unique moyen d'étouffer les vices, qu'autorise une apparence de vertu, & d'empêcher la subdivision d'un peuple en une infinité de familles ou de petites sociétés, dont les intérêts, presque toujours opposés à l'intérêt public, éteindroient à la fin dans les ames toute espece d'amour de la patrie.
Pour détourner encore ce malheur, & créer une vraie république, Lycurgue mit en commun toutes les terres du pays, & les divisa en 39 mille portions égales, qu'il distribua comme à des freres républicains qui feroient leur partage.
Il voulut que les deux sexes eussent leurs sacrifices réunis, & joignissent ensemble leurs voeux & leurs offrandes à chaque solemnité religieuse. Il se persuada par cet institut, que les premiers noeuds de l'amitié & de l'union des esprits seroient les heureux augures de la fidélité des mariages.
Il bannit des funérailles toutes superstitions ; ordonnant qu'on ne mit rien dans la biere avec le cadavre, & qu'on n'ornât les cercueils que de simples feuilles d'olivier. Mais comme les prétentions de la vanité sont sans bornes, il défendit d'écrire le nom du défunt sur son tombeau, hormis qu'il n'eût été tué les armes à la main, ou que ce ne fût une prêtresse de la religion.
Il permit d'enterrer les morts autour des temples, & dans les temples mêmes, pour accoutumer les jeunes gens à voir souvent ce spectacle, & leur apprendre qu'on n'étoit point impur ni souillé en passant par dessus des ossemens & des sépulchres.
Il abrégea la durée des deuils, & la régla à onze jours, ne voulant laisser dans les actions de la vie rien d'inutile & d'oiseux.
Se proposant encore d'abolir les superfluités religieuses, il fixa dans tous les rits de la religion les lois d'épargne & d'économie. Nous présentons aux dieux des choses communes, disoit un lacédémonien, afin que nous ayons tous les jours les moyens de les honorer.
Il renferma dans un même code politique les lois, les moeurs & les manieres, parce que les lois & les manieres représentent les moeurs ; mais en formant les manieres il n'eut en vûe que la subordination à la magistrature, & l'esprit belliqueux qu'il vouloit donner à son peuple. Des gens toujours corrigeans & toujours corrigés, qui instruisoient toujours & étoient instruits, également simples & rigides, exerçoient plûtôt des vertus qu'ils n'avoient des manieres : ainsi les moeurs donnerent le ton dans cette république. L'ignominie y devint le plus grand des maux, & la foiblesse le plus grand des crimes.
Comme l'usage de l'or & de l'argent n'est qu'un usage funeste, Lycurgue le proscrivit sous peine de la vie. Il ordonna que toute la monnoie ne seroit que de fer & de cuivre : encore Séneque est le seul qui parle de celle de cuivre ; tous les autres auteurs ne nomment que celle de fer, & même de fer aigre, selon Plutarque. Les deniers publics de Lacédémone furent mis en séquestre chez des voisins, & on les faisoit garder en Arcadie. Bientôt on ne vit plus à Sparte ni sophiste, ni charlatan, ni devin, ni diseur de bonne avanture ; tous ces gens qui vendent leurs sciences & leurs secrets pour de l'argent, délogerent du pays, & furent suivis de ceux qui ne travaillent que pour le luxe.
Les procès s'éteignirent avec l'argent : comment auroient-ils pû subsister dans une république où il n'y avoit ni pauvreté ni richesse, l'égalité chassant la disette, & l'abondance étant toujours également entretenue par la frugalité ? Plutus fut enfermé dans Sparte comme une statue sans ame & sans vie ; & c'est la seule ville du monde où ce que l'on dit communément de ce dieu, qu'il est aveugle, se trouva vérifié : ainsi le législateur de Lacédémone s'assura, qu'après avoir éteint l'amour des richesses, il tourneroit infailliblement toutes les pensées des Spartiates vers la gloire & la probité. Il ne crut pas même devoir assujettir à aucunes formules les petits contrats entre particuliers. Il laissa la liberté d'y ajouter ou retrancher tout ce qui paroîtroit convenable à un peuple si vertueux & si sage.
Mais pour préserver ce peuple de la corruption du dehors, il fit deux choses importantes.
Premierement, il ne permit pas à tous les citoyens d'aller voyager de côté & d'autre selon leur fantaisie, de peur qu'ils n'introduisissent à leur retour dans la patrie, des idées, des goûts, des usages, qui ruinassent l'harmonie du gouvernement établi, comme les dissonnances & les faux tons détruisent l'harmonie dans la Musique.
Secondement, pour empêcher encore avec plus d'efficace que le mélange des coûtumes opposées à celles de ses lois, n'altérât la discipline & les moeurs des Lacédémoniens, il ordonna que les étrangers ne fussent reçus à Sparte que pendant la solemnité des fêtes, des jeux publics & autres spectacles. On les accueilloit alors honorablement, & on les plaçoit sur des siéges à couvert, tandis que les habitans se mettoient où ils pouvoient. Les proxènes n'étoient établis à Lacédémone que pour l'observation de cet usage. On ne fit que rarement des exceptions à la loi, & seulement en faveur de certaines personnes dont le séjour ne pouvoit qu'honorer l'état. C'est à ce sujet que Xénophon & Plutarque vantent l'hospitalité du spartiate Lychas.
Il ne s'agissoit plus que de prévenir dans l'intérieur des maisons, les dissolutions & les débauches particulieres, nuisibles à la santé, & qui demandent ensuite pour cure palliative, le long sommeil, du repos, de la diete, des bains & des remedes de la Medecine, qui ne sont eux-mêmes que de nouveaux maux. Lycurgue coupa toutes les sources à l'intempérance domestique, en établissant des phidities, c'est-à-dire une communauté de repas publics, dans des salles expresses, où tous les citoyens seroient obligés de manger ensemble des mêmes mets reglés par la loi.
Les tables étoient de quinze personnes, plus ou moins. Chacun apportoit par mois un boisseau de farine, huit mesures de vin, cinq livres de fromage, deux livres & demie de figues, & quelque peu de monnoie de fer pour acheter de la viande. Celui qui faisoit chez lui un sacrifice, ou qui avoit tué du gibier à la chasse, envoyoit d'ordinaire une piece de sa victime ou de sa venaison à la table dont il étoit membre.
Il n'y avoit que deux occasions, sans maladie, où il fut permis de manger chez soi ; savoir, quand on étoit revenu fort tard de la chasse, ou qu'on avoit achevé fort tard son sacrifice, autrement il falloit se trouver aux repas publics ; & cet usage s'observa très-longtems avec la derniere exactitude ; jusques-là, que le roi Agis, qui revenoit de l'armée, après avoir vaincu les Athéniens, & qui se faisoit une fête de souper chez lui avec sa femme, envoya demander ses deux portions dans la salle, mais les polémarques les lui refuserent.
Les rois seuls, pour le remarquer en passant, avoient deux portions ; non pas, dit Xénophon, afin qu'ils mangeassent le double des autres, mais afin qu'ils pussent donner une de ces portions à celui qu'ils jugeroient digne de cet honneur. Les enfans d'un certain âge assistoient à ces repas, & on les y menoit comme à une école de tempérance & d'instruction.
Lycurgue fit orner toutes les salles à manger des images & des statues du Ris, pour montrer que la joie devoit être un des assaisonnemens des tables, & qu'elle se marioit avec l'ordre & la frugalité.
Le plus exquis de tous les mets que l'on servoit dans les repas de Lacédémone, étoit le brouet noir, du moins les vieillards le préféroient à toute autre chose. Il y eut un roi de Pont qui entendant faire l'éloge de ce brouet, acheta exprès un cuisinier de Lacédémone pour lui en préparer à sa table. Cependant il n'en eut pas plûtôt goûté, qu'il le trouva détestable ; mais le cuisinier lui dit : " Seigneur, je n'en suis pas surpris, le meilleur manque à mon brouet, & je ne peux vous le procurer ; c'est qu'avant que d'en manger, il faut se baigner dans l'Eurotas ".
Les Lacédémoniens, après le repas du soir, s'en retournoient chacun chez eux sans flambeaux & sans lumiere. Lycurgue le prescrivit ainsi, afin d'accoutumer les citoyens à marcher hardiment de nuit & au fort des ténebres.
Mais voici d'autres faits merveilleux de la législation de Lycurgue, c'est qu'elle se porta sur le beau sexe avec des vûes toutes nouvelles & toutes utiles. Ce grand homme se convainquit " que les femmes, qui par-tout ailleurs sembloient, comme les fleurs d'un beau jardin, n'être faites que pour l'ornement de la terre & le plaisir des yeux, pouvoient être employées à un plus noble usage, & que ce sexe, avili & dégradé chez presque tous les peuples du monde, pouvoit entrer en communauté de gloire avec les hommes, partager avec eux les lauriers qu'il leur faisoit cueillir, & devenir enfin un des puissans ressorts de la législation ".
Nous n'avons aucun intérêt à exagérer les attraits des Lacédémoniennes des siecles passés ; mais la voix d'un oracle rapporté par Eusebe, prononce qu'elles étoient les plus belles de l'univers ; & presque tous les auteurs grecs en parlent sur ce ton : il suffiroit même de se ressouvenir qu'Hélene étoit de Lacédémone. Pour l'amour d'elle, Thésée y vint d'Athènes, & Paris de Troye, assurés d'y trouver quelque chose de plus beau que dans tout autre pays. Pénélope étoit aussi de Sparte ; & presque dans le même tems que les charmes d'Hélene y faisoient naître des desirs criminels dans l'ame de deux amans, les chastes regards de Pénélope y allumoient un grand nombre d'innocentes flammes dans le coeur des rivaux qui vinrent en foule la disputer à Ulysse.
Le législateur de Lacédémone se proposant donc d'élever les filles de Sparte au-dessus des coûtumes de leur sexe, leur fit faire les mêmes exercices que faisoient les hommes, afin qu'elles ne leur fussent point inférieures, ni pour la force & la santé du corps, ni pour la grandeur du courage. Ainsi destinées à s'exercer à la course, à la lutte, à jetter le palet & à lancer le javelot, elles portoient des habits qui leur donnoient toute l'aisance nécessaire pour s'acquiter de ces exercices. Sophocle a peint l'habit des filles de Sparte, en décrivant celui d'Hermione, dans un fragment que Plutarque rapporte : " il étoit très-court, cet habit, & c'est tout ce que j'en dois dire. "
Lycurgue ne voulut pas seulement que les jeunes garçons dansassent nuds, mais il établit que les jeunes filles, dans certaines fêtes solemnelles, danseroient en public, parées seulement de leur propre beauté, & sans autre voile que leur vertu. La pudeur s'en allarma d'abord, mais elle céda bien-tôt à l'utilité publique. La nation vit avec respect ces aimables beautés célébrer dans des fêtes, par leurs hymnes, les jeunes guerriers qui s'étoient signalés par des exploits éclatans. " Quel triomphe pour le héros qui recevoit la palme de la gloire des mains de la beauté ; qui lisoit l'estime sur le front des vieillards, l'amour dans les yeux de ces jeunes filles, & l'assurance de ces faveurs dont l'espoir seul est un plaisir ! Peut-on douter qu'alors ce jeune guerrier ne fût ivre de valeur " ? Tout concouroit dans cette législation à métamorphoser les hommes en héros.
Je ne parle point de la gymnopédie des jeunes lacédémoniennes, pour la justifier d'après Plutarque. Tout est dit, selon la remarque d'un illustre moderne, en avançant " que cet usage ne convenoit qu'aux éleves de Lycurgue, que leur vie frugale & laborieuse, leurs moeurs pures & séveres, la force d'ame qui leur étoit propre, pouvoient seules rendre innocent sous leurs yeux un spectacle si choquant pour tout peuple qui n'est qu'honnête.
Mais pense-t-on qu'au fonds l'adroite parure de nos femmes ait moins son danger qu'une nudité absolue, dont l'habitude tourneroit bientôt les premiers effets en indifférence. Ne sait-on pas que les statues & les tableaux n'offensent les yeux que quand un mélange de vêtement rend les nudités obscènes ? Le pouvoir immédiat des sens, est foible & borné ; c'est par l'entremise de l'imagination qu'ils font leurs plus grands ravages ; c'est elle qui prend soin d'irriter les desirs, en prêtant à leurs objets encore plus d'attraits que ne leur en donna la nature. Enfin, quand on s'habille avec tant d'art, & si peu d'exactitude que les femmes font aujourd'hui : quand on ne montre moins que pour faire desirer davantage ; quand l'obstacle qu'on oppose aux yeux, ne sert qu'à mieux irriter la passion ; quand on ne cache une partie de l'objet que pour parer celle qu'on expose : "
Heu malè tùm mites defendit pampinus uvas !
Les femmes de Lacédémone portoient un voile sur le visage, mais non pas les filles ; & lorsqu'un étranger en demanda autrefois la raison à Charilaüs, il répondit que les filles cherchoient un mari, & que les femmes se conservoient pour le leur.
Dès que ce mari étoit trouvé, & agréé par le magistrat, il falloit qu'il enlevât la fille qu'il devoit épouser ; peut-être afin que la pudeur prête à succomber, eût un prétexte dans la violence du ravisseur. Plutarque ajoute, qu'au tems de la consommation du mariage, la femme étoit vêtue de l'habit d'homme. Comme on n'en apporte point de raison, on n'en peut imaginer de plus modeste, ni de plus apparente, sinon que c'étoit le symbole d'un pouvoir égal entre la femme & le mari ; car il est certain qu'il n'y a jamais eu de nation, où les femmes aient été plus absolues qu'à Lacédémone. On sait à ce sujet ce que répondit Gorgo femme de Léonidas, roi de Sparte, à une dame étrangere qui lui disoit : " il n'y a que vous autres qui commandiez à vos maris ; cela est vrai, répliqua la reine, mais aussi il n'y a que nous qui mettions des hommes au monde ".
Personne n'ignore ce qui se pratiquoit aux couches de ces femmes. Prévenues d'un sentiment de gloire, & animées du génie de la république, elles ne songeoient dans ces momens qu'à inspirer une ardeur martiale à leurs enfans. Dès qu'elles étoient en travail, on apportoit un javelot & un bouclier, & on les mettoit elles-mêmes sur ce bouclier, afin que ces peuples belliqueux en tirassent au moins un présage de la naissance d'un nouveau soldat. Si elles accouchoient d'un garçon, les parens élevoient l'enfant sur le bouclier, poussant au ciel ces acclamations héroïques, I tan, I epi tan, mots que les Latins ont rendu, aut hunc, aut in hoc ; c'est-à-dire, ou conservez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avec la vie ; & de peur que les enfans n'oubliassent ces premieres leçons, les meres venoient les leur rappeller quand ils alloient à la guerre, en leur mettant le bouclier à la main. Ausone le dit après tous les auteurs Grecs :
Mater Lacaena clypeo obarmans filium,
Cum hoc inquit, aut in hoc redi.
Aristote nous apprend, que ce fut l'illustre femme de Léonidas dont je viens de parler, qui tint la premiere ce propos à son fils, lorsqu'il partoit pour l'armée ; ce que les autres Lacédémoniennes imiterent depuis.
De quelque amour qu'on soit animé pour la patrie dans les républiques guerrieres, on n'y verra jamais de mere, après la perte d'un fils tué dans le combat, reprocher au fils qui lui reste, d'avoir survécu à sa défaite. On ne prendra plus exemple sur les anciennes Lacédémoniennes. Après la bataille de Leuctres, honteuses d'avoir porté dans leur sein des hommes capables de fuir, celles dont les enfans étoient échappés au carnage, se retiroient au fond de leurs maisons, dans le deuil & dans le silence, lorsqu'au contraire les meres, dont les fils étoient morts en combattant, se montroient en public, & la tête couronnée de fleurs, alloient aux temples en rendre graces aux dieux. Il est certain qu'il n'y a jamais eu de pays où la grandeur d'ame ait été plus commune parmi le beau sexe. Lisez, si vous ne m'en croyez point, ce que Plutarque rapporte de Démétria, & de tant d'autres Lacédémoniennes.
Quand elles avoient appris que leurs enfans venoient de périr, & qu'elles étoient à portée de visiter leur corps, elles y couroient pour examiner si leurs blessures avoient été reçues le visage ou le dos tourné contre l'ennemi ; si c'étoit en faisant face, elles essuyoient leurs larmes, & d'un visage plus tranquille, elles alloient inhumer leurs fils dans le tombeau de leurs ancêtres ; mais s'ils avoient été blessés autrement, elles se retiroient saisies de douleur, & abandonnoient les cadavres à leur sépulture ordinaire.
Comme ces mêmes Lacédémoniennes, n'étoient pas moins attachées à leurs maris qu'à la gloire des enfans qu'elles avoient mis au monde, leurs mariages étoient très-heureux. Il est vrai que les lois de Lycurgue punissoient les célibataires, ceux qui se marioient sur l'âge avancé, & même ceux qui faisoient des alliances mal-assorties ; mais après ce que nous avons dit des charmes & de la vertu des Lacédémoniennes, il n'y avoit gueres moyen de garder le célibat auprès d'elles, & leurs attraits suffisoient pour faire desirer le mariage.
Ajoutez qu'il étoit interdit à ceux que la lâcheté avoit fait sauver d'une bataille. Et quel est le Spartiate qui eut osé s'exposer à cette double ignominie !
Enfin, à moins que de se marier, tous les autres remedes contre l'amour pour des femmes honnêtes, étoient à Sparte ou dangereux ou rares. Quiconque y violoit une fille, étoit puni de mort. A l'égard de l'adultere, il ne faut que se souvenir du bon mot de Géradas. Un étranger demandoit à ce Lacédémonien, comment on punissoit cette action à Sparte : Elle y est inconnue, dit Géradas. Mais supposons l'événement, répondit l'étranger ; en ce cas, répliqua le Spartiate, il faudroit que le coupable payât un taureau d'une si grande taille, qu'il pût boire de la pointe du mont Taygete dans la riviere d'Eurotas. Mais, reprit l'étranger, vous ne songez donc pas, qu'il est impossible de former un si grand taureau. Géradas souriant ; mais vous ne songez donc pas vous, qu'il est impossible d'avoir une galanterie criminelle avec une femme de Lacédémone.
N'imaginons pas que les anciens auteurs se contredisent, quand ils nous assurent qu'on ne voyoit point d'adultere à Sparte, & que cependant un mari cédoit quelquefois son lit nuptial à un homme de bonne mine pour avoir des enfans robustes & bienfaits ; les Spartiates n'appelloient point cette cession un adultere. Ils croyoient que dans le partage d'un bien si précieux, le consentement ou la répugnance d'un mari, fait ou détruit le crime, & qu'il en étoit de cette action comme d'un trésor qu'un homme donne quand il lui plaît, mais qu'il ne veut point qu'on lui ravisse. Dans cette rencontre, la femme ne trahissoit pas son époux ; & comme les personnes intéressées ne sentoient point d'offense à ce contrat, elles n'y trouvoient point de honte. En un mot, un Lacédémonien ne demandoit point à sa femme des voluptés, il lui demandoit des enfans.
Que ces enfans devoient être beaux ! Et comment n'auroient-ils point été tels, si on considere outre leur origine, tous les soins qu'on y apportoit ? Lisez seulement ce que le poëte Oppian en a publié. Les Spartiates, dit-il, se persuadant que dans le tems de la conception, l'imagination d'une mere contribue aux beautés de l'enfant, quand elle se représente des objets agréables, étaloient aux yeux de leurs épouses, les portraits des héros les mieux faits, ceux de Castor & de Pollux, du charmant Hyacinthe, d'Apollon, de Bacchus, de Narcisse, & de l'incomparable Nerée, roi de Naxe, qui au rapport d'Homere, fut le plus beau des Grecs qui combattirent devant Troye.
Envisagez ensuite combien des enfans nés de peres & meres robustes, chastes & tempérans, devoient devenir à leur tour forts & vigoureux ! Telles étoient les institutions de Lycurgue, qu'elles tendoient toutes à produire cet effet. Philopoemen voulut contraindre les Lacédémoniennes d'abandonner la nourriture de leurs enfans, persuadé que sans ce moyen ils auroient toujours une ame grande & le coeur haut. Les gardes même des dames de Sparte nouvellement accouchées, étoient renommées dans toute la Grece pour exceller dans les premiers soins de la vie, & pour avoir une maniere d'emmaillotter les enfans, propre à leur rendre la taille plus libre & plus dégagée que par-tout ailleurs. Amicla vint de Lacédémone à Athènes pour alaiter Alcibiade.
Malgré toutes les apparences de la vigueur des enfans, les Spartiates les éprouvoient encore à leur naissance, en les lavant dans du vin. Cette liqueur, selon leur opinion, avoit la vertu d'augmenter la force de la bonne constitution, ou d'accabler la langueur de la mauvaise. Je me rappelle qu'Henri IV. fut traité comme un spartiate. Son pere Antoine de Bourbon, après l'avoir reçu des bras de la sage-femme, lui fit sucer une gousse d'ail, & lui mit du vin dans la bouche.
Les enfans qui sortoient heureusement de cette épreuve, (& l'on en voyoit peu, sans-doute, qui y succombassent) avoient une portion des terres de la république, assignée pour leur subsistance, & jouissoient du droit de bourgeoisie. Les infirmes étoient exposés à l'abandon, parce que selon l'esprit des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne naissoit ni pour soi-même, ni pour ses parens, mais pour la république, dont il falloit que l'intérêt fût toujours préféré aux devoirs du sang. Athénée nous assure que de dix en dix jours, les enfans passoient en revue tous nuds devant les éphores, pour examiner si leur santé pouvoit rendre à la république le service qu'elle en attendoit.
Lacédémone ayant, avec une poignée de sujets, à soutenir le poids des armées de l'Asie, ne devoit sa conservation qu'aux grands hommes qui naissoient dans son sein pour la défendre ; aussi toujours occupée du soin d'en former, c'étoit sur les enfans que se portoit la principale attention du gouvernement. Il n'est donc pas étrange que lorsqu' Antipater vint à demander cinquante enfans pour ôtages, ils lui répondirent bien différemment de ce que nous ferions aujourd'hui, qu'ils aimeroient mieux lui donner le double d'hommes faits, tant ils estimoient la perte de l'éducation publique !
Chaque enfant de Sparte avoit pour ami particulier un autre lacédémonien, qui s'attachoit intimement à lui. C'étoit un commerce d'esprit & de moeurs, d'où l'ombre même du crime étoit bannie ; ou comme dit le divin Platon, c'étoit une émulation de vertu entre l'amant & la personne aimée. L'amant devoit avoir un soin continuel d'inspirer des sentimens de gloire à l'objet de son affection. Xénophon comparoit l'ardeur & la modestie de cet amour mutuel aux enchaînemens du coeur qui sont entre le pere & ses enfans.
Malheur à l'amant qui n'eût pas donné un bon exemple à son éleve, & qui ne l'eût pas corrigé de ses fautes ! Si l'enfant vient à faillir, dit Elien, on le pardonne à la foiblesse de l'âge, mais la peine tombe sur son tuteur, qui est obligé d'être le garant des fautes du pupille qu'il chérit. Plutarque rapporte que dans les combats à outrance que les enfans faisoient dans le Platoniste, il y en eut un qui laissa échapper une plainte indigne d'un lacédémonien, son amant fut aussi-tôt condamné en l'amende. Un autre auteur ajoute, que si quelqu'amant venoit à concevoir, comme dans d'autres villes de Grèce, des desirs criminels pour l'objet de ses affections, il ne pouvoit se sauver d'une mort infame que par une fuite honteuse. N'écoutons donc point ce qu'Hésychius & Suidas ont osé dire contre la nature de cet amour ; le verbe laconisein doit être expliqué des habits & des moeurs de Lacédémone, & c'est ainsi qu'Athénée & Démosthene l'ont entendu.
En un mot, on regardoit l'éducation de Sparte comme si pure & si parfaite, que c'étoit une grace de permettre aux enfans de quelques grands hommes étrangers, d'être mis sous la discipline lacédémonienne. Deux célébres athéniens, Xénophon & Phocion, profiterent de cette faveur.
De plus, chaque vieillard, chaque pere de famille avoit droit de châtier les enfans d'autrui comme les siens propres ; & s'il le négligeoit, on lui imputoit la faute commise par l'enfant. Cette loi de Lycurgue tenoit les peres dans une vigilance continuelle, & rappelloit sans-cesse aux enfans qu'ils appartenoient à la république. Aussi se soumettoient-ils de leur propre mouvement à la censure de tous les vieillards ; jamais ils ne rencontroient un homme d'âge, qu'ils ne s'arrêtassent par respect jusqu'à ce qu'il fût passé ; & quand ils étoient assis, ils se levoient sur le champ à son abord. C'est ce qui faisoit dire aux autres peuples de la Grèce, que si la derniere saison de la vie avoit quelque chose de flatteur, ce n'étoit qu'à Lacédémone.
Dans cette république l'oisiveté des jeunes gens étoit mise au rang des fautes capitales, tandis qu'on la regardoit comme une marque d'honneur dans les hommes faits ; car elle servoit à discerner les maîtres des esclaves : mais avant que de goûter les douceurs du repos, il falloit s'être continuellement exercé dans la jeunesse à la lutte, à la course, au saut, aux combats, aux évolutions militaires, à la chasse, à la danse, & même aux petits brigandages. On imposoit quelquefois à un enfant un châtiment bien singulier : on mordoit le doigt à celui qui avoit failli : Hésychius vous dira les noms différens qu'on donnoit aux jeunes gens, selon l'ordre de l'âge & des exercices, je n'ose entrer dans ce genre de détails.
Les peres, en certains jours de fêtes, faisoient enivrer leurs esclaves, & les produisoient dans cet état méprisable devant la jeunesse de Lacédémone, afin de la préserver de la débauche du vin, & lui enseigner la vertu par les défauts qui lui sont opposés ; comme qui voudroit faire admirer les beautés de la nature, en montrant les horreurs de la nuit.
Le larcin étoit permis aux enfans de Lacédémone, pour leur donner de l'adresse, de la ruse & de l'activité, & c'étoit le même usage chez les Crétois. Lycurgue, dit Montagne, considéra au larcin, la vivacité, diligence, hardiesse, ensemble l'utilité qui revient au public, que chacun regarde plus curieusement à la conservation de ce qui est sien ; & le législateur estima que de cette double institution à assaillir & à défendre, il s'en tireroit du fruit pour la science militaire de plus grande considération que n'étoit le désordre & l'injustice de semblables vols, qui d'ailleurs ne pouvoient consister qu'en quelques volailles ou légumes ; cependant ceux qui étoient pris sur le fait, étoient châtiés pour leur mal-adresse.
Ils craignoient tellement la honte d'être découverts, qu'un d'eux ayant volé un petit renard, le cacha sous sa robe, & souffrit, sans jetter un seul cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jusqu'à ce qu'il tomba mort sur la place. Ce fait ne doit pas paroître incroyable, dit Plutarque, à ceux qui savent ce que les enfans de la même ville font encore. Nous en avons vû continue cet historien, expirer sous les verges, sur l'autel de Diane Orthia, sans dire une seule parole.
Cicéron avoit aussi été témoin du spectacle de ces enfans, qui pour prouver leur patience dans la douleur, souffroient, à l'âge de sept ans, d'être fouettés jusqu'au sang, sans altérer leur visage. La coutume ne l'auroit pas chez nous emporté sur la nature ; car notre jugement empoisonné par les délices, la mollesse, l'oisiveté, la lâcheté, la paresse, nous l'avons perverti par d'honteuses habitudes. Ce n'est pas moi qui parle ainsi de ma nation, on pourroit s'y tromper à cette peinture, c'est Cicéron lui-même qui porte ce témoignage des Romains de son siecle ; & pour que personne n'en doute, voici ses propres termes : nos umbris delitiis, otio, languore, desidiâ, animum infetimus, maloque more delinitum, mollivimus. Tusc. quaest. liv. V. cap. xxvij.
Telle étoit encore l'éducation des enfans de Sparte, qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus rudes. On formoit leur corps aux rigueurs de toutes les saisons ; on les plongeoit dans l'eau froide pour les endurcir aux fatigues de la guerre, & on les faisoit coucher sur des roseaux qu'ils étoient obligés d'aller arracher dans l'Eurotas, sans autre instrument que leurs seules mains.
On reprocha publiquement à un jeune spartiate de s'être arrêté pendant l'orage sous le couvert d'une maison : comme auroit fait un esclave. Il étoit honteux à la jeunesse d'être vue sous le couvert d'un autre toît que celui du ciel, quelque tems qu'il fît. Après cela, nous étonnerons-nous que de tels enfans devinssent des hommes si forts, si vigoureux & si courageux ?
Lacédémone pendant environ sept siecles n'eut point d'autres murailles que les boucliers de ses soldats, c'étoit encore une institution de Lycurgue : " Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on ne faisoit à Sparte ; aussi n'éprouvons-nous pas à l'aspect d'une ville fortifiée, le sentiment de mépris dont étoient affectés les Lacédémoniens. Quelques-uns d'eux passant sous les murs de Corinthe ; quelles femmes, demanderent-ils, habitent cette ville ? Ce sont, leur répondit-on, des Corinthiens : Ne savent-ils pas reprirent-ils, ces hommes vils & lâches ; que les seuls remparts impénétrables à l'ennemi, sont des citoyens déterminés à la mort " ? Philippe ayant écrit aux Spartiates, qu'il empêcheroit leurs entreprises : Quoi ! nous empêcherois-tu de mourir, lui répondirent-ils ? L'histoire de Lacédémone est pleine de pareils traits ; elle est tout miracle en ce genre.
Je sais, comme d'autres, le prétendu bon mot du sybarite, que Plutarque nous a conservé dans Pélopidas. On lui vantoit l'intrépidité des Lacédémoniens à affronter la mort dans les périls de la guerre. Dequoi s'étonne-t-on, répondit cet homme voluptueux, de les voir chercher dans les combats une mort qui les délivre d'une vie misérable. Le sybarite se trompoit ; un spartiate ne menoit point une triste vie, une vie misérable ; il croyoit seulement que le bonheur ne consiste ni à vivre ni à mourir, mais à faire l'un & l'autre avec gloire & avec gaieté. " Il n'étoit pas moins doux à un lacédémonien de vivre à l'ombre des bonnes lois, qu'aux Sybarites à l'ombre de leurs bocages. Que dis-je ! Dans Suze même au milieu de la mollesse, le spartiate ennuyé soupiroit après ses grossiers festins, seuls convenables à son temperament ". Il soupiroit après l'instruction publique des salles qui nourrissoit son esprit ; après les fatiguans exercices qui conservoient sa santé ; après sa femme, dont les faveurs étoient toujours des plaisirs nouveaux ; enfin après des jeux dont ils se délassoient à la guerre.
Au moment que les Spartiates entroient en campagne, leur vie étoit moins pénible, leur nourriture plus délicate, & ce qui les touchoit davantage, c'étoit le moment de faire briller leur gloire & leur valeur. On leur permettoit à l'armée, d'embellir leurs habits & leurs armes, de parfumer & de tresser leurs longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couronnoient leurs chapeaux de fleurs. Dès qu'ils étoient en présence de l'ennemi, leur roi se mettoit à leur tête, commandoit aux joueurs de flûte de jouer l'air de Castor, & entonnoit lui-même l'hymne pour signal de la charge. C'étoit un spectacle admirable & terrible de les voir s'avancer à l'ennemi au son des flûtes, & affronter avec intrépidité, sans jamais rompre leurs rangs, toutes les horreurs du trépas. Liés par l'amour de la patrie, ils périssoient tous ensemble, ou revenoient victorieux.
Quelques Chalcidiens arrivant à Lacédémone, allerent voir Argiléonide, mere de Brasidas, qui venoit d'être tué en les défendant contre les Athéniens. Argiléonide leur demanda d'abord les larmes aux yeux, si son fils étoit mort en homme de coeur, & s'il étoit digne de son pays. Ces étrangers pleins d'admiration pour Brasidas, exalterent sa bravoure & ses exploits, jusqu'à dire que dans Sparte, il n'y avoit pas son égal. Non, non, repartit Argiléonide en les interrompant, & en essuyant ses larmes, mon fils étoit, j'espere, digne de son pays, mais sachez que Sparte est pleine de sujets qui ne lui cedent point ni en vertu ni en courage.
En effet, les actions de bravoure des Spartiates passeroient peut-être pour folles, si elles n'étoient consacrées par l'admiration de tous les siecles. Cette audacieuse opiniatreté, qui les rendoit invincibles, fut toujours entretenue par leurs héros, qui savoient bien que trop de prudence émousse la force du courage, & qu'un peuple n'a point les vertus dont il n'a pas les scrupules. Aussi les Spartiates toujours impatiens de combattre, se précipitoient avec fureur dans les bataillons ennemis, & de toutes parts environnés de la mort, ils n'envisagoient autre chose que la gloire.
Ils inventerent des armes qui n'étoient faites que pour eux ; mais leur discipline & leur vaillance produisoient leurs véritables forces. Les autres peuples, dit Séneque, couroient à la victoire quand ils la voyoient certaine ; mais les Spartiates couroient à la mort, quand elle étoit assurée : & il ajoute élégamment, turpe est cuilibet fugisse, Laconi verò deliberasse ; c'est une honte à qui que ce soit d'avoir pris la fuite, mais c'en est une à un lacédémonien d'y avoir seulement songé.
Les étrangers alliés de Lacédémone, ne lui demandoient pour soutenir leurs guerres, ni argent, ni vaisseaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un Spartiate à la tête de leurs armées ; & quand ils l'avoient obtenu, ils lui rendoient avec une entiere soumission toutes sortes d'honneurs & de respects. C'est ainsi que les Siciliens obéirent à Gylippe, les Chalcidiens à Brasidas, & tous les Grecs d'Asie à Lysandre, à Callicratidas & à Agésilas.
Ce peuple belliqueux réprésentoit toutes ses déïtés armées, Vénus elle-même l'étoit : armatam Venerem vidit Lacedemona Pallas. Bacchus qui par-tout ailleurs tenoit le thyrse à la main, portoit un dard à Lacédémone. Jugez si les Spartiates pouvoient manquer d'être vaillans. Ils n'alloient jamais dans leurs temples qu'ils n'y trouvassent une espece d'armée, & ne pouvoient jamais prier les dieux, qu'en même tems la dévotion ne réveillât leur courage.
Il falloit bien que ces gens-là se fussent fait toute leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi de Lacédémone, partit pour se trouver à la défense du pas des Thermopyles avec trois cent Spartiates, opposés à trois cent mille persans, ils se déterminerent si bien à périr, qu'avant que de sortir de la ville, on leur fit des pompes funebres où ils assisterent eux-mêmes. Léonidas est ce roi magnanime dont Pausanias préfere les grandes actions à ce qu'Achille fit devant Troie, à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à Marathon, & à tous les grands exemples de valeur de l'histoire grecque & romaine. Lorsque vous aurez lû Plutarque sur les exploits héroïques de ce capitaine, vous serez embarrassé de me nommer un homme qui lui soit comparable.
Du tems de ce héros, Athènes étoit si convaincue de la prééminence des Lacédémoniens, qu'elle n'hésita point à leur céder le commandement de l'armée des Grecs. Thémistocle servit sous Eurybiades, qui gagna sur les Perses la bataille navale de Salamine. Pausanias en triompha de nouveau à la journée de Platée, porta ses armes dans l'Hellespont, & s'empara de Bisance. Le seul Epaminondas Thébain, eut la gloire, long-tems après, de vaincre les Lacédémoniens à Leuctres & à Mantinée, & de leur ôter l'empire de la Grece qu'ils avoient conservé l'espace de 730 ans.
Les Romains s'étant rendus maîtres de toute l'Achaïe, n'imposerent aux Lacédémoniens d'autre sujetion que de fournir des troupes auxiliaires quand Rome les en solliciteroit. Philostrate raconte qu'Apollonius de Thyane qui vivoit sous Domitien, se rendit par curiosité à Lacédémone, & qu'il y trouva encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enfin la réputation de la bravoure des Spartiates continua jusques dans le bas-empire.
Les Lacédémoniens se conserverent l'estime des empereurs de Rome, & éleverent des temples à l'honneur de Jules-César & d'Auguste, de qui ils avoient reçus de nouveaux bienfaits. Ils frapperent aussi quelques médailles aux coins d'Antonin, de Marc-Aurele & de Commode. M. Vaillant en cite une de Néron, parce que ce prince vint se signaler aux jeux de la Grece ; mais il n'osa jamais mettre le pié dans Sparte, à cause de la sévérité des lois de Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, dit-on, que des furies d'Athènes.
Cependant quelle différence entre ces deux peuples ! vainement les Athéniens travaillerent à ternir la gloire de leurs rivaux & à les tourner en ridicule de ce qu'ils ne cultivoient pas comme eux les lettres & la Philosophie. Il est aisé de vanger les Lacédémoniens de pareils reproches, & j'oserai bien moi-même l'entreprendre, si on veut me le permettre.
J'avoue qu'on alloit chercher à Athènes & dans les autres villes de Grece des rhétoriciens, des peintres & des sculpteurs, mais on trouvoit à Lacédémone des législateurs, des magistrats & des généraux d'armées. A Athènes on apprenoit à bien dire, & à Sparte à bien faire ; là à se démêler d'un argument sophistique, & à rabattre la subtilité des mots captieusement entrelacés ; ici à se démêler des appas de la volupté, & à rabattre d'un grand courage les menaces de la fortune & de la mort. Ceux-là, dit joliment la Montagne, s'embesognoient après les paroles, ceux-ci après les choses. Envoyez-nous vos enfans, écrivoit Agésilaüs à Xénophon, non pas pour étudier auprès de nous la dialectique, mais pour apprendre une plus belle science, c'est d'obéir & de commander.
Si la Morale & la Philosophie s'expliquoient à Athènes, elles se pratiquoient à Lacédémone. Le spartiate Panthoidès le sut bien dire à des Athéniens, qui se promenant avec lui dans le Lycée, l'engagerent d'écouter les beaux traits de morale de leurs philosophes : on lui demanda ce qu'il en pensoit, ils sont admirables, repliqua-t-il, mais au reste inutiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait aucun usage.
Voulez-vous un fait historique qui peigne le caractere de ces deux peuples, le voici. " Un vieillard, au rapport de Plutarque, cherchoit place à un des spectacles d'Athènes, & n'en trouvoit point ; de jeunes Athéniens le voyant en peine, lui firent signe ; il s'approche, & pour lors il se serrerent & se moquerent de lui : le bon homme faisoit ainsi le tour du théâtre, toûjours hué de la belle jeunesse. Les ambassadeurs de Sparte s'en apperçurent, & aussi-tôt placerent honorablement le vieillard au milieu d'eux. Cette action fut remarquée de tout le monde, & même applaudie d'un battement de mains général. Hélas, s'écria le bon vieillard d'un ton de douleur, les Athéniens savent ce qui est honnête, mais les Lacédémoniens le pratiquent " !
Ces Athéniens dont nous parlons, abuserent souvent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la regarderent toûjours comme l'image de l'action.
Chez eux, il n'étoit permis de dire un bon mot qu'à celui qui menoit une bonne vie. Lorsque dans les affaires importantes, un homme de mauvaise réputation donnoit un avis salutaire, les éphores respectoient la proposition ; mais ils empruntoient la voix d'un homme de bien pour faire passer cet avis ; autrement le peuple ne l'auroit pas autorisé. C'est ainsi que les magistrats accoutumerent les Spartiates à se laisser plutot persuader par les bonnes moeurs, que par toute autre voie.
Ce n'étoit pas chez eux que manquoit le talent de manier la parole : il regne dans leurs discours & dans leurs reparties une certaine force, une certaine grandeur, que le sel attique n'a jamais su mettre dans toute l'éloquence de leurs rivaux. Ils ne se sont pas amusés comme les citoyens d'Athènes, à faire retentir les théatres de satyres & de railleries ; un seul bon mot d'Eudamidas obscurcit la scene outrageante de l'Andromaque. Ce lacédémonien se trouvant un jour dans l'Académie, & découvrant le philosophe Xénocrate déja fort âgé, qui étudioit la Philosophie, demanda qui étoit ce vieillard. C'est un sage, lui répondit-on, qui cherche la vertu. Eh quand donc en usera-t-il s'il la cherche encore, repartit Eudamidas ? Mais aussi les hommes illustres d'Athènes étoient les premiers à préférer la conduite des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles.
Il est très-plaisant de voir Socrate se moquant à sa maniere d'Hippias, qui lui disoit qu'à Sparte, il n'avoit pas pu gagner un sol à régenter ; que c'étoient des gens sans goût qui n'estimoient ni la grammaire, ni le rythme, s'amusant à étudier l'histoire & le caractere de leurs rois, l'établissement & la décadence des états, & autres choses de cette espece. Alors Socrate sans le contredire, lui fait avouer en détail l'excellence du gouvernement de Sparte, le mérite de ses citoyens, & le bonheur de leur vie privée, lui laissant à tirer la conclusion de l'inutilité des arts qu'il professoit.
En un mot, l'ignorance des Spartiates dans ces sortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de stupidité, mais de préceptes, & Platon même en demeuroit d'accord. Cependant malgré l'austérité de leur politique, il y a eu de très-beaux esprits sortis de Lacédémone, des philosophes, des poëtes célebres, & des auteurs illustres, dont l'injure des tems nous a dérobé les ouvrages. Les soins que se donna Lycurgue pour recueillir les oeuvres d'Homere, qui seroient perdues sans lui ; les belles statues dont Sparte étoit embellie, & l'amour des Lacédémoniens pour les tableaux de grands maîtres, montrent qu'ils n'étoient pas insensibles aux beautés de tous les Arts.
Passionnés pour les poésies de Terpandre, de Spendon, & d'Alcman, ils défendirent à tout esclave de les chanter, parce que selon eux, il n'appartenoit qu'à des hommes libres de chanter des choses divines.
Ils punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux sept cordes de la Musique il en avoit ajouté quatre autres ; mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la mollesse de cette nouvelle harmonie n'altérât la sévérité de leurs moeurs. En même tems ils admirerent le génie de l'artiste ; ils ne brûlerent pas sa lyre, au contraire ils la suspendirent à la voûte d'un de leurs plus beaux bâtimens où l'on venoit prendre le frais, & qui étoit un ouvrage de Théodore de Samos. Ils chasserent aussi le poëte Archiloque de Sparte ; mais c'étoit pour avoir dit en vers, qu'il convenoit mieux de fuir & de sauver sa vie, que de périr les armes à la main. L'exil auquel ils le condamnerent ne procédoit pas de leur indifférence pour la poésie, mais de leur amour pour la valeur.
C'étoit encore par des principes de sagesse que l'architecture de leurs maisons n'employoit que la coignée & la scie. Un Lacédémonien, je puis le nommer, c'étoit le roi Léotichidas, qui soupant un jour à Corinthe, & voyant dans la salle où on le reçut, des pieces de bois dorées & richement travaillées, demanda froidement à son hôte, si les arbres chez eux croissoient de la sorte ; cependant ces mêmes Spartiates avoient des temples superbes. Ils avoient aussi un magnifique théatre qui servoit au spectacle des exercices, des danses, des jeux, & autres représentations publiques. La description que Pausanias a faite des décorations de leurs temples & de la somptuosité de ce théatre, prouve assez que ce peuple savoit étaler la magnificence dans les lieux où elle étoit vraiment convenable, & proscrire le luxe des maisons particulieres où son éclat frivole ne satisfait que les faux besoins de la vanité.
Mais comme leurs ouvriers étoient d'une industrie, d'une patience, & d'une adresse admirable, ils porterent leurs talens à perfectionner les meubles utiles, & journellement nécessaires. Les lits, les tables, les chaises des Lacédémoniens étoient mieux travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie étoit plus belle & plus agréable ; on vantoit en particulier la forme du gobelet laconique nommé cothon, sur-tout à cause du service qu'on en tiroit à l'armée. La couleur de ce gobelet, dit Critias, cachoit à la vûe la couleur dégoutante des eaux bourbeuses, qu'on est quelquefois obligé de boire à la guerre ; les impuretés se déposoient au fond de ce gobelet, & ses bords quand on buvoit arrêtoient en-dedans le limon, ne laissant venir à la bouche que l'eau pure & limpide.
Pour ce qui regarde la culture de l'esprit & du langage, les Lacédémoniens loin de la négliger, vouloient que leurs enfans apprissent de bonne heure à joindre la force & l'élégance des expressions, à la pureté des pensées. Ils vouloient, dit Plutarque, que leurs réponses toûjours courtes & justes, fussent pleines de sel & d'agrément. Ceux qui par précipitation ou par lenteur d'esprit, répondoient mal, ou ne répondoient rien, étoient châtiés : un mauvais raisonnement se punissoit à Sparte, comme une mauvaise conduite ; aussi rien n'en imposoit à la raison de ce peuple. " Un lacédémonien exemt dès le berceau des caprices & des humeurs de l'enfance, étoit dans la jeunesse affranchi de toute crainte ; moins superstitieux que les autres grecs, les Spartiates citoient leur religion & leurs rits au tribunal du bon sens ". Aussi Diogène arrivant de Lacédémone à Athènes, répondit avec transport à ceux qui lui demandoient d'où il venoit : " je viens de quitter des hommes "
Tous les peuples de la Grece avoient consacré des temples sans nombre à la Fortune ; les seuls Lacédémoniens ne lui avoient dressé qu'une statue, dont ils n'approchoient jamais : ils ne recherchoient point les faveurs de cette déesse, & tâchoient par leur vertu de se mettre à l'abri de ses outrages.
S'ils n'étoient pas toûjours heureux,
Ils savoient du-moins être sages.
On sait ce grand mot de l'antiquité, Spartam nactus es, hanc orna : " vous avez rencontré une ville de Sparte, songez à lui servir d'ornement ". C'étoit un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans les occasions importantes à se regler pour remplir l'attente publique sur les sentimens & sur la conduite des Spartiates. Quand Cimon vouloit détourner ses compatriotes de prendre un mauvais parti : " pensez bien, leur disoit-il, à celui que suivroient les Lacédémoniens à votre place ".
Voilà quel étoit le lustre de cette république célebre, bien supérieure à celle d'Athènes ; & ce fut le fruit de la seule législation de Lycurgue. Mais, comme l'observe M. de Montesquieu, quelle étendue de génie ne fallut-il pas à ce grand homme, pour élever ainsi sa patrie ; pour voir qu'en choquant les usages reçus, en confondant toutes les vertus, il montreroit à l'univers sa sagesse ! Lycurgue mêlant le larcin avec l'esprit de justice, le plus dur esclavage avec la liberté, des sentimens atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité aux fondemens de sa ville, tandis qu'il sembloit lui enlever toutes les ressources, les Arts, le Commerce, l'argent, & les murailles.
On eut à Lacédémone, de l'ambition sans espérance d'être mieux ; on y eut les sentimens naturels : on n'y étoit ni enfant, ni pere, ni mari ; on y étoit tout à l'état. Le beau sexe s'y fit voir avec tous les attraits & toutes les vertus ; & cependant la pudeur même fut ôtée à la chasteté. C'est par ces chemins étranges, que Lycurgue conduisit sa Sparte au plus haut degré de grandeur ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu'on n'obtint jamais rien contr'elle en gagnant des batailles. Après tous les succès qu'eut cette république dans ses jours heureux, elle ne voulut jamais étendre ses frontieres : son seul but fut la liberté, & le seul avantage de sa liberté, fut la gloire.
Quelle société offrit jamais à la raison un spectacle plus éclatant & plus sublime ! Pendant sept ou huit siecles, les lois de Lycurgue y furent observées avec la fidélité la plus religieuse. Quels hommes aussi estimables que les Spartiates, donnerent jamais des exemples aussi grands, aussi continuels, de modération, de patience, de courage, de tempérance, de justice & d'amour de la patrie ? En lisant leur histoire, notre ame s'éleve, & semble franchir les limites étroites dans lesquelles la corruption de notre siecle retient nos foibles vertus.
Lycurgue a rempli ce plan sublime d'une excellente république que se sont fait après lui Platon, Diogène, Zénon, & autres, qui ont traité cette matiere ; avec cette différence, qu'ils n'ont laissé que des discours ; au lieu que le législateur de la Laconie n'a laissé ni paroles, ni propos ; mais il a fait voir au monde un gouvernement inimitable : & a confondu ceux qui prétendroient que le vrai sage n'a jamais existé. C'est d'après de semblables considérations, qu'Aristote n'a pu s'empêcher d'écrire, que cet homme sublime n'avoit pas reçu tous les honneurs qui lui étoient dus, quoiqu'on lui ait rendu tous les plus grands qu'on puisse jamais rendre à aucun mortel, & qu'on lui ait érigé un temple, où du tems de Pausanias, on lui offroit encore tous les ans des sacrifices comme à un dieu.
Quand Lycurgue vit sa forme de gouvernement solidement établie, il dit à ses compatriotes qu'il alloit consulter l'oracle, pour savoir s'il y avoit quelques changemens à faire aux lois qu'il leur avoit données ; & qu'en ce cas, il reviendroit promtement remplir les decrets d'Apollon. Mais il résolut dans son coeur de ne point retourner à Lacédémone, & de finir ses jours à Delphes, étant parvenu à l'âge où l'on peut quitter la vie sans regret. Il termina la sienne secrettement, en s'abstenant de manger ; car il étoit persuadé que la mort des hommes d'état doit servir à leur patrie, être une suite de leur ministere, & concourir à leur procurer autant ou plus de gloire, qu'aucune autre action. Il comprit qu'après avoir exécuté de très-belles choses, sa mort mettroit le comble à son bonheur, & assureroit à ses citoyens les biens qu'il leur avoit faits pendant sa vie, puisqu'elle les obligeroit à garder toûjours ses ordonnances, qu'ils avoient juré d'observer inviolablement jusqu'à son retour.
Dicearque, que Cicéron estimoit à un point singulier, composa la description de la république de Sparte. Ce traité fut trouvé à Lacédémone même, si beau, si exact, & si utile, qu'il fut décidé par les magistrats, qu'on le liroit tous les ans en public à la jeunesse. La perte de cet ouvrage est sans-doute très-digne de nos regrets ; il faut pourtant nous en consoler par la lecture des anciens historiens qui nous restent ; sur-tout par celle de Pausanias & de Plutarque, par les recueils de Meursius, de Cragius, & de Sigonius, & par la Lacédémone ancienne & moderne de M. Guillet, livre savant & très-agréablement écrit. (D.J.)
|
| LACER | v. act. (Gramm. & art méchan.) c'est serrer ou fermer avec un lacet ; on lace un corps en passant un lacet dans les oeillets percés sur ses bords à droite & à gauche. On lace une voile en la saisissant avec un quarantenier qui passe dans les yeux du pié & qui l'attache à la vergue, lorsqu'on est surpris de gros tems, & qu'il n'y a point de garcelles au ris. On fait lacer ses lices par de bons chiens, c'est-à-dire couvrir, &c. Quand une lice lacée a retenu, on dit qu'elle est nouée.
|
| LACERATION | S. f. (Jurisprud.) en termes de Palais, signifie le déchirement de quelque écrit ou imprimé. Quand on déclare nulles des pieces qui sont reconnues fausses, on ordonne qu'elles seront lacérées par le greffier : quand on supprime quelque écrit ou imprimé scandaleux ou injurieux à quelque personne ou compagnie constituée en dignité, on ordonne qu'il sera lacéré par l'exécuteur de la haute-justice, & ensuite brûlé. (A)
|
| LACERNE | S. f. lacerna, lacernum, (Littér.) nom d'une sorte d'habit ou de capote des Romains ; j'en ai déja parlé au mot habit des Romains ; j'ajoute ici quelques particularités moins connues.
La lacerne étoit une espece de manteau qu'on mettoit par-dessus la toge, & quand on quittoit cette robe, par-dessus la tunique ; on l'attachoit avec une agraffe sur l'épaule, ou par-devant. Elle étoit d'abord courte, ensuite on l'allongea. Les pauvres en portoient constamment pour cacher leurs haillons, & les riches en prirent l'usage pour se garantir de la pluie, du mauvais tems, ou du froid aux spectacles, comme nous l'apprenons de Martial.
Amphitheatrales nos commendamur ad usus,
Quùm tegit algentes nostra lacerna togas.
L'usage des lacernes étoit fort ancien dans les armées de Rome ; tous les soldats en avoient. Ovide, liv. II. des Fastes, v. 745, nous apprend que Lucrèce pressoit ses esclaves d'achever la lacerne de son mari Collatinus, qui assiégeoit Ardée.
Mittendo est domino, nunc nunc properate, puellae,
Quà primùm nostrâ facta lacerna manu.
Mais sur la fin de la république, la mode s'en établit à la ville comme à l'armée ; & cette mode dura pour les grands jusqu'aux regnes de Gratien, de Valentinien & de Théodose ; qui défendirent aux sénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en servoient même le soir, & dans certains rendez-vous de galanterie, la clara lacerna d'Horace, satyr. VII. liv. II. v. 48, c'est-à-dire le manteau transparent, vaut tout autant pour la leçon du texte, que la clara lucerna, la lampe allumée de Lambin.
Il y avoit des lacernes à tout prix. Martial parle de quelques-unes qu'on achetoit jusqu'à dix mille sexterces. Enfin si vous êtes curieux d'épuiser vos recherches sur ce sujet, voyez les auteurs de re vestiariâ Romanorum, & Saumaise dans ses notes sur Spartien & sur Lampridius. (D.J.)
|
| LACERT | dracunculus, s. m. (Hist. nat. Lytholog.) poisson de mer ainsi nommé parce qu'il ressemble en quelque façon à un lésard. Sa longueur est d'un pié ; il a le museau pointu, la tête grande, large, applatie, & la bouche petite. Au lieu d'une fente à l'endroit des ouies, il y a au-dessous de la tête deux trous qui y suppléent, un de chaque côté. Les yeux sont aussi placés sur la face supérieure de la tête, les nageoires sont en partie de couleur d'or, & en partie de couleur d'argent ; celles qui se trouvent au-dessous des nageoires voisines des ouies, ont plus de longueur, & sont placées fort près de la bouche. Le dos a deux nageoires : la premiere est fort petite, & de couleur d'or, avec des traits de couleur d'argent : la seconde est très-longue, & terminée par cinq pointes ; il se trouve au-delà de l'anus une nageoire dorée dans toute son étendue, excepté le bord qui est noir ; le corps a peu de diametre ; la queue a une nageoire très-longue, & noire sur le bord ; la couleur du dos est d'un jaune verdâtre ; les côtés ont de petites taches argentées & bleuâtres ; le ventre est blanc, large, plat, & revêtu seulement d'une peau déliée ; la chair du lacert a beaucoup de rapport à celle du goujon. On voit des lacerts à Gênes & à Rome. Voyez Rond. Hist. des poissons, liv. X. Voyez POISSON.
|
| LACET | S. m. (Art, mécan.) petit cordon ferré par les deux bouts ; qui sert à quelques vêtemens des femmes ou des enfans, & à d'autres usages ; il y a des lacets ronds, des lacets plats, & des lacets de fil & de soie.
Des lacets de fil. On fait avec le fil deux sortes de lacets, les uns de fil de plain, & les autres de fil d'étoupes ; le fil de plain qui provient du chanvre, qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme mâle, parce que c'est le chanvre le plus fort, sert à la fabrique des meilleurs lacets, & ne s'emploie jamais qu'en blanc, parce que ces lacets étant plus fins & plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens aisés ; le fil d'étoupes qui est fait des matieres grossieres qui restent après que le frotteur a tiré la meilleure filasse, tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour la fabrique des lacets d'étoupes que l'on teint de différentes couleurs, parce que les gens de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui est apparent ; mais la vraie raison est que la teinture altere beaucoup moins le fil d'étoupes que le blanchissage, qui en abrege considérablement la durée. On fait cependant blanchir la sixieme partie du fil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs dont il sera parlé ci-après ; on teint tout le reste, mais la moindre partie en rouge avec le bois de Bresil & l'alun, & le surplus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de-gris.
Du rouet. Le fil étant blanchi on le devide en bobines sur un rouet ordinaire, tel qu'on le voit à la Planche I. fig. 1. Ce rouet A est composé d'une roue B, de deux montans C qui l. soutiennent, d'une piece de bois D qui sert d'empatement à toute la machine, & de quatre morceaux de bois qui servent de pié pour élever cette piece de bois, au bout de laquelle il y a une espece de coffre E dans lequel on met la bobine F sur laquelle on doit devider le fil. Cette bobine tourne sur son axe, par le moyen d'une broche de fer G, qui parcourt toute la longueur du coffre : cette broche traverse les deux bouts du coffre. Voyez la bobine séparée de cette broche, Planche III. fig. 1. Cette bobine tourne sur elle-même par le moyen d'une petite poulie qui est fixée sur elle, & la corde de boyau passant sur cette poulie, la fait tourner avec la broche. A deux piés de distance se trouve un devidoir H sur lequel le fil qu'on doit devider doit être mis. Ce qui étant disposé comme on le voit à la Planche I. fig. 1. on commence par tirer de la main droite du fil du devidoir, lequel étant parvenu au rouet, on l'attache sur la bobine, l'ouvrier tourne de la main gauche la roue qui par son mouvement fait tourner la broche, & de la droite il tient toujours le fil qu'il dirige & entasse sur la bobine.
Du tri. Le fil étant dévidé sur plusieurs bobines, on les met sur un tri, Planche I. fig. 2. qui est au bas du métier à lacets. Ce tri A est composé de quatre petites colonnes B B B B rangées en ligne droite, & enclavées sur le marche-pié du métier à lacets ; elles sont arrêtées dans le haut par une petite traverse qui les embrasse & leur sert de chapiteau. Ces colonnes sont hautes d'un pié & demi, & éloignées d'un demi-pié l'une de l'autre, elles sont percées sur leur hauteur, à distance égale de quatre pouces. On passe dans ces trous des petites broches de fer dans lesquelles on fait passer des bobines, & on en met entre les colonnes le nombre dont on a besoin, ce qui ne va qu'à trois ou quatre. Voyez Planche I. fig. 2.
Du métier à lacet, Planche I. fig. 3. il est composé de deux colonnes A A, d'un demi-pié d'équarissage, hautes de trois piés chacune. Elles sont soutenues par deux petites pieces de bois B B, longues de deux piés, qui sont couchées, & dans lesquelles sont enclavées les deux colonnes : elles sont éloignées l'une de l'autre de trois piés, & arrêtées dans le bas par deux planches C C, qui sont clouées de chaque côté des colonnes, sur les deux pieces de bois sur lesquelles on met deux poids pesans chacun cent livres ou environ. Voyez ces poids mis séparément, Planche I. fig. 6. A A. Ces deux colonnes soutiennent une traverse D qui est percée à distance égale de vingt-quatre trous F, sur une ligne droite, & de douze autres E rangés également sur une seconde ligne, à l'opposite des vingt-quatre premiers, où l'on place les fers à crochet. Planche III. fig. 2.
Du fer à crochet. Le fer à crochet Planche II. fig. 1. est une manivelle qui sert à tordre le lacet. A en est la poignée, B le coude, C un bouton qui appuie contre la traverse du métier, D le bout du fer à crochet qui ayant passé par la traverse, Planche III. fig. 3. est recourbé à la pointe ; c'est au bout de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordre. Derriere cette traverse E, il s'en trouve une autre F, de même longueur, qui est attachée aux deux bouts par deux petits cordons à la premiere traverse, & qui étant percée d'autant de trous que la premiere, reçoit le bout des fers à crochet, & les fait tourner tous ensemble. On observe que cette seconde traverse n'est attachée que foiblement, afin qu'elle puisse se prêter au mouvement. Derriere ce métier est une escabelle C, Planche I. fig. 2. où s'assied l'ouvrier.
Du chariot. Le chariot, Planche I. fig. 4. est un second métier à lacet, qui se met à l'opposite du premier. Il est composé d'un montant A, arrêté par deux goussets montés sur deux roulettes, & terminé au-dessous par une traverse B pareille à celle du premier métier, laquelle est percée de douze trous qui répondent aux douze autres trous de la seconde ligne, Planche III. fig. 4. du premier métier. Il y a derriere cette traverse, comme à celle du premier métier, une autre double traverse C, que les Fabriquans appellent la poignée, Planche III. fig. 5. qui étant percée d'autant de trous que cette premiere traverse, reçoit les fers à crochet, comme je l'ai dit dans celle du premier métier. Cette seconde traverse du chariot sert à accélérer le mouvement des fers à crochet : en les faisant tourner en sens contraire, Planche I. fig. 7. de ceux du premier métier, & par ce moyen on parvient à accélérer du double le tortillement des lacets. On met sur ce second métier un poids A de cent livres pesant, ou environ, pour arrêter la force de l'ourdissement du lacet, qui ne doit se faire sentir qu'imperceptiblement.
Connoissant à présent la disposition du métier à lacet, & les instrumens qu'on y emploie, il faut expliquer comment on le fabrique. On commence à placer le premier métier au bout d'une chambre, voyez Pl. II. figure 1. que l'on rend solide par deux poids A A de cent livres chacun, qui se placent de chaque côté des colonnes, afin qu'il puisse supporter tout l'effort de l'ourdissement des lacets. On met à l'autre bout de la même chambre le second métier, que l'on appelle le chariot B, qu'il faut éloigner du premier métier, en ligne droite, de treize piés, quoique la longueur du lacet ne doive être que d'onze. Car il faut observer que quand les fils ont acquis un certain degré de force élastique par le tortillement, le lacet fait effort pour tourner dans la main de l'ouvrier ; c'est par cette raison qu'on a mis deux roulettes au métier appellé le chariot, qui étant tiré par l'effort que fait le lacet en s'ourdissant, diminue la grandeur que l'on a donné aux fils, en se retirant à mesure que le lacet s'ourdit. On commence ensuite par tirer le fil des bobines C, qui sont placées au bas du premier métier, comme je l'ai déja dit ci-dessus ; & réunissant les trois fils des trois bobines en un seul, l'ouvrier accroche par un noeud ce triple fil au premier fer à crochet de la premiere rangée du premier métier ; il va ensuite accrocher ce même triple fil au premier fer à crochet du second métier appellé le chariot. Ce triple fil est destiné à faire la premiere partie des neufs fils dont le lacet doit être composé. Cela fait, il revient attacher un second triple fil au premier crochet de la seconde rangée, opposé à celui où il a attaché le premier, & va l'arrêter sur le même crochet du chariot sur lequel il a déja attaché le premier triple fil. Ensuite il revient au premier métier, & accroche un troisieme triple fil au second crochet de la seconde rangée ; il retourne l'attacher sur le même crochet du chariot où il a déja attaché les deux autres ; ce qui forme une espece de triangle. Il faut avoir attention que les fils que l'on tire des trois bobines pour n'en former qu'un seul, doivent être de même longueur, de même grosseur & avoir une égale tension. Cette opération étant faite sur les trente-six fers à crochet dont le premier métier est composé, & sur les douze fers à crochet du second métier, l'ouvrier commence par tourner pendant un demi-quart d'heure environ, la double traverse du premier métier, laquelle, par son mouvement, fait tourner tous les fers à crochet de gauche à droite, jusqu'à ce que les neuf fils dont chaque lacet est composé, soient ourdis en trois parties.
Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier prend un instrument que l'on appelle le sabot ; voy. Pl. I. fig. 5. où il est placé entre la premiere & la seconde rangée des fers à crochet D du premier métier ; il tourne la double traverse de ce métier pendant cinq minutes, cette traverse faisant agir tous les fers à crochet, ourdit chacun des trois fils en son particulier, & par ce mouvement le sabot A s'avance peu-à-peu du côté du chariot. Quand il y est arrivé, l'ouvrier l'arrête avec une ficelle, qui doit être attachée au milieu du chariot ; ensuite il reprend la double traverse du premier métier, & tournant encore quelques tours, il détache le sabot ; puis faisant tourner la traverse du premier métier pendant qu'une autre main fait tourner celle du chariot, le mouvement qui se fait du côté du chariot, éloigne le sabot, & le renvoie du côté du premier métier ; mais il faut que l'ouvrier qui est du côté du chariot ait soin, pendant qu'il tourne d'une main, de diriger le sabot avec l'autre main, au moyen d'un bâton fourchu, Pl. III. fig. 3. parce que ce sabot se trouve quelquefois arrêté par des noeuds qui se rencontrent dans les fils. On se sert aussi d'un autre bâton crochu, fig. 4, pour l'arrêter lorsqu'il s'éloigne trop vîte. Ce sabot, en s'éloignant, glisse entre les fils jusqu'au premier métier par le mouvement du second métier. La traverse du chariot faisant mouvoir les douze fers à crochet du second métier dont elle est composée, réunit en un seul les trois fils que contient chaque fer à crochet en se roulant les uns sur les autres ; mais il faut observer que pendant cette seconde opération, c'est-à-dire pendant que le lacet s'ourdit, il continue de se raccourcir, & le chariot B remonte d'environ deux piés. Quelquefois il arrive que plusieurs fers à crochet s'embarrassent en tournant, par le frottement qui se fait contre la traverse : c'est à quoi il faut bien prendre garde ; on peut y remédier en prenant soin de les frotter de tems en tems d'huile d'olive, qu'il faut avoir auprès de soi dans un vaisseau ; voyez la Pl. III. fig. 10. Toute l'opération que les ouvriers du pays appellent un tirage, se fait en un quart-d'heure.
Le lacet étant ourdi, on le cire avec un torchon ciré, & on le détache des fers à crochet du métier. On rassemble ces lacets en grosse ; voyez Planche III. fig. 6. La grosse de lacets est composée de douze douzaines, ou de 144 lacets : ceux de fil de plain doivent être garnis de neufs fils, & ceux d'étoupes de six. La grosse de lacets de fils d'étoupes mise en couleur, est composée de 18 lacets blancs, de 18 mêlés de rouge & de blanc, de 36 mêlés de bleu & de blanc, & de 72 entierement bleus. On fabrique des lacets de cinq longueurs, d'une demi-aune, de trois quarts, d'une aune, d'une aune & demie & de trois aunes, qui est la plus grande longueur qu'on puisse leur donner. On en fait d'un seul tirage une douzaine de ceux de trois aunes, deux douzaines de ceux d'une aune, quatre douzaines de ceux de trois quarts, & six douzaines de ceux d'une demi-aune.
Du fer à lacet. Les lacets étant rassemblés en grosse, on les garnit aux deux bouts d'un morceau de fer-blanc, Pl. III. fig. 7. La grosse de lacets d'une aune de long & au-dessous, doit avoir à chaque bout une garniture de fer-blanc de huit lignes de longueur ; celle de trois quarts d'aune, de cinq lignes, & celle d'une demi-aune, de trois lignes. On peut, avec une feuille de fer-blanc ordinaire, garnir trois grosses de lacets ; mais on ne se sert que des retailles des Lanterniers, qui sont à très-bon marché.
On coupe le fer-blanc avec des cisailles, qui sont attachées sur une table, Pl. III. fig. 8, au moyen d'une broche de fer qui les soutient dans la position où il faut qu'elles soient pour ce travail.
Le fer à lacet étant taillé, on le plie ; voyez Planche III. figure 9. L'ouvrier étant assis, tient de la main droite un marteau, & de la main gauche une broche de fer ; voyez cette broche Pl. III. fig. 7. Sous cette broche qu'il tient de la main gauche, il met un des morceaux de fer-blanc taillé, qu'il soutient avec le second doigt de la même main. Il pose le tout ensemble sur l'une des cannelures dont la petite enclume A est garnie sur sa largeur ; voyez fig. 9. L'ouvrier, avec un marteau dont le manche n'a que la longueur qu'il faut pour l'empoigner, frappe légerement sur la broche deux ou trois coups, qui font prendre au fer la forme de la cannelure ; & pour donner à ce fer une demi-rondeur suffisante, il soutient toujours le bout du fer avec le bout du second doigt de la main gauche ; & en le faisant un peu tourner de côté & d'autre, il frappe quelques coups qui achevent de donner au fer-blanc la voussure suffisante. Il y a ordinairement deux cases sur l'établi, l'une pour mettre les morceaux de fer-blanc qui sont plats, & l'autre pour les déposer, à mesure qu'ils sont pliés.
Lorsqu'il est question de ferrer le lacet, l'ouvrier prend une grosse de lacets, qu'il attache sur une petite table garnie d'une enclume, Pl. III. fig. 10. le tout pareil à la table qui sert à plier les fers, & qui peut servir aussi à ce double travail. Il prend l'un des lacets, qu'il tient de la main gauche ; il prend de l'autre main un fer plié, dans lequel il fait entrer le bout du lacet. Il applique l'un avec l'autre sur l'une des cannelures de l'enclume. Il frappe un premier coup pour adapter le fer au lacet ; puis tournant le bout du lacet avec ce fer, il arrondit & assujettit le fer au lacet, en donnant quelques coups avec le marteau.
A onze ou douze ans les jeunes gens sont assez forts pour tourner le métier à lacet, & les enfans de huit ans peuvent plier le fer-blanc & l'appliquer aux lacets. Un ouvrier dans la force de l'âge, ou ce que l'on appelle un bon ouvrier, fait par jour ses dix grosses de lacets d'une aune de long, mais un petit apprentif, ou un foible ouvrier, n'en fait que huit. Un seul homme en un jour coupe assez de fer-blanc pour la garniture de 80 grosses de lacets.
Mémoire sur la fabrique des lacets. 1re Question : Combien se vend le fil, & de quelle qualité on l'emploie pour les lacets. REPONSE. On distingue trois sortes de fil, le fil fin, le fil de plain & le fil d'étoupes, Le fil fin est celui qui provient du meilleur chanvre, improprement appellé femelle, que l'on recueille le premier ; mais on n'emploie point ce fil pour les lacets. Le fil de plain, qui provient du chanvre qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme le mâle, apparemment parce que c'est le plus fort, sert à la fabrique des meilleurs lacets : il coûte ordinairement quinze sols la livre. Le fil d'étoupes, qui est fait des matieres grossieres qui restent après que le frotteur a tiré la meilleure filasse, tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour la fabrique des lacets de couleur, & coûte communément neuf sols la livre.
II. Si les fabriquans achetent le chanvre pour le faire frotter & filer, ou s'ils achetent le fil tout fait, & s'ils le font blanchir ou teindre. REP. Ils achetent le fil tout fait, & ils font toujours blanchir le fil de plain, qui ne s'emploie jamais qu'en blanc pour faire les meilleurs lacets. Le fil d'étoupes ne sert jamais qu'à faire des lacets de couleur : on n'en fait blanchir qu'environ la sixieme partie, pour faire un mélange de couleurs dont il sera parlé ci-après, & on teint tout le reste, mais la moindre partie en rouge avec le bois du Brésil & l'alun, & le surplus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de-gris.
III. Si les fabriquans font eux mêmes le blanchissage & la teinture du fil. REP. Les fabriquans teignent le fil par eux-mêmes, mais ils font faire tous leurs blanchissages au village de Marmagne, à une petite demi-lieue de Montbard, où il y a une blanchisserie renommée.
IV. Ce qu'il en coûte pour le blanchissage & pour la teinture du fil. REP. Il en coûte un sol de blanchissage par écheveau de fil, & chaque écheveau pese communément une demi-livre. La teinture en rouge coûte deux sols six deniers par livre de fil ; & en bleu, un sol six deniers, outre la peine, que l'on compte pour rien, attendu que les petits fabriquans qui n'ont pas de fonds pour leur commerce, peuvent teindre le fil à mesure qu'ils l'achetent, & en toute saison, au lieu qu'il n'y a qu'une saison propre pour le blanchissage, qui exige beaucoup plus de tems. Il ne faut que 24 heures pour teindre, mais pour blanchir il faut six semaines au printems, & jusqu'à trois mois dans l'automne ; ce qui fait que les petits fabriquans sont souvent obligés, par cette seule raison, de faire des lacets de couleur, quoique moins lucratifs & moins de défaite que les blancs. Il résulte que, tout considéré, la livre de fil, soit à blanchir, soit à teindre, coûte deux sols.
V. Ce qu'il en coûte pour devider une livre de fil. REP. On paie aux dévideurs trois deniers par chaque écheveau de fil, ce qui fait six deniers par livre ; les deux écheveaux pesent une livre environ.
VI. De combien de longueurs différentes se font les lacets. REP. On en fabrique de cinq longueurs ; d'une demi-aune, de trois quarts, d'une aune, d'une aune & demie & de trois aunes, qui est la plus grande longueur qu'on puisse leur donner ici. On en fait d'un seul tirage une douzaine de ceux de trois aunes, deux douzaines de ceux d'une aune & demie, trois douzaines de ceux d'une aune, quatre douzaines de ceux de trois quarts, & six douzaines de ceux d'une demi-aune.
VII. De combien de fils chaque lacet est composé, & combien il faut de lacets pour faire une grosse. REP. La grosse de lacets est composée de douze douzaines, ou de 144 lacets : ceux de fil plain doivent être garnis de neuf fils, & ceux d'étoupes de six fils seulement.
VIII. Combien il entre de fil pesant dans une grosse de lacets de chaque qualité. REP. Une grosse de lacets de fil de plain d'une aune de long, consomme dix onces de fil, & il en faut onze onces pour ceux de fil d'étoupes.
IX. Quelle matiere emploie-t-on pour garnir le bout des lacets, & combien cette matiere coûte-t-elle à couper pour la garniture d'une grosse de lacets. REP. On se sert de fer-blanc pour garnir le bout des lacets, & un seul homme coupe en un jour de quoi faire la garniture de 80 grosses ; desorte que, en payant sa journée quatorze sols ; il en coûte deux deniers par grosse.
X. Ce qu'il en coûte pour le fer-blanc de la garniture d'une grosse de lacets. REP. La grosse de lacets d'une aune de long & au-dessus, qui doivent avoir à chaque bout une garniture de fer-blanc de huit lignes de longueur, coûte deux sols pour le prix du fer-blanc qui y entre. La grosse de lacets de trois quarts d'aune, qui doivent être garnis de cinq lignes de fer-blanc, coûte un sol six deniers ; & la grosse de lacets d'une demi-aune, dont la garniture ne doit être que de trois lignes, un sol.
XI. D'où se tire le fer-blanc qui s'emploie à Montbard pour la fabrique des lacets. REP. Le fer-blanc se tire de Lorraine, & il coûte, rendu à Montbard, six sols une feuille de grandeur suffisante pour la garniture de trois grosses de lacets d'une aune de long. Mais il est un moyen de faire une épargne sur cette matiere, en se servant des retailles des Lanterniers. Quelques colporteurs qui viennent prendre ici des lacets, apportent de Lyon des rognures de fer-blanc, qui coûtent, rendues ici, neuf sols la livre, & qui fournissent de quoi garnir six grosses de lacets d'une aune de long ; par ce moyen il y a six deniers à gagner par grosses. Mais quoique ces retailles soient d'une forme avantageuse à la fabrique, puisque ce sont des lisieres coupées quarrément, cependant ce fer-blanc étant plus épais & plus dur que celui de Lorraine, il faut plus de tems & de peine pour le couper, le plier & l'appliquer. Il y a encore un meilleur expédient pour tirer à l'épargne, c'est de prendre les retailles des Lanterniers de Paris, qui ne coûtent que trois sols la livre, & huit deniers de transport. Il est vrai que ces retailles étant de formes irrégulieres, il faut beaucoup plus de tems pour les couper ; mais ce fer-blanc étant de bonne qualité, & y ayant beaucoup de petits fabriquans qui ne craignent pas de perdre en tems ce qu'ils gagnent en argent, la plûpart commencent à prendre le parti de faire venir de Paris des retailles, qui leur font un profit de moitié ; ensorte que ce qui coûtoit deux sols en fer-blanc neuf, ne leur coûte qu'un sol en retailles.
XII. A combien revient la façon d'une grosse de lacets. REP. Une grosse de lacets d'une aune de long & de toute qualité, coûte un sol à tourner sur le métier, & un autre sol pour plier le fer-blanc & l'appliquer à chaque bout du lacet.
XIII. Combien les fabriquans vendent-ils la grosse de lacets de chaque qualité & grandeur. REP. La grosse de fil plain, que l'on façonne toujours en blanc, se vend 20 s. lorsque le lacet n'a qu'une aune de long : 30 s. ceux d'une aune & demie, & 3 l. ceux de trois aunes. La grosse de lacets de fil d'étoupes en couleur, se vend 6 s. lorsque le lacet n'a qu'une demi-aune de long ; 10 s. ceux de trois quarts d'aune ; 15. s. ceux d'une aune ; 18 s. ceux d'une aune & demie, & 36 s. ceux de trois aunes.
XIV. Pourquoi met-on toujours en couleur les lacets de fil d'étoupes, & qu'au contraire on ne teint jamais ceux de fil plain. REP. Les lacets de fil de plain ne se façonnent qu'en blanc ; parce qu'étant plus fins & plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens aisés. Les lacets de fil d'étoupes au contraire, se varient de différentes couleurs, parce que les fabriquans font cette teinture eux-mêmes quand il leur plait, & que les gens de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui est apparent. La meilleure raison, c'est que la teinture altere beaucoup moins le fil d'étoupes que le blanchissage, qui en abrege trop la durée.
XV. Comment se fait le mélange dans une grosse de lacets de fil d'étoupes. REP. La grosse de lacets de couleur est composée ordinairement de 18 lacets blancs, de 18 mêlés de rouge & de blanc, de 36 mêlés de bleu & de blanc, & de 72 entierement bleus.
XVI. Si les ouvriers travaillent à la journée, ou s'ils sont à la tâche. REP. Tous les ouvriers sont à la tâche.
XVII. Si les fabriquans travaillent tous pour leur compte. REP. Tous les fabriquans travaillent pour leur compte.
XVIII. A quel âge les enfans sont-ils propres à être employés aux différentes opérations de la fabrique des lacets. REP. A 11 ou 12 ans les jeunes gens sont assez forts pour tourner le métier à lacets, & les enfans de 8 ans peuvent plier le fer-blanc & l'appliquer aux lacets.
XIX. Combien un ouvrier peut-il tourner de grosses de lacets en un jour. REP. Un ouvrier, dans la force de l'âge, & ce qu'on appelle un bon ouvrier, fait par jour ses dix grosses de lacets d'une aune de long, & un petit apprentif, ou un foible ouvrier, n'en fait que huit.
XX. Où se fait le principal débit des lacets. REP. Il s'en fait un grand débit à de petits colporteurs, qui les vont détailler dans l'Orléanois, l'Auvergne, la Franche-Comté, la Savoie, la Suisse, l'Alsace, la Lorraine, &c. mais le principal débit se fait à quelques marchands flamands, qui viennent en enlever jusqu'à deux mille grosses dans des petites voitures ; & ils viennent ordinairement deux fois par an. Il s'en débite aussi aux villes de la basse Bourgogne, de Nuis, Dijon, Auxerre, & aux foires des voisinages.
XXI. Pourquoi cet espece de commerce a-t-il pris faveur plûtôt à Montbard que nulle autre part. REP. C'est la seule bonne chose qu'ait procuré le voisinage de Sainte-Reine. Il y a bien eu de tout tems à Montbard des fabriquans de lacets qui fournissoient à la consommation du pays ; mais depuis environ 30 ans, les colporteurs qui vont aux apports de Sainte-Reine, s'étant avisé de se fournir à Montbard des lacets dont ils eurent bien leur débit, ils en porterent plus loin, où ils trouverent encore leur profit ; & ainsi de suite ce commerce a toujours augmenté, & a été porté jusqu'en Flandres, où deux raisons lui donnent faveur, le médiocre prix de la matiere, & la façon plus simple de cette marchandise. On cultive beaucoup de chanvre à Montbard & aux environs : c'est la nature de récolte qui donne le plus de revenu. Un journal de cheneviere s'afferme au moins 24 liv. par an, & rapporte tous les ans, sans qu'il soit besoin de le laisser reposer, au lieu qu'une pareille continence de pré, qui passe pour la meilleure nature d'héritage, ne s'afferme au plus par an que 12 liv. Il ne faut qu'un seul coup de labourage à la cheneviere : il est vrai qu'elle exige plus d'engrais que les autres sortes de grains. A l'égard de la façon plus simple des lacets, elle résulte de ce que dans les autres provinces, & surtout en Flandres, tous les lacets s'y font de fil fin, & se façonnent au boisseau ; c'est-à-dire, qu'en fabriquant le lacet, on entremêle les fils les uns dans les autres ; au lieu qu'à Montbard on les façonne à-peu-près comme la ficelle ; & c'est en quelque chose de mieux & de plus exact qu'on s'en écarte. C'est particulierement dans la Flandre allemande qu'il y a des manufactures de lacets façonnés au boisseau : on se sert pour cela de machines à l'eau qui coûtent jusqu'à deux mille écus. Des marchands flamands de qui je tiens ces circonstances, m'ont assuré qu'il n'y avoit point de ces machines en France, & que la plus proche étoit à Comines, à trois lieues au-delà de Lille.
XXII. Ce que gagne le fabriquant sur une grosse de lacets, de profit clair, déduction faite du prix des matieres & de toutes les façons nécessaires. REP. Une grosse de lacets de fil de plain d'une aune de long, coûte.
D'où il résulte que la grosse se vendant vingt sols, il y a quatre sols de profit clair pour le fabriquant.
Une grosse de lacets de fil d'étoupe en couleur d'une aune de long, coûte
La grosse de ces lacets se vend quinze sols ; par conséquent il y a deux sols dix deniers de bénéfice pour le fabriquant.
XXIII. Combien il y a de fabriquans à Montbard, & s'il se fait des lacets aux environs. REP. Il y a dix-huit fabriquans à Montbard, qui font ouvrer environ trente métiers ; mais il ne se fait point de lacets dans tous les environs, si ce n'est à Flavigny, où il y a un seul fabriquant, encore est-il natif de Montbard : mais il ne fait aller qu'un métier, & son commerce ne va pas à deux cent livres par an.
XXIV. Combien il se fabrique de grosses de lacets à Montbard en un an ; & à combien peut-on estimer le produit de ce commerce par année commune. REP. Il sera fort aisé de donner une juste idée de ce commerce, par la combinaison que voici. On compte à Montbard trente métiers à lacets, que je réduis à vingt-quatre, parce qu'il y en a une cinquieme partie que l'on ne fait pas ouvrer continuellement ; chaque métier, s'il étoit en bonne main, pourroit fournir jusqu'à dix grosses de lacets par jour, il en fournit ordinairement huit ; mais je restrains le produit de chaque métier à six grosses par jour seulement à cause du desoeuvrement qui peut être occasionné ; des trois cent soixante-cinq jours dont l'année est composée, j'en retranche quatre-vingt pour les fêtes, & trente pour différens cas de cessation des ouvrages : il reste donc 255 jours de travail, lesquels à raison de six grosses pour chacun, doivent rendre pour un métier quinze cent trente grosses en un an, il s'ensuit que vingt-quatre métiers doivent fournir par an trente-six mille sept cent vingt grosses de lacets d'une aune de long, que l'on peut estimer vingt sols l'une parmi l'autre : d'où il résulte que ce commerce peut s'estimer à trente-six mille sept cent vingt livres par an, que nous réduisons à trente-six mille livres pour éviter les fractions dans le détail que nous allons présenter des différentes parties de consommation de matieres & de produit industriel ; mais pour mieux distinguer tout ce qui profite à l'industrie, je dois observer que pour une livre de fil il faut une livre & demie de chanvre, qui vaut communément quatre sols la livre, le frotteur en fait une livre de filasse, dont la façon coûte trois sols, & cette filasse produit une livre de fil, dont le filage coûte cinq sols ; ensorte que dans les quinze sols que coûte une livre de fil, il y a pour six sols de matiere & pour neuf sols de façon.
On peut conclure de ce détail que les deux tiers du commerce de lacets tourne au profit de l'industrie des habitans de Montbard pour une moitié, & pour l'autre au profit des villages circonvoisins, où se fait le frottage du chanvre, le filage & le blanchissage du fil. (c)
LACET, en terme de Boyaudier, c'est une petite corde qui tient à une cheville, à laquelle on attache un bout du boyau qu'on veut retordre.
LACETS, (Chasse) ce sont plusieurs brins de crin de cheval cordelés ensemble ; il s'en fait de fil de soie ou de fil de fer.
|
| LACETANI | S. m. pl. (Géogr. anc.) ancien peuple d'Espagne. Pline, liv. III. ch. iij. & Tite-Live, liv. XXI. chap. lx. en parlent. Les Lacetani & les Jaccetani de ce dernier historien répondent à une partie du diocèse de Lérida, & à une partie de la nouvelle Catalogne. Voyez le P. Briet & Sanson. (D.J.)
|
| LACHE | adj. (Gramm.) c'est l'opposé de tendu. Une corde est lâche si elle paroît fléchir en quelqu'endroit de sa longueur ; tendue, si elle ne paroît fléchir en aucun point de sa longueur. C'est l'opposé de ferme, & le synonyme de mol ; une étoffe est lâche si elle a été mal frappée ; ferme, si elle est bien fournie de trame. C'est l'opposé d'actif ; un animal est lâche, lorsqu'il se meut nonchalamment & foiblement. C'est l'opposé de serré ; coudre lâche, c'est éloigner ses points, & les faire longs & mous. C'est l'opposé de resserré ; on a le ventre lâche. C'est au figuré l'opposé de brave ; c'est un lâche. Il est synonyme à vil & honteux ; il a fait une action lâche. Celui qui a fait une lâcheté est communément plus méprisé que celui qui a fait une atrocité. On aime mieux inspirer de l'horreur que faire pitié. La trahison est peut-être la plus lâche de toutes les actions. Un stile est lâche lorsqu'il est chargé de mots inutiles, & que ceux qu'on a employés ne peignent point l'idée fortement.
LACHE, (Maréchallerie) cheval lâche. La méthode pour réveiller un cheval naturellement lâche, sourd & paresseux, est de l'enfermer dans une écurie très-obscure, & de l'y laisser durant un mois ou six semaines, sans l'en faire sortir, & de lui donner à manger tant qu'il veut. On prétend que cette maniere de gouverner un cheval lâche, l'éveille & le rend propre à l'exercice. Si on n'en vient pas à bout par-là, il faut avoir recours à la chambriere, à la houssine & à la voix, & si ces aides ne l'animent & ne le réveillent point, il faut le bannir entierement du manege, car c'est un tems perdu que de l'y garder plus long-tems.
LACHE, (Ourdisserie.) se dit de tout ouvrage qui est peu frappé, & par conséquent mal fabriqué, surtout si c'est quelque ouvrage qui demande essentiellement à être frappé. On entend encore par ce mot tout ce qui est lâche dans les soies de la chaîne pendant le travail, au lieu de la tension égale où tout doit être en droit soi.
|
| LACHER | v. act. (Gramm.) c'est abandonner à elle-même une chose retenue par un obstacle. On lâche en écartant l'obstacle. On lâche une pierre & elle tombe. On lâche la corde d'une grue & le poids descend. On lâche un robinet & l'eau coule. On lâche un coup de pistolet, ce qui suppose qu'il étoit armé. On lâche tout sous soi, ce qui suppose une foiblesse dans les intestins ; on lâche un chien après un lievre ; on lâche le mot qui nous démasque ; on lâche prise ; on lâche le pié ; on lâche sa proie ; on lâche la bride ; on lâche la mesure ; on lâche la balle ; on lâche l'autour ; on lâche la main, lorsqu'on vend une chose au-dessous de son prix.
LACHER LA MAIN à son cheval, (Manege) c'est le faire courir de toute sa vîtesse. Lâcher la gourmette, c'est l'accrocher au premier maillon lorsqu'elle serre trop le menton du cheval au second. Voyez GOURMETTE. Lâcher la bride, c'est pousser un cheval, ou le laisser aller à sa volonté.
|
| LACHES | (Ornith.) Voyez HARENGADES.
|
| LACHÉSIS | S. f. (Myth.) Lachésis en latin comme en grec ; une des trois parques. C'est, selon Hésiode, Lachésis qui tient la quenouille, c'est Clotho qui file les commencemens de la vie ; & c'est Atropos qui tient en main les fatals ciseaux pour couper le fil de nos jours. Cependant les Poëtes confondent sans difficulté ces fonctions, & font quelquefois filer Lachésis, comme a fait Juvenal, lib. I. sat. 3. v. 27. en disant, dùm super est Lachésis quod torqueat, pendant que Lachésis a encore de quoi filer, pour dire pendant que nous vivons encore. Lachésis est un mot grec, qui signifie sort, de , sortior, je tire au sort. Le système des Poëtes sur les parques est un des plus ingénieux & des plus féconds en belles images ; il leur a fourni mille pensées brillantes ou philosophiques, qu'on ne peut se lasser de lire dans leurs écrits. Voyez PARQUES. (D.J.)
|
| LACHETÉ | subst. f. (Morale) Voy. LACHE.
|
| LACHRIMA | LACHRIMA
|
| LACHRIME | LACHRIME
|
| LACHRYMA | (LE), adj. (Anat.) se dit de plusieurs parties relatives aux larmes. Voyez LARMES. La grande lachrymale, la glande innominée des anciens & de Warthon est une petite glande, oblongue, située au-dessus de l'oeil près du petit angle. Elle est conglomérée, divisée en plusieurs lobules, entre lesquels il y a de la graisse. Nicolas, fils de Stenon, est le premier qui ait découvert ces conduits en présence de Borrichius, le 11 de Novembre 1661. Ils naissent des intervalles des lobules, & s'ouvrent par des orifices propres dans la partie concave de la paupiere supérieure, beaucoup plus postérieurement que les cils. Il y en a dans le boeuf depuis six jusqu'à douze ; ils sont assez grands pour qu'on y puisse introduire un brin de vergette ; mais dans l'homme ils sont si obscurs, que Morgagni & Haller ne les ont jamais vûs, &c. Comment. Boerh. Voyez OEIL. Il y a aussi près du grand angle de l'oeil, une petite éminence, appellée caroncule lachrymale. Voyez CARONCULE.
Il y a du même côté un petit os, qui est du nombre de ceux de la mâchoire supérieure, & qui est quelquefois nommé os lachrymal ; mais plus ordinairement os unguis. Voyez UNGUIS.
Les points lachrymaux sont deux petites ouvertures au grand angle de l'oeil ; ce sont des tuyaux membraneux assez ouverts, formés dans la substance du muscle orbiculaire & dans l'extrémité des paupieres ; le supérieur descend un peu en se courbant ; selon Monro, l'inférieur est plus transverse. Ils marchent sous la peau & le muscle orbiculaire au sac nasal, auquel ils s'inserent sous l'extrémité supérieure, non par un conduit commun, comme le veulent Bianchi, Anel, Winslow & Petit, mais par deux différens conduits, dans lesquels passe une humeur aqueuse, saline & transparente, qui est séparée du sang par la glande lachrymale. Ensuite cette humeur est portée par les conduits lachrymaux dans une petite poche, appellée sac lachrymal, situé à la partie supérieure du canal nasal. Il est placé en arriere, & en partie en-dedans du tendon de l'orbiculaire ; sa figure est presque ovale, son diametre est assez grand, & va un peu en descendant. Bianchi est le seul qui ait vû des glandes dans ce sac. Il a été fort connu de Morgagni ; c'est pourquoi il est surprenant qu'il l'ait oublié. Haller, Comment. Boerh. Ce sac est suivi d'un conduit qu'on appelle aussi conduit lachrymal, & qui descend par le canal nasal dans le nez, où il va se décharger immédiatement audessous de l'os spongieux inférieur, ou cornet inférieur du nez. Voyez NEZ. On voit par-là pourquoi le nez dégoutte quand on pleure.
L'humeur qui sépare la glande lachrymale sert à humecter & à lubrifier le globe de l'oeil, afin d'empêcher qu'il ne frotte rudement. Lorsque cette humeur est séparée en grande quantité, ensorte qu'elle s'épanche au-delà des paupieres, on la nomme larmes.
|
| LACHRYMATOIRE | subst. m. (Antiq. rom.) les lachrymatoires étoient des phioles de terre ou de verre, dans lesquelles on a cru qu'on recevoit les larmes répandues pour quelqu'un à sa mort ; mais la seule figure de ces phioles qu'on enfermoit dans les tombeaux, annonce qu'on ne pouvoit point s'en servir pour recueillir les larmes, & qu'elles étoient faites pour y mettre les baumes ou onguens liquides, dont on arrosoit les ossemens brûlés. Il est même vraisemblable que tout ce qu'on appelle improprement lachrymatoire dans les cabinets des curieux, doit être rapporté à cette espece de phioles, uniquement destinées à ces sortes de baumes. (D.J.)
|
| LACHTER | S. m. (Minéral.) mesure suivant laquelle on compte en Allemagne la profondeur des puits des mines, ou les dimensions des galeries ; elle répond à une brasse. Cette mesure se divise en 80 pouces, & fait trois aulnes & demie de Misnie, c'est-à-dire environ sept piés ; cependant elle n'est point par-tout la même. (-)
|
| LACIADES | Laciadae, (Géogr. anc.) lieu municipal de Grece dans l'Attique, de la tribu Oenéide. Il y avoit dans cet endroit un temple du héros Lacius, qui avoit donné le nom au peuple qui l'habitoit. Ce lieu étoit la patrie des deux plus grands capitaines de la Grece, Miltiades & son fils Cimon ; Cornelius Nepos & Plutarque ont écrit leurs vies ; elles sont faites pour élever l'ame & pour l'annoblir. (D.J.)
|
| LACINIÉ | adj. (Gramm. Bot.) il se dit des feuilles. Une feuille laciniée est celle qui est comme déchirée, déchiquetée, découpée en plusieurs autres feuilles étroites & longues. La feuille du fenouil est laciniée. Voyez l'article FENOUIL.
|
| LACINIENNE | adj. fem. Lacinia, (Littér.) surnom que l'on donnoit à Junon ; tiré du promontoire Lacinium, où elle avoit un temple respectable par sa sainteté, dit Tite-Live, & célebre par les riches présens dont il étoit orné. Cicéron ne parle guere sérieusement dans le récit qu'il fait, qu'Annibal eût grande envie de voler de ce temple une colonne qui étoit toute d'or massif ; mais qu'il en fut détourné par un songe, où Junon l'avertit de n'en rien faire, s'il vouloit conserver le bon oeil qui lui restoit encore. Voy. LACINIUM. (D.J.)
|
| LACINIUM | LACINIUM
|
| LACIS | subst. masc. (Art. Méchan.) ouvrage à reseau fait de fil de lin, ou de soie, ou de coton, ou d'autres matieres qu'on peut entrelacer.
LACIS, (Anatom.) Voyez PLEXUS.
|
| LACKMUS | S. m. lacca musica, (Arts) nom que les Allemands donnent à une couleur bleue, semblable à celle qu'on tire du tournesol. Elle vient d'Hollande & de Flandres. C'est un mélange composé de chaux vive, de verd-de-gris, d'un peu de sel ammoniac, & du suc du fruit de myrtille épaissi par la coction. Quand ce mélange a été séché, on le met en pastilles ou en tablettes quarrées. Les Peintres en font usage, & l'on en mêle dans la chaux dont on se sert pour blanchir les plafonds & l'intérieur des maisons ; cela donne un coup d'oeil bleuâtre au blanc, ce qui le rend plus beau. (-)
|
| LACOBRIGA | (Géogr. anc.) nom de deux anciennes villes d'Espagne dans la Lusitanie, dont l'une étoit dans le promontoire sacré. Lagobrica est encore le nom d'une ville de l'Espagne Tarragonoise, au pays des Vaccéens. Festus dit que ce nom est composé de lacu & de briga. Briga signifie un pont, & ce mot n'entre dans les mots géographiques, que pour exprimer des lieux où il y avoit un pont ; les Anglois ont pris de là leur mot bridge, un pont, mot qui entre dans la composition de plusieurs noms propres géographiques de leurs pays, soit au commencement, soit à la fin de ces mots, comme Cambridge, Tumbridge, Bridgenorth, Bridgewater ; & comme ces lieux sont tous au passage de quelque riviere, il a fallu y poser des ponts. (D.J.)
|
| LACONICON | S. m. (Littérat.) le laconique étoit l'étuve seche dans les palestres greques, & l'étuve voûtée pour faire suer, ou le bain de vapeur portoit chez les Latins le nom de tepidarium. Ces deux étuves étoient jointes ensemble, leur plancher étoit creux & suspendu pour recevoir la chaleur de l'hypocauste, c'est-à-dire d'un grand fourneau maçonné au-dessous. On avoit soin de remplir ce fourneau de bois, ou d'autres matieres combustibles, dont l'ardeur se communiquoit aux deux étuves, à la faveur du vuide qu'on laissoit sous leurs planchers.
L'idée d'entretenir la santé par la sueur de ces sortes d'étuves, étoit de l'invention de Lacédémone, comme le mot laconicon le témoigne ; & Martial le confirme dans les vers suivans.
Ritus si placeant tibi laconum,
Contentus potes arido vapore,
Crudâ virgine, Martiaque mergi.
Les Romains emprunterent cet usage des Lacédémoniens ; Dion Cassius rapporte, qu'Agrippa fit bâtir un magnifique laconicon à Rome l'an 729 de sa fondation, ce qui revient à l'année 25 avant Jesus-Christ. L'effet de ces sortes d'étuves, dit Columelle, est de réveiller la soif & de dessécher le corps. On bâtissoit les laconiques avec des pierres brûlées, ou desséchées par le feu. (D.J.)
|
| LACONIE | (LA) Géog. anc. ou le pays de Lacédémone, en Latin Laconia ; célebre contrée de la Grece, au Péloponnèse, dont Lacédémone étoit la capitale. La Laconie étoit entre le royaume d'Argos au nord, l'Archipel à l'orient, le golfe Laconique au midi, la Messénie au couchant, & l'Arcadie au nord-ouest. L'Eurotas la partageoit en deux parties fort inégales. Toute la côte de la Laconie s'étendoit depuis le cap Ténarien, Taenarium, jusques au lieu Praesium ou Prasia.
La Laconie s'appelle aujourd'hui Zaconie ou Brazzo di Maina en Morée, & ses habitans sont nommés Magnottes. Mais la Zaconie des modernes ne répond que très-imparfaitement à la Laconie des anciens. (D.J.)
LACONIE, (Golfe de) en latin Laconicus sinus, (Géog. anc.) golfe de la mer de Grece, au midi du Péloponnèse, à l'orient du golfe Messéniaque, dont il est separé par le cap, autrefois nommé Taenarien. C'est proprement une anse, qu'on appelle présentement golfe de Colochine, & qui est séparé du golfe de Coron par le cap Matapan. C'étoit dans cette anse que se pêchoit la pourpre la plus estimée en Europe ; ce qui a fait dire à Horace (ode 18. lib. II.) " Je n'ai point pour clientes des dames occupées à me filer des laines teintes dans la pourpre de Laconie ".
.... Non Laconicas mihi
Trahunt honestae purpuras clientae.
Cette expression hardie d'Horace, trahunt purpuras pour lanas purpurâ infectas, prouve & justifie les libertés que la poésie lyrique a droit de prendre. (D.J.)
LACONIE (marbre de Laconie) Laconium marmor, (Hist. nat.) les anciens donnoient ce nom à un marbre verd d'une grande beauté, mais dont la couleur n'étoit point entierement uniforme ; il étoit rempli de taches & de veines d'un verd ou plus clair ou plus obscur que le fond de la couleur. Sa ressemblance avec la peau de quelques serpens l'a fait appeller ophites par quelques auteurs : il ne faut point confondre ce marbre avec la serpentine, que l'on a aussi appellée ophites. Voyez SERPENTINE.
Le nom de ce marbre sembleroit devoir faire conjecturer qu'on en tiroit de la partie de la Grece qui est aux environs de Lacédémone, cependant on dit que les Romains le faisoient venir d'Egypte. Aujourd'hui on en trouve en Europe près de Vérone en Italie, en Suede & en Angleterre près de Bristol. Il paroît que ce marbre est le même que celui que les Marbriers nomment verd d'Egypte ou verd antique. (-)
|
| LACONIMURGUM | (Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne chez les Vettons, peuples situés à l'orient de la Lusitanie. Le P. Hardouin croit que c'est présentement Constantina dans l'Andalousie, au-dessus de Penaflor. (D.J.)
|
| LACONISME | S. m. (Littérat.) c'est-à-dire en françois, langage bref, animé & sententieux ; mais ce mot désigne proprement l'expression énergique des anciens Lacédémoniens, qui avoient une maniere de s'énoncer succincte, serrée, animée & touchante.
Le style des modernes, qui habitent la Zaconie, ne s'en éloigne guere encore aujourd'hui : mais ce style vigoureux & hardi ne sied plus à de misérables esclaves, & répond mal au caractere de l'ancien laconisme.
En effet, les Spartiates conservoient un air de grandeur & d'autorité dans leurs manieres de dire beaucoup en peu de paroles. Le partage de celui qui commande est de trancher en deux mots. Les Turcs ont assez humilié les Grecs de Misitra, pour avoir droit de leur tenir le propos qu'Epaminondas tint autrefois aux gens du pays : " En vous ôtant l'empire, nous vous avons ôté le style d'autorité ".
Ce talent de s'énoncer en peu de mots, étoit particulier aux anciens Lacédémoniens, & rien n'est si rare que les deux lettres qu'ils écrivirent à Philippe, pere d'Alexandre. Après que ce prince les eut vaincus, & réduit leur état à une grande extrémité, il leur envoya demander en termes impérieux, s'ils ne vouloient pas le recevoir dans leur ville, ils lui écrivirent tout uniment, non ; en leur langue, la réponse étoit encore plus courte, .
Comme ce roi de Macédoine insultoit à leurs malheurs, dans le tems que Denys venoit d'être dépouillé du pouvoir souverain, & réduit à être maitre d'école dans Corinthe, ils attaquerent indirectement la conduite de Philippe par une lettre de trois paroles, qui le menaçoient de la destinée du tyran de Syracuse : , Denys est à Corinthe.
Je sais que notre politesse trouvera ces deux lettres si laconiques des Lacédémoniens extrêmement grossieres ; eh ! bien, voici d'autres exemples de laconisme de la part du même peuple, que nous proposerons pour modele ! Les Lacédémoniens, après la journée de Platée, dont le récit pouvoit souffrir quelque éloge de la valeur de leurs troupes, puisqu'il s'agissoit de la plus glorieuse de leurs victoires, se contenterent d'écrire à Sparte, les Persans viennent d'être humiliés ; & lorsqu'après de si sanglantes guerres, ils se furent rendus maîtres d'Athènes, ils manderent simplement à Lacédémone, la ville d'Athènes est prise.
Leur priere publique & particuliere tenoit d'un laconisme plein de sens. Ils prioient seulement les dieux de leur accorder les choses belles & bonnes, . Voilà toute la teneur de leurs oraisons.
N'espérons pas de pouvoir transporter dans le françois l'énergie de la langue greque ; Eschine, dans son plaidoyer contre Ctésiphon, dit aux Athéniens : " Nous sommes nés pour la paradoxologie " ; tout le monde savoit que ce seul mot signifioit " pour transmettre par notre conduite aux races futures une histoire incroyable de paradoxes " ; mais il n'y a que le grec qui ait trouvé l'art d'atteindre à une briéveté si nerveuse & si forte. (D.J.)
|
| LACOWITZ | (Géog.) ville de la Pologne, dans la Russie blanche, au palatinat de Novogorodeck.
|
| LACQUE | S. f. (Hist. nat. des Drog. Arts, Chim.) espece de cire que des fourmis aîlées, de couleur rouge, ramassent sur des fleurs aux Indes orientales, & qu'elles transportent sur de petits branchages d'arbres où elles font leur nid.
Il est vraisemblable qu'elles y déposent leurs oeufs ; car ces nids sont pleins de cellules, où l'on trouve un petit grain rouge quand il est broyé, & ce petit grain rouge est selon les apparences, l'oeuf d'où la fourmi volante tire son origine.
La lacque n'est donc point précisément du genre des gommes, ni des résines, mais une sorte de cire recueillie en forme de ruche, aux Indes orientales, par des fourmis volantes ; cette cire séchée au soleil devient brune, rouge-clair, transparente, fragile.
On nous l'apporte de Bengale, de Pégu, de Malabar, & autres endroits des Indes. On la nomme trec dans les royaumes de Pégu & de Martaban.
Garcie des Jardins & Bontius sont du nombre des premiers parmi les auteurs qui nous ont appris sa véritable origine. Ceux qui pretendent que la lacque est une partie de la fêve du jujuba indica, suintée à-travers l'écorce, sont dans l'erreur ; car, outre que les bâtons sur lesquels elle a été formée prouvent le contraire, la résine qui distille par incision de cet arbre est en petite quantité & d'une nature toute différente.
Plusieurs écrivains se sont aussi persuadés que la lacque avoit été connue de Dioscoride & de Sérapion ; mais la description qu'ils nous en ont donnée démontre assez le contraire. Quant au nom de gomme qu'elle porte, c'est un nom impropre & qui ne peut lui convenir, puisque c'est un ouvrage de petits insectes.
La principale espece de lacque est celle qu'on nomme lacque en bâtons, parce qu'on nous l'apporte attachée à de petits branchages sur lesquels elle a été formée. Il ne faut pas croire que cette espece de cire provienne des petits rameaux où on la voit attachée, puisqu'en la cassant, & en la détachant de ces petits bâtons, on ne voit aucune issue par où elle auroit pû couler. D'ailleurs, comme cette espece de cire est fort abondante, & que souvent les bâtons sont très-petits, il est visible qu'elle n'en est point produite. Enfin, le sentiment unanime des voyageurs le confirme.
Ils nous disent tous que les bâtons de la lacque ne sont autre chose que des branchages que les habitans ont soin de piquer en terre en grande quantité, pour servir de soutien à l'ouvrage des fourmis volantes, qui viennent y déposer l'espece de cire que nous appellons lacque. Le mérite de la lacque de Bengale sur celle de Pégu ne procede que du peu de soin que les Péguans ont de préparer les bâtons pour recevoir le riche ouvrage de leurs fourmis, ce qui oblige ces insectes de se décharger à terre de la lacque qu'ils ont recueillie, laquelle étant mêlée de quantité d'ordures, est beaucoup moins estimée que celle de Bengale, qui ne vient qu'en bâtons.
Mais tâchons de dévoiler la nature de l'ouvrage de ces insectes ; M. Geoffroy, qui s'en est occupé, semble y être parvenu. Voici le précis de ses observations, insérées dans les Mém. de l'acad. des Sc. année 1714.
Il lui a paru, en examinant l'ouvrage de ces petits animaux, que ce ne pouvoit être qu'une sorte de ruche, approchant en quelque façon de celle que les abeilles & d'autres insectes ont coutume de travailler. En effet, quand on la casse, on la trouve partagée en plusieurs cellules ou alvéoles, d'une figure assez uniforme, & qui marque que ce n'a jamais été une gomme, ni une résine coulante des arbres. Chacune de ces alvéoles est oblongue, à plusieurs pans, quelquefois tout-à-fait ronde, selon que la matiere étant encore molle, a été dérangée, & a coulé autour de la branche qui la soutient.
Les cloisons de ces alvéoles sont extrèmement fines, & toutes pareilles à celles des ruches des mouches à miel ; mais comme elles n'ont rien qui les défende de l'injure de l'air, elles sont recouvertes d'une couche de cette même cire, assez dure & assez épaisse pour leur servir d'abri ; d'où l'on peut conjecturer que ces animaux ne travaillent pas avec moins d'industrie que les abeilles, puisqu'ils ont beaucoup moins de commodités.
Il y a lieu de croire que ces alvéoles sont destinées aux essains de ces insectes comme celles des abeilles ; & que ces petits corps qu'on y trouve sont les embrions des insectes qui en doivent sortir ; ou les enveloppes de ceux qui en sont sortis effectivement, comme on le voit dans la noix de galle, & autres excroissances provenant de la piqûure des insectes.
Ces petits corps sont oblongs, ridés ou chagrinés, terminés d'un côté par une pointe, de l'autre par deux, & quelquefois par une troisieme. En mettant ces petits corps dans l'eau, ils s'y renflent comme la cochenille, la teignent d'une aussi belle couleur, & en prennent à peu-près la figure, ensorte que la seule inspection fait juger que ce sont de petits corps d'insectes ; en quelque état qu'ils soient ce sont eux qui donnent à la lacque la teinture rouge qu'elle semble avoir ; car quand elle en est absolument dépouillée ou peu fournie, à peine en a-t-elle une légere teinture.
Il paroît donc que la lacque n'est qu'une sorte de cire, qui forme pour ainsi dire le corps de la ruche, & cette cire est d'une bonne odeur quand on la brûle. Mais pour ce qui est des petits corps, qui sont renfermés dans les alvéoles, ils jettent, en brûlant, une odeur desagréable, semblable à celle que rendent les parties des animaux. Plusieurs de ces petits corps sont creux, pourris ou moisis ; d'autres sont pleins d'une poudre où l'on découvre, à l'aide du microscope, quantité d'insectes longs, transparens, à plusieurs pattes.
On peut comparer la lacque, qui est sur les bâtons chargés d'alvéoles, à la cire de nos mouches, & dire que sans les fourmis il n'y auroit point de lacque ; car ce sont elles qui prennent soin de la ramasser, de la préparer & de la travailler pendant huit mois de l'année pour leur usage particulier, qui est la production & la conservation de leurs petits. Les hommes ont aussi mis à profit cette lacque, en l'employant pour la belle teinture des toiles qui se fait aux Indes, pour la belle cire à cacheter dont nous nous servons, pour les vernis & pour la peinture.
On a établi différentes sortes de lacques. Premierement, la lacque en branches, dont on peut distinguer deux especes ; une de couleur d'ambre jaune, qui porte des alvéoles remplies de chrysalides, dont la couleur est grise, c'est la lacque de Madagascar : Flacourt en a parlé le premier, & elle ne mérite aucune estime.
La seconde espece est d'une couleur plus obscure à l'extérieur ; mais entierement rouge, lorsqu'on regarde la lumiere à-travers. Cette belle couleur lui vient de ce que ses alvéoles sont bien remplis, & que les parties animales y étant en abondance, ont communiqué leur teinture à la cire à l'aide de la chaleur du soleil. On peut dire que c'est la lacque dans sa maturité, aussi est-elle pesante, plus serrée & plus solide que la précédente ; c'est-là la bonne lacque.
Les Indiens, sur-tout les habitans de Bengale, qui en connoissent tout le prix, & combien les Européens l'estiment, sont attentifs à sa préparation. Pour cet effet ils enfoncent en terre dans les lieux où se trouvent les insectes qui la forment, quantité de petites branches d'arbres ou de roseaux, de la maniere qu'on rame les pois en France. Lorsque ces insectes les ont couvert de lacque, on fait passer de l'eau par-dessus, & on la laisse ainsi exposée quelque tems au soleil, où elle vient dure & seche, telle qu'on nous l'apporte en Europe.
Cette gomme bouillie dans l'eau avec quelques acides, fait une teinture d'un très-beau rouge. Les Indiens en teignent ces toiles peintes si sévérement défendues, & si fort à la mode en France, qui ne perdent point leur couleur à l'eau ? les Levantins en rougissent aussi leurs maroquins. Elle doit être choisie la plus haute en couleur, nette, claire, un peu transparente, se fondant sur le feu, rendant étant allumée une odeur agréable, & quand elle est mâchée, teignant la salive en couleur rouge.
Quelques auteurs de matiere médicale lui attribuent les vertus d'être incisive, apéritive, atténuante ; de purifier le sang, d'exciter les mois aux femmes, la transpiration & la sueur ; mais ces vertus sont si peu confirmées par l'expérience, que l'usage de cette drogue est entierement reservé pour les Arts.
La lacque en grain, est celle que l'on a fait passer légerement entre deux meules, pour en exprimer la substance la plus précieuse : la lacque plate est celle qu'on a fondue & applatie sur un marbre : elle ressemble au verre d'antimoine.
Tout le monde sait que la lacque en grain est employée pour la cire à cacheter, dont celle des Indes est la meilleure de toutes : c'est de la bonne lacque liquefiée & colorée avec du vermillon. Les Indiens font encore avec leur lacque colorée une pâte très-dure, d'un beau rouge, dont ils forment des brasselets appellés manilles.
Pour tirer la teinture rouge de la lacque, au rapport du P. Tachard, on la sépare des branches, on la pile dans un mortier, on la jette dans de l'eau bouillante, & quand l'eau est bien teinte, on en remet d'autre, jusqu'à ce qu'elle ne teigne plus. On fait évaporer au soleil la plus grande partie de l'eau ; on met ensuite cette teinture épaissie dans un linge clair, on l'approche du feu, & on l'exprime au-travers du linge. Celle qui a passé la premiere est en gouttes transparentes, & c'est la plus belle lacque. Celle qui sort ensuite par une plus forte expression, & qu'on est obligé de racler avec un couteau, est plus brune, & d'un moindre prix. Voilà la préparation de la lacque la plus simple, qui n'est qu'un extrait de la couleur rouge que donnent les parties animales.
C'est de cette premiere préparation, dont les autres qui se sont introduites depuis par le secours de l'art, ont pris leur nom. De-là toutes les lacques employées dans la Peinture, pour peindre en mignature & en huile, qui sont des pâtes séches, auxquelles on a donné la couleur de la lacque, selon les degrés nécessaires pour la gradation des teintes.
Ce mot de lacque s'est ensuite étendu à un grand nombre d'autres pâtes séches, ou poudres de différentes couleurs, & teintes avec des matieres bien différentes. Ainsi la lacque fine de Venise est une pâte faite avec de la cochenille mesteque qui reste après qu'on en a tiré le premier carmin. La lacque colombine, ou lacque plate, est une pâte qu'on préparoit autrefois à Venise mieux qu'ailleurs, avec des tontures de l'écarlate bouillie dans une lessive de soude blanchie avec de la craie & de l'alun. La lacque liquide est une certaine teinture tirée du bois de Brésil ; toutes ces lacques s'emploient dans la Peinture & dans les vernis.
Divers chimistes en travaillant la lacque ont observé qu'elle ne se fond ni ne se liquéfie point dans de l'huile d'olive, quoiqu'on les échauffe ensemble sur le feu ; l'huile n'en prend même aucune couleur, & la lacque demeure au fond du vaisseau, en une substance gommeuse, dure, cassante, grumeleuse, rouge & brune ; ce qui prouve encore chimiquement que la lacque n'est point une résine.
Les mêmes chimistes ont cherché curieusement à tirer la teinture de la lacque, & l'on ne sera pas fâché d'en trouver ici le meilleur procédé : c'est à Boerhaave qu'on le doit.
Prenez de la lacque pure, reduisez-la en une poudre très-fine, humectez-la avec de l'huile de tartre par défaillance, faites-en une pâte molle, que vous mettrez dans un matras, exposez ce vaisseau sur un fourneau à une chaleur suffisante, pour sécher peu-à-peu la masse que vous aurez formée. Retirez ensuite votre vaisseau, laissez-le refroidir en plein air, l'huile alkaline se resoudra derechef ; remettez la masse sur le feu une seconde fois, retirez une seconde fois le vaisseau, & réitérez la liquéfaction ; continuez de la même maniere une troisieme fois, desséchant & liquéfiant alternativement, & vous parviendrez finalement à détruire la ténacité de la gomme, & à la mettre en une liqueur d'une belle couleur purpurine. Faites sécher derechef, & tirez la masse seche hors du vaisseau ; cette masse ainsi préparée & pulvérisée, vous fournira la teinture avec l'alcohol.
Mettez-la dans un grand matras, versez dessus autant d'alcohol pur qu'il en faut pour qu'il surnage, fermez votre vaisseau avec du papier ; remettez-le sur votre fourneau, jusqu'à ce qu'y ayant demeuré deux ou trois heures, l'alcohol commence à bouillir ; vous pouvez le faire sans danger, à cause de la longueur & de l'étroitesse du col du matras. Laissez refroidir la liqueur, ôtez la teinture claire, en inclinant doucement le vaisseau que vous tiendrez bien fermé : traitez le reste de la même maniere avec d'autre alcohol, & continuez jusqu'à ce que la matiere soit épuisée, & ne teigne plus l'alcohol.
C'est par ce beau procédé qu'on peut tirer d'excellentes teintures de la myrrhe, de l'ambre, de la gomme de genievre & autres, dont l'efficacité dépendra des vertus résidentes dans les substances d'où on les tirera, & dans l'esprit qui y sera secrettement logé.
Ce même procédé nous apprend 1°. qu'un alkali à l'aide de l'air & d'une chaleur digestive, est capable d'ouvrir un corps dense, & de le disposer à communiquer ses vertus à l'alcohol ; 2°. que l'action de la désiccation sur le feu & de la liquéfaction à l'air, faites alternativement, agit sur les particules les plus insensibles du corps dense, sans toutefois qu'en poussant ce procédé aussi loin qu'il est possible, on parvienne jamais à les dissoudre toutes. (D.J.)
LACQUE ARTIFICIELLE, (Arts) substance colorée qu'on tire des fleurs, soit en les faisant cuire à feu lent dans une lessive convenable, soit en les faisant distiller plusieurs fois avec de l'esprit-de-vin. C'est de ces deux manieres qu'on tire les couleurs de toutes sortes de plantes récentes ; la jaune de la fleur du genêt ; la rouge, du pavot ; la bleue, de l'iris ou de la violette ; la verte, de l'acanthe ; la noire, de la laterne selon Clusius, &c. & cette lacque est d'un grand usage dans la Peinture, sur-tout aux peintres en fleurs, & aux enlumineurs ; nous allons parler de ces deux méthodes ; commençons par celle de la lessive.
Faites avec de la soude & de la chaux une lessive médiocrement forte ; mettez cuire, par exemple, des fleurs de genêts, récentes, à un feu doux, de maniere que cette lessive se charge de toute la couleur des fleurs de genêts ; ce que vous reconnoîtrez, si les fleurs dont on a fait l'extrait sont devenues blanches, & la lessive d'un beau jaune ; vous en retirerez pour lors les fleurs, & vous mettrez la décoction dans des pots de terre vernissés pour la faire bouillir ; vous y joindrez autant d'alun de roche qu'il s'y en pourra dissoudre. Retirez ensuite la décoction, versez-la dans un pot plein d'eau claire, la couleur jaune se précipitera au fond. Vous laisserez alors reposer l'eau, vous la décanterez & y en verserez de nouvelle. Lorsque la couleur se sera déposée, vous décanterez encore cette eau, & vous continuerez de même, jusqu'à ce que tout le sel de la lessive & l'alun ayent été enlevés, parce que plus la couleur sera déchargée de sel & d'alun, plus elle sera belle. Dès que l'eau ne se chargera plus de sel, & qu'elle sortira sans changer de couleur, vous serez assurés que tout le sel & l'alun ont été emportés ; alors vous trouverez au fond du pot, de la lacque pure & d'une belle couleur.
Il faut observer entr'autres choses dans ces opérations, que lorsqu'on a fait un peu bouillir les fleurs dans une lessive, qu'on l'a décantée, qu'on en a versé une nouvelle sur ce qui reste ; qu'après une deuxieme cuisson douce, on a réitéré cette opération jusqu'à trois fois, ou plutôt tant qu'il vient de la couleur, & qu'on a précipité chaque extrait avec de l'alun ; chaque extrait ou précipitation donne une lacque ou couleur particuliere, qui est utile pour les différentes nuances, dont sont obligés de se servir les peintres en fleurs.
On ne doit point cependant attendre cet effet de toutes les fleurs, parce qu'il y en a dont les couleurs sont si tendres, qu'on est obligé d'en mettre beaucoup sur une petite quantité de lessive, tandis qu'il y en a d'autres pour qui on prend beaucoup de lessive sur peu de fleurs ; mais ce n'est que la pratique & l'expérience qui peuvent enseigner quel est le tempérament à garder.
Il ne s'agit plus que de sécher la lacque qu'on a tirée des fleurs. On pourroit l'étendre sur des morceaux de linge blanc, qu'on feroit sécher à l'ombre sur des briques nouvellement cuites ; mais il vaut mieux avoir une plaque de gypse, haute de deux ou trois travers de doigts ; dès qu'on voudra sécher la lacque, on fera un peu chauffer le plateau de gypse, & on étendra la lacque dessus ; ce plateau attire promtement l'humidité. Un plateau de gypse peut servir long-tems à cet usage, pourvu qu'on le fasse sécher à chaque fois qu'on l'aura employé ; au lieu de gypse on pourroit encore se servir d'un gros morceau de craye lisse & unie. Il n'est pas indifférent de sécher la lacque vîte ou lentement ; car il s'en trouve, qui en séchant trop vîte, perd l'éclat de sa couleur, & devient vilaine ; il faut donc en ceci beaucoup de patience & de précaution.
Passons à la méthode de tirer la lacque artificielle par l'esprit-de-vin ; voici cette méthode selon Kunckel.
Je prends, dit-il, un esprit-de-vin bien rectifié & déflegmé, je le verse sur une plante ou fleur, dont je veux extraire la teinture ; si la plante est trop grosse ou seche, je la coupe en plusieurs morceaux ; s'il s'agit de fleurs, je ne les coupe ni ne les écrase.
Aussi-tôt que mon esprit-de-vin s'est coloré, je le décante, & j'en verse de nouveau. Si la couleur qu'il me donne cette seconde fois est semblable à la premiere, je les mets ensemble ; si elle est différente, je les laisse à part, j'en ôte l'esprit-de-vin par la voye de la distillation, & je n'en laisse qu'un peu dans l'alambic pour pouvoir en retirer la couleur ; je la mets dans un vase ou matras, pour la faire évaporer lentement, jusqu'à ce que la couleur ait une consistance convenable, ou jusqu'à ce qu'elle soit entierement seche ; mais il faut que le feu soit bien doux, parce que ces sortes de couleurs sont fort tendres.
Il y a des couleurs de fleurs qui changent & donnent une teinture toute différente de la couleur qu'elles ont naturellement, c'est ce qui arrive sur-tout au bleu ; il faut une grande attention & un soin particulier pour tirer cette couleur : il n'y a même que l'usage & l'habitude qui apprennent la maniere d'y réussir.
Finissons par deux courtes observations ; la premiere que les plantes ou fleurs donnent souvent dans l'esprit-de vin une couleur différente de celle qu'elles donnent à la lessive. La seconde, que l'extraction ne doit se faire que dans un endroit frais ; car pour peu qu'il y eût de chaleur, la couleur se gâteroit ; c'est par la même raison qu'il est très-aisé en distillant, de se tromper au degré de chaleur, & que cette méprise rend tout l'ouvrage laid & disgracieux ; un peu trop de chaleur noircit les couleurs des végétaux ; le lapis lui-même perd sa couleur à un feu trop violent. (D.J.)
|
| LACROME | (Géog.) écueil au voisinage du port de Raguse ; & sur cet écueil qui a près d'une lieue de tour, est une abbaye de bénédictins. M. Delisle nomme cet écueil Chirona dans sa carte de la Grece. (D J.)
|
| LACTAIRE | COLOMNE, (Littér.) Lactaria, on sousentend columna ; colomne élevée dans le marché aux herbes à Rome, où l'on apportoit les enfans trouvés pour leur avoir des nourrices. Nous apprenons de Juvénal, Satyr. VI. v. 610. que les femmes de qualité y venoient souvent prendre des enfans abandonnés pour les élever chez elles ; ensuite les autres enfans dont personne ne se chargeoit étoient nourris aux dépens du public. (D.J.)
|
| LACTÉE | VOIE, (Astron.) est la même chose que GALAXIE ; on l'appelle aussi voie de lait : mais de ces trois dénominations celle de voie lactée est plus en usage, même parmi les Astronomes. Voyez l'article GALAXIE.
|
| LACTÉES | VEINES LACTEES, ou VAISSEAUX LACTES, en Anatomie, sont de petits vaisseaux longs, qui des intestins portent le chyle dans le réservoir commun. Voyez CHYLE.
Hippocrate, Erasistrate & Galien, passent pour les avoir connues ; mais Asellius fut le premier qui publia en 1622 une description exacte de celles qu'il avoit vûes dans les animaux, & qui les nomma veines lactées, parce que la liqueur qu'elles contiennent ressemble à du lait. Voyez Dougl. bibl. anat. pag. 236. édit. 1734. Tulpius est le premier qui les ait vûes dans l'homme en 1537. Highmor & Folius en 1739. Veslingius les a souvent vûes dans l'homme, & il en a donné la figure. Celle que Duverney a insérée dans le vol. I. des actes de Petersbourg, est la meilleure de toutes. Ces veines, du tems de Bartholin, ont été tellement confondues avec les vaisseaux lymphatiques, que les uns ont dit qu'elles se jettoient dans le foie, d'autres dans la matrice, d'autres enfin dans différentes parties.
Ces vaisseaux ont des tuniques si minces, qu'ils sont invisibles, excepté lorsqu'ils sont remplis de chyle ou de lymphe. Ils viennent de tous les endroits des intestins grêles, & à mesure qu'ils s'avancent de-là vers les glandes du mesentere, ils s'unissent & forment de plus grosses branches, appellées veines lactées du premier genre. Les orifices par lesquels ces vaisseaux s'ouvrent dans la cavité des intestins, d'où ils reçoivent le chyle, sont si petits qu'il est impossible de les appercevoir avec le meilleur microscope. Il étoit nécessaire qu'ils surpassassent en petitesse les plus petites arteres, afin qu'il n'y entrât rien qui pût arrêter la circulation du sang.
Cette extrémité des veines lactées communique avec les arteres capillaires des intestins, & les veines lactées reçoivent par ce moyen une lymphe qui détrempe le chyle, en facilite le cours, les tiennent nettes elles-mêmes, & aussi les glandes, de peur que le chyle venant à s'y arrêter quand on jeûne, ne les embarrasse & ne les bouche.
Les veines lactées par leur autre extrémité, déchargent le chyle dans les cellules vessiculaires des glandes répandues par tout le mésentere. De ces glandes viennent d'autres veines lactées plus grosses, qui portent le chyle immédiatement dans le reservoir de Pecquet ; & ces dernieres sont appellées veines lactées secondaires.
Les veines lactées ont de distance en distance des valvules qui empêchent le chyle de retourner dans les intestins. Voyez VALVULE.
On doute encore si les gros intestins ont des veines lactées ou non. L'impossibilité de disséquer des corps humains comme il faudroit pour une telle recherche, ne permet pas de l'assurer ou de le nier. Les matieres contenues dans les gros intestins ne sont pas propres à fournir beaucoup de chyle ; de sorte que s'ils ont des veines lactées, ils ne sauroient vraisemblablement en avoir que très-peu. Il est constant qu'on les a observées dans plusieurs animaux. Winslow, Bohne, Folius, Warcher, Higmor les ont vues dans l'homme. Santorini, Leprotti, Drelincourt, Brunner, prétendent qu'il n'y en a point dans les gros intestins ; mais, comme l'observe très-judicieusement M. Haller, les conclusions négatives doivent être soutenues par beaucoup d'expériences.
Dans les animaux, si on les ouvre, un tems raisonnable après qu'ils ont pris de la nourriture, comme au bout de deux ou trois heures, on apperçoit les veines lactées blanches & très-gonflées : & si on les blesse, le chyle en sort abondamment. Mais si on les examine lorsque l'estomac de l'animal a été quelque tems vuide, elles paroissent comme des vaisseaux lymphatiques, étant visibles à la vérité, mais pleines d'une liqueur transparente.
Le chyle contenu dans les veines lactées, montre qu'elles communiquent avec la cavité des intestins. Mais on n'a pas encore découvert comment leurs orifices sont disposés pour le recevoir, & on ne connoît aucun moyen d'injecter les veines lactées par la cavité des intestins. Ainsi leur entrée dans ce canal est probablement oblique, puisque ni l'air, ni les liqueurs n'y peuvent pénétrer de-là ; & comme les veines lactées ne reçoivent rien que pendant la vie de l'animal, il y a lieu de croire que c'est le mouvement péristaltique des intestins qui les met en état de recevoir le chyle. Ce qui peut s'exécuter par le moyen des fibres circulaires & longitudinales des intestins, qui appliquent sans-cesse leurs tuniques internes contre ce qu'ils contiennent ; en conséquence de quoi le chyle est séparé de la matiere excrémentitielle, & se trouve forcé d'entrer par les orifices des veines lactées.
|
| LACTODORUM | (Géog. anc.) ou plutôt LACTORODUM, ancien lieu de la grande-Bretagne, qui se trouvoit, selon l'Itinéraire d'Antonin, entre Bennavenna & Magiovintum. M. Gale rend Bennavenna par Weedon, & Magiovintum par Dunstale. Il croit que Lactorodum est Stony-streadfort, un gué sur le chemin pavé. Il aime mieux lire Lactorodum que Lactorodum, parce qu'en langue bretone, lech signifie une pierre, & rhyd, un gué. (D.J.)
|
| LACTURCIE | (Littér.) & par d'autres LACTUCINE ou LACTICINIE, déesse des Romains, qui amollissoit les blés en lait, après que Flore en avoit pris soin lorsqu'ils étoient en fleurs. Varron donnoit cette charge au dieu Lactans, & selon les PP. Bénédictins au dieu Lacturne. Tous ces mots qui renferment la même idée, faisoient grand plaisir aux poëtes géorgiques, & ne pouvoient qu'annoblir leurs écrits ; nous n'avons plus ces mêmes avantages. (D.J.)
|
| LACUNES | lacunae, chez les Anatomistes, sont certains conduits excrétoires dans les parties naturelles de la femme. Voyez les Planch. anatomiques & leur explication.
Entre les fibres charnues des ureteres & la membrane du vagin, on trouve un corps blanchâtre & glanduleux, d'environ un doigt d'épais, qui s'étend autour du col de la vessie, & qui a un grand nombre de conduits excrétoires, que de Graaf appelle lacunes ; lesquels se terminent à la partie inférieure de l'orifice de la matrice de chaque côté par un petit trou plus visible que tous les autres qui répondent par deux petits tuyaux à ce corps folliculeux, & y apportent une humeur visqueuse qui se mêle avec la semence du mâle. Voyez GENERATION, CONCEPTION, SEMENCE. &c.
LACUNE, (Imprimerie) ce mot s'entend dans la pratique de l'Imprimerie, d'un vuide ou interruption de discours que l'on imite dans l'impression lorsqu'il s'en trouve dans un manuscrit, que l'on n'a pas jugé à propos ou que l'on n'a pu remplir ; assez ordinairement on représente ce défaut d'un manuscrit, à l'impression, par des lignes de points.
|
| LACYDON | (Géog. anc.) , c'est proprement le nom du port de Marseille. La ville & le port avoient leurs noms particuliers, comme Athènes. (D.J.)
|
| LADA | S. m. (Hist. mod.) du saxon ladian, signifie aussi une purgation canonique ou maniere de se laver d'une accusation, en faisant entendre trois témoins pour sa décharge. Dans les lois du roi Ethelred, il est souvent fait mention de lada simplex, triplex & plena. La premiere étoit apparemment celle où l'accusé se justifioit par son seul serment ; la seconde celle où il produisoit trois témoins, ou comme on les nommoit alors conjuratores, & peut-être étoit-il du nombre. Quant à la troisieme espece, on ignore quel nombre de témoins étoit précisément requis pour remplir la formalité nommée lada plena.
|
| LADANUM | S. m. (Hist. nat. des drog. exot.) en Grec , en arabe laden, suc gluant ou substance résineuse, qui transsude des feuilles du ciste ladanifere, que nous appellons lede. Voy. LEDE.
On trouve dans les boutiques deux sortes de ladanum ; l'une en grandes masses molles, qui approchent de la consistance d'emplâtre ou d'extrait, gluantes lorsqu'on les manie avec les doigts, d'une odeur agréable & d'un roux noirâtre ; elles sont enveloppées dans des vessies ou dans des peaux ; c'est ce qu'on nomme communément ladanum en masse.
L'autre sorte est en pains entortillés & roulés, secs, durs, fragiles, s'amollissant cependant à la chaleur du feu, de couleur noire, d'une odeur foible, & mêlés d'une quantité prodigieuse d'un petit sable noir ; c'est l'espece la plus commune, on l'appelle ladanum in tortis. Nous les recevons toutes les deux de l'isle de Candie, & des autres isles de l'Archipel. On le recueille aussi dans l'isle de Chypre du côté de Baffa, qui est l'ancienne Paphos.
Les anciens grecs ont connu comme nous cette résine grasse, & la maniere de la recueillir ; du tems de Dioscoride, & même du tems d'Hérodote, on n'amassoit pas seulement le ladanum avec des cordes, on détachoit encore soigneusement celui qui s'étoit pris à la barbe & aux cuisses des chevres, lorsqu'elles avoient brouté le ciste.
Les Grecs modernes ont pour faire cette récolte un instrument particulier, qu'ils nomment , & dont M. de Tournefort a donné la figure dans son voyage du Levant. Cet instrument est semblable à un rateau qui n'a point de dents ; ils y attachent plusieurs languettes ou courroies de cuir grossier, qui n'a point été préparé. Ils les passent & repassent sur les cistes, & à force de les rouler sur ces plantes, de les secouer, & de les frotter aux feuilles de cet arbuste, leurs courroies se chargent de la glu odoriférante, attachée sur les feuilles ; c'est une partie du suc nourricier de l'arbrisseau, lequel transsude au-travers de la tissure de ses feuilles comme une sueur grasse, dont les gouttes sont luisantes & aussi claires que la térébenthine.
Lorsque les courroies du rateau sont bien chargées de cette graisse, on les ratisse avec un couteau, & l'on met en pain ce que l'on en détache, c'est-là le ladanum. Un homme qui travaille avec application en amasse par jour environ trois livres deux onces, quantité qu'on vendoit un écu de France à Retimo du tems que M. de Tournefort y voyageoit.
Cette récolte n'est rude que parce qu'il faut la faire dans les plus grandes chaleurs, & lorsque le tems est calme ; cela n'empêche pas qu'il n'y ait quantité d'ordures dans le ladanum le plus pur, parce que les vents des mois précédens ont jetté beaucoup de poussiere sur les arbrisseaux : mais pour augmenter le poids de cette drogue, les Grecs la pétrissent avec un sablon noirâtre, ferrugineux & très-fin, qui se trouve sur les lieux, comme si la nature avoit voulu leur apprendre à sophistiquer leur marchandise. Il est difficile de connoître la tromperie lorsque le sablon est bien mêlé avec la résine ; & ce n'est qu'après l'avoir mâché long-tems qu'on sent le ladanum craquer sous la dent ; il y a néanmoins un bon remede, c'est de dissoudre le ladanum, & le filtrer ; car par ce moyen on sépare tout ce qu'on y a ajouté, qui n'est pas peu de chose, puisque sur deux livres de ladanum commun, on en retire ordinairement vingt-quatre onces de sable, & tout au plus quatre onces de vraie résine.
Les femmes grecques portent souvent dans leurs mains des boules faites de ladanum simple ou de ladanum ambré pour les sentir. (D.J.)
LADANUM ou LABDANUM, (Mat. méd.) est une gomme résine selon les auteurs de la table des médicamens, mise à la tête de la Pharmacopée de Paris. On doit choisir le ladanum pur, très-aromatique & qui s'amollisse facilement par la chaleur. Le ladanum en masses ou en pain doit être préféré au ladanum commun ou en tortis ; c'est pourtant cette derniere espece qu'on emploie plus fréquemment.
Le ladanum est fort rarement employé dans les remedes magistraux destinés à l'usage intérieur, il a cependant les vertus génériques des baumes ou des résines molles aromatiques. Voyez BAUMES & RESINE.
Quelques auteurs en ont recommandé l'application extérieure contre la foiblesse d'estomac, & dans le mal des dents ; mais on compte peu aujourd'hui sur de pareilles applications. Sont-elles absolument inutiles ? Voyez TOPIQUE.
On fait entrer le ladanum dans les fumigations odorantes. Voyez FUMIGATION.
Il entre aussi dans le baume hystérique, dans l'emplâtre contra rupturam, l'emplâtre stomacal ; & sa résine séparée par le moyen de l'esprit-de-vin dans la thériaque céleste de la Pharmacopée de Paris.
Les produits de sa distillation qui sont les mêmes que ceux de toute autre résine odorante, ne sont point d'usage. Voyez RESINE. (b)
|
| LADE | (Géog. anc.) isle de la mer Egée, devant Milet, sur la côte d'Asie. Hérodote, Thucydide & Pausanias en parlent. (D.J.)
|
| LADENBOURG | (Géog.) Ladenburgum, petite ville d'Allemagne au palatinat du Rhin, entre Heidelberg & Manheim sur le Necker. Elle appartient à l'évêché de Worms, & à l'électeur Palatin, Long. 27. 17. lat. 49. (D.J.)
|
| LADIZIN | (Géogr.) ville du royaume de Pologne, dans la petite Russie, au Palatinat de Braclow.
|
| LADOG | S. m. (Hist. nat. Comm.) c'est ainsi que l'on nomme en Russie un poisson qui ressemble beaucoup au hareng. On le pêche dans le lac de Ladoga, d'où lui vient le nom qu'il porte. Les Russes le salent & le mettent dans des barrils de la même façon que cela se pratique pour les harengs ; & comme ils observent un carême rigoureux & des jeûnes très-austeres, il s'en fait une si grande consommation dans le pays, que la pêche ne suffit pas à la provision, & que l'on a recours aux Anglois & aux Hollandois.
|
| LADOGA | (Géogr.) ville de l'empire Russien, sur le bord méridional du lac du même nom. Long. 51. 4. lat. 60. (D.J.)
|
| LADON LE | (Géog. anc.) riviere de Grece, au Péloponnèse dans l'Arcadie. Elle avoit sa source dans les marais de la ville de Phénée, & se perdoit dans l'Alphée. Pausanias vante la beauté de ses eaux sur toutes celles de la Grece ; de-là vient que les Mythologistes firent le Ladon pere de la nymphe Daphné & de la nymphe Syrinx. Il étoit couvert de magnifiques roseaux, dont Pan se servit pour sa flûte à sept tuyaux. Ovide n'est point d'accord avec lui-même sur la nature du cours de ce fleuve ; tantôt il entraine tout par sa rapidité, Ladon rapax ; tantôt au contraire, il roule tranquillement ses eaux sur le gravier, arenosus, placidus amnis.
Il y avoit une autre riviere de ce nom dans la Béotie, qu'on appelle depuis Ismenus. (D.J.)
|
| LADRE | voyez LEPRE, LEPREUX & ÉLEPHANTIASIS.
LADRE, (Maréchal) se dit d'un cheval qui a plusieurs petites taches naturellement dégarnies de poil, & de couleur brune autour des yeux ou au bout du nez. Les marques de ladre sont des indices de la bonté d'un cheval. Quoi qu'en dise le vulgaire, celui qui en a est très-sensible à l'éperon.
Ces marques au reste se distinguent sur quelque poil que ce soit, mais plus difficilement sur le blanc que sur tout autre.
LADRE, (Vener.) se dit d'un lievre qui habite aux lieux marécageux.
|
| LADRONE | (Géog.) ville & comté située dans l'évêché de Trente, sur le lac d'Idro.
|
| LAEH | ou LEHN, (Géog.) ville d'Allemagne de la basse Silésie, dans la principauté de Jauer, sur la riviere de Bober.
|
| LAEP | S. m. (Comm.) poids qui est en usage à Breslau en Silésie, & qui fait 24 liv. du pays, c'est-à-dire 20 livres du poids de Hambourg.
|
| LAEPA | (Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne dans la Bétique, au pays des Turdetains, selon Ptolomée, qui la surnomme la grande ; cependant nous ignorons le lieu même qui pourroit lui répondre. (D.J.)
|
| LAERTE | (Géog. anc.) ; ville de la Cilicie montagneuse, dans la Pamphilie, selon Ptolomée, lib. V. c. v. C'étoit, selon Strabon, une place forte, située sur une colline, & où on entretenoit une garnison. (D.J.)
|
| LAES | S. m. (Commerce) espece de monnoie de compte dont on se sert dans quelques endroits des Indes orientales, particulierement à Amadabath.
Un laes vaut 100000 roupies ; cent laes font un crou, & chaque crou vaut quatre arebs. Voyez Dictionn. du Commerce. (G)
|
| LAESZIN | (Géog.) petite ville de la Prusse polonoise, de la dépendance du palatinat de Culm.
|
| LAFFA | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbre de l'île de Madagascar ; on en tire des filamens semblables à du crin de cheval, dont les habitans font des lignes pour la pêche.
|
| LAGA | S. m. sorte de feve rouge & noire qui croît en diverses contrées des Indes orientales, & qui sert en quelques endroits de poids pour l'or & l'argent. Les Melais l'appellent conduit.
|
| LAGAN | S. m. (Droit marit.) terme ancien & hors d'usage ; il designoit le droit que plusieurs nations s'arrogeoient autrefois sur les hommes, les vaisseaux & les marchandises qui avoient fait naufrage, & dont la mer jettoit les personnes ou les débris sur la côte.
S'il en faut croire quelques historiens, les peuples habitans du comté de Ponthieu ne se faisoient point de scrupule, dans le x. & xje. siecle, de déclarer prisonniers tous ceux que le malheur faisoit échouer sur leurs côtes, & d'exiger d'eux une grosse rançon. Mais ce droit barbare, qui s'appelloit en France le lagan (laga maris), loi de mer, étoit reçu chez la plûpart des peuples européens.
Ce fut à Amiens que l'an 1191, le roi Philippe Auguste, le comte de Flandres, Philippe d'Alsace, Jean comte de Ponthieu, Ide comtesse de Boulogne, Bernard seigneur de S. Valery, & Guillaume de Caveu, consentirent conjointement d'abolir cet usage, que d'ailleurs la religion & l'humanité ont abrogé dans toute l'Europe. Il n'en reste, à proprement parler, que ce qu'on appelle en françois le jet ; ce sont les marchandises que le maître d'un vaisseau qui se trouve en danger, jette à la mer pour alléger son bâtiment, & que la mer renvoie à terre. Les princes, seigneurs ou peuples qui les recueillent, se les approprient. (D.J.)
|
| LAGANUM | S. n. (Littér.) mot d'Horace. Le laganum n'étoit point précisément un morceau de pâte cuite dans la graisse, une gaufre, une crêpe, un bignet comme traduisent nos dictionnaires. Le laganum étoit une espece de petit gâteau, fait avec de la farine, de l'huile & du miel : c'étoit-là un des trois plats du souper d'Horace, à ce qu'il dit ; les deux autres consistoient, l'un en poireaux & l'autre en feves ; mais Horace savoit bien quelquefois faire meilleure chere, & il paroît assez par ses écrits qu'il s'y connoissoit. (D.J.)
Galien a fait mention de cette espece de gâteau grossier, de aliment. facult. lib. I. cap. jv.
|
| LAGARIA | (Géog. anc.) ville ancienne de la grande Grece, dans le territoire des Tituriens. Cette ville ne subsiste plus ; le lieu où elle étoit est desert & sans habitans. (D.J.)
|
| LAGÉNIE | (Géog. anc.) nom ancien d'une des quatre provinces de l'Irlande, qu'on appelle aujourd'hui Leinster. C'est le pays où Ptolomée place les Brigantes, les Cauques, les Blaines & les Ménapiens : ses trois rivieres remarquables nommées dans Speed le Shour, le Néor & le Borrao, s'appellent à présent le Shanon, la Nuer & le Barrow. (D.J.)
|
| LAGÉNOPHORIES | S. f. pl. (Littér.) réjouissances d'usage chez le menu peuple à Alexandrie du tems des Ptolomées. Ces réjouissances tiroient leur nom de lagena, une bouteille, & fero, je porte, parce que ceux qui les célébroient devoient apporter chacun pour leur écot chez leur hôte, un certain nombre de bouteilles de vin pour égayer la fête. (D.J.)
|
| LAGENTIU | ou LAGECIUM, (Géog. ancien.) ancien lieu de la grande Bretagne, selon l'itinéraire d'Antonin, sur la route d'Yorck à Londres, à 21 mille pas de la premiere. Gale observe que c'est présentement Castleford, ou plûtôt Casterford, au confluent des rivieres l'Are & la Caulder. Il ajoute qu'on a trouvé près de Castleford un aussi grand nombre de monnoies romaines, que si on les y avoit semées. (D.J.)
|
| LAGHI | (Géog.) ville de l'Arabie heureuse, vers les côtes de la mer d'Arabie, au royaume d'Adramont, à 90 mille pas d'Aden. (D.J.)
|
| LAGIAS | S. m. (Commerce) toiles peintes qu'on appelle, à cause de leur perfection, lagias du Peoy, se fabriquent & se vendent au Pegu. Les torpites, les corpis & les pentadis sont inférieurs aux lagias.
|
| LAGIDES | S. m. (Hist. anc.) nom qu'on donna aux rois grecs qui posséderent l'Egypte après la mort d'Alexandre. Les deux plus puissantes monarchies qui s'éleverent alors, furent celle d'Egypte, fondée par Ptolomée, fils de Lagus, d'où viennent les Lagides, & celle d'Asie ou de Syrie, fondée par Séleucus, d'où viennent les Séleucides.
|
| LAGLY | ou LOUGHLEN, (Géog.) ville d'Irlande dans la province de Leinster, au comté de Catherlagh. Long. 10. 45. lat. 52. 40. (D.J.)
|
| LAGNI | (Géog.) Latiniacum, ville de l'île de France, dans le territoire de Paris, sur laquelle on peut consulter Longuerue, description de la France. Lagni est à 6 lieues au-dessus de Paris, & à 4 de Meaux, sur la Marne. La fondation de son abbaye de Bénédictin par S. Fourcy, est du vije. siecle. Long. 20. 20. lat. 48. 50. (D.J.)
|
| LAGNIEU | (Géog.) petite ville de France dans le Bugey, au diocèse de Lyon, sur le bord du Rhône, avec une église collégiale érigée en 1476. Long. 23. 20. lat. 45. 44. (D.J.)
|
| LAGNUS-SINUS | (Géog. anc.) golfe de la mer Baltique, qui, selon Pline, touche au pays des Cimbres. Le P. Hardouin prétend que c'est cette espece de mer qui baigne le Jutland, le Holstein & le Mecklembourg. (D.J.)
|
| LAGO-NEGRO | (Géog.) petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Basilicate, au pié de l'Apennin. Long. 34. 57. lat. 41. 12. (D.J.)
|
| LAGOPHTHALMI | ou OEIL DE LIEVRE, subst. fém. (Chirurgie) maladie de la paupiere supérieure retirée en-haut, ensorte que l'oeil n'en peut être couvert. Ce nom est composé de deux mots grecs , lievre, & , oeil, parce qu'on dit que les lievres dorment les paupieres ouvertes.
Les auteurs ont confondu la lagophthalmie avec l'éraillement, de même que l'ectropium qui est à la paupiere inférieure, la même maladie que la lagophthalmie à la supérieure. Les descriptions qu'on a données de ces maux, de leurs causes, de leurs symptômes & de leurs indications curatives, m'ont paru défectueuses à plusieurs égards. Voyez ECTROPIUM.
Quand la peau qui forme extérieurement la paupiere est retirée par quelque cause que ce soit, la membrane intérieure rebroussée, fort saillante, & dans une inversion véritable, se gonfle communément au point de couvrir entierement la cornée transparente. On ne doit pas confondre l'éraillement, qui est la suite d'une plaie simple à la commissure ou au bord des paupieres & qui n'a pas été réunie, avec le boursoufflement de la membrane interne, produit par d'autres causes.
Ce boursoufflement idiopathique qui seroit causé par une fluxion habituelle d'humeurs séreuses, ou par l'usage indiscret des remedes émolliens, prescriroit les remedes astringens & fortifians, comme on l'a dit au mot ECTROPIUM ; mais ces médicamens pourroient être sans effet si l'on ne donnoit aucune attention à la cause. Il faut détourner l'humeur par les purgatifs ; faire usage de la ptisane d'esquine ; appliquer des vésicatoires ou faire un cautere, suivant le besoin : souvent même, avec toutes ces précautions, le vice local exige qu'on fasse dégorger la partie tuméfiée au moyen des scarifications ; & le tissu de la partie dans les tuméfactions invétérées, peut s'être relâché au point qu'il en faut faire l'amputation.
L'usage des remedes ophthalmiques fort astringens ne paroît pas pouvoir être mis au nombre des causes de la lagophthalmie ni de l'ectropium, comme on l'a dit ailleurs. Mais pour ne parler ici que de la paupiere supérieure, les auteurs ont admis quatre causes principales du raccourcissement de cette partie, qui sont ; 1°. un vice de conformation ; 2°. la convulsion du muscle releveur de cette paupiere, & la paralysie simultanée du muscle orbiculaire qui sert à l'abaisser ; 3°. le dessechement de la paupiere ; & 4°. des cicatrices qui suivent les plaies, les ulceres & les brûlures de cette partie.
Maître Jean ne dispute point l'existence des trois premieres causes, quoiqu'il ne les ait jamais rencontrées dans la pratique ; mais il soutient avec raison que l'opération que quelques praticiens ont proposée contre cette maladie n'est point admissible. Cette opération consiste à faire sur la paupiere supérieure une incision en forme de croissant, dont les extrémités seroient vers le bord de la paupiere. On rempliroit la plaie de charpie, & l'on aurait soin d'en entretenir les levres écartées jusqu'à ce que la cicatrice fût formée. Maître Jean prouve très-solidement que toute cicatrice causant un rétrécissement de la peau, & étant toujours beaucoup plus courte que la plaie qui y a donné lieu, l'opération proposée doit rendre la difformité plus grande, parce que la paupiere en sera nécessairement un peu raccourcie. L'expérience m'a montré la verité de cette assertion. Cette opération a été pratiquée sur un homme qui, à la suite d'un abscès, avoit la peau de la paupiere supérieure raccourcie ; la membrane interne étoit un peu saillante & rebroussée. Depuis l'opération elle devint fort saillante, & couvrit tout le globe de l'oeil : je fus obligé d'en faire l'extirpation ; le malade sentit qu'il avoit la paupiere beaucoup plus courte qu'avant l'opération qu'on lui avoit faite pour l'allonger. J'ai traité quelque tems après un homme d'un phlegmon gangreneux à la paupiere supérieure. Pendant le tems de la suppuration, & assez longtems après la chûte de l'escare, on auroit pû craindre que la paupiere ne demeurât de beaucoup trop longue ; le dégorgement permit aux parties tuméfiées de se resserrer au point, que malgré toutes mes précautions, le malade ne guérit qu'avec une lagophthalmie ; preuve bien certaine de l'inutilité de l'opération proposée, & grand argument contre la régénération des substances perdues dans les ulceres. Voyez INCARNATION. La membrane interne forma un bourrelet fort lâche sur le globe de l'oeil au-dessus de la cornée transparente. Le seul usage de lotions avec l'eau de plantain a donné à cette membrane le ressort nécessaire pour ne pas s'éloigner de la peau de la paupiere.
Cet état ne doit pas être confondu avec l'éraillement causé, comme nous l'avons dit, par la simple solution de continuité qui s'étend jusqu'au cartilage qui les borde, comme la fente de la levre dans le bec de lievre. Pourquoi donner le nom de mutilation à une simple fente ? Le renversement de la paupiere, ou l'éraillement qui résulte de ce qu'on a entamé la commissure des paupieres dans l'opération de la fistule lacrymale étant sans déperdition de substance, peut être assez facilement corrigé. On a dit à l'art. ECTROPIUM que la paupiere a trop peu d'épaisseur pour pouvoir être retaillée, unie, consolidée & remise dans l'état qu'elle doit avoir naturellement. La raison montre la possibilité de cette opération, & l'expérience en a prouvé le succès. Le premier tome des mémoires de l'acad. royale de Chirurgie contient une observation de M. Ledran sur un oeil éraillé, dans laquelle il décrit les procédés qu'il a suivis pour corriger efficacement cette difformité. (Y)
|
| LAGOS | (Géog.) Lacobrica, ancienne ville de Portugal, au royaume d'Algarve, dans la province de Beyra, & dans l'évêché de Coimbre, à 10 lieues de la ville de Guarda, sur une hauteur, entre deux rivieres & quelques lacs, d'où lui vient son nom de Lagos. Long. 8. 40. lat. 37. (D.J.)
|
| LAGOW | (Géog.) ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Sendomir.
|
| LAGUE | S. f. (Marine) lague d'un vaisseau, c'est l'endroit par où il passe. Venir dans la lague d'un vaisseau, c'est quand on approche d'un vaisseau, & qu'on s'est mis côté à-travers de lui, ou proue à son côté, on revire & on se met à son arriere, c'est-à-dire dans ses eaux & dans son sillage.
|
| LAGUNA | LAGUNA
|
| LAGUNES | LAGUNES
Les lagunes du côté de Terre-ferme, sont bornées depuis le Midi jusqu'au Nord par le Dogado, proprement dit ; la mer a son entrée & son issue dans les lagunes par six bouches, dont il y en a deux nommées malomocco & lido, où les vaisseaux peuvent mouiller.
L'on compte une soixantaine d'îles dans toute l'étendue des lagunes ; plus de la moitié sont bâties & bien peuplées. De toutes ces îles qui bordent la mer, la Polestrine est la plus peuplée ; & de toutes celles qui composent le corps de la ville de Venise, Murano est la plus grande & la plus agréable ; elle fait les délices des Vénitiens. Voyez MURANO. (D.J.)
|
| LAGYRA | (Géog. anc.) ville de la Quersonnèse taurique, selon Ptolomée, ou ce qui revient au même, ancienne ville de la Crimée ; Niger croit que c'est présentement Soldaia. (D.J.)
|
| LAHELA | (Géog. sacrée) pays de la Palestine au delà du Jourdain, où Teglatphalasar roi d'Assyrie, transporta les tribus de Ruben, de Gad, & la demi-tribu de Manassé. Lahela est-il le même pays que Stade, ou que Hévila ? Les curieux peuvent lire sur cet article la dissertation de dom Calmet, sur le pays où les dix tribus furent transportées. (D.J.)
|
| LAHEM | ou LEHEM, (Géog. sacrée) ville de la Terre-Sainte, dont il est parlé au livre des Paral. ch. jv. vers. 22. C'est la même ville que Béthléem, comme l'ont prouvé Sanctius, Cornelius à Lapide, Tirin, & autres critiques, parce que souvent les Hébreux ôtent par aphérèse une partie des noms propres. (D.J.)
|
| LAHÉRIC | S. m. (Hist. nat. Botan.) arbre de l'île de Madagascar, dont la souche est droite & creuse ; ses feuilles croissent à l'entour en forme de spirale, ce qui en rend le coup-d'oeil très agréable.
|
| LAHIJON | (Géog.) ville de Perse, selon Tavernier, qui la met à 74. 25. de long. & à 37. 15. de latitude. (D.J.)
|
| LAHOLM | Laholmia, (Géog.) ville forte de Suede, dans la province de Halland, proche la mer Baltique, avec un château & un port sur le bord septentrional de la riviere de Laga, à 20 lieues N. E. de Helsingborg, 4. S. E. d'Helmstadt. Long. 30. 18. lat. 56. 35. (D.J.)
|
| LAHOR | LAHOR
Les quatre fleuves dont on vient de parler, fertilisent merveilleusement la province de Lahor. Le ris y croît en abondance, aussi-bien que le blé & les fruits ; le sucre y est en particulier le meilleur de l'Indoustan. C'est aussi de cette province que l'on tire le sel de roche, qu'on transporte dans tout l'empire. On y fait des toiles fines, des pieces de soie de toutes les couleurs, des ouvrages de broderie, des tapis pleins, des tapis à fleurs, & de grosses étoffes de laine.
Enfin, quoique le pays de Lahor soit plutôt une province qu'un royaume, c'est une province de l'Indoustan si considérable, qu'on la divise en cinq sarcats ou provinces, dans lesquelles on compte trois cent quatorze gouvernemens, qui rendent en total au grand mogol deux carols, 33 lacks, & cinq mille roupies d'argent. La roupie d'argent (car il y en a d'or) vaut 38 sols de France. Le lack vaut 100 mille roupies, & le carol vaut cent lacks, c'est-à-dire dix-neuf millions. Il résulte de-là, que l'empereur du Mogol retire de la province de Lahor 44 millions 279 mille 500 livres de notre monnoie. (D.J.)
LAHOR, (Géog.) grande ville d'Asie dans l'Indoustan, capitale de la province du même nom. D'Herbelot écrit Lahawar, & Lahaver ; Thevenot écrit Lahors. C'étoit une très-belle ville, quand les rois du Mogol y faisoient leur résidence, & qu'ils ne lui avoient pas encore préféré Dehly & Agra. Elle a été ornée dans ces tems-là de mosquées, de bains publics, de karavanseras, de places, de tanquies, de palais, de jardins, & de pagodes. Les voyageurs nous parlent avec admiration d'un grand chemin bordé d'arbres, qui s'étendoit depuis Lahor jusqu'à la ville d'Agra, c'est-à-dire l'espace de 150 lieues, suivant Thevenot. Ce cours étoit d'autant plus magnifique, qu'il étoit planté d'arbres, dont les branches aussi grandes qu'épaisses, s'élevoient en berceaux, & couvroient toute la route. C'étoit un ouvrage d'Akabar, embelli encore par son fils Géhanguir : Lahor est dans un pays abondant en tout, près du fleuve Ravy, qui se jette dans l'Indus, à 75 lieues O. de Multan, 100 S. de Dehly, & 150 N. O. d'Agra. Long. suivant le P. Riccioli, 102 30. lat. 32. 40. (D.J.)
|
| LAI | adj. (Théologie) qui n'est point engagé dans les ordres ecclésiastiques : ce mot paroît être une corruption ou une abréviation du mot laïque, & est principalement en usage parmi les moines, qui par le nom de frere lai, entendent un homme pieux & non lettré, qui se donne à quelque monastere pour servir les religieux. Voyez FRERE.
Le frere lai porte un habit un peu différent de celui des religieux ; il n'a point de place au choeur, n'a point voix en chapitre ; il n'est ni dans les ordres, ni même souvent tonsuré, & ne fait voeu que de stabilité & d'obéissance.
Frere lai se prend aussi pour un religieux non lettré, qui a soin du temporel & de l'extérieur du couvent, de la cuisine, du jardin, de la porte, &c. Ces freres lais font les trois voeux de religion.
Dans les monasteres de religieuses, outre les dames de choeur, il y a des filles reçues pour le service du couvent, & qu'on nomme soeurs converses.
L'institution des freres lais commença dans l'onzieme siecle : ceux à qui l'on donnoit ce titre, étoient des religieux trop peu lettrés pour pouvoir devenir clercs, & qui par cette raison se destinoient entiere ment au travail des mains, ou au soin du temporel des monasteres ; la plûpart des laïques dans ce tems-là n'ayant aucune teinture des Lettres. De-là vint aussi qu'on appella clercs, ceux qui avoient un peu étudié & qui savoient lire, pour les distinguer des autres. Voyez CLERC. (G)
LAI, s. m. (Littérat.) espece de vieille poésie françoise ; il y a le grand lai composé de douze couplets de vers de mesure différente, sur deux rimes ; & le petit lai composé de seize ou vingt vers en quatre couplets, & presque toûjours aussi sur deux rimes ; ils sont l'un & l'autre tristes ; c'étoit le lyrique de nos premiers poëtes. Au reste cette définition qu'on vient de donner du lai, ne convient point à la piece qu'Alain Chartier a intitulée lai, elle a bien douze couplets, mais le nombre de vers de chacun varie beaucoup ; & la mesure avec la rime encore davantage. Voyez LAI.
|
| LAICOCEPHALES | S. m. pl. (Théolog.) nom que quelques catholiques donnerent aux schismatiques anglois, qui, sous la discipline de Samson & Morisson étoient obligés d'avouer, sous peine de prison & de confiscation de biens, que le roi du pays étoit le chef de l'église. Scandera, her. 120. (G)
|
| LAID | adj. (Gram. Mor.) se dit des hommes, des femmes, des animaux, qui manquent des proportions ou des couleurs dont nous formons l'idée de beauté ; il se dit aussi des differentes parties d'un corps animé ; mais quoiqu'en disent les auteurs du dictionnaire de Trévoux, & même ceux du dictionnaire de l'académie, on ne doit pas dire, & on ne dit pas quand on parle avec noblesse & avec précision une laide mode, une laide maison, une étoffe laide. On fait usage d'autres épithetes ou de périphrases, pour exprimer la privation des qualités qui nous rendroient agréables les êtres inanimés ; il en est de même des êtres moraux ; & ce n'est plus que dans quelques proverbes, qu'on emploie le mot de laid dans le sens moral.
Les idées de la laideur varient comme celles de la beauté, selon les tems, les lieux, les climats, & le caractere des nations & des individus ; vous en verrez la raison au mot ORDRE. Si le contraire de beau ne s'exprime pas toûjours par laid, & si on donne à ce dernier mot bien moins d'acceptions qu'au premier, c'est qu'en général toutes les langues ont plus d'expressions pour les défauts ou pour les douleurs, que pour les perfections ou pour les plaisirs.
Laid se dit des especes trop différentes de celles qui peuvent nous plaire, & difforme se dit des individus qui manquent à l'excès des qualités de leur espece, laid suppose des défauts, & difforme suppose des défectuosités ; la laideur dégoûte, la difformité blesse.
|
| LAIDANGER | v. act. (Jurisprud.) signifioit anciennement injurier. Voyez ci-après LAIDANGES. (A)
|
| LAIDANGES | S. f. (Jurisprud.) dans l'ancien style de pratique signifioit vilaines paroles, injures verbales. Celui qui injurioit ainsi un autre à tort, devoit se dédire en justice en se prenant par le bout du nez ; c'est sans-doute de-là que quand un homme paroît peu assuré de ce qu'il avance, on lui dit en riant votre nez branle. Voyez l'ancienne coûtume de Normandie, ch. 51. 59 & 86 ; le style de juge, c. xv. art. 14. Monstrelet, en son hist. ch. xl. du I. vol. (A)
|
| LAIDEUR | S. f. (Gramm. & Morale) c'est l'opposé de la beauté ; il n'y a au moral rien de beau ou de laid, sans regles ; au physique, sans rapports ; dans les Arts, sans modele. Il n'y a donc nulle connoissance du beau ou du laid, sans connoissance de la regle, sans connoissance du modele, sans connoissance des rapports & de la fin. Ce qui est necessaire n'est en soi ni bon ni mauvais, ni beau ni laid ; ce monde n'est donc ni bon ni mauvais, ni beau ni laid en lui-même ; ce qui n'est pas entierement connu, ne peut être dit ni bon ni mauvais, ni beau ni laid. Or on ne connoît ni l'univers entier, ni son but ; on ne peut donc rien prononcer ni sur sa perfection ni sur son imperfection. Un bloc informe de marbre, considéré en lui-même, n'offre ni rien à admirer, ni rien à blâmer ; mais si vous le regardez par ses qualités ; si vous le destinez dans votre esprit à quelqu'usage ; s'il a déja pris quelque forme sous la main du statuaire, alors naissent les idées de beauté & de laideur ; il n'y a rien d'absolu dans ces idées. Voilà un palais bien construit ; les murs en sont solides ; toutes les parties en sont bien combinées ; vous prenez un lesard, vous le laissez dans un de ses appartemens ; l'animal ne trouvant pas un trou où se refugier, trouvera cette habitation fort incommode ; il aimera mieux des décombres. Qu'un homme soit boiteux, bossu ; qu'on ajoute à ces difformités toutes celles qu'on imaginera, il ne sera beau ou laid, que comparé à un autre ; & cet autre ne sera beau ou laid que rélativement au plus ou moins de facilité à remplir ses fonctions animales. Il en est de même des qualités morales. Quel témoignage Newton seul sur la surface de la terre, dans la supposition qu'il eût pu s'élever par ses propres forces à toutes les découvertes que nous lui devons, auroit-il pu se rendre à lui-même ? Aucun ; il n'a pu se dire grand, que parce que ses semblables qui l'ont environné, étoient petits. Une chose est belle ou laide sous deux aspects differens. La conspiration de Venise dans son commencement, ses progrès & ses moyens nous font écrier : quel homme que le comte de Bedmard ! qu'il est grand ! La même conspiration sous des points de vûe moraux & relatifs à l'humanité & à la justice, nous fait dire, qu'elle est atroce ! & que le comte de Bedmard est hideux ! Voyez l'article BEAU.
LAIE, (Jurisp.) cour laie c'est une cour séculiere & non ecclésiastique.
Laie en termes d'eaux & forêts, est une route que l'on a ouverte dans une forêt, en coupant pour cet effet le bois qui se trouvoit dans le passage. Il est permis aux arpenteurs de faire des laies de trois piés pour porter leur chaîne quand ils en ont besoin pour arpenter ou pour marquer les coupes. L'ordonnance de 1669 défend aux gardes d'enlever le bois qui a été abattu pour faire des laies. On disoit autrefois lée.
Laie se prend aussi quelquefois pour une certaine étendue de bois.
Laies accenses dans quelques coutumes, sont des baux à rente perpétuelle ou à longues années. (A)
LAIE, s. f. (Maçonnerie) dentelure ou bretelure que laisse sur la pierre le marteau qu'on appelle aussi laie, lorsqu'on s'en sert pour la tailler.
|
| LAIE | S. f. (Hist. nat.) c'est la femelle du sanglier. Voyez l'article SANGLIER.
|
| LAINAGE | S. m. (Commerce) il se dit de tous les poils d'animaux qui s'emploient dans l'ourdissage, dont on fait commerce, & qui payent le dixme aux ecclésiastiques. Cet abbé a la dixme des lainages.
Il se dit encore d'une façon qu'on donne aux étoffes de laine qu'on tire avec le chardon. Voyez aux articles suivans LAINE, (manufacture en)
|
| LAINE | S. f. (Arts, Manufactures, Commerce) poil de beliers, brebis, agneaux & moutons, qui de-là sont appellés bêtes à laine, & quand ce poil coupé de dessus leur corps n'a point encore reçu d'apprêt, il se nomme toison.
La laine est de toutes les matieres la plus abondante, & la plus souple ; elle joint à la solidité le ressort & la mobilité. Elle nous procure la plus sûre défense contre les injures de l'air. Elle est pour les royaumes florissans le plus grand objet de leurs manufactures & de leur commerce. Tout nous engage à le traiter cet objet, avec l'étendue qu'il mérite.
Les poils qui composent la laine, offrent des filets très-déliés, flexibles & moëlleux. Vûs au microscope, ils sont autant de tiges implantées dans la peau, par des radicules : ces petites racines qui vont en divergeant, forment autant de canaux qui leur portent un suc nourricier, que la circulation dépose dans des folécules ovales, composées de deux membranes, l'une est externe, d'un tissu assez ferme, & comme tendineux ; l'autre est interne, enveloppant la bulbe. Dans ces capsules bulbeuses, on apperçoit les racines des poils baignées d'une liqueur qui s'y filtre continuellement, outre une substance moëlleuse qui fournit apparemment la nourriture. Comme ces poils tiennent aux houpes nerveuses, ils sont vasculeux, & prennent dans des pores tortueux la configuration frisée que nous leur voyons sur l'animal.
Mais tandis que le physicien ne considere que la structure des poils qui composent la laine, leur origine, & leur accroissement, les peuples ne sont touchés que des commodités qu'ils en retirent. Ce sentiment est tout naturel. La laine fournit à l'homme la matiere d'un habillement qui joint la souplesse à la solidité, & dont le tissu varié selon les saisons, le garantit successivement du souffle glacé des aquilons, & des traits enflammés de la canicule. Ces précieuses couvertures qui croissent avec la même proportion que le froid, deviennent pour les animaux qui les portent, un poids incommode, à mesure que la belle saison s'avance. L'été qui mûrit pour ainsi dire les toisons, ainsi que les moissons, est le terme ordinaire de la récolte des laines.
Les gens du métier distinguent dans chaque toison trois qualités de laine. 1°. La laine mere, qui est celle du dos & du cou. 2°. La laine des queues & des cuisses. 3°. Celle de la gorge, de dessous le ventre & des autres endroits du corps.
Il est des classes de laines, dont l'emploi doit être défendu dans les manufactures ; les laines dites pelades, les laines cottisées ou sallies, les morelles ou laines de moutons morts de maladies ; enfin les peignons & les bourres (on nomme ainsi la laine qui reste au fond des peignes, & celle qui tombe sous la claie). On donne à toutes ces laines le nom commun de jettices & de rebut. S'il est des mégissiers qui ne souscrivent pas à cette liste de laines rejettables, il ne faut pas les écouter.
Il y a des laines de diverses couleurs, de blanches, de jaunes, de rougeâtres & de noires. Autrefois presque toutes les bêtes à laine d'Espagne, excepté celles de la Bétique (l'Andalousie), étoient noires. Les naturels préféroient cette couleur à la blanche, qui est aujourd'hui la seule estimée dans l'Europe, parce qu'elle reçoit à la teinture des couleurs plus vives, plus variées, & plus foncées que celles qui sont naturellement colorées.
Le soin des bêtes à laine n'est pas une institution de mode ou de caprice ; l'histoire en fait remonter l'époque jusqu'au premier âge du monde. La richesse principale des anciens habitans de la terre consistoit en troupeaux de brebis. Les Romains regarderent cette branche d'agriculture, comme la plus essentielle. Numa voulant donner cours à la monnoie dont il fut l'inventeur, y fit marquer l'empreinte d'une brebis, en signe de son utilité, pecunia à pecude, dit Varron.
Quelle preuve plus authentique du cas qu'on faisoit à Rome des bêtes à laine, que l'attachement avec lequel on y veilloit à leur conservation ? Plus de six siecles après Numa, la direction de tous les troupeaux de bêtes blanches appartenoit encore aux censeurs, ces magistrats suprêmes, à qui la charge donnoit le droit d'inspection sur la conduite & sur les moeurs de chaque citoyen. Ils condamnoient à de fortes amendes ceux qui négligeoient leurs troupeaux, & accordoient des récompenses avec le titre honorable d'ovinus, aux personnes qui faisoient preuve de quelque industrie, en concourant à l'amélioration de leurs laines. Elles servoient chez eux, comme parmi nous, aux vêtemens de toute espece. Curieux de celles qui surpassoient les autres en soie, en finesse, en mollesse, & en longueur, ils tiroient leurs belles toisons de la Galatie, de la Pouille, surtout de Tarente, de l'Attique & de Milet. Virgile célebre ces dernieres laines dans ses Géorgiques, & leurs teintures étoient fort estimées.
Milesia vellera nymphae
Carpebant.
Pline & Columelle vantent aussi les toisons de la Gaule. L'Espagne & l'Angleterre n'avoient encore rien en ce genre qui pût balancer le choix des autres contrées soumises aux conquérans du monde ; mais les Espagnols & les Anglois sont parvenus depuis à établir chez eux des races de bêtes à laine, dont les toisons sont d'un prix bien supérieur à tout ce que l'ancienne Europe a eu de plus parfait.
La qualité de la laine d'Espagne est d'être douce, soyeuse, fine, déliée, & molle au toucher. On ne peut s'en passer, quoiqu'elle soit dans un état affreux de mal-propreté, lorsqu'elle arrive de Castille. On la dégage de ces impuretés en la lavant dans un bain composé d'un tiers d'urine, & de deux tiers d'eau. Cette opération y donne un éclat solide, mais elle coûte un déchet de 53 pour cent. Cette laine a le défaut de fouler beaucoup plus que les autres, sur la longueur & sur la largeur des draps, dans la fabrique desquels elle entre toute seule. Quand on la mêle, ce doit être avec précaution, parce qu'étant sujette à se retirer plus que les autres, elle forme dans les étoffes de petits creux, & des inégalités très-apparentes.
Les belles laines d'Espagne se tirent principalement d'Andalousie, de Valence, de Castille, d'Aragon & de Biscaye. Les environs de Sarragosse pour l'Aragon, & le voisinage de Ségovie pour la Castille, fournissent les laines espagnoles les plus estimées. Parmi les plus fines de ces deux royaumes, on distingue la pile de l'Escurial, celles de Munos, de Mondajos, d'Orléga, de Torre, de Paular, la pile des Chartreux, celle des Jésuites, la grille & le refin de Ségovie ; mais on met la pile de l'Escurial au-dessus de toutes.
La laine est le plus grand objet du commerce particulier des Espagnols ; & non-seulement les François en emploient une partie considérable dans la fabrique de leurs draps fins, mais les Anglois eux-mêmes, qui ont des laines si fines & si précieuses, en font un fréquent usage dans la fabrique de leurs plus belles étoffes. On donne des noms aux laines d'Espagne, selon les lieux d'où on les envoie, ou selon leur qualité. Par exemple, on donne le nom commun de Ségovie aux laines de Portugal, de Roussillon & de Léon, parce qu'elles sont de pareille qualité.
La laine de Portugal a pourtant ceci de particulier, qu'elle foule sur la longueur, & non pas sur la largeur des draps où on l'emploie.
Les autres noms de laines d'Espagne, ou réputées d'Espagne, sont l'albarazin grand & petit, les ségéveuses de Moline, les sories ségovianes, & les sories communes. Les laines moliennes qu'on tire de Barcelone, les fleuretonnes communes de Navarre & d'Aragon, les cabésas d'Estramadoure, les petits campos de Séville : toutes ces laines font autant de classes différentes ; les ouvriers connoissent la propriété de chacune.
Les Espagnols séparent leurs laines en fines, moyennes & inférieures. Ils donnent à la plus fine le nom de prime ; celle qui suit s'appelle seconde ; la troisieme porte le nom de tierce. Ces noms servent à distinguer la qualité des laines de chaque canton ; & pour cela l'on a soin d'ajouter à ces dénominations le nom des lieux d'où elles viennent ; ainsi l'on dit prime de Ségovie, pour désigner la plus belle laine de ce canton, celle de Portugal, de Roussillon, &c. On nomme seconde ou refleuret de Ségovie, celle de la seconde qualité ; on appelle tierce de Ségovie les laines de la moindre espece.
L'Angleterre, je comprends même sous ce nom l'Ecosse & l'Irlande, est après l'Espagne le pays le plus abondant en magnifiques laines.
La laine choisie d'Angleterre, est moins fine & moins douce au toucher, mais plus longue & plus luisante que la laine d'Espagne. Sa blancheur & son éclat naturel la rendent plus propre qu'aucune autre à recevoir les belles teintures.
Les deux genres de laines dont nous venons de parler, les laines d'Angleterre & d'Espagne, sont les plus précieuses que la France emploie dans ses manufactures, en les mélangeant avec celles de son cru ; mais ce ne sont pas les seules dont elle ait besoin pour son commerce & sa consommation. Elle est obligée d'en tirer quantité du Levant & des pays du Nord, quelques inférieures en qualité que soient ces dernieres laines.
Celles du Levant lui arrivent par la voie de Marseille ; on préfere aux autres celles qui viennent en droiture de Constantinople & de Smyrne ; mais comme les Grecs & les Turcs emploient la meilleure à leurs usages, la bonne parvient difficilement jusqu'à nous. Les Turcs sachant que les François sont friands de leurs laines, fardent & déguisent autant qu'ils peuvent, ce qu'ils ont de plus commun, & le vendent aux Négocians pour de véritables laines de Constantinople & de Smyrne. Celles des environs d'Alexandrie, d'Alep, de l'île de Chypre & de la Morée sont passables ; faute d'autres, on les prend pour ce qu'elles valent, & nos marchands sont souvent trompés, dans l'obligation d'en accaparer un certain nombre de balles pour faire leur charge.
Les laines du Nord, les plus estimées dans nos manufactures, sont celles du duché de Weymar. On en tire aussi d'assez bonnes de la Lorraine & des environs du Rhin. Enfin nos fabriques usent des laines de Hollande & de Flandre, suivant leurs qualités.
Mais il est tems de parler des laines du cru du royaume, de leurs différentes qualités, de leur emploi, & du mêlange qu'on en fait dans nos manufactures, avec des laines étrangeres.
Les meilleures laines de France sont celles du Roussillon, de Languedoc, du Berry, de Valogne, du Cotentin, & de toute la basse-Normandie. La Picardie & la Champagne n'en fournissent que d'inférieures à celles des autres provinces.
Les toisons du Roussillon, du Languedoc, & de la basse-Normandie, sont sans difficulté les plus riches & les plus précieuses qu'on recueille en France, quoiqu'elles ne soient pas les seules employées. Le Dauphiné, le Limousin, la Bourgogne & le Poitou fournissent aussi de bonnes toisons.
Le Berry & le Beauvoisis sont de tout le royaume les lieux les plus garnis de bêtes à laines ; mais les toisons qui viennent de ces deux pays, différent totalement en qualité. Les laines de Sologne & de Berry sont courtes & douces à manier, au lieu que celles de Beauvais ont beaucoup de rudesse & de longueur ; heureusement elles s'adoucissent au lavage.
On tire encore beaucoup de laines de la Gascogne & de l'Auvergne : Bayonne en produit de deux sortes. La laine qui croit sur les moutons du pays, est plus semblable à de longs poils, qu'à de véritables toisons. La race des brebis flandrines qu'on y a établie depuis près d'un siecle, y a passablement réussi. Elles fournissent des toisons qui surpassent en bonté celles qui nous viennent du Poitou & des marais de Charante.
Toutes ces laines trouvent leur usage dans nos manufactures, à raison de leur qualité. La laine de Roussillon entre dans la fabrique de nos plus beaux draps, sous le nom de Ségovie. Celles du Languedoc décorées du même titre par les facteurs des Fabriquans, servent au même usage. La laine du Berry entre dans la fabrique des draps de Valogne & de Vire ; & c'est aussi avec ces laines que l'on fait les draps qui portent le nom de Berry, de même que les droguets d'Amboise, en y mêlant un peu de laine d'Espagne. Les laines de Valogne & du Cotentin s'emploient en draps de Valogne & de Cherbourg, & en serges tant finettes que razs de S. Lo. On assortit ces laines avec les belles d'Angleterre.
Les laines de Caux, apprêtées comme il convient, sont propres aux pinchinats de Champagne, que l'on fabrique avec les laines de cette province. L'on en fait des couvertures & des chaînes pour plusieurs sortes d'étoffes, & entr'autres pour les marchandises de Rheims & d'Amiens. Les grosses laines de Bayonne servent aux lisieres des draps noirs, en y mêlant quelques poils d'autruche & de chameau.
L'on voit déja que toutes les qualités de laines ont leur usage, à raison du mérite de chacune. Celles que le bonnetier ou le drapier rejettent comme trop fortes ou trop grossieres, le tapissier les assortit pour ses ouvrages particuliers. Dévoilons donc cet emploi de toutes sortes de laines dans nos différentes manufactures.
On peut partager en trois classes les fabriquans qui consument les laines dans leurs atteliers ; ce sont des drapiers drapans, des bonnetiers, & des tapissiers.
La draperie est, comme l'on sait, l'art d'ourdir les étoffes de laine. On range sous cette classe les serges, les étoffes croisées & les couvertures. Le drap est de tous les tissus le plus fécond en commodités, le plus propre à satisfaire le goût & les besoins des nations : aussi consomme-t-il les laines les plus belles & les plus précieuses.
Les ouvrages de bonnetterie s'exécutent sur le métier ou au tricot. Cette derniere façon est la moins coûteuse ; elle donne à l'homme une couverture très parfaite, qui forme un tout sans assemblage & sans couture.
Les Tapissiers font servir la laine à mille ouvrages divers ; ils l'employent en tapisseries soit au métier, soit à l'aiguille, en matelats, en fauteuils, en moëtes, &c. On en fait du fil à coudre, des chapeaux, des jarretieres, & cent sortes de marchandises qu'il seroit trop long d'énoncer ici.
La laine d'Espagne entre dans la fabrique de nos plus beaux draps en usant de grandes précautions pour l'assortir aux laines qui sont du crû de la France. J'ai déja dit que la laine d'Espagne la plus recherchée, est celle qui vient en droiture de l'Escurial : on l'emploie presque sans mêlange avec succès dans la manufacture des Gobelins. La prime de Ségovie & de Villecassin, sert pour l'ordinaire à faire des draps des ratines, & autres semblables étoffes façon d'Angleterre & de Hollande. La ségoviane ou refleuret sert à fabriquer des draps d'Elboeuf ou autres de pareille qualité. La tierce n'entre que dans les draps communs, comme dans ceux de Rouen ou de Darnetal. Les couvertures & les bas de Ségovie ont beaucoup de débit, parce qu'ils sont moëlleux, doux au toucher, & d'un excellent usé.
Cette laine néanmoins malgré son extrème finesse, n'est pas propre à toutes sortes d'ouvrages. Il en est qui demandent de la longueur dans la laine ; par exemple, il seroit imprudent d'employer la magnifique laine d'Espagne à former les chaînes des tapisseries que l'on fabrique aux Gobelins : la perfection de l'ouvrage exige que les chaînes avec beaucoup de portée soient fortement tendues, & que leur tissu, sans être épais, soit assez ferme, assez élastique pour résister aux coups & au maniement des ouvriers qui sans-cesse les tirent, les frappent & les allongent.
La laine d'Angleterre est donc la seule que sa longueur rende propre à cet usage. Quel effet ne fait point sur nos yeux l'éclat de sa blancheur ? Elle est la seule qui par sa propreté reçoive parfaitement les couleurs de feu & les nuances les plus vives. On assortit très-bien la laine d'Angleterre à la laine de Valogne & du Cotentin. Elle entre dans la fabrique des draps de Valogne, serges façon de londres, &c. On en fait en bonnetterie des bas de bouchons, & de très-belles couvertures : on la carde rarement ; peignée & filée, elle sert à toutes sortes d'ouvrages à l'aiguille & sur le cannevas.
La plûpart des laines du levant ne vaudroient pas le transport si l'on se donnoit la peine de les voiturer jusqu'à Paris. On les employe dans les manufactures de Languedoc & de Provence, à raison de leurs qualités. On fait usage des laines du nord avec la même reserve. Les meilleures toisons de Weymar & les laines d'été de Pologne, servent à la fabrique des petites étoffes de Rheims & de Champagne.
En un mot il n'est aucune espece de laines étrangeres ou françoises que nos ouvriers ne mettent en oeuvre, depuis le drap de Julienne, de Van Robais, de Pagnon, de Rousseau, & le beau camelot de Lille en Flandres, jusqu'aux draps de tricot & de Poulangis, & jusqu'au gros bouracan de Rouen. Il n'est point de qualité de laines que nous n'employons & n'apprêtions avec une variété infinie, en étamine, en serge, en voile, en espagnolette, & en ouvrages de tout genre.
Mais, dira quelqu'un, cet étalage pompeux & mercantile que vous venez de nous faire de l'emploi de toutes sortes de laines, n'est pas une chose bien merveilleuse dans une monarchie où tout se débite ; le bon, le médiocre, le mauvais & le très-mauvais. Il vaudroit bien mieux nous apprendre si l'on ne pourroit pas se passer dans notre royaume des laines étrangeres, notamment de celles d'Espagne & d'Angleterre, en perfectionnant la qualité & en augmentant la quantité de nos laines en France. Voilà des objets de discussion qui seroient dignes d'un Encyclopédiste. Eh bien, sans perdre le tems en discours superflus, je vais examiner par des faits si les causes qui procurent aux Espagnols & aux Anglois des laines supérieures en qualité, sont particulieres à leur pays, & exclusives pour tout autre.
L'Espagne eut le sort des contrées soumises aux armes romaines, de nombreuses colonies y introduisirent le goût du travail & de l'agriculture. Un riche métayer de Cadix, Marc Columelle (oncle du célebre écrivain de ce nom), qui vivoit comme lui sous l'empire de Claude, & qui faisoit ses délices des douceurs de la vie champêtre, fut frappé de la blancheur éclatante des laines qu'il vit sur des moutons sauvages que des marchands d'Afrique débarquoient pour les spectacles. Sur-le-champ il prit la résolution de tenter s'il seroit possible d'apprivoiser ces bêtes, & d'en établir la race dans les environs de Cadix. Il l'essaya avec succès ; & portant plus loin ses expériences, il accoupla des béliers africains avec des brebis communes. Les moutons qui en vinrent avoient, avec la délicatesse de la mere, la blancheur & la qualité de la laine du pere.
Cependant cet établissement ingénieux n'eut point de suite, parce que sans la protection des souverains, les tentatives les mieux conçues des particuliers sont presque toujours des spéculations stériles.
Plus de treize siecles s'écoulerent depuis cette époque, sans que personne se soit avisé en Espagne de renouveller l'expérience de Columelle. Les Goths, peuple barbare, usurpateurs de ce royaume, n'étoient pas faits pour y songer, encore moins les Musulmans d'Afrique qui leur succederent. Ensuite les Chrétiens d'Espagne ne perfectionnerent pas l'Agriculture, en faisant perpétuellement la guerre aux Maures & aux Mahométans, ou en se la faisant malheureusement entr'eux.
Dom Pedre IV. qui monta sur le trône de Castille en 1350, fut le premier depuis Columelle, qui tenta d'augmenter & d'améliorer les laines de son pays. Informé du profit que les brebis de Barbarie donnoient à leurs propriétaires, il résolut d'en établir la race dans ses états. Pour cet effet il profita des bonnes volontés d'un prince Maure, duquel il obtint la permission de transporter de Barbarie en Espagne un grand nombre de béliers & de brebis de la plus belle espece. Il voulut, par cette démarche, s'attacher l'affection des Castillans, afin qu'ils le soutinssent sur le trône contre le parti de ses freres bâtards, & contre Eleonore leur mere.
Selon les regles de l'économie la plus exacte, & selon les lois de la nature, le projet judicieux de Dom Pedre, taillé dans le grand & soutenu de sa puissance, ne pouvoit manquer de réussir. Il étoit naturel de penser qu'en transplantant d'un lieu défavorable une race de bêtes mal nourries, dans des pâturages d'herbes fines & succulentes, où le soleil est moins ardent, les abris plus fréquens, & les eaux plus salutaires, les bêtes transplantées produiroient de nombreux troupeaux couverts de laines fines, soyeuses & abondantes. Ce prince ne se trompa point dans ses conjectures, & la Castille acquit au quatorzieme siecle un genre de richesses qui y étoit auparavant inconnu.
Le cardinal Ximenès, devenu premier ministre d'Espagne au commencement du seizieme siecle, marcha sur les traces heureuses de Dom Pedre, & à son exemple, profita de quelques avantages que les troupes de Ferdinand avoient eu sur les côtes de Barbarie, pour en exporter des brebis & des béliers de la plus belle espece. Il les établit principalement aux environs de Ségovie, où croit encore la plus précieuse laine du royaume. Venons à l'Angleterre.
Non-seulement la culture des laines y est d'une plus grande ancienneté qu'en Espagne, mais elle y a été portée, encouragée, maintenue & perfectionnée avec une toute autre attention.
Si l'Angleterre doit à la température de son climat & à la nature de son sol l'excellente qualité de ses laines, elle commença à être redevable de leur abondance au partage accidentel de ses terres, fait en 830 ; partage qui invita naturellement ses habitans à nourrir de grands troupeaux de toutes sortes de bestiaux. Ils n'avoient d'autre moyen que celui-là pour jouir de leur droit de communes, perpétué jusqu'à nos jours, & ce droit fut longtems le seul objet de l'industrie de la nation. Ce grand terrein, destiné au paturage, s'augmenta par l'étendue des parcs que les seigneurs s'étoient reservés pour leur chasse, leurs daims & leurs propres bestiaux.
Les Anglois ne connurent pas d'abord toute l'étendue de la richesse qu'ils possédoient. Ils ne savoient dans le onzieme & douzieme siecle que se nourrir de la chair de leurs troupeaux ; & se couvrir de la toison de leurs moutons ; mais bientôt après ils apprirent le mérite de leurs laines par la demande des Flamands, qui seuls alors avoient des manufactures. Un auteur anglois, M. Daniel Foc, fort instruit des choses de son pays, dit que sous Edouard III. entre 1327 & 1377, c'est-à-dire dans l'espace de 50 ans, l'exportation des laines d'Angleterre monta à plus dix millions de livres sterling, valeur présente 230 millions tournois.
Dans cet intervalle de 1327 & 1377, Jean Kemp, flamand, porta le premier dans la Grande-Bretagne l'art de travailler des draps fins ; & cet art fit des progrès si rapides, par l'affluence des ouvriers des Pays-bas, persécutés dans leur patrie, qu'Edouard IV. étant monté sur le trône en 1461, n'hésita pas de défendre l'entrée des draps étrangers dans son royaume. Richard III. prohiba les apprêts & mauvaises façons qui pouvoient faire tomber le débit des draps anglois, en altérant leur qualité. L'esprit de commerce vint à se développer encore davantage sous Henri VII. & son fils Henri VIII. continua de protéger, de toute sa puissance, les manufactures de son royaume, qui lui doivent infiniment.
C'est lui qui pour procurer à ses sujets les laines précieuses de Castille, dont ils étoient si curieux pour leurs fabriques, obtint de Charles-Quint l'exportation de trois mille bêtes blanches. Ces animaux réussirent parfaitement bien en Angleterre, & s'y multiplierent en peu de tems, par les soins qu'on mit en oeuvre pour élever & conserver cette race précieuse. Il n'est pas inutile de savoir comment on s'y prit.
On établit une commission pour présider à l'entretien & à la propagation de cette espece. La commission fut composée de personnes intelligentes & d'une exacte probité. La répartition des bêtes nouvellement arrivées de Castille, leur fut assignée ; & l'événement justifia l'attente du souverain, qui avoit mis en eux sa confiance.
D'abord ils envoyerent deux de ces brebis castillanes, avec un bélier de même race, dans chacune des paroisses dont la température & les paturages parurent favorables à ces bêtes. On fit en même tems les plus sérieuses défenses de tuer ni de mutiler aucun de ces animaux pendant l'espace de sept années. La garde de ces trois bêtes fut confiée à peu-près comme celle de nos chevaux-étalons, à un gentleman ou au plus notable fermier du lieu, attachant à ce soin des exemptions de subsides, quelque droit honorifique ou utile.
Mais afin de tirer des conjonctures tout l'avantage possible, on fit saillir des béliers espagnols sur des brebis communes. Les agneaux qui provinrent de cet accouplement, tenoient de la force & de la fécondité du pere à un tiers près. Cette pratique ingénieuse, dont on trouve des exemples dans Columelle, fut habilement renouvellée. Elle fit en Angleterre quantité de bâtards espagnols, dont les mâles communiquerent leur fécondité aux brebis communes. C'est par cette raison qu'il y a actuellement dans la Grande-Bretagne trois sortes précieuses de bêtes à laine.
Voilà comme Henri VIII. a contribué à préparer la gloire dont Elisabeth s'est couronnée, en frayant à la nation angloise le chemin qui l'a conduite à la richesse dont elle jouit aujourd'hui. Cette reine considérant l'importance d'assurer à son pays la possession exclusive de ses laines, imposa les peines les plus rigoureuses à l'exportation de tout bélier, brebis ou agneau vivant. Il s'agit dans ses statuts de la confiscation des biens, de la prison d'un an, & de la main coupée pour la premiere contravention ; en cas de récidive, le coupable est puni de mort.
Ainsi le tems ouvrit les yeux des Anglois sur toutes les utilités qu'ils pouvoient retirer de leurs toisons. Les Arts produisirent l'industrie : on défricha les terres communes. On se mit à enclorre plusieurs endroits pour en tirer un plus grand profit. On les échauffa & on les engraissa, en tenant dessus des bêtes à laine. Ainsi le paturage fut porté à un point d'amélioration inconnu jusqu'alors ; l'espece même des moutons se perfectionna par l'étude de la nourriture qui leur étoit la plus propre, & par le mélange des races. Enfin la laine devint la toison d'or des habitans de la Grande-Bretagne.
Les successeurs d'Elisabeth ont continué de faire des réglemens très-détaillés sur la police des manufactures de laines, soit pour en prévenir la dégradation, soit pour en avancer les progrès ; mais on dit qu'on ne conserve aujourd'hui ces réglemens que par forme d'instruction, & que les Anglois, qui se regardent comme les plus habiles fabriquans du monde, & les plus soutenus par la seule émulation, laissent beaucoup de liberté à leurs manufactures, sans avoir lieu de s'appercevoir encore que leur commerce en soit diminué.
Le seul point sur lequel ils soient un peu séveres, c'est sur le mélange des laines d'une mauvaise qualité dans la tissure des draps larges. Du reste, le gouvernement, pour encourager les manufactures, a affranchi de droits de sortie les draps & les étoffes de lainage. Tout ce qui est destiné pour l'apprêt des laines, a été déchargé sous la reine Anne d'une partie des impositions qui pouvoient renchérir cette marchandise. En même tems le parlement a défendu l'exportation des instrumens qui servent dans la fabrique des étoffes de lainerie.
Ces détails prouvent combien le gouvernement peut favoriser les fabriques, combien l'industrie peut perfectionner les productions de la nature ; mais cette industrie ne peut changer leur essence. Je n'ignore pas que la nature est libérale à ceux qui la cultivent, que c'est aux hommes à l'étudier, à la suivre & à l'embellir ; mais ils doivent savoir jusqu'à quel point ils peuvent l'enrichir. On se préserve des traits enflammés du soleil, on prévient la disette, & on remédie aux stérilités des années ; on peut même, à force de travaux, détourner le cours & le lit des fleuves. Mais qui fera croître le thim & le romarin sur les côteaux de Laponie, qui ne produisent que de la mousse ? Qui peut donner aux eaux des fleuves des qualités médicinales & bienfaisantes qu'elles n'ont pas ?
L'Espagne & l'Angleterre jouissent de cet avantage sur les autres contrées du monde, qu'indépendamment des races de leurs brebis, le climat, les paturages & les eaux y sont très-salutaires aux bêtes à laine. La température & les alimens font sur les animaux le même effet qu'une bonne terre fait sur un arbre qu'on vient d'arracher d'un mauvais terrein, & de transplanter dans un sol favorable : il prospere à vûe d'oeil, & produit abondamment de bons fruits.
On éprouve en Espagne, & sur-tout en Castille, des chaleurs bien moins considérables qu'en Afrique ; le climat y est plus tempéré. Les montagnes de Castille sont tellement disposées, qu'on y jouit d'un air pur & modérement chaud. Les exhalaisons qui montent des vallées, émoussent les rayons du soleil ; & l'hiver n'a point de rigueur qui oblige à renfermer les troupeaux pendant les trois mois de sa durée.
Où trouve-t-on des paturages aussi parfaits que ceux de la Castille & de Léon ? Les herbes fines & odoriférantes, communiquent au sang de l'animal un suc précieux, qui fait germer sur sa peau une infinité de filets, aussi moëlleux, aussi doux au toucher, qu'ils flatent agréablement la vûe par leur blancheur, quand la malpropreté ne les a pas encore salies. Ce n'est pas exagérer de dire que l'Espagne a des eaux d'une qualité presque unique. On y voit des ruisseaux & des rivieres, dont l'eau opere visiblement la guérison des maladies, auxquelles les moutons sont sujets. Les voyageurs & les Géographes citent entr'autres le Xenil & le Daro, qui tous deux tirent leur source de la Sierra-Nevada, montagne de Grenade. Leurs eaux ont une vertu incisive, qui purifie la laine, & rend la santé aux animaux languissans ; c'est pour cela que dans le pays on nomme ces deux fleuves, le bain salutaire des brebis.
L'Angleterre réunit ces mêmes avantages dans un degré très-éminent. Sa température y est aussi salutaire aux brebis, que l'est celle de l'Espagne ; & on y est bien moins sujet qu'en France, aux vicissitudes des saisons. Comme les abris sont fréquens en Angleterre, & que le froid y est généralement doux, on laisse d'ordinaire les bêtes à laine pâturer nuit & jour dans les plaines ; leurs toisons ne contractent aucune saleté, & ne sont point gâtées par la fiente, ni l'air épais des étables. Les Espagnols ni les François ne sauroient en plusieurs lieux imiter les Anglois dans cette partie à cause des loups ; la race de ces animaux voraces, une fois extirpée de l'Angleterre, ne peut plus y rentrer : ils y étoient le fléau des laboureurs & des bergers, lorsque le roi Edgard, l'an 961, vint à bout de les détruire en trois ans de tems, sans qu'il en soit resté un seul dans les trois royaumes.
Leurs habitans n'ont plus besoin de l'avis de l'auteur des Géorgiques pour la garde de leurs troupeaux.
Nec tibi cura canûm fuerit postrema, sed unâ
Veloces Spartae catulo, acremque molossum
Pasce sero pingui ; nunquam custodibus illis
Incursus luporum horrebis.
Les Anglois distinguent autant de sortes de pâturages, qu'ils ont d'especes de bêtes à laine ; chaque classe de moutons a pour ainsi dire son lot & son domaine. Les herbes fines & succulentes que l'on trouve abondamment sur un grand nombre de côteaux & sur les landes, conviennent aux moutons de la premiere espece. N'allez point les conduire dans les grands pâturages, ou la qualité de la laine changeroit, ou l'animal périroit ; c'est ici pour eux le cas de suivre le conseil que donnoit Virgile aux bergers de la Pouille & de Tarente ; " Fuyez les paturages trop abondans : Fuge pabula laeta. "
Les Anglois ont encore la bonne habitude d'ensemencer de faux seigle les terres qui ne sont propres à aucune autre production ; cette herbe plus délicate que celle des prairies communes, est pour les moutons une nourriture exquise ; elle est l'aliment ordinaire de cette seconde espece, à qui j'ai donné ci-dessus le nom de bâtards espagnols.
L'ancienne race des bêtes à laine s'est perpétuée en Angleterre ; leur nourriture demande moins de soin & moins de précaution que celle des autres. Les prés & les bords des rivieres leur fournissent des pâturages excellens ; leur laine, quoique plus grossiere, trouve son emploi, & la chair de ces animaux est d'un grand débit parmi le peuple.
C'est en faveur de cette race, & pour ménager le soin des prairies, qu'on introduisit au commencement de ce siecle l'usage de nourrir ce bétail de navets ou turnipes ; on les seme à peu-près comme le gros seigle dans les friches, & ces moutons naturellement forts, en mangent jusqu'à la racine, & fertilisent les landes sur lesquelles on les tient.
Les eaux en Angleterre ont assez la même vertu que celles d'Espagne ; mais elles y produisent un effet bien plus marqué. Les Anglois jaloux de donner à leurs laines toute la blancheur possible, sont dans la louable coutume de les laver sur pié, c'est-à-dire sur le dos de l'animal. Cette pratique leur vaut un double profit ; les laines tondues sont plus aisées à laver, elles deviennent plus éclatantes, & ne souffrent presque point de déchet au lavage. Voyez LAINE, apprêt des.
Enfin la grande-Bretagne baignée de la mer de toutes parts, jouit d'un air très-favorable aux brebis, & qui differe à leur avantage de celui qu'elles éprouvent dans le continent. Les paturages qu'elles mangent, & l'air qui les environne, imprégnés des vapeurs salines que les vents y charrient sans-cesse, de quelque part qu'ils soufflent, font passer aux poumons & au sang des bêtes blanches, un acide qui leur est salutaire ; elles trouvent naturellement dans ce climat tout ce que Virgile recommande qu'on leur donne, quand il dit à ses bergers :
At cui lactis amor, cytisum, lotosque frequentes,
Ipse manu, salsasque ferat praesepibus herbas ;
Hinc & amant fluvios magis, & magis ubera tendunt,
Et salis occultum referunt in lacte saporem.
Georg. liv. III. v. 392.
Il est donc vrai que le climat tempéré d'Angleterre, les races de ses brebis, les excellens paturages où l'on les tient toute l'année, les eaux dont on les lave & dont on les abreuve, l'air enfin qu'elles respirent, favorisent exclusivement aux autres peuples la beauté & la quantité de leurs bêtes à laine.
Pour donner en passant une idée de la multitude surprenante & indéterminée qu'on en éleve dans les trois royaumes, M. de Foé assure que les 605, 520 livres que l'on tire par année des moutons de Rumney-marsh, ne forment que la deux-centieme partie de la récolte du royaume. Les moutons de la grande espece fournissent depuis cinq jusqu'à huit livres de laine par toison ; les béliers de ces troupeaux ont été achetés jusqu'à douze guinées. Les laines du sud des marais de Lincoln & de Leicester doivent le cas qu'on en fait à leur longueur, leur finesse, leur douceur & leur brillant : les plus belles laines courtes, sont celles des montagnes de Cotswold en Glocester-Shire.
En un mot, l'Angleterre par plusieurs causes réunies, possede en abondance les laines les plus propres pour la fabrication de toutes sortes d'étoffes, si l'on en excepte seulement les draps superfins, qu'elle ne peut fabriquer sans le secours des toisons d'Espagne. Ses ouvriers savent faire en laine depuis le drap le plus fort ou le plus chaud, jusqu'à l'étoffe la plus mince & la plus légere. Ils en fabriquent à raies & à fleurs qui peuvent tenir lieu d'étoffes de soie, par leur légéreté & la vivacité de leurs couleurs. Ils font aussi des dentelles de laine fort jolies, des rubans, des chemises de flanelle, des fichus & des coëffes de crêpes blancs. Enfin ils vendent de leur lainerie à l'étranger, selon les uns, pour deux ou trois millions, & selon d'autres pour cinq millions sterlings.
Mais sans m'arrêter davantage à ces idées accessoires, qui ne nous intéressent qu'indirectement, & sans m'étendre plus au long sur l'objet principal, je crois qu'il résulte avec évidence de la discussion dans laquelle je suis entré au sujet des laines d'Espagne & d'Angleterre, que trois choses concourent à leur procurer des qualités supérieures qu'on ne peut obtenir ailleurs, la race, les paturages & le climat. J'ajoûte même pour surcroît de preuves, que les moutons de Castille & d'Andalousie, transportés dans les belles plaines de Salisbury, n'y donnent pas des laines aussi précieuses, quas baeticus adjuvat aër.
Je conclus donc avec les personnes les plus éclairées de ce royaume, qu'il est tout-à-fait impossible à la France de se passer des laines étrangeres, & que sans le secours des riches toisons qui lui viennent des îles Britanniques & d'Espagne, les manufactures des Gobelins, d'Abbeville & de Sedan, tomberoient bientôt dans le discrédit, & ne pourroient pas même subsister.
Je suis cependant bien éloigné de penser qu'on ne soit maître en France de perfectionner la qualité, & d'augmenter la quantité des laines qu'on y recueille ; mais ce tems heureux n'est pas près de nous, & trop d'obstacles s'opposent à nous flatter de l'espérance de le voir encore arriver. (D.J.)
LAINES, apprêt des (Economie rustique & Manufactures) ce sont les différentes façons qu'on donne aux laines.
Les laines avant que d'être employées reçoivent bien des façons, & passent par bien des mains. Après que la laine a été tondue, on la lave, on la trie, on l'épluche, on la drousse, on la carde, ou on la peigne suivant sa qualité ; ensuite on la mêle, & on la file. Expliquons toutes ces façons ; j'ai lu d'excellens mémoires qui m'en ont instruit.
1°. Tonte. Les anciens arrachoient leurs laines, ils ne la tondoient pas ; vellus à vellendo. Ils prenoient pour cette opération le tems où la laine se sépare du corps de l'animal ; & comme toute la toison ne quitte pas à la fois, ils couvroient de peaux pendant quelques semaines chaque bête à laine, jusqu'à ce que toute la toison fût parvenue au degré de maturité qu'il falloit, pour ne pas causer à ces bêtes des douleurs trop cuisantes. Cette coutume prévaloit encore sous Vespasien dans plusieurs provinces de l'empire ; aujourd'hui elle est avec raison totalement abandonnée.
Quand le tems est venu de décharger les moutons du poids incommode de leur laine, on prend les mesures suivantes. Les laboureurs intelligens préviennent cette opération, en faisant laver plusieurs fois sur pié la laine avant que de l'abattre.
Cette maniere étoit pratiquée chez les anciens ; elle est passée en méthode parmi les Anglois, qui doivent principalement à ce soin l'éclat & la blancheur de leurs laines. Débarrassée du suin & des matieres graisseuses qui enveloppoient ses filets, elle recouvre le ressort & la flexibilité qui lui est propre. Les poils detenus jusques-là dans la prison de leur surge, s'élancent avec facilité, se fortifient en peu de jours, prennent du corps, & se rétablissent dans leur état naturel ; au lieu que le lavage qui succede à la coupe, dégage seulement la laine de ses saletés, sans lui rendre sa premiere qualité & son ancienne consistance.
Pour empêcher que le tempérament de l'animal ne s'altere par le dépouillement de son vêtement, on a soin d'augmenter sa nourriture, à mesure qu'on approche du terme de sa tonte.
Quand l'année a été pluvieuse, il suffit que chaque mouton ait été lavé quelques jours consécutifs, avant celui où on le décharge de sa laine ; mais si l'année a été seche, il faut disposer chaque bête à cette opération, en la lavant quinze jours, un mois auparavant. Cette pratique prévient le déchet de la laine qui est très-considérable, lorsque l'année a été trop seche. On doit préférer l'eau de la mer à l'eau douce, l'eau de pluie à l'eau de riviere ; dans les lieux où l'on manque absolument de ces secours, on mêle du sel dans l'eau qu'on fait servir à ce lavage.
La laine, comme les fruits, a son point de maturité ; on tond les brebis suivant les saisons & selon le climat. Dans le Piémont on tond trois fois l'année, en Mai, en Juillet & en Novembre ; dans les lieux où l'on tond deux fois l'an, la premiere coupe des laines se fait en Mars, la seconde en Août ; les toisons de la seconde coupe sont toujours inférieures en qualité à celles de la premiere. En France on ne fait communément qu'une tonte par an, en Mai ou en Juin ; on tond les agneaux en Juillet.
Si dans le grand nombre il se rencontre quelque bête qui soit attaquée de maladie, il faut bien se garder de la dégarnir, la laine en seroit défectueuse, & l'on exposeroit la vie de l'animal.
Après avoir pris toutes les mesures que je viens d'exposer, il seroit imprudent de fixer tellement un jour pour abattre les laines, qu'on ne fût plus maître de différer l'opération, supposé qu'il survînt quelque intempérie ; il faut en général choisir un tems chaud, un ciel serein, qui semble promettre plusieurs belles journées consécutives. N'épargnez rien pour avoir un tondeur habile ; c'est un abus commun à bien des laboureurs de faire tondre leurs bêtes par leurs bergers, & cela pour éviter une légere dépense, qu'il importe ici de savoir sacrifier, même dans l'état de pauvreté.
C'est une bonne coutume que l'on néglige dans bien des endroits, de couvrir d'un drap l'aire où l'on tond la laine ; il faut que le lieu soit bien sec & bien nettoyé. Chaque robe de laine abattue doit être repliée séparément, & déposée dans un endroit fort aéré. On laisse la laine en pile le moins de tems qu'il est possible ; il convient de la porter sur le champ au lavage, de peur que la graisse & les matieres hétérogènes dont elle est imprégnée, ne viennent à rancir & à moisir, ce qui ne manqueroit pas d'altérer considérablement sa qualité.
Une tonte bien faite est une préparation à une pousse plus abondante. On lave les moutons qu'on a tondus ; afin de donner à la nouvelle laine un essor plus facile ; alors comme avant la tonte, l'eau de la mer est préférable à l'eau douce pour les laver, l'eau de pluie & l'eau salée, à l'eau commune des ruisseaux & des fleuves.
Les forces, en séparant les filets de leurs tiges, laissent à chaque tuyau comme autant de petites blessures, que l'eau salée referme subitement. Les anciens au lieu de laver leurs bêtes après la tonte, les frottoient de lie d'huile ou de vin, de vieux-oint, de soufre, ou de quelqu'autre liniment semblable ; & je crois qu'ils faisoient mal, parce qu'ils arrêtoient la transpiration.
La premiere façon que l'on donne à la toison qui vient d'être abattue, c'est de l'émécher ; c'est-à-dire de couper avec les forces l'extrémité de certains filets, qui surpassent le niveau de la toison ; la qualité de ces filets excédens, est d'être beaucoup plus grossiers, plus durs & plus secs que les autres ; leur mélange seroit capable de dégrader toute la toison.
2°. Lavage. La laine en surge porte avec elle un germe de corruption dans cette crasse, qu'on nomme aesipe, quand elle est détachée de la laine. Elle provient d'une humeur onctueuse, qui en sortant des pores de l'animal, facilite l'entrée du suc nourricier dans les filets de la toison ; sans cette matiere huileuse qui se reproduit continuellement, le soleil dessécheroit le vêtement de la brebis, comme il seche les moissons ; & la pluie qui ne tient pas contre cette huile séjournant dans la toison, pourriroit bientôt la racine de la laine.
Cette secrétion continuelle des parties graisseuses forme à la longue un sédiment, & de petites croûtes qui gâtent la laine, sur-tout pendant les tems chauds.
On lave les laines depuis le mois de Juin jusqu'à la fin d'Août ; c'est le tems le plus favorable de toute l'année, outre qu'il suit immédiatement l'opération de la tonte, il a encore cet avantage, que l'eau adoucie & attiédie en quelque sorte par la chaleur des rayons du soleil, détache & emporte plus facilement les malpropretés qui sont comme adhérentes à la laine.
Plus on differe le lavage des laines ; plus le déchet est considérable ; il est souvent de moitié ; les laines de Castille perdent cinquante-trois pour cent. Ce déchet suit cependant un peu les années ; l'altération est plus forte quand il n'a pas plu vers le tems de la coupe, que quand la saison a été pluvieuse. Le moyen le plus sûr d'éviter le déchet, où de le diminuer beaucoup lorsque la saison a été séche, c'est de laver la laine à dos plusieurs semaines ; & même des mois entiers avant le tems de la tonte.
Je ne puis ici passer sous silence deux abus qui intéressent la qualité de nos laines ; l'un regarde les laboureurs, l'autre concerne les bouchers.
C'est une nécessité indispensable aux premiers de distinguer leurs moutons par quelque marque. Deux troupeaux peuvent se rencontrer & se mêler ; on peut enlever un ou plusieurs moutons ; la marque décele le larcin ; enfin les pâturages de chaque ferme ont des limites, & cette marque est une condamnation manifeste pour le berger qui conduit son troupeau dans un territoire étranger. Ce caractere est donc nécessaire, l'abus ne consiste que dans la maniere de l'appliquer. Nos laboureurs de l'Ile de France & de la Picardie, plaquent ordinairement sans choix des couleurs trempées dans l'huile, sur la partie la plus précieuse de la toison, sur le dos ou sur les flancs ; ces marques ne s'en vont point au lavage ; elles restent ordinairement collées & adhérentes à la toison, & souvent les éplucheurs négligent de séparer de la laine les croûtes qu'elles forment, parce que cette opération demande trop de tems. Que suit-il de-là ? Ces croûtes passant dans le fil & dans les étoffes qu'on en fabrique, les rendent tout-à-fait défectueuses ; il est un moyen fort simple d'obvier à cet abus. On peut marquer les moutons à l'oreille par une marque latérale, perpendiculaire ou transversale, & ces marques peuvent varier à l'infini, en prenant l'oreille gauche ou l'oreille droite, ou les deux oreilles, &c.
Si cependant la nature du lieu demandoit un signe plus apparent, on pourroit marquer les moutons à la tête comme on fait en Berri ; la toison par ce moyen ne souffre aucun dommage.
L'autre abus ne concerne que les pélades, mais il ne mérite pas moins notre attention. Les bouchers, au lieu de ménager les toisons des peaux qu'ils abattent, semblent mettre tout en oeuvre pour les salir ; ils les couvrent de graisse & de tout ce qu'il y a de plus infect. Il est d'autres détails qu'il ne seroit pas amusant de lire ni d'exposer, & que la police pourroit facilement proscrire, sans nuire à ces sortes ne gens, qui d'ailleurs sont les derniers de la lie des hommes ; l'on épargneroit par-là de la peine aux mégissiers, & cette laine dans son espece, seroit d'une meilleure qualité.
On lave la laine par tas dans l'eau dormante, à la manne dans l'eau courante, & dans des cuves pleines d'eau de riviere. Les laines trop malpropres & difficiles à décrasser (comme celles d'Espagne) se dégorgent dans un bain composé d'un tiers d'urine, & de deux tiers d'eau ; ce seroit je pense la meilleure méthode pour toutes nos laines.
Toutes les rivieres ne sont pas également propres au lavage. Les eaux de Beauvais ont une qualité excellente, on pourroit en tirer parti mieux qu'on ne fait, en établissant dans cette ville une espece de buanderie générale pour les laines du pays. Quand la laine a passé par le lavage, on la met égoutter sur des claies.
Les manufacturiers doivent se précautionner, s'il est possible, contre un grand nombre de supercheries frauduleuses. Par exemple, quand l'année a été séche. les Laboureurs ou les Marchands qui tiennent les laines de la premiere main, les font mal laver, afin d'éprouver moins de déchet. Qu'arrive-t-il alors ? Pour empêcher la graisse & les ordures de paroître, ils fardent les toisons qu'ils blanchissent avec de la craye, ou d'autres ingrédiens qu'ils imaginent. Les suites de cette manoeuvre ne peuvent être que très-funestes, soit au fabriquant, soit au public. Si l'on emploie la laine comme on l'achete, l'étoffe n'en vaut rien, les vers & les mites s'y mettent au bout de peu de tems, & l'acheteur perd son drap. Si le fabriquant veut rendre à la laine sa qualité par un second lavage, il lui en coûte sa façon & un nouveau déchet. Il seroit à souhaiter qu'on travaillât sérieusement à la suppression de ces abus.
3°. Triage. Après que la laine a été lavée, on la trie, on l'épluche, on la drousse, on la peigne, ou on la corde suivant sa longueur, on la mêle & on la file.
Le triage des laines consiste à distinguer les différentes qualités, à séparer la mere-laine, qui est celle du dos, d'avec celle des cuisses & du ventre, qui ne sont pas également propres à toutes sortes d'ouvrages. On peut encore entendre par ce terme, le partage du bon d'avec le moindre, & du médiocre d'avec le mauvais.
Les Marchands qui achetent les laines de la premiere main, se chargent ordinairement du soin de les trier, après les avoir fait laver. Les laines lavées, qui ne sont pas triées, se vendent par toisons ; celles qui sont triées, ne se vendent plus qu'au poids. Les bons fabriquans pensent qu'il y a plus d'avantages à acheter les laines toutes triées qu'en toison ; mais cette opinion n'est fondée que sur la mauvaise foi des vendeurs, qui fardent leurs toisons, en roulant le plus fin par-dessus, & en renfermant au-dedans le plus mauvais.
Les Espagnols ont une pratique contraire, surtout les Hyéronimites, possesseurs de la fameuse pile de l'Escurial. Ces religieux vendent leur pile, nonseulement sans séparer la qualité des toisons, mais ils y joignent aussi ce qu'ils nomment laine des agreges ; qui viennent des lieux circonvoisins de l'Escurial.
La bonne foi & la sureté du commerce étant rétablies, ce dernier parti me paroîtroit préférable à celui que prennent nos fabriquans ; & le public & le chef de manufacture y gagneroient pareillement ; celui-ci seroit plus maître de l'assortiment de ses laines, & le public auroit des étoffes plus durables.
Il y auroit ici cent choses à observer au sujet des fraudes & des ruses, qui se perpétuent journellement, tant dans le lavage, que dans le triage des laines ; mais le sordide amour du gain n'est-il pas capable de tout ?
4°. Epluchement. La négligence des éplucheurs occasionne les noeuds & les grosseurs qui se rencontrent dans les étoffes.
Les corps étrangers que l'on sépare de la laine en l'épluchant, sont, ou des ordures qui s'insinuent dans la toison, pendant qu'elle est encore sur le dos de l'animal, ou des molécules de suin qui se durcissent, ou enfin des paillettes, & diverses petites matieres qui s'attachent aux toisons lavées, lorsqu'on les étend au soleil pour les faire sécher sans drap dessous, sans soin & sans attention.
Cette façon comprend encore ce que l'on appelle écharpir, ou écharper la laine, ce qui consiste à déchirer & à étendre les flocons de laine qui sont trop compactes. Cette méthode a l'avantage de dévoiler les imperfections de la portion qu'on épluche, & de préparer la laine à être plus facilement droussée.
5°. Le Droussage. Drousser, ou trousser la laine, c'est l'huiler, l'imbiber d'huile d'olive ou de navette, pour la carder. Je ne puis m'étendre autant que je le voudrois sur les moyens qui sont les plus expédiens pour bien huiler la laine ; je dirai seulement en passant, qu'il est plus à propos d'asperger la laine, que de l'arroser ; de l'huiler par petites portions, que par tas & en monceau.
6°. Cardage & peignage. La longue laine se peigne, la courte se carde. Les cardeurs ont deux excès à éviter ; l'un de trop carder, l'autre de carder moins qu'il ne faut.
Ceux qui cardent trop légérement laissent dans la portion de la laine qu'ils façonnent, de petits flocons plus durs que le reste de la cardée. La laine ainsi préparée, donne un fil inégal & vicieux. Les cardeurs qui ont la main pesante, brisent la laine ; les filets ou coupés ou brisés, ne donnent plus une trême de même consistance, l'étoffe a moins de force. Cette façon, qui est des plus essentielles, est fort négligée dans nos manufactures ; la paye modique qu'on donne aux ouvriers, leur fait préferer la méthode la plus expéditive à la meilleure.
7°. Mélange. Mêler, assortir, ou rompre la laine, c'est faire le mélange des laines de différentes qualités, que l'on veut employer à la fabrique des draps. Nos fabriquans françois étant obligés depuis longtems d'employer toutes sortes de laines pour fournir à la consommation, ont acquis une grande habileté dans l'art de mêler & d'allier les laines du royaume avec celles de leurs voisins.
8°. Filage. Filer la laine c'est réduire en fil les portions que le cardeur ou le peigneur ont disposées à s'étendre & à s'unir ensemble, pour ne former qu'un seul tissu long, étroit, & délié. Le fileur doit se précautionner contre deux défauts bien communs ; l'un de trop tordre son fil, ce qui lui ôte de sa force, & fait fouler le drap ; l'autre de donner un fil inégal, en le filant plus gros dans un endroit que dans l'autre. Il semble qu'on ne peut éviter ces deux défauts que par l'invention de machines qui tordent le fil au point qu'on le désire en le filant également. Voyez l'article suivant sur la main-d'oeuvre de toutes ces opérations. (D.J.)
LAINE, (Mat. méd.) laine de bélier ou de brebis. La laine sale, grasse, imprégnée de la sueur de l'animal, ou d'oesipe (voyez OESIPE), étoit d'un grand usage chez les anciens. Hippocrate la faisoit appliquer sur les tumeurs après l'avoir fait carder, tremper dans de l'huile & dans du vin. Celse & Dioscoride célebrent aussi beaucoup de pareilles applications, & même pour des maladies internes, telles que l'inflammation de l'estomac, les douleurs de tête, &c.
Dioscoride préfere celle du cou & des cuisses, comme étant plus chargée d'oesipe.
Dioscoride décrit aussi fort au long une espece de calcination fort mal entendue de la laine, & sur-tout de la laine teinte en couleur de pourpre, qu'il prétend être un excellent ophtalmique après avoir essuyé cette calcination.
Heureusement la laine & ses préparations ne grossissent plus la liste des inutilités pharmaceutiques assez énormes sans cela ; car on ne compte pour rien l'action de la laine dans l'application des flanelles imbibées de différentes liqueurs, qui est en usage aujourd'hui. Il est évident qu'elle ne fait proprement dans ce cas que la fonction de vaisseau, c'est-à-dire d'instrument retenant le remede sur la partie affectée.
Les vêtemens de laine, & même ceux qu'on applique immédiatement sur la peau (ce qui est une pratique fort salutaire dans bien des cas, voyez TRANSPIRATION), ne doivent aussi leurs effets qu'à la propriété très-commune de couvrir le corps mollement & exactement, & par conséquent ces effets ne dépendent point de la laine comme telle, c'est-à-dire de ses qualités spécifiques. Voyez VETEMENT. (b)
LAINE, MANUFACTURE EN LAINE, ou DRAPERIE, (Art méchan.) la laine habille tous les hommes policés. Les hommes sauvages sont nuds, ou couverts de la peau des animaux. Ils regardent en pitié les peines que nous prenons pour obtenir de notre industrie un secours moins sûr & moins promt que celui que la bonté de la nature leur offre contre l'inclémence des saisons. Ils nous diroient volontiers : Tu as apporté en naissant le vêtement qu'il te faut en été, & tu as sous ta main celui qui t'est nécessaire en hiver. Laisse à la brebis sa toison. Vois-tu cet animal fourré. Prend ta fleche, tue-le, sa chair te nourrira, & sa peau te vêtira sans apprêt. On raconte qu'un sauvage transporté de son pays dans le nôtre, & promené dans nos atteliers, regarda avec assez d'indifférence tous nos travaux. Nos manufactures de couvertures en laine parurent seules arrêter un moment son attention. Il sourit à la vue de cette sorte d'ouvrage. Il prit une couverture, il la jetta sur ses épaules, fit quelques tours ; & rendant avec dédain cette enveloppe artificielle au manufacturier : en vérité, lui dit-il, cela est presqu'aussi bon qu'une peau de bête.
Les manufactures en laine, si superflues à l'homme de la nature, sont les plus importantes à l'homme policé. Aucunes substances, pas même l'or, l'argent & les pierreries, n'occupent autant de bras que la laine. Quelle quantité d'étoffes différentes n'en fabriquons-nous pas ! nous lui associons le duvet du castor, le ploc de l'autruche, le poil du chameau, celui de la chevre, &c.
Quoique la plûpart de ces poils soient très-lians, on n'en forme point une étoffe sans mélange ; ils fouleroient mal.
Si l'on unit la vigogne & le duvet du castor dans une étoffe, elle en aura l'oeil plus brillant. On appelle vigogne la laine de la brebis du Pérou.
Le ploc de l'autruche, le poil du chameau, celui de la chevre, sont des matieres fines, mais dures ; elles n'entrent que dans des étoffes qu'on n'envoie point à la foule, telles que les camelots & autres dont nous faisons nos vêtemens d'été. Ces matieres ne fournissent donc qu'une très-petite partie de ce qu'on appelle étoffe de laine.
La laine de la brebis commune est seule l'objet du travail le plus étendu, & du commerce le plus considérable.
Entre les laines, on place au premier rang celles d'Espagne ; après celles-ci, on nomme les laines d'Angleterre ; les laines de France sont les dernieres. La Hollande en produit aussi d'assez belles ; mais on ne les emploie qu'en étoffes légeres, parce qu'elles ne foulent pas.
On distingue trois qualités dans les laines d'Espagne ; les léonoises, ou sorices ou ségovies ; les belchites ou campos di Riziedos, & les navarroises.
On divise les deux premieres sortes seulement en trois qualités, qu'on appelle prime, seconde & tierce.
Dans les laines d'Angleterre & de Hollande, il y a le bouchon & la laine commune. Ces bouchons ne vont qu'au peigne, le reste passe à la carde.
Les meilleures laines de France sont celles du Berry. On nomme ensuite les laines du Languedoc. Quelques autres provinces fournissent encore des laines fines. Le reste est commun, & ne se travaille qu'en étoffes grossieres.
Travail préliminaire de la laine. Toutes les laines en général doivent être lavées & dégraissées de leur suin. On appelle suin, cette crasse onctueuse qu'elles rapportent de dessus la brebis. Il est si nécessaire d'en purger la laine, qu'on ne fabriquera jamais un beau drap sans cette précaution, à laquelle on n'est pas assez attentif parmi nous, parce qu'elle cause un déchet de trente à quarante pour cent au moins. Cependant il est impossible de dégraisser un drap comme il convient, si la laine dont on l'a manufacturé, n'a pas été bien débarrassée de son suin.
Du lavage des laines. La laine ne se lave pas bien dans l'eau froide. C'est cependant l'usage du Berry & des autres provinces de France, malgré les ordonnances qui enjoignent de se servir de l'eau chaude. C'est toujours la raison d'intérêt qui prévaut. Il est défendu par arrêt du 4 Septembre 1714, de vendre ni exposer en vente aucunes laines, qu'elles n'aient été lavées de maniere à pouvoir être employées en étoffe sans être relavées, & ce à peine de trente livres d'amende pour chaque balle, tant contre le vendeur que contre l'acheteur. On n'excepte que les laines d'Espagne qui auront été lavées sur les lieux, & qui pourront être vendues d'après le lavage d'Espagne.
Cependant les laines d'Espagne qu'on emploie dans les bonnes manufactures sont toutes lavées ou relavées avec de l'eau tiede & de l'urine. Ce dernier ingrédient est absolument nécessaire pour en écarter les parties qui ont été rapprochées & serrées dans l'emballage, de maniere qu'elles feutreroient, si on n'employoit au lavage que l'eau.
La premiere opération du lavage à l'eau chaude se fait dans les baquets ou cuves disposées à cet effet. Il faut observer que l'eau ne soit pas trop chaude, le trop de chaleur amollissant les parties les plus déliées, les rapprocheroit & feroit feutrer. Que l'eau soit seulement tiede. Lorsque l'ouvrier l'aura bien serrée, pressée entre ses mains, il la mettra dans une grande corbeille d'osier, ensuite on la portera dans une eau courante pour la faire dégorger. Pour cet effet, la corbeille étant plongée dans l'eau, qui la pénétrera par-tout, on la relevera, pressera, remuera. Cette manoeuvre lui ôtera la mauvaise odeur qu'elle aura contractée au premier lavage, & achevera de la nettoyer. Voyez ce travail dans nos Planches de Draperie, fig. 1. A est la cuve pour laver les laines dans leur suin. B, le laveur. C, la laine dans la cuve. D, la riviere où l'on rinse & dégorge la laine. E, la manne ou corbeille qui contient la laine qu'on fait dégorger. F, le laveur. G, un petit banc portatif qui soutient le laveur sur les bords du courant.
Une observation qui n'est pas à négliger, c'est que plus l'eau des baquets destinés au lavage des laines est chargée de suin, plus le lavage s'exécute parfaitement. Ainsi le lavage se fait d'autant mieux, qu'il a déja passé plus de laine dans un baquet avant celle qu'on y met.
Du pilotage des laines. Outre cette premiere opération, il est encore une façon de relaver les laines, & de leur donner une blancheur qui convient au genre d'étoffe que le fabriquant se propose de faire. C'est le pilotage.
Le pilotage n'a lieu que sur la laine à employer en étoffes légeres, telles que les flanelles, les molletons fins, &c. dont le dégrais avec la terre glaise altéreroit la qualité, lorsqu'on les feroit passer au moulin comme les draps & autres étoffes qui ont plus de résistance & de corps.
Pour piloter les laines on se sert du savon fondu dans de l'eau un peu chaude. On en remplit les cuves ou baquets semblables au premier lavage. On y ajoute de l'eau de suin, ou du premier lavage ; & deux hommes qui ont des especes de pilons, l'agitent & la remuent avec la laine qui en prend la blancheur qu'on desire. On voit cette opération fig. 2. A, la cuve B, les lissoires, ou bâtons à remuer la laine dans de l'eau de savon. C, les ouvriers qui pilotent.
Après que la laine a été pilotée, on la porte à la riviere pour la rinser & la faire dégorger.
De l'étendage des laines. Lorsque les laines ont été lavées, on les fait sécher ; l'usage dans les campagnes est de les étendre sur les prés, & quelquefois sur la terre ; mais cet usage est mauvais. Les laines se chargent ainsi de poussiere, ou même ramassent de la terre qui s'y attache ; ensorte qu'un manufacturier entendu, lorsqu'il achete des laines qui ont été séchées de cette maniere, & que la proximité des lieux le lui permet, a soin de la faire secouer par les emballeurs, à mesure qu'ils la mettent dans les sacs. On en séparera ainsi la poussiere & les autres ordures qui causeroient un déchet considérable.
Dans les manufactures réglées, on fait sécher les laines sur des perches posées dans des greniers. Il en est de même des laines teintes destinées à des draps & autres étoffes, lorsqu'elles ont besoin de sécher avant que d'être transmises à d'autres opérations relatives à la fabrication. Voyez fig. 3. la disposition des perches sur lesquelles on étend & l'on fait sécher les laines teintes ou en blanc, A, A, A, &c. B, B, B, les perches.
Du triage des laines. Lorsque les laines sont seches, on en fait un triage, c'est-à-dire qu'on divise les laines d'Espagne de la premiere qualité, en prime, seconde & tierce. Pour celle de Navarre & de France & autres plus communes, on sépare seulement les inférieures des autres.
La finesse du drap est proportionnée à la qualité de la laine ; il faut pour les draps d'Abbeville & de Sedan des laines plus belles que pour ceux de Louviers & de d'Arnetat. Les laines qu'on employe aux draps d'Elboeuf, sont inférieures à celles du drap de Louvier. On exige dans la fabrication des ouvrages dont nous venons de parler, l'emploi des laines d'Espagne seules.
Après le premier triage des laines communes de Navarre & de France, on en fait un second qui consiste à séparer les laines les plus longues des plus courtes. Les premieres sont destinées aux chaînes des étoffes, les secondes aux trames. Il faut encore que le trieur soit attentif à en rejetter les ordures qu'il rencontre sous ses mains. Voyez fig. iv. cette opération. A est la claie sur laquelle la laine est posée ; B, la laine ; C, le trieur.
Le manufacturier donne le nom de haute laine à la laine longue, & celui de basse laine à la laine courte. On emploie la haute laine aux chaînes, parce que le fil en aura plus de consistance, & que le travail de l'ourdisseur en sera facilité. On ne distingue point de haute & basse laine dans celles d'Espagne, & l'on n'en fait point de triage.
Le triage & le choix ont lieu pour toutes les autres, quelle que soit leur destination ; qu'elles doivent aller à la carde ou au peigne. Nous allons suivre la main-d'oeuvre sur celles qui passeront à la carde, & dont on fabrique les draps. Nous reviendrons ensuite à celles qui vont au peigne, & nous exposerons leur usage.
Du battage des laines. Lorsque les laines ont été triées, & que la séparation en a été faite, on les porte par petites portions sur une espece de claie, formée de cordes tendues où on les frappe à coups de baguette, comme on voit, fig. v. A est la claie de corde à battre les laines ; les ouvriers B, B sont deux batteurs.
Cette manoeuvre a deux objets. Le premier d'ouvrir la laine ou d'en écarter les brins les uns des autres ; le second d'en chasser la poussiere. Si la poussiere restoit dans la laine, & si ces brins n'étoient pas divisés, l'huile qu'on lui donneroit dans la suite ne s'étendroit pas partout, & elle ne manqueroit pas de former une espece de camboui qui la gâteroit.
Mais l'opération du battage n'expulsant que la poussiere, & laissant après elle les pailles & autres ordures, il faut y faire succéder l'épluchage.
De l'épluchage des laines. L'éplucheur sépare de la laine toute l'ordure qui a échappé à la vigilance du trieur, soit qu'il se soit négligé dans son travail, soit que la laine n'étant pas assez ouverte, il n'eût pu y discerner ce qu'il en falloit rejetter. Pour cette opération, on la remet entre les mains d'enfans ou autres personnes qui la manient brin par brin ; évitant toutefois de la rompre.
Quelques auteurs, entre lesquels on peut, je crois, compter celui du spectacle de la nature, ont avancé que le mélange des laines d'Espagne avec celles de France contribuoit à la fabrication des draps plus fins & plus beaux. Ils n'ont pas conçu que les unes foulant moins que les autres, ils en deviendroient au contraire ce que les ouvriers appellent creux, & que la qualité en seroit très-imparfaite. Ils n'ont qu'à consulter là-dessus les ordonnances & réglemens du mois d'Août 1669, registrés en parlement le 13 du même mois.
Ce qu'on pourroit tenter de mieux ; ce seroit d'employer une qualité de laine à la chaîne, mais sans aucun mélange, & une autre qualité de laine à la trame, mais aussi sans aucun mélange. Cependant cette maniere de fabriquer n'est pas même celle qu'il faut préférer.
Des draps mélangés & des étoffes simples & blanches. Tous les draps mélangés ont été fabriqués avec des laines teintes de différentes couleurs. Les bleus & les verds, quoique sans mélange, ont été faits de laines teintes avant la fabrication. Les draps ainsi fabriqués sont plus chers, mais la couleur en est aussi plus durable.
Pour les draps mélangés, on a soin de prendre une certaine quantité des laines diversement colorées qu'on pese chacune séparément. On les brise & carde ensemble, par ce moyen toutes sont effacées & se fondent en une couleur nouvelle, telle que le fabriquant se proposoit de l'avoir. Il s'en assure par un échantillon qu'on nomme le feutre ; le feutre contient des laines différentes une quantité proportionnée au tout, & sert de guide pour le reste.
Il y a des teintures qui, comme le noir, mordent la laine si rudement, que le travail en deviendroit presqu'impossible, si l'on commençoit par les teindre. Il y en a d'éclatantes qui, comme le rouge de la cochenille, perdroient leur éclat en passant par un grand nombre de manoeuvres, & sur-tout à celle du foulon où l'on emploie la terre à dégraisser & le savon qui ne manqueroient point de déteindre.
Pour prévenir ces inconvéniens, on fabrique l'étoffe en blanc, & c'est en blanc qu'on la livre au teinturier. L'expérience du rapport du profit à la perte, du bien au mieux, a réglé toutes ces choses.
Il résulte de ce qui précede qu'il ne se fabrique que des draps blancs & des draps mélangés ; jamais ou du moins rarement des draps ont la laine teinte.
Les manufacturiers qui travaillent en blanc font peu d'étoffes mélangées, de même que ceux qui fabriquent des draps mélangés en font peu de blancs.
Lorsque les laines ont été lavées, pilotées, séchées, battues, épluchées, & réépluchées, il s'agit de les carder.
Du carder des laines. On ne carde les laines d'Espagne que deux fois. Il faut carder jusqu'à trois fois les laines plus communes ou moins fines.
Mais avant que d'en venir à cette opération, on les arrose ou humecte avec l'huile d'olive. On employe sur la livre de laine qui doit être mise en trame, un quart de livre d'huile, & un huitieme sur la livre de laine qui doit être mise en chaîne pour les draps fins. Quant aux draps grossiers depuis sept & huit jusqu'à neuf francs l'aune, la quantité d'huile est la même pour la trame que pour la chaîne, c'est-à-dire qu'on emploie communément trois livres & demie d'huile ou à peu près sur vingt livres de laine.
L'huile la meilleure qu'on puisse donner à la laine destinée à la carde & à la fabrication des draps fins, est sans contredit celle d'olive. On lui substitue cependant celle de navette, lorsqu'il s'agit des draps les plus grossiers, parce qu'elle coute moins ; mais aussi il en faut davantage, cette huile ne s'étendant ni autant ni aussi facilement, parce qu'elle est moins tenue.
La raison pour laquelle on emploie plus d'huile sur la laine destinée à la trame que sur la laine destinée à la chaîne, c'est que la trame n'étant tordue qu'autant qu'elle a besoin de l'être pour acquérir une consistance, & que s'il étoit possible de l'employer sans la filer, le drap en seroit plus parfait, il est nécessaire de l'humecter davantage : il n'en est pas ainsi de la chaîne qui a besoin d'un tors considérable pour supporter la fatigue de la fabrication, les coups du battant ou de la chasse dont l'ouvrage est frappé, la violence de l'extension dans la levée continuelle des fils, &c.
Les cardes sont des planchettes de bois couvertes d'un cuir de basanne, hérissées de pointes de fer, petites & un peu recourbées. Elles rompent la laine qui passe entr'elles, en parcelles très-menues.
Les hautes & les basses laines ne se cardent pas différemment. L'intention du travail est de préparer une maniere touffue, lâche & propre à former un fil peu dur dont les poils fassent ressort en tous sens les uns contre les autres, & cherchent à s'échapper de toute part. Or les menus poils qui ont passé entre les cardes, étant mêlés d'une infinité de manieres possibles, ne peuvent se tordre ou être pliés sans tendre continuellement à se redresser & à se désunir. Le fil qui en est formé en doit être hérissé, sur-tout s'il est peu tors. Il fournit donc pour la trame une matiere propre à gonfler l'étoffe & à la faire draper, en élançant en dehors des poils engagés du reste par quelque endroit de leur longueur dans le corps de la piece.
La laine se carde à diverses reprises où l'on emploie successivement des instrumens plus fins & des dents plus courtes.
La laine d'Espagne n'est cardée que deux fois ; sa finesse ne pourroit résister à trois opérations de cette espece que la laine grossiere soutient ; elle se briseroit en se divisant.
Au contraire plus la laine commune est cardée, plus elle s'emploie facilement. Cependant on ne la passe & repasse que trois fois ; deux fois avec la grande carde au chevalet, & une fois avec la petite carde sur les genoux.
A cette derniere opération elle sort de dessous la carde en forme de petits rouleaux d'un pouce, plus ou moins de diametre, sur environ douze pouces de long.
Ces rouleaux de laine veules se nomment loquets, ploques ou saucissons, suivant l'usage du pays, & se filent au grand rouet sans le secours de la quenouille. On voit dans nos Planches, fig. vj. A le chevalet, fig. vij. b, b, les grandes cardes ; fig. viij. c, c, les petites cardes ; e, fig. vj. la carde posée sur le chevalet ; f, même fig. la boëte à renfermer la laine que l'ouvrier veut travailler,
Du filage de la laine. L'ouvrier présente de la main gauche l'extrémité du loquet à la broche de la fusée du rouet ; de la droite, il met la roue, la corde & la fusée en mouvement. La laine saisie par le bout de la broche qui tourne, se tortille dans le même sens. L'ouvrier éloigne sa main & allonge de trois ou quatre piés le loquet, qui en s'amincissant & prenant d'un bout à l'autre le mouvement de la fusée, devient un fil assez tors pour avoir quelque résistance, & assez lâche pour laisser en dehors les extrémités de ses poils dégagés.
D'une secousse de revers donnée brusquement à la roue, l'ouvrier détache son fil de la broche & l'enroule aussi-tôt sur la fusée en redonnant à la roue son mouvement ordinaire. Il approche ensuite un nouveau loquet à l'extrémité du fil formé & enroulé ; il applique le point d'union du loquet qui commence au fil formé du loquet précédent ; il continue d'opérer, & il met en fil ce second loquet qu'il enroule comme le précédent.
En accumulant de cette maniere plusieurs saucissons ou loquets filés, il garnit tellement le fond de la fusée diminuant de plus en plus les volumes de l'enroulement jusqu'au bout de la broche, qu'en conséquence le fil se range en cône. Ce cône est vuide au centre ; ce vuide y est formé par la broche qui le traverse. On l'enleve de dessus la broche sans l'ébouler.
L'huile ou la simple humidité dont la laine a été pénétrée, suffit pour en assouplir le ressort, & l'on transporte sans risque le cône de la laine filée sur une autre broche.
Remis sur cette broche, il se distribue sur le devidoir où on l'unit par un noeud léger avec le fil d'une autre fusée ; & le tout se forme ensuite en écheveaux, à l'aide d'un devidoir qui régle plûtôt l'ouvrier que l'ouvrier ne le régle. On voit fig. ix. le grand rouet. A, son banc ; b, marionette ou soutien des fraseaux ; C, roue du grand rouet ; D, moyeu de la roue ; e, broche sur laquelle s'assemble le fil en maniere de cône ; f, esquive qui arrête le volume du fil sur la fusée ; g, fraseaux qui sont deux cordons de natte doubles & ouverts pour recevoir & laisser jouer la broche ; H, arbre ou montant qui supporte la roue.
Du dévidage de la laine. On donne à la cage du dévidoir l'étendue que l'on veut, en écartant ou rapprochant ses barres. Veut-on ensuite que l'écheveau soit formé, par exemple de trois cent tours de fil ? il faut que l'essieu engraine par un pignon de quatre dents sur une roue qui en ait vingt-quatre, & que l'essieu de celle-ci, dont le pignon en a également quatre, engraine par ce pignon dans une grande roue de quarante. Chaque dent du dévidoir emportant une dent de la petite roue, le devidoir fera six tours pour épuiser les quatre fois six dents ou les vingt-quatre dents de la petite roue. Celle-ci fera de même autant de tours que son pignon qui tournera dix fois pour emporter les quarante dents de la grande roue. Ainsi pendant que la grande roue fait un tour, la petite en fait dix, & le devidoir soixante. Il faut donc cinq tours de la grande roue pour avoir cinq fois soixante tours de devidoir. Un petit marteau dont la queue est emportée par une cheville de détente fixée à la grande roue, frappe cinq coups, par cinq chutes, après les cinq tours de la grande roue. C'est-là ce qui fait donner le nom de sons aux soixante fils qui font partie de l'écheveau, qui dans son total est appellé écheveau de cinq sons.
La grande roue est encore traversée d'un essieu qui enroule une corde fine, à laquelle un petit poids est suspendu. Or ce poids se trouvant arrêté après le cinquieme tour, avertit l'ouvrier qu'il a trois cent fils sur son devidoir, puisque le devidoir a fait cinq fois soixante ou trois cent tours.
Les écheveaux formés par une quantité fixe & connue de fils, soit trame soit chaîne, sont assemblés de maniere que tous ont leurs bouts réunis à un même point d'attache, afin d'être retrouvés sans peine.
Cette façon de devider le fil, soit chaîne, soit trame, est d'une telle utilité qu'il est impossible de conduire sûrement une manufacture sans l'usage de cette ingénieuse machine.
Elle a deux objets principaux ; le premier de fournir au manufacturier le moyen de connoître parfaitement la qualité du fil qu'il doit employer à l'étoffe qu'il se propose de faire ; le fil devant être plus ou moins gros, selon la finesse de la laine & celle du drap, ce qu'il découvrira facilement par le poids de l'écheveau dont la longueur est donnée. La différence des poids le réglera. Il ordonnera à sa volonté de filer un écheveau, soit chaîne, soit trame, à tant de poids chaque son ou à tant de sons pour tel poids.
Le second a rapport au payement du fileur & du tisseur qui ne sont payés qu'à tant la longueur de fil & non à tant la livre de poids. Si l'ouvrier étoit payé au poids, celui qui fileroit gros gagneroit plus que celui qui fileroit fin. Il a fallu régler le prix du filage à un poids fixe pour chaque écheveau d'une longueur déterminée.
Il faut en user de même avec les tisseurs, & les payer tant par écheveau, & non pas tant par piece, comme il se pratique dans les manufactures mal dirigées. Il s'ensuit de cette derniere maniere de payer, qu'un ouvrier fait entrer plus ou moins de trame dans son étoffe sans gagner ni plus ni moins. Une chaîne cependant qui ne sera par hasard pas aussi pesante qu'une autre, doit prendre plus de trame pour que l'étoffe soit parfaite. Il est donc juste que celui-ci soit plus payé. Payez-le par piece, & il fournira sa piece le moins qu'il pourra, & conséquemment son ouvrage sera foible & défectueux.
Voyez, dans nos Planches, figures 10 & 11, le devidoir. A, banc ou selle du devidoir. b, b, b, montans. c c, c c, c c, &c. bras du devidoir ; son arbre d d tournant & engrénant par sa petite lanterne e de quatre cannelures dans les dents de la roue D. F, autre roue que la supérieure emporte par un pignon également de quatre dents. G, marteau dont le manche est abaissé par une cheville h de détente attachée à la roue inférieure F, & dont la tête vient frapper après la détente sur le tasseau l ; i, corde qui s'enroule sur l'essieu de la roue inférieure F, & qui soutient un poids K. Ses tours sur l'essieu indiquent ceux du devidoire, & terminent la longueur de l'écheveau. La figure 11 montre le même tour, vû de profil.
Mais avant que d'aller plus loin, il est à propos de parler d'une précaution, legere en apparence, mais qui n'est pas au fond sans quelque importance ; c'est relativement au tors qu'on donne au fil. Ce tors peut contribuer beaucoup à l'éclat des étoffes légeres, & au moelleux des étoffes drapées. Il faut filer & tordre du même sens la chaîne & la trame destinées à la fabrication d'une étoffe luisante, comme l'étamine & le camelot dont nous parlerons dans la suite, & filer & tordre en sens contraire la trame & la chaîne des draps.
Il ne s'agit pas ici du mouvement des doigts, qui est toujours le même, mais de la corde du rouet qu'on peut tenir ouverte ou croisée. La corde ouverte qui enveloppe le tour de la roue, & qui assujettit à son mouvement la fusée & le fil, ira comme la roue, verticalement de bas en haut, & fera pareillement aller tous les tours du fil, en montant verticalement & de bas en haut. Au lieu que si la corde qui embrasse la roue se croise avant que de passer sur la noix de la fusée où le fil s'assemble, elle emportera nécessairement la fusée dans un sens contraire au précédent, verticalement, mais de haut en bas.
Tous les brins de laine qui se tortillent les uns sur les autres, soit au petit rouet, soit au grand, dans le sens qui leur est imprimé par la broche de la fusée, se plieront donc en un sens, quand on file à corde ouverte ; & dans un sens contraire, quand on file à corde croisée.
Mais quel intérêt peut-on prendre à ce que l'un des deux fils soit par rapport à l'autre un fil de rebours, pour parler le langage des ouvriers ? C'est ce que nous expliquerons à l'article de la FOULE DES ÉTOFFES. Nous remarquerons seulement ici que tous les fils destinés pour la chaîne des draps sont filés à corde ouverte, & ceux pour la trame à corde croisée, & que l'auteur du spectacle de la nature s'est trompé sur ce point.
La raison de cette différence de filer est que le fil de la chaîne ayant besoin d'être plus tors & plus parfait que celui de la trame, & la corde croisée étant sujette à plus de variation dans son mouvement que la corde ouverte, le fil filé de cette façon acquiert plus de perfection que celui qui l'est à corde croisée. Il est filé plus également.
De l'ourdissage des chaînes. Lorsque les fils sont ainsi disposés, il s'agit d'ourdir les chaînes destinées à être montées sur les métiers. Pour cet effet, on assemble plusieurs bobines sur lesquelles sont dévidés les fils qui ont été filés pour chaîne. On les distribue ensuite sur des machines garnies de pointes de fil de fer de cinq à six pouces de longueur, en deux rangées différentes, au nombre de huit, plus ou moins, par chaque rangée. Une corde sépare ces deux rangées, dont l'une est plus élevée que l'autre. On prend tous les fils ensemble, tant de la rangée de bobines de dessus que de celles de dessous, avec la main gauche. Après quoi, pour commencer l'ourdissage, l'ouvrier les croise séparément sur ses doigts avec la main droite, & les porte à la cheville de l'ourdissoir où il arrête la poignée de fils, ayant soin de passer deux autres chevilles dans les croisures formées par ses doigts, ce qui s'appelle croisure ou envergeure. On prend cette précaution, & elle est absolument nécessaire, pour que les fils ne soient point dérangés de leur place, lorsqu'il faut monter le métier, & que l'ouvrier puisse prendre chaque fil de suite, lorsqu'il sera question de les passer dans les lames ou lisses.
Cette premiere poignée de fils étant arrêtée & envergée dans le haut de l'ourdissoir qui est fait en forme de devidoire ou de tour posé debout, & que la main fait tourner, la poignée de fils en se dévidant sur sa surface, forme une spirale depuis le haut jusqu'au bas, où elle arrive après un certain nombre de tours, fixés d'après la longueur que l'ouvrier s'est proposée. Il s'arrête-là à une autre cheville, & passant sa poignée dessous une seconde cheville éloignée de la premiere de quatre à cinq pouces, il fait le retour & remonte sur la même poignée de fils, qu'il remet sur la cheville d'en haut, observant de croiser les fils par l'insertion de ses doigts, & de passer la croisiere dans les deux chevilles éloignées de celle où ils sont arrêtés, d'un pié & demi ou environ, afin de descendre comme il a commencé ; il observe dans le nombre des fils & dans les longueurs un ordre & des mesures qui varient d'une manufacture à l'autre.
Nous ne donnons point ici la figure & la description de cet ourdissoir, nous aurons occasion d'en parler à l'article SOIERIE, & à plusieurs articles de PASSEMENTERIE.
Il y a une autre maniere d'ourdir par un ourdissoir composé de deux barres de bois qui sont posées parallelement & un peu en talud contre une muraille. Elles sont hérissées de chevilles, en deux rangées ; & c'est sur ces chevilles que les fils sont reçûs.
Quand on porte les fils sur ces ourdissoirs plats & inclinés contre la muraille, on les réunit tous sur la premiere cheville d'une des deux barres ; & après les avoir croisés ou envergés sur les deux autres chevilles qui en sont éloignées, comme on a fait sur l'ourdissoir tournant, on les conduit de-là tous ensemble d'une barre à l'autre, & successivement d'une cheville à l'autre, jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on se proposoit. Alors on les arrête ; & en faisant le retour, on les reporte à contre-sens sur la premiere en-haut, en observant de les croiser comme dans l'ourdissoir tournant.
Nous ne donnons pas la représentation de cette maniere d'ourdir, parce que l'ourdissoir tournant est beaucoup plus sûr & d'un usage plus commun, & que l'ourdissoir tournant bien entendu, on concevra l'ourdissoir plat qui n'en est qu'un développement.
La poignée de fils conduite par l'ouvrier sur les ourdissoirs est appellée demi-branche ou portée, & n'est appellée portée entiere ou branche que lorsque le retour en est fait. Il faut donc que l'ouvrier ait soin, lorsqu'il est au bas de l'ourdissoir, de faire passer la demi-branche sur les deux chevilles, de maniere qu'elle puisse, par sa croisiere, être séparée, qu'on en connoisse la quantité, & que le nombre des fils ourdis soit compté. De même que les fils ourdis sont croisés dans le haut de l'ourdissoir à pouvoir être distingués un par un, les branches ou portées sont croisées dans le bas à pouvoir être comptées une par une.
C'est la totalité de ces parties qui forme la poignée de fils à laquelle on donne le nom de chaîne.
Pour rendre cette poignée de longs fils portative & maniable, l'ouvrier en arrondit le bout en une grande boucle, dans laquelle il passe son bras, un amene à lui la poignée de fils. Il en forme ainsi un second chaînon ; puis au-travers de celui-là, un troisieme, & au-travers du troisieme, un quatrieme, & ainsi de suite.
Ces longs assemblages de fils ainsi bouclés & raccourcis en un petit espace, s'appellent chaînes. On leur conserve le même nom, étendus sur le métier, pour le monter, & y passer la trame ou fil de traverse. Il faut deux de ces chaînes pour former la monture d'un drap, attendu que l'ourdissoir ne pourroit contenir la chaîne entiere ; elle a trop de volume. On donne à chacun aussi le nom de chaînons.
Du collage des chaînes. Lorsque les chaines sont ourdies pour les monter sur le métier, il s'agit d'abord de les coller. Cette préparation est nécessaire pour donner au fil la consistance dont il a besoin pour être travaillé en étoffe.
Pour cet effet, on fait bouillir une quantité de peaux de lapin, ou de rognures de gants, ou de la colle forte, ou quelqu'autre matiere qui fasse colle. On la met dans un baquet ou autre ustensile disposé à cette manoeuvre. L'ouvrier y fait tremper la chaîne, tandis qu'elle est chaude. La retirant ensuite par un bout, il la tord poignée par poignée, & la serre entre ses mains d'une force proportionnée à la quantité de colle qu'il veut lui laisser. Voyez fig. 12, un ouvrier occupé à cette manoeuvre ; A, la cuve ; B, la chaîne ; C, la colle ; D, l'ouvrier qui tord la chaîne pour n'y laisser que la quantité de colle qu'elle demande.
De l'étendage des chaînes. Après que la chaîne a été tirée de la colle, on la porte à l'air pour la faire sécher. L'ouvrier passe une branche assez forte d'un bois poli dans la boucle qui a servi à former le premier chaînon d'un côté ; & l'étendant dans toute sa longueur sur des perches posées horisontalement, & soutenus sur des pieux verticaux, il passe à l'autre extrémité une autre perche, & lui donne une certaine extension, afin de pouvoir disposer les portées sur un espace assez large ; opération qui est facilitée par le moyen des cordes que l'ourdisseur a eu l'attention de passer dans les croisieres avant que de lever les chaines de dessus l'ourdissoir. Voy. fig. 13, l'étendoir ; A, ses piliers ; B, ses traverses ; C, une chaîne.
Du montage du métier. Lorsque la chaîne est seche, l'ouvrier la ramasse en chaînon, de la même maniere qu'elle a été levée de dessus l'ourdissoir, pour la disposer à être montée sur le métier.
Il faut pour cela se servir d'un rateau, dont les dents sont placées à distance les unes des autres d'un demi-pouce plus ou moins, suivant la largeur que doit avoir la chaîne. Nous renverrons pour cette opération & pour la figure de l'instrument, aux Planches du Gazier, à celles du Passementier, & à l'article SOIERIE.
On place une portée dans chaque dent du rateau. L'ouverture du rateau étant couverte, les portées arrêtent avec une longue baguette qui les traverse & les enfile, cette premiere brasse de longs fils étendus, & passant sur une traverse du métier qu'on arrondit pour cet effet, on fait entrer la baguette & les portées dans une cannelure pratiquée à un grand rouleau, ou à une ensuple sur laquelle les fils sont reçus & enveloppés à l'aide de deux hommes, dont l'un tourne l'ensuple, tandis que l'autre tire la chaîne, la tend, & la conduit de maniere qu'elle s'enroule juste & ferme.
Dans cette opération toute la chaîne se trouve chargée sur le rouleau jusqu'à la premiere croisiere des fils simples.
Lorsque l'ouvrier est arrivé à cette croisade ou croisiere, qui est fixée par les cordes que l'ourdisseur a eu soin d'y laisser ; il y passe deux baguettes polies & minces, d'une longueur convenable, pour avoir la facilité de choisir les fils qui, en conséquence de la croisiere, se trouvent rangés sur les baguettes, alternativement un dessus, l'autre dessous, & dans l'ordre même qu'on a observé en ourdissant, de maniere qu'un fil premier ne peut passer devant un fil second, ni celui-ci devant le troisieme ; qu'on ne sauroit les brouiller ; qu'ils se succedent exactement, & qu'ils sont pris de suite pour etre passés & mis dans les lames ou lisses.
De la rentrure des fils dans les lames & le rot. Les lames ou lisses sont un composé de ficelles, lesquelles passées sur deux fortes baguettes appellées liets ou lisserons forment une petite boucle dans le milieu de leur longueur où chaque fil de la chaîne est passé. Chaque boucle est appellée maille, & a un pouce environ d'ouverture. La longueur de la ficelle est de quinze ou seize ; c'est la distance d'un lisseron à l'autre. Nous expliquerons ailleurs la maniere de faire les lisses. Voyez les Planches de Passementier, leur explication, & l'article SOIERIE.
Tous les draps en général ne portent que deux lisses, dont l'une en baissant au moyen d'une pedale, appellée par les artistes manche, fait lever celle qui lui est opposée, les deux lames étant attachées à une seule corde dont une des extrémités répond à l'une des lames, & l'autre extrémité, après avoir passé sur une poulie, va se rendre à l'autre.
Du peigne ou rot. Les fils étant passés dans les mailles ou boucles des lisses, il faut les passer dans le rot ou peigne.
Le rot est un composé de petits morceaux minces de roseaux ; ce qui l'a fait appeller rot. Il tient le nom de peigne de sa figure. Les dents en sont liées ou tenues verticales en dessus & en dessous par deux baguettes légeres, qu'on nomme jumelles. Les jumelles sont plates ; elles ont un demi-pouce de large ; un fil gaudronné ou poissé les revêtit : ce fil laisse entre chaque dent l'intervalle qui convient pour passer les fils.
Tous les draps en général ont deux fils par chaque dent de peigne, qui doit être de la largeur des lames, qui est la même que la largeur de la chaîne roulée sur l'ensuple. Tout se correspond également, & le frottement du fil dans les lames & le rot est le moins sensible qu'il est possible, & le cassement des fils très-rare.
De l'arrêt de la chaîne, ou de son extension pour commencer le travail. Lorsque les fils sont passés dans les lames ou dans le rot, on les noue par petites parties ; ensuite on les enfile sur une baguette, dont la longueur est égale à la longueur du drap. Au milieu des fils de chaque partie nouée, on attache la baguette en plusieurs endroits avec des cordes arrêtées à l'ensoupleau. L'ensoupleau est un cylindre de bois couché devant l'ouvrier sous le jeu de la navette. L'ouvrage s'enveloppe sur ce rouleau pendant la fabrication. On donne l'extension convenable à la chaîne, en tournant l'ensoupleau, dont une des extrémités est garnie d'une roue semblable à une roue à crochet, qui est fixée par un fer recourbé, que les ouvriers appellent chien.
La chaine ainsi tendue, l'ensuple est sur l'ensoupleau, le drap est prêt à être fabriqué. Mais pour vous former des idées justes de la fabrication, voyez figure 14, le métier du tisseur tout monté. A, A, A, A, sont les montans du métier ; b, b, les traverses ; c, c, la chasse qui sert à frapper & à serrer plus ou moins le fil de trame ; d, d, le dessus de la chasse ou longue barre que l'ouvrier empoigne des deux mains ; e, e, le dessous de la chasse, contenant le rot ou le peigne ; F, F, planche sur laquelle reposent les fils qui baissent pour donner passage à la navette angloise montée sur ce métier. Nous expliquerons en détail plus bas le méchanisme de cette navette. g, tringle de fer qui soutient l'équerre ou crosse qui chasse la navette d'un côté à l'autre ; h, l'équerre ou crosse ; i, petite piece de bois qui retient la navette entre la planche attachée au battant & la piece même ; k, la navette, l, l, corde qui répond de chacune de ses extrémités à l'équerre que l'ouvrier tire pour faire partir la navette ; m, rot ou peigne. M, planchette de bois alignée avec le peigne ou rot ; n, n, aiguille de la chasse ; o, o, o, porte-lame ou piece à laquelle est suspendue la poulie sur laquelle roule la corde qui tient à deux lames ; p, p, la couloire ou piece de bois plate & équarrie, où l'on a pratiqué une ouverture par laquelle l'étoffe fabriquée se rend sur l'ensoupleau ; q, l'ensuple ou rouleau qui porte le fil de chaîne au derriere du métier ; r, r, liais ou longues baguettes qui soutiennent les lisses qu'on voit ; R R, les lisses ; s s, poulie sur laquelle roule la corde qui est attachée aux deux lames t, t, t, t, la marionette, c'est la corde qui va d'une lame à l'autre, après avoir passé pardessus la poulie s, & qui montant & descendant, fait hausser & baisser les lames ; v, v, moufle ou chape dans laquelle la poulie tourne ; x, x, x, le banc de l'ouvrier ; y, y, les marches ; z, z, l'ensoupleau ; &, &, la roue à rochet avec son chien. Le reste de la figure s'entend de lui-même. On voit que la chasse c, est suspendue à vis 1 & à écrou 2 sur les traverses b, b, & que ces traverses sont garnies de cramaillées à dents 33, qui fixent la chasse au point où l'ouvrier la veut.
Ce métier est vû de face. On auroit pû le montrer de côté ; alors on auroit apperçu la chaîne & d'autres parties ; mais les métiers d'ourdissage ont presque toutes leurs parties communes, & l'on en trouvera dans nos Planches sous toutes sortes d'aspect.
De la fabrication du drap & autres étoffes en laine Quoique le drap soit prêt à être commencé, il est bon néanmoins d'observer qu'encore que les fils soient disposés avec beaucoup d'ordre & d'exactitude sur le métier, il est d'usage de placer sur les deux bords de la largeur un nombre déterminé de fils, ou d'une matiere ou d'une couleur différente de la chaîne ; ce qui sert à caractériser les différentes sortes d'étoffes. Il y a des reglemens qui fixent la largeur & la longueur de la chaîne, la matiere & la couleur des lisieres, en un mot, ce qui constitue chaque espece de tissu, afin qu'on sache ce qu'on achete.
Lorsqu'il s'agit de commencer le drap, on devide en dernier lieu le fil de trame des écheveaux sur de petits roseaux de trois pouces de long, & qu'on nomme épolets, espolets, époulins ou espoulins.
Dans les bonnes manufactures on a soin de mouiller l'écheveau de trame avant que de la devider sur les petits roseaux, afin que le fil de la chaîne, dur par la colle dont il a été enduit, devienne plus flexible dans la partie où la duite se joint, & la fasse entrer plus aisément ; ce qui s'appelle travailler à trame mouillée. On ne peut donner le nom de bonnes manufactures à celles qui travaillent à trame seche.
L'espolin chargé de fil, est embroché d'une verge de fer qui se nomme fuserole, puis couché & arrêté par les deux bouts de la fuserole dans la poche de la navette, d'où le fil s'échappe par une ouverture latérale. Ce fil arrêté sur la premiere lisiere de la chaîne, se prête & se devide de dessus l'espolin à mesure que la navette court & s'échappe par l'autre lisiere. Les fils de chaîne se haussent par moitié, puis s'abaissent tour-à-tour, tandis que les autres remontent, saisissent & embrassent chaque duite ou chaque jet de fil de trame ; desorte que c'est proprement la chaîne qui fait l'appui & la force du tissu, au lieu que la trame en fait la fourniture.
De la maniere de frapper le drap. Le rot ou le peigne sert à joindre chaque duite ou jet de trame contre celui qui a été lancé précédemment, par le moyen de la chasse ou battant dans lequel il est arrêté. Le battant suspendu de maniere qu'il puisse avancer & reculer, est amené par les deux ouvriers tisseurs contre la duite ; & c'est par les différens coups qu'il donne, que le drap se trouve plus ou moins frappé. Les draps communs sont frappés à quatre coups ; les fins à neuf ; les doubles broches à quinze & pas davantage.
Largeur des draps en toile. En général tous les draps doivent avoir depuis sept quarts de large sur le métier, jusqu'à deux aunes & un tiers. Cette largeur doit être proportionnée à celle qu'ils doivent avoir au retour du foulon : toutes ces dimensions sont fixées par les reglemens.
Il y a cependant des draps forts qui n'ont qu'une aune de large sur le métier ; mais ces sortes de draps doivent être réduits à demi-aune seulement au retour du foulon, & sont appellés draps au petit large. Quant aux grands larges, ils sont ordinairement réduits à une aune, une aune & un quart, ou une aune & un tiers, & rien de plus, toujours en raison de la largeur qu'ils ont sur le métier.
La largeur du drap sur le métier a exigé pendant longtems le concours de deux ouvriers pour fabriquer l'étoffe, lesquels se jettant la navette ou la lançant tour-à-tour, la reçoivent & se la renvoient après qu'ils ont frappé sur la duite le nombre de coups nécessaires pour la perfection de l'ouvrage, un seul ouvrier n'ayant pas dans ses bras l'étendue propre pour recevoir la navette d'un côté quand il l'a poussée de l'autre. Un anglois, nommé Jean Kay, a trouvé les moyens de faire travailler les étoffes les plus larges à un seul ouvrier, qui les fabrique aussi-bien, & n'emploie pas plus de tems que deux. Ce méchanisme a commencé à paroître sur la fin de l'année 1737, & a valu à son auteur toute la reconnoissance du Conseil ; reconnoissance proportionnée au mérite de l'invention, qui est déja établie en plusieurs manufactures du royaume.
De la navette angloise, ou de la fabrique du drap par un homme seul. L'usage de cette navette ne dérange en aucune maniere l'ancienne méthode de monter les métiers ; elle consiste seulement à se servir d'une navette qui est soutenue sur deux doubles roulettes, outre deux autres roulettes simples placées sur le côté, qui lors du travail, se trouvent adossées au rot ou peigne. Cette navette devide ou lance avec plus d'activité & en même-tems plus de facilité la duite ou le fil qui fournit l'étoffe, au moyen d'un petit cone ou tambour tournant sur lequel elle passe, afin d'éviter le frottement qu'elle souffriroit en s'échappant par l'ouverture latérale. Elle contient encore plus de trame, & n'a pas besoin d'être chargée aussi souvent que la trame ordinaire. Elle ne comporte point de noeuds, & fabrique par conséquent une étoffe plus unie. Une petite planche de bois bien taillée en forme de lame de couteau, de trois pouces & demi de large, de trois lignes d'épaisseur du côté du battant auquel elle est attachée, & de dix lignes de l'autre côté, de la longueur du large du métier, est placée de niveau à la cannelure du battant, dans son dessous, & à la hauteur de l'ouverture inférieure de la dent du peigne.
Lorsque l'ouvrier foule la marche, afin d'ouvrir la chaîne pour y lancer la navette, la portion des fils qui baissent appuie sur cette planchette, de façon que la navette à roulette ne trouve en passant ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent, & va rapidement d'une lisiere à l'autre sans être arrêtée.
Une piece de bois de deux lignes environ de hauteur, & d'un pié & demi plus ou moins de longueur, posée sur la planche de chaque côté du battant, contient la navette & la dirige, soit en entrant, soit en sortant ; car alors elle se trouve entre la lame du battant & cette petite piece.
Pour donner le mouvement à la navette, une espece de main de bois recourbée à angles droits, dont la partie supérieure est garnie de deux crochets de fil de fer ; dans lesquels entre une petite tringle de fer de la longueur de la navette, à laquelle est attachée une corde que l'ouvrier tient entre ses mains, au milieu du métier, meut une plaque de bois ou crosse qui chasse la navette.
Mais l'inspection de nos figures achevera de rendre tout ce méchanisme intelligible. Voyez donc la figure 15. C'est une partie du rot & de la chasse, avec la navette angloise en place. Il faut imaginer le côté A de cette figure semblable à l'autre côté. c, partie de la chasse ; D, dessus de la chasse, ou la barre que l'ouvrier tient à la main pour frapper l'étoffe ; e, e, la rangée des dents du rot ou peigne ; f, f, la tringle qui soutient la crosse. Cette tringle est attachée à la chasse ; g, la crosse avec ses anneaux, dans lesquels la tringle passe ; h, la navette angloise posée sur la planchette i, i ; k, k, petite piece de bois posée sur la planchette i ; imaginez au milieu du quarré de la planchette ou crosse g, une corde qui aille jusqu'à l'ouvrier, & qui s'étende jusqu'à l'autre bout du métier e, où il faut supposer une pareille crosse, au milieu de laquelle soit aussi attachée l'autre extrémité de la même corde.
Qu'arrivera-t-il après que l'ouvrier aura baissé une marche ? Le voici.
La moitié des fils de la chaîne sera appliquée sur la planchette i ; l'autre sera haussée ; il y aura entre les deux une ouverture pour passer la navette. L'ouvrier tirera sa corde de gauche à droite ; la crosse g glissant sur la tringle de fer, poussera la navette ; la navette poussée coulera sur la planchette & sur les fils de chaîne baissés, & s'en ira à l'autre bout du métier, appuyée dans sa course contre la jumelle d'em-bas du peigne ou rot. Un pareil mouvement de corde, après que l'étoffe aura été frappée, la fera passer, à l'aide d'une pareille crosse, placée au côté où elle est, de ce côté à celui d'où elle est venue, & ainsi de suite.
Mais une piece très-ingénieusement imaginée, & sur laquelle il faut fixer son attention, c'est la petite piece de bois k, k ; elle est taillée en dedans en s, & percée de deux trous m, n. Le trou m est un peu plus grand que le trou n. Il y a dans chacun une pointe de fer fixée dans la jumelle d'em-bas, ou plûtôt dans la planchette sur laquelle la navette est posée.
Qu'arrive-t-il de-là ? Lorsque la navette se présente en k pour entrer, elle arrive jusqu'en n sans effort ; en n elle presse la piece, qui a là un peu plus de hauteur ou de saillie qu'ailleurs ; mais le trou m étant un peu plus grand que le trou n, & ce trou m n'étant pas rempli exactement par sa goupille, la piece cede un peu, & la quantité dont elle cede est égale précisément à la différence du diametre du trou m, & du diametre de la goupille qui y passe. Cela suffit pour laisser entrer la navette qui se trouve alors enfermée ; car la piece k, k ne peut pas se déplacer, passé le point ou trou m, qu'elle ne se déplace de la même quantité passé le trou n ; ainsi la navette ne peut ni toucher, ni avancer, ni reculer. Elle s'arrête contre la crosse ; & poussée ensuite par la crosse, elle a, au sortir de l'espace terminé par la petite piece k, k, une espece d'échappement qui lui donne de la vitesse. Ajoutez à cela que la planchette sur laquelle elle est posée, est un peu en talud vers le rot ou peigne.
On voit, fig. 16. la navette en dessus, & fig. 17, la navette en dessous ; a a est sa longueur ; b b, la poche ; c, la bobine dont le fil va passer sur le petit cylindre ou tambour t, & sortir par l'ouverture latérale l. e e sont deux roulettes horisontales, fixées dans son épaisseur, & qui facilitent son mouvement contre la jumelle inférieure du rot ; ff, ff en font quatre verticales prises aussi dans son épaisseur, mais verticalement & qui facilitent son mouvement sur la planchette qui la soutient.
La figure 18 montre la bobine séparée de la navette, & prête à être mise dans sa poche.
Avec le secours d'une navette semblable, un seul ouvrier peut fabriquer des draps larges, des étoffes larges, des toiles larges, des couvertures, & généralement toutes les étoffes auxquelles on emploie deux ou trois hommes à la fois.
On assure qu'expérience faite avec cet instrument, le travail d'un homme équivaut au travail de quatre autres avec la navette ordinaire.
Quoique la navette angloise convienne particulierement aux étoffes larges, on l'a essayée sur les étoffes étroites, comme de trois quarts ou d'une aune, & l'on a trouvé qu'elle ne réussissoit pas moins bien.
Passer le drap à la perche. Lorsque le drap est fabriqué, le maître de la manufacture le fait passer à la perche pour reconnoître les fautes des tisseurs ; delà il passe à l'épinseur. L'épinseur en tire toutes les pailles & autres ordures. De l'épinsage il est envoyé au foulon.
De l'épinsage des draps. On voit figure 19, la table de l'épinseur. A, le drap en toile ; b b, la table ; c c, les tréteaux qui la soutiennent ; d, tréteaux mobiles pour incliner plus ou moins la table à discrétion.
Il faut avoir grand soin de mettre le drap épinsé sur des perches, si on ne l'envoie pas tout de suite au foulon, parce que le mélange de l'huile de la carde, de la colle & de l'eau qui a servi à humecter les trames, le feroit échauffer & pourrir, si on ne l'étendoit pas pour le faire sécher.
Du dégrais & du foulage des draps. Dans les bonnes manufactures il y a un moulin à dégraisser & un moulin à fouler. C'est le moulin à dégraisser qu'on voit figure 20, & le moulin à fouler qu'on voit figure 21. Dans le premier, les branches ou manches des maillets sont posés horisontalement, & les auges ou vaisseaux toujours ouverts. Dans le second, les branches sont perpendiculaires, & les vaisseaux toujours fermés, afin que le drap n'ayant point d'air, s'échauffe plus vîte & foule plus facilement. Ces derniers moulins sont appellés façon de Hollande, parce que c'est de-là qu'ils nous viennent. Celui de l'hôpital de Paris, situé à Essonne, sur la riviere d'Etampes, est très-bien fait.
Quand on veut qu'un drap soit garni & plus ou moins drappé, on lui donne plus ou moins de largeur sur le métier, & on le réduit à la même au foulage. C'est le foulon qui donne, à proprement parler, aux draperies leur consistance, l'effet principal des coups de maillets étant d'ajouter le mérite du feutre à la régularité du tissu. C'est par une suite de ce principe que les étoffes lisses reçoivent leur dernier lustre sans passer par la foulerie, ou que, si quelques-unes y sont portées, c'est pour être bien dégorgées, & non pour être battues à sec : elles perdroient en s'étoffant la légereté & le brillant qui les caractérisent.
Les étoffes qu'on y portera pour y prendre la consistance de drap, y gagneront beaucoup, si elles ont eû leur chaîne & leur trame de laine cardée ou du moins leur trame faite de fil lâche, & leur chaîne filée de rebours. Plusieurs personnes qui couroient d'un même côté, iroient loin sans se rencontrer ; mais elles ne tarderoient pas à se heurter & à se croiser en marchant en sens contraires. Il n'y a pas non-plus beaucoup d'union à attendre des poils de deux fils lâches, s'ils ont été filés au rouet dans le même sens. Mais si l'un des deux fils a été fait à corde ouverte & l'autre à corde croisée ? si les poils de la chaine sont couchés dans un sens, & ceux de la trame dans un autre, l'insertion & le mélange des poils se fera mieux. Quand les maillets battent & retournent l'étoffe dans la pile du foulon, il n'y a point de poils qui ne s'ébranlent à chaque coup. Les poils qui sous un coup formeront une chambrette en se courbant ou en se séparant des poils voisins, s'affaissent ou s'allongent sous un autre coup qui aura tourné l'étoffe d'un nouveau sens, le propre du maillet & la façon dont la pile est creusée, étant de faire tourner le drap à chaque coup qu'il reçoit. Si donc les poils de la chaîne & de la trame ont été filés en sens contraires, & qu'ils se hérissent, les uns en tendant à droite, & les autres en tendant à gauche, ils formeront déja un commencement de mélange, qui s'achevera sous l'impression des maillets. Mais l'engrenage en sera d'autant plus promt, si les deux fils sont d'une laine rompue à la carde, comme il se pratique pour les draps.
Toute autre étoffe à fil de trame sur étaim, se drappera suffisamment par la simple précaution du fil de rebours, & acquérera au point desiré la contention & la solidité du feutre. On dit jusqu'au point desiré ; car si l'étoffe, soit drap, soit serge, devenoit vraiment feutre, par une suite de son renflement, elle se retireroit trop sur sa largeur & sur sa longueur ; elle se dissoudroit même si on la poussoit trop à la foulerie.
Mais, dira-t-on, ne pourroit-on pas aussi-bien files les chaînes à corde croisée, & les trames à corde ouverte, que les chaînes à corde ouverte, & les trames à corde croisée ?
On peut répondre que toutes les matieres, soit fil de chanvre, soit lin, coton ou soie, filées au petit rouet, ne pouvant l'être qu'à corde ouverte, on a observé la même chose pour les fils filés au grand rouet. Filés au fuseau, ou filés à corde ouverte, c'est la même chose.
L'effet des fouleries est double. Premierement, l'étoffe est dégraissée à fond. Secondement, elle y est plus ou moins feutrée. On y bat à la terre, ou l'on y bat à sec. On y bat l'étoffe enduite de terre glaise bien délayée dans de l'eau : cette matiere s'unit à tous les sucs onctueux. Cette opération dure deux heures : c'est ce qu'on appelle le dégrais.
Lorsque le drap paroît suffisamment dégraissé, on lâche un robinet d'eau dans la pile qui est percée en deux ou trois endroits par le fond. On a eu soin de tenir ces trous bouchés pendant le battage du dégrais. Lorsque leurs bouchons sont ôtés, on continue de faire battre, afin que l'étoffe dégorge, & que l'eau qui entre continuellement dans la pile, & qui en sort à mesure, emporte avec elle la terre unie à l'huile, aux autres sucs graisseux, les impuretés de la teinture, s'il y a des laines teintes, & la colle dont les fils de chaînes ont été couverts. On ne tire le drap de ce moulin que quand l'eau est, au sortir de la pile, aussi claire qu'en y entrant ; ce qui s'apperçoit aisément,
Voyez, fig. 20, le moulin à dégraisser. A, A, le beffroi ; B, B, la traverse ; c, c, c, les manches des maillets ; d, d, les maillets ; e, le vaisseau ou la pile ; f, f, f, les geolieres qui retiennent les maillets & empêchent qu'ils ne vacillent ; g, l'arbre ; h, h, h, h, les levées ou éminences qui font lever les maillets ; i, la selle ; k, le tourillon. Ce méchanisme est simple, & ne demande qu'un coup d'oeil.
Lorsque le drap est dégraissé, on le remet une seconde fois entre les mains de l'énoueuse ou épinceuse, qui le reprend d'un bout à l'autre, & emporte de nouveau les corps terreux ou autres qui seroient capables d'en altérer la couleur ou d'en rendre l'épaisseur inégale. Voyez, figure 22, l'épinsage des draps fins après le dégrais ; a, le drap ; b, b, faudets à grille dans lesquels le drap est placé ; c, l'intervalle entre les deux portions du drap, où se place l'épinceuse pour travailler, en regardant l'étoffe au jour ; d, d, pieces de bois qui tiennent l'étoffe étendue ; f, f, porte-perche. Figure 23, pince de l'épinceuse.
L'étoffe, après cette seconde visite, qui n'est pratiquée que pour les draps fins, retourne à la foulerie.
Les ordonnances qui assujettissent les fabriquans de différentes manufactures à ne donner qu'une certaine longueur aux draps à l'ourdissage, sont faites relativement au vaisseau du foulon, qui doit contenir une quantité d'étoffe proportionnée à sa profondeur ou largeur. Un drap qui remplit trop la pile, n'est pas frappé si fort, le maillet n'ayant pas assez de chûte. Il en est de même de celui qui ne la remplit pas assez, la chûte n'ayant qu'une certaine étendue déterminée.
Remise au foulon, l'étoffe y est battue non à l'eau froide, mais à l'eau chaude & au savon, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à une largeur déterminée ; après quoi on la fait dégorger à l'eau froide, & on la tient dans la pile jusqu'à ce que l'eau en sorte aussi claire qu'elle y est entrée : alors on ferme le robinet, qui ne fournissant plus d'eau dans la pile, la laisse un peu dessécher ; cela fait, on la retire sur le champ.
Tous les manufacturiers ne foulent pas le drap avec du savon, sur-tout ceux qui ne sont pas fins. Les uns emploient la terre glaise & l'eau chaude, ce qui les rend rudes & terreux ; les autres l'eau chaude seulement. Les draps foulés de cette maniere perdent de leur qualité, parce qu'ils demeurent plus long-tems à la foule, & que la grande quantité de coups de maillets qu'ils reçoivent, les vuide & les altere. Le mieux est donc de se servir du savon ; il abrege le tems de la foule, & rend le drap plus doux.
Il faut avoir l'attention de tirer le drap de la pile toutes les deux heures, tant pour en effacer les plis, que pour arrêter le rétrécissement.
Plus les draps sont fins, plus promtement ils sont foulés. Ceux-ci foulent en 8 ou 10 heures : ceux de la qualité suivante en 14 heures : les plus gros vont jusqu'à 18 ou 20 heures. Les coups de maillets sont réglés comme les battemens d'une pendule à secondes.
Pour placer les draps dans le vaisseau ou la pile, on les plie tous en deux ; on jette le savon fondu sur le milieu de la largeur du drap ; on le plie selon sa longueur ; on joint les deux lisieres, qui en se croisant de 5 à 6 pouces, enferment le savon dans le pli du drap ; de façon que le maillet ne frappe que sur son côté qui fera l'envers ? c'est la raison pour laquelle on apperçoit toujours à l'étoffe foulée, au sortir de la pile, un côté plus beau que l'autre, quoiqu'elle n'ait reçu aucun apprêt.
Quelques manufacturiers ont essayé de substituer l'urine au savon, ce qui a très-bien réussi ; mais la mauvaise odeur du drap qui s'échauffe en foulant, y a fait renoncer.
Les foulonniers qui veulent conserver aux draps leur longueur à la foule, ont soin de les tordre sur eux-mêmes, lorsqu'ils les placent dans la pile, par portion d'une aune & plus, cette quantité à droite, & la même à gauche, & ainsi de suite, jusqu'à ce que la piece soit empilée. On appelle cette maniere de fouler, fouler sur le large. Au contraire, si c'est la largeur qu'ils veulent conserver, ils empilent double, & par plis ordinaires, ce qui s'appelle fouler en pié.
On ne foule en pié que dans le cas où le drap foulé dans sa largeur ordinaire, ne seroit pas assez fort, ou lorsqu'il n'est pas bien droit, & qu'il faut le redresser.
Voyez figure 21, le moulin à foulon ; a a, la grande roue appellée le hérisson ; b, la lanterne ; c c, l'arbre ; e e e, les levées ou parties saillantes qui font hausser les pelotes ; f f, les tourillons ; g g, les frettes qui lient l'arbre ; h h, les queues des pilons ; i, les pilons ; l l l, les geolieres ; m, les vaisseaux ou piles ; n n, les moises ; o, l'arbre de l'hérisson auquel s'engrene la grande roue qui reçoit de l'eau son mouvement.
Du lainage des draps. Lorsque les draps sont foulés, il est question de les lainer ou garnir : pour cet effet, deux vigoureux ouvriers s'arment de doubles croix de fer ou de chardon, dont chaque petite feuille regardée au microscope, se voit terminée par un crochet très-aigu. Après avoir mouillé l'étoffe en pleine eau, ils la tiennent étalée ou suspendue sur une perche, & la lainent en la chardonnant, c'est-à-dire qu'ils en font sortir le poil en la brossant à plusieurs reprises devant & derriere, le drap étant doublé, ce qui fait un brossage à poil & à contre-poil ; d'abord à chardon mort ou qui a servi, puis à chardon vif ou qu'on emploie pour la premiere fois. On procede d'abord à trait modéré, ensuite à trait plus appuyé, qu'on appelle voies. La grande précaution à prendre, c'est de ne pas effondrer l'étoffe, à force de chercher à garnir & velouter le dehors.
Le lainage la rend plus belle & plus chaude. Il enleve au drap tous les poils grossiers qui n'ont pu être foulés ; on les appelle le jars ; il emporte peu de la laine fine qui reste comprise dans le corps du drap.
On voit ce travail fig. 24. a, porte-perche ; b, les perches ; c c, croix & le drap montés, & ouvriers qui s'en servent ; f, faudets ; fig. 25, croix montée.
Les figures 27 & 28 montrent les faudets séparés. Ce sont des appuis à claires voies, pour recevoir le drap, soit qu'on le tire, soit qu'on le descende en travaillant.
La figure 26 est un instrument ou peigne qui sert à nettoyer les chardons. Ses dents sont de fer, & son manche, de bois. Fig. 27 & 28, faudets.
De la tonte du drap. La tonte du drap succede au lainage ; c'est aux forces ou ciseaux du tondeur, à réparer les irrégularités du chardonnier ; il passe ses ciseaux sur toute la surface. Cela s'appelle travailler en premiere voie. Cela fait, il renvoye l'étoffe aux laineurs : ceux-ci la chardonnent de nouveau. Des laineurs elle revient au tondeur qui la travaille en reparage ; elle repasse encore aux laineurs, d'où elle est transmise en dernier lieu au tondeur qui finit par l'affinage.
Ces mots, premiere voie, repassage, affinage, n'expriment donc que les différens instans d'une même manoeuvre. L'étoffe passe donc successivement des chardons aux forces, & des forces aux chardons, jusqu'à quatre ou cinq différentes fois, plus ou moins, sans parler des tontures & façons de l'envers.
Il y a des manufactures où l'on renvoie le drap à la foulerie, après le premier lainage.
L'étoffe ne soutient pas tant d'attaques réitérées, ni l'approche d'un si grand nombre d'outils tranchans, sans courir quelque risque. Mais il n'est pas de soin qu'on ne prenne pour rentraire imperceptiblement, & dérober les endroits affoiblis ou percés.
Dans les bonnes manufactures, les tondeurs sont chargés d'attacher un bout de ficelle à la lisiere d'un drap qui a quelque défaut. On l'appelle tare. La tare empêche que l'acheteur ne soit trompé.
Voyez figures 29, 30, 31, 32, & 33, les instrumens du lainage & de la tonte ou tonture. La fig. 29 montre les forces ; A, les lames ou taillans des forces ; b, c, le manche ; il sert à rapprocher les lames, en bandant une courroie qui les embrasse.
On voit ce manche séparé, fig. 30. c est un tasseau avec sa vis d ; il y a une plaque de plomb qui affermit la lame dormante ; e, billette ou piece de bois que l'ouvrier empoigne de la main droite, pendant que la gauche fait jouer les fers par le continuel bandement & débandement de la courroie de la manivelle.
L'instrument qu'on voit fig. 31, s'appelle une rebrousse. On s'en sert pour faire sortir le poil.
Les figures 32, sont des cardinaux ou petites cardes de fer pour coucher le poil ; b, vûe en-dessus ; a, vûe en-dessous.
Les figures 33, 34 sont des crochets qui tiennent le drap à tondre étendu dans sa largeur sur la table.
La fig. 35 est une table avec son coussin, ses supports & son marche-pié. C'est sur cette table que le drap s'étend pour être tondu.
De la rame. Après les longues manoeuvres des fouleries, du lainage & de la tonture, manoeuvres qui varient selon la qualité de l'étoffe ou l'usage des lieux, soit pour le nombre, soit pour l'ordre ; les draps lustrés d'un premier coup de brosse, sont mouillés & étendus sur la rame.
La rame est un long chassis ou un très-grand assemblage de bois aussi large & aussi long que les plus grandes pieces de drap. On tient ce chassis debout, & arrêté en terre. On y attache l'étoffe sur de longues enfilades de crochets dont ses bords sont garnis, par ce moyen elle est distendue en tout sens.
La partie qui la tire en large & l'arrête em-bas sur une partie transversale mobile, s'appelle larget ; celle qui la saisit par des crochets, à son chef, s'appelle templet.
Il s'agit d'effacer les plis que l'étoffe peut avoir pris dans les pots des foulons, de la tenir d'équerre, & de l'amener sans violence à sa juste largeur : d'ailleurs en cet état on la brosse, on la lustre mieux, on la peut plier plus quarrément ; le ramage n'a pas d'autre fin dans les bonnes manufactures.
L'intention de certains fabriquans dans le tiraillement du drap sur la rame, est quelquefois un peu différente. Ils se proposent de gagner avec la bonne largeur, un rallongement de plusieurs aulnes sur la piece : mais cet effort relâche l'étoffe, l'amollit, & détruit d'un bout à l'autre le plus grand avantage que la foulerie ait produit. C'est inutilement qu'on a eu la précaution de rendre par la carde le fil de chaîne fort, & celui de trame, velu, de les filer de rebours, & de fouler le drap en fort pour le liaisonner comme un feutre, si on l'étonne à force de le distendre, si on en resout l'assemblage par une violence qui le porte de vingt aulnes à vingt-quatre. C'est ce qu'on a fait aux draps effondrés, mollasses & sans consistance.
On a souvent porté des plaintes au Conseil, contre la rame, & elle y a toujours trouvé des défenseurs. Les derniers réglemens en ont arrêté les principaux abus, en décernant la confiscation de toute étoffe qui à la rame auroit été allongée au-delà de la demi-aulne sur vingt-aulnes, ou qui s'est prêtée de plus d'un seizieme sur sa largeur. La mouillure en ramenant tout d'un coup le drap à sa mesure naturelle, éclaircit l'infidélité, s'il y en a. Le rapport du poids à la longueur & largeur, produiroit le même renseignement.
La figure 36 représente la rame a a, où l'on étend des pieces entieres de drap ; b b, sa traverse d'en-haut où le drap s'attache sur une rangée de clous à crochets, espacés de trois pouces ; c c, la traverse d'em-bas qui se déplace & peut monter à coulisse ; d, montans ou piliers. Fig. 37 e larget ou diable, comme les ouvriers l'appellent. C'est une espece de levier qui sert à abaisser les traverses d'embas, quand on veut élargir le drap ; f, templet garni de deux crochets auxquels on attache la tête ou la queue de la piece ; il sert à l'allonger au moyen d'une corde attachée à un pilier plus éloigné, & qui passe sur la poulie g.
De la brosse & de la tuile. Le drap est ensuite brossé de nouveau, & toujours du même sens, afin de disposer les poils à prendre un pli uniforme. On aide le lustre & l'uniformité du pli des poils, en tuilant le drap, c'est-à-dire, en y appliquant une planche de sapin qu'on appelle la tuile. Voyez fig. 38 la tuile.
Cette planche, du côté qui touche l'étoffe, est enduite d'un mastic de résine, de grais pilé, & de limaille passés au sas. Les paillettes & les résidus des tontures qui altéreroient la couleur par leur déplacement, s'y attachent, ou sont poussés enavant, & déchargent l'étoffe & la couleur qui en a l'oeil plus beau. On acheve de perfectionner le lustre par le cati.
Du cati, du feuilletage, & des cartons. Catir le drap ou toute autre étoffe, c'est le mettre en plis quarrés, quelquefois gommer chaque pli, puis feuilleter toute la piece, c'est-à-dire, insérer un carton entre un pli & un autre, jusqu'au dernier qu'on couvre d'un ais quarré qu'on nomme le tableau, & tenir le paquet ainsi quelque tems sous une presse.
Pour qu'une étoffe soit bien lustrée & bien catie, ce n'est point assez que les poils en soient tous couchés du même sens, ce qui toutefois produit sur toute l'étendue de la piece, la même réflexion de lumiere : il faut de plus qu'ils ayent entierement perdu leur ressort au point où ils sont pliés ; sans quoi ils se releveront inégalement. La premiere goutte de pluie qui tombera sur l'étoffe, venant à sécher, les poils qu'elle aura touchés, reprendront quelqu'élasticité, se redresseront, & montreront une tache où il n'y a en effet qu'une lumiere réfléchie en cet endroit, autrement qu'ailleurs.
On essaie de prévenir cet inconvénient par l'égalité de la presse, on réitere le feuilletage, en substituant aux premiers cartons d'autres cartons ou vélins plus lisses & plus fins ; en y ajoutant de loin en loin des plaques de fer ou de cuivre bien chaudes. Malgré cela, il est presqu'impossible de briser entierement le ressort des poils, & de les fixer couchés si parfaitement d'un coté, que quoiqu'il puisse arriver, ils ne se relevent plus.
Quoique la matiere dont on fabrique les draps, soit mêlée, soit blancs, vienne d'être exposée avec assez d'exactitude & d'étendue, & qu'elle semble devoir former la partie principale de cet article, cependant on fabrique avec la laine peignée une si grande quantité d'étoffes, que ce qui nous en reste à dire, comparé avec ce que nous avons dit des ouvrages faits avec de la laine cardée ; ne paroîtra ni moins curieux, ni moins important, c'est l'objet de ce qui va suivre.
Du travail du peigne. Tous les tissus en général pourroient être compris sous le nom d'étoffes, il y auroit les étoffes en soie, en laine, en poil, en or, en argent, &c. Les draps n'ont qu'une même façon de travail & d'apprêt. Les uns exigent plus de main-d'oeuvre, les autres moins ; mais l'espece ne change point malgré la diversité des noms, relative à la qualité, aux prix, aux lieux, aux manufactures, &c.
Les longues broches de fer qui forment le peigne, rangées à deux étages sur une piece de bois avec laquelle une autre de corne s'assemble, & qui les soutient, de la longueur de sept pouces ou environ ; la premiere rangée à vingt-trois broches ; la seconde à vingt-deux un peu moins longues, & posées de maniere que les unes correspondent sur leur rangée, aux intervalles qui séparent les autres sur la leur, servent d'abord à dégager les poils, & à diviser les longs filamens qu'on y passe de tout ce qui s'y trouve de grossier, d'inégal & d'étranger.
Si la pointe de quelqu'une de ces dents vient à s'émousser à la rencontre de quelque matiere dure qui cede avec peine, on l'aiguise avec une lime douce ; & si le corps de la dent se courbe sous une filasse trop embarrassée, on la redresse avec un petit canon de fer ou de cuivre.
L'application d'un peigne sur un autre, dont les dents s'engagent dans le premier ; l'insertion des fils entre ces deux peignes ; l'attention de l'ouvrier à passer sa matiere entre les dents des peignes en des sens différens, démêlent parfaitement les poils dont chaque peigne a été également chargé.
Ce travail réitéré range le plus grand nombre de poils en longueur, les uns à côté des autres, en couche nécessairement plusieurs sur l'intervalle qui sépare les extrémités des poils voisins, les uns plus hauts, les autres plus bas, dans toute la poignée, selon l'étage des dents qui les saisissent.
Lorsque la laine paroît suffisamment peignée, l'ouvrier accroche le peigne au pilier, pour tirer la plus belle matiere dans une seule longueur, à laquelle il donne le nom de barre ; quant à la partie de laine qui demeure attachée au peigne, on l'appelle retiron, parce qu'étant mêlée avec de la laine nouvelle, elle est retirée une seconde fois. A cette seconde manoeuvre, celle qui reste dans le peigne est appellée peignon, & ne peut être que mêlée avec la trame destinée aux étoffes grossieres. Les réglemens ont défendu de la faire entrer dans la fabrication des draps.
On dispose par ce préparatif les poils de la laine peignée, à se tordre les uns sur les autres sans se quitter, quand des mains adroites les tireront sous un volume toujours égal, & les feront rouler uniment sous l'impression circulaire d'un rouet ou d'un fuseau.
Voyez figure 39, le travail du peigne. a, a, a, le fourneau pour chauffer les peignes ; b, b, l'ouverture pour faire chauffer les peignes ; c, plaque de fer qui couvre l'entrée du fourneau, & conserve sa chaleur. C'est par le même endroit qu'on renouvelle le charbon ; d, piliers qui soutiennent les crochets ; e, fig. 42, crochet ou chevre ; f, fig. 40, le peigne ; g, fig. 39, ouvrier qui peigne ; h, ouvrier qui tire la barre quand la laine est peignée ; i, petite cuve dans laquelle l'ouvrier teint la laine huilée ou humectée par le savon ; K, K, banc sur lequel l'ouvrier est assis en travaillant, & dans la capacité duquel il met le peignon ; Fig. 41, canon ou tuyau de fer ou de laiton, pour redresser les broches du peigne, quand elles sont courbées.
Il y a des manufacturiers qui sont dans l'usage de faire teindre les laines avant que de les passer au peigne. D'autres aiment mieux les travailler en blanc, & ne les mettre en teinture qu'en fils ou même en étoffe.
La méthode de teindre en fils est impraticable dans certaines étoffes, telles que les mélangées & les façonnées, &c.
Si l'on teint le fil quand il est filé, les écheveaux ne prendront pas la même couleur ; la teinture agira diversement sur les fils bien tordus & sur ceux qui le sont trop ou trop peu. Il y a des couleurs qui exigent une eau bouillante, dans laquelle les fils se colleront ensemble ; on ne pourra les devider, & moins encore les mettre en oeuvre.
La laine quelque déliée qu'elle soit, est susceptible de plusieurs nuances dans une même couleur.
Mais tout s'égalisera parfaitement par le mêlange du peigne & l'attention de l'ouvrier.
Il vaut donc mieux pour la perfection des étoffes fabriquées avec la laine peignée, de faire teindre la matiere avant que de la préparer, à moins qu'on ne se propose d'avoir des étoffes en blanc qu'on teindra d'une seule couleur, ou noir, ou bleu, ou écarlate, &c.
Les laines teintes seront lavées ; les blanches seront pilotées, puis battues sur les claies & ouvertes-là à grands coups de baguettes.
Ces manoeuvres préliminaires que nous avons expliquées plus haut, auront lieu, soit qu'on veuille les peigner, ou à l'huile ou à l'eau.
Les étoffes fabriquées avec des laines teintes peignées, vont rarement au foulon ; conséquemment il faut les peigner à l'eau ; pour les laines blanches & destinées à la fabrication d'étoffes sujettes au foulon, on les peignera à l'huile.
Les laines blanches ou de couleur qui seront peignées sans huile, seront après avoir été battues, trempées dans une cuvette où l'on aura délayé du savon blanc ou autre.
La laine retirée par poignée sera attachée d'une part au crochet dormant du dégraissoir, & de l'autre au crochet mobile, qui tourné sur lui-même, à l'aide des branches du moulinet, la tord & la dégorge.
Voyez fig. 43. le dégraissoir que les ouvriers appellent aussi verin. A, A, les montans. B, crochet fixe ou dormant. C, le moulinet. D, crochet mobile. E, fig. 44, roue de retenue. f, même fig. le chien. G, fig. 43, la cuvette.
Toute la pesée de laine est conservée en tas dans une corbeille pour être peignée plus aisément à l'aide de cette humidité.
Si elle doit être tissée en blanc, elle passe de-là au soufroir, qui est une étuve où on la tient sans air, & exposée sur des perches à la vapeur du soufre qui brûle. Le soufre qui macule sans ressource la plûpart des couleurs, dégage efficacement la laine qui n'est pas teinte de toutes ses impuretés, & lui donne la blancheur la plus éclatante. C'est l'effet de l'acide sulfureux volatil qui attaque les choses grasses & onctueuses.
Les laines de Hollande, de Nort-Hollande, d'Est-Frise, du Texel, sont les plus propres à être peignées. On peut y ajouter celles d'Angleterre ; mais il y a des lois séveres qui en défendent l'exportation, & qui nous empêchent de prononcer sur sa qualité. Les laines du Nord de la France, vont aussi fort bien au peigne : mais elles n'ont pas la finesse de celles de Hollande & d'Angleterre. Les laines d'Espagne, du Berry, de Languedoc, se peigneroient aussi, mais elles sont très-basses ; elles feutrent facilement à la teinture chaude, & elles souffrent un déchet au-moins de cinquante par cent ; ce qui ne permet guere de les employer de cette maniere.
La longue laine qui a passé par les peignes, est celle qu'on destine à faire le fil d'étaim qui est le premier fonds de la plûpart des petites étoffes de laine, tant fines que communes ; on en fait aussi des bas d'estame, des ouvrages de Bonnetterie à mailles fortes, & qu'on ne veut pas draper. Nous en avons dit la raison en parlant des laines qui se rompent sous la carde.
Pour disposer la laine peignée & conservée dans une juste longueur à prendre un lustre qui imite celui de la soie, il faut que cette laine soit filée au petit rouet ou au fuseau, & le plus tors qu'il est possible. Si ce fil est serré, il ne laisse échapper que très-peu de poils en-dehors ; d'où il arrive que la réflexion de la lumiere se fait plus également & en plus grande masse, que si elle tomboit sur des poils hérissés en tout sens, qui la briseroient & l'éparpilleroient.
Voyez fig. 45, le petit rouet pour la laine peignée. a, a, a, a, les piliers du banc du rouet. b, les montans. c, la roue. d, sa circonférence large. e, la manivelle. f, la pédale ou marche pour faire tourner la roue. g, la corde qui répond de l'extrémité de la marche à la manivelle. h, la corde du rouet. i, les marionettes soutenant les fraseaux. l, les fraseaux ou morceaux de feutre ou de natte percée, pour recevoir ou laisser jouer la broche. m, la broche. n, la bobine. o, le banc soutenu par les par les piliers a. Le fil d'étaim se dévide de dessus les fuseaux ou de dessus les canelles du petit rouet sur des bobines, ou sur des pelotes, au nombre nécessaire pour l'ourdissage.
Toutes les particules de ce fil ont une roideur ou un ressort qui les dispose à une rétraction perpétuelle ; ce qui à la premiere liberté qu'on lui donneroit, cordelleroit un fil avec l'autre. On amortit ce ressort en pénétrant les pelotes ou bobines de la vapeur d'une eau bouillante.
Cela fait, on distribue les pelotes dans autant de cassetins ou de petites loges, comme on la pratique au fil de la toile. On les tire de-là en les menant par un pareil nombre d'anneaux qu'il y a de pelotes, ou sans anneaux sur un ourdissoir ; cet ourdissoir où se prépare la chaîne est le même qu'aux draps ; & l'ourdissage n'est pas différent.
Dans les lieux où se fabriquent les petites étoffes, comme à Aumale pour les serges ; il est d'usage de mener vingt fils sur les chevilles de l'ourdissoir. L'allée sur toutes les chevilles & le repli au retour sur ces chevilles ou sur l'ourdissoir tournant, produiront un premier assemblage de quarante fils ; c'est ce qu'on nomme une portée. Il faut trente-huit de ces portées, en conformité des réglemens, pour former la totalité de la poignée qu'on appelle chaine. Il y a donc à la chaîne 1520 fils, qui multipliés par la longueur que les réglemens ont enjointe, donnent 97280 aunes de fils, à soixante-quatre aulnes d'attache ou d'ourdissage.
Les apprêts de la laine peignée, filée & ourdie, sont pour une infinité de villages dispersés autour des grandes manufactures, un fonds aussi fécond presque que la propriété des terres. Cependant le laboureur n'y devroit être employé que quand il n'y a point de friche, & que la culture a toute la valeur qu'on en peut attendre. Ces travaux toutefois font revenir sur les lieux une sorte d'équivalent qui remplit ce que les propriétaires en emportent sans retour.
On donne à toutes les étoffes dont la chaîne est d'étaim, des lisieres semblables à celles du drap ; mais elles ne sont pas si larges ni si épaisses : la lisiere est ordonnée dans quelques-unes pour les distinguer.
De l'étoffe de deux étaims ou de l'étamine. Il y a des étoffes dont la trame n'est point velue, mais faite de fil d'étaim ou de laine peignée, ainsi que la chaîne ; ce qui fabrique une étoffe lisse, qui eu égard à l'égalité ou presque égalité de ses deux fils, se nommera étamine, ou étoffe à deux étaims. Au contraire, on appellera étoffe sur étaim, celle dont la chaîne est de laine peignée, & la trame ou fourniture, ou enflure de fil lâche, ou de laine cardée.
De la distinction des étoffes. C'est de ces premiers préparatifs du fil provenu de matieres qui ont passé ou par les peignes, ou par les cardes, que naît la différence d'une simple toile, dont la chaîne & la trame sont d'un chaînon également tors, à une futaine qui est toute de coton, mais à chaîne lisse & à trame velue ; du drap, à une étamine rase. Le drap est fabriqué d'une chaîne & d'une trame qui ont été également cardées, quoique de la plus longue & de la plus haute laine ; au lieu que la belle étamine est faite d'étaim sur étaim, c'est-à-dire d'une chaîne & d'une trame également lisses, l'une & l'autre également serrées, & d'une fine & longue laine qui a passé par le peigne pour être mieux torse & rendue plus luisante. De la serge ou de l'étoffe drapée dont la trame est lâche & velue, aux burats, aux voiles, & aux autres étoffes fines dont le fil de longueur & celui de traverse, sont d'une laine très-fine, l'une & l'autre peignées, & l'une & l'autre presque également serrées au petit rouet. C'est cette égalité ou presque égalité des deux fils & la suppression de tout poil élancé au-dehors, qui, avec la finesse de la laine, donne aux petites étoffes de Rheims, du Mans, & de Châlons sur-Marne, le brillant de la soie.
L'étamine change & prend un nouveau nom avec une forme nouvelle, si seulement on a filé fort doux la laine destinée à la trame, quoiqu'elle ait été peignée comme celle de la chaîne.
Ce ne sera plus une étamine, mais une serge façon d'Aumale, si la trame est de laine peignée & filée lâche au petit rouet, & que la chaîne soit haussée & abaissée par quatre marches au lieu de deux, & que l'entrelas des fils soit doublement croisé.
Si au contraire la trame est grosse & filée au grand rouet, ce sera une serge façon de tricot.
Si la trame est fine, ce sera une serge façon de Saint-Lo, ou Londres ou façon de Londres.
Si la chaîne est filée au grand rouet & la trame de même, comme pour les draps, ce sera une ratine ou serge forte.
A ces premieres combinaisons, il s'en joint d'autres qui naissent ou simplement des degrés du plus au moins, ou des changemens alternatifs soit de couleur, soit de grosseur dans les fils de la chaîne, ou du frapper de l'étoffe sur le métier.
Une étoffe fine d'étaim sur étaim à deux marches, & serrée au métier, fera l'étamine du Mans.
La même frappée moins fort, ou laissée à claire voie, fera du voile.
La trame est elle filée de laine fine, mais cardée ? c'est un beau maroc.
Est-elle un peu grosse ? ce sera une baguette ou une sempiterne, pourvû qu'elle ait de largeur une aune & demie ou deux aunes.
Y a-t-on employé ce qu'il y a de pire en laine ? c'est une revesche.
La chaîne est-elle haussée & baissée par quatre marches, & la trame très-fine ? c'est un maroc double croisé.
La trame est-elle de laine un peu grosse sans croisure ? c'est une dauphine.
La trame est-elle de Ségovie cardée sur étaim fin ? c'est l'espagnolette de Rheims.
Est-elle double croisée ? c'est la flanelle.
La chaîne est-elle d'étaim double & retordu ? c'est le camelot.
Est-elle sur cinq lisses ou lames avec autant de marches ? c'est la calemande de Lisle.
Trame de Berri sur étaim croisé ? c'est le moleton, en le tirant au chardon des deux côtés.
Grosse trame de laine du pays, mêlée avec du peignon, sur chaîne de chanvre ? c'est la tiretaine de Baucamp ou le droguet du Berri & de Poitou.
La serge bien drappée, n'est que le pinchina de Toulon ou de Châlons-sur-Marne.
La serge de grosse laine bien foulée, est le pinchina de Berri.
On rempliroit cent pages des noms qui sont donnés aux étoffes d'une même espece, & qui n'ont de différence que les lieux où elles sont fabriquées.
En un mot, toutes les étoffes unies de laine, sous quelque dénomination qu'elles puissent être, ne se fabriquent que de deux façons, ou à simple croisure ou à double. Tout ce qui est fabriqué à simple croisure est de la nature du drap quand il foule ; tels sont les draps londrins, les soies ou draps façon de Venise, destinés pour le commerce du Levant, auxquels on donne des noms extraordinaires, comme aboucouchou, &c. & quand il ne foule pas, il est de la nature de la toile. Tout ce qui est fabriqué à double croisure est serge, soit qu'il foule ou qu'il ne foule pas. De façon que la Draperie en général, n'est que de drap ou de serge, excepté néanmoins les calemandes qui ont cinq lisses & cinq marches, & qui ne levent qu'une lisse à chaque coup de navette ; ce qui leur donne un envers & un endroit, quoique sans apprêt.
On appelle croisé simple, une étoffe à deux lisses & à deux marches dont les fils parfaitement croisés haussent & baissent alternativement à chaque coup de navette.
On appelle double croisé, une étoffe à quatre lisses & à quatre marches, dont le premier & le second fil levent au premier coup de navette ; le second & le troisieme au second coup de navette ; le troisieme & le quatrieme au troisieme coup de navette ; le quatrieme & le premier, au quatrieme coup, & ainsi de suite ; de maniere qu'un même fil hausse & baisse deux fois pour chaque duite, au lieu qu'il ne hausse & ne baisse qu'une fois au drap.
Après les étoffes de laine viennent les étoffes mélangées de laine & poil.
Des étoffes mélangées de laine & de poil. Tel est le camelot poil qui ne differe du camelot ordinaire, qu'en ce que la chaîne qui est d'un fil d'étaim bien fin est filée & retordue avec un fil de poil de chameau également fin, & la trame d'un fil d'étaim simple.
Les étamines & les camelots en soie, ou étamines jaspées & camelots jaspés, sont fabriqués pour la chaîne d'un fil de soie & d'un fil d'étaim, comme les camelots poil, mais frappés moins fort.
Le camelot & l'étamine jaspée ont la chaîne d'un fil d'étaim & d'un fil de soie de différentes couleurs, & c'est ce qui fait la jaspure.
Le cannelé, façon de Bruxelles, a la moitié de la chaîne d'une couleur, & l'autre moitié d'une autre ; il se travaille avec deux navettes, dont l'une chargée de grosse laine, & l'autre d'étaim fin, des deux mêmes couleurs que la chaîne qui est également retordue à deux fils, pour donner plus de consistance à l'étoffe, & la liberté de la frapper avec plus de force, & avec les battans les plus pesans.
Le drap, façon de Silésie, a sa chaîne & sa trame filées au grand rouet. Quoique cette étoffe soit réellement drap, néanmoins elle n'est pas travaillée à deux marches comme les draps ordinaires. C'est le dessein qui détermine la distribution des fils qui doivent lever & demeurer baissés ; de maniere que le fabriquant est assujetti à composer un dessein qui convienne à l'étoffe, dont la fabrication deviendroit impossible, si le dessein étoit autrement entendu.
Il ne faut pas oublier les camelots fleuris ou droguets façonnés d'Amiens. Ils ont la chaîne composée d'un fil de soie tordu avec un fil d'étaim très-fin, pour leur donner plus de consistance. Cette union du fil de soie & du fil d'étaim devient nécessaire ; car ces étoffes étant travaillées à la marche, la chaîne fatigue davantage.
On avoit entrepris à la manufacture de l'Hôpital de faire des droguets de cette espece tout laine ; ils ont eu quelque succès. Ces étoffes se fabriquoient à la tire ou au bouton, comme les draps de Silésie ; par ce moyen la chaîne étoit moins fatiguée.
Les droguets de Rheims soie & laine, ont la trame d'une laine extrêmement fine.
Ces étoffes qui sont fabriquées de deux matieres différentes, & qui ne foulent point, sont montées avec deux chaînes, dont l'une exécute la figure, & l'autre fournit au corps de l'étoffe ; ce qui ne pourroit se faire avec de la laine ; la grosseur du fil d'étaim, de quelque maniere qu'il soit filé, étant beaucoup plus considérable que celle de la soie, & la quantité qu'il en faudroit employer pour la fabrication dans les deux chaînes, étant d'un volume à ne pouvoir plus passer dans les lisses.
Après ces étoffes viennent les calemandes façonnées, ou à grandes fleurs.
Des calemandes façonnées ou à grandes fleurs. La composition de ces étoffes est semblable à celle des satins tout soie. La tire en est aussi la même ; il n'y a de différence que dans le nombre des fils, qui n'est pas si considerable à la chaîne, où ceux-là sont retordus & doubles.
Des pluches unies & façonnées. Les pluches unies ont été fabriquées à l'imitation des velours. La chaîne est également de fil d'étaim double & retordu, & le poil qui fait la seconde chaîne de la pluche, de poil de chameau tordu & doublé, à deux brins de fil pour les simples, à trois pour les moyennes, & à quatre pour les plus belles. Les pluches ciselées sont fabriquées comme les velours de cette espece ; les unes avec la marche, lorsque le dessein est peint ; les autres à la tire, lorsque le dessein est plus grand.
Il y a des pluches dont le poil est de soie, qu'on appelle pluches mi-soie ; elles ont la trame & la chaîne à l'ordinaire.
On rompoit plus efficacement le ressort du poil de la laine, & l'on donnoit aux étoffes un lustre plus net & plus durable, autrefois qu'on étoit dans l'usage de les passer à la calandre ; mais on s'est apperçu que celles qui étoient foulées n'acquéroient point la fermeté qu'elles devoient avoir, en ne prenant point le cati ; ce qui a conduit à l'emploi de la presse. La presse aidée des plaques de fer ou de cuivre extrêmement échauffées, donne la consistance qu'on exige.
Les ordonnances qui défendent de presser à chaud, sont des années 1508, 1560, 1601, & du 3 Décembre 1697 ; il faut s'y soumettre au moins pour les draps d'écarlate & rouge de garence, dont la chaleur éteint l'éclat. Mais pour éviter cet inconvénient, on tombe dans un autre, & ces étoffes non pressées à chaud, n'offrent jamais une qualité égale aux draps qui ont subi cette manoeuvre.
Les fabriquans contraints d'opter, ont négligé les ordonnances sur la presse à chaud ; ils la donnent même aux couleurs qui la craignent, & ils n'en font pas mieux.
Les étamines & les serges, soit celles qui étant fort lisses ne vont pas à la foulerie, soit celles qui n'ont été que dégraissées ou battues à l'eau, soit celles qui ont été non-seulement dégraissées & dégorgées, mais foulées à sec pour être drapées, doivent toutes être rinsées & aérées. On les retire de la perche pour leur donner les derniers apprêts, dont le but principal est d'achever de détruire les causes de rétraction & de ressort qui troublent l'égalité du tissu, d'incliner d'un même sens tous les poils d'un côté, d'en former l'endroit, & d'établir ainsi une sorte d'harmonie dans l'étoffe entiere, par la suppression des dérangemens & tiraillemens des fibres extérieures, & l'uniformité de la réflexion de la lumiere au-dehors.
C'est ce que l'on observe en faisant passer au bruisage les étamines délicates, & au retendoir ou bien à la calandre, toutes les étoffes foulées.
Du bruisage. Bruir des pieces d'étoffes, c'est les étendre proprement chacune à part, sur un petit rouleau ; & coucher tous ces rouleaux ensemble dans une grande chaudiere de cuivre rouge & de forme quarrée, sur un plancher criblé de trous, & élevé à quelque distance du vrai fond de la chaudiere.
On remplit d'eau l'intervalle du vrai fond, ou faux fond percé de trous ; on fait chauffer, on tient la chaudiere bien couverte. La vapeur qui s'éleve & qui passe par les trous du faux fond, est renvoyée par le couvercle de toutes parts sur les étoffes, les pénetre peu-à-peu, & assouplit tout ce qui est de roide & d'élastique ; la presse acheve de détruire ce qui reste.
Du retendoir. Il en est de même du retendoir. Après avoir aspergé d'une eau gommée tout l'envers de l'étoffe, & l'avoir mise sur un grand rouleau, on en applanit plus efficacement encore tous les plis & toute l'inégalité des tensions, en dévidant lentement l'étoffe de dessus son rouleau, & la faisant passer sur une barre de fer poli, qui la tient en état audessus d'un grand brasier capable d'en agiter jusqu'aux moindres fibres, & en la portant de-là sur un autre rouleau qui l'entraîne uniment à l'aide d'une roue, d'une chevre ou d'un moulinet. L'étoffe va & vient de la sorte à diverses reprises d'un rouleau à l'autre ; c'est l'intelligence de l'apprêteur qui regle la machine & la manoeuvre.
Voyez figure 46. le retendoir. A A A A, le banc ; b b, le rouleau ; c c c, les traverses, dessus & dessous lesquelles passe l'étoffe ; d d d, l'étoffe ; e e, la poële à mettre un brasier, qu'on glisse sous l'étoffe près du rouleau.
Enfin l'étoffe soit bruisée, soit retendue, est plissée, feuilletée, mise à la presse, ou même calandrée, puis empointée, ou empaquetée avec des ficelles qui saisissent tous les plis par les lisieres.
Il y a encore quelques apprêts qui different des précédens ; telle est la gaufre. Voyez l'article GAUFRER.
Il y a des étoffes gaufrées & qui portent ce nom, parce qu'on y a imprimé des fleurons, ou compartimens avec des fers figurés. Il y a des serges peintes qui se fabriquent & s'impriment à Caudebec en Normandie. Le débit en est d'autant plus considérable, que tout dépend du bon goût du fabriquant, du dessein & de la beauté des couleurs.
Il y a des étoffes tabisées ou ondées comme le gros taffetas qu'on nomme tabis, parce qu'ayant été inégalement, & par des méthodes différentes de l'ordinaire, pressées sous la calandre, le cylindre quoique parfaitement uni, a plié une longue enfilade de poils en un sens, & une autre enfilade de poils sur une ligne ou pression différente ; ce qui donne à la soie ou à la laine ces différens effets de lumiere ou sillons de lustre, qui semblent se succéder comme des ondes, & qui se conservent assez long-tems ; parce que ce sont les impressions d'un poids énorme, qui dans ses différentes allées & venues, a plutôt écrasé que plié les poils & le grain de l'étoffe.
On fit il y a plusieurs années à la manufacture de Saint-Denis des expériences sur une nouvelle méthode de fabriquer les étoffes de laine, sans les coller après qu'elles sont ourdies, comme c'est l'usage.
Il s'agit de préparer les fils d'une façon, qui leur donne toute la consistance nécessaire.
Nous ne savons ce que cela est devenu.
Nous finirons cet article en rassemblant sous un même point de vûe quelques arts assez différens, qui semblent avoir un but commun, & presque les mêmes manoeuvres ; ces arts sont ceux du Chapelier, du Perruquier, du Tabletier-Cornetier, du Faiseur de tabatieres en écaille, & du Drapier. Ils emploient tous, les uns les poils des animaux, les autres l'écaille, les cheveux, & tous leurs procédés consistent à les amollir par la chaleur, à les appliquer fortement, & à les lier.
LAINE HACHEE, TAPISSERIE EN LAINE HACHEE, (Art méchan.) Comme nous ne fabriquons point ici de ces sortes d'ouvrages, voici ce que nous en avons pu recueillir.
1. Préparez un mélange d'huile de noix, de blanc de céruse & de litharge ; employez ce mélange chaud.
2. Que votre toile soit bien étendue sur un métier.
3. Prenez un pinceau ; répandez par-tout de votre laine hachée, & que cette laine soit de la couleur dont vous voulez que soit votre tapisserie.
4. Si vous voulez varier de dessein coloré votre tapisserie ; lorsque votre laine hachée tiendra à la toile, peignez toute sa surface comme on peint les toiles peintes : ayez des planches.
5. Si vous voulez qu'il y ait des parties enfoncées & des parties saillantes, & que le dessein soit exécuté par ces parties saillantes & enfoncées, ayez un rouleau gravé avec une presse, comme pour le gaufrer des velours. Un ouvrier enduira le rouleau de couleurs avec des balles ; un autre ouvrier tournera le moulinet ; l'étoffe passera sur le rouleau, sera pressée & mise en tapisserie.
|
| LAINERIE | terme de, (Commerce, Manufact.) voici d'après Savary, Ricard & autres, l'explication de la plupart des termes de lainerie ou lainage, qui sont usités dans le Commerce & les Manufactures de France.
Laine d'agnelin, laine provenant des agneaux & jeunes moutons ; ce sont les bouchers & rotisseurs qui en font les abattis. La laine d'agnelin n'est permise que dans la fabrique des chapeaux.
Laine d'autruche, terme impropre ; car ce n'est point une laine provenant de la tonture des brebis ou moutons, c'est le ploc d'autruche, c'est-à-dire le duvet ou poil de cet oiseau. Il y en a de deux sortes, le fin & le gros ; le fin entre dans la fabrique des chapeaux communs ; le gros que l'on appelle ordinairement gros d'autruche, se file & s'emploie dans les manufactures de lainage, pour faire les lisieres des draps noirs les plus fins.
Laines auxi, autrement laine triée, est la plus belle laine filée, qui se tire des environs d'Abbeville.
Laine basse ou basse laine ; c'est la plus courte & la plus fine laine de la toison du mouton ou de la brebis ; elle provient du collet de l'animal qu'on a tondu. Cette sorte de laine filée sert aux ouvrages de bonnetterie, comme aussi à faire la trême des tapisseries de haute & basse lisse, des draps, des ratines & semblables étoffes fines ; c'est pour cela qu'on l'appelle laine-trame. Les Espagnols & les Portugais lui donnent le nom de prime, qui signifie premiere.
Laine cardée ; c'est toute laine, qui après avoir été dégraissée, lavée, séchée, battue sur la claie, épluchée & aspergée d'huile, a passé par les mains des cardeurs, afin de la disposer à être filée, pour en fabriquer des tapisseries, des étoffes, des bas, des couvertures, &c. La laine cardée qui n'a point été aspergée d'huile, ni filée, s'emploie en courtepointes, en matelas, &c.
Laine crue ; c'est de la laine qui n'est point apprétée.
Laine cuisse ; c'est de la laine coupée entre les cuisses des brebis & des moutons.
Laine filée ; c'est de la laine filée, qu'on appelle fil de sayette. Elle vient de Flandres, & particulierement du bourg de Turcoing ; elle entre dans plusieurs fabriques de lainage, & fait l'objet d'un grand commerce de la Flandre françoise.
Laine fine, ou haute laine : c'est la meilleure de toutes les laines, & le triage de la mere- laine.
Laine frontiere ; on appelle ainsi la laine filée des environs d'Abbeville & de Rosieres ; c'est la moindre laine qui se tire de Picardie.
Laine grasse, ou laine en suif, laine en suin, ou laine surge ; tous ces noms se donnent à la laine qui n'a point encore été lavée, ni dégraissée. Les Epiciers-Droguistes appellent oesipe, le suin ou la graisse qui se tire des laines. Voyez OESIPE.
Laine haute, autrement dite laine-chaîne : laine-étaim ; c'est la laine longue & grossiere qu'on tire des cuisses, des jambes, & de la queue des bêtes à laine.
Laine migeau ; on appelle ainsi dans le Roussillon la laine de la troisieme sorte, ou la moindre de toutes les laines, que les Espagnols nomment tierce.
Laine moyenne ; est le nom de celle qui reste du premier triage de la mere laine.
Laine de Moscovie ; c'est le duvet des castors qu'on tire sans gâter ni offenser le grand poil ; le moyen d'y parvenir n'est pas trop connu.
Laine peignée ; est celle que l'on a fait passer par les dents d'une sorte de peigne ou grande carde, pour la disposer à être filée ; on l'appelle aussi en un seul mot estaim.
Laine pelade, ou laine avalie ; est le nom de la laine que les Mégissiers & Chamoiseurs font tomber par le moyen de la chaux, de dessus les peaux de brebis & moutons, provenantes des abattis des bouchers : elle sert à faire les trêmes de certaines sortes d'étoffes.
Laine peignon, ou en un seul mot peignons ; sorte de laine de rebut, comme la bourre ; c'est le reste de la laine qui a été peignée.
Laine riflard ; espece de laine la plus longue de celles qui se trouvent sur les peaux de moutons non apprétées. Elle sert aux Imprimeurs à remplir les instrumens qu'ils appellent balles, avec lesquelles ils prennent l'encre qu'ils emploient à l'Imprimerie.
Laine de vigogne ; laine d'un animal d'Amérique qui se trouve dans les montagnes du Pérou, & qui ne se trouve que là. Cette laine est brune ou cendrée, quelquefois mêlée d'espace en espace de taches blanches : on en distingue de trois sortes ; la fine, la carmeline ou batarde, & le pelotage ; cette derniere se nomme ainsi, parce qu'elle vient en pelotes ; elle n'est point estimée. Toutes ces trois laines entrent néanmoins mélangées avec du poil de lapin, ou partie poil de lapin, & partie poil de lievre, dans les chapeaux qu'on appelle vigognes.
Pile de laine, est un monceau de laines, formé des toisons abattues de dessus l'animal : ce terme de pile est en partie consacré aux laines primes d'Espagne. Entre ces laines primes, la pile des chartreux de l'Escurial & celle des jésuites, passent pour les meilleures. Voyez LAINE.
LAINER, ou LANER, v. act. c'est tirer la laine sur la superficie d'une étoffe, la garnir, y faire venir le poil par le moyen des chardons.
LAINEUR ou LANEUR, s. m. (Arts méch.) ouvrier qui laine les étoffes, ou autres ouvrages de lainerie : on l'appelle aussi éplaigneur, emplaigneur, aplaigneur, pareur. Les outils dont il se sert pour travailler, se nomment croix ou croisées, qui sont des especes de doubles croix de fer avec des manches de bois, sur lesquelles sont montées des brosses de chardons.
LAINIER, s. m. (Com.) est celui qui vend en écheveaux ou à la livre, les laines qu'on emploie aux tapisseries, franges & autres ouvrages. Les marchands lainiers ont le nom de teinturiers en laine dans leurs lettres de maîtrise, les statuts & réglemens de police des Teinturiers, trois choses qui d'ailleurs ne fourniroient pas matiere à nos éloges.
S'il se rencontre ici des termes omis, on en trouvera l'explication aux mots LAINE, manuf. & LAINE apprêt des (D.J.)
|
| LAINO | (Géog.) Lans, petite place d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, au pié de l'Apennin, sur les confins de la Basilicate, près la petite riviere de Laino qui lui a donné son nom. Long. 33. 46. lat. 40. 4. (D.J.)
|
| LAIQUE | S. m. (Théolog.) se dit des personnes ou des choses distingués dans l'état ecclésiastique, ou de ce qui appartient à l'Eglise.
Laïque, en parlant des personnes, se dit de toutes celles qui ne sont point engagées dans les ordres ou du moins dans la cléricature.
Laïque, en parlant des choses, se dit ou des biens ou de la puissance ; ainsi l'on dit biens laïques, pour exprimer des biens qui n'appartiennent pas aux églises. Puissance laïque, par opposition à la puissance spirituelle ou ecclésiastique.
Juge laïque, est un magistrat qui tient son autorité du prince & de la république, par opposition au juge ecclésiastique qui tient la sienne immédiatement de Dieu même, tels que les évêques ; ou des évêques, comme l'official. Voyez OFFICIAL.
|
| LAIS | S. m. (Jurisprud.) en termes d'eaux & forêts signifie un jeune baliveau de l'âge du bois qu'on laisse quand on coupe le taillis, afin qu'il revienne en haute futaie.
Lais dans quelques coutumes signifie ce que la riviere donne par alluvion au seigneur haut-justicier. Cout. de Bourbonnois, art. 340.
Lais se dit aussi quelquefois au lieu de laie à cens ou bail à rente, ou emphitéotique. Voyez LAIE.
Tous ces termes viennent de laisser. (A)
|
| LAISOT | S. m. (Commerce) c'est dans les manufactures en toile de Bretagne, la plus petite laise que les toiles peuvent avoir selon les réglemens.
|
| LAISSADE | S. f. (Marine) c'est l'endroit d'une jutere où la largeur des fonds est diminuée en venant sur l'arriere. La laissade est la même chose que la queste de poupe.
|
| LAISSE | S. f. (Chasse) corde dont on tient un chien pour le conduire, ou deux chiens accouplés.
LAISSE, (Chapelier) cordon dont on fait plusieurs tours sur la forme du chapeau pour la tenir en état. Il y en a de crin, de soie, d'or & d'argent.
LAISSE, (Chasse) Voyez LAISSEES.
LAISSE, (Géog.) riviere de Savoie ; elle sort des montagnes des Deserts, passe au faubourg de Chambery, & se jette avec l'Orbane, dans le lac du Bourget. (D.J.)
|
| LAISSÉ | S. m. (Rubanier) ce sont tous les points blancs d'un patron qui désignent les hautes lisses, c'est-à-dire les endroits où il faut passer les trames à côté des bouclettes des hautes lisses, & non dedans. Ainsi on dit, la sixieme haute lisse fait un laissé -le. En un mot, c'est le contraire des pris. Voyez PRIS.
|
| LAISSÉE | S. f. (terme de Chasse) ce sont les fientes des loups & des bêtes noires.
|
| LAISSER | v. act. (Gramm. & Art mech.) ce verbe a un grand nombre d'acceptions différentes, dont voici les principales désignées par des exemples : l'accusation calomnieuse de cet homme que j'aimois, m'a laissé une grande douleur, malgré le mépris que j'en fais à présent. On a laissé cet argent en dépôt. On laisse tout traîner. On laisse un homme dans la nasse & l'on s'en tire. On laisse souvent le droit chemin. Malgré le peu de vraisemblance, ce fait ne laisse pas que d'être vrai. Il faut laisser à ses enfans un bien dont on n'est que le dépositaire, quand on l'a reçu de ses peres. Laissez -moi parler, & vous direz après. Il vaut mieux laisser aux pauvres qu'aux églises. Je me suis laissé dire cette nouvelle. Cette comparaison laisse une idée dégoûtante. Ce vin laisse un mauvais goût. Je me laisse aller, quand je suis las de resister. Je ne laisse au hasard que le moins que je peus. Il y a dans cet auteur plus à prendre qu'à laisser, &c.
LAISSER aller son cheval, c'est ne lui rien demander, & le laisser marcher à sa fantaisie, ou bien c'est ne le pas retenir de la bride lorsqu'il marche ou qu'il galope ; il signifie encore, lorsqu'un cheval galope, lui rendre toute la main & le faire aller de toute sa vitesse. Laisser échapper. Voyez ECHAPPER. Laisser tomber. Voyez TOMBER. Laisser souffler son cheval. Voyez SOUFFLER.
|
| LAISSES | LAISSES
|
| LAIT | S. m. (Chimie, Diete & Mat. med.) Il est inutile de définir le lait par ses qualités extérieures : tout le monde connoit le lait.
Sa constitution intérieure ou chimique, sa nature n'est pas bien difficile à dévoiler non plus ; cette substance est de l'ordre des corps surcomposés, voyez MIXTION, & même de ceux dont les principes ne sont unis que par une adhérence très-imparfaite.
Une altération spontanée & promte que cette liqueur subit infailliblement lorsqu'on la laisse à elle-même, c'est-à-dire sans mélange & sans application de chaleur artificielle ; cette altération, dis-je, suffit pour désunir ces principes & pour les mettre en état d'être séparés par des moyens simples & méchaniques. Les opérations les plus communes pratiquées dans les laiteries, prouvent cette vérité. Voy. LAIT, économie rustique.
Les principes du lait ainsi manifestés comme d'eux-mêmes, sont une graisse subtile, connue sous le nom de beurre, voyez BEURRE ; une substance muqueuse, appellée caséeuse, du latin caseus, fromage, voyez MUQUEUX & FROMAGE ; & une liqueur aqueuse, chargée d'une matiere saline & muqueuse. Cette liqueur est connue sous le nom de petit-lait, & sous le nom vulgaire de lait de beurre ; & cette matiere saline-muqueuse, sous celui de sel ou de sucre de lait. Voyez PETIT-LAIT & SUCRE DE LAIT, à la suite du présent article.
Cette altération spontanée du lait est évidemment une espece de fermentation. Aussi la partie liquide du lait ainsi altéré, qui a été débarrassée des matieres concrescibles dont elle étoit auparavant chargée, est-elle devenue une vraie liqueur fermentée, c'est-à-dire qu'il s'est engendré ou développé chez elle le produit essentiel & spécifique d'une des fermentations proprement dites, voyez FERMENTATION. C'est à la fermentation acéteuse que tourne communément le petit lait séparé de soi-même, ou lait de beurre ; mais on pense qu'il n'est pas impossible de ménager cette altération de maniere à exciter dans le lait la fermentation vineuse, & à saisir dans la succession des changemens arrivés dans le petit- lait, au moins quelques instans, pendant lesquels on le trouveroit spiritueux & enivrant. On ajoûte que de pareilles observations ont été faites plus d'une fois par hasard dans les pays où, comme en Suisse, le lait de beurre est une boisson commune & habituelle pour les hommes & pour quelques animaux domestiques, tels que les cochons, &c. On prétend donc qu'il n'est pas rare dans ces contrées de voir des hommes & des cochons enivrés par une abondante boisson de lait de beurre. On peut tenter sur ce sujet des expériences très-curieuses & très-intéressantes.
La fermentation commence dans le lait, & même s'y accomplit quant à son principal produit, celui de l'acide, avant que le beurre & le fromage se séparent ; car le lait laissé à lui-même s'aigrit avant de tourner, c'est-à-dire avant la desunion des principes dont nous venons de parler : l'un & l'autre changement, savoir l'aigrir & le tourner, sont d'autant plus promts, que la saison est plus chaude.
On n'a pas déterminé, que je sache, par des expériences, si une partie de l'acide du lait aigri étoit volatile.
Les principes immédiats du lait se desunissent aussi par l'ébullition. Dès qu'on fait bouillir du lait, il se forme à sa surface une pellicule qui ne differe presque point de celle qui nage sur le lait qui a subi la décomposition spontanée : cette matiere s'appelle crême ? elle n'est autre chose que du beurre mêlé de quelques parties de fromage, & empreint ou imbibé de petit- lait. On peut épuiser le lait de sa partie butireuse, par le moyen de l'ébullition. Dans cette opération, le fromage reste dissous dans le petit- lait qui n'aigrit point (ce qui est conforme à une propriété constante de la fermentation vineuse & de l'acéteuse, savoir d'être empêchées, prévenues, suspendues par un mouvement étranger), & qui acquiert même la propriété d'aigrir beaucoup plus tard, lorsqu'on l'abandonne ensuite à sa propre pente. Le lait qu'on a fait bouillir seulement pendant un quart-d'heure, se conserve sans aigrir ni tourner pendant beaucoup plus de tems, pendant trente-six & même quarante-huit heures, plus ou moins, selon la température de l'air ; au lieu que le lait qui n'a pas bouilli, se conserve à peine douze heures. Mais enfin, comme nous venons de l'indiquer, la séparation du fromage & du petit- lait arrive enfin aussi bien que l'aigrissement du petit- lait.
On opere encore la décomposition du lait par un moyen très-connu, très-vulgaire, mais dont il n'existe encore dans l'art aucune théorie satisfaisante, je veux dire, la coagulation par l'application de certaines substances, savoir les acides (soit foibles, soit très-forts, tels que l'acide vitriolique le plus concentré, qu'Hoffman prétend produire dans le lait l'effet directement contraire. Voyez la dissertation de salub. seri lactis virtute, §. 4), les alcalis, les esprits ardens, & particulierement le lait aigri dans l'estomac des jeunes animaux à la mamelle, lactantium, & certaines fleurs & étamines ; ce lait aigri & ces fleurs tirent de leur usage le nom commun de presure. Voy. COAGULATION, PRESURE & LAIT, Economie rustique.
Le lait n'est séparé par la coagulation qu'en deux parties, & cette séparation n'est pas absolue ou parfaite. Le coagulum ou caillé contient cependant presque tout le fromage & le beurre, & la liqueur est le petit- lait ou le principe aqueux chargé du sel ou sucre, & d'une très petite quantité de fromage & de beurre.
Quelques auteurs ont prétendu que de même que certaines substances mêlées au lait hâtoient son altération ou le coaguloient, de même il en étoit d'autres qui le préservoient de la coagulation en opérant une espece d'assaisonnement. Ils ont attribué principalement cette vertu aux eaux minérales alcalines ou sulphureuses, & aux spiritueuses. Ces prétentions sont sans fondement : on ne connoit aucune matiere qui étant mêlée en petite quantité au lait, en empêche l'altération spontanée ; & quant aux eaux minérales, j'ai éprouvé que le principe aqueux étoit le seul agent utile dans les mélanges d'eaux minérales & de lait, faits dans la vûe de corriger la tendance du lait à une promte décomposition : car il est vrai que ces eaux minérales mêlées à du lait frais à parties à-peu-près égales, en retardent sensiblement, quoique pour peu de tems, l'altération spontanée ; mais de l'eau pure produit exactement le même effet.
Le petit lait n'aigrit point, n'a pas le tems d'aigrir dans cette derniere opération. Aussi est-ce toûjours par ce moyen qu'on le sépare pour l'usage médicinal ordinaire. Voyez PETIT-LAIT, à la suite du présent article.
Le lait distillé au bain-marie, donne un phlegme chargé d'une odeur de lait ; mais cette odeur n'est point dûe à un principe aromatique particulier, & distinct des principes dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ce n'est ici, comme dans toutes les substances véritablement inodores (c'est-à-dire dépourvûes d'un principe aromatique distinct) qui se font reconnoître pourtant dans le produit le plus mobile de leur distillation, qu'une foible & legere émanation, effluvium, de leur substance entiere.
Tout ce principe aqueux étant séparé par la distillation au bain-marie, ou dissipé par l'évaporation libre au même degré de chaleur, on obtient une matiere solide, friable, jaunâtre, d'un goût gras & sucré assez agréable, qui étant jettée dans des liqueurs aqueuses bouillantes, s'y dissout en partie, les blanchit, & leur donne presque le même goût que le mêlange du lait frais & inaltéré. Il est évident que cette matiere n'est que du lait concentré, mais cependant un peu dérangé dans sa composition. Voyez SUCRE DE LAIT, à la suite du présent article.
L'analyse ultérieure à la violence du feu, ou la distillation par le feu seul poussée jusqu'à ses derniers degrés, fournit une quantité assez considérable d'huile empyreumatique ; & s'il en faut croire Homberg, Mém. de l'Acad. royale des Scienc. 1712, incomparablement plus d'acide que le sang & la chair des gros animaux, & point du tout de sel volatil concret. Cette attention à spécifier l'état concret de l'alcali volatil que ce chimiste exclut des produits du lait, fait conjecturer, avec beaucoup de fondement, qu'il retiroit du lait de l'alcali volatil sous son autre forme, c'est-à-dire liquide. Or, quoique les matieres d'où on ne retire de l'alcali volatil que sous cette derniere forme, dans les distillations vulgaires, en contiennent beaucoup moins en général que celles qui fournissent communément ce principe sous forme concrete, cependant cette différence peut n'être qu'accidentelle, dépendre d'une circonstance de manuel, savoir du desséchement plus ou moins absolu du sujet pendant le premier tems de la distillation. Voyez DISTILLATION, MANUEL CHIMIQUE & SEL VOLATIL. Ainsi l'observation d'Homberg sur ce principe du lait, n'est rien moins qu'exacte & positive.
Ce que nous avons dit du lait jusqu'à-présent, convient au lait en général. Ces connoissances sont déduites des observations faites sur le lait de plusieurs animaux, différant entr'eux autant qu'il est possible à cet égard, c'est-à-dire sur celui de plusieurs animaux qui ne se nourrissent que de substances végétales, & sur celui de certains autres qui vivent principalement de chair. L'analogie entre ces différens laits est parfaite, du moins très-considérable ; & il y a aussi très-peu de différence quant au fond de la composition du lait entre celui que donne un même individu, une femme, par exemple, nourrie absolument avec des végétaux, ou qui ne vivra presque que de substances animales. Ce dernier fait est une suite bien naturelle de l'observation précédente. Une expérience décisive prouve ici que la Chimie, en découvrant cette identité, ne l'établit point seulement sur des principes grossiers, tandis que des principes plus subtils & qui fondent des différences essentielles lui échappent. Cette expérience est que les quadrupedes, soit très-jeunes, lactantia, soit adultes, sont très-bien nourris avec le lait de quelqu'autre quadrupede que ce soit : on éleve très-bien un jeune loup avec du lait de brebis. Rien n'est si commun que de voir des petits chats têter des chiennes. On nourrit très-bien les enfans avec le lait de vache, de chevre, &c. Un observateur très-judicieux, très-philosophe, très-bon citoyen, a même prétendu qu'il résulteroit un grand bien pour l'espece humaine en général, & un avantage décidé pour les individus, de l'usage de nourrir tous les enfans avec le lait des animaux. Voyez NOURRICE.
Cette identité générique ou fondamentale, n'empêche pas que les laits des divers animaux ne soient distingués entr'eux par des qualités spécifiques ; la différence qui les spécifie principalement & essentiellement, c'est la diverse proportion des principes ci-dessus mentionnés. Les Chimistes medecins se sont principalement attachés à déterminer ces proportions dans les especes de lait qui ont des usages médicinaux, savoir le lait de femme, le lait d'anesse & celui de jument, le lait de vache, celui de chevre, & celui de brebis.
Fréderic Hoffman a trouvé qu'une livre de médecine ou douze onces de lait de vache, épuisée par l'évaporation de sa partie aqueuse, laissoit une once & cinq gros de matiere jaunâtre, concrete, seche & pulvérulente ; que cette matiere lessivée avec l'eau bouillante, perdoit une dragme & demie. Homberg a d'ailleurs observé dans les mémoires de l'acad. R. des Sc. ann. 1712. que la partie caséeuse & la butireuse étoient contenues à parties à peu près égales dans le lait de vache. Ainsi supposé que l'eau employée à lessiver le lait concentré & desséché, n'en ait emporté que la matiere qui est naturellement dissoute dans le petit- lait, il résultera de ces expériences que le lait de vache examiné par Hoffman, contenoit environ un seizieme de son poids de beurre, autant de fromage, & un soixante-quatrieme de matiere, tant saline ou sucrée, que caseoso-butyreuse, soluble par l'eau. Voyez PETIT-LAIT & SUCRE DE LAIT.
Les mêmes expériences tentées par Hoffman & par Homberg sur le lait de chevre, ont indiqué que la proportion des principes étoit la même dans ce lait : & que la quantité de matiere concrescible prise en somme, étoit seulement moindre d'un vingt-sixieme.
Hoffman a tiré, par la même voie, de douze onces de lait d'anesse, une once de résidu sec, pulvérulent & blanc, qui ayant été lessivé avec de l'eau bouillante, a perdu environ sept gros. Homberg prétend que le lait d'anesse contient trois ou quatre fois plus de fromage que de crême ou de substance dans laquelle le beurre domine. Ainsi la partie soluble dans l'eau, ou le sucre de lait un peu barbouillé de fromage & de beurre domine dans le lait d'anesse, y est contenue à la quantité d'environ un quinzieme ou un seizieme du poids total ; le beurre fait tout au plus le trois-centieme du tout, & le fromage le centieme.
Le lait de femme a donné à Hoffman un résidu blanchâtre, presqu'égal en quantité à celui du lait d'ânesse ; mais qui ne contenoit pas tant de matiere soluble par l'eau, & seulement six gros sur neuf ou les deux tiers.
Les expériences que nous venons de rapporter ont été faites avec beaucoup de négligence & d'inéxactitude ; l'énoncé de celles d'Homberg est on ne peut pas plus vague, & Hoffman a manqué, 1°. à employer le bain-marie pour dessécher la substance fixe ou concrescible du lait : or il est presqu'impossible de dessécher cette matiere parfaitement au feu nud, sans la brûler ou du moins la rissoler tant soit peu, ce qui est le défaut contraire au desséchement imparfait. Secondement, il n'a point distingué dans la partie insoluble de son résidu, le beurre du fromage, ni dans la matiere enlevée par les lessives le sel ou sucre du lait d'un fromage subtil, uni à un peu de beurre que l'eau entraîne avec ce sel, qui fournit la matiere de la recuite, & qui est celle qu'on se propose d'enlever par la clarification du petit- lait, & par la lotion du sel ou sucre de lait. Voyez ci-dessous PETIT-LAIT & SUCRE DE LAIT. Cet examen bien fait seroit donc encore un travail tout neuf, & certainement, indépendamment des différences qu'on doit se promettre dans les résultats d'une analyse exacte, on en trouveroit beaucoup qui seroient nécessairement dépendantes de l'âge, du tempérament, de la santé des divers animaux, & sur-tout de la maniere dont ils seroient nourris ; par exemple des paturages plus ou moins gras, & encore du climat où ils vivroient, &c.
Ce que nous venons de rapporter, tout imparfait qu'il est, suffit pourtant pour fixer l'idée des Médecins sur les différences essentielles des especes de lait qui fournissent des alimens ou des remedes aux hommes ; car l'usage médicinal se borne presque aux quatre especes de lait dont nous venons de faire mention ; & il est connu encore par des observations à peu près suffisantes, que le lait de brebis qu'on emploie dans quelques contrées, est fort analogue à celui de vache, & que le lait de jument, dont l'usage commence à s'établir en France, est d'une nature moyenne entre le lait de vache & celui d'ânesse, s'approchant pourtant davantage de celle du dernier. Celui de chameau dont les peuples du Levant se servent, est un objet absolument étranger pour nous.
Usage diététique & médicamenteux du lait, & premierement du lait de vache, de chevre & de brebis.
Le lait de vache est, pour les Médecins, le lait par excellence ; c'est de ce lait qu'il est toujours question dans leurs ouvrages, lorsqu'ils parlent de lait en général, & sans en déterminer l'espece. Le lait de vache possede en effet le plus grand nombre des qualités génériques du lait : il est, s'il est permis de s'exprimer ainsi, le plus lait de tous ceux que la Médecine emploie, celui qui contient les principes que nous avons exposés plus haut, dans la proportion la plus exacte. Il est vraisemblable pourtant que cette espece de prééminence lui a été principalement accordée, parce qu'il est le plus commun de tous, celui qu'on a le plus commodément sous la main ; car le lait de chevre est très-analogue au lait de vache : la prétendue qualité plus particulierement pectorale, vulnéraire, par laquelle on distingue le premier dans la pratique la plus reçue, est peu évidente ; & dans les pays où l'on trouve plus facilement du lait de chevre que du lait de vache, on emploie le premier au lieu du second, sans avoir observé des différences bien constatées dans leurs bons & dans leurs mauvais effets. Le lait de brebis supplée très-bien aussi dans tous les cas à l'un & à l'autre, dans les pays où l'on manque de vaches & de chevres. Tout cela pourroit peut-être s'éclaircir par des observations : je dis peut-être, car ces observations seroient au moins très-difficiles, très-fines. Quoi qu'il en soit, elles n'existent pas, & il paroît que l'art y perd peu. On peut cependant, si l'on veut, regarder le lait de vache comme le remede principal, chef majeur ; & les deux autres seulement comme ses succédanées.
Le mot lait sans épithéte signifiera donc dans la suite de cet article, comme il doit le signifier dans les ouvrages de Médecine, lait de vache, ou à son défaut lait de chevre ou de brebis ; & nous renfermerons ce que nous avons à dire à ce sujet dans les considérations suivantes, où nous nous occuperons premierement de ses usages diététiques dans l'état sain, & ensuite de son emploi plus proprement médicinal, c'est-à-dire dans le cas de maladie.
Le lait fournit à des nations entieres, principalement aux habitans des montagnes, la nourriture ordinaire, journaliere, fondamentale. Les hommes de ces contrées sont gras, lourds, paresseux : stupides ou du moins graves, sérieux, pensifs, sombres. Il n'est pas douteux que l'usage habituel du lait ne soit une des causes de cette constitution populaire. La gaieté, l'air leste, la légereté, les mouvemens aisés, vifs & vigoureux des peuples qui boivent habituellement du vin, en est le contraste le plus frappant.
Ce qui confirme cette conjecture, & qui est en même tems une observation utile, c'est que le lait donné pour toute nourriture, ou ce qu'on appelle communément la diete lactée ou la diete blanche, que ce régime, dis-je, jette très-communément les sujets qu'on y soumet dans une mélancolie très sombre, très-noire, dans des vapeurs affreuses.
Il est admirable cependant combien le lait pris en très-petite quantité pour toute nourriture, nourrit & soutient, lorsqu'il réussit, les personnes mêmes les plus vigoureuses, & de l'esprit le plus vif, sans faire tomber sensiblement leurs forces corporelles, & sans affoiblir considérablement leurs facultés intellectuelles, & cela pendant des années entieres. On comprend plus aisément, mais il est pourtant assez singulier aussi que des personnes auparavant très-voraces, s'accoutument bientôt à la sobriété que cette diete exige, & qu'elles contractent de l'indifférence & enfin même du dégoût pour les alimens ordinaires.
Nous ne parlons dans les deux observations précédentes que des sujets qui se réduisent à la diete lactée pour prévenir des maux dont ils sont menacés, & non pas pour remédier à des maux présens. Ces sujets doivent être considérés alors comme véritablement sains, & nous n'examinons encore que les effets du lait dans l'état sain.
Le lait pur, certains alimens solides, & quelques boissons assaisonnées avec le lait, tels que le ris, les oeufs, le thé, le caffé, ont l'inconvénient très-commun de lâcher le ventre. Ces alimens, sur-tout ceux qui sont sous forme liquide, produisent cet effet par une espece de corruption qu'ils éprouvent dans les premieres voies, ils deviennent vraiment purgatifs par cette altération qui se démontre, & par la nature des rapports nidoreux qui s'élevent de l'estomac, & par des borborygmes & des légeres tranchées, & enfin par la mauvaise odeur des excrémens qui est exactement semblable à celle des évacuations excitées par une légere médecine. De toutes les boissons que nous mêlons ordinairement avec le lait, celle qui produit le moins communément cette espece de purgation, c'est le caffé au lait, soit que la petite quantité qu'on en prend en comparaison du thé au lait, par exemple, cause cette différence, soit que le caffé corrige véritablement le lait. Voyez CORRECTIF.
L'effet dont nous venons de parler s'observe principalement sur les personnes robustes, agissantes, peu accoutumées au lait, & qui sont dans l'usage journalier des alimens & des boissons ordinaires, sur-tout de la grosse viande & du vin ; & ces personnes sont sensiblement affoiblies par cette opération de ces laitages. Les gens foibles, peu exercés au lait, ou ceux qui sont accoutumés au lait, & ceux enfin de quelque constitution qu'ils soient qui vivent de lait pour toute nourriture, sont au contraire ordinairement constipés par le lait ; & cet accident qui est principalement propre à la diete lactée, est un des principaux inconvéniens de cette diete.
En général le lait passe mieux, c'est-à-dire est mieux digéré, laisse mieux subsister l'état naturel & sain des organes de la digestion, lorsqu'on le prend pour toute nourriture, ou qu'on n'en combine l'usage qu'avec celui des farineux fermentés ou non fermentés, tels que le pain, le ris, les pâtes d'Italie, le sagou, &c. que lorsqu'on en use, sans cesser de tirer le fond de la nourriture des alimens ordinaires, même avec les exceptions vulgaires des assaisonnemens acides, des fruits cruds, des salades, &c. Cependant il y a encore en ceci une bisarrerie fort remarquable (quoique ces sortes de contradictions soient fort communes dans l'ordre des objets diététiques. Voyez REGIME, DIGESTION, & presque tous les articles particuliers de diete de ce Dictionnaire ; l'article CONCOMBRE, par exemple) : il est très-ordinaire de voir des personnes qui dans un même jour, & souvent même dans un seul repas, se gorgent de viandes de toute espece, de vin, de salades, de fruits & de laitages, & qui digerent très-bien & cent fois de suite ce margouilli qui feroit frémir tout médecin raisonneur.
Le proverbe vulgaire, que le vin bu après le lait est salutaire, & que le lait bu après le vin est un poison, ne porte sur rien, si on l'explique in sensu abvio, & comme on l'entend communément ; c'est-à-dire qu'il n'est rien moins qu'observé qu'un mélange de vin & de lait affecte différemment l'estomac, selon que l'une ou l'autre de ces liqueurs y est versée la premiere. Il est très-sûr, au contraire, que ce mélange, dans quelque ordre qu'il soit fait, est toujours monstrueux aux yeux de la Médecine rationnelle, & plus souvent nuisible qu'in différent aux yeux de l'observation ; mais si ce dogme populaire signifie que le vin remédie au mauvais effet que du lait pris depuis quelques heures a produit sur les premieres voies, & qu'au contraire du lait jetté dans un estomac n'a guere chargé de vin, y cause constamment un mal considérable ; alors il ne fait que trop promettre sur le premier chef, & il est conforme à l'expérience pour le second.
Il est facile de conclure de ce petit nombre d'observations sur les propriétés diététiques du lait dans l'état sain, que c'est un aliment suspect, peu analogue aux organes digestifs de l'adulte, & que l'art humain, l'éducation, l'habitude, n'ont pu faire adopter à la nature, comme elles ont naturalisé le vin, liqueur pourtant bien plus étrangere à l'homme que le lait des animaux ; & qu'ainsi un canon diététique sûr & incontestable, & qui suffit seul en cette matiere, c'est que les personnes qui n'ont point éprouvé leur estomac à ce sujet, ne doivent user de lait que dans le cas de nécessité, c'est-à-dire, s'il arrivoit par hasard qu'elles manquassent dans quelque occasion particuliere d'autres alimens, ou si elles étoient menacées de quelques maladies que l'usage du lait peut prévenir. Mais comme il est peu d'hommes qui se soient toûjours conduits assez médicinalement pour avoir constamment usé de cette circonspection, & qu'ainsi chacun sait à-peu-près, par le souvenir des effets du lait sur son estomac, si c'est pour lui un aliment sain, mal-sain ou indifférent, & dans quelles circonstances il lui a fait du bien, du mal, ni bien ni mal ; cette expérience peut suffire à chacun pour s'observer convenablement à cet égard. Il faut se souvenir pourtant, il n'est pas inutile de le repéter, que pour toute personne qui n'est pas très-accoutumée au lait, c'est toûjours un aliment suspect que celui-là, tant en soi, par sa propre nature, qu'à cause des altérations dont il est très-susceptible dans les premieres voies, par le mêlange des autres alimens ; & que ceci est vrai principalement des personnes vigoureuses & vivant durement, qui sont peut-être les seules qu'on puisse appeller vraiment saines, les sujets délicats, élevés mollement, étant par leur propre constitution dans un état de maladie habituelle. Cette importante distinction méritera encore plus de considération dans ce que nous allons dire de l'emploi du lait dans le cas de maladie.
Nous observons d'abord, sous ce nouvel aspect, que le lait est une de ces matieres que les Medecins appellent alimens médicamenteux. Voyez MEDICAMENT.
Les lois ou les canons thérapeutiques sur l'usage du lait, observés encore aujourd'hui, existent de toute ancienneté dans l'art ; ils sont renfermés dans un aphorisme d'Hippocrate, mille fois repété, & commenté par les auteurs anciens & modernes, depuis Galien & Celse, jusqu'aux écrivains de nos jours. Voici cet aphorisme : " Il est mal de donner le lait à ceux qui souffrent des douleurs de tête : il est mal aussi de le donner à ceux qui ont la fievre, à ceux qui ont les hypocondres bouffis & murmurans, à ceux qui sont tourmentés de soif, à ceux qui rendent des déjections bilieuses, à ceux qui sont dans des fievres aiguës, & enfin à ceux qui ont subi des hémorrhagies considérables ; mais il est bon dans la phtisie lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fievre ; dans les fievres longues & languissantes, c'est-à-dire dans les fievres lentes, & dans les extrèmes amaigrissemens ". Les anciens avoient aussi observé l'efficacité du lait contre l'actions des venins corrosifs sur l'estomac & les intestins, & contre celle des cantharides sur les voies urinaires.
L'observation journaliere & commune confirme à-peu-près toutes ces lois : cependant quelques nouvelles tentatives ont appris à s'écarter, sans inconvénient & même avec quelqu'avantage, de la route ordinaire, & d'étendre l'usage du lait à quelques-uns des cas prohibés ; elles en ont encore augmenté l'usage, en découvrant son utilité dans un plus grand nombre de maladies que celles qui sont comprises sous le genre de phtisies, marasmes, consomptions, &c. & sous celui d'amaigrissemens, épuisemens, &c. Quelques auteurs modernes se sont élevés au contraire contre l'ancienne réputation du lait, & en ont voulu resserrer & presqu'anéantir l'usage. Nous allons entrer dans quelque détail sur tout cela.
Et, premiérement, quant aux cas prohibés par l'ancienne loi, on donne assez communément le lait dans les grandes hémorrhagies, principalement dans les pertes des femmes, & dans ces éruptions abondantes de sang par les vaisseaux du poulmon, qu'on appelle vulgairement & très-improprement vomissement de sang. La diete lactée est même dans ce dernier cas le secours le plus efficace que l'art fournisse contre les récidives. On ne craint pas tant non plus aujourd'hui la fievre, sur-tout la fievre lente ou hectique, lors même qu'elle redouble par accès vifs, soit réguliers, soit irréguliers : ce symptôme n'empêche point de donner le lait lorsqu'on le croit indiqué d'ailleurs ; & il est vraisemblable que si le lait réussit peu dans ces cas, comme il faut en convenir, c'est moins parce qu'il fait un mal direct, qu'il nuit en effet, que parce qu'il est simplement inefficace, c'est-à-dire qu'une telle maladie est trop grave pour que le lait puisse la guérir, & même en retarder les progrès. Ce qui paroît établir ce sentiment, c'est que si l'on observe que le lait donné avec la fievre dans une pulmonie au dernier degré, par exemple, ne réussisse point, c'est-à-dire qu'il augmente quelques symptômes, & qu'il produise divers accidens, tels que des aigreurs, des pesanteurs d'estomac, des ventosités, des dévoiemens, des sueurs, &c. & qu'on se détermine à en supprimer l'usage, tous ces effets cessent, il est vrai, mais le malade n'en est pas mieux : la maladie fait ses progrès ordinaires, & il n'est décidé par aucune observation si ces effets du lait, qui paroissent funestes au premier aspect, hâtoient réellement, ou si au contraire ils ne suspendoient pas ses progrès.
Enfin, plusieurs medecins pensent que ce pourroit bien n'être qu'un préjugé que de redouter l'usage du lait dans les maladies aiguës. L'usage du posset simple ou du zythogala, c'est-à-dire du mélange de la biere & du lait, pour boisson ordinaire dans les maladies aiguës, est connu en Angleterre. Sydenham ne desapprouve point qu'on nourrisse les malades attaqués de la petite vérole avec du lait dans lequel on aura écrasé des pommes cuites. Je connois un célebre praticien qui n'hésite point à donner du lait dans les fluxions de poitrine. Il est observé que l'hydrogale ou le lait mêlé avec l'eau, est une boisson très-salutaire dans les maladies dissenteriques.
Secondement, quant à l'extension de l'application du lait à plusieurs nouveaux usages, la doctrine clinique s'est considérablement accrûe à cet égard. D'abord elle prescrit l'usage du lait dans tous les cas de simple menace des maladies contre lesquelles Hippocrate ne l'ordonne que lorsqu'elles sont confirmées & même parvenues à leur degré extrème, praeter rationem extenuatis. Par exemple, les modernes emploient le lait contre les hoemophtysies, les toux même simples, la goutte, les rhumatismes, les dartres & autres maladies de la peau, comme le principal remede des fleurs blanches, dans le traitement de la maladie vénérienne, dans la petite vérole, dans quelques cas d'hydropisies, &c. (Voyez ces articles particuliers), sans parler de plusieurs usages extérieurs dont il sera question dans la suite de cet article. Jean Costoeus a écrit un traité entier de la Medecine aisée, de facili Medicinâ ; & son secret, son moyen de rendre la Medecine aisée, c'est d'employer le lait, comme remede universel. Wepfer, medecin suisse, auteur de très-grande considération, parle du lait comme d'une substance qui renferme en soi quelque chose de divin. Cheyne, célebre auteur anglois, a proposé depuis peu d'années, pour le bien de l'humanité, avec tout l'enthousiasme que cette vûe sublime est capable d'inspirer, & avec toute la bonne-foi & la confiance de la conviction, a proposé, dis-je, de réduire tous les hommes, lorsqu'ils ont atteint un certain âge, à la diete lactée, ou à un régime dont le lait fait la base. La doctrine des écoles & le penchant des medecins théoriciens ou raisonneurs, sont assez généralement en faveur du lait.
Troisiemement, pour ce qui regarde le sentiment des medecins modernes qui ont combattu les vertus les plus célébrées du lait, nous observerons d'abord que leur avis devroit être d'un grand poids, qu'il mériteroit au moins d'être discuté avec la plus grande circonspection, quand même ces auteurs n'auroient d'autre mérite que d'avoir osé douter sur un objet grave, des opinions reçues à-peu-près sans contradiction : car en général, & plus encore en Medecine qu'ailleurs, les opinions anciennes & non contredites doivent être très-suspectes au sage. Mais ces auteurs ont outre le mérite d'un louable scepticisme, celui d'avoir appuyé leur sentiment de bonnes observations. Bennet, célebre medecin anglois, interdit le lait aux vrais phtysiques, dans son traité vraiment original, intitulé Theatrum tabidorum. Sydenham compte fort peu sur la diete lactée dans le traitement prophilactique de la goutte, qui est aujourd'hui un des cas où le lait est le plus généralement recommandé. Morton, l'oracle de la médecine moderne, sur les maladies chroniques de la poitrine, auxquelles le lait est éminemment consacré dans la pratique la plus répandue, n'est rien moins que partisan de ce remede. De Sault, medecin de Bordeaux, auteur plein du génie & du vrai zele de l'art, ne nomme pas même le lait dans sa dissertation sur la phtisie. Frideric Hoffman fait à la vérité un éloge pompeux du lait au commencement de sa dissertation sur le lait d'ânesse ; mais c'est-là le dissertateur qui parle ; car Hoffman lorsqu'il est praticien oublie si parfaitement toutes ces admirables qualités qu'il a célébrées dans le lait, que ce remede entre à peine dans sa pratique ; il n'est pas ordonné deux fois dans ses consultations sur les maladies chroniques de la poitrine. Juncker, excellent juge en cette matiere, est très-peu favorable à l'usage du lait. M. Bordeu, pere, medecin de Pau en Béarn, un des plus consommés & des plus habiles praticiens du royaume, a proposé (dans sa dissertation sur les eaux minérales de Béarn) sur l'usage du lait, des remarques très-judicieuses & presque toutes contraires à ce remede. Enfin, beaucoup de très-habiles praticiens de nos jours, qui ont été élevés dans une entiere confiance aux vertus admirables du lait, s'en sont absolument dégoûtés.
L'espece d'éloge que nous venons de faire du système antilactaire, n'est pas cependant une adoption formelle de ce système. Nous n'avons prétendu jusqu'ici qu'exposer historiquement les sentimens divers qui partagent les Medecins sur cette importante matiere.
Si nous passons à-présent de l'exposition de ce qu'on peut appeller le fait, à ce qu'on peut appeller le droit (nous ne parlons toûjours que de l'usage intérieur, qui est l'essentiel), il me paroît, toutes les autorités & les observations étant opposées, comparées, résumées, & en y joignant le résultat de mes propres expériences, qu'on a dit en général du lait trop de bien & trop de mal.
Premierement, trop de bien, car il est sûr que le lait ne guérit véritablement aucune maladie grave, nommément les phtisies décidées, c'est-à-dire dès le commencement du second degré, lors même qu'il réussit, ou passe très-bien. J'ai même observé plus d'une fois que quoiqu'il calmât certains symptômes, ce n'étoit-là qu'un calme trompeur, comme celui de l'opium, & que la maladie n'en alloit pas moins son train perfide. Que s'il réussit quelquefois très-bien dans le premier degré de phtisie, c'est que cet état est moins une maladie qu'une menace de maladie. Il ne guérit non-plus aucun ulcere des organes intérieurs, ni les rhumatismes, ni les maladies de la peau, notamment les boutons au visage, ni les ophtalmies. Il a, dans la petite vérole, le défaut capital de constiper trop opiniâtrément, trop longtems ; c'est même, comme nous l'avons observé déjà, un des effets des plus communs de la diete lactée : cette diete a encore l'inconvénient très-grave de devenir presque nécessaire pour toute la vie, une fois qu'on s'y est accoutumé, notamment chez les goutteux qui éprouvent, selon l'observation de Sydenham, des accès plus cruels & plus fréquens, lorsqu'après s'être soumis pendant un certain tems à la diete lactée, ils reviennent à l'usage des alimens ordinaires. En général l'usage du lait demande une façon de vivre très-réguliere, & à laquelle il est difficile de réduire la plûpart des malades ; & soit par des erreurs de régime presque inévitables, soit même sans aucune de ces erreurs, il est très-sujet à causer des nausées, des abolitions totales d'appétit, des diarrhées, des vents, des sueurs, une mélancholie noire, des douleurs de tête, la fievre. Or tous ces accidens, qui rendent son usage dangereux, même dans l'état de santé, comme nous l'avons observé plus haut, sont bien plus funestes, sans-doute, dans l'état de maladie, & principalement dans les maladies chroniques de la poitrine, & presque tous les cas de suppuration interne. Il n'est pas rare non-plus d'observer dans ces derniers cas, & lorsque le pus a une issue, comme dans les ulceres du poumon ou de la matrice, que cet écoulement est supprimé par l'usage du lait, avec augmentation de symptômes & accélération de la mort. Enfin c'est un reproche très-grave à faire au lait, que celui de ne pouvoir être supporté que par la moindre partie des sujets non-accoutumés, auxquels on le prescrit.
Secondement, trop de mal, car il est observé d'abord que si on s'obstine à user du lait, quoiqu'il cause la plûpart des accidens ci-dessus rapportés, il n'est pas rare de voir tous ces accidens disparoître peu-à-peu, & le lait passer ensuite assez heureusement. Il est observé encore, comme nous en avons touché quelque chose déjà, que de même que le lait passe très-bien quelquefois sans que le fond de la maladie reçoive aucun amandement utile, de même il paroît quelquefois causer & même il cause en effet dans les cas graves, certains accidens, ou qui ne sont funestes qu'en apparence, ou qui n'en existeroient pas moins si on n'avoit pas donné le lait. Il est sûr encore que le lait fait communément très-bien dans les amaigrissemens externes, sans fievre suppuratoire, dans les toux simples & vraiment pectorales ou gutturales, dans les menaces de phtisie, & dans les dispositions à l'hémoptisie, dans les fleurs blanches, &c. On l'a vu même réussir plus d'une fois dans les vapeurs hystériques, & dans les affections mélancoliques hypocondriaques ; mais le lait brille principalement sur un ordre de sujets que beaucoup de medecins n'ont pas été à portée de distinguer & d'observer, savoir les habitans élevés délicatement des grandes villes. Toutes les petites incommodités presque particulieres aux grands & aux riches, aux constitutions dégénérées par le luxe, que les Medecins comprennent sous le nom d'affections vaporeuses ou nerveuses, dont la plus grande partie sont inconnues dans les provinces ; tout cela, dis-je, est assez bien assoupi, masqué par l'usage du lait ; & l'on ne se passeroit que très-difficilement de ce secours dans la pratique de la Medecine exercée dans le grand monde. Enfin le lait est au-moins une ressource dans les cas desespérés pour calmer les angoisses, les douleurs, l'horreur du dernier période de la maladie, pour cacher au malade, par l'emploi d'un secours indifférent, la triste vérité qu'il n'a plus de secours à espérer.
Le lait étant suffisamment indiqué par la nature de la maladie, il reste à déterminer les autres circonstances qui doivent diriger dans son administration, & premierement la constitution du sujet. Quant à ce premier chef, toutes les regles se réduisent à celle-ci. On le donne sans hésiter à ceux qui y sont accoutumés ; Bennet ajoûte, & qui l'appetent vivement, avidè petentibus. On ne le donne point à ceux qui l'ont en horreur, & même on en suspend, on en supprime l'usage lorsqu'il dégoûte celui qui en use. Enfin, dans les sujets neutres, s'il est permis d'appeller ainsi ceux qui n'ont pour le lait, ni penchant, ni dégoût, & qui n'y sont point accoutumés, on n'a d'autre ressource que le tatonnement.
2°. La saison de l'année, on choisit, lorsque les circonstances le permettent, le printems & l'automne ; quand la nécessité est urgente, on le donne en tout tems.
3°. L'heure dans la journée. Si on n'en prend qu'une fois par jour, c'est le matin à jeun, ou le soir en se couchant, trois heures au moins après le souper. S'il s'agit de la diete lactée, ou de la boisson du lait en guise de ptisane dans la toux par exemple, ou dans certaines maladies aiguës, la question n'a plus lieu. Dans le premier cas, on le prend à l'heure des repas, & dans le second, à toutes les heures de la journée.
4°. Faut-il préparer le sujet au moins par une médecine ? Cette pratique est salutaire dans la plupart des cas ; mais certainement on en fait une loi trop universelle.
5°. Quel régime doivent observer ceux qui prennent le lait ? Il y a ici une distinction essentielle à faire, savoir, entre le lait donné pour toute nourriture, ou à peu près, & le lait pris pendant l'usage, sub usu, des alimens communs. Dans le premier cas, la premiere est de régime, c'est-à-dire la privation de tout aliment ou boisson qui pourroit corrompre le lait, est comprise dans la prescription même de cet aliment médicamenteux, puisqu'on le prend pour toute nourriture, c'est-à-dire pour tout aliment & pour toute boisson. Cependant comme cet usage est moins sévere que ne l'annonce la valeur de ces mots pour toute nourriture, on accorde communément avec le lait, comme nous l'avons dit plus haut, les farineux fermentés & non fermentés, & on supprime tout autre aliment.
Une tasse de lait pur ou coupé, d'environ six onces le matin, une soupe faite avec deux ou trois petites tranches de pain, & environ dix ou douze onces de lait à midi, un riz clair avec pareille quantité de lait à sept heures du soir, & une tasse de lait pareille à celle du matin, le soir en se couchant ; cette maniere de vivre, dis-je, fait une diete lactée très-pleine, & capable de soutenir les forces & l'embonpoint. Une diete lactée purement suffisante pour vivre, peut ne consister qu'en trois petites tasses à caffé de lait par jour.
On interdit à ceux qui usent en même tems du lait, & les alimens communs, tout ce qui peut cailler le lait, & principalement les acides. En général cette pratique est bonne, mais non pas autant qu'on le croit, ni par la raison qui le fait croire ; car il est de fait que le lait est caillé, même dans l'estomac le plus sain avant d'être digéré ; qu'il subit dans l'état sain une vraie digestion, à la maniere des alimens solides ; par conséquent les acides ne nuisent pas en le coagulant. D'ailleurs ils ne nuisent pas aussi généralement qu'on le croit ; & peut-être sont-ils utiles au contraire dans certains cas ; dans celui du défaut de la présure naturelle, à laquelle ils peuvent suppléer utilement. On a vu plusieurs personnes ne digérer jamais mieux le lait, que lorsqu'elles prenoient ensuite des acides. Une femme m'a assuré qu'elle ne pouvoit souffrir le lait que coupé avec la limonade ; j'ai entendu dire que ce mélange étoit communément usité en Italie. Quoi qu'il en soit, il est clair que la sobriété est plus nécessaire à ceux qui prennent le lait, que la privation de tel ou tel aliment. Cependant si ce doit être là la premiere loi diététique, la seconde chez les gens vraiment malades, doit être d'éviter autant qu'il est possible les crudités, sur-tout les fruits verds, les alimens éminemment indigestes.
Une regle commune à la diete lactée, & à l'usage non-exclusif du lait, c'est que ceux qui en usent, soient très-circonspects, très-sobres sur l'usage de la veille, des exercices, de l'acte vénérien, des passions ; & qu'ils évitent l'air humide & froid, & le chaud excessif.
6°. Quels sont les effets du lait évidemment mauvais, & qui doivent engager à en suspendre, & même à en abandonner absolument l'usage ? Nous avons déja répondu en partie à cette question, lorsque nous avons rapporté les accidens divers qui suivent assez souvent l'usage du lait. Car, quoique nous ayons observé qu'il arrivoit quelquefois qu'en bravant ces accidens, & s'obstinant dans l'emploi du lait, on réussissoit à le faire passer ; quoique nous ayons remarqué aussi que les malades ne se trouvoient pas mieux, quoiqu'on eût éloigné par la suppression du lait les accidens qui étoient évidemment dûs à l'usage de ce remede ; cependant ce n'est pas là la loi commune ; & en général lorsque le lait donne des nausées, des gonflemens, des vents, des pertes d'appétit, des diarrhées, des sueurs, des maux de tête, la fievre, ou seulement une partie de ces accidens, il faut en suspendre, ou en supprimer absolument l'usage.
Nous avons déja observé que la coagulation du lait dans l'estomac, n'étoit point un mal ; par conséquent ce n'est pas une raison pour quitter le lait, que d'en vomir une partie sous la forme d'un caillé blanc & peu dense.
Mais lorsque pendant l'usage du lait, les gros excrémens sont mêlés d'une maniere coagulée dense, de la nature du fromage, blanchâtre, verte ou jaune, & qu'en même tems les hypocondres sont gonflés, & que le malade se sent lourd, bouffi, foible, & qu'il n'a point d'appétit &c. alors, dis-je, il faut quitter le lait. Ce genre d'altération ne se corrige ni par les remedes, ni par le tems ; l'espece d'engorgement sans irritation, iners, qu'il cause dans l'estomac & dans les intestins, augmente chaque jour, & élude si bien la force expultrice de ces organes, qu'on a vu des malades rendre abondamment de ces concrétions caséeuses six mois après avoir quitté le lait, or ces embourbemens sont toujours funestes.
La constipation opiniâtre, c'est-à-dire qui ne cede point aux remedes ordinaires que nous allons indiquer dans un instant, est aussi une raison pour quitter le lait, sur tout chez les vaporeux des deux sexes ; ou si elle donne des vapeurs à ceux même qui n'y étoient pas sujets, ce qui est une suite très-ordinaire de la constipation.
Enfin le dégoût du lait, sur-tout lorsqu'il est considérable, est une indication certaine & évidente d'en interdire, ou au moins d'en suspendre l'usage.
7°. Quels sont les remedes de ces divers accidens causés par le lait, soit qu'ils exigent qu'on en suspende l'usage, soit qu'on se propose d'y remédier, afin de continuer le lait avec moins d'inconvénient.
Lorsqu'on se détermine à renoncer au lait : il est presque toujours utile de purger le malade ; & c'est même l'unique remede direct à employer dans ce cas. Les autres remedes destinés à réparer le mal causé dans les premieres voies, doivent être réglés non-seulement sur cette vûe, mais même sur la considération de l'état général du malade.
La constipation causée par le lait n'est pas vaincue communément par les lavemens ; ils ne font que faire rendre quelques crotins blancs ; & il arrive souvent même que la constipation augmente. La magnésie blanche, & la casse cuite qui sont fort usitées dans ce cas ne réussissent pas toujours ; le suc d'herbe de violette, de mauve & de cerfeuil, mêlés en parties égales, ajoutés à pareille quantité d'eau de veau ou de poulet, & pris à la dose de quelques cuillerées seulement dans la matinée, font à merveille dans ces sujets délicats, dont nous avons déja parlé : or c'est à ceux-là principalement, comme nous l'avons observé encore, que convient la diete lactée ; & c'est eux aussi que tourmentent particulierement les constipations & les bouffées portant à la tête & à la poitrine, qui sont les suites les plus facheuses de la constipation.
On remédie communément d'avance autant qu'il est possible, aux autres mauvais effets du lait, par les diverses circonstances de sa préparation, que nous allons exposer sur le champ.
On donne le lait pur & chaud sortant du pis, ou bouilli ou froid ; on le mêle ou on le coupe avec différentes liqueurs, avec de l'eau pure (ce qui fait le mêlange appellé par les Grecs ), avec des décoctions des semences farineuses, principalement de l'orge, avec les sucs, infusions ou décoctions de plusieurs plantes vulnéraires, astringentes, adoucissantes, antiscorbutiques, sudorifiques, &c. telles que le suc ou la décoction de Plantin, l'infusion de millepertuis, de violette, de bouillon blanc, le suc de cresson, la décoction d'esquine, &c. avec des bouillons & des brouets ; tels que le bouillon commun de boeuf ou de mouton, l'eau de veau, l'eau de poulet, &c. avec les liqueurs fermentées même, comme le vin & la biere, avec les eaux minérales, &c. On l'assaisonne avec le sucre, le sel, le miel, divers syrops, les absorbans, le fer rouillé & rougi au feu, & éteint dedans, &c. On l'emploie comme assaisonnement lui même dans les crêmes de riz, de gruau, d'orge mondé, avec les pâtes d'Italie, le sagou, &c. On le donne entier, ou privé de l'un de ses principes ; d'une partie du beurre, par exemple, ce qui fait le lait écremé, ou de plusieurs de ses principes ; du beurre & du fromage, par exemple ce qui fait le petit lait, dont nous ferons un petit article à part, à la suite de celui-ci. Le beurre & le fromage, soit confondus ensemble, soit séparés, ne sont pas mis communément au rang des laitages considérés médicinalement : nous en avons fait des articles particuliers. Voyez ces articles.
Le lait pur demande la trop grande habitude pour bien passer. La circonstance d'être pris chaud, froid, au sortir du pis, bouilli, &c. est souvent si essentielle que tel estomac exige constamment l'un de ces états, à l'exclusion de tous les autres, mais elle est entierement dépendante d'une disposition inconnue, & aussi bizarre que tout ce qui regarde le goût. Le lait coupé avec l'eau ou les décoctions farineuses, passe beaucoup plus aisément, & ce mélange ne remplit que l'indication simple qui fait employer le lait ; les sucs, décoctions, infusions vulnéraires, sudorifiques, &c. mêlés avec le lait, remplissent des indications composées. On ordonne par exemple, le lait coupé avec le suc ou la décoction de plantain, dans les pertes de sang, pour adoucir par le lait, & resserrer par le plantain, &c. Les mélanges peu communs de bouillon, & de liqueurs vineuses avec le lait sont plus nourrissans & plus fortifians que le lait pur. Le dernier est même une espece de stomachique cordial chez certains sujets singuliers, indéfinis, indéfinissables, qu'on ne découvre que par instinct ou par tatonnement. Le lait assaisonné de sucre, de sel, de poudre absorbante, &c. est utilement préservé par ces additions, des différentes altérations auxquelles il est sujet. Il est sur-tout utile de le ferrer, pour prévenir ou pour arrêter le devoyement. Les farineux mêlés au lait l'empêchent aussi de jouir de tous ses droits, d'être autant sui juris ; il est au contraire entraîné dans la digestion propre à ces substances, beaucoup plus appropriées que le lait à nos organes digestifs, & même éminemment digestible pour ainsi dire ; mais aussi l'effet médicamenteux du lait est moindre dans la même proportion. Enfin le lait écremé passe plus communément que le lait entier ; il est moins sujet à fatiguer l'estomac.
Choix du lait. On doit prendre le lait d'un jeune animal, bien soigné, nourri habituellement à la campagne, & dans de bons paturages autant qu'il est possible, ou du moins dans une étable bien aérée, & pourvûe de bonne litiere fraîche, abondante, & souvent renouvellée. Les vaches qu'on entretient dans les fauxbourgs de Paris pour fournir du lait à la ville, ne jouissent certainement d'aucun de ces avantages, & sur-tout de celui d'une étable bien saine, & d'une litiere fraîche, choses très-essentielles pourtant à la santé de l'animal, & par conséquent à la bonne qualité du lait. Le lait est meilleur quelques semaines après que la bête qui le fournit a mis bas, & tant qu'elle en donne abondamment, que dans les premiers jours, & lorsqu'il commence à être moins abondant. On doit rejetter celui d'une bête pleine, ou qui est en chaleur : on doit choisir le lait aussi frais & aussi pur qu'il est possible. On en vend assez communément à Paris qui est fourré d'eau & de farine, & qui d'ailleurs est fort peu récent. Il importe beaucoup encore de le loger dans des vaisseaux propres, & qui ne puissent lui communiquer aucune qualité nuisible. Il s'en faut bien que les cruches de cuivre dans lesquelles on le porte ordinairement à Paris, soient des vaisseaux convenables à cet usage. Un reste de lait oublié dans ces cruches, est, par sa pente à aigrir, beaucoup plus propre que la plupart des liqueurs qu'on loge dans le cuivre, à y former du verd-de-gris, qui communique très-aisément sa qualité malfaisante au lait qu'on y met ensuite. Les exemples de familles entieres empoisonnées par de pareil lait, ne sont pas rares à Paris. On prétend enfin qu'il est utile pendant l'usage suivi & continu du lait, de prendre constamment celui d'une même vache ou d'une même chevre. En effet, il se trouve des estomacs dont la sensibilité est si exquise, qu'ils distinguent très-bien les laits tirés de divers individus, & qui n'en peuvent supporter l'alternative ou le mélange. C'est encore ici une disposition d'organes particuliere aux victimes du luxe. Les estomacs vulgaires n'y regardent pas de si près ; il est très-avantageux pour les premiers, & c'est aussi un usage reçu chez les grands, de prendre une vache ou une chevre à soi.
Usage extérieur du lait. On emploie assez communément le lait comme émollient, calmant, adoucissant dans plusieurs affections externes, principalement quand elles sont accompagnées de douleurs vives. On en verse quelques gouttes dans les yeux contre l'ophtalmie ; on bassine les hémorrhoïdes très-douloureuses avec du lait chaud ; on le donne en lavement dans les dyssenteries ; on le fait entrer dans les bouillies, les cataplasmes, &c. qu'on applique sur des tumeurs inflammatoires, &c. Cet emploi ne mérite aucune considération particuliere ; on peut avancer qu'en général il réussit assez bien dans ces cas.
2°. Du lait d'ânesse, c'est-à-dire, des usages médicinaux du lait d'ânesse. Ce que nous avons dit de la composition naturelle du lait d'ânesse, annonce déja ses propriétés medicinales. On peut en déduire, avec beaucoup de vraisemblance, que ce lait possede en un degré supérieur toutes les vertus du lait, sans faire appréhender ses principaux inconvéniens. En effet, c'est par le principe caséeux & par le principe butyreux que le lait est principalement capable de produire tous les accidens qu'on lui reproche. C'est par la facilité avec laquelle ces principes se séparent & s'alterent diversement dans le lait de vache, par exemple, que ce lait est sujet à produire les mauvais effets que nous avons détaillés plus haut. Or le lait d'ânesse contient fort peu de ces principes. Une expérience ancienne & constante vient à l'appui de ce raisonnement. Hippocrate a compté parmi les bonnes qualités du lait d'ânesse, celle de passer plus facilement par les selles que les autres especes de lait, de lâcher doucement le ventre. Sur quoi il faut observer que cet effet appartient au lait d'ânesse inaltéré ; au lieu que le lait de vache, par exemple, ne devient laxatif que lorsqu'il a essuyé une vraie corruption. Aussi un leger dévoiement, ou du-moins une ou deux selles liquides, quelques heures après l'usage du lait d'ânesse, sont ordinairement un bien, un signe que le remede réussit, & ces selles sont sans douleur & sans ventosités : au lieu que le dévoiement, même égal pour l'abondance & la fréquence des selles, est presque toujours de mauvais augure pendant l'usage du lait de vache ou de chevre, & les déjections sont ordinairement flatueuses & accompagnées de quelques tranchées. Au reste, il faut observer qu'il ne s'agit point ici du dévoiement qu'on peut appeller in extremis, c'est-à-dire de celui par lequel finissent communément les malades qui succombent à plusieurs des maladies pour lesquelles on donne du lait. Il est à peu-près démontré, comme nous l'avons remarqué plus haut, que cet accident appartient à la marche de la maladie, & non pas au lait, ou à tel lait.
La quantité très-considérable de substance sucrée que contient le lait d'ânesse le rend aussi très-nourrissant. Cette substance est dans le lait la matiere nutritive par excellence ; la substance caséeuse ne mérite que le second rang, & le beurre n'est point nourrissant, du-moins le beurre pur. C'est par conséquent un préjugé, une erreur, que d'imaginer, comme on le fait assez généralement, que le lait le plus épais est le plus nourrissant, car c'est le plus butyreux qui est le plus épais ; & un lait très-clair, comme celui d'ânesse, peut être éminemment sucré, comme il l'est en effet. C'est manifestement cette opinion qui a empêché d'essayer l'usage du lait d'ânesse pour toute nourriture, ou du-moins cet usage de le prendre, si tant est que quelqu'un l'ait essayé. Or je crois que cette pratique pourroit devenir très-salutaire.
Selon la méthode ordinaire, le lait d'ânesse se donne seulement une fois par jour, à la dose de huit onces jusqu'à une livre. On le prend ou le matin à jeun, ou le soir en se couchant, & quant au degré de chaleur, tel qu'on vient de le traire. Pour cela, on amene l'ânesse à côté du lit, ou à la porte de la chambre du malade, où on la trait dans un vaisseau de verre à ouverture un peu étroite, plongé dans de l'eau tiede, & qu'on tient dans cette espece de bain-marie jusqu'à-ce qu'on le présente au malade. On y ajoute quelquefois un morceau de sucre, mais cet assaisonnement est assez inutile, le lait d'ânesse étant naturellement très-doux.
On donne le lait d'ânesse contre toutes les maladies dans lesquelles on emploie aussi le lait de vache, &c. & que nous avons énoncées, en parlant de cette autre espece de lait. Mais on préfere le lait d'ânesse dans les cas particuliers où l'on craint les accidens propres du lait que nous avons aussi rapportés ; & principalement lorsque les sujets étant très-foibles, ces accidens deviendroient nécessairement funestes, c'est-à-dire, que le lait d'ânesse est dans la plûpart de ces maladies, & sur-tout dans les maladies chroniques de la poitrine, un remede extrème ; une derniere ressource, sacra anchora ; que par cette raison, on voit très-rarement réussir, du moins guérir. Mais quand il est employé de bonne heure, ou contre ces maladies lorsqu'elles sont encore à un degré curable, il fait assez communément des merveilles. Il est admirable, par exemple, dans les toux séches vraiment pectorales, dans les menaces de jaunisse, ou les jaunisses commençantes, dans presque toutes les affections des voies urinaires, dans les sensibilités d'entrailles, les dispositions aux ophtalmies appellées bilieuses ou séches, les fleurs blanches.
On prend le lait d'ânesse principalement au printems & en automne. On a coutume, & on fait bien, de mettre en pâture l'ânesse qui fournit le lait, ou de la nourrir, autant qu'il est possible, de fourrage vert, sur-tout d'herbe presque mûre de froment ou d'orge ; on lui donne aussi du grain, sur-tout de l'orge. On doit encore la bien étriller plusieurs fois par jour, lui fournir de bonne litiere, &c.
3°. Du lait de femme, ou des usages medicinaux du lait de femme. Le lait de femme peut être considéré medicinalement sous deux aspects ; ou comme fournissant la nourriture ordinaire, propre, naturelle des enfans ; ou comme un aliment médicamenteux ordonné aux adultes dans certains cas. Nous ne le considérerons ici que sous le dernier aspect. Quant au premier, voyez ENFANT & NOURRICE.
Le lait de femme, considéré comme remede, a été célébré dès l'enfance de l'art, comme le premier de tous les laits, principalement dans les marasmes, in tabidis, celui qui étoit le plus salutaire, le plus approprié à la nature de l'homme. Les livres, les théories, tirent un merveilleux parti de cette considération. Quoique les raisonnemens ne se soient pas dissimulés cette observation défavorable, savoir que ce lait provenant d'un animal carnivore, est plus sujet à rancir que celui des animaux qui se nourrissent uniquement de végétaux. Mais la pratique, l'expérience, le mettent au dernier rang au contraire ; ne fût-ce que parce qu'il est le moins usité, & que le plus grand nombre de Medecins ne l'ont point essayé. D'ailleurs le raisonnement a dit encore que pour l'appliquer couvenablement & avec espoir de succès, il falloit ne le donner qu'à des sujets qui approchassent beaucoup de la nature des enfans, & qui vecussent comme les enfans, non seulement quant à l'exercice, aux mouvemens du corps, mais encore quant aux passions, aux affections de l'ame. Or il est très-rare de rencontrer ces conditions chez des adultes.
Quant à la circonstance de faire teter le malade, & de lui faire ainsi avaler un lait animé d'un prétendu esprit vivifiant, que Galien lui-même a célébré ; outre que le malade pourroit aussi-bien teter une vache ou une ânesse qu'une femme ; d'ailleurs l'esprit du lait, & sa dissipation par la moindre communication avec l'air, ne sont certainement pas des choses démontrées. Au reste, c'est cependant là un remede & une maniere de l'administrer qu'il paroit fort utile de tenter.
Nous ne pensons certainement pas aussi avantageusement de la méthode de faire coucher de jeunes hommes absolument exténués, réduits au dernier degré d'étisie, tabe consumptis, avec des jeunes nourrices, jolies, fraîches, proprettes, afin que le pauvre moribond puisse teter à son aise, tant que la nourrice y peut fournir. Forestius étale envain l'observation fameuse d'un jeune homme arraché des bras de la mort par ce singulier remede ; & plus vainement encore, à mon avis, un très-célebre auteur moderne prétend-il qu'une émanation très-subtile qui s'échappe du corps jeune & vigoureux de la nourrice, venant à s'insinuer dans le corps très-foible du malade (subtilissima exhalentia è valido juvenili corpore insinuata debilissimis, &c.) doit le ranimer très-efficacement. L'exemple de David, dont on réchauffoit la vieillesse par ce moyen, que cet écrivain allegue, ne conclut rien en faveur de son opinion : car, 1°. il n'est pas rapporté que cette pratique ait été suivie de quelque succès. 2°. Quand bien même ce seroit là une bonne recette contre les glaces de l'extrème vieillesse, il paroit que la maniere d'opérer de ce secours seroit fort mal estimée par l'insinuation des tenuissima exhalantia è valido juvenili corpore, in effaetum senile, &c. Il nous paroît donc évident sur tout ceci, d'abord que les tenuissima exhalantia, c'est-à-dire la transpiration, ne fait absolument rien ici. En second lieu, que si des jeunes gens réduits au dernier degré de marasme, pouvoient en être retirés en couchant habituellement avec des jeunes & belles nourrices, cette révolution salutaire seroit vraisemblablement dûe (si l'usage du lait de femme ne l'opéroit pas toute entiere) à l'appétit vénérien constamment excité, & jamais éteint par la jouissance, qui agiroit comme un puissant cordial : ou comme un irritant extérieur, les vésicatoires ou la flagellation. Enfin, que quand même la religion permettroit d'avoir recours à un pareil moyen, ce seroit toujours une ressource très-équivoque, parce que l'espece de fièvre, d'ardeur, de convulsion continuelle dans laquelle je suppose mon malade, état dont il est en effet très-susceptible, & même éminemment susceptible, selon une observation très-connue ; que cet état, dis-je, paroit plus capable de hâter la mort que de la prévenir, encore qu'on fût sûr que le malade ne consommeroit point l'acte vénérien, à plus forte raison s'il le consommoit ; car il est très-connu que cette erreur de régime est mortelle aux étiques, & que plusieurs sont morts dans l'acte même.
Du petit-lait. Nous avons déja donné une idée de la nature du petit-lait au commencement de cet article. Nous avons observé aussi que le petit-lait étoit différent, selon qu'on le séparoit par l'altération spontanée du lait : ou bien par la coagulation. Celui qui est séparé par le premier moyen est connu dans les campagnes, comme nous l'avons déja rapporté aussi sous le nom de lait de beurre. Il est aigrelet ; car c'est dans son sein que réside l'unique substance qui s'est aigrie pendant la décomposition spontanée du lait : il est fort peu usité en Medecine ; on pourroit cependant l'employer avec succès, comme on l'employe en effet dans les pays où les laitages sont très-abondans, dans les cas où une boisson aqueuse & légerement acide est indiquée. Le nom de petit-lait acidule lui convient beaucoup mieux qu'à celui que M. Cartheuser a désigné par ce nom dans sa Pharmacologie, & qui n'est autre chose que le petit-lait, séparé du lait coagulé par les acides. Car on peut bien par ce moyen même obtenir un petit-lait très-doux : il n'y a pour cela qu'à être circonspect sur la proportion de l'acide employé ; & M. Cartheuser n'exige pas qu'on employe l'acide en une quantité surabondante. En un mot, le serum lactis acidulum de M. Cartheuser est du petit-lait ordinaire, dont nous allons nous occuper sur le champ.
Celui-ci, c'est-à-dire le petit-lait ordinaire, qu'on pourroit aussi appeller doux, en le comparant au précédent, au lait de beurre, est celui qu'on sépare du lait coagulé par la pressure ordinaire, ou même, quoique beaucoup moins usuellement, par des acides végétaux. La coagulation du lait, pour la préparation pharmaceutique du petit-lait, & la séparation de cette derniere liqueur d'avec le caillé, n'ont rien de particulier. On s'y prend dans les Pharmacies comme dans les Laiteries. Voyez LAIT, Economie rustiq. L'opération vraiment pharmaceutique qu'on exécute sur le petit lait, c'est la clarification. Voici cette opération : prenez du petit-lait récent, qui est naturellement très-trouble ; ajoutez-y à froid un blanc d'oeuf sur chaque livre de liqueur ; mêlez exactement en fouettant ; faites bouillir, & jettez dans la liqueur pendant l'ébullition, environ 18 ou 20 grains de crême de tartre ; passez au blanchet & ensuite au papier à filtrer.
Quoique ce soit principalement la saveur & l'élégance du remede, le jucundè qu'on a en vûe dans cette clarification, il faut convenir aussi que les parties fromageuses & butireuses qui sont suspendues dans le petit-lait trouble, non-seulement rendent ce remede dégoûtant, & souvent trop laxatif, mais même peuvent le disposer à engendrer dans les premieres voies, ces concrétions butyreuses & fromageuses que nous avons comptées parmi les mauvais effets du lait. Il faut convenir encore que c'est vraisemblablement une pratique très-mal entendue que l'usage constant de donner toujours le petit-lait le mieux clarifié qu'il est possible. Car quoiqu'il n'en faille pas croire M. Quincy, qui assure dans sa Pharmacopée, que le petit-lait ainsi clarifié, n'est qu'un pur phlegme, qui n'est bon à rien, il est indubitable cependant qu'il est des cas où une liqueur, pour ainsi dire moins seche, plus muqueuse, plus grasse que le petit-lait très-clarifié, est plus indiquée que le petit-lait clair comme de l'eau. Au reste, ces petits-laits ne différeroient entr'eux que par des nuances d'activité ; & je ne voudrois pas qu'on admît dans l'usage l'extrème opposé au très-clair, c'est-à-dire le petit-lait brut très-trouble, tel qu'il se sépare du caillé.
Il est une troisieme espece de petit-lait, qui doit peut-être tenir lieu de ce dernier, du petit-lait éminemment gras ; savoir, celui qui est connu sous le nom de petit-lait d'Hoffman, & que M. Cartheuser appelle petit-lait doux, serum lactis dulce. Voici comment Frédéric Hoffman en expose la préparation dans sa dissertation de saluberrima seri lactis virtute. Il prend du lait sortant du pis ; il le fait évaporer au feu nud dans un vaisseau d'étain (il vaut beaucoup mieux exécuter cette évaporation au bain-marie) jusqu'à ce qu'il obtienne un résidu qui se présente sous la forme d'une poudre jaunâtre & grumelée. Alors il jette sur ce résidu autant d'eau qu'il s'en est dissipé par l'évaporation ; il donne quelques bouillons, & il filtre. L'auteur prétend, avec raison, que cette liqueur, qui est son petit-lait (& qu'il appelle eau de lait par décoction, ou petit-lait artificiel), a bien des qualités au-dessus du petit-lait ordinaire, du moins s'il est vrai que le petit-lait soit d'autant meilleur, que la substance muqueuse qu'il contient, est plus grasse, plus savonneuse : car il est très-vrai que les substances salines & sucrées quelconques, se chargent facilement des matieres oléagineuses, lorsqu'elles ont avec ces matieres une communication pareille à celle que la matiere sucrée du petit-lait a, dans la méthode d'Hoffman, avec la matiere butyreuse.
Ce caractere, qui distingue le petit-lait d'Hoffman d'avec le petit-lait ordinaire, n'a cependant rien d'absolu : il ne peut constituer qu'une variété dans le degré d'action, & même une variété peu considérable.
Une livre de petit-lait (apparemment de vache) fournie par une livre & demie de lait entier, filtrée, évaporée au bain-marie, & rapprochée autant qu'il est possible, & cependant imparfaitement, a donné à M. Geoffroi une once un gros & trois grains de matiere concrete, qui est le sel ou sucre de lait dont nous allons parler dans un moment.
Hoffman n'a retiré, par l'évaporation, d'une livre de medecine (qui répond à 10 ou 12 onces, poids de marc) qu'un gros, c'est-à-dire 60 ou 72 grains de matiere sucrée. La différence prodigieuse de ces deux produits ne paroit pas pouvoir être raisonnablement déduite de ce que M. Geoffroi a desseché sa matiere au bain-marie, & qu'Hoffman a employé la chaleur d'un bain de sable. On ne peut cependant avoir recours qu'à cette cause, ou à la différence individuelle des laits que chacun de ces chimistes a traités, ou enfin à l'inexactitude de l'un d'eux, ou de tous les deux : car il ne faut pas soupçonner que la matiere concrescible du petit-lait ayant été une fois dessechée, soit devenue moins soluble qu'elle ne l'étoit auparavant, & que le beurre & le fromage avec lesquels elle a été intimement entremêlée dans cette dessication, la défendent contre l'action de l'eau. Le sucre de lait est une substance trop soluble par le menstrue aqueux, pour qu'on puisse former raisonnablement cette conjecture.
Vertus ou usages medicinaux du petit-lait. Presque tous les auteurs, sur-tout les anciens, que Fréd. Hoffman a imités en cela, recommandent par préférence le petit-lait de chevre. On se sert en France principalement du petit-lait de vache, excepté dans les cantons où le lait de chevre est plus commun que celui de vache. A Paris, où cette raison de commodité n'est pas un titre de préférence, on distingue ces deux petits-laits dans l'usage, & beaucoup de medecins assurent qu'ils different réellement en vertu, de même que les Apoticaires observent qu'ils présentent des phénomenes différens dans la coagulation & dans la clarification.
Nous croyons cependant pouvoir regarder ces différences d'action médicamenteuse, comme méritant d'être constatées par de nouvelles observations, ou comme peu considérables. D'après ce sentiment nous ne parlerons que des vertus communes à l'un & à l'autre petit-lait. Au reste, comme on ne prépare ordinairement que ces deux especes, ce que nous dirons du petit-lait en général ne sera censé convenir qu'à celles-là.
La vertu la plus évidente du petit-lait est d'être un laxatif doux & assez sûr, peut-être le premier ou le plus réel des eccoprotiques. Il pousse aussi assez communément par les urines. On le donne pour exciter l'une ou l'autre de ces deux évacuations, ou seul, ou chargé de différentes matieres purgatives ou diurétiques. Plusieurs auteurs le proposent même comme un bon excipient des purgatifs les plus forts, dont ils croyent que le petit-lait opere une véritable correction ; mais ce mélange est assez chimérique dans cette vûe.
Il n'y a point d'inconvénient de mêler le petit-lait aux remedes acides, tels que les tamarins. les sucs acidules des fruits, &c. Le petit-lait n'est point, comme le lait, altéré par ces substances ; au contraire, leur mélange avec le petit-lait peut être agréable & salutaire toutes les fois qu'on se propose de rafraîchir & de relâcher. Une legere limonade préparée avec le petit-lait au lieu de l'eau, doit mériter la préférence sur la limonade commune dans les ardeurs d'entrailles & des voies urinaires, avec menace d'inflammation, &c. Une décoction de tamarins dans le petit-lait, vaut mieux aussi que la décoction de ces fruits dans l'eau commune, lorsqu'on se propose de lâcher le ventre dans les mêmes cas.
Le petit-lait est regardé, avec raison, comme le premier des remedes relâchans, humectans & adoucissans. On s'en sert efficacement en cette qualité dans toutes les affections des visceres du bas-ventre qui dépendent des tensions spontanées ou nerveuses, ou d'irritations, par la présence de quelque humeur viciée, ou de quelque poison ou remede trop actif. On le donne par conséquent avec succès dans les maladies hypochondriaques & hystériques, principalement dans les digestions fougueuses, les coliques habituelles d'estomac, manifestement dûes à la tension & à la sécheresse de ce viscere, les flux hémorrhoïdaux irréguliers & douloureux, les jaunisses commençantes & soudaines, le flux hépatique, les coliques bilieuses, les fleurs blanches, les flux dissentériques, les diarrhées douloureuses, les tenesmes, les superpurgations, &c. Il est regardé aussi comme capable d'étendre sa salutaire influence au-delà des premieres voies, du moins de produire de bons effets dans des maladies qu'on peut regarder comme plus générales que celles dont nous venons de parler. On le donne avec succès dans toutes les fievres aigues, & principalement dans la fievre ardente & dans la fievre maligne.
Il est utile aussi dans tous les cas d'inflammation présente ou imminente des organes particuliers, des parties de la génération ; par exemple, dans les maladies vénériennes inflammatoires, dans l'inflammation d'une partie des intestins, après une blessure ou une opération chirurgicale, dans les ophtalmies exquises, &c.
On peut assurer que dans tous ces cas il est préférable aux émulsions & aux ptisanes mucilagineuses qu'on a coûtume d'employer.
Hoffman remarque (dans sa dissertation sur le petit-lait) que les plus habiles auteurs qui ont traité du scorbut, recommandent le petit-lait contre cette maladie. M. Lind, auteur bien postérieur à Hoffman, qui a composé un traité du scorbut très-complet, le met aussi au rang des remedes les plus efficaces de ce mal.
Fréd. Hoffman attribue encore au petit-lait, d'après Sylvaticus, célebre médecin italien, de grandes vertus contre la manie, certaines menaces de paralysie, l'épilepsie, les cancers des mamelles commençans, &c.
Le petit-lait a beaucoup d'analogie avec le lait d'ânesse. Hippocrate ordonne presque indifféremment le lait d'ânesse ou le petit-lait de chevre ; & Fréd. Hoffman, dans la dissertation que nous avons déja citée plusieurs fois, attribue au petit-lait, sur l'autorité d'Hippocrate, toutes les vertus que cet auteur attribue au lait d'ânesse, lors même qu'il ne propose pas l'alternative de ce remede ou du petit-lait.
En général le petit-lait doit être donné à grandes doses & continué longtems : il faut prendre garde cependant qu'il n'affadisse point l'estomac, c'est-à-dire qu'il ne fasse point perdre l'appétit & qu'il n'abatte point les forces ; car c'est-là son unique, mais très-grave inconvénient. On voit bien au reste que cette considération ne peut avoir lieu que dans les incommodités & les maladies chroniques ; car dans les cas urgens, tels que les fievres aiguës & les inflammations des visceres, l'appétit & les forces musculaires ne sont pas des facultés que l'on doive se mettre en peine de ménager. Il est encore vrai cependant que dans les fievres aiguës il ne faut pas donner le petit-lait dans le cas de foiblesse réelle.
Petit-lait à l'angloise, ou préparé avec les vins doux. Les Anglois préparent communément le petit-lait en faisant cailler le lait avec le vin d'Espagne ou de Canarie. On nous rapporte même que c'est presque-là l'unique façon dont on prépare ce remede à Londres ; mais nous ne le connoissons en France que sur quelques exposés assez vagues. Les pharmacopées angloises les plus modernes ne font point mention de cette préparation : il est naturel de conjecturer pourtant qu'elle doit varier beaucoup selon la quantité de vin qu'on y emploie. Jusqu'à présent ce remede n'a point été reçu en France ; ainsi nous ne saurions prononcer légitimement sur ses propriétés medicinales, qui ne peuvent être établies que sur des observations. Nous osons avancer pourtant que l'usage de mêler une petite quantité de vin d'Espagne à du petit-lait déja préparé, que quelques praticiens de Paris ont tenté avec succès dans les sujets chez qui le petit-lait pur avoit besoin d'être aiguisé par quelque substance un peu active ; que cet usage, dis-je, doit paroître préférable à celui du petit-lait tiré du lait caillé avec le même vin. Car de la premiere façon, la préparation du vin peut se déterminer bien plus exactement ; & il ne seroit pas difficile, si l'on désiroit une analogie plus parfaite avec la méthode angloise, de l'obtenir, en chauffant le vin qu'on voudroit mêler au petit-lait jusqu'au degré voisin de l'ébullition, ou même jusqu'à une ébullition légere.
Sel ou sucre de lait. Kempfer rapporte que les Brachmanes ont connu autrefois la maniere de faire le sucre de lait ; quoi qu'il en soit, Fabricius Bartholetus, médecin italien, est le premier qui ait fait mention, au commencement du siecle dernier, du sel essentiel de lait, sous le titre de manne ou de nitre du lait. Ettmuller en a donné une description qu'il a empruntée de cet auteur. Testi, médecin vénitien, est le second qui, sur la fin du dernier siecle, a trouvé le moyen de retirer ce sel, & il l'a appellé sucre de lait.
Ce médecin composoit quatre especes de sucre de lait. La premiere étoit fort grasse ; la seconde l'étoit moins ; la troisieme ne contenoit presque pas de parties grasses ; la derniere étoit mêlée avec quelques autres médicamens. Ce sel étoit sujet à se rancir comme la graisse des animaux, sur tout lorsqu'on le conservoit dans des vaisseaux fermés, c'est pourquoi l'auteur conseilloit de le laisser exposé à l'air libre.
M. Fickius, en 1710, publia en Allemagne une maniere de faire le sel de lait. Enfin on a poussé en Suisse à sa perfection la maniere de préparer cette espece de sel ; mais on en a tenu la préparation secrette. M. Cartheuzer en a donné une préparation particuliere, qu'il attribue mal-à-propos à Testi ; & que l'auteur, dont nous empruntons ce morceau sur le sucre de lait, a tentée sans succès.
Il y a en Suisse un chimiste nommé Creusius, qui a une maniere admirable de composer ce sel, mais malheureusement il ne fait part de son secret à personne, ce qui est d'autant plus fâcheux, que celui dont il a la propriété est infiniment plus beau que les autres ; il est plus blanc, plus doux ; il se dissout mieux sur la langue.
En attendant qu'il plaise à M. Creusius de publier son secret *, voici la méthode la meilleure de faire
* Il est très-vraisemblable que ce secret consiste à dégraisser le sucre de lait, ou à le raffiner par les mêmes moyens qu'on emploie à raffiner le sucre ordinaire, c'est-à-dire par l'emploi convenable de la chaux vive & d'une glaise blanche & pure. Voyez RAFFINERIE ou RAFFINAGE DU SUCRE au mot SUCRE.
ce sel que nous propose notre auteur, & qui est celle qu'on pratique dans les Alpes du côté de la Suisse. On prépare dans ce pays deux especes de sucre de lait ; l'une est en crystaux, l'autre se vend sous la forme de tablettes. La derniere espece se fait de cette maniere : on écrême le lait à l'ordinaire : on le fait prendre ensuite avec de la présure pour en tirer le petit-lait que l'on filtre à travers un linge propre, & que l'on fait évaporer sur un feu lent, en le remuant doucement, jusqu'à ce qu'il soit réduit en consistance de miel. Quand il est épaissi de cette façon on le moule, on lui donne différentes figures & on le fait sécher au soleil ; c'est ce qu'on appelle sucre de lait en tablettes.
L'autre espece se tire de la précédente. On fait dissoudre dans de l'eau le sucre de lait en tablettes, on le clarifie avec le blanc-d'oeuf, on le passe à la chausse, on le fait épaissir par l'évaporation jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'un sirop, & on le met reposer pour que la crystallisation se fasse. Les crystaux se trouvent séparés formant des masses cubiques, brillantes & très-blanches ; ils sont attachés aux parties du vase par couches. Si l'on veut encore faire épaissir la liqueur qui reste & la mettre en repos, on en retire de nouveaux crystaux ; on peut répéter ce manuel trois fois. Les premiers crystaux sont d'un blanc éblouissant ; les seconds sont paillés ; les derniers sont d'une couleur brune. En les faisant dissoudre de nouveau dans de l'eau pure, & répétant la clarification, la filtration & la crystallisation, on peut porter les derniers au degré de blancheur des premiers.
L'auteur prétend que, quoique le lait de tous les animaux soit propre à fournir du sel essentiel, cependant celui de la femme est le meilleur, ensuite ceux d'anesse, de chevre & de vache.
Le sel essentiel de lait est très-soluble dans l'eau ; mais le différent degré de chaleur de ce menstrue fait varier considérablement la proportion dans laquelle se fait cette dissolution. Une once d'eau bouillante dissout parfaitement sept gros de sucre de lait, tandis que la même quantité a bien de la peine à fondre dans une livre d'eau qui n'étoit refroidie que jusqu'au 160 degré du thermomètre de Farenheit.
Quant aux vertus médicinales du sucre de lait, notre auteur remarque que s'il convient d'avoir égard aux éloges que Boerhaave & Hoffman ont donnés au sucre ordinaire, on doit les accorder à plus forte raison au sucre de lait. Le sel essentiel de lait produit le même effet que le petit-lait, qui n'est que le même remede plus étendu. On peut employer le premier avec avantage pour les estomacs paresseux qui ne sont pas en état de soutenir de grandes boissons. Lorsque le petit-lait est indiqué pour de pareils sujets, on peut y substituer du sucre de lait dissous dans une liqueur convenable à l'état & aux forces du malade. Testi, Aloysius Afabra, & beaucoup d'autres auteurs le croient merveilleux dans les affections goutteuses & rhumatismales ; notre auteur ne croit pas beaucoup à cette propriété que son expérience a constamment démentie. Extrait d'un écrit de M. Vullyamoz, médecin de Lausanne, inséré dans le recueil périodique d'observations de médecine, &c. pour le mois de Décembre 1756.
On distribue dans le royaume une espece de placard ou mémoire sut la nature & l'usage du sucre de lait de Suisse qui se vend dans plusieurs villes du royaume, & principalement à Lyon. Il est dit dans ce mémoire que ce précieux remede convient fort, lorsqu'on soupçonne d'avoir quelques restes de maux vénériens, & qu'il est très-propre pour les enfans qui peuvent avoir apporté cette maladie en naissant, ou qui ont sucé quelques nourrices infectées. Tout médecin raisonnable peut assurer très-positivement au contraire que le sucre de lait est un remede impuissant dans l'un & dans l'autre cas.
Tout ce qu'on sait de la nature du sucre de lait, c'est que c'est une matiere de la classe des corps muqueux du genre des corps doux, & de l'espece de ces corps qui est caractérisée par la propriété de prendre une forme concrete. Le sucre de lait est distingué dans cette division par la moindre pente à subir la fermentation spiritueuse, & par un degré de douceur beaucoup moindre que celle des sucres végétaux avec lesquels il a d'ailleurs beaucoup d'analogie. Voyez DOUX, MUQUEUX & SUCRE.
Lait distillé. Le petit-lait distillé au bain-marie qui a été mis au nombre des médicamens, doit être rejetté dans la classe des eaux distillées parfaitement inutiles. Celle-ci est recommandée principalement comme cosmétique ; mais on peut avancer que la très-petite quantité & l'extrème subtilité des principes propres du lait qui s'élevent avec la partie aqueuse dans la distillation, & qui donnent à l'eau de lait distillée une odeur de lait très-reconnoissable, ne sauroit cependant lui communiquer aucune vertu médicamenteuse. On doit penser la même chose de l'eau distillée de limaçons avec le petit-lait, qui est décrite dans la plupart des dispensaires sous le nom d'eau de limaçon, & d'une autre eau plus composée, connue sous le nom d'eau de lait aléxitere : du moins est-il certain que cette eau dont les autres ingrédiens sont de chardon-bénit, la scabieuse, la reine des prés, la mélisse, la menthe & l'angelique, ne doit sa vertu médicinale qu'à la plupart de ces plantes qui contiennent un principe actif & volatil, & plus généralement, que l'eau de lait alexitere, est une préparation fort mal-entendue.
Le petit-lait entre dans la composition de la confection-hamec, & en est un ingrédient fort ridicule. (b)
LAIT VIRGINAL, (Chimie, Mat. méd.) les Pharmacopistes ont donné ce nom à plusieurs liqueurs rendues laiteuses, c'est-à-dire opaques & blanches, par un précipité blanc & très-léger, formé & suspendu dans leur sein.
Celle de ces liqueurs la plus connue est une teinture de benjoin précipitée par l'eau. Une résine quelconque, dissoute dans l'esprit-de-vin, & précipitée par l'eau, fourniroit un lait virginal pareil à celui-ci, qui n'a prévalu dans l'usage que par l'odeur agréable & l'âcreté modérée du benjoin. Le lait virginal du benjoin est un remede externe, recommandé contre les taches du visage ; ce cosmétique n'a, dans la plupart de ces cas, qu'un succès fort médiocre. Voyez BENJOIN, RESINE & TEINTURE.
Une autre liqueur fort différente de la précédente & qui porte le nom de lait virginal dans quelques livres classiques, dans la Chimie de Lemery, par exemple, c'est le vinaigre de Saturne précipité par l'eau. Ce remede est vanté contre les dartres, les éruptions érésipélateuses, & presque toutes les maladies de la peau. Son usage mérite quelque considération dans la pratique, à cause de sa qualité répercussive. Voyez REPERCUSSIF & PLOMB. (b)
LAIT, maladies qui dépendent du, (Méd. Pathologie) nous ne considérons le lait dans cet article que comme cause de maladie, comme contribuant à grossir le nombre de celles qui attaquent spécialement cette moitié aimable du genre humain, & qui lui font payer bien cher la beauté, les agrémens & toutes les prérogatives qu'elle a par-dessus l'autre. Les maladies les plus communes excitées par le lait, sont la fievre de lait, le lait répandu, le caillement de lait dans les mamelles, & le poil de lait. On pourroit encore ajouter aux maladies dont le lait est la source, celles qu'il occasionne dans les enfans lorsqu'il est altéré. Ces machines délicates, avides à recevoir les plus légeres impressions, faciles (cerei) à s'y plier, se ressentent d'abord des vices de cette liqueur leur seule nourriture, & elles en portent les funestes marques pendant tout le cours d'une vie languissante & maladive ; quelquefois ils payent par une mort promte les dérangemens d'une nourrice infectée ou trop emportée dans ses passions. C'est un fait confirmé par l'expérience de tous les jours, que le lait d'une femme en colere fait, dans les petits enfans qui le sucent, l'effet d'un poison actif ; & personne n'ignore que l'obstruction des glandes du mésentere, l'atrophie, le rachitis, &c. ne doivent le plus souvent être imputés qu'à un lait vicieux, & sur tout à celui qui est fourni par une nourrice enceinte, qui pour n'être pas privée d'un gain mercenaire, immole cruellement ces innocentes victimes à ses plaisirs & à sa cupidité. Nous ne poursuivrons pas cette matiere, parce qu'elle est traitée plus au long aux articles particuliers des MALADIES des enfans ; nous nous bornerons ici à l'exposition succincte des maladies produites immédiatement par le lait dans les femmes.
Fievre de lait, febris lactea. D'abord que la matrice a été débarrassée par l'accouchement de l'enfant qu'elle contenoit, elle se resserre ; les humeurs qui s'y étoient ramassées s'écoulent, les sucs nourriciers qui y abordoient, destinés à la nourriture de l'enfant, prennent une autre route ; ils se portent aux mamelles, & concourent à y former le vrai lait alimenteux, bien différent de cette humeur tenue & blanchâtre qui y étoit contenue pendant la grossesse, & qui n'avoit rien que de désagréable au goût & de nuisible à l'estomac ; les mamelles paroîtront alors gonflées, distendues, raffermies par le lait qui en remplit & dilate les vaisseaux. Sa quantité augmente à chaque instant, & si l'enfant en tetant ne vient la diminuer, ou si on ne l'exprime de quelqu'autre façon, les mamelles se tendent, deviennent douloureuses, s'enflamment, le lait s'y épaissit, empêche l'abord de celui qui vient après, qui reflue ou reste sans être séparé dans les vaisseaux sanguins, & y forme une plethore de lait. Cette humeur pour lors étrangere dans le sang, trouble, gêne, dérange, & sans-doute par-là même anime le mouvement intestin, & y excite la fievre qu'on appelle pour cela fievre de lait. Quelques auteurs ont prétendu qu'elle n'étoit qu'une suite du trouble, du désordre de l'accouchement & de l'agitation des humeurs, obligées dans ces circonstances à se frayer de nouvelles routes. C'est ainsi qu'Hoffman pense qu'elle est produite par les humeurs qui vont, dit-il, de la matrice aux mamelles, & qui en irritent les nerfs. (De febrib. symptomat. sect. 11. capit. xiv. tom. II.) Mais pour faire appercevoir tout le faux & l'inconséquent de cette assertion, il suffit de remarquer, 1°. que cette fievre ne se manifeste que le trois ou quatrieme jour après l'accouchement ; 2°. qu'elle ne s'observe bien sensible que chez les personnes qui ne veulent pas alaiter ; les femmes qui nourrissent elles-mêmes leurs enfans, en sont presqu'entierement exemptes. Cette fievre n'a aucun symptome particulier que la douleur tensive des mamelles, qui se continue jusques sous les aisselles, au dos & aux épaules ; il n'est pas rare de la voir compliquée avec la fievre miliaire. Elle se termine ordinairement en trois ou quatre jours sans accident fâcheux ; bien plus, elle sert plus que tout autre remede à dissiper le lait, à le faire passer ; elle en procure l'évacuation par les sueurs principalement qui sont assez abondantes. Lorsque la suppression des vuidanges se joint à cette maladie, elle en augmente beaucoup le danger ; & l'on a tout sujet de craindre une mort prochaine, si l'on observe en même tems pesanteur de tête & tintement d'oreille ; si l'oppression est grande, le pouls foible, petit, resserré, &c. Si le délire est considérable, &c. elle est alors une juste punition de la plupart des femmes, qui sous le spécieux prétexte d'une excessive délicatesse, d'une santé peu solide, d'une foible complexion, ou simplement pour éviter les peines attachées à l'état de nourrice, refusent d'alaiter elles-mêmes leurs enfans, se soustrayant par-là à une des lois les plus sacrées de la nature, & confiant cet emploi important & périlleux à des nourrices mercénaires, à des domestiques, le plus souvent au grand préjudice des enfans.
Cette fievre n'exige aucun secours, lorsqu'elle est contenue dans les bornes ordinaires ; il suffit d'astreindre la nouvelle accouchée à un régime exact ; le moindre excès dans le manger peut avoir de très-fâcheux inconvéniens ; la diete un peu sévere a outre cela l'avantage réel d'empêcher une abondante secrétion du lait. Il faut avoir soin de tenir toujours les mamelles enveloppées de linges chauds ; on peut même les humecter avec les décoctions d'anis, de fenouil, de menthe, de fleurs de sureau, plantes dont l'usage est presque consacré pour favoriser la dissipation du lait. Si la fievre miliaire se met de la partie, il faudra recourir aux légers cordiaux & diaphorétiques, quelquefois aux vesicatoires. Voyez FIEVRE MILIAIRE. Si le cours des vuidanges est dérangé, diminué ou suspendu totalement, il faut tourner principalement ses vûes de ce côté, & employer les secours propres à remettre cette excrétion dans son état naturel. Voyez VUIDANGES.
Lait répandu. Le lait répandu ou épanché ne forme pas une maladie particuliere qui ait ses symptomes propres ; il est plutôt la source d'une infinité de maladies différentes, d'autant plus funestes qu'elles restent plus long-tems cachées, & qu'elles tardent plus à se développer : c'est un levain vicieux qui altere sourdement le sang, & imprime aux humeurs un mauvais caractere, & qui prépare ainsi de loin, tantôt des ophtalmies, tantôt des ulceres, quelquefois des tumeurs dans différentes parties ; chez quelques femmes des attaques de vapeurs, dans d'autres une suite d'indispositions souvent plus fâcheuses que des maladies décidées. Toutes ces maladies, effets du lait répandu, sont ordinairement rebelles, & cedent rarement aux remedes usités ; c'est aussi une tradition qui se perpétue chez les femmes, que ces sortes d'accidens sont incurables ; on voit que cette tradition n'est pas tout-à-fait sans fondement : au reste une des grandes causes d'incurabilité, est que dans le traitement on perd de vûe cet objet, on oublie, ou l'on ne fait pas attention que la maladie est produite, ou entretenue par un lait répandu : ce qui donne occasion au repompement & à l'épanchement du lait, c'est l'inattention & l'imprudence des nourrices, qui étant dans le dessein de ne plus nourrir, négligent tous les secours propres à faire perdre leur lait, ou se contentent de quelques applications extérieures, inéfficaces, ou trop actives, sans continuer pendant quelque tems de se faire teter, ou d'exprimer elles-mêmes leur lait surabondant. La même chose arrive aux nouvelles accouchées qui ne veulent pas alaiter, lorsque la fievre de lait est foible & de courte durée, & qu'elle n'est point suppléée par des vuidanges abondantes ou quelqu'autre excrétion augmentée : alors le lait repompé dans le sang, se mêle avec lui, & l'altere insensiblement.
Il est plus facile de prévenir les desordres du lait répandu, que de les réparer ou de les faire cesser ; ainsi lorsqu'une nourrice veut cesser de l'être, elle doit s'astreindre à une diete médiocre, n'user que d'alimens légers, de peu de suc, prendre quelques purgatifs légers, des lavemens réitérés ; les diurétiques conviennent aussi très-bien ; la térébenthine jointe à la poudre de cloportes, est celui dont on use le plus familierement, & dont on éprouve le succès le plus promt & le plus constant. On peut laisser à la femme la liberté & le choix d'applications sur les mamelles, pourvu cependant qu'elles ne soient pas trop astringentes ou emplastiques ; il ne faut pas non plus les envelopper & les affaisser sous le poids des linges & des cataplasmes, dans la vûe de les tenir chaudes. Avec ces précautions, ces topiques peuvent être appliqués avec quelque succès, du moins sans inconvénient. Lorsqu'on a négligé ces remedes, ou qu'ils ont été sans effet, que le lait répandu a excité quelques maladies, outre les remedes particulierement indiqués dans cette maladie, il faut avoir recours aux diuretiques, aux légers diaphorétiques, aux différens sels neutres, & sur-tout aux eaux minérales dont le succès est presque assuré.
Caillement de lait, poil de lait. Un autre accident assez ordinaire aux femmes qui ne veulent pas nourrir, & aux nourrices qui ne sont pas suffisamment tetées, & qui laissent par-là engorger leurs mamelles, est le caillement de lait ; il est aussi quelquefois occasionné par des passions d'ames vives, par la colere, par une grande & subite joie, par une terreur, par des applications acides, astringentes sur les mamelles, par un air froid agissant trop immédiatement sur une gorge de nourrice imprudemment découverte, & sur-tout par l'usage trop continué d'alimens gélatineux, austeres, acides, &c. Il est inconcevable avec quelle rapidité les vices des alimens se communiquent au lait, & quelle impression ils y font ; c'est un fait connu de tout le monde, que le lait d'une nourrice devient purgatif lorsqu'elle a pris quelque médicament qui a cette propriété. Olaus Borrichius raconte que le lait d'une femme qui fit usage pendant quelques jours d'absinthe, devint d'une amertume insoutenable. Salomon Branner assure avoir vu sortir par une blessure à la mamelle, de la biere inaltérée qu'on venoit de boire, ce qui doit être un motif pour les nourrices d'éviter avec soin tous les mets trop salés, épicés, les liqueurs ardentes, spiritueuses, aromatiques, &c. & un avertissement aux medecins de ne pas trop les surcharger de remedes. Lorsque par quelqu'une des causes que je viens d'exposer le lait s'est caillé, la mamelle paroît au tact dure, inégale ; on sent sous le doigt les grumeaux de lait endurci ; son excrétion est diminuée, suspendue ou dérangée ; la mamelle devient douloureuse, s'enflamme même quelquefois. On appelle proprement poil de lait, lorsque le caillement est joint à une espece particuliere de douleur que les femmes savent bien distinguer, & qui est semblable, dit Mauriceau, liv. III. chap. xvij. à celle qu'Aristote, Hist. animal. liv. VII. chap. II. " assure fabuleusement procéder de quelque poil avalé par la femme en buvant, lequel étant ensuite facilement porté dans la substance fongueuse des mamelles, y fait une très grande douleur qui ne s'appaise pas avant qu'on ait fait sortir le poil avec le lait, soit en pressant les mamelles, soit en les suçant ".
Si l'on ne remédie pas tout de suite à cet accident, il peut avoir des suites fâcheuses ; il occasionne assez ordinairement l'abcès ou apostème des mamelles ; quelquefois la tumeur s'endurcit, devient skirrheuse, & dégénere enfin en cancer, comme Fabrice de Hilden dit l'avoir observé, Observ. chirurg. centur. 2.
On ne peut remédier à cet accident plus sûrement & plus promtement, qu'en faisant teter fortement la femme ; mais comme le lait vient difficilement, l'enfant ne sauroit être propre à cet emploi ; il faut alors se servir d'une personne robuste qui puisse vuider & tarir entierement les mamelles ; il est vrai que la suction entretient la disposition à l'engorgement, & attire de nouvelles humeurs aux mamelles, ce qui est un bien si la femme veut continuer de nourrir, & n'est pas un grand mal si elle est dans un dessein contraire ; car il est bien plus facile de dissiper le lait fluide & naturel, que de le résoudre & l'évacuer lorsqu'il est grumelé ; on peut hâter ou faciliter la résolution de ce lait, par les applications résolutives ordinaires ; telles sont celles qui sont composées avec les plantes dont nous avons parlé, fievre de lait ; tels sont aussi les cataplasmes de miel, des quatre farines, & lorsque la douleur est un peu vive, dans le poil, celui, qui reçoit dans sa composition le blanc de baleine ; les fomentations faites avec la liqueur de saturne animée avec un peu d'eau-de-vie, me paroissent très-appropriées dans ce dernier cas.
LAIT DE LUNE, lac lunae, (Hist. nat.) La plûpart des Naturalistes désignent sous ce nom, une terre calcaire, blanche, légere, peu liée, & semblable à de la farine ; cette substance se trouve presqu'en tout pays ; elle ne forme jamais de lits ou de couches suivies dans le sein de la terre ; mais on la rencontre dans les fentes des rochers, & adhérente aux parois de quelques cavités souterraines où elle a été déposée par les eaux qui avoient entraîné, lavé, détrempé cette espece de terre. Quoique cette substance ne différe des autres terres calcaires que par sa blancheur & sa pureté, les auteurs lui ont donné plusieurs noms différens, tels sont ceux d'agaric minéral, de farine fossile, de fungus petraeus, de medulla sanorum, de stenomarga, lithomarga, &c. d'où l'on peut voir combien la multiplicité des noms est propre à brouiller les idées de ceux qui veulent connoître le fond des choses.
On dit que le nom de lait de lune a été donné à cette substance parce qu'elle blanchit l'eau, & lui fait prendre une couleur de lait ; cela vient de la finesse de ces parties qui les rend très-miscibles avec l'eau ; elle fait effervescence avec tous les acides, ce qui caractérise sa nature calcaire.
On regarde le lait de lune comme un excellent absorbant, qualité qui lui est commune avec les yeux d'écrevisses, la magnésie blanche, & d'autres préparations de la pharmacie auxquelles il est plus sûr de recourir qu'à une terre, qui quelque pure qu'elle paroisse, peut avoir pourtant contracté des qualités nuisibles dans le sein de la terre. (-)
LAIT, PIERRE DE, lactea, lapis lacteus, (Hist. nat.) Quelques auteurs donnent ce nom à la même substance calcaire & absorbante que d'autres ont nommée lait de lune, lac lunae, ou moroctus. Ce nom lui vient de ce que mise dans l'eau elle la blanchissoit & la rendoit laiteuse. On lui attribuoit plusieurs vertus medecinales. Voyez de Boot, lapid. hist. & voyez LAIT DE LUNE.
LAIT DE CHAUX, (Architect.) dans l'art de bâtir ; c'est de la chaux délayée avec de l'eau, dont on se sert pour blanchir les murs, en latin albarium opus, selon Pline.
|
| LAITAGE | S. m. (Econom. rust.) il se dit de tous les alimens qui se tirent du lait, du lait même, du beurre, de la crême, du fromage, &c.
|
| LAITANC | ou LAITE, s. f. (Cuisine) c'est la partie des poissons mâles qui contient la semence ou liqueur seminale. Un des Bartholins dit avoir trouvé dans l'asellus, espece de merlan, une laite & des oeufs.
|
| LAITERIE | S. f. (Econom. rustiq.) endroit où l'on fait le laitage. Il faut qu'il soit voisin de la cuisine, ait un côté frais & non exposé au soleil, vouté s'il se peut, assez spacieux, & sur-tout tenu avec beaucoup de propreté ; il faut qu'il y ait des ais, des terrines, des pots de différentes grandeurs, des baquets, des barattes, des claies, des éclisses ou chazerets, des caserons ou cornes, des moules, des cuillieres, des couloires, des cages d'osier, & en confier le soin à une servante entendue & amie de la netteté. Voyez nos pl. d'Agr. & Econ. rust.
|
| LAITIER | S. m. (Métallurg.) matiere écumeuse qui sort du fourneau où l'on fait fondre la mine. Cette matiere vient non-seulement de la mine, mais encore plus de la castine qu'on met avec la mine, pour en faciliter la fusion ; c'est ainsi qu'on met du borax pour fondre l'or, & du salpêtre pour fondre l'argent ; comme dans la fonte du fer les laitiers emportent toujours des portions de ce métal, les forgerons ont soin de les piler avec une machine faite exprès, qu'on appelle bocard, afin d'en tirer le fer qu'ils ont charrié avec eux. Dict. de Trév. de Chambers, &c. Voyez l'article FORGE. (D.J.)
|
| LAITIERE | (s. f. (Econom. rust.) femme qui vend du laitage. Il se dit de la vache qui donne beaucoup de lait, & même de la femme qui est bonne nourrice.
|
| LAITON | S. m. (Métallurgie) le laiton est un alliage d'une certaine quantité de pierre calaminaire, de cuivre de rosette, & de vieux cuivre ou mitraille. Voyez les articles CALAMINE, CUIVRE, & ALLIAGE.
Nous allons expliquer la maniere dont on procede à cet alliage : pour cet effet nous diviserons cet article en quatre sections. Dans la premiere, nous parlerons de l'exploitation de la calamine. Dans la seconde, de la préparation & de l'emploi de cette substance. Dans la troisieme, de la fonderie. Dans la quatrieme, des batteries & de la trifilerie.
Nous ignorons si ces travaux s'exécutent par-tout de la même maniere. On peut consulter là-dessus l'ouvrage de Schwendenborg qui a écrit très au long sur le cuivre. Nous nous contenterons de détailler ce qui concerne la calamine, d'après les manoeuvres en usage dans la montagne de Lembourg ; & ce qui concerne les procédés sur le laiton, d'après des usines & les fonderies de Namur.
Sect. I. De l'exploitation de la calamine. On trouve de la pierre calaminaire à trois lieues de Namur ; à une demi-lieue de la Meuse, sur la rive gauche, aux environs des petits villages de Landenne, Vilaine, & Haimonet, tous les trois de la même jurisdiction. Haimonet situé sur une hauteur en fournit à une profondeur médiocre ; on n'y emploie par conséquent aucune machine à épuiser ; elle n'est point inférieure en qualité à celle des autres villages ; la mine en est seulement moins abondante. Il en est de même de celle de Terme au Griffe, lieu situé sur une autre montagne, à la rive droite de la Meuse.
L'exploitation de la calamine ne differe pas de celle du charbon-de-terre. Voyez CHARBON-DE-TERRE. Elle se fait par des puits qu'on appelle bures ; les bures ont d'ouverture depuis douze jusqu'à seize piés en quarré ; on soutient les terres par des assemblages de charpente, & l'on descend jusqu'à ce qu'on rencontre une bonne veine. Là, à mesure que l'on enleve le minerai, on pratique des galeries sous lesquelles on travaille en sureté, par le soin qu'on a de soutenir les terres avec des chassis. A mesure qu'on exploite, on rejette les déblais de la galerie d'où l'on tire, dans les galeries d'où l'on n'a plus rien à tirer, observant d'enlever les chassis à mesure qu'on fait le remblai. Voyez les articles CHASSIS, DEBLAI, REMBLAI, & BURES.
On commence ordinairement l'ouverture d'une mine par deux bures. L'un sert à l'établissement des pompes à épuisement ; on le tient toûjours plus profond que l'autre qui sert à tirer & à monter le minerai. On en pratique encore de voisins qui servent à donner de l'air, lorsque les galeries s'éloignent trop du grand bure. On appelle ceux-ci bures d'airages : quelquefois on partage la profondeur du grand bure en deux espaces ; dans l'un, on établit les pompes ; c'est par l'autre qu'on monte & descend : alors les bures d'airage sont indispensables ; presque tous les grands bures de la calamine sont dans ce dernier cas. Lorsque les eaux abondent & menacent ou incommodent les ouvriers, on approfondit le bure, & l'on y pratique un canal que les gens du pays appellent une arène. L'arène part du grand bure ; & se conduit en remontant jusqu'à la rencontre de la galerie qu'on veut dessécher. Il y a dans les galeries, qu'on appelle aussi charges, d'autres conduits par lesquels les eaux vont se perdre : on nomme ces conduits égoutoirs ou égougeoirs.
Lorsque nous écrivions ce mémoire, le grand bure avoit en profondeur 43 toises du pays, ou trente-neuf toises un pouce six lignes de France ; il y avoit plusieurs bures d'airage, une plombiere ou fosse d'où l'on exploitoit du plomb ; cette fosse étoit poussée à trente-cinq toises. Le bure de la calamine & la plombiere avoient chacun leurs machines à épuisement ; ces machines étoient composées l'une & l'autre d'une grande roue de 45 piés de diametre cette roue étoit enterrée de 19 piés, & contenue entre deux murs de maçonnerie qui la soutenoient à six piés au-dessus de la surface du terrein. Elle étoit garnie au centre d'une manivelle qui faisoit mouvoir des balanciers de renvoi, à l'extrémité desquels étoient les pompes établies dans le bure. C'étoit la machine de Marli simplifiée : des courans dirigés sur ses aubes la mettoient en mouvement ? on ménageoit l'eau par des beuses, comme on le pratique dans les grosses forges. Voyez cet article. On avoit encore conduit à mi-roue, par d'autres beuses souterraines, les eaux élevées de la mine. On avoit trouvé par ce moyen, l'art de multiplier les forces dont on a besoin pour accélérer le mouvement de ces grandes machines.
L'observateur qui jettera un oeil attentif sur une mine en exploitation, verra des rochers coupés d'un côté, des mines travaillées, des déblais ; de l'autre des remblais, des mines où l'on travaille, des caves ou mines submergées, plusieurs galeries élevées les unes sur les autres, rarement dans un même plan, des sables & autres substances fossiles.
Le terrein produit à sa surface toutes sortes de grains ; les environs des mines dont il s'agit ici, sont couverts de genievre ; les eaux de la mine n'ont aucun goût dominant ; elles sont légeres ; le maître fondeur donne au propriétaire du sol tant par poids de mine exploitée. Lorsque nous y étions, le prix convenu étoit de cinquante-six sols de change, ou de 5 liv. 3 s. 4 d. argent de France, pour 15000 pesant de calamine ; auparavant on donnoit la dixieme charretée.
La calamine est dans ces mines très-poreuse, calcinée ou non calcinée, l'action de l'air l'altere. Si on la tire d'un magasin sec & qu'on l'expose dehors, elle augmente considérablement de poids : sa couleur est d'un jaune pâle, tirant quelquefois sur le rouge & le blanc ; elle est souvent mélée de mine de plomb. Il y a des mines qui sont d'autant meilleures, que les filons s'enfoncent davantage. Cette loi n'est pas applicable à la calamine : celle que l'on tire à 8 ou 10 toises est aussi parfaite que celle qu'on va chercher à 45 ou 50. La calamine calcinée en devient plus legere ; cette opération lui donne aussi un degré de blancheur ; cependant le feu lui laisse des mouches ou taches noires.
La planche premiere de celles qui ont rapport à cet article, montre la coupe d'une mine de calamine.
Sect. II. De la calcination de la calamine. Pour calciner la calamine, on en fait une pyramide, comme on la voit en A, B, C, fig. 2 ; sa base F, G, f, g, est fig. 3. partagée en quatre ouvertures, x, x, x, x, d'un pié ou environ de largeur ; ces ouvertures vont aboutir à une cheminée H, ménagée au centre. Cette cheminée regne tout le long de l'axe de la pyramide, & va se terminer à sa pointe A, fig. 2 ; la base a 10 à 12 piés de diametre ; elle est formée de bois à brûler, posés sur une couche de paille & de même bois. C'est avec le gros bois élevé à dix-huit pouces, que l'on forme les ouvertures x, x, x, x, & les fondemens de la cheminée. On arrose la derniere couche avec du charbon de bois, & l'on place dans la cheminée deux fagots debout.
Cela fait, on forme un lit de calamine de sept à huit pouces d'épaisseur ; sur ce lit, on en forme un de charbon de bois, mais beaucoup moins épais ; il ne faut pas qu'il couvre entierement la surface du lit de la calamine. Sur ce lit de charbon, on en étend un second de calamine, tout semblable au premier ; sur celui-ci un lit de charbon, & ainsi de suite, jusqu'à ce que le volume que l'on veut calciner soit épuisé. Il faut observer de ménager à travers ces lits l'ouverture de la cheminée. On calcine communément quatorze à quinze cent pesant de calamine à-la-fois ; on y emploie quatre cordes & demie de bois, & à-peu-près une bonne de charbon, ou une voiture de 25 vaux ou 18 queues, à deux mannes la queue ? ou, pour parler plus exactement, le charbon d'environ six cordes de bois.
La pyramide étant formée, on y met le feu, il faut veiller à sa conduite : le feu trop poussé, brûle la calamine ou la calcine trop ; pas assez poussé, elle demeure sous forme de minerai. C'est l'habitude d'un travail journalier, qui apprend à l'ouvrier à connoître le vrai point de la calcination. On retire les premiers lits à mesure que le procédé s'avance ; ils ont souffert depuis huit jusqu'à douze heures de feu.
Lorsque la calamine est calcinée & refroidie, on la nettoye, c'est-à-dire qu'on en separe les pierres & autres substances étrangeres ; on la porte dans un magasin bien sec, d'où on la tire ensuite pour l'écraser & la réduire en poudre.
On voit dans nos Planches, fig. 2. une pyramide de calamine en calcination ; fig. 3. la base de la pyramide ; fig. 4, de la calamine calcinée ; fig. 1, de la calamine apportée de la mine & prête à être mise en pyramide.
On mêle la calamine de la montagne de Lembourg avec celle de Namur ; la premiere s'achete toute calcinée & nettoyée : elle est plus douce & produit davantage que celle de Landenne ; mais les ouvriers la trouvent trop grasse, défaut qu'ils corrigent par le mélange avec celle de Lembourg. Sans ce correctif, les ouvrages qu'on feroit se noirciroient & se décrasseroient avec peine. Lorsque nous écrivions ce mémoire, la calamine de Lembourg se vendoit 50 s. le cent pesant, ou 25 liv. de France le mille, rendu à Viset où on l'amene par charrois, & de Viset 5 liv. le mille pour la transporter par bateau à Namur, où elle revenoit par conséquent à 30 livres de France.
Cette calamine de Namur n'est pas toute ni toûjours de la même qualité ; le fondeur en fait des essais. Pour cet effet, il met sur 60 livres de calamine de Namur, 15 à 20 livres de calamine de Lembourg ; il fait écraser & passer le tout au blutoir ; il y ajoute 35 livres de rosette ou cuivre rouge, & 35 livres de vieux cuivre ou mitraille ; ce qui doit donner une table de 85 à 87 livres. Dès la premiere fonte, il trouve la proportion qu'il doit garder entre ses calamines, tant que celle de Namur dure.
Trituration de la calamine. Cette opération se fait par le moyen d'un moulin ; ce moulin est composé de deux meules roulantes I, L, fig. 5. Pl. II. dont les essieux sont fixés à l'arbre vertical M, N, qu'un cheval dont on masque la vûe fait mouvoir. Ces meules portent sur un gros bloc de pierre P, qui est enterré ; ce bloc est revétu sur son pourtour de douves de bois S, S, S, arrêtées avec des cerceaux de fer, & des appuis de bois R, le tourillon d'em-bas N, tourne dans une crapaudine de fonte, enchâssée en un marbre quarré, placé au centre du bloc ; le tourillon d'en-haut M, se meut en un sommier du bâtiment, & est arrêté en V, par deux boulons qui traversent le sommier.
L'ouvrier employé au moulin remue continuellement la calamine avec une pelle, & la chasse sous les meules : le cheval doit faire quatre tours par minutes, & moudre 20 mesures par jour ; chaque mesure de 15 pouces 6 lignes de diametre en-haut, & de 13 pouces 6 lignes dans le fonds, sur 13 pouces de hauteur. Cette mesure ou espece de baquet cerclé de fer, contient 150 liv. & les 20 mesures font 3000 liv. ce poids est le travail ordinaire.
Le même moulin mout quatre de ces mesures de terre à creuset dans une heure, & trois mesures de vieux creusets, matiere cuite & plus dure. On écrase aussi six mannes de charbon de bois dans le même intervalle de tems ; & ces six mannes se réduisent à trois mannes de charbon pulvérisé. Les pierres qui forment ce moulin sont tirées des carrieres voisines de Namur ; elles sont très-dures, d'un grain fin & bien piqué, les meules s'usent peu : bien choisies & bien travaillées, elles servent 40 à 50 ans. Le bloc sur lequel elles portent & qui fait la plate-forme, dure beaucoup moins.
Blutage de la calamine. La calamine & le charbon étant écrasés au moulin, on les passe au blutoir A, B, fig. 6. Pl. II. C'est un cylindre construit de plusieurs cerceaux assemblés sur un arbre, & couverts d'une étamine de crin ; il est enfermé dans une caisse C, D, posée sur des traverses & incliné de A, en E. Il a une manivelle qui le fait mouvoir ; le son ou les parties grossieres qui peuvent passer au-travers de l'étamine tombent en F, & le gros & le fin séparés, s'amassent dessous le blutoir ; la matiere à tamiser est en G, & l'ouvrier qui est au blutoir la fait tomber d'une main dans la trémie H, qui la conduit dans le blutoir, tandis que de l'autre main il meut la manivelle. Les deux fonds du tambour étant ouverts le gros descend vers la planche E, d'où on le ramasse pour le reporter au moulin ; la calamine passée au blutoir est en poudre très-fine.
La calamine de Lembourg passée au blutoir & pressée dans un cube d'un pouce, a pesé 1 once 1 gros 19 grains ; & la même quantité de Namur, a pesé 1 once 0 gros 24 grains ; leur différence étoit de 67 grains ; celle de Lembourg étoit d'un jaune fort pâle, & celle de Namur d'un jaune tirant sur le rouge, toutes les deux pulvérisées.
De l'alliage de 60 liv. de calamine avec 35 liv. de vieux cuivre & 35 liv. de rosette, il provient 15 à 17 livres d'augmentation, non compris l'arco, matiere qu'on sépare des cendres par des lessives, comme on le dira ci-après.
Sect. III. Fonderie. Une fonderie est ordinairement composée de trois fourneaux A, B, C, fig. 7 Pl. I. construits dans un massif de mâçonnerie E, F, fig. 8. Pl. III. enfoncés de maniere que les bouches de ces fourneaux D, ne soient que de trois à quatre pouces plus élevées que le niveau du terrein. On pratique en-avant deux fosses G, H, fig. 7. & 8. de 2 piés neuf pouces de profondeur, où l'on jette les cendres, ordures, & crasses qui proviennent de la fusion.
Il y a trois moules I, K, L, fig. 9. Pl. I. qu'on manoeuvre avec des pinces, & qu'on ouvre & ferme au moyen du treuil M, N.
Sur la roue N, s'enveloppe une corde qui vient se rouler sur le tour O.
Il y a une cisaille p, fig. 10, qui sert à couper & à distribuer le cuivre.
Il y a un mortier enterré qui sert à faire des paquets de vieux cuivre. Pour cet effet on étend sur ses bords un morceau de vieux cuivre le plus large & le plus propre à contenir le reste de la mitraille ; on bat bien le tout ; l'on en forme ainsi une espece de pelote de calibre au creuset : les ouvriers appellent cette pelote ou boule, poupe. La poupe pese environ 4 livres.
Il y a un bacquet qui contient la calamine.
Des amas de rosette rompue par morceaux, d'un pouce ou deux en quarré ; une palette de fer pour enfoncer la rosette dans la calamine, & battre le tout dans le creuset.
Un instrument appellé la mée, pour mélanger la calamine avec le charbon de bois pulvérisé : on jette le tout dans le creuset, soit avec des pelles, soit à la main.
Trois lits autour des fourneaux, pour les fondeurs qui ne quittent leur travail que le samedi au soir.
Il faut que la hotte y fig. 8. Pl. III. de la cheminée dépasse le bord du fossé H, afin que ce qui s'exhale des creusets suive la fumée des fourneaux.
Des moules pour former les creusets.
Des couvercles pour les fourneaux.
Les instrumens de la poterie.
Des pinces pour arranger les creusets dans les fourneaux, exporter le charbon où il faut, vers les bords des creusets ; on les appelle pinces ou etnets.
Une pince coudée pour retirer les creusets, les manier, transvaser la matiere d'un creuset dans un autre, les redresser : on l'appelle attrape.
Une pince ou etnet droit, pour retirer la table du moule, & l'ébarber tout de suite, lorsque la matiere s'est extravasée entre les lames de fer & le plâtre.
Un fourgon pour attiser le feu, & entasser la calamine dans le creuset.
Un crochet qu'on employe à différens usages ; il s'appelle havet.
Un caillou plat, en forme de ciseaux, emmanché de bois, pour tirer les crasses & les cendres du creuset, lorsqu'on vuide la matiere du creuset où elle est en fusion, dans celui d'où on doit la couler dans le moule. On appelle cet instrument le tiout.
Un bouriquet pour contenir les branches de la tenaille, lorsqu'il s'agit de tenir à plomb le creuset qu'on charge.
Une palette de fer pour entasser les matieres dans le creuset.
Une tenaille double, pour transporter le creuset & le verser dans le moule.
Un instrument coudé & plat par le bout, en forme de hoyau, emmanché de bois, pour former le lit d'argile, ou le raccommoder sur les barres du fourneau, lorsque les trous du registre qu'on y a pratiqués, deviennent trop grands. On l'appelle polichinelle.
D'autres cisailles pour débiler le cuivre.
Un etnet ou pince à rompre le cuivre qui vient de l'arcot.
Une enclume avec sa masse, pour rompre la rosette.
Des mannes à charbon.
Des bacquets pour la calamine & autres usages.
Des mesures pour les mélanges.
Des brouettes. V. sur ces outils nos pl. & leur exp.
Chaque fourneau, tel que A, fig. 7 & 8, contient huit creusets qui sont rangés dans le fond, sur un lit d'argille de quatre pouces d'épaisseur, étendu sur les barres : ce lit est percé de onze trous.
Le cendrier est au-dessous des barres qui ont deux pouces en quarré, & qui sont rangées tant plein que vuide, excepté dans les angles où l'espace est plus grand. On y a ménagé quatre registres plus ouverts que les autres.
On appelle tilla la premiere assise du fourneau. Le tilla est une espece de brique faite de terre à creuset, qui sert à la construction du fourneau. Les piés droits du fourneau s'établissent sur la grille, & de la hauteur de deux piés quatre pouces. La calotte qui forme la voûte du four, est composée de quatre piéces, & s'assied sur la derniere portion du tilla. On travaille ces pieces de la calotte comme les creusets, au tour.
Lorsque les cendriers & fourneaux sont construits, on remplit d'argille bien battue les intervalles des voûtes seulement : il n'y a qu'un parement de maçonnerie du côté de la fosse.
Les voûtes, les creusets & le tilla, sont tous d'une même matiere que les creusets.
La terre à creuset se prend à Namur, au-dessus de l'abbaye de Gerousart. On la coupe en plein terrein ; elle est noire, forte, fine & savonneuse. Elle pese 1 once 3/20 2/4 le pouce ; elle détache les étoffes. Les ouvrages qu'on en forme, recuits sont très-durs. On en fait des chenets qui durent trois à quatre ans, des contrecoeurs de cheminées ; la neuve se mêle avec la vieille dans la composition des creusets.
Des voutes & des tilla. On mêle un tiers de vieille sur deux tiers de neuve. La vieille provient des creusets cassés & autres ouvrages détruits. On la garde en magasin ; & quand on en a amassé une certaine quantité, on l'écrase au moulin ; on la passe dans une bassine percée de trous, & on l'emploie.
La terre à creuset se tient à couvert & en manne aux environs des fourneaux, où elle seche pendant l'hiver. Au commencement du printems, on la mout, puis on fait le mélange que nous avons dit. On en prépare 40 à 50 milliers à la fois ; on l'étend ensuite à terre, on la mouille, & deux hommes pendant douze jours la marchent deux fois par jour, une heure chaque fois : on laisse ensuite reposer quinze jours sans y toucher. Ce tems écoulé, on recommence à l'humecter & à la marcher encore douze jours ; alors elle est en pâte très-fine, & propre à être mise en oeuvre, au tour ou autrement.
On met à sécher & à s'essuyer les ouvrages qu'on a préparés dans des greniers, & non au soleil ; & quand on veut s'en servir, on les cuit. Les voûtes du fourneau se cuisent en place ; cependant elles ont été passées au feu deux ou trois heures avant que d'être placées. On laisse le tilla & les chenets aux fourneaux depuis le samedi jusqu'au lundi : les creusets se cuisent à mesure qu'on en a besoin.
Des moules. Chaque moule, fig. 9, est composé de deux pierres posées l'une sur l'autre. Chacune de ces pierres a communément cinq piés de longueur, deux piés neuf pouces de largeur, & un pié d'épaisseur ; elles sont entaillées vers le milieu de leur épaisseur, & seulement de la profondeur d'un demi-pouce : cette entaille sert à recevoir les chassis de fer qui contiendront ces pierres.
C'est une espece de grès d'une qualité particuliere. On n'en a trouvé jusqu'à présent que dans les carrieres de Basanges, vis-à-vis S. Michel, près le Ponteau-de-mer : elles ne coutent sur les lieux que 60 livres la paire : mais rendues à Namur, elles reviennent à cent florins du pays, ou à peu-près à 200 livres. il y a du choix à faire ; les plus tendres sont les meilleures : le grain en est médiocre. Il ne faut ni les piquer au fer, ni les polir, parce que l'enduit dont il faut les revêtir, n'y tiendroit pas ; elles durent pour l'ordinaire quatre à cinq ans. Les Namurois ont bien cherché dans leurs carrieres ; mais à l'essai, toutes les pierres qu'ils ont employées se cassent ou se calcinent.
Les pierres du moule sont, comme on voit fig. citée, saisies dans un chassis de fer, dont les longs côtés se joignent à des traverses, où elles sont retenues & assujetties par des clavettes. Chaque barre a des oeillets à divers usages, comme de recevoir des grilles qui soutiennent le platrage d'argille que l'on étend de niveau sur les pierres, & qui forme les levres de la gueule du moule, ou de porter une bande de fer qui regne sur la plus grande longueur de la pierre de dessous, & qui garnie de deux chevilles est mise de niveau avec cette pierre. Cette bande est contrainte en cette situation par deux courbes placées debout sur la barre ; mais il est inutile d'entrer dans un plus long détail sur l'assemblage de ces pierres, la figure en dit assez. On voit que ces pierres ou moules font charniere ; on voit trois de ces moules en situations différentes. La pierre de dessous est emboîtée dans un plancher de gros madriers, cloués sur une traverse posée sur des coussins. Comme les deux extrémités de cette traverse sont arrondies en dessous, il est facile d'incliner le moule. Les coussins sont établis dans une fosse, de même que la traverse.
Les deux pierres s'assujettissent ensemble par deux barres. Toutes les barres qui sont de fer sont boutonnées aux extrémités, & se fixent comme on voit dans la figure 9.
On fait aussi à la pierre de dessus une levre en argille, qui avec celle de dessous forme une gueule.
Ce qui détermine la largeur & l'épaisseur de la table, ce sont des barres posées sur une traverse, & tenues par deux crochets qui entrent dans les oeillets de la traverse.
Le plâtrage est d'argille. On prépare l'argille en la faisant bien sécher, en séparant le gravier, la réduisant en poudre, la détrempant à la main, & la faisant passer à-travers une bassine percée de trous d'une demi-ligne. On en forme de la pâte dont on remplit les trous & autres inégalités des pierres : on applatit bien le tout avec les mains, mouillant toujours la pierre à mesure qu'on la répare. Après quoi on étend un enduit de la même pâte, & d'une demi ligne d'épaisseur sur toute la surface de la pierre : on applanit cet enduit avec des bois durs & polis en forme de briques, que l'on promene également partout. On donne ensuite le poli avec une couche d'argille bien claire, que l'on répand également, en commençant par la pierre de dessus qui est suspendue au treuil. L'ouvrier parcourt le long côté de cette pierre, en versant la coulée uniformement, & tirant à soi le vase qui la contient. On en fait autant à la pierre de dessous ; & comme elle est horisontalement placée, on ôte le trop de coulée avec un morceau de feutre : on passe aussi le feutre à la pierre de dessus. Ce feutre sert encore à emporter le trop d'humidité : au reste on donne à cet enduit le moins d'épaisseur possible.
Lorsque les pierres sont enduites, on laisse sécher l'enduit à l'air. Si l'on est en hiver, que le tems soit humide, & que l'on ne puisse remuer la pierre, on fait rougir les fourgons & autres instrumens de fer ; on les présente à l'enduit à une certaine distance, & on l'échauffe ainsi d'une chaleur douce. Lorsqu'il est parfaitement sec, on le réunit avec du charbon allumé, & on y tient le feu dix à douze heures, au point qu'il paroît prêt à gercer. On assujettit la pierre de dessus sur celle de dessous, afin que la chaleur se distribue également. Deux grandes mannes de charbon suffisent pour entretenir la chaleur pendant le tems de la recuite ; ensuite on nettoie à sec le moule, & cela se fait avec soin. On y pose les lames de fer qui doivent régler la largeur & l'épaisseur de la table : on ferme le moule & on l'incline.
La gueule du moule se fait en même tems que l'enduit ; mais d'une argille moins fine, mêlée avec de la bourre de crin, ce qui forme une espece de torche.
L'enduit recuit devient d'une dureté presqu'égale à celle de la pierre : on peut couler jusqu'à vingt tables sur le même plâtre.
Les tables coulées sur des pierres qui n'ont point servi, ont ordinairement des soufflures ; alors il faut rompre cet ouvrage & le remettre à la fonte en guise de mitraille. On observe, quand on emploie de cette mitraille, de mettre avec elle moins de rosette.
Dans l'intervalle d'une coulée à une autre, on repare le moule, & la pierre qui cesse de se tourmenter à la seconde coulée qui se fait l'instant d'après. La premiere, la seconde & la troisieme table, sont bonnes & se conservent.
Il y a des pierres d'une qualité si particuliere, que pendant sept à huit jours il faut toujours sacrifier la façon de la premiere table.
Chaque moule travaille tous les trois jours, & le même moule sert aux tables que l'on fond pendant vingt-quatre heures, c'est-à-dire à six tables par fonte, ou à une table par fourneau toutes les douze heures.
Quand l'enduit ne peut plus supporter de fonte, on le détache de la pierre avec des dragées de cuivre que l'on trouve dans l'arcot, ou les cendres de la fonte : cette opération s'appelle aiguiser la pierre.
On aiguise la pierre de la maniere suivante. On fixe une barre de fer coudée dans la mortoise de l'extrémité du support du moule ; un grand lévier, fig. 11, est appliqué à cette barre. Il est mobile ; il est pareillement percé d'un trou rond à l'endroit où passe une cheville attachée au milieu de la tenaille. Cette tenaille se joint au chassis de fer, & par conséquent à la pierre de dessus, par le moyen de deux crochets & d'écroux que l'on arrête fortement.
L'extrémité du levier est tenue suspendue par une chaîne ; elle porte plusieurs pitons où l'on fait entrer des crochets. Des hommes appliqués à ces crochets poussent & tirent alternativement le levier : ce levier entraîne la pierre qui suit son mouvement, & les dragées arrachent le plâtre. Cependant d'autres ouvriers tournent la pierre, lui font faire des révolutions sur elle-même, ensorte que le frottement a lieu sur toute la surface.
Lorsque les dragées & le frottement ont pulvérisé le vieux plâtre, on nettoie les pierres, on les lave, on remet un nouvel enduit, & le travail reprend.
De la fonte. C'est l'habitude du travail qui apprend à connoître au fondeur la bonne fusion. Alors la flamme est légere, sa couleur change ; elle devient d'un bleu clair & vif ; & il s'en éleve une pareille des creusets quand on les transvase.
Lorsque le métal est prêt à jetter, on prépare le moule en posant avec soin les barres qui détermineront la dimension de la table. La longueur est à discrétion ; son épaisseur ordinaire est de trois lignes ; sa largeur de deux piés un pouce trois lignes, & son poids d'environ 85 à 87 livres.
Les lames de fer posées, on ferme le moule ; on le joint avec force ; on incline ; on retire le creuset du fourneau où on l'a mis quatre à cinq heures à rougir avant que de fondre ; on a un second creuset, on y transvase la matiere ; on en écarte les ordures ; les crasses & les cendres ; on tire les autres creusets du fourneau, dont on transvase également la matiere dans le même second creuset : on continue jusqu'au huitieme creuset. Lorsque le creuset du jet contient la matiere de ces huit creusets de fourneau, on saisit celui-ci avec la tenaille double, on le porte vers le moule, & l'on coule une table.
Au même moment un ouvrier court au treuil, tourne, releve le moule & le met dans sa situation horisontale ; après quoi continuant de tourner, & la pierre de dessous etant arrêtée, il sépare celle de dessus, & le fondeur avec une tenaille tire la table coulée qu'il a grand soin d'ébarber.
Le même moule sert, comme j'ai dit, à fondre les trois tables que fournissent les trois fourneaux ; & dans l'intervalle d'une jettée à l'autre on répare le moule.
Ainsi il y a trois fourneaux, huit creusets dans chacun ; ces huit creusets se versent dans un seul, & celui-ci fournit une table ; ce qui fait trois tables pour les trois fourneaux & pour les vingt-quatre creusets.
En réparant le moule, on le rafraîchit avec de la fiente de vache ; pour cela on en écarte les lames de fer qui déterminoient les dimensions de la table. On les remet ensuite en place ; on bouche les vuides qu'elles peuvent laisser avec de la fiente de vache. On abat la pierre de dessus, on referme le moule, on le réincline & l'on coule.
Quand les trois tables d'une fonte ont été jettées, on nettoie & l'on rafraîchit encore le moule ; on repose les pierres l'une sur l'autre sans les serrer, & on les couvre avec trois ou quatre grosses couvertures de laine, afin de les tenir chaudes pour la fonte suivante qui se fait douze heures après.
On observe aussi de tenir les portes & les fenêtres de la fonderie bien fermées, seulement pendant qu'on coule ; ensuite on ouvre les portes.
Les ouvriers tiennent le bout de leurs cravates entre leurs dents, soit qu'ils transvasent, soit qu'ils coulent ; ils amortissent ainsi la chaleur de l'air qu'ils respirent.
Après avoir transvasé le cuivre fondu du creuset de fourneau dans le creuset de jettée, le fondeur prend deux bonnes jointées de la composition de calamine & de charbon qui remplit un bacquet, les met dans le creuset qu'il vient de vuider, & par-dessus cela la poupe de mitraille ; puis il replace le creuset au fourneau, où il reste jusqu'à ce que les tables soient jettées, c'est-à-dire environ une demi-heure : on en fait autant à tous les autres creusets de fourneau à mesure qu'on les en tire. Le vieux cuivre en s'échauffant devient cassant & s'affaisse bien mieux, lorsqu'on travaille à recharger le creuset ; c'est ce qu'on appelle amollir le cuivre ; le contraire arrive au cuivre rouge.
Les tables étant situées & le moule préparé pour la fonte suivante, on revient aux fourneaux d'où l'on retire les creusets les uns après les autres pour achever de les charger, ce qui se fait en remettant par-dessus le vieux cuivre déja fort échauffé, beaucoup de calamine de composition que l'on entasse avec le fourgon ; à quoi l'on ajoute le cuivre rouge que l'on enfonce dans la calamine en frappant fortement avec la palette : pour cet effet on assujettit & l'on tient droit le creuset avec la pince coudée & le bouriquet.
Chaque creuset chargé, on le replace au fourneau, on l'y arrange, on repare les onze trous du fond du fourneau qui servent de soufflet : on débouche ceux qui peuvent se trouver bouchés, ou l'on remet de l'argille à ceux qui sont trop aggrandis ; en un mot on acheve comme pour la premiere fonte. On fait d'abord peu de feu, du-moins pendant les deux premieres heures, après lesquelles le fondeur prend de la calamine de composition dans un panier, & sans déplacer les creusets, il en jette sur chacun une ou deux poignées, cela remplit l'espace causé par l'affaissement des matieres. D'ailleurs il y a une dose de matiere pour chaque creuset, & il faut qu'elle y entre ou tout de suite, ou à des intervalles de tems différens.
Si un creuset vient alors à casser, on le retire & on le remplace par celui qui a servi à couler les tables, parce qu'il est encore rouge & disposé à servir ; mais lorsque les huit creusets sont placés & attachés, s'il en casse un, on ne dérange plus rien ; la table se trouve alors d'un moindre poids & plus courte.
On attise en premier lieu en mettant au fourneau une manne de charbon qui contient 200 livres pesant. On commence par choisir les plus gros morceaux qu'on couche sur les bords du creuset ; quand on a formé de cette maniere une espece de plancher, on jette le reste du charbon sans aucune attention, & l'on couvre aux deux tiers la bouche du fourneau, quelques heures après on lui donne, comme disent les ouvriers, à manger de la petite houille, ou du charbon de terre menu.
C'est entre deux & trois heures de l'après-midi qu'on coule ; à cinq heures, les creusets sont tous rangés ; sur les dix heures on donne à manger aux fourneaux, & la seconde fonte se fait à deux heures & demie, ou trois heures après minuit, c'est-à-dire qu'il y a toujours environ douze heures d'une jettée à une autre.
Le samedi ou la veille des grandes fêtes, après la fonte ou jettée, on charge & l'on attise, comme si l'on devoit couler la nuit suivante ; mais sur les quatre à cinq heures du soir, les fondeurs ne font que fermer exactement les bouches des fourneaux qui sont bien allumés ; ils ne laissent d'autre ouverture que celle qui est au centre du couvercle. Cette ouverture est environ d'un pouce & demi de diametre : le tout se tient en cet état jusqu'au lundi suivant. Sur les 5 heures du matin les fondeurs arrivent, & raniment le feu par de nouveau charbon ; son action a été si foible pendant tout l'intervalle qui s'est écoulé, que le travail est quelquefois très-peu avancé, & qu'il faut forcer pour rattraper le cours des fontes accoutumées.
Le travail de la fonderie demande une attention presque continuelle, soit pour attiser & conduire le feu, en ouvrant & fermant les régîtres, soit pour aiguiser les pierres, y appliquer un nouvel enduit, couper & débiter les tables du poids requis. C'est au maître fondeur à régler toutes ces choses : il a pour aide deux autres ouvriers ; & quoiqu'il n'y ait que trois hommes par fonderie, chaque manufacture a du-moins deux fonderies, dont les ouvriers vont de l'une à l'autre, lorsque la manoeuvre le requiert, comme lorsqu'il s'agit d'aiguiser les pierres ou de couper les tables.
Les autres ouvriers sont employés ou au moulin ou au blutoir, & l'on emprunte leurs secours dans l'occasion.
La paie du maître fondeur est plus forte que celle de ses aides.
On fournit à tous la biere, le chauffage, la houille pour leur ménage, qu'ils n'habitent que le samedi jusqu'au lundi. Ils ne s'éloignent jamais de leur attelier. Tandis qu'un d'entr'eux se repose sur les lits de l'usine, les autres veillent.
Trois fourneaux consomment ordinairement 1000 livres pesant de charbon par chaque fonte de douze heures, & 2000 livres pour vingt-quatre heures, le tems de deux fontes.
Le cuivre jaune ou laiton est composé de vieux cuivre de la même espece, appellé mitraille, de cuivre rouge de Suede, & l'alliage de la calamine. L'alliage est, comme je l'ai dit plus haut, de 35 livres de vieux cuivre, de 35 livres de cuivre rouge, & de 60 livres de calamine bien pulvérisée ; sur quoi l'on met 20 à 25 livres de charbon de bois réduit en poudre, passé au blutoir, & que l'on a la précaution de mouiller pour empêcher le cuivre de brûler. C'est après avoir été bluté qu'on le mouille. De ces parties mélangées, il vient une table de 85 à 87 livres ; d'où l'on voit que la calamine de Namur, jointe à celle de Lembourg, rapporte à-peu-près le quart du poids.
On connoît la valeur du cuivre rouge, on connoit la valeur du charbon, celle de la rosette ; ajoutez à ces frais ceux de la main-d'oeuvre & de batterie, & vous aurez le produit d'un fourneau.
Chaque fonderie ayant au-moins six fourneaux allumés, & chaque fourneau produisant ces deux tables, en vingt-quatre heures ; on aura douze tables par jour.
De l'évaporation qui se fait dans les fourneaux par l'action du feu, il se forme aux parois de la voûte contre la couronne & sur la surface des couvercles, un enduit qui se durcit, & qui dans la fracture montre plusieurs lits distincts de couleur jaune plus ou moins foncée : on l'appelle tutie. Les fondeurs lui attribuent deux propriétés ; l'une c'est de produite un beau cuivre très-malléable & très fin, si, réduite en poudre, on la substitue à la calamine. Mais il y en a si peu, que ce qu'on en détache est jetté au moulin & mêlé à la calamine. On parle encore d'une autre espece de tutie qui se fait dans les forges de fer, de couleur brune, mêlée d'un peu de jaune, qui produit le même effet avec la calamine ; mais on n'en use point : elle gâteroit le cuivre & le feroit gercer. La seconde propriété de la tutie du cuivre, c'est de soulager dans quelques maladies des yeux, si on les lave avec de l'eau de pluie où l'on en aura mis en poudre.
Les tables ordinaires varient depuis trois lignes jusqu'à quatre d'épaisseur ; ces dernieres sont les plus fortes qu'on puisse couper à la cisaille de la fonderie, encore faut-il mettre un homme de plus au levier.
Les lames qui déterminent l'épaisseur des tables, sont depuis deux jusqu'à quatre lignes. Dans les cas extraordinaires, on en met deux l'une sur l'autre.
Entre les tables extraordinaires, les plus fortes vont jusqu'à neuf lignes d'épaisseur ; elles ont les autres dimensions communes. Il faut cependant savoir qu'alors on emploie à une seule la matiere des trois fourneaux. Elles pesent depuis 255 jusqu'à 261 liv. Avant que de les couper à la cisaille, on les porte à la batterie pour les étendre.
S'il s'agit de jetter les tables à tuyaux de pompe, ou à fond de grandes chaudieres, on se sert de creusets de huit pouces de diametre en dedans. On en a deux qui rougissent dans les fourneaux six à sept heures avant qu'on jette. On y vuide la matiere des vingt-quatre creusets ; cela s'exécute avec la plus grande célérité : ensuite on jette un des creusets, puis l'autre ; mais à si peu d'intervalle entre ces jettées, qu'elles n'en font qu'une.
Quand on se propose de faire de ces grosses tables, on met un peu plus de cuivre de deux especes, & un peu moins de calamine.
Les tables jettées, on les coupe à la cisaille. La cisaille destinée à ce travail est plantée dans un corps d'arbre profondément enterré, comme on voit fig. 12 ; cet arbre est encore lié de gros cercles de fer : la cisaille qui n'y est retenue que par sa branche droite, peut se démonter ; l'autre branche coudée est engagée dans un levier de vingt piés de longueur, où son extrémité peut se mouvoir autour d'un boulon. La piece de bois emmortoisée où l'un des bouts du levier est reçu, est aussi fixée très-fermement ; l'autre bout du levier est tenu suspendu par un treuil. On conçoit l'action de cette machine à l'inspection du dessein. L'ouvrier A, dirige la table entre les lames de la cisaille ; les ouvriers b, b, b, poussant le levier c, d, font mouvoir la branche K & couper la cisaille. A mesure que la table se coupe, elle descend par son propre poids entre les lames de la cisaille.
Pour la distribution des tables relativement au poids, on a dans les fonderies des baguettes quarrées de six à sept lignes de large, sur lesquelles on trouve les mesures suivantes :
Le pié quarré de roi en table, pese douze livres & quelquefois douze livres & demie, lorsque les pierres ont des fentes, que l'enduit d'argille fléchit, & que la table vient d'épaisseur inégale.
Les intervalles des mesures des baguettes, sont sous-divisés en petites portées qui donnent la gradation des fourrures. J'expliquerai à l'article des batteries ce que c'est qu'une fourrure.
Il faut se rappeller que j'ai dit que les crasses qui provenoient des creusets contenoient beaucoup de cuivre ; qu'il s'en répandoit en transvasant ; qu'on en retrouvoit dans les cendres & poussieres qu'on jette dans les fosses pratiquées au-devant des fourneaux ; qu'on ne vuidoit ces fosses qu'à moitié ; que ce qui restoit servoit à asseoir le creuset qui l'étoit d'autant mieux, que la matiere est molle & continuellement chaude, & maintient le creuset ferme sur sa base & dans un état de chaleur.
Pour retirer de là le cuivre, on commence par mouiller le tas ; on en emplit deux mannes qu'on jette dans une grande cuve à demi-pleine d'eau : on remue le tout avec une pelle ou louchet ; on laisse reposer un instant, puis on prend une espece de poële percée de trous qui ont quatre à cinq lignes de diametre, on s'en sert pour retenir toutes les grosses ordures qui nagent, tandis que le cuivre pesant tombe au fond. Cela fait, on ajoûte deux autres mannes de cendres, & l'on réitere la même manoeuvre ; on enleve aussi avec les grosses ordures les grosses crasses : ensuite on incline le cuvier au-dessus d'un réservoir fait exprès, & l'on y verse la premiere eau bourbeuse : on passe la matiere restante par un crible à fil de laiton dont les ouvertures sont de deux lignes & demie ; il retient les grosses crasses, le reste tombe dans la cuve.
Ce n'est pas tout, on recharge le crible de matiere, & le trempant dans la cuve & le remuant à plusieurs reprises, les ordures passent dans l'eau. On change de tamis, on en prend un plus fin ; on opere avec le second tamis comme avec le premier, avec un troisieme, comme avec le second, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à retenir pures les parties crasseuses : c'est-là ce qu'on appelle l'arco. C'est dans cet arco que l'on choisit les dragées qui serviront à aiguiser les pierres des moules, ou à remplacer une portion de mitraille dans la fonte des tables.
Section IV. Des usines. Une usine est composée de différentes machines qui servent à travailler le cuivre après qu'il a été coulé en table. Il y en a de deux sortes ; les unes sont un assemblage de marteaux pour former toutes sortes d'ouvrages plats, comme tables de cuivre de toute épaisseur, toutes sortes d'ouvrages concaves, comme chaudieres, chauderons, &c. les autres sont des trifleries ou machines à mettre le laiton en fil. Les premieres s'appellent des batteries.
Des batteries. Pour établir une batterie, il faut avoir un courant d'eau qui fournisse un pié cube, & dont la chûte soit d'environ douze à treize piés. Avec cela on fera tourner quatre roues, dont deux serviront aux martinets, la troisieme à une meule, & la quatrieme à une triflerie. Il faut être à portée de fourrages pour les chevaux qu'on employera aux charrois des bois & des cuivres. Cette situation trouvée, il faut construire un grand bassin de retenue, semblable à ceux des moulins ordinaires, mais beaucoup plus étendu. Outre ce reservoir, il faut une seconde écluse de décharge, & un roulis pour le dégorgement dans les crues.
La muraille du reservoir tient au bâtiment de l'usine, & un second mur parallele au premier, forme l'enceinte où l'on place la roue. A l'endroit du mur qui soutient toute la hauteur de l'eau, on établit une écluse qui distribue l'eau dans une beuse qui fait tourner la roue. En un autre endroit on établit encore une beuse qui traverse le mur & porte l'eau sur une seconde roue ; cette beuse est faite de madriers de chêne bien assemblés ; elle est couverte jusqu'au lieu où il y a une écluse semblable à la premiere, que le maitre usinier peut gouverner au moyen d'un levier dont la suspension est en quelque point de l'épaisseur de la muraille qu'il traverse ; son bout fait en fourchette tient à la tige de la vanne, & son autre extrémité est tirée ou poussée de bas en haut par une gaule attachée en cet endroit par deux chaînons. Une troisieme beuse, mais beaucoup plus petite que les premieres, fait tourner une troisieme roue, à l'arbre de laquelle tient une meule qui sert, à raccommoder les marteaux & enclumes. Une quatrieme beuse met en mouvement la roue de la triflerie, située dans le même bâtiment, à l'extrémité.
On pratique une voûte par où l'eau de toutes les beuses s'écoule & va rejoindre le ruisseau.
L'arbre b c, d'une des roues porte à sa circonférence, fig. 13, trois rangées d, d, d, de douze mantonnets chacune ; ces mantonnets rencontrant les queues e, f, g, de trois marteaux h, i, k, les éleve ; mais à l'échappée de la dent, ils retombent sur l'enclume l, m, n.
L'enclume l, ou m, ou n, est enchâssée dans des ouvertures faites à des billots : ces billots sont des troncs d'arbres de chêne enfoncés de trois à quatre piés en terre cerclés de fer, & dont les têtes sont au niveau du terrein. Il y a autour d'eux un grand enfoncement commun où descendent les jambes des ouvriers assis sur les planches o, mises en travers de cet enfoncement.
Les manches des marteaux passent dans un collet de figure ovale, dont les tourillons sont soutenus par les montans qu'on voit dans la figure citée ; ces montans sont d'un pied en quarré solidement assemblés par le haut à un chapeau p q, & au niveau du terrein par une autre piece de la même solidité, sur laquelle sont attachées des pieces de fer plates, contre lesquelles donnent les queues des marteaux : ces pieces plates font la fonction de ressort, & doublent pour ainsi dire le coup du marteau, qu'elles renvoyent à son échappement.
Il faut appliquer à l'arbre A B tout ce que nous venons de dire de l'arbre R S, il n'y a de différence qu'en ce que l'un porte treize mantonnets sur chaque rangée.
Il faut observer que les mantonnets soient distribués à ne pas élever à-la-fois les trois marteaux ; ce qui employeroit une force immense en pure perte. Il faut que quand un des marteaux frappe, l'autre échappe & que le troisieme s'éleve. Pour cet effet on divisera la circonférence de l'arbre en autant de parties égales qu'il doit y avoir de mantonnets dans toutes les rangées ; ainsi, dans ce cas, en trente-six parties ; & l'on placera les mantonnets de la seconde rangée de maniere qu'ils répondent aux vuides de la premiere, & les mantonnets de la troisieme de maniere qu'ils répondent aux vuides de la seconde.
On voit à l'extrémité de la même Pl. IV. un fourneau : c'est-là qu'on recuit le cuivre à mesure qu'on le bat.
Les tourillons des arbres sont portés par des coussinets qui ne sont qu'à quinze pouces d'élevation audessus du niveau de l'usine, qui est élevée de six à sept piés au-dessus du terrein.
Ce sont des coffres qui s'appellent beuse, qui portent l'eau sur les aubes des roues. On lâche l'eau par des vannes, & les vannes sont toûjours proportionnées dans leurs levées à la quantité de marteaux qu'on fait travailler. Si l'on n'a à mouvoir que deux marteaux d'un poids médiocre, l'ouverture de l'écluse ne sera que de deux pouces six lignes. Si l'on a à mouvoir à-la-fois trois des plus gros marteaux, la levée de la vanne sera de quatre pouces six lignes. Il y a un chauderon percé de deux ou trois trous, suspendu au dessus des tourillons de l'arbre qu'il arrose de gouttes d'eau qui le rafraichissent : cette précaution est inutile du côté des roues ; elles sont toûjours mouillées & leurs tourillons aussi.
Le mantonnet en frappant la queue du marteau, la chasse devant lui, ensorte qu'ils se séparent immédiatement après le choc ; ainsi elle va porter avec force sur la piece plate qui la renvoie avec la même force.
Lorsque l'ouvrier veut arrêter son marteau, il a un bâton qu'il place sous le manche quand il s'éleve : alors le collier porte sur la plaque & le mantonnet n'engrene plus.
La queue du marteau est couverte d'une plaque recourbée, en s'arrondissant vers le mantonnet ; l'autre extrémité assujettie dessous le collier, est percée de deux trous dans lesquels on met des clous qui entrent dans une espece de coin chassé avec force entre la queue de cette plaque & le manche du marteau. On fait entrer ce manche dans un collier oval, où il est fixé par d'autres coins & calles de bois. Les tourillons de ce collier oval portent dans deux madriers verticaux, garnis à cet endroit d'une bande de fer percée à cet effet : ces madriers, qui ont quatre pouces six lignes d'équarrissage, se placent dans une entaille pratiquée au montant. Comme ils sont plus courts que l'entaille, on les resserre par des morceaux de bois ou des coins. Aussi l'on peut démancher les marteaux quand on le juge à propos.
Les montans dans l'intervalle desquels les marteaux se meuvent, ont deux pouces d'équarrissage ; ils sont assujettis par le chapeau en haut, à fleur de terre, par la traverse qui porte la piece plate, & dans la terre par une troisieme piece. Il est inutile de parler de ses appuis & de la maçonnerie solide qu'il faut pour fondement à un chassis aussi fort & qui fatigue autant. V. là-dessus l'art. Grosses Forges.
L'extrémité des manches des marteaux est un tenon d'une grandeur convenable.
Il y a deux sortes de marteaux. Des marteaux à bassin qui ne servent qu'à abattre les plates, c'est ainsi qu'on appelle les tables destinées à faire le fil de laiton, le plus petit pese 20 livres, & le plus gros 50. Entre ces deux limites, il y en a du poids de 23, 24, 26, 28 livres ; ils ont tous la même figure. La pointe de quelques-uns a quatre pouces de large. Il sert à battre les lames qui se couperont par filets pour faire le fil de laiton. Des marteaux qui ont assez la figure d'un bec de bécasse, & qu'on appelle marteaux à cuvelette, on bat avec ceux-ci les ouvrages concaves. Le plus petit est du poids de vingt-une livres, le plus gros du poids de trente-une ; il y en a d'autres intermédiaires : ceux de cette espece, dont la pointe est arrondie, servent aux petits ouvrages concaves.
Il y a aussi deux sortes d'enclumes ; les unes arrondies par un bout, pour les plates ; les autres quarrées, oblongues & plates, pour les concaves.
Ces enclumes sont fixées dans un enfoncement pratiqué au tronc d'arbre qui les supporte, avec des morceaux de bois resserrés par des coins.
On voit dans nos figures des ouvriers qui travaillent à trois sortes d'ouvrages ; l'un bat des plates qu'il tient des deux mains, les avançant peu-à-peu sous le marteau & parallelement, de maniere que le marteau frappe de toute sa surface. Quand le marteau a agi de cette maniere, l'ouvrier expose son ouvrage à ses coups, de maniere que ces seconds coups croisent les premiers.
Comme les ouvrages plats ont été coupés de maniere que posés les uns sur les autres ils forment une pyramide, & qu'ils se battent tous les uns autant que les autres ; après avoir passé sous le marteau, ils ont pris un accroissement proportionné, & leurs surfaces se surpassent après le travail de la même quantité dont elles se surpassoient auparavant.
Quand les plaques ou pieces plates ont été martelées deux fois, comme j'ai dit, on les recuit, en les rangeant sur la grille du fourneau, où l'on a allumé un feu clair qui dure ordinairement une heure & demie. Lorsque le cuivre est rouge, on laisse éteindre le feu, & l'on ne touche point aux pieces qu'elles ne soient refroidies. Le bois du feu à recuire est de saule ou de noisettier.
Les pieces plates étant refroidies, on les rebat & on les recuit de nouveau. Ces manoeuvres se réiterent jusqu'à ce qu'elles aient l'étendue & l'épaisseur requises. On acheve de les arrondir à la cisaille : la cisaille de cet attelier qu'on voit, même pl. n'a rien de particulier. C'est ainsi que l'on prépare une fourrure ; une fourrure est une pyramide de pieces battues plates, au nombre de 3 à 400, destinées à faire des chauderons qui, tous plus petits les uns que les autres, entreront les uns dans les autres quand ils seront achevés.
Pour cet effet on prend quatre de ces pieces plates, ou de ces plates tout court, pour parler comme les ouvriers. La plus grande a neuf lignes de diametre plus que les trois autres. On place celles-ci sur le milieu de la premiere dont on rabat le bord, ce qui contient les trois autres, & on les martele toutes quatre à-la-fois. On se sert dans cette opération de marteaux à cuvelette, d'enclumes plates, & propres à la convexité qu'on veut donner. Les chauderons se recuisent en se fabriquant, comme on a recuit les plates. Ce travail se mene avec tant d'exactitude, que tous les ouvrages se font de l'étendue rigoureuse que l'on se proposoit. Les fonds des chauderons se battent en calotte, & la cire n'est pas plus douce sous la main du modeleur, que le cuivre sous le marteau d'un bon ouvrier. La lame qu'on coupera pour le fil de laiton, n'a que quatre pouces de largeur, & ne se bat que d'un sens, sans croiser les coups.
Le morceau qui donne un chauderon de dix livres pesant, a 122 pouces 9 lignes de surface, sur 3 lignes d'épaisseur ; & le chauderon fait, a 20 pouces 8 lignes de diametre, 10 pouces 8 lignes de hauteur, sur un sixieme de ligne d'épaisseur ; ce qui, avec la surface du fond, forme 949 pouces & 1 ligne 9 points quarrés de surface. Il est vrai qu'à une sixieme de ligne d'épaisseur, la piece est foible ; mais il se fait des pieces qui le sont davantage, & qui durent. On ne comprend pas dans ce calcul la superficie des rognures ; mais c'est peu de chose ; la plate devient presque ronde en la travaillant. On n'en sépare à la cisaille que quelques coins. Ces rognures sont vendues au poids par l'usinier au maître fondeur, qui les remet à la fonte.
Lorsque les fourrures de chauderons ou d'autres ouvrages ont reçu leur principale façon aux batteries, on les rapporte à la fonderie, où on les finit, en effaçant au marteau les marques de la batterie, & en leur donnant le poli qu'elles peuvent prendre.
Dans presque toutes les fourrures il y a des pieces dont les parties ont été plus comprimées que d'autres, qui ont des pailles ou autres défauts ; desorte que quand on les déboîte, on en trouve de percées, & même en assez grand nombre. Voici comment on y remet des pieces.
On commence par bien nettoyer le trou, en séparant tout le mauvais cuivre & arrachant les bords avec des pinces quand la piece a peu d'épaisseur, ou les coupant à la cisaille quand la piece est forte ; ensuite on martele sur l'enclume les bords du trou, les rendant unis & égaux ; on a une piece de l'épaisseur convenable ; on l'applique au trou à boucher ; on prend une pointe, & suivant avec cette pointe les bords du trou, on trace sa figure sur la piece. A cette figure on en circonscrit sur la piece une pareille, qui l'excede d'environ deux lignes. On coupe la piece sur ce second trait ; on la dentelle sur toute sa circonférence, & les dents atteignent le premier trait. On replie ces dents alternativement & en sens contraire. On applique ainsi la piece au trou ; on rabat les dents qui serrent les bords du trou en dessus & en dessous ; on rebat sur l'enclume, & l'on soude le tout ensemble.
La soudure se fait d'une demi-livre d'étain fin d'Angleterre, de 30 livres de vieux cuivre & de 7 livres de zinc ; on fait fondre le mélange. Après la fusion on le coule par petites portions dans un vaisseau plein d'eau, qu'on remue afin d'occasionner la division. Cela fait on retire la soudure de l'eau, & on la pulvérise en la battant dans des mortiers de fer. On la passe pulvérisée par de petits cribles, qui en déterminent la finesse. Il en faut de différentes grosseurs, selon les différentes épaisseurs des ouvrages à souder.
Pour faire tenir la soudure sur les dents de la piece à souder, on en fait une pâte avec de l'eau commune, & partie égale de borax ; on en forme une traînée sur la dentelure ; on laisse sécher la traînée ; puis on passe la piece au feu, ou on la laisse jusqu'à ce que l'endroit à reboucher ait rougi.
Mais comme la couleur de la soudure differe de celle du cuivre, pour l'empêcher de paroître on a une eau rousse épaisse, faite de terre de potier & de soufre, détrempés avec de la biere, qu'on applique sur la soudure ; ensuite on remet au feu, qui rend au tout une couleur si égale, qu'il faut être du métier pour découvrir ce défaut, sur-tout après que l'ouvrage a été frotté avec des bouchons d'étoffe imbibés d'eau & de poussiere ramassée sur le plancher même de l'attelier. D'ailleurs, soit par économie, soit par propreté, soit pour pallier les défauts, après qu'on a battu les pieces on les passe au tour.
Ce tour n'a rien de particulier ; c'est celui des potiers d'étain. Deux poupées contiennent un arbre garni d'un rouet de poulie, sur laquelle passe une corde sans fin, qui va s'envelopper aussi sur une grande roue, qui se meut par une manivelle. Le bout de l'arbre qui tient à la poupée est en pointe ; l'autre bout porte un plateau rond & un peu concave, sur lequel on fixe le fond du chauderon par une piece destinée à cet usage, dont la grande barre est concave.
Les chauderons ou autres ouvrages ne manquent jamais par les soudures : les pieces n'y feroient de tort qu'en cas qu'on voulût les remarteler, alors la piece se sépareroit.
Voici comment on donne le dernier poli aux ouvrages de cuivre. Après avoir passé les ouvrages à polir par les marteaux de bois sur les enclumes de fer à l'ordinaire, de maniere qu'il n'y reste aucune trace grossiere ; on les met à tremper dans la lie de vin ou de biere, pour les dépouiller du noir qu'ils ont. Eclaircis par ce moyen, on les frotte avec le tripoli, puis avec la craie & le soufre réduits en poudre, & l'on finit avec la cendre des os de mouton. L'outil dont on se sert est une lissoire de fer, qu'on promene sur toutes les moulures & autres endroits.
Lorsqu'on a martelé & allongé une plate de cuivre en lame de 10 à 12 piés de longueur, sur quatre pouces de largeur, & un tiers ou quart de ligne d'épaisseur, on la coupe en filet pour faire le fil de laiton. Pour cet effet on se sert d'une cisaille affermie dans un soc profondément enfoncé en terre. Cet outil ne differe des cisailles ordinaires, qu'en ce qu'il a à l'extrémité de la branche fixée dans le soc, une pointe recourbée qui dépasse les tranchans, & qui s'éleve de 3 à 4 lignes au-dessus de la tête de la cisaille. Cette pointe a une tige qui traverse toute l'épaisseur de la tête ; & comme elle peut s'en approcher ou s'en éloigner, elle détermine la dimension du fil que l'on coupe.
Pour couper la bande de cuivre, l'ouvrier la jette dans la beuse, figure 18 ; car c'est ainsi qu'on appelle l'espece de boîte verticale qu'on voit dans la figure citée, qui embrasse la bande, la contient & la dirige. L'ouvrier tire la bande à lui, l'engage dans les tranchans de la cisaille, pousse une de ses branches du genou, & coupe. La branche qu'il pousse du genou est garnie d'un coussin. A mesure qu'il fait des filets, il les met en rouleau, comme on les voit figure 19.
S'il s'agissoit de mettre en filets une bande fort épaisse, on se serviroit d'un levier mobile horisontalement, & appliqué à la branche de la cisaille que l'ouvrier pousse du genou. On a des exemples de ce méchanisme dans l'attelier de fonderie que nous avons décrit plus haut, en parlant du debit des tables coulées.
Trifilerie. Cette partie de l'usine est à deux étages. Le premier est de niveau avec les batteries ; il y a une roue que l'eau fait mouvoir : cette roue n'a rien de particulier ; l'eau est portée sur elle par une beuse. A l'autre étage on voit un assemblage de charpente, composée de montans assemblés solidement par le bas dans une semelle de 11 pouces d'équarrissage, & par le haut à un sommier de plancher de 15 à 18 pouces d'équarrissage. Chacun de ces montans en a 12 ; ils sont percés d'une mortoise chacun, d'où partent autant de leviers mobiles autour d'un boulart qui les traverse, ainsi que les montans. Ils sont encore garnis de barres de fer, nécessaires au méchanisme & à la solidité. Vers le milieu de leur longueur, ces leviers posent sur des coussins de grosse toile, ou autre matiere molle, dont on garnit les petites traverses à l'endroit où elles reçoivent le choc des leviers quand ils sont tirés. Du reste, cette trifilerie n'a rien de différent de la trifilerie du fil de fer que nous avons décrite à l'article des grosses forges ; voyez cet article. C'est la même tenaille ; c'est le même mouvement ; c'est le même effet.
La roue a à mantonnets, figure 20, agit sur la traverse mobile b ; cette traverse b, en baissant, tire à elle la partie coudée e ; cette partie coudée e tire à elle les attaches de la tenaille g ; la tenaille h tirée serre le fil de laiton & l'entraîne à-travers les trous de la filiere K. Cependant le mantonnet de la roue a échappe ; le levier f agit, repousse la partie coudée e ; la partie coudée e repousse les attaches des branches de la tenaille, fait r'ouvrir la tenaille, avance la tête de cette tenaille jusques vers la filiere ; la roue a continue de tourner ; un autre mantonnet agit en b, qui retire la partie coudée e ; cette partie retire les attaches de la tenaille ; la tenaille se referme ; en se refermant elle resserre le fil ; le fil resserré est forcé de suivre & de passer par le trou de la filiere, & ainsi de suite.
Ce qui s'exécute d'un côté de la figure citée, s'exécute de l'autre. On multiplie les tenailles & les leviers à discrétion. On voit, figure 19, quatre leviers & autant de tenailles.
La figure 21 montre le méchanisme de la tenaille ; 1 est l'étrier qui entre dans le bout de la partie coudée ; 2 est le tirant de l'attache des branches de la tenaille ; 3 sont les attaches de ces branches ; 4 est la tenaille ; les parties latérales 5, 6 servent à diriger la tenaille dans ses allées & venues. Le reste est le détail desassemblé de la machine.
On voit à l'extrémité de l'attelier, planche 5 une espece de fourneau avec sa grille ; c'est-là qu'on fait recuire le fil de laiton lorsqu'il a passé aux filieres. La chaudiere contient du suif de Moscovie, pour graisser à chaud le fil coupé sur la plate, au premier tirage seulement.
La filiere 9, figure 19, est engagée dans deux crochets enfoncés dans l'établi. Il y a encore un étrier de fer contre lequel elle porte.
Il faut dans cet attelier un petit étau & des limes, pour préparer le bout du fil à passer par le trou de la filiere.
Il y a de plus une pelote de suif de Moscovie qui tient à la filiere du côté de l'introduction du fil, & qui le frotte sans-cesse.
Au reste, comme il faut que dans toutes les parties de cette machine le mouvement soit doux, on doit les tenir bien graissées.
On voit d'espace en espace derriere les filieres, des montans 10 avec des chevilles ; c'est-là qu'on accroche les paquets de fil de fer à mesure qu'ils se font.
Le plan sur lequel la tenaille est posée est incliné. Sur ce plan il y a deux portions de fil de fer en arc, qui détermine la quantité de son ouverture ; par cette précaution elle n'échappe jamais le fil de fer.
On voit, figure 22, la tenaille & ses attaches : c'est encore elle qu'on voit figure 23 ; a est son profil ; b, une piece quarrée où entre la queue de la tenaille, & qui dirige son mouvement entre les jumelles ; c, la clé qui arrête sa queue dans la piece quarrée.
La figure 24 est une piece qui s'ajuste aux attaches de la tenaille ; e, cette piece ; f & g, autres pieces d'assemblage.
On voit, figure 25. Pl. III. en A le dessus d'un fourneau ; en B la grille ; en C les creusets.
Les figures 26 & 27 sont les tours à creuset & à calotte.
Le reste, ce sont les différens instrumens de la fonderie dont nous avons parlé ; 1, etnet ou pince à ranger le creuset ; 2, 3, attrape ou pince ; 4, havet ; 5, bouriquet ; 6, palette ; 7, tenaille double ; 8, polichinelle ; 9, 10, 11, divers ringards ; 12, 13, pinces ; 14, 15, autres ringards ou fourgons ; 16, batte.
Voici l'état des échantillons qu'un naturaliste, qui visite une manufacture telle que celle que nous venons de décrire, se procurera ; 1, de la calamine brute, telle qu'on la tire de la mine ; 2, de la calamine calcinée & prête à être broyée ; 3, du cuivre rouge : 4, du vieux cuivre ; 4, de la tutie ; 5, du cuivre de l'épaisseur dont on coule les tables ; 6, du cuivre battu ; 7, de la terre à creuset brute, préparée & recuite.
Avant l'année 1595 on battoit tous les cuivres à bras ; en 1595 les batteries furent inventées. La premiere fut établie sur la Meuse. L'inventeur obtint pour sa machine un privilege exclusif. Cette machine renversoit les établissemens anciens des fondeurs & batteurs de cuivre ; car quoique ces martinets ne fussent pas en grand nombre, elle faisoit plus d'ouvrage en un jour que dix manufacturiers ordinaires n'en pouvoient faire en dix jours. Les fondeurs & batteurs anciens songerent donc à faire révoquer le privilége ; pour cet effet ils assemblé tous leurs ouvriers avec leurs femmes & leurs enfans ; & à la tête de cette multitude, vêtue de leurs habits de travail, ils allerent à Bruxelles, se jetterent aux piés de l'Infante Isabelle, qui en eut pitié, accorda une récompense à l'inventeur des batteries, & permit à tout le monde de construire & d'user de cette machine.
Il n'y a pas deux partis à prendre avec les inventeurs de machines utiles ; il faut, ou les récompenser par le privilége exclusif, ou leur accorder une somme proportionnée à leur travail, aux frais de leurs expériences, & à l'utilité de leur invention ; sans quoi il faut que l'esprit d'industrie s'éteigne, & que les arts demeurent dans un état d'engourdissement. Le privilege exclusif est une mauvaise chose, en ce qu'il restraint du moins pour un tems les avantages d'une machine à un seul particulier, lorsqu'ils pourroient être étendus à un grand nombre de citoyens, qui tous en profiteroient.
Un autre inconvénient, c'est de ruiner ceux qui s'occupoient, avant l'invention, du même genre de travail, qu'ils sont forcés de quitter ; parce que leurs frais sont les mêmes, & que l'ouvrage baisse nécessairement de prix : donc il faut que le gouvernement acquiere à ses dépens toutes les machines nouvelles & d'une utilité reconnue, & qu'il les rende publiques : & s'il arrive qu'il ne puisse pas faire cette dépense, c'est qu'il y a eu & qu'il y a encore quelque vice dans l'administration, un défaut d'économie qu'il faut corriger.
Ceux qui réfléchissent ne seront pas médiocrement étonnés de voir la calamine, qu'ils prendront pour une terre, se métalliser en s'unissant au cuivre rouge, & ils ne manqueront pas de dire, pourquoi n'y auroit-il pas dans la nature d'autres substances propres à subir la même transformation en se combinant avec l'or, l'argent, le mercure ? Pourquoi l'art n'en prépareroit-il pas ? Les prétentions des Alchymistes ne sont donc pas mal fondées.
Il n'y a pas plus de 5 ou 6 ans que ce raisonnement étoit sans réponse ; mais on a découvert depuis que la calamine n'étoit qu'un composé de terre & de zinc ; que c'est le zinc qui s'unit au cuivre rouge, qui change sa couleur & qui augmente son poids, & que le laiton rentre dans la classe de tous les alliages artificiels de plusieurs métaux différens.
Si le cuivre rouge devient jaune par l'addition de la calamine, c'est que le zinc est d'un blanc bleuâtre, & qu'il n'est pas difficile de concevoir comment un blanc bleuâtre fondu avec une couleur rouge, donne un jaune verdâtre, tel qu'on le remarque au laiton.
La merveille que les ignorans voyent dans l'union de la calamine au cuivre rouge, & les espérances que les Alchymistes fondent sur le zinc, s'évanouissent donc aux yeux d'un homme un peu instruit.
|
| LAITRON | S. m. (Hist. nat. Bot.) sonchus, genre de plante à fleur, composée de demi-fleurons, portés chacun sur un embryon, & soutenus par un calice épais qui prend une figure presque conique en meurissant. Dans la suite les embryons deviennent des semences garnies d'aigrettes & attachées à la couche. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Des 13 especes de laitrons de Tournefort, ou des 15 de Boerhaave, j'en décrirai deux générales, qui sont les plus communes, & qui d'ailleurs sont employées en Medecine, le laitron rude ou épineux, & le laitron doux ou uni.
Le laitron rude ou épineux est appellé sonchus asper par Gérard & autres ; sonchus asper, laciniatus par Tournefort J. R. H. 474 ; sonchus minor, laciniosus, spinosus par J. B. 2. 1026 ; en anglois the prickly sow-thistle.
Sa racine est fibreuse & blanchâtre ; sa tige est creuse, angulaire, cannelée, haute d'environ deux piés & chargée de feuilles, dont les plus basses sont longues, roides, dentelées par les bords, d'un verd foncé, luisantes, garnies d'épines, piquantes. Les feuilles qui croissent sur la tige, & qui l'environnent pour ainsi dire, ont deux oreilles rondelettes, & sont moins coupées que les feuilles inférieures. Ses fleurs croissent en grand nombre au sommet de la tige ; elles sont composées de demi-fleurons, & ressemblent à celles de la dent de lion, mais elles sont plus petites & d'un jaune plus pâle. La partie inférieure des pétales est panachée de pourpre. Elles sont placées dans des calices écailleux & longuets. Elles dégénerent en un duvet, qui contient des semences menues & un peu applaties.
Le laitron doux ou uni, que le vulgaire appelle laceron doux, palais de lievre, se nomme en Botanique, sonchus laevis, sonchus laciniatus, latifolius, sonchus laciniatus, non spinosus ; en anglois, the smooth sow-thistle.
Elle pousse une tige à trois piés de haut, creuse, tendre & cannelée. Ses feuilles sont unies, lisses & sans piquans, dentelées dans leurs bords, remplies d'un suc laiteux, rangées alternativement, les unes attachées à de longues queues, & les autres sans queues. Ses fleurs naissent aux sommités de la tige & des branches par bouquets à demi-fleurons, jaunes, quelquefois blancs. Quand ces fleurs sont passées, il leur succede des fruits, qui renferment de petites semences oblongues, brunes, rougeâtres, garnies chacune d'une aigrette.
Ces deux laitrons fleurissent en Mai & Juin ; ils croissent par-tout, dans les blés, dans les vignobles, sur les levées & le long des chemins. Ils rendent, quand on les broye, un suc laiteux & amer. Ils contiennent un peu de sel, semblable à l'oxysal diaphorétique de sala, dissous dans beaucoup de soufre ; d'où vient que les Medecins attribuent à ces plantes des propriétés adoucissantes, rafraîchissantes & modérement fondantes ; mais les jardiniers curieux les regardent comme des herbes pullulantes, nuisibles, qui prennent par-tout racine, à cause de leurs semences à aigrettes ; desorte qu'ils ne cessent de les arracher de leurs jardins pour les donner au bétail, lequel s'en accommode à merveille. (D.J.)
LAITRON, (Mat. med.) laitron ou laceron doux, palais de lievre ; laitron ou laceron épineux, & petit laitron ou terre-crêpe. Ces plantes sont comptées parmi les rafraîchissantes destinées à l'usage intérieur. Elles sont peu d'usage. (b)
|
| LAITUE | S. f. (Hist. nat. Bot.) lactuca, genre de plante à fleur, composée de plusieurs demi-fleurons, portés chacun sur un embryon, & soutenus par un calice écailleux, grêle & oblong. L'embryon devient dans la suite une semence garnie d'une aigrette. Ajoûtez aux caracteres de ce genre le port de la plante entiere. Tournefort, Inst. rei herbariae. Voyez PLANTE.
Le mot de laitue, en françois comme en latin, vient du suc laiteux que cette plante répand, quand on la rompt. Tournefort compte 23 especes de laitues, & Boerhaave 55, dont la plûpart sont cultivées, & les autres sont sauvages.
La laitue que l'on cultive & que l'on forme, est très-variée en grosseur, en couleur, ou en figure. Elle est blanche, noire, rouge, pommée, crépue, lisse, découpée. De-là vient le nombre étendu de ses différentes especes, entre lesquelles il y en a trois principales d'un usage fréquent, soit en aliment, soit en guise de remede ; savoir, 1°. la laitue ordinaire qui n'est point pommée, lactuca sativa, non capitata, des Botanistes ; 2°. la laitue pommée, lactuca capitata ; 3°. la laitue romaine, lactuca romana, dulcis.
La laitue commune, qui n'est point pommée, a la racine ordinairement longue, annuelle, épaisse & fibreuse. Ses feuilles sont oblongues, larges, ridées, lisses, d'un verd-pâle, remplies d'un suc laiteux, agréable quand elle commence à grandir, & amer quand elle vieillit. Sa tige est ferme, épaisse, cylindrique, branchue, feuillée, haute d'une coudée & demie, & plus. Ses rameaux sont encore divisés en d'autres plus petits, chargés de fleurs, & écartés en maniere de gerbes. Ses fleurs sont composées de plusieurs demi-fleurons, jaunâtres, portés sur des embryons, & renfermés dans un calice écailleux, foible, oblong, & menu ; quand ces fleurs sont passées, il leur succede de petites semences garnies d'aigrettes, pointues par les deux bouts, oblongues, applaties, cendrées. On la seme dans les jardins.
La laitue pommée a les feuilles plus courtes, plus larges, plus rondes à l'extrémité que celles de la laitue ordinaire, plates, lisses, & formant bientôt une tête arrondie de la même maniere que le choux. Sa graine est semblable à celle de la précédente, mais noire. On seme cette laitue pendant toute l'année dans les potagers. On l'arrache quand elle est encore tendre, & on la transplante dans des terres bien fumées. Par-là ses feuilles deviennent plus nombreuses, & mieux pommées. Quand elle est panachée de blanc, de pourpre & de jaune, on l'appelle laitue panachée ou laitue de Silésie, lactuca sativa, maxima, Austriaca, capitata, variegata, I. R. H. 473.
La laitue romaine, dite chicons par le vulgaire, a la feuille plus étroite & plus longue, plate, sans rides & sans bosselures, peu sinuée, & garnie en-dessous de petites épines le long de la côte. Sa fleur & sa tige sont semblables à celles de la laitue ordinaire ; mais ses graines sont noires. On lie ensemble ses feuilles avec de la paille, quand elles grandissent, ce qui les rend très-blanches & plus tendres que les autres.
Les Botanistes connoissent aussi plusieurs sortes de laitues sauvages ; l'ordinaire, nommée simplement lactuca sylvestris, a la racine plus courte & plus petite que celle de la laitue cultivée. Ses feuilles sont placées sans ordre ; elles sont oblongues, mais petites, étroites, sinuées & découpées profondément des deux côtés, armées d'épines un peu rudes le long de la côte qui est au-dessous, & remplies d'un suc laiteux. Sa tige est au moins haute d'une coudée, elle est épineuse à son commencement, & partagée à son sommet en plusieurs petits rameaux, chargés de petites fleurs jaunes semblables à celles de la laitue des jardins. Quand ces fleurs sont tombées, il leur succede des semences garnies d'aigrettes & noirâtres. On trouve cette laitue dans les haies, sur les bords des chemins, dans les vignes & les potagers ; elle fleurit en Juin & Juillet. Elle est d'usage en Medecine, & paroît plus détersive que la laitue cultivée ; son suc est hypnotique.
Il est fort surprenant que la laitue, plante aqueuse & presque insipide, donne dans l'analyse une si grande quantité de sel urineux, qu'on en tire davantage que de beaucoup d'autres plantes bien plus savoureuses. Son sel essentiel nitreux se change presque tout, par le moyen du feu dans la distillation, en un sel alkali, soit fixe, soit volatil.
Au reste, les laitues ont toujours tenu le premier rang parmi les herbes potageres ; les Romains en particulier en faisoient un de leurs mets favoris. D'abord ils les mangeoient à la fin du repas ; ensuite, sous Domitien, cette mode vint à changer, & les laitues leur servirent d'entrée de table. Elles sont agréables au goût, elles rafraîchissent, humectent, fournissent un chyle doux, délayé, fluide ; elles moderent l'acrimonie des humeurs par leur suc aqueux & nitreux. En conséquence, elles conviennent aux tempéramens bilieux, robustes & resserrés. Auguste, attaqué d'hypocondrie, se rétablit par le seul usage des laitues, d'après le conseil de Musa son premier medecin, à qui le peuple romain, dit Suétone, fit dresser pour cette cure une belle statue auprès du temple d'Esculape.
Les Pythagoriciens croyoient que les laitues éteignoient les feux de l'amour ; c'est pourquoi Callimaque assure que Venus, après la mort d'Adonis, se coucha sur un lit de laitues pour modérer la violence de sa passion ; & c'est par la même raison qu'Eubalus le comique appelle cette herbe la nourriture des morts. (D.J.)
LAITUE, (Jardinage) la culture de cette plante, dont il se fait une si grande consommation, a été épuisée en France par la Quintinie, Chomel, Liger, l'auteur de l'Ecole du potager, &c. & en Angleterre par Bradley & Miller ; nous y renvoyons les curieux.
Nous remarquerons seulement que la graine de toutes sortes de laitues est aisée à recueillir, mais l'embarras est de l'avoir bonne. Il faut d'abord préférer celle des laitues qui ont été semées de bonne-heure au printems, ou qui ont passé l'hiver en terre. Quand vos laitues montent en fleurs, on choisit les piés dont on veut avoir la graine ; on les accôte les uns après les autres tout debout contre les lattes des contre-espaliers, où on les laisse bien mûrir & dessécher ; ensuite on les coupe, & on les étend sur un gros linge, dans un lieu sec, pour faire encore ressécher les graines. On bat la plante quand la graine est bien seche, on la nettoye de sa bâle, on la serre dans un endroit où les souris & la vermine n'ayent point d'accès, en mettant chaque espece de graine à part. Malgré ces précautions, il arrive souvent que les graines bien recueillies, bien choisies, sans mélange, bien séchées, bien conservées, dégénerent si on les reseme dans le même jardin où elles ont été recueillies ; c'est pourquoi il faut avoir un correspondant assuré, qui recueille comme vous tous les ans la graine dont vous avez besoin, & en faire un échange avec lui ; tous les deux y trouveront leur avantage. Cette derniere observation mérite l'attention des Fleuristes, qui doivent sur-tout la mettre en pratique pour les fleurs qu'ils cultivent. (D.J.)
LAITUE, (Diete & Mat. med.) on connoît assez les usages dietetiques des différentes especes de laitues que nous cultivons dans nos jardins : on les mange en salade, on les fait entrer dans les potages & dans plusieurs ragoûts ; on sert encore la laitue cuite à l'eau & convenablement assaisonnée sous différentes viandes rôties.
La laitue est fade & très-aqueuse ; elle fournit donc un aliment peu stimulant qui convient par conséquent aux estomacs chauds & sensibles ; par une suite des mêmes qualités, elle doit rafraîchir, tenir le ventre libre, disposer au sommeil, &c. surtout lorsqu'on la mange crue & en grande quantité, comme les gens du peuple le font presque journellement à Paris pendant l'été : car il est bien difficile d'évaluer l'effet de quelques feuilles de laitue mangées en salade dans un repas composé de différens mets. La laitue cuite mangée avec le potage ou avec les viandes, ne peut presque être regardée que comme une espece d'éponge chargée de jus ou de bouillon.
Ses propriétés medicinales se réduisent aussi à rafraîchir & à relâcher, ou, ce qui est la même chose, la laitue est vraiment diluante & émolliente. Voyez DILUANT & ÉMOLLIENT.
C'est à ce titre qu'on fait entrer ses feuilles dans les bouillons & les apozemes rafraîchissans, dans les lavemens émolliens & relâchans, dans les décoctions émollientes destinées à l'usage extérieur, dans les cataplasmes, &c.
Les Medecins ont observé depuis long-tems une vertu narcotique dans les laitues. Galien rapporte que dans sa vieillesse il ne trouva point de meilleur remede contre les insomnies, auxquelles il fut sujet, que de manger des laitues le soir, soit crues, soit bouillies.
Le même auteur avance que le suc exprimé de laitue, donné à la dose de deux onces, est un poison mortel, quoique les feuilles prises en une beaucoup plus grande quantité qu'il n'en faut pour en tirer ce suc, ne fassent aucun mal. Cette prétention, que les Medecins ont apparemment divulguée, car elle est en effet fort connue, est démentie par l'expérience.
Les laitues ont passé pour diminuer la semence & le feu de l'amour ; on les a accusées aussi d'affoiblir la vûe si l'on en faisoit trop d'usage ; mais ce sont encore ici des erreurs populaires.
Les semences de laitue, qui sont émulsives, sont comptées parmi les quatre semences froides mineures. Voyez SEMENCES FROIDES.
On conserve dans les boutiques une eau distillée de laitue qui n'est bonne à rien. Voyez EAUX DISTILLEES.
Les feuilles de laitue entrent dans l'onguent populeum ; ses semences dans le syrop de jujube, dans celui de tortue & dans le requies Nicolai. (b)
|
| LAJAZZE | ou LAJAZZO, (Géog.) ville de la Turquie asiatique, dans la Caramanie, aux confins de la Syrie, près du mont Néro, sur la côte septentrionale du golfe de même nom, assez près de son embouchure, à six lieues de l'ancien Issus ; mais son golfe reste toûjours le même que l'Issicus sinus des anciens. Ce golfe est dans la Méditerranée, entre la Caramanie & la Syrie, entre Adana & Antioche. (D.J.)
|
| LAKA | (Géogr.) ville d'Espagne dans la Castille vieille, sur la riviere d'Arianza.
|
| LALA | S. m. (Hist. mod.) titre d'honneur que donnent les sultans aux visirs & à un grand de l'empire. Suivant son étymologie, il signifie tuteur, parce qu'ils sont les gardiens & les tuteurs des freres du sultan. Voyez Cantemir, hist. othomane.
|
| LALAND | Lalandia, (Géog.) petite île du royaume de Danemark, dans la mer Baltique ; elle est très-fertile en blé. Elle n'a aucune ville, mais seulement quelques lieux fortifiés, comme Naxchow, Parkoping, Nysted. Cette île a huit milles d'orient en occident, & cinq du nord au sud. Longit. 29. 20-55. lat. 54. 48-53. (D.J.)
|
| LALETANI | (Géog. anc.) ancien peuple d'Espagne, qui faisoit partie de la Catalogne d'aujourd'hui, & occupoit Barcelone, & ses environs. (D.J.)
|
| LALLUS | S. m. (Hist. anc. Mytholog.) nom d'une divinité des anciens qui étoit invoquée par les nourrices pour empêcher les enfans de crier, & les faire dormir. C'est ce que prouve un passage d'Ausone :
Hic iste qui natus tibi
Flos flosculorum Romuli,
Nutricis inter lemmata
Lallique somniferos modos
Suescat peritis fabulis
Simul jocari & discere.
Peut-être aussi n'étoient-ce que des contes ou des chansons qu'on faisoit aux petits enfans pour les faire dormir. Voyez Ephemérides natur. curios. Centuria V. & VI.
|
| LALONDE | S. f. (Hist. nat. Bot.) espece de jassemin de l'île de Madagascar. Il a les feuilles plus grandes que celui d'Europe ; il croit en arbrisseau, sans ramper ni s'attacher à d'autres arbres. Sa fleur répand une odeur merveilleuse.
|
| LAMA | S. m. (terme de Relation.) Les lamas sont les prêtres des Tartares asiatiques, dans la Tartarie chinoise.
Ils font voeu de célibat, sont vêtus d'un habit particulier, ne tressent point leurs cheveux, & ne portent point de pendans d'oreilles. Ils font des prodiges par la force des enchantemens & de la magie, récitent de certaines prieres en maniere de choeurs, sont chargés de l'instruction des peuples, & ne savent pas lire pour la plûpart, vivent ordinairement en communauté, ont des supérieurs locaux, & audessus de tous, un supérieur général qu'on nomme le dalai-lama.
C'est-là leur grand pontife, qui leur confere les différens ordres, décide seul & despotiquement tous les points de foi sur lesquels ils peuvent être divisés ; c'est, en un mot, le chef absolu de toute leur hiérarchie.
Il tient le premier rang dans le royaume de Tongut par la vénération qu'on lui porte, qui est telle que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux, & que l'empereur de la Chine reçoit ses ambassadeurs, & lui en envoie avec des présens considérables. Enfin, il s'est fait lui-même, depuis un siecle, souverain temporel & spirituel du Tibet, royaume de l'Asie, dont il est difficile d'établir les limites.
Il est regardé comme un dieu dans ces vastes pays : l'on vient de toute la Tartarie, & même de l'Indostan, lui offrir des hommages & des adorations. Il reçoit toutes ces humiliations de dessus un autel, posé au plus haut étage du pagode de la montagne de Pontola, ne se découvre & ne se leve jamais pour personne ; il se contente seulement de mettre la main sur la tête de ses adorateurs pour leur accorder la rémission de leurs péchés.
Il confere différens pouvoirs & dignités aux lamas les plus distingués qui l'entourent ; mais dans ce grand nombre, il n'en admet que deux cent au rang de ses disciples, ou de ses favoris privilégiés ; & ces deux cent vivent dans les honneurs & l'opulence, par la foule d'adorateurs & de présens qu'ils reçoivent de toutes parts.
Lorsque le grand lama vient à mourir, on est persuadé qu'il renaît dans un autre corps, & qu'il ne s'agit que de trouver en quel corps il a bien voulu prendre une nouvelle naissance ; mais la découverte n'est pas difficile, ce doit être, & c'est toujours dans le corps d'un jeune lama privilégié qu'on entretient auprès de lui ; & qu'il a par sa puissance désigné son successeur secret au moment de sa mort.
Ces faits abrégés, que nous avons puisés dans les meilleures sources, doivent servir à porter nos réflexions sur l'étendue des superstitions humaines, & c'est le fruit le plus utile qu'on puisse retirer de l'étude de l'Histoire. (D.J.)
LAMA, (Géog. anc.) ancienne ville de la Lusitanie, au pays des Vettons, selon Ptolomée, liv. II. chap. v. Quelques-uns croient que c'est Lamégal, village de Portugal, dans la province de Trallos-mortes, à 7 lieues nord de Guarda. (D.J.)
|
| LAMANAGE | S. m. (Marine) c'est le travail & la manoeuvre que font les matelots ou mariniers pour entrer dans un port & dans une riviere, ou pour en sortir, sur-tout lorsque l'entrée en est difficile.
|
| LAMANEUR | S. m. (Marine) pilote lamaneur, Locman. Ce sont des pilotes pratiques des ports & des entrées des rivieres, qui y font leur résidence, & que l'on prend pour l'entrée & la sortie de ces endroits, lorsqu'on ne les connoît pas bien, ou qu'il y a des dangers ou des bancs qu'il faut éviter. L'ordonnance de la marine de 1681, liv. IV. tit. III. traite des pilotes lamaneurs, de leurs fonctions, de l'examen qu'ils doivent subir avant d'être reçus, de leurs salaires, de leurs privileges, & des peines auxquelles ils sont condamnés, si par ignorance ou par méchanceté ils avoient causé la perte d'un bâtiment, qu'ils seroient chargés de conduire. Voici comme l'ordonnance s'explique à ce sujet, art. xviij. " Les lamaneurs qui par ignorance auront fait échouer un bâtiment, seront condamnés au fouet, & privés pour jamais du pilotage ; & à l'égard de celui qui aura malicieusement jetté un navire sur un banc ou rocher, ou à la côte, il sera puni du dernier supplice, & son corps attaché à un mât planté près le lieu du naufrage ".
|
| LAMANTIN | manati, s. m. (Hist. nat.) animal amphibie, qui a été mis au nombre des poissons par plusieurs naturalistes, & qui a été regardé comme un quadrupede par ceux qui l'ont mieux observé. Cet animal a beaucoup de rapport à la vache marine, & au phoca ou veau de mer ; il paroit qu'il doit passer comme eux pour quadrupede. Le lamantin a depuis dix jusqu'à quinze piés de longueur, & même davantage, & six ou sept piés de largeur ; il pese depuis soixante-dix jusqu'à cent ou deux cent livres ; on prétend même qu'il s'en trouve du poids de neuf cent livres. La tête est oblongue, ronde ; elle a quelque ressemblance avec celle d'un boeuf ; mais le muffle est moins gros, & le menton est plus épais ; les yeux sont petits ; il n'y a que de petits trous à l'endroit des oreilles ; les levres sont grandes ; il sort de la bouche deux dents longues d'un ampan, & grosses comme le pouce ; le col est très-gros & fort-court ; cet animal a deux bras courts, terminés par une sorte de nageoire composée comme une main de cinq doigts qui tiennent les uns aux autres par une forte membrane, & qui ont des ongles courtes : c'est à cause de ces sortes de mains que les Espagnols ont appellé cet animal manates ou manati ; il n'y a aucune apparence de piés à la partie postérieure du corps qui est terminée par une large queue. Les lamantins femelles ont sur la poitrine deux mammelles arrondies ; celles d'un individu long de quatorze piés neuf pouces, avoient sept pouces de diametre, & quatre pouces d'élévation ; le mamelon étoit long de deux ou trois pouces d'élévation, & avoit un pouce de diametre. Les parties de la génération ressemblent à celles des autres quadrupedes, & même à celles de l'homme & de la femme. La peau du lamantin est épaisse, dure, presqu' impénétrable, & revêtue de poils rares, gros, & de couleur cendrée ou mêlée de gris & de brun.
Cet animal broute l'herbe commune & l'algue de mer sur les bords de l'eau sans en sortir ; on prétend qu'il ne peut pas marcher, & qu'étant engagé dans quelque anse, d'où il ne puisse pas sortir avec le reflu, il demeure sur le sable, sans pouvoir s'aider de ses bras ; d'autres assurent qu'il marche, ou au moins qu'il se traîne sur la terre ; il jette des larmes ; il se plaint lorsqu'on le tire de l'eau ; il a un cri, il soupire ; c'est à cause de cette sorte de lamentation qu'il a été appellé lamantin ; ce gémissement est bien différent du chant : cependant on croit que cet animal a donné lieu à la fable des sirènes : lorsqu'il porte ses petits entre ses bras, & qu'on le voit hors de l'eau avec ses mammelles & sa tête, on pourroit peut-être y appercevoir quelques rapports avec la figure chimérique des sirènes. Le lamantin aime l'eau fraîche ; aussi ne s'éloigne-t-il guere des côtes ; on le trouve à l'embouchure des grandes rivieres, en divers lieux de l'Afrique, dans la mer rouge, dans l'île de Madagascar, à Manaar près de Ceylan, aux îles Moluques, Philippines, Lucayes, & Antilles, dans la riviere des Amazones ; au Bresil, à Surinam, au Pérou, &c. Cet animal est timide ; il s'apprivoise facilement ; ses principaux ennemis sont le crocodile & le requin : il porte ordinairement deux petits à-la-fois ; lorsqu'il les a mis bas, il les approche de ses mammelles avec ses bras ; ils se laissent prendre avec la mere, lorsqu'elle n'a pas encore cessé de les nourrir. La chair du lamantin est très-bonne à manger, blanche & fort saine : on la compare pour le goût à celle du veau, mais elle est plus ferme ; sa graisse est une sorte de lard qui a jusqu'à quatre doigts d'épaisseur, on en fait des lardons & des bardes pour les autres viandes ; on le mange fondu sur le pain comme du beurre ; il ne se rancit pas si aisément que d'autres graisses ; on trouve dans la tête du lamantin, quatre pierres de différentes grosseurs, qui ressemblent à des os : elles sont d'usage en Medecine.
On tue le lamantin tandis qu'il paît sur le bord des rivieres ; lorsqu'il est jeune, il se prend au filet. Dans le continent de l'Amérique, lorsque les pêcheurs voient cet animal nager à fleur d'eau, ils lui jettent depuis leur barque ou leur canot, des harpons qui tiennent à une corde menue mais forte. Le lamantin étant blessé, s'enfuit : alors on lâche la corde à l'extrémité de laquelle est lié un morceau de bois ou de liege, pour l'empêcher d'être submergée entierement, & pour en faire appercevoir le bout : le poisson ayant perdu son sang & ses forces, aborde au rivage. Voyez l'Hist. nat. des animaux, par MM. Arnauld de Nobleville, & Salerne, tom. V. Voyez QUADRUPEDE.
|
| LAMAO | (Géog.) petite île de l'Océan oriental, à 4 lieues de la côte de la Chine ; elle est dans un endroit bien commode, entre les trois grandes villes de Canton, de Thieuchen, & de Chinchen. (D.J.)
|
| LAMBALE | (Géog.) petite ville de France dans la haute-Bretagne, chef-lieu du duché de Penthievre, au diocèse de Saint Brieux, à cinq lieues de cette ville, & à quinze de Rennes. long. 15. 4. lat. 48. 28.
C'est au siege de Lambale en 1591, que fut tué le fameux François de la Noue, surnommé Bras-de-fer ; il eut le bras fracassé d'un coup de canon en 1570, à l'action de Fontenay ; on le lui coupa, & on lui en mit un postiche de ce métal. La Noue étoit tout ensemble le premier capitaine de son tems, le plus humain & le plus vertueux. Ayant été fait prisonnier en Flandres en 1580, après un combat desespéré, les Provinces-unies offrirent pour son échange le comte d'Egmont, le comte de Champigni, & le Baron de Selles ; mais plus ils témoignoient par cette offre singuliere l'idée qu'ils avoient du mérite de la Noue, moins Philippe II. crut devoir acquiescer à son élargissement ; il ne l'accorda que cinq ans après, sous condition qu'il ne serviroit jamais contre lui ; que son fils Téligny, alors prisonnier du duc de Parme, resteroit en ôtage, & qu'en cas de contravention, la Noue payeroit cent mille écus d'or. Général des troupes, il n'avoit pas cent mille sols de bien. Henri IV. par un sentiment héroïque, répondit pour lui, & engagea pour cette somme les terres qu'il possédoit en Flandres. Les ducs de Lorraine & de Guise voulurent aussi par des motifs de politique, devenir caution de ce grand homme ; il a laissé des mémoires rares & précieux. Amyraut a donné sa vie ; tous les Historiens l'ont comblé d'éloges ; mais personne n'en a parlé plus souvent, plus dignement, & avec plus d'admiration que M. de Thou. Voyez le, si vous êtes encore sensible au noble récit des belles choses. (D.J.)
|
| LAMBDA | S. m. (Gramm.) Voyez l'art. L.
|
| LAMBDOIDE | adj. mas. en Anatomie, est le nom que l'on donne à la troisieme suture propre du crâne, parce qu'elle a la figure d'un lambda grec. Voyez SUTURE.
On la nomme quelquefois par la même raison, ypsiloïde, comme ayant quelque ressemblance avec l'upsilon grec. Voyez UPSILOÏDE.
On appelle angle lambdoïde, une apophyse de l'os des tempes, qui forme une partie de cette suture.
|
| LAMBEAU | S. m. (Gramm. & Art. méchaniq.) morceau d'étoffe déchirée. Mettre en lambeaux, c'est déchirer. Voyez les art. suiv.
LAMBEAU, (Chapelier) c'est un morceau de toile neuve & forte, qui est taillée en pointe, de la forme des capades, & que l'on met entre chacune, pour les empêcher de se joindre, ou, comme ils disent, de se feutrer ensemble, tandis qu'on les bastit, pour en former un chapeau. C'est proprement le lambeau qui donne la forme à un chapeau, & sur lequel chaque capade se moule. Voyez CHAPEAU & nos fig.
LAMBEAU, terme de Chasse, c'est la peau velue du bois de cerf qu'il dépouille, & qu'on trouve au pié du freouer.
|
| LAMBEL | S. m. (Blason) espece de brisure la plus noble de toutes ; elle se forme d'un filet qui se place ordinairement au milieu & le long du chef de l'écu, sans qu'il touche ses extrémités. Sa largeur doit être de la neuvieme partie du chef ; il est garni de pendans qui ressemblent au fer d'une coignée, ou plûtôt aux gouttes de la frise de l'ordre dorique, qu'on voit sous les triglyphes. Quand il y a plus de trois pendans, il en faut spécifier le nombre. Il y en a quelquefois jusqu'à six dans les écus de cadets. Le lambel distingue les cadets des ainés.
|
| LAMBESC | (Géog.) en latin moderne, lambescum, petite ville de France en Provence, à 4 lieues d'Aix. Long. 23. 7. lat. 43. 32. (D.J.)
|
| LAMBESE | lambaesa, (Géog. anc.) ancienne ville d'Afrique dans la Numidie, dont Antonin & Ptolomée parlent plus d'une fois ; elle étoit un des siéges épiscopaux du pays. Il s'y tint un concile vers l'an 240 de J. C. Baudrand dit que c'est une ville de Barbarie, au royaume d'Alger & de Constantine, sur la riviere de Suffegmar ; il la nomme lambesca. (D.J.)
|
| LAMBITIF | adj. terme de Pharmacie, qui n'est pas fort en usage ; il signifie un médicament qu'on prend en séchant au bout d'un bâton de réglisse.
C'est la même chose que ce qu'on appelle autrement linetus, looch, & éclegme. Voyez LOOCH.
|
| LAMBOURDES | S. f. (Jardinage) ce sont de petites branches, maigres, longuettes, de la grosseur d'un fétu, plus communes aux arbres à pepin, qu'aux fruits à noyaux. Ces branches ont des yeux plus gros & plus serrés que les branches à bord, & jamais elles ne s'élevent droit comme elles, mais toujours sur les côtés, & en maniere de dard. On peut dire que les lambourdes sont les sources fécondes des fruits ; c'est d'elles principalement que naissent les bons boutons. La coutume est de les casser par les bouts, à dessein de les décharger, & de peur qu'elles n'aient à nourrir par la suite un trop grand nombre de boutons à fruit qui avorteroient.
LAMBOURDES, (Charpente) ce sont des pieces de bois que l'on met le long des murs & le long des poutres, sur des corbeaux de bois, de fer ou de pierre pour soutenir les bouts des solives lorsqu'elles ne portent point dans les murs ni sur les poutres. Voyez nos fig.
|
| LAMBREQUIN | S. m. terme de Blason, les lambrequins sont des volets d'étoffes découpés, qui descendant du casque, coëffent & embrassent l'écu pour lui servir d'ornement. Quelques-uns disent lamoquin, d'autres lambequin, & il y en a qui croient que le mot de lambrequin est venu de ce qu'ils pendoient en lambeaux ; & étoient tout hachés des coups qu'ils avoient reçus dans les batailles. Ceux qui sont formés de feuillages entremêlés les uns dans les autres, sont tenus plus nobles que ceux qui ne sont composés que de plumes naturelles. Le fond & le gros du corps des lambrequins doivent être de l'émail du fond & du champ de l'écu ; mais c'est de ses autres émaux qu'on doit faire leurs bords. Les lambrequins étoient l'ancienne couverture des casques, comme la cotte d'armes étoit celle du reste de l'armure. Cette espece de couverture préservoit les casques de la pluie & de la poudre, & c'étoit par-là que les chevaliers étoient reconnus dans la mêlée. On les faisoit d'étoffe, & ils servoient à soutenir & à lier les cimiers qu'on faisoit de plumes. Comme ils ressembloient en quelque façon à des feuilles d'acanthe, quelques-uns les ont appellés feuillards ; on les a mis quelquefois sur le casque en forme de bonnet, élevé comme celui du doge de Venise, & leur origine vient des anciens chaperons qui servoient de coëffure aux hommes & aux femmes. Voyez le dictionnaire de Trévoux & nos pl. de Blason.
|
| LAMBRIS | S. m. (Archit.) mot général qui signifie en terme de maçonnerie, toutes sortes de plat-fonds & ouvrages de maçonnerie, dont on revêt les murailles sur des lattes ; car encore que le mot de lambris se prenne particulierement pour ce que les Latins appellent lacunar, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la tête ; il désigne aussi tout enduit de plâtre soutenu par des lattes, formant des cloisons.
On appelle encore lambris, en terme de menuiserie, tout ouvrage de menuiserie dont on revêt les murs d'un appartement, tant par les côtés, que dans le platfond.
Il est bon de savoir à ce sujet, que quand on attache les lambris contre les poutres & les solives, il faut laisser du vuide ou des petits trous, pour que l'air y passe, & qu'il empêche que du bois appliqué contre de l'autre bois, ne s'échauffe ; car il peut arriver des accidens par les lambris attachés aux planchers contre les solives ou poutres, que la pesanteur du bois fait affaisser, ou qui viennent à dépérir & à se gâter, sans que l'on s'en apperçoive.
On dore, on peint, on vernisse, on enrichit de tableaux les lambris de nos appartemens. On en faisoit de même à Rome ; mais les lambris dorés ne s'y introduisirent qu'après la destruction de Carthage. On commença sous la censure de Lucius Mummius par dorer ceux du capitole ; ainsi de la dorure des lambris de nos chapelles, nous sommes venus à celle de nos cabinets ; enfin les termes de luxe se sont multipliés sur ce sujet avec les ouvrages qui s'y rapportent.
On appelle donc lambris d'appui, le lambris qui n'a que deux, trois ou quatre piés dans le pourtour d'une piece.
Lambris de revêtement, designe un lambris qui prend depuis le bas jusqu'au haut.
Lambris de demi-revêtement, est celui qui ne passe pas la hauteur de l'attique de la cheminée, & audessus duquel on met de la tapisserie.
Lambris feint, est un lambris de couleur, fait par compartimens, qui imitent un véritable lambris.
Lambris de marbre, est un revêtement par divers compartimens de marbre, qui est ou à rase, c'est-à-dire sans saillie, comme aux embrasures des croisées de Versailles ; ou avec des saillies, comme à l'escalier de la reine du même château. On fait de tels lambris de trois hauteurs, comme dans la menuiserie.
Le mot lambris, vient, selon les uns, de ambrices, qui dans Festus signifie des lattes ; selon Ménage, de imbrex, une tuile, en y ajoutant l'article ; & selon le P. Pezron, du celtique lambrusq, qui désigne un panneau de menuiserie, fait pour revêtir les murs d'un appartement. Le lecteur peut choisir entre ces trois étymologies. (D.J.)
|
| LAMBRO | LE, (Géog.) Lambras dans Pline, riviere d'Italie dans la Lombardie au Milanez. Elle a sa source près de Pescaglio, entre le lac de Côme & le lac de Lecco, entre dans le Lodésan, & se perd dans le Pô, à sept milles au-dessus du Pont de Plaisance. (D.J.)
|
| LAME | S. f. (Gramm.) se dit en général de toute portion de métal, plate, longue, étroite & mince. Voyez aux articles suivans différentes acceptions de ce mot.
LAMES inférieures du nez, (Anatom.) c'est la même chose que ce qu'on nomme les cornets inférieurs du nez.
Presque tous les anatomistes font des lames inférieures du nez, deux os spongieux particuliers de la tête, roulés en maniere de coquille, un dans chaque narine, & formant dans quelques sujets par un jeu de la nature, une continuité avec l'os ethmoïde ; mais ce n'est point par un jeu de la nature que les cornets inférieurs du nez forment une continuité avec l'os ethmoïde, c'est qu'ils en sont réellement une portion, & que par conséquent on peut les retrancher du nombre des os, qu'on compte ordinairement dans la tête.
Comme les lames osseuses qui font leur union avec l'os ethmoïde, ou avec l'os unguis, ou avec l'os maxillaire, sont très-minces & très-fragiles, on les casse presque toujours, & d'autant plus facilement qu'ils sont retenus avec l'os maxillaire par leur apophyse en forme d'oreille, qui est engagée dans le sinus maxillaire.
Les cornets inférieurs se soudent avec l'os du palais, & ensuite avec l'os maxillaire ; mais cette union ne les doit pas faire regarder comme faisant partie de l'un ou de l'autre de ces os : presque tous les os qui se touchent, s'unissent & se soudent ensemble avec l'âge, les uns plutôt, les autres plus tard. Une piece osseuse peut être regardée comme un os particulier, lorsque dans l'âge où les os sont bien formés, on ne trouve point entr'elles & les pieces voisines une continuité non interrompue d'ossification.
Pour avoir un os ethmoïde auquel les cornets inférieurs restent attachés, il n'y a qu'à choisir une tête où ces cornets ne soient point encore soudés avec les os du palais & les os maxillaires ; on ouvrira le sinus maxillaire par sa partie externe, & on détruira le bord de l'os maxillaire, sur lequel l'oreille du cornet inférieur est appliquée ; pour ne point en même tems détacher le cornet de l'os ethmoïde, il faut un peu d'adresse & de patience, & avec cela ne réussira-t-on pas toujours.
L'oreille du cornet étant ainsi dégagée, on ôte l'os maxillaire qui suit ordinairement l'os du palais & le cornet reste attaché à l'os ethmoïde.
Au reste, il n'est pas besoin de cette préparation si l'on veut seulement s'assurer de la continuité des lames spongieuses inférieures avec l'os ethmoïde ; il ne faut que consulter des têtes où il n'y a rien de détruit, on verra presque toujours que du bord supérieur de chaque cornet inférieur, s'éleve une lame qui va s'attacher à l'os ethmoïde ; & lorsque les cornets inférieurs sont séparés de l'os ethmoïde, on apperçoit sur leur bord supérieur, de petites éminences osseuses qui ne paroissent être que les restes de la lame rompue. (D.J.)
LAME D'EAU, (Hydr.) est, à proprement parler, un jet applati, tel qu'en vomissent les animaux qui accompagnent les fontaines. Ces jets applatis sont de vrais parallélogrammes. Voyez JET-D'EAU. (K)
LAME, (Marine) Ce sont les flots ou vagues que la mer pousse les uns contre les autres ; il y a des côtes le long desquelles la mer forme des lames si grosses, qu'il est très-difficile d'y pouvoir débarquer sans courir le risque de voir les chaloupes renversées ou remplies par ces lames. On dit la lame vient de l'avant ou de l'arriere, c'est-à-dire, que le vent pousse la vague contre l'avant ou contre l'arriere du vaisseau. La lame vient du large, la lame prend par le travers, c'est-à-dire que les vagues ou les flots donnent contre le côté du vaisseau.
La lame est courte, se dit lorsque les vagues de la mer se suivent de près les unes des autres.
La lame est longue lorsque les vagues se suivent de loin & lentement.
LAME à deux tranchans, (Ardois.) le corps du marteau dont les couvreurs se servent pour couper l'ardoise.
LAME, (Boutonnier) c'est de l'or ou de l'argent, trait fin ou faux, qu'on a battu & applati entre deux rouleaux d'acier poli, pour le mettre en état d'être facilement tortillé ou filé sur un brin de soie ou de fil.
Quoique l'or & l'argent en lame soit presque toujours destiné à être filé sur la soie ou le fil, on ne laisse pas que d'en employer sans être filé dans la fabrique de quelques étoffes & rubans, & même dans les broderies, dentelles, galons & autres ouvrages semblables pour les rendre plus riches & plus brillans.
LAMES, (Soieries) partie du battant. Ce sont, dans le métier à fabriquer des étoffes, des planches de noyer de cinq à six pouces de large, d'un pouce d'épaisseur, pour soutenir & porter le dessus du battant au moyen d'une mortaise juste & bien chevillée, pratiquée de chaque côté. Le dessus du battant ou la poignée a également une mortaise de chaque côté, dans laquelle elle entre librement pour laisser la facilité de la lever & baisser, quand on veut sortir le peigne. Voyez BATTANT. Il y a aussi une partie qu'on appelle porte-lame. Voyez METIER EN SOIE, à l'article SOIERIE.
LAME, (Fourbisseur) on appelle ainsi la partie des épées, des poignards, des bayonnettes & autres armes offensives, qui perce & qui tranche. On dit aussi la lame d'un couteau, la lame d'un rasoir, pour exprimer la partie de ces ustensiles de ménage qui coupe ou qui rase. Toutes ces sortes de lames sont d'acier très-fin, ou du moins d'acier moyen. Les lames des armes se font par les fourbisseurs, & celles des couteaux par les couteliers. Voyez FOURBISSEUR & COUTELIER.
La bonne qualité d'une lame d'épée est d'être bien pliante & bien évidée : on en fait à arrête, à dos & à demi-dos.
Les lames de damas & d'Angleterre sont les plus estimées pour les étrangers, & celles de Vienne en Dauphiné pour celles qu'on fabrique en France.
Voyez les différentes sortes de lames & leur profil, au bas de la planche du Fourbisseur au moulin.
LAMES, CONTRE-LAMES, terme de manufacture, ce sont, dans les métiers des faiseurs de gaze, trois tringles de bois qui servent à tirer ou baisser les lisses, c'est pourquoi on les appelle aussi tirelisses. Voyez GAZE.
LAME signifie en général parmi les Horlogers une petite bande de métal, un peu longue & fort mince ; mais elle s'entend particulierement de la bande d'acier trempé mince & fort longue, dont est formé le grand ressort d'une montre ou d'une pendule. Cependant lorsque ce ressort est dans le barillet, ils regardent alors chacun de ses tours comme autant de lames. C'est en ce sens qu'ils disent que les lames d'un ressort ne doivent point se frotter, lorsqu'il se débande. Voyez RESSORT.
LAME, en terme de Lapidaire, n'est autre chose qu'une lame de couteau, dont l'ébaucheur se sert pour hacher sa roue.
LAMES, (à la monnoie) ce sont des bandes minces de métal, soit d'or, d'argent ou de billon, formées & jettées en moule d'une épaisseur conséquente à l'espece de monnoie que l'on veut fabriquer.
Les lames, avant de passer au coupoir, sont ébarbées, dégrossies, recuites & laminées.
LAMES les, (Rubanier) ce sont de petites barres de bois que les marches font baisser par le moyen de leurs lacs ; elles sont plates & enfilées par leur tête dans deux broches ou boulons de fer qui traversent leur chassis, qui est lui-même couché & arrêté sur les traverses du métier ; leur usage est de faire hausser la haute-lisse, au moyen de leurs tirans qui redescendent ensuite par le poids de la platine, lorsque l'ouvrier quitte la marche qu'il enfonçoit ; il y en a autant que de marches. Voyez MARCHES.
LAME PERCEE, (Rubanier) est une barre étroite & mince comme une lame, voyez LAMES, attachée par les deux bouts dessus ou dessous les deux barres de long du métier à frange ; cette lame fixe est percée de plusieurs trous, pour donner passage aux tirans des lisettes ; ces tirans, au nombre de deux (puisqu'il n'y a que deux lisettes), ont chacun un noeud juste à l'endroit où ils doivent s'arrêter dessus la lame percée ; ces noeuds n'empêchent pas que ces tirans ne puissent baisser, lorsqu'ils sont tirés par les marches, mais bien de remonter au-delà d'eux, sans quoi le bandage de derriere & qui les fait mouvoir, entraîneroit tout à lui.
LAME, (Tapissier) c'est cette partie du métier de basselissier, qui est composée de plusieurs petites ficelles attachées par haut & par bas à de longues tringles de bois, appellées liais. Chacune de ces ficelles, que l'on nomme lisse, a sa petite boucle dans le milieu faite de la même ficelle, ou son petit anneau de fer, de corne, d'os, de verre ou d'émail, à travers desquels sont passés les fils de la chaîne de la piece que l'on veut fabriquer.
LAME, (Tireur d'or) les Tireurs d'or appellent ainsi de l'or ou de l'argent trait fin ou faux, qu'on a battu ou écaché entre deux petits rouleaux d'acier poli, pour le mettre en état de pouvoir être facilement tortillé ou filé sur de la soie ou du fil de chanvre ou de lin.
Quoique l'or & l'argent en lame soient presque toujours destinés à être filés sur la soie ou sur le fil, on ne laisse pas cependant d'en faire entrer de non-filé dans la composition de quelques étoffes, même de certaines broderies, dentelles & autres semblables ouvrages, pour les rendre plus brillantes & plus riches. Voyez OR.
LAME, chez les Tisserands & autres ouvriers qui travaillent avec la navette, signifie la partie de leur métier, qui est faite de plusieurs petites ficelles attachées par les deux bouts à de longues tringles de bois, appellées liais.
Chacune de ces ficelles, appellées lisses, a dans son milieu une petite boucle de la même corde, ou un petit anneau de fer, d'os &c, à-travers desquels sont passés les fils de la chaîne de la toile que l'on veut travailler.
Les lames, qui sont suspendues en l'air par des cordes passées dans des poulies au haut du métier des deux côtés, servent par le moyen des marches qui sont en bas, à faire hausser & baisser alternativement les fils de la chaîne, entre lesquels on glisse la navette, pour porter successivement le fil de la trame d'un côté à l'autre du métier.
LAMES, au jeu de trictrac, certaines marques longues terminées en pointes, & tracées au fond du trictrac. Il y en a vingt-quatre : elles sont blanches & vertes, ou d'autres couleurs opposées ; c'est sur ces lames qu'on fait les cases. On les appelle encore fleches ou languettes. Voyez l'art. TRICTRAC.
|
| LAMÉ | adj. (Ourdissage) il se dit de tout ouvrage où l'on a employé la lame d'or ou d'argent. On dit lamé d'or & lamé d'argent.
|
| LAMÉGO | (Géog.) en latin Lameca ou Lamacum, ville de Portugal dans la province de Beira, entre Coimbre & Guarda, à 26 lieues S. E. de Brague, 50 de Lisbonne. Les Arabes l'ont conquise deux fois sur les Chrétiens ; elle est aujourd'hui le siege d'un évêque, a une petite citadelle & plusieurs privileges. Long. 10. 18. latit. 44. 1. (D.J.)
|
| LAMENTATION | (Gram.) c'est une plainte forte & continuée ; la plainte s'exprime par le discours ; les gémissemens accompagnent la lamentation ; on se lamente dans la douleur, on se plaint du malheur. L'homme qui se plaint, demande justice ; celui qui se lamente, implore la pitié.
LAMENTATION FUNEBRE, (Littérat.) en latin lassum, terme générique, qui désigne les cris de douleurs, les plaintes, les gémissemens qu'on répandoit aux funérailles chez plusieurs peuples de l'antiquité.
Diodore de Sicile nous apprend qu'à la mort des souverains en Egypte toute la face du pays étoit changée, & que l'on n'entendoit de toutes parts, à leurs pompes funebres, que des gémissemens & des lamentations.
Cette même coutume régnoit chez les Assyriens & les Phéniciens, au rapport d'Hérodote & de Strabon. De-là viennent ces fêtes lugubres des femmes d'Egypte & de Phénicie, où les unes pleuroient leur dieu Apis, & les autres se désoloient sur la perte d'Adonis. Voyez ADONIS.
Les Grecs imiterent une pratique qui convenoit si bien à leur génie. On sait assez tout ce que les poëtes ont chanté des lamentations de Thétis, à la mort de son fils Achille ; & des voyages des muses en habit de deuil à Lesbos, pour y assister aux funérailles & y faire leurs lamentations. Mais c'est certainement à cet usage des lamentations funebres qu'il faut rapporter l'origine de l'élegie.
Enfin la flûte accommodée aux sanglots de ces hommes & de ces femmes gagées, qui possédoient le talent de pleurer sans affliction, fit un art ingénieux des lamentations, qui n'étoient auparavant ni liées ni suivies. Elle en donna le signal, & en régla le ton.
Cette musique ligystale, expressive de la douleur, consola les vivans en même tems qu'elle honora les morts. Comme elle étoit tendre & pathétique, elle remuoit l'ame, & par les mouvemens qu'elle lui inspiroit, elle la tenoit tellement occupée, qu'il ne lui restoit plus d'attention pour l'objet même, dont la perte l'affligeoit. Il n'est peut-être point de plus grand secret pour charmer les amertumes de la vie. (D.J.)
LAMENTATIONS, (Théolog.) on donne ce nom à un poëme lugubre, que Jérémie composa à l'occasion de la mort du saint roi Josias, & dont il est fait mention dans le second livre des Paralipomenes, chap. xxxv. v. 25. On croit que ce fameux poëme est perdu, mais il nous en reste un autre du même prophete, composé sur la ruine de Jérusalem par Nabuchodonosor.
Ces lamentations contiennent cinq chapitres, dont les quatre premiers sont en vers acrostiches & abecedaires ; chaque verset ou chaque strophe commençant par une des lettres de l'alphabet hébreu, rangées selon son ordre alphabétique. Le premier & le second chapitre contiennent vingt-deux versets, suivant le nombre des lettres de l'alphabet. Le troisieme a trois versets de suite, qui commencent par la même lettre ; il y a en tout soixante-six versets. Le quatrieme est semblable aux deux premiers, & n'a que vingt-deux versets. Le cinquieme n'est pas acrostiche.
Les Hébreux donnent au livre des lamentations le nom d'echa du premier mot du texte, ou de kinnoth, lamentationes. Les Grecs les appellent , qui signifie la même chose en leur langue. Le style de Jérémie est tendre, vif, pathétique. C'étoit son talent particulier que d'écrire des choses touchantes.
Les Hébreux avoient coutume de faire des lamentations ou des cantiques lugubres à la mort des grands hommes, des princes, des héros qui s'étoient distingués dans les armes, & même à l'occasion des malheurs & des calamités publiques. Ils avoient des recueils de ces lamentations, comme il paroit par les Paralipomenes, ecce scriptum fertur in lamentationibus, c. xxxv. v. 25. Nous avons encore celles que David composa à la mort d'Abner & de Jonathas. Il semble par Jérémie qu'ils avoient des pleureuses à gage ; comme celles qu'on nommoit chez les Romains, Praeficae, vocate lamentatrices & veniant... festinent & assumant super nos lamentum, c. xix. v. 16. Calmet, Diction. de la Bibl. Voyez DEUIL, ÉLEGIE, FUNERAILLES, &c. (G)
|
| LAMÉTIA | (Géog. anc.) ancienne ville de l'Italie, dans la grande Grece, au pays des Brutiens ; Cluvier croit que Lamétia est Santa Euphemia ; mais Holstenius prétend que c'est l'Amanthéa ; le promontorium Lametum est le capo Suvaro. La riviere Lametus est le Lamato ou l'Amato. (D.J.)
|
| LAMETTES | S. f. (Soierie) ce sont, dans le métier de l'ouvrage en étoffes de soie, de petites lames de bois, d'une ligne d'épaisseur, servant à soutenir les carreaux des lisses qui passent entre les carquerons ou calquerons, & qui s'usent moins que la corde.
|
| LAMIA | (Géog. anc.) ville de Thessalie, en Phthiotide ; elle est principalement mémorable par la bataille qui se donna dans son territoire, après la mort d'Alexandre, entre les Athéniens secourus des autres Grecs, & Antipater Gouverneur de la Macédoine. Le succès de cette journée fut très-funeste aux Athéniens, & à plusieurs autres villes de la Grece, comme il paroît par le récit de Diodore de Sicile, liv. XVIII. & de Pausanias, liv. VII. Il en résulte que Suidas, au mot , se trompe quand il dit qu'Antipater perdit la bataille. (D.J.)
|
| LAMIAQUE, GUERRE | (Hist. ancienne) guerre entreprise par les Grecs ligués ensemble, à l'exception des Béotiens, contre Antipater ; & c'est de la bataille donnée près de Lamia, que cette guerre tira son nom. Voyez LAMIA. (D.J.)
|
| LAMIE | (Hist. nat.) Voyez REQUIN.
|
| LAMIER | S. m. (Art méchan.) ouvrier qui prépare la lame d'or & d'argent pour le manufacturier en étoffes riches.
|
| LAMIES | S. f. pl. Lamiae, (Mythol. littér.) spectres de la fable qu'on représentoit avec un visage de femme, & qu'on disoit se cacher dans les buissons, près des grands chemins, pour dévorer les passans. On leur donna ce nom du mot grec , qui signifie voracité ; hormis qu'on aime mieux adopter le sentiment de Bochart, qui tire de Lybie la fable des Lamies, & qui donne à ce mot une étymologie phénicienne, dont le sens est le même que celui de l'étymologie greque.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que de tout tems & en tout pays, on a inventé de pareilles chimeres, dont les nourrices, les gouvernantes, & les bonnes femmes, se servent comme d'un épouvantail pour faire peur à leurs enfans, les empêcher de pleurer, ou les appaiser. C'est une coutume d'autant plus mauvaise, que rien n'est plus capable d'ébranler ces petits cerveaux, si tendres & si flexibles, & d'y produire des impressions de frayeur dont ils se ressentent malheureusement toute leur vie.
Lucilius se moque en très-beaux vers de la frayeur de l'homme, qui parvenu à l'âge de raison, ajoûte encore foi à ces sortes d'êtres imaginaires.
Terricula Lamias Fauni quas, Pompiliique
Instituere Numae ; tremit has, hîc omnia ponit,
Ut pueri infantes credunt signa omnia ahena
Vivere....
" Et toutes les effroyables Lamies que les Faunus & les Numa Pompilius ont inventées, il les craint. Il croit que tous ses maux & ses biens dépendent d'elles, comme les petits enfans croyent que toutes leurs poupées & toutes les statues sont vivantes "
La Fontaine a renchéri sur cette pensée de Lucile, dans cette strophe de son ingénieuse fable, le statuaire & la statue de Jupiter :
L'artisan exprima si bien
Le caractere de l'idole,
Qu'on jugea qu'il ne manquoit rien
A Jupiter que la parole.
Même l'on dit que l'ouvrier
Eut à peine achevé l'ouvrage,
Qu'on le vit frémir le premier,
Et redouter son propre ouvrage, &c.
Mais le commencement de cette fable est d'une toute autre beauté, & peut-être la Fontaine n'a rien fait de si fort. (D.J.)
LAMIES (dents de), lamiodontes, (Hist. nat. Minéral.) nom donné par quelques naturalistes à des dents de poissons que l'on trouve pétrifiées dans le sein de la terre, & que l'on croit communément avoir appartenu à des chiens de mer ou lamies. Ces dents varient pour la forme & pour la grandeur ; elles sont ordinairement triangulaires, mais on en trouve aussi qui sont très-aiguës. On en rencontre en Bearn au pié des Pyrénées, près de Dax, qui ont près de deux pouces de longueur. M. Hill dit qu'il y en a qui ont jusqu'à cinq & six pouces de longueur ; il y en a qui sont unies par les côtés, d'autres sont dentelées comme une scie. Voyez GLOSSOPETRES. (-)
|
| LAMINAGE | S. m. (Art méchanique) c'est l'action & la maniere de réduire en lames, par le moyen d'une machine appellée laminoir. Il se dit particulierement de l'or, de l'argent & du plomb. Voyez les articles suivans.
|
| LAMINIUM | (Géog. anc.) ancienne ville de l'Espagne chez les Carpétaniens, selon Ptolomée, liv. II. cap. vj. c'est à présent Montiel.
Laminium donnoit à son territoire le nom de Laminitanus ager ; ce canton s'appelle aussi présentement Campo de Montiel. (D.J.)
|
| LAMINOIR | S. m. à la Monnoie, est un instrument qui a pour objet de réduire les lames au sortir des moules à une épaisseur conséquente à la monnoie que l'on veut fabriquer. Voyez Planches du Monnoyage, le manege dont l'arbre & la grande roue reçoivent leur mouvement par quatre chevaux. La fig. 2. représente le laminoire du dégrossi en H, & le laminoir simple en I ; A, est le gros arbre qui fait tourner la grande roue B ; C, C, sont les lanternes ; D, le hérisson ; E, l'arbre du hérisson ; F, F, les arbres des lanternes ; G, G, les boîtes dans lesquelles sont attachés les rouleaux du dégrossi.
La fig. 3. est le laminoir du dégrossi. A, est le conduit par lequel passent les lames ; B, la boîte ; C, C, les rouleaux ; D, D, les ressorts qui maintiennent les écrous. Fig. 4. A, est le laminoir d'après le dégrossi ; B, B, sont les rouleaux ; C, C, les pignons qui font tourner les rouleaux ; D, D, les conduits ; F, F, les vis avec les écrous.
LAMINOIR, (plomb.) machine qui sert à laminer le plomb ; c'est-à-dire à le réduire en table de telle épaisseur que l'on veut.
Avant de décrire cette machine, il convient d'expliquer ce qui concerne la fonderie particuliere à l'attelier du laminoir. On fond le plomb dans une chaudiere de fer fondu monté sur un fourneau de mâçonnerie de brique représenté dans la vignette de la seconde Planche du laminoir. Voyez aussi l'article PLOMBIER. Ce fourneau A, élevé d'environ 4 ou 5 piés, est accompagné de côté & d'autre d'un petit escalier C, composé de 4 à 5 marches, par lesquelles on peut monter sur les paliers D, d'où les ouvriers peuvent voir & travailler dans la chaudiere qui n'est élevée que de trois piés ou environ au-dessus des paliers g. C'est-là où les ouvriers se placent pour charger ou écumer la chaudiere ; au-devant du fourneau est placée une forte table V R K G, avec ses rebords. C'est sur cette table remplie de sable que l'on coule le plomb ; pour cet effet, on commence par dresser le sable avec un rable ou rateau ; on l'unit ensuite avec les plaques de cuivre dont on se sert comme d'un fer à repasser ; on observe de former une espece d'anse du côté du gruau ; ce qui se fait en formant un arrondissement dans le sable du côté opposé au fourneau, & en plaçant une grosse cheville de fer un peu conique dans le sable & au centre de l'arrondissement dont on a parlé. Cette cheville que l'on repousse après que la table est coulée & refroidie, sert à y reserver un trou, au moyen duquel & du gruau P R S, on enleve facilement la table de plomb de dessus la forme de sable pour la porter sur l'établi du laminoir, comme on le voit dans la même vignette ; Q, la table de plomb ; N, l'anse & le crochet par lequel elle est suspendue.
Pour couler la table, on commence après que la quantité de plomb suffisante est en fusion dans la chaudiere, par faire écouler ce métal dans un auge G K, aussi long que la forme de sable H est large (cet auge peut contenir 3500 livres de métal) ; ce qui se fait en lâchant au robinet la bonde de fer A, par laquelle le plomb coule du fond de la chaudiere sur une feuille de taule placée au-dessous du chevalet 1, 2, dans l'auge G K, où on le laisse un peu rafraîchir, jusqu'à ce que par exemple, un rouleau de papier soit seulement roussi & non pas enflammé par la chaleur du plomb fondu ; alors il est tems de verser : ce qui se fait en tirant les chaînes suspendues aux extrémités a a des leviers a b, qui par leurs extrémités b b, enlevent & versent le plomb contenu dans l'auge G K ; sur la forme H, bien établie de niveau ; précaution essentielle, pour que les tables de plomb ayent par-tout la même épaisseur, qui est d'environ 18 lignes. On laisse refroidir la table que l'on enleve ensuite au moyen de la grue tournante Q P, en faisant entrer le crochet N, pendant à la moufle inférieure, dans le trou reservé au-devant de la table.
Description du laminoir. Le laminoir est composé de deux cylindres ou rouleaux A A, B B, de fer fondu de 5 piés de long, non compris les tourillons. Ces cylindres ont un pié de diametre, & pesent chacun deux mille huit cent livres. Leur situation est horisontale, & ils sont placés en-travers & vers le milieu de l'établi du laminoir, comme on voit fig. 1. Planche I. du laminoir. Cet établi est composé d'un chassis A B, C I, d'environ 56 piés de long, sur six de large, élevé au-dessus du rez-de-chaussée d'environ trois piés où il est soutenu par différentes pieces de charpente, comme A Z, A m, assemblées dans le patin z m ; le dessus est rempli de rouleaux de bois A I, de cinq pouces de diametre, dont les tourillons de fer entrent dans des trous pratiqués aux faces inférieures des longs côtés du chassis dont on ne voit qu'une portion dans la figure. C'est sur ces rouleaux que la table glisse pendant l'opération du laminer. Les rouleaux A A, B B, fig. 2. & 3, A A, le rouleau supérieur ; B B, l'inférieur qui n'en differe point ; A, les tourillons de sept à huit pouces de diametre ; a la partie quarrée qui est reçue dans la boîte C C, de l'arbre C G, dont voici le détail des parties ; C C, la boîte quarrée, dans laquelle le tenon quarré a, du rouleau inférieur entre ; b, un tourillon ; d, une virole ou assiette contre laquelle la face u, de la lanterne D, vient s'appuyer ; E, partie quarrée, sur laquelle le dormant du verrouil est placé ; la place qu'il occupe est représentée par des lignes ponctuées : ce quarré est inscrit au cercle de la partie arrondie D, qui reçoit le canon m u, de la lanterne D, fig. 7. F, partie arrondie qui reçoit le canon o p, de la lanterne, F, fig. 7. G, autre tourillon ; le cercle de la partie F, est inscrit au quarré de la partie E, pour laisser le passage libre au dormant du verrouil, représenté dans les fig. 4. & 5. & le quarré est inscrit au cercle D, afin que le canon u m, de la petite lanterne, puisse passer sur cette partie. On place donc ces trois pieces, les deux lanternes, fig. 7. & le porte verrouil, fig. 4. & 5. en les faisant entrer sur l'arbre par l'extrémité G, premierement la lanterne D, ensuite le porte verrouil, & en dernier lieu la lanterne F.
Cet arbre de la proportion des parties duquel on peut juger par l'échelle jointe aux figures, ainsi que des rouleaux & des canons u m, o p, qui sont au centre des lanternes, & le porte-verrouil, sont tous de fer fondu. On fait les moules de toutes ces pieces avec différens calibres & de la même maniere que ceux des pieces d'Artillerie. Voyez CANON & FONDERIE EN FER.
Voici maintenant comment le mouvement est communiqué à cette machine. O S, figures 1. & 2. l'axe d'un rouet N ; S, la pierre qui porte la crapaudine, sur laquelle le pivot roule ; R Q, quatre leviers de treize piés de long, auxquels on attelle des chevaux. Ce rouet communique le mouvement à un arbre horisontal O H, par le moyen de la lanterne M ; ce même arbre porte encore une roue dentée ou hérisson L, & une lanterne K, qui transmettent le mouvement aux lanternes F & D, à la lanterne F, directement, puisque les dents de l'hérisson L, engrenent dans les fuseaux de la lanterne F, & à la lanterne D, au moyen de l'étoile de cuivre d d, qui engrene à-la-fois dans les lanternes D & K ; l'hérisson L & les lanternes K, M, sont fixes sur l'arbre O H, avec lequel elles tournent nécessairement, au lieu que les lanternes D & F sont mobiles sur leur axe C G, au moyen des canons qui en occupent le centre, comme on l'a remarqué ci-dessus.
Il résulte de cette construction, que de quelque sens que l'on puisse supposer que l'axe horisontal H O, puisse tourner, il y a toûjours une des deux lanternes D ou F, qui tourne du même sens que lui, & l'autre en sens contraire, savoir la lanterne F, dans le sens opposé à l'arbre, & la lanterne D, dans le même sens ; sans pour cela que le mouvement soit communiqué à l'axe commun C G, de ces deux lanternes, & par conséquent sans qu'il soit communiqué au rouleau inférieur B B, du laminoir.
Mais on parvient au moyen du verrouil, fig. 2, 4, 5 & 6, à fixer à choix une des deux lanternes D ou F sur l'arbre C G ; le verrouil ou les verrouils, car il y en a deux, sont des barres de fer forgé 56, 56, fig. 4 & 6, soudées à une poulie du même métal ; représentée en profil, fig. 2 & 4, en plan, fig. 5, où l'on voit le profil du porte-verrouil ; 7 est le trou quarré dans lequel entre la partie quarrée E de l'arbre C C G, fig. 3. a b, c d, les fourchettes qui reçoivent les verrouils 5, 5, dont les extrémités 55 entrent dans la rainure circulaire q r s t pratiquée dans la face de la lanterne D, & où les mêmes verrouils trouvent un point d'appui dans les barres de fer q s, t r, fig. 7, qui sont encastrées de leur épaisseur dans le bois de la lanterne. Les extrémités 66 des mêmes verrouils entrent dans une semblable rainure circulaire x y pratiquée à la face de la lanterne F, qui regarde le verrouil selon que le verrouil en coulant dans les fourchettes représentées en profil, fig. 4 en 1, 4 ; 2, 3 s'engage par son extrémité 5 dans la lanterne D ou par son extrémité 6 dans la lanterne F ; car il n'est jamais engagé dans les deux lanternes à-la-fois ; le verrouil, dis-je, est contraint de suivre le mouvement de la lanterne, dans laquelle il est engagé, & par conséquent l'axe C C G tourne du même sens que cette lanterne, aussi-bien que le rouleau inférieur B B du laminoir ; cet axe tourne du même sens que l'arbre de bois H O, fig. 2 ; lorsque le verrouil est engagé dans la lanterne D mûe par renvoi, c'est le cas de la fig. 2, & le même axe C G, & par conséquent le rouleau du laminoir tourne en sens contraire lorsque l'extrémité 6 du verrouil est engagée dans la lanterne F, comme on l'a déjà remarqué ci-dessus.
Il faut maintenant expliquer comment on fait changer le verrouil ; pour cela il faut entendre qu'en T, fig. 2, c'est-à-dire au-dessous de la partie E du verrouil, est placé horisontalement un arbre de fer forgé, représenté en perspective par la fig. 6 Pl. II. Cet axe T e porte deux montans f a, b g reliés ensemble par la traverse f g ; ces deux montans sont terminés en a & b par des boulons qui entrent dans la rainure de la poulie E, sans cependant l'empêcher de tourner. A une des extrémités de l'axe c T est assemblé quarrément un long levier T V, au moyen duquel, selon que l'on leve ou qu'on abaisse l'extrémité V, on fait incliner de côté ou d'autre le plan de la fourchette a f g b, qui pousse du même sens la poulie E & par conséquent les verrouils qui y sont adhérens, & les fait entrer par ce moyen dans l'un ou l'autre des deux lanternes D ou F mobile sur l'axe C G, auquel elle devient alors fixe.
Par ce moyen ingénieux applicable à bien d'autres machines que le laminoir, on est dispensé de retourner les chevaux pour faire tourner les cylindres en sens contraire, & de la peine qu'il faudroit prendre de transporter la table de plomb du poids de 2600 livres ou environ, du côté du laminoir où elle est sortie d'entre les rouleaux, au côté par où elle y est entrée ; car on ne lamine que d'un seul sens, ainsi qu'on l'expliquera après avoir parlé du régulateur.
Le régulateur est l'assemblage des pieces au moyen desquelles on approche ou on éloigne les cylindres l'un de l'autre, en élevant ou abaissant le cylindre supérieur. Voyez la figure premiere qui représente en perspective le régulateur & le reste de la machine, la fig. 2 qui en est l'élevation geométrale, & la fig. 8, Planche seconde, qui représente en détail les différentes pieces qui composent un des côtés du laminoir, l'autre côté étant parfaitement semblable. X, dans toutes les fig. citées, grosse piece de bois dans laquelle sont plantées quatre colonnes de fer, telles que les deux r m, r n, fig. 8 ; ces colonnes traversent le collet inférieur 88, le double collet 77, & le collet supérieur 66. Elles sont faites en vis par leur partie supérieure m n pour recevoir les écrous 55, garnis chacun d'une roue de fer horisontale. Deux de ces roues engrenent à-la-fois dans un pignon fixe sur la tige 24, & ce pignon, qui est couvert par une roue de fer, est mis en mouvement par une vis sans fin W conduite à son tour par une manivelle L, comme on voit, figure premiere. Toutes les pieces dont on vient de faire l'énumération sont doubles, c'est-à-dire qu'il y en a autant à l'autre extrémité du laminoir. Les colonnes r m, r n, fig. 8, sont représentées beaucoup plus longues qu'il ne faut, mais on doit concevoir que le collet inférieur 88 s'applique exactement au sommier X, le tourillon du cylindre B sur le collet, & que le tourillon du cylindre A est exactement embrassé par le collet 66 & le double collet 77 dont on va expliquer l'usage.
Il résulte de cette construction, que lorsque l'on tourne la manivelle L, fixée sur la tige de la vis sans fin W, ou plûtôt des deux vis sans fin ; car cette tige qui passe dans les trous des pieces 3 fixées par des vis au collet supérieur 66, en porte deux ; il suit que le mouvement est communiqué à la roue qui est audessus du pignon 2, 4 ; que ce pignon communique le mouvement aux deux roues 5, 5, & les fait tourner du même sens, ce qui fait connoître que les vis doivent être taraudées du même côté. Il est visible qu'en faisant descendre les écrous on comprime le cylindre supérieur A sur l'inférieur B, qui est fixe, c'est-à-dire qu'il n'a que le mouvement de rotation qui lui est communiqué par les roues & lanternes de la machine ; mais pour faire éloigner les cylindres l'un de l'autre, il ne suffiroit pas de tourner les écrous 5, 5 en sens contraire, puisque n'étant point assemblés avec le collet supérieur 66, ni le cylindre supérieur A avec le collet, les écrous s'éloigneroient sans que le cylindre fût relevé. On a remédié à cet inconvénient par le double collet 77 qui embrasse en-dessous le tourillon du cylindre supérieur. Ces doubles collets forment les traverses inférieures des étriers 7 k h g, fig. prem. dont les montans g terminés par une chaîne qui s'enroule sur l'axe a b, sont perpétuellement tirées en en-haut par le poids 10 appliqué à l'extrémité 10 du levier a, 10 b ; ce poids doit être suffisant pour soûlever le cylindre supérieur A, les collets 66, & toutes les pieces de l'armure du régulateur.
Après avoir décrit cette belle machine, il ne reste plus qu'à ajoûter un mot sur la maniere de s'en servir, en quoi l'opération du laminer consiste.
La table de plomb ayant été fondue comme il a été dit ci-dessus, & ébarbée & nettoyée du sable qui pouvoit y être resté, est enlevée par la grue tournante P R S, Planche seconde, pour être portée sur les rouleaux de bois qui composent l'établi du laminoir ; le service de cette grue est facilité par un cric sur le treuil duquel le cable s'enroule : deux hommes suffisent pour cette manoeuvre, tant par la facilité que la moufle N & le cric procurent, que parce qu'il y a un verrouil près du cric par lequel on arrête les manivelles, ce qui laisse la liberté à ceux qui servent cette machine de faire les manoeuvres auxquelles d'autres hommes seroient nécessaires.
La table de plomb étant donc placée sur les rouleaux de bois & une de ses extrémités entre les cylindres, on abaisse par le moyen du régulateur le cylindre supérieur sur la table que l'on comprime autant qu'il convient, & le verrouil des lanternes étant en prise dans la lanterne F, on fait marcher les chevaux. Le mouvement communiqué au cylindre inférieur B B par l'axe C G auquel la lanterne F est devenue adhérente par le moyen du verrouil, est transmis à la table ; de la table au cylindre supérieur A, ensorte que la table entiere passe entre les cylindres, où ayant été fortement comprimée, elle a reçu à ce premier passage un degré d'applattissement & d'allongement proportionnels à la compression ; l'extrémité suivante de la table étant arrivée entre les cylindres, on change le verrouil, & aussitôt, quoique les chevaux continuent de marcher du même sens, le mouvement des cylindres est changé, ce qui fait repasser la table du même côté où elle étoit auparavant. On resserre alors les cylindres, on rechange aussi le verrouil, & la table repasse une troisieme fois entre les cylindres, où elle reçoit un nouveau degré d'applatissement & d'allongement : on réitere cette opération autant de fois qu'il est nécessaire pour réduire le plomb de l'épaisseur qu'il a au sortir de la fonte à l'épaisseur demandée. Il faut remarquer que la table n'est pas laminée dans les retours, mais seulement dans les passages lorsque le cylindre est mû par la lanterne F.
Pendant le laminage la table n'est soutenue que par les rouleaux de bois qui traversent l'établi du laminoir, ce qui diminue d'autant le frottement.
Moyennant ces divers secours, c'est assez de six hommes pour servir la machine, & de six chevaux pour la faire marcher toute l'année onze heures par jour ; & on peut en dix heures de travail réduire une table de plomb de 18 lignes à une ligne d'épaisseur : pour cela il faut qu'elle passe environ deux cent fois entre les cylindres D.
|
| LAMIS | DRAPS-LAMIS, (Commerce) une des sortes de draps d'or qui viennent de Venise à Smyrne ; ils paient d'entrée à raison de trois piastres & demi par picq.
|
| LAMIUM | S. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale labiée ; la levre supérieure est creusée en cuilliere ; la levre inférieure est fendue en deux parties & a la forme d'un coeur : les deux levres aboutissent à une gorge bordée d'une aîle ou feuillet. Le calice est en forme de tuyau divisé en cinq parties : il en sort un pistil attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & environné de quatre embryons qui deviennent dans la suite autant de semences triangulaires renfermées dans une capsule qui a été le calice de la fleur. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LAMO | (Géogr.) ville d'Afrique dans une île de même nom sur la côte de Mélinde, capitale d'un canton qui porte le nom de royaume. (D.J.)
|
| LAMON | S. m. (Commerce) bois de Bresil qui vient de la baie de tous les Saints. On l'appelle aussi bresil de la baie, & bresil de tous les Saints. Voyez BRESIL.
|
| LAMPADAIRE | S. m. (Hist. eccles. grecq.) nom d'un officier de l'église de Constantinople, qui prenoit soin du luminaire de l'église, & portoit un bougeoir élevé devant l'empereur & l'impératrice pendant qu'ils assistoient au service divin. La bougie qu'il tenoit devant l'empereur étoit entourée de deux cercles d'or en forme de couronne, & celle qu'il tenoit devant l'impératrice n'en avoit qu'un. Cette nouveauté, quelqu'interprétation favorable qu'on puisse lui donner, ne paroît pas le fruit des préceptes du Christianisme. Cependant les patriarches de Constantinople en imiterent la pratique, & s'arrogerent le même droit ; c'est de là vraisemblablement qu'est venu l'usage de porter des bougeoirs à nos évêques quand ils officient.
Au reste, l'empereur avoit dans son palais plusieurs lampadaires ; c'étoit une charge que les uns possédoient en chef ; & les autres en sous ordre : l'exemple s'étendit bientôt sur tous les grands officiers de la couronne, & passa jusqu'aux magistrats : de nos jours on n'est pas plus sage.
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs.
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.
Lampadaire vient du mot grec , lampe, bougie, flambeau. (D.J.)
|
| LAMPADATION | S. f. (Hist. mod.) espece de question qu'on faisoit souffrir aux premiers martyrs chrétiens. Quand ils étoient étendus sur le chevalet on leur appliquoit aux jarrets des lampes ou bougies ardentes.
|
| LAMPADEDROMIE | S. f. (Hist. anc.) course de jeunes gens qui se faisoit dans Athènes. Celui qui arrivoit le premier sans que sa torche s'éteignît, obtenoit le prix. La Lampadedromie se célébroit aux panathenées, aux vulcanales & aux prométhées : aux panathenées on couroit à cheval ; aux deux autres fêtes, à pié. On alloit de l'autel de Promethée dans l'académie, vers la ville. C'est de-là que vient le proverbe, lampadem suam alio tradere. Celui qui étoit arrivé avec sa torche allumée, la donnoit à un autre qui lui succédoit dans la course, tandis que le premier se reposoit.
|
| LAMPADIAS | S. m. (Phys.) espece de comete barbue dont il y en a de plusieurs formes ; car quelquefois sa flamme s'éleve en cône ou en forme d'épée, d'autres fois elle se termine en deux ou trois pointes. Cette dénomination est peu en usage, & ne se trouve que dans quelques anciens auteurs. Harris.
|
| LAMPADOMANCIE | S. f. Divination dans laquelle on observoit la forme, la couleur & les divers mouvemens de la lumiere d'une lampe, afin d'en tirer des présages pour l'avenir.
Ce mot est tiré du grec , lampe, & , divination.
C'est de cette divination que parle Properce, liv. IV. lorsqu'il dit :
Sed neque suppletis constabat flamma lucernis.
Et ailleurs :
Seu voluit tangi parca lucerna mero.
Petrone en fait aussi mention dans sa satyre. Cependant on pense que la lampadomancie étoit une espece d'augure.
Delrio rapporte à la lampadomancie la pratique superstitieuse de ceux qui allument un cierge en l'honneur de saint Antoine de Padoue pour retrouver les choses perdues. Voyez Delrio, lib. IV. cap. iij. quest. 7. sect. 2. p. 557.
|
| LAMPADOPHORE | S. m. (Littérat.) . On appelloit ainsi celui qui portoit le flambeau dans les lampadophories : ce nom fut encore appliqué à ceux qui donnoient le signal du combat, en élevant en-haut des torches ou des flambeaux. Ce terme est dérivé de , une lampe, un flambeau, & , je porte. (D.J.)
|
| LAMPADOPHORIES | ou LAMPAS, s. f. pl. (Littérat.) nom d'une fête des Grecs, dans laquelle ils allumoient une infinité de lampes en l'honneur de Minerve, de Vulcain & de Prométhée, toutes en actions de graces de ce que la premiere de ces divinités leur avoit donné l'huile ; que Vulcain étoit l'inventeur des lampes, & que Prométhée les avoit rendues utiles, en dérobant le feu du ciel. Le même jour de cette fête ils faisoient des sacrifices & des jeux, dont le grand spectacle servoit à voir courir des hommes un flambeau à la main pour remporter des prix.
On célébroit dans Athènes trois fois l'année cette course du flambeau ; la premiere pendant la fête des Panathénées à l'honneur de Minerve ; la seconde pendant la fête de Vulcain, à l'honneur de ce même dieu ; & la troisieme à l'honneur de Prométhée, & pendant sa fête. Celle des Panathénées se faisoit au port de Pirée, & les deux autres dans le céramique, c'est-à-dire dans le parc de l'académie.
De jeunes gens couroient successivement un certain espace de toutes leurs forces, en portant à la main un flambeau allumé. Celui entre les mains de qui le flambeau venoit à s'éteindre, le donnoit à celui qui devoit courir après lui, & ainsi des autres ; mais celui-là seul étoit victorieux qui achevoit sa carriere avec le flambeau toujours allumé. A la course des Panathénées, on jettoit les flambeaux tout allumés du haut d'une tour, & aux deux autres celui qui devoit courir, l'alloit allumer sur l'autel de Prométhée, près de la statue de l'amour consacrée par Pisistrate.
Le jour de la fête de Cérès, se nommoit par excellence dies lampadum, le jour des flambeaux, en mémoire de ceux que la déesse alluma aux flammes du mont Etna, pour aller chercher Proserpine. Tous les initiés aux mysteres de la déesse, célébroient dans l'Attique le jour des flambeaux. Phedre découvrant à sa nourrice l'amour dont elle brûle pour Hyppolite, lui dit dans Seneque, que sa passion lui fait oublier les dieux ; qu'on ne la voit plus avec les dames athéniennes agiter les flambeaux sacrés autour des autels de Cérès :
Non colere donis templa votivis libet,
Non inter aras Atridûm mixtam choris
Jactare tacitis conscias sacris faces. (D.J.)
|
| LAMPANGUY | (Géog.) montagne de l'Amérique méridionale auprès de la Cordeliere, à 80 lieues de Valparaiso, sous le 31 degré de latitude. Frézier dit qu'on y a découvert en 1710 plusieurs mines d'or, d'argent, de fer, de plomb, de cuivre & d'étain : il ajoûte que l'or de Lampanguy est de 21 à 22 carats ; mais aucune des mines de Frezier n'a produit de grandes richesses jusqu'à ce jour. (D.J.)
|
| LAMPANT | adj. (Commerce) c'est ainsi que l'on appelle en Provence & en Italie l'huile claire & bien purifiée.
|
| LAMPAREILLES | S. f. (Manufact. en laine) petits camelots légers qui se fabriquent en Flandres. Il y en a d'unis, à fleurs & de rayés. Leur largeur est de 3/8 ou 1/4 & 1/2 de l'aune de Paris : quant à la longueur des pieces, elle varie. Il s'en fabrique tout de laine, ou de laine mêlée d'un fil de laine en chaîne. Le terme lampareille est espagnol : nous disons nonpareilles. Les Flamands, polimites, polemits ou polemmites.
|
| LAMPAS | S. m. (Maréchallerie) sorte d'enflure qui arrive au palais du cheval, ainsi appellée, parce qu'on la guérit en la brûlant avec une lampe ou un fer chaud.
Le lampas est une inflammation ou une tumeur au-dedans de la bouche du cheval, derriere les pinces de la mâchoire supérieure. Il vient de l'abondance excessive du sang dans ces parties, qui fait enfler le palais au niveau des pinces ; ce qui empêche le cheval de manger, ou du moins fait tomber son manger à demi-mâché de sa bouche.
Le lampas est une infirmité naturelle qu'il faut qu'un cheval ait tôt ou tard, mais que tout maréchal est en état de guérir.
LAMPAS, (Manufacture en soie) espece de persienne qui tous les quatre ou six coups, reçoit un coup de navette de fil d'argent, en place de la navette blanche. Il y a des lampas sans dorure : cette étoffe à cinq huitiemes de large.
|
| LAMPASSÉ | adj. en terme de Blason, se dit de la langue des lions & des autres animaux.
Daubigné de gueules, au lion d'hermine, armé, lampassé & couronné d'or ; c'est la maison de madame la marquise de Maintenon.
|
| LAMPASSES | S. f. pl. (Commerce) toiles peintes qui se font aux Indes orientales, en plusieurs lieux de la côte de Coromandel. Elles ont 18 cobres de long sur deux de large, à raison de 17 pouces 1/2 de roi le cobre. Le commerce en est avantageux de l'Inde en l'Inde : on les porte sur-tout aux Manilles.
|
| LAMPE | S. f. (Littérat.) en grec , en latin lychnus, lucerna ; vaisseau propre à faire brûler de l'huile, en y joignant une meche de coton pour éclairer.
Les lampes servoient chez les anciens à trois principaux usages, indépendamment de l'usage domestique.
Elles servoient 1°. aux fêtes, aux temples & aux actes de religion ; car quoique l'usage de la cire ne fût pas inconnu des anciens, quoiqu'ils usassent de gros flambeaux, ils n'avoient point de bougies comme nous, mais des lampes de différentes grandeurs, formes & matieres, d'où vint le proverbe latin, tempus & oleum perdidi, pour dire j'ai perdu ma peine. Dans les premiers tems de Rome, ces lampes étoient la plûpart très-simples, de terre cuite ou de bronze ; mais par l'introduction du luxe, on en fit d'airain de Corinthe, d'or, d'argent, & à plusieurs meches ; enfin l'on en disposa par étages, qu'on plaçoit sur des lustres, des candélabres à plusieurs branches, qui formoient une véritable illumination.
En second lieu l'usage de ces lampes se prodigua dans les maisons aux jours de réjouissances, de noces & de festins, qui se faisoient seulement la nuit. On ne voit, dit Virgile, dans sa description d'une brillante fête, on ne voit que lampes pendues aux lambris dorés, qui étouffent la nuit par leur lumiere.
Dependent lychni laquearibus aureis.
Incensi & noctem flammis funalia vincunt.
En troisieme lieu, l'usage des lampes s'introduisit pour les sépulchres ; l'on en mit dans les tombeaux, mais rarement enfermées dans le cercueil, & ces lampes prirent le nom de lampes sépulchrales, que quelques modernes ont prétendu brûler perpétuellement. Voyez LAMPE PERPETUELLE. Lorsqu'on enterroit vive une vestale qui avoit enfreint son voeu de chasteté, on mettoit dans son tombeau une grande lampe qui brûloit jusqu'à ce que l'huile fût consumée.
Enfin, les Romains ainsi que les Grecs avoient des lampes de veille, c'est-à-dire des lampes particulieres qu'ils n'éteignoient jamais pendant la nuit, & qui étoient à l'usage de tous ceux de la maison. Cet établissement régnoit par un principe d'humanité, car, dit Plutarque dans ses questions romaines sur la coutume, question 75 ; il n'est pas honnête d'éteindre une lampe par avarice, mais il faut la laisser brûler, pour que chacun qui le désire puisse jouir à toute heure de sa clarté ; en effet, ajoûtoit-il, s'il étoit possible quand on va se coucher, que quelqu'un se servit alors de notre propre vûe pour ses besoins, il ne faudroit pas lui en refuser l'usage. (D.J.)
LAMPE PERPETUELLE, ou LAMPE INEXTINGUIBLE, (Littérat.) quelques modernes ont imaginé que les anciens avoient de telles lampes qu'ils enfermoient dans les tombeaux, & que leur lumiere duroit toujours, parce qu'on mettoit dans ces lampes une huile qui ne se consumoit point.
Entre les exemples qu'ils ont cités pour appuyer cette erreur, le plus fameux est celui du sépulchre de Tullia fille de Cicéron, découvert sous le pontificat de Paul III. en 1540. On trouva, dit-on, dans ce tombeau, ainsi que dans ceux des environs de Viterbe, plusieurs lampes qui ne s'éteignirent qu'au moment qu'elles prirent l'air ; ce sont là de vraies fables, qui doivent leur origine à des rapports de manoeuvres employés à remuer les terres de ces tombeaux. Ces sortes d'ouvriers ayant vu sortir des monumens qu'ils fouilloient quelque fumée, quelque flamme, quelque feu folet ; & ayant trouvé des lampes dans le voisinage, ils ont cru qu'elles venoient de s'éteindre tout d'un coup. Il n'en a pas fallu davantage pour établir des lampes éternelles, lorsqu'il n'étoit question que d'un phosphore assez commun sur nos cimetieres mêmes, & dans les endroits où l'on enterre les animaux. Ce phénomène est produit par des matieres grasses, qui après avoir été concentrées, s'échappent à l'abord d'un nouvel air, se subtilisent & s'enflamment.
Mais la fausse existence des lampes inextinguibles adoptées par Pietro Sancti-Bartholi, nous a valu son recueil des lampes sépulchrales des anciens, gravées en taille-douce, & ensuite illustrées par les savantes observations de Bellori.
Ces deux ouvrages ont été suivis du traité de Fortunius Licetus, de lucernis antiquorum reconditis, dans lequel il a prodigué beaucoup d'érudition, sans pouvoir nous apprendre le secret des lampes perpétuelles. Cassiodore qui se vantoit de le posséder, n'a persuadé personne ; Kircher & Korndoffer n'ont pas été plus heureux. Joignez-leur l'abbé Trithème, qui donnoit son huile de soufre, de borax & d'esprit-de-vin, pour brûler sans aucun déchet. La plus légere teinture de Physique suffit pour refuter toutes les chimeres de cette espece. Il n'est point d'huile qui ne se consume en brûlant, ni de meche qui brûle longtems sans nourriture. Il est vrai que celle d'amiante éclaire sans déperdition de substance, & sans qu'il soit besoin de la moucher, mais non pas sans aliment, ni après la consommation de son aliment ; c'est un merveilleux impossible. La meche de lin pouvoit brûler un an dans la lampe d'or consacrée par Callimaque au temple de Minerve, parce qu'on ne laissoit point l'huile de cette lampe tarir ; & qu'on la renouvelloit secrettement. Ainsi ce que Pausanias & Plutarque racontent des lampes consacrées dans quelques temples de Diane & de Jupiter Ammon, qui brûloient des années entieres sans consumer de l'huile, n'est que d'après le récit qu'en faisoient des prêtres fourbes, intéressés à persuader au peuple ces sortes de merveilles. (D.J.)
LAMPE SEPULCHRALE, (Littérat.) nom de lampes trouvées dans les tombeaux des anciens romains, chez qui les gens de condition chargeoient quelquefois par testament leurs parens ou leurs affranchis, de faire garder leur corps, & d'entretenir une lampe allumée dans leurs tombeaux, car il falloit bien en renouveller l'huile à mesure qu'elle se consumoit ; voyez pour preuve Ferrari (Octavio) discursus de veterum lucernis sepulchralibus, & l'article LAMPE PERPETUELLE. (D.J.)
LAMPE D'HABITACLE, (Marine) ce sont de petits vases où l'on met de l'huile avec une meche pour éclairer.
LAMPE à souder, à fermer hermétiquement les vaisseaux, (Art méch.) cette lampe n'a rien de particulier ; elle est montée sur un pié ; il en sort un ou plusieurs gros lumignons, dont la flamme est portée sur l'ouvrage à l'aide du chalumeau. Il faut que l'huile qu'on y brûle soit excellente, sans quoi la fumée qu'elle rendroit terniroit l'ouvrage, sur-tout de l'émailleur ; voyez cette lampe dans nos Planches.
LAMPE, (Comm.) étamine de laine qui se fabrique en quelques endroits de la généralité d'Orléans ; elles sont toutes laine d'Espagne. On appelle aussi laines lampes, les laines dont on les fabrique.
|
| LAMPEDOUSE | ou LAMPADOUSé, (Géog.) Ptolomée la nomme Lopadusa ; les Italiens l'appellent Lampedosa. Petite île de la mer d'Afrique sur la côte de Tunis, d'environ 16 milles de circuit, & 6 de longueur, à 20 lieues E. de Tunis, & 43 de Malte ; elle est déserte, mais elle a un assez bon port, où les vaisseaux vont faire de l'eau. C'est auprès de cette île que l'armée navale de l'empereur Charles-Quint fit naufrage en 1552. Long. 30. 35. lat. 36. (D.J.)
|
| LAMPETIENS | S. m. pl. (Théol.) secte d'hérétiques qui s'éleva dans le vij siecle, & que Pratéole a mal-à-propos confondus avec les sectateurs de Wiclef qui ne parut que plus de 600 ans après.
Les Lampétiens adoptoient en plusieurs points la doctrine des Aériens. Voyez AERIENS.
Lampetius leur chef avoit renouvellé quelques erreurs des Marcionites. Ce qu'on en sait de plus certain, sur la foi de S. Jean Damascene, c'est qu'ils condamnoient les voeux monastiques, particulierement celui d'obéissance, qui étoit, disoient-ils, incompatible avec la liberté des en fans de Dieu. Ils permettoient aussi aux religieux de porter tel habit qu'il leur plaisoit, prétendant qu'il étoit ridicule d'en fixer la forme ou la couleur pour une profession plutôt que pour une autre.
|
| LAMPIA | ou LAMPEA, , (Géog. anc.) montagne du Péloponnèse dans l'Arcadie, au pié de l'Erymanthe selon Strabon, l. VIII. p. 341, & Pausanias, l. VIII. cap. xxiv. (D.J.)
|
| LAMPION | S. m. (Artificier) c'est une petite lampe de fer blanc ou d'autre matiere propre à contenir des huiles ou des suifs, dont on se sert pour former des illuminations, en les multipliant & les rangeant avec symmétrie.
LAMPION A PARAPET, (Fortification) est un vaisseau de fer où l'on met du gaudron & de la poix pour brûler & pour éclairer la nuit, dans une place assiégée, sur le parapet & ailleurs.
LAMPION, (Marine) c'est un diminutif de lampe dont on se sert dans les lanternes lorsqu'on va dans les soutes aux poudres.
|
| LAMPON | (Géog.) ville d'Asie, au fond d'un golphe dans la partie la plus méridionale de l'île de Sumatra. Elle donne, ou tire son nom du pays & du golphe, qui selon M. Delisle, est vers les 5 deg. 40 min. de latitude méridionale. (D.J.)
|
| LAMPRA | ou LAMPRIAE, (Géog. anc.) . Il y avoit deux municipes de ce nom dans l'Attique ; l'un au bord de la mer, & l'autre sur une hauteur, & tous deux dans la tribu Erecthéide. M. Spon les nomme lampra l'un & l'autre, & les distingue en lampra supérieur qui s'appelle encore à présent Palaeo lambrica, & lampra inférieur, voisine du précédent, près de la mer, entre Sunium & Phalère. On voyoit dans l'un ou dans l'autre de ces deux municipes, le tombeau de Cranéus roi d'Athènes.
Ammonius, successeur d'Aristarque dans l'école d'Alexandrie, étoit natif d'un de ces municipes de l'Attique, & fleurissoit peu de tems avant l'empire d'Auguste. Il fit deux traités qui se sont perdus ; le premier sur les sacrifices, & le second sur les courtisannes d'Athenes.
|
| LAMPRESSES | S. f. pl. terme de pêche, ce sont les filets qui servent à faire, dans la Loire, la pêche des lamproies qui y est très-considérable. Cette pêche commence ordinairement à la fin de Novembre, & finit vers la pentecôte ; ce poisson venant de la mer, entre fort gras dans la riviere, où il diminue de qualité à mesure qu'il y séjourne ; ensorte qu'à la fin de la saison, il est très-méprisable, au contraire des aloses qui entrent maigres dans la riviere où elles s'engraissent.
Les tramaux à lampresses ont vingt-huit brasses de longueur sur six piés de haut ; ils servent aussi à faire la pêche des laiteaux ou petits couverts, feintes ou pucelles que les pécheurs de Seine nomment cahuyaux, & qu'ils prennent avec les tramaux appellés cahuyautiers ou vergues aux petites pucelles.
Les mailles des lampresses des pêcheurs de quelques côtés de la Bretagne, sont très-larges, la toile nappe ou menue est de deux sortes de grandeurs ; les mailles les plus larges ont dix-huit lignes, & les plus serrées dix-sept lignes en quarré ; les gardes, homails ou hameaux qui sont des deux côtés, ne différent guere de celles des couverées, étant de dix pouces trois lignes en quarré.
|
| LAMPRILLON | ou LAMPROION, s. m. (Hist. nat. Icthyolog.) petite lamproie qui ressemble à la lamproie de mer, mais qui se trouve dans des rivieres & dans des ruisseaux, où il ne paroît pas qu'elles puissent être venues de la mer ; il y en a qui ne sont pas plus grandes que le doigt, d'autres ont la grandeur des gros vers de terre. Rondelet, hist. des poissons de riviere, ch. xxj.
|
| LAMPROIE | S. f. (Hist. nat. Icthyolg.) lampetra, asterius, hirundo, murena, vermis, marinus. Poisson cartilagineux, long & glissant qui se trouve dans la mer & dans les rivieres ; car il y entre au commencement du printems pour y jetter ses oeufs, & ensuite il retourne dans la mer. Il a beaucoup de rapport à l'anguille & à la murene par la figure du corps, mais il en differe par celle de la tête. La bouche forme, comme celle des sangsues, une concavité ronde, où il n'a point de langue, mais seulement des dents jaunes ; le corps est plus rond que celui de la murene. La lamproie a la queue menue & un peu large, le ventre blanc, le dos parsemé de taches bleues & blanches, la peau lisse, ferme & dure, les yeux ronds & profonds ; les ouies sont ouvertes en dehors de chaque côté par sept trous ronds. On voit entre les yeux l'orifice d'un conduit qui communique jusqu'au palais ; ce poisson tire de l'air & rejette l'eau par ce conduit, comme ceux qui ont des poumons. Il nage comme les anguilles en fléchissant son corps en différens sens ; il n'a que deux petites nageoires, l'une près de l'extrémité de la queue, & l'autre un peu plus haut. Rondelet, hist. des poissons, liv. XIV. Voyez POISSON.
|
| LAMPROPHORE | S. m. & f. (Hist. ecclés.) nom qu'on donnoit aux néophites pendant les sept jours qui suivoient leur baptême ; l'origine de ce nom vient de ce que dans les anciens tems de l'Eglise, lors de la cérémonie du baptême, on revêtissoit les nouveaux chrétiens d'un habit blanc, qu'ils portoient une semaine entiere ; & pendant qu'ils le portoient, on les appelloit Lamprophores, à cause de l'éclat de la blancheur de leurs habits, de , éclatant, & , je porte. Les Grecs donnoient aussi ce nom au jour de la résurrection, tant parce que le jour de Pâques est un symbole de lumiere aux chrétiens, que parce que le même jour les maisons étoient éclairées d'un grand nombre de cierges. (D.J.)
|
| LAMPSANE | S. f. lampsana, (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur, composée de demi-fleurons portés sur un embryon, & soutenus par un calice d'une seule piece découpée : ce calice devient dans la suite une capsule cannelée, remplie de semences qui sont pour l'ordinaire déliées & pointues. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Tournefort ne connoît qu'une espece de lampsane, dont voici la description ; sa racine est blanche, simple, ligneuse & fibreuse : sa tige est haute de deux coudées & plus, cylindrique, cannelée, garnie de quelques poils, rougeâtre, creuse, branchue. Les feuilles qui sont vers la racine & la partie inférieure de la tige, ont une ou deux découpures de chaque côté, & une troisieme à leur extrémité, comme dans le laitron des murailles ou l'herbe de sainte Barbe. Les feuilles sont très-molles, velues, & placées alternativement ; celles des tiges & des rameaux, sont oblongues, étroites, pointues, sans queue, & entieres ; la partie supérieure des tiges & des rameaux, est lisse, & terminée par de petites fleurs jaunes, composées de plusieurs demi-fleurons, portées sur un embryon, & renfermées dans un calice d'une seule piece, découpé en plusieurs parties. Ce calice se change ensuite en une capsule cannelée, remplie de menues graines, noirâtres, un peu courbées, pointues, sans aigrettes, quoique J. Bauhin dise le contraire.
Cette plante est commune dans les jardins, les vergers, le long des champs & sur le bord des chemins. Il paroît qu'elle contient un sel alumineux, dégénéré en sel tartareux amer, mais engagé dans un suc laiteux & gluant ; aussi répand-elle un lait amer, quand on la blesse, elle passe pour émolliente & détersive, on ne l'emploie qu'à l'extérieur pour déterger les ulceres. Il est bien difficile de déterminer ce que c'est que la lampsane de Dioscoride, (D.J.)
|
| LAMPSAQUE | (Géogr. anc. & mod.) en latin Lampsacus ; ville ancienne de l'Asie mineure ; dans la Mysie, presque au bord de la mer, à l'entrée de la Propontide : elle avoit un temple dédié à Cybele, & un port vanté par Strabon, vis-à-vis de Callipolis, ville d'Europe dans la Chersonese de Thrace. Elle s'étoit accrue des ruines de la ville voisine de Paesus, dont les habitans passerent à Lampsaque. Quelques-uns disent qu'elle fût bâtie par les Phocéens, & d'autres par les Milésiens en la xxxj. olympiade.
On sait comme la présence d'esprit d'Anaximène sauva Lampsaque de la fureur d'Alexandre. Ce prince honteusement insulté par cette ville, marchoit dans la résolution de la détruire. Anaximène fut prié par ses concitoyens, d'aller intercéder pour leur patrie commune ; mais d'aussi loin qu'Alexandre l'apperçut : " Je jure, s'écria-t-il, de ne point accorder ce que vous venez me demander.... " Eh bien, dit Anaximène, je vous demande de détruire Lampsaque. Ce seul mot fut comme une digue qui arrêta le torrent prêt à tout ravager ; le jeune prince crut que le serment qui lui étoit échappé, & dans lequel il avoit prétendu renfermer une exception positive de ce qu'on lui demanderoit, le lioit d'une maniere irrévocable, & Lampsaque fut ainsi conservée.
Ses vignobles étoient excellens, c'est pourquoi, au rapport de Cornelius Népos & de Diodore de Sicile, ils furent assignés à Thémistocle par Artaxerxe pour sa table.
On adoroit à Lampsaque plus particulierement qu'ailleurs Priape le dieu des jardins, si nous en croyons ce vers d'Ovide, Trist. l. I. eleg. 9. v. 770.
Et te ruricola, Lampsace, tuta deo.
On voyoit aussi dans cette ville un beau temple que les habitans avoient pris soin de dédier à Cybele.
Lampsacus, dit Whéler dans ses voyages, a présent appellée Lampsaco, a perdu l'avantage qu'elle avoit du tems de Strabon sur Gallipoli ; ce n'est qu'une petite ville ou bourg, habité par quelques turcs & grecs ; c'étoit une des trois villes que le roi de Perse donna à Thémistocle pour son entretien : Magnésie étoit pour son pain, Mynus pour sa viande, & Lampsaque pour son vin. Elle a conservé sur les collines qui l'environnent quelques vignes, dont les raisins & les vins, en très-petite quantité, sont excellens.
Whéler se trouvant à Lampsaco, y vit encore dans un jardin deux belles inscriptions antiques ; la premiere étoit une dédicace d'une statue à Julia Augusta, remplie des titres de Vésta, & de nouvelle Cérès. L'érection de cette statue fut faite aux dépens de Dionisius, fils d'Apollonitimus, sacrificateur de l'empereur, intendant de la distribution des couronnes, & trésorier du sénat pour la seconde fois ; l'autre inscription étoit la base d'une statue dressée en l'honneur d'un certain Cyrus ; fils d'Apollonius, médecin de la ville, & érigée par la communauté, à cause des bienfaits qu'elle en avoit reçus. (D.J.)
|
| LAMPTÉRIES | (Littér.) , fête qui se faisoit à Palènes pendant la nuit, en l'honneur de Bacchus, & à la clarté des lampes.
Pausanias nous apprend que cette fête étoit placée immédiatement après la vendange, & qu'elle consistoit en une grande illumination nocturne, & en profusions de vin qu'on versoit aux passans.
Dès les premiers siecles du christianisme, on usa d'illuminations, non-seulement pour les réjouissances prophanes, mais pour celles qui tenoient à la religion ; c'est ainsi qu'on les employoit aux cérémonies du baptême des princes, comme un symbole de la vie de lumiere dans laquelle ils alloient entrer par la foi.
L'illumination de la chandeleur, dont le nom a tant de conformité avec les lamptéries des Grecs, peut être attribuée, dans son institution, à une condescendance des papes, pour s'accommoder à la portée des néophytes qui étoient mêlés avec les Gentils, & leur rendre la privation des spectacles moins sensible. J'aimerois donc mieux dire que le christianisme a tout sanctifié, qu'il a heureusement changé les lustrations des payens en purifications chrétiennes, que de soutenir que nos fêtes n'ont point d'analogie avec celles du paganisme, ou me persuader que leur ressemblance est un effet du hasard. (D.J.)
|
| LANCASHIRE | (Géog.) ou la province de Lancastre, en latin Lancastria, province maritime d'Angleterre, au diocèse de Chester, le long de la mer d'Irlande qui la borne au couchant. Les provinces du Cumberland & de Westmorland, la terminent au nord & au nord-est ; Yorckshire au levant, & Cheshire au midi. Elle a 170 milles de circuit, contient environ 11 cent 50 milles arpens, & 40 mille 202 maisons. L'air y est fort bon, les habitans robustes, & les femmes très-belles. Les rivieres de cette province sont le Mersey ; la Ribble & le Long ; ses deux lacs sont le Winder & le Merton. Le Winder a dix milles de longueur sur quatre de large, & c'est le plus grand lac qu'il y ait en Angleterre. Les anciens habitans de ce comté étoient les Brigantes.
Cette province est du nombre de celles qu'on nomme Palatines, & elle a donné à plusieurs princes du sang le titre de ducs de Lancastre. Ses villes principales ou bourgs, sont Lancastre capitale, Clitero, Leverpool, Preston, Wigan, Newton, Manchester.
Entre les gens de lettres que cette province a produits, je ne citerai que le chevalier Henri Brotherton, l'évêque Fleetwood & Guillaume Vitaker.
On doit au premier des observations & des expériences curieuses, publiées dans les Transact. philos. Juin 1697. n °. 177. sur la maniere dont croissent les arbres, & sur les moyens de faciliter cet accroissement.
Fleetwood mort évêque d'Ely en 1723, âgé de 67 ans, a illustré son nom par des ouvrages où regne une profonde connoissance de la Théologie & des antiquités sacrées.
Vitaker décédé en 1545, à l'âge de 45 ans, est de tous les antagonistes du cardinal Bellarmin, celui qui l'a réfuté avec le plus d'érudition & de succès.
Les curieux de l'histoire naturelle de la province de Lancastre, doivent se procurer l'ouvrage de Leigh, intitulé Leigh's (Charles) A natural History of Lancashire, Chelshre, and the Peak in Derbishire. Oxoniae, 1700, in-fol. C'est un bien bon livre. (D.J.)
|
| LANCASTRE | (Géog.) le Mediolanum des anciens, selon Cambden, ville à marché d'Angleterre, capitale du Lancashire ; elle a donné le titre de duc à plusieurs princes du sang d'Angleterre, fameux dans l'histoire par leurs querelles avec la maison d'Yorck. Elle est sur le Lon, à 5 milles de la mer d'Irlande, & à 187 N. O. de Londres. Long. 14. 35. lat. 54. (D.J.)
|
| LANCE | S. f. (Art milit.) arme offensive que portoient les anciens cavaliers, en forme d'une demi-pique.
La lance est composée de trois parties, qui sont la fleche ou le manche, les aîles, & le dard ou la pointe. Pline attribue l'invention des lances aux Etésiens. Varron & Aulugelle disent que le mot de lance est espagnol, d'où quelques auteurs concluent que les Italiens s'étoient servis de cette arme à l'imitation des Espagnols.
Diodore de Sicile fait dériver ce mot du gaulois, & Festus du grec , qui a la même signification.
La lance fut longtems l'arme propre des chevaliers & des gendarmes. Il n'étoit permis qu'aux personnes de condition libre de la porter dans les armées ; elle est appellée dans le latin lancea ; mais elle est aussi très-souvent signifiée par le mot hasta. C'est dans cette signification que Guillaume le Breton la prend en parlant des armes propres des gentilshommes,
Ut famuli quorum est gladio pugnare & hastis.
On les faisoit d'ordinaire de bois de frêne, parce qu'il est roide & moins cassant. Les piques de notre tems étoient de même bois par la même raison. Dans l'énumération des armes qu'on donne à Géoffroi, duc de Normandie, que j'ai tirée de Jean, moine de Marmoutiers ; il est dit qu'entr'autres armes, on lui mit en main une lance de bois de frêne, armée d'un fer de Poitou, & Guillaume le Breton, en parlant du combat de Guillaume des Barres contre Richard d'Angleterre auprès de Mantes, dit en style poétique, que leurs boucliers furent percés par le frêne, c'est-à-dire par leurs lances de bois de frêne :
Utraque per clipeos ad corpora fraxinus ibat.
Le passage d'un autre auteur nous apprend la même chose, & en même tems que ces lances étoient fort longues. " Les lances des François, dit-il, étoient de bois de frêne, avoient un fer fort aigu, & étoient comme de longues perches ", Hastae fraxineae in manibus eorum ferro acutissimo praefixae sunt, quasi grandes perticae. Mais depuis on les fit plus grosses & plus courtes, & je crois que ce changement se fit un peu avant Philippe de Valois, que la mode vint que les chevaliers & la gendarmerie combatissent à pié, même dans les batailles & les combats réglés.
Dans ces occasions-là même, lorsqu'ils se mettoient à pié, ils accourcissoient encore leurs lances, en les coupant par le bout du manche. Cela s'appelloit retailler les lances. C'est ce que témoigne Froissard en divers endroits de son histoire. Voici ce que dit sur cela le président Fauchet en peu de mots.
" La lance qui aussi s'appelloit bois, je crois par excellence & encore glaive, & puis quand elles furent grosses, bourdons & bourdonnasses ; quand elles furent creuses, se dit Philippes de Comines, en parlant de la bataille de Fournoue, mais le même Comines témoigne qu'elles étoient creuses. Quant à la lance, elle a toujours été arme de cavalier, plus longue toutefois que celles d'aujourd'hui, comme celles des Polonois, laquelle encore que les chevaliers n'eussent point d'arrêt ferme, à cause que leurs hauberts étoient de mailles, on n'eut su où les clouer (ces arrêts) sur les mailles, les chevaliers ne laissoient pas de clouer sur l'arson de la selle de leurs chevaux, je crois bandée à l'angloise ; mais il ne me souvient point d'avoir vu peintes des lances qui eussent des poignées comme aujourd'hui, avant l'an 1300, ains toutes unies depuis le fer jusqu'à l'autre bout, comme javelines, lesquelles, même du tems de Froissard, les chevaliers étant descendus à pié, rognoient pour mieux s'en aider au poussis. En ce tems-là, les chevaliers croyoient que les meilleurs fers de lances venoient de Bourdeaux.... Après l'envahie, eslais ou course du tems de Froissard, il falloit mettre pié à terre, rogner son glaive, c'est-à-dire sa lance, & d'icelui pousser tant qu'on eût renversé son ennemi ; cependant choisissant la faute de son harnois pour le blesser & tuer. Et lors ceux qui étoient plus adroits & avoient meilleure haleine pour durer à ce poussis de lance, étoient estimés les plus experts hommes d'armes, c'est-à-dire dextres, & rusés, & experts ".
On ornoit les lances d'une banderole auprès du fer, & cet ornement avoit bonne grace ; c'étoit une coutume très-ancienne, & dès le tems des croisades.
D'ordinaire, dans ces rudes chocs, les lances se fracassoient & sautoient en éclats. C'est pourquoi dans les tournois pour dire faire un assaut de lances, on disoit rompre une lance ; ainsi le combat de cheval, quand il se faisoit à la lance, ne duroit qu'un moment. On la jettoit après le premier choc, & on en venoit à l'épée. Guillaume Guiart, en racontant la descente de S. Louis à Damiette, dit :
Après le froissis des lances,
Qui j à sont par terre semées,
Portent mains à blanches épées,
Desquelles ils s'entre-envahissent
Hiaumes, & bacinets tentissent,
Et plusieurs autres ferrures,
Coutiaux très-perçans armures.
Quand, dans le combat de deux troupes de gendarmerie l'une contre l'autre, on voyoit dans l'une les lances levées, c'étoit un signe d'une prochaine déroute. C'est ce qu'observe d'Aubigné dans la relation de la bataille de Coutras. En effet, cela marquoit que les gendarmes ne pouvoient plus faire usage de leurs lances, parce qu'ils étoient serrés de trop près par les ennemis.
L'usage des lances cessa en France beaucoup avant le tems que les compagnies d'ordonnance fussent réduites à la gendarmerie d'aujourd'hui. Et le prince Maurice l'abolit entiérement dans les armées de Hollande. Il en eut une raison particuliere : c'est que les pays où il soutenoit la guerre contre les Espagnols sont marécageux, coupés de canaux & de rivieres, fourrés & inégaux, & qu'il falloit pour les lanciers, des pays plats & unis, où ils pussent faire un assez grand front, & courir à bride abattue sur la même ligne, dès qu'ils avoient pris carriere, c'est-à-dire dès qu'ils commençoient à piquer, ce qu'ils faisoient d'ordinaire à soixante pas de l'ennemi.
Mais il eut encore d'autres raisons qui lui furent communes avec la France. Les lanciers jusques à ce tems-là étoient presque tous gentilshommes ; & même Henri III. par son ordonnance de 1575, avoit déclaré que non seulement les lanciers, mais encore les archers des ordonnances devoient être de noble race. Or les guerres civiles avoient fait périr une infinité de noblesse en France, aussi-bien que dans les Pays-bas, ce qui faisoit qu'on avoit peine à fournir de gentilshommes les compagnies d'ordonnance.
Secondement, il falloit que les lanciers eussent de grands chevaux de bataille très-forts, de même taille, dressés avec grand soin, & très-maniables pour tous les mouvemens que demandoit le combat avec la lance. Il étoit difficile d'en trouver un grand nombre de cette sorte, ils coûtoient beaucoup d'argent, & bien des gentilshommes n'étoient pas en état de faire cette dépense ; les guerres civiles ayant ruiné & désolé la France & les Pays-bas.
Troisiemement, le combat de la lance supposoit une grande habitude pour s'en bien servir, & un exercice très-fréquent où l'on élevoit les jeunes gentilshommes. L'habileté à manier cette arme s'acquéroit dans les tournois & dans les académies ; les guerres civiles ne permettoient plus guere depuis long-tems l'usage des tournois ; & la jeune noblesse, pour la plûpart, s'engageoit dans les troupes sans avoir fait d'académie, & par conséquent n'étoit guere habile à se servir de la lance. Toutes ces raisons firent qu'on abandonna la lance peu à peu, & qu'on ne s'en servoit plus guere sous le regne de Henri IV. Il ne paroît point par notre histoire qu'il y ait eu d'ordonnance pour abolir cet usage. Mais George Basta, fameux capitaine dans les armées de Philippe II. roi d'Espagne, & celles de l'Empire, marque expressément le retranchement des lances dans les armées françoises sous Henri IV. car il écrivoit du tems de ce prince ; c'est dans l'ouvrage qu'il publia sur le gouvernement de la cavalerie légere, ou voici comme il parle : " L'introduction des cuirasses, c'est-à-dire des escadrons de cuirassiers en France, avec un total bannissement des lances, a donné occasion de discourir quelle armure seroit la meilleure, &c ". C'est donc en ce tems-là que les lances furent abolies en France. Les Espagnols s'en servirent encore depuis, mais ils en avoient peu dans leurs troupes. Les Espagnols seuls, dit le duc de Rohan dans son Traité de la guerre, dédié à Louis XIII, ont encore retenu quelques compagnies de lances, qu'ils conservent plutôt par gravité que par raison : car la lance ne fait effet que par la roideur de la course du cheval, & encore il n'y a qu'un rang qui s'en puisse servir, tellement que leur ordre ne doit être de combattre en haie, ce qui ne peut résister aux escadrons ; & si elles combattoient en escadrons, elles feroient plus d'embarras que de service.
On voit par ce que je viens de dire, l'époque de l'abolition des lances en France, arme que les François avoient su manier de son tems mieux qu'aucune autre nation. On ne s'en sert plus aujourd'hui que dans les courses de bagues, & quelques semblables exercices utiles autrefois par rapport à la guerre, & qui ne sont plus maintenant que de purs divertissemens. Hist. de la milice françoise, par le P. Daniel.
LANCE, (Hist. de la Chevalerie) du tems de l'ancienne chevalerie, le combat de la lance à course de cheval étoit fort en usage, & passoit même pour la plus noble des joûtes. Un chevalier tient ce propos à son adversaire dans le roman de Florès de Grece : " Pendant que nous sommes à cheval, & que les lances ne nous peuvent manquer, éprouvons-nous encore quelque tems, étant comme il m'est avis, le plaisir de la course à lance, trop plus beau que le combat à l'épée ". C'est pour cette raison que la lance affranchissoit l'épée, & que l'épée n'affranchissoit pas la lance. On ne parloit dans les récits de joûtes que de lances à outrance, lances à fer émoulu, lances courtoises, lances mousses, lances frettées & mornées ; ces dernieres étoient des lances non pointues, qui avoient une frette, morne ou anneau au bout.
De cette passion qui regnoit alors, de montrer à la lance sa force & son adresse, vinrent ces expressions si fréquentes dans les livres de chevalerie, faire un coup de lance, rompre des lances, briser la lance, baisser la lance. Cette derniere expression signifioit, céder la victoire, & nous le disons encore en ce sens au figuré.
Cependant tous les combats d'exercices & d'amusemens à la lance, cesserent dans ce royaume par l'accident d'un éclat de lance qu'Henri II. reçut dans l'oeil le 29 Juin 1559, en joûtant contre le comte de Montgommery. On sait que ce prince en mourut onze jours après.
Enfin l'usage de la lance qui continuoit à la guerre, perdit toute sa gloire à la journée de Pont-Charra, où Amédée, duc de Savoie, fut défait par Lesdiguieres l'an 1591. Voyez-en les raisons dans Mezeray, tome III. p. 900. Et si vous voulez connoître les avantages & les défauts de cette ancienne arme de cavalerie, George Basta, Walhausen, & surtout Montecuculli, vous en instruiront. (D.J.)
LANCE, (Iconolog.) les anciens Sabins représentoient leur dieu Quirinus sous la forme d'une lance, parce que la lance étoit chez eux le symbole de la guerre. Les Romains emprunterent de cette nation la même coutume, avant qu'ils eussent trouvé l'art de donner des figures humaines à leurs statues. Il y avoit d'autres peuples, selon Justin, qui, par des raisons semblables, rendoient leur culte à une lance, & c'est de-là, dit-il, que vient l'usage de donner des lances aux statues des dieux. (D.J.)
LANCE D'EAU, (Hydr.) voyez JET-D'EAU.
LANCE ou PIQUE, (Chirurgie) instrument de Chirurgie, pour ouvrir la tête du foetus mort & arrêté au passage. M. Mauriceau en est l'inventeur. Il est fait comme le couteau à crochet, dont nous avons parlé en son lieu, excepté que son manche n'a point de bec. Son extrémité est un fer de pique, fait en coeur, long d'un pouce & demi, fort aigu, pointu & tranchant sur les côtés. On introduit cette lance dans le vagin, à la faveur de la main gauche, & l'on perce la tête de l'enfant entre les pariétaux, s'il est possible, pour donner entrée à un autre instrument, appellé tire-tête. Voyez la fig. 2. Pl. XX. (Y)
LANCE A FEU ; (Artificier) Les lances à feu sont de gros & longs tuyaux ou canons de bois, emmanchés par le bout avec de bons bâtons bien retenus, pour soutenir la force du feu, & percés en divers endroits pour contenir les fusées ou les pétards qu'on y applique.
On s'en sert dans les feux de joie où l'on veut représenter des combats nocturnes, tant pour jetter des fusées, que pour faire une scopeterie, c'est-à-dire un bruit en l'air par plusieurs coups tirés ensemble.
Il se fait avec une feuille de grand papier à dessiner, du plus fort ; on la roule par sa largeur sur une baguette, qui est de la grosseur d'une baguette de mousquet & d'un pié & demi de long. Ce papier étant roulé, on le colle tout du long pour l'arrêter ; ensuite on fait entrer dans un des bouts de ce cartouche, environ avant d'un pouce, un morceau de bois que l'on appelle le manche, ou le pié de la lance, & qui est de son calibre, après l'avoir trempé dans la colle, afin qu'il puisse bien tenir ; l'autre bout de ce manche est plat, & percé de deux trous pour l'attacher avec des clous sur ce que l'on veut.
La composition doit être de quatre onces de salpêtre bien raffiné & mis en poudre, de deux onces de poudre & de poussier passé dans un tamis de soie bien fin, une once de soufre en fleur ; on mélange le tout ensemble, & on le passe dans un tamis de crin un peu gros après l'avoir bien remué.
On met cette composition dans une sebille de bois ; on la prend ensuite avec une carte à jouer, que l'on coupe en houlette, & l'on s'en sert pour charger la lance. A mesure que l'on charge avec cette houlette, on frappe cette charge, en y faisant entrer la baguette qui a servi à rouler le cartouche, & avec une petite palette de bois ; & lorsqu'on est au quart de la hauteur de la lance, on met de la poudre la valeur de l'amorce d'un pistolet, qu'on serre doucement avec la baguette sans frapper, & l'on continue ainsi jusqu'à quatre fois ; jusqu'à ce que la lance soit pleine jusqu'au haut ; après quoi l'on prend un peu de poudre écrasée qu'on trempe dans l'eau pour lui servir d'amorce, & on la colle ensuite avec un peu de papier. Voyez nos Pl. d'Artifice.
LANCE, (Stucateur) lance ou spatule dont se servent les sculpteurs en stuc. Voyez les Pl. du Stuc.
|
| LANCER | v. act. (Gramm.) c'est jetter avec force. Ce verbe a différentes acceptions. Voyez les articles suivans.
LANCER une manoeuvre, (Marine) c'est amarrer une manoeuvre, en la tournant autour d'un bois mis exprès pour cet usage.
LANCER, (Marine) navire qui lance bas-bord ou stribord ; cela se dit d'un vaisseau qui, au lieu d'aller droit à sa route, se jette d'un côté ou d'autre, soit que le timonnier gouverne mal, soit par quelqu'autre raison.
LANCER un vaisseau à l'eau, (Marine) Le terrein sur lequel on construit le vaisseau, & qu'on appelle le chantier, est incliné & va en pente jusqu'à l'eau : cette inclinaison est ordinairement de six lignes sur chaque pié de longueur. On prolonge ce chantier jusques dans l'eau, en y ajoutant d'autres poutres & d'autres tins, qui forment un plan toujours également incliné, & on met au-dessus de forts madriers pour servir de chemin à la quille, retenue dans une espece de coulisse formée par de longues tringles paralleles. On place ensuite de chaque côté jusqu'à l'eau, des poutres qu'on nomme coites, & qui étant éloignées les unes des autres à-peu-près à la distance de la demi-largeur du vaisseau, répondent vers l'extrémité du plat de la maîtresse varangue. Comme elles ne peuvent être assez hautes pour parvenir jusqu'à la carene du vaisseau, quoiqu'elles soient fort avancées dessous, on attache deux autres pieces de bois appellées colombiers, qui s'appuient sur les coites, & qui peuvent glisser dessus. Ces poutres sont frottées avec du saindoux ou avec du suif ; on frotte de même la quille. On attache ensuite le vaisseau par l'avant, par les côtés & par-derriere à un des gonds du gouvernail. Des hommes tiennent les cordes des côtes & de l'avant, & la corde de derriere, qu'on appelle corde de retenue, est liée à un gros pieu qui est en terre.
Les choses ainsi disposées, on ôte, à coups de massue, les anciens coins, & on en substitue sur le champ de nouveaux, pour soutenir la quille dans le tems qu'elle coulera ; enfin on coupe les acores & les étances de devant & des côtés & la corde de retenue, & dans l'instant le vaisseau part. Il faut alors jetter de l'eau sur l'endroit où il glisse, crainte que le feu n'y prenne par le grand frottement, & mettre tout en oeuvre pour accélérer la marche du vaisseau. A cette fin on engage sous la quille de longues solives par le bout pour l'ébranler & lui donner du mouvement si le vaisseau ne part pas assez vîte. Les hommes qui tiennent les cordes de l'avant, comme on l'a dit ci-dessus, les tirent alors ou les roidissent par le moyen des cabestans, & ils hâlent celles des côtés pour retenir le vaisseau dans sa chûte, ou pour diminuer la force du choc dans l'eau, qui lui seroit préjudiciable.
Cette maniere de lancer les vaisseaux à l'eau, qui est la meilleure qu'on ait imaginé, n'est pas cependant suivie par les Portugais. Ils croient qu'il vaut mieux que le vaisseau entre dans l'eau par la poupe que par la proue. Il n'est pas aisé de découvrir sur quelles raisons ils fondent une pareille manoeuvre.
Dans la nord-Hollande, pour lancer les vaisseaux à l'eau, on les fait passer sur une digue qui s'éleve en talud des deux côtés, & qui est frottée de graisse. Le vaisseau est construit sur un pont à rouleaux au bas de la digue. On amarre deux cordes à l'étrave en deux endroits, & autant à la quille, & on ceintre l'arriere avec d'autres cordes. Ces cordes passent par divers vindas ou cabestans, dans chacun desquels il y a deux poulies & trois rouets dans chaque poulie. Vingt à trente hommes virent ces machines, tandis que d'autres sont attentifs à roidir les cordes de l'arriere lorsque le bâtiment vient à rouler. On le monte d'abord au haut de la digue ; & quand il y est parvenu, on le met sur la pente qui conduit à l'eau, & on le suit à-peu-près de la même façon qu'on l'a suivi pour le faire monter. Cette méthode est aussi fort bonne.
LANCER LA NAVETTE, (Rubanier) voici ce que c'est : lorsqu'un ouvrier commence un ouvrage, ou même lorsqu'il remonte sur son métier, il faut toujours que sa navette commence à lever par sa main gauche, parce que sa premiere marche est marchée du pié gauche, la main devant suivre le pié du même côté. Il y a encore une autre raison de cet usage ; si c'étoit la main droite qui partît la premiere, la navette reviendroit (au dernier coup du cours de marche) dans cette même main droite : il faudroit donc que l'ouvrier changeât sa navette de main pour pouvoir tirer un autre retour ; ce qui, outre l'embarras, feroit beaucoup perdre de tems, puisque ces retours sont toujours à sa main droite.
LANCER LE CERF, (Chasse) c'est le faire partir de la reposée comme les autres bêtes fauves.
Autrefois on ne lançoit qu'avec les limiers ; à-présent on découple les chiens de meute pour lancer le cerf.
Lancer un loup, c'est le faire partir du liteau.
Lancer un lievre, c'est le faire sortir du gîte.
Lancer une bête noire, c'est la faire partir de la bauge. Voyez nos Pl. de Chasse.
|
| LANCEROT | ou LANCELOTE, (Géog.) île de l'Afrique, l'une des Canaries, d'environ 12 lieues de longueur sur 7 de largeur, selon Delisle. On la met à 40 lieues françoises de la côte du continent la plus proche, au nord-est de Forteventura, dont elle est séparée par un détroit de 5 lieues de large, & comme couronnée au nord par quatre petites îles ; savoir, Sainte-Claire, Alagranca, Rocca & Graciosa. Elle fut découverte en 1417 par Jean de Bethencourt, qui la céda au roi de Castille, d'où elle est passée à l'Espagne. Long. 5. 25. lat. 28. 40. (D.J.)
|
| LANCETTE | S. f. (Chirurgie) c'est un petit instrument de Chirurgie, d'un acier extrêmement fin, très-pointu & à deux tranchans, qui sert principalement à ouvrir la veine.
Cet instrument est composé d'une lame & d'une châsse ou manche. La lame est faite en pyramide, dont la pointe est très-aiguë : elle ne doit pas excéder un pouce 6 ou 7 lignes sur 4 de largeur à sa base. Le corps de la lancette, qui est d'environ sept lignes de longueur, ne coupe point sur les côtés, mais le poli, qui est long de sept à huit lignes, est très-tranchant & très-net jusqu'à la pointe. La base, qui en fait le talon, est engagée dans la châsse par le moyen d'un clou de laiton, autour duquel elle tourne pour pouvoir s'ouvrir & se nettoyer facilement. La châsse, qui est longue de deux pouces quatre à cinq lignes, est composée de deux petites lames d'écailles fort minces & polies, qui ne sont point arrêtées ensemble par leur extrémité.
On fait ordinairement de quatre sortes de lancettes ; la premiere est à grain d'orge, figure 13. Pl. I. elle est plus large vers la pointe que les autres, afin de faire une plus grande ouverture en saignant ; elle convient pour les vaisseaux gros & superficiels : cette lancette dispense de faire une élevation après la ponction ; & dans ce cas elle peut convenir aux commençans. La seconde est appellée lancette à grain d'avoine, figure 11. Pl. I. parce que sa pointe est plus allongée que celle de la précédente : elle est propre à tous les vaisseaux, principalement à ceux qui sont profonds : en la retirant on peut faire une élevation aussi grande qu'on le juge-à-propos. La figure 12. en représente une autre plus petite pour les saignées difficiles. La troisieme est en pyramide ou à langue de serpent ; elle va toujours en diminuant, & se termine par une pointe très-longue, très-fine & très-aiguë : elle ne convient qu'aux vaisseaux les plus profonds, figure 14. Pl. I. La quatrieme est nommée lancette à abscès ; elle est plus forte, plus longue & plus large que les autres ; sa lame a deux pouces & demi de longueur ; sa pointe est à grain d'avoine, sans être extrèmement fine, crainte qu'elle ne se casse, fig. 10. Pl. I. On peut ouvrir les abscès superficiels & faire des scarifications avec ces quatre especes de lancettes. En Allemagne on saigne très-adroitement avec une flamme à ressort : cet instrument n'est point en usage en France. Voyez PHLEBOTOMIE. (Y)
LANCETTE, (Graveur en bois) outil de graveur en bois ; c'est un ferrement de la forme des lancettes des Chirurgiens, tranchant des deux côtés & fort aigu, qui est emmanché dans un petit bâton ; il sert aux graveurs en bois pour évider les petits points blancs qui se trouvent entre les hachures qui se croisent en cette sorte, ce qui se fait en enfonçant la lancette obliquement aux quatre faces du point blanc ; par ce moyen on enleve une petite pyramide de bois dont la base est le point blanc, & le sommet au fond du trou qu'elle fait dans la planche. Mais comme l'encre des Imprimeurs en lettre ne s'applique que sur la surface de la planche, & non dans les creux, il suit que le papier ne doit recevoir l'empreinte que des parties saillantes de la planche, & laisser du blanc vis-à-vis des creux qui y sont. Voyez nos Planches de gravure en bois.
|
| LANCIA | (Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne dans l'Asturie ; elle est qualifiée ville très-forte, validissima civitas, par Florus, l. IV. c. xij. (D.J.)
|
| LANCIA OPPIDANA | (Géog. anc.) ancienne ville de Lusitanie, chez les Vettons, selon Ptolomée, l. II. c. v. Pline nomme les habitans de cette ville Lancienses. On en trouve encore un monument du siecle d'Auguste dans une inscription de Gruter, p. 199. n. 3.
Term. Aug. inter
Lanc. Oppi. & Igaedit.
C'est peut-être présentement la penna di Francia. (D.J.)
|
| LANCIAN | ou LANCIANA ANXANUM, (Géog.) ville d'Italie au royaume de Naples, dans l'Abruze citérieure, dont elle est la capitale, avec un archevêché érigé en 1562. Elle est située sur le torrent de Feltrino, à 6 lieues S. E. de Chieti, 30 N. E. de Naples. Long. 32. 40. lat. 42. 12. (D.J.)
|
| LANCIER | S. m. (Art méchan.) c'est un ouvrier qui fait des lances.
|
| LANCIS | S. m. (en Architecture) ce sont dans le jambage d'une porte ou d'une croisée, les deux pierres plus longues que le pié qui est d'une piece. Ces lancis se font pour ménager la pierre qui ne peut pas toujours faire parpin dans un mur épais.
Lancis de moilon, il se dit, lorsqu'on refait le parement d'un vieux mur avec du moilon, & qu'on lance le plus avant que faire se peut avec plâtre ou mortier de chaux & sable.
|
| LANCKHEIM | (Géog.) petite ville de Thuringe, sur la riviere d'Itsch, dans la principauté de Cobourg.
|
| LANÇOIR | S. m. (Econom. rustiq.) ouverture par laquelle s'écoule l'eau des moulins lorsqu'ils ne vont pas.
|
| LANÇO | ou ÉGUILLETTES, ou ORPHIES, (Ichol.) sorte de petit poisson. Voyez ÉGUILLETTES.
|
| LANÇU | (Hist. mod.) nom que les Chinois donnent à une secte de leur religion. L'auteur de cette secte étoit un philosophe contemporain de Confucius, & qui fut appellé Lançu ou Lanzu, c'est-à-dire philosophe ancien, parce qu'on feint qu'il demeura quatre-vingt ans dans le ventre de sa mere avant que de naître. Ses sectateurs croient qu'après la mort leurs ames & leurs corps sont transportés au ciel pour y goûter toutes sortes de délices. Ils se vantent aussi d'avoir des charmes contre toute sorte de malheurs, de chasser les démons, &c. Kircher, de la Chine.
|
| LANCUT | (Géog.) ville du royaume de Pologne, dans le palatinat de Russie ou Reussen.
|
| LAND & LANDT | (Géogr.) Le mot land ou landt, dans les langues du Nord, signifie pays, & entre dans la composition de plusieurs noms, Landgrave, Zéland, Gotland, Hollande. Quand nous disons lande en françois, nous faisons du genre féminin les mots à la fin desquels lande se trouve dans la composition, comme la Zélande, la Hollande, & nous donnons le genre masculin à ceux où nous mettons le mot de land ou de landt, ce qui fait qu'un même mot est quelquefois du genre masculin ou féminin, selon que nous l'écrivons, comme le Groenland ou la Groenlande. La plûpart des provinces de Suede ont leur nom composé de celui de land, & du nom des anciens peuples qui l'habitoient ; l'île de Gotland, par exemple, signifie pays des Goths ; l'Amelande signifie pays des Amales : on dit encore en bas-breton lannec dans le même sens. (D.J.)
|
| LAND | TRAIT ou JET DE FILETS, terme de Pêche usité dans le ressort de l'amirauté de Marennes. C'est la manoeuvre qui se fait depuis qu'on a jetté un filet à la mer jusqu'à ce qu'on le releve.
|
| LANDA | (Géogr.) ville de la grande Pologne, dans le palatinat de Kalisch.
|
| LANDAFF | (Géog.) petite ville & évêché d'Angleterre, au pays de Galles, dans le comté de Glamorgan, sur la Tave, un peu au-dessus de Cardiff, à 30 milles de Bristol au couchant, & à 123 milles de Londres. Long. 14. 20. latit. 51. 32. (D.J.)
|
| LANDAU | Landavia, (Géogr.) ville de France très-forte, dans la basse Alsace, au pays de Wasgou, autrefois impériale, mais sujette à la France par la paix de Munster. L'empereur Joseph la prit, n'étant que roi des Romains, en 1702. Les François la reprirent en 1703, & les Impériaux en 1704. Enfin, par le traité de Bade, elle a été cédée à la France, qui l'avoit reprise en 1713. Voyez ce qu'en disent Heiss, Longuerue & Piganiol de la Force : mais voyez principalement l'article de Landau dans le dictionnaire de Bayle, parce qu'il est rempli de réflexions utiles, applicables en tout tems & en tous lieux, aux récits de siéges & de batailles que les nouvellistes de puissances belligérantes repandent dans le public, pour inspirer la confiance ou tromper la crédulité des peuples.
Landau est sur le Queich, vers les frontieres du palatinat, à une égale distance de Spire & du Rhin, dans un pays agréable & fertile, à 3 lieues & demie S. de Neustatt, 5 O. de Philipsbourg, 6 S. O. de Spire, 15 N. E. de Strasbourg, 108 N. E. de Paris. Longit. 25. 47. 30. latit. 49. 11. 38.
Landaw est encore le nom de deux petites villes d'Allemagne, l'une dans la basse Baviere sur l'Iser, à 4 milles de Straubing ; l'autre sise sur une montagne, au comté de Valdeck. (D.J.)
|
| LANDEN | Landenum, (Géog.) petite ville des Pays-bas autrichiens, dans le Brabant, au quartier de Louvain, fameuse par la bataille meurtriere que le maréchal de Luxembourg y gagna sur les alliés, le 29 Juillet 1693. On appelle aussi cette journée la bataille de Nerwinde, nom d'un village voisin. Landen est sur le Beck, à 2 lieues de Tillemont, 7. N. O. de Huy, 7. S. E. de Louvain, 8. N. E. de Namur. Long. 22. 40. latit. 50. 45. (D.J.)
|
| LANDERNEAU | Landernacum, (Géogr.) petite ville de France dans la basse Bretagne, sur la riviere d'Elhorn, à 8 lieues E. de Brest. Long. 13. 22. latit. 48. 25. (D.J.)
|
| LANDES | S. f. (Agriculture) pays inculte, peu propre au labour, rempli de joncs, de bruyeres, serpolets, joncs-marins, où l'on ne peut faire venir du bois.
LANDES, (les) ou LES LANES, Ager Syrticus, (Géog.) pays de France dans la Gascogne. On le nomme quelquefois les landes de Bordeaux ; c'est un pays de sable & de bruyeres, dont les lieux principaux sont Dax, Tartas, Albret, Peirourade. Le sénéchal des Landes est une charge d'épée, dont le bailliage du pays de Labour dépend. On divise les Landes en grandes & petites ; les grandes sont entre Bordeaux & Bayonne, les petites sont entre Bazas & le mont de Marsan. (D.J.)
|
| LANDFOCTIE | (Géog.) ce mot d'origine allemande, land-vochtey, & travesti à la françoise, peut se rendre autrement par bailliage ou préfecture, & en latin par praefectura. On dit cependant la landfoctie de Haguenau, pour signifier une partie de l'Alsace ; dont Haguenau est le chef-lieu. (D.J.)
|
| LANDGRAVE | S. m. (Hist. mod.) ce mot est composé de deux mots allemands : land, terre, & de graff ou grave, juge ou comte. On donnoit anciennement ce titre à des juges qui rendoient la justice au nom des empereurs dans l'intérieur du pays. Quelquefois on les trouve désignés sous le nom de comites patriae & de comites provinciales. Le mot landgrave ne paroit point avoir été usité avant l'onzieme siecle. Ces juges, dans l'origine, n'étoient établis que pour rendre la justice à un certain district ou à une province intérieure de l'Allemagne, en quoi ils différoient des marggraves, qui étoient juges des provinces sur les limites : peu-à-peu ces titres sont devenus héréditaires, & ceux qui les possédoient se sont rendus souverains des pays dont ils n'étoient originairement que les juges. Aujourd'hui l'on donne le titre de landgrave par excellence à des princes souverains de l'Empire qui possedent héréditairement des états qu'on nomme landgraviats, & dont ils reçoivent l'investiture de l'empereur. On compte quatre princes dans l'Empire qui ont le titre de landgraves ; ce sont ceux de Thuringe, de Hesse, d'Alsace & de Leuchtenberg. Il y a encore en Allemagne d'autres landgraves : ces derniers ne sont point au rang des princes ; ils sont seulement parmi les comtes de l'Empire ; tels sont les landgraves de Baar, de Brisgau, de Burgend, de Kletgow, de Nellenbourg, de Saussemberg, de Sisgow, de Steveningen, de Stulingen, de Suntgau, de Turgow, de Walgow. (-)
|
| LANDI | S. m. (Hist. mod.) foire qui se tient à Saint Denis-en-France. C'est un jour de vacance pour les jurisdictions de Paris & pour l'université. C'est le recteur qui ouvre le landi. Il se célébroit autrefois à Aix-la-Chapelle. Charles le Chauve l'a transféré à Saint-Denis avec les reliques, les clous & la couronne de N. S.
Landi se disoit encore d'un salaire que les écoliers payoient à leurs maîtres vers le tems de la foire de ce nom. C'étoient six ou sept écus d'or, qu'on fichoit dans un citron, & qu'on mettoit dans un verre de crystal. Cet argent servoit à défrayer le recteur & ses suppôts lorsqu'ils alloient ouvrir la foire à Saint-Denis.
LANDI stato di (Géog.) nom d'un district assez considérable d'Italie, sur les frontieres des états de la république de Gènes, dépendant du duché de Plaisance.
|
| LANDIER | S. m. (Gramm. & Cuisine) grand chenet de cuisine. On ne sait d'où vient le proverbe, froid comme un landier, si ce n'est que cet épais instrument, quoique toujours dans le feu, n'est presque point échauffé.
|
| LANDIES | S. f. (terme d'Anat.) nymphes, deux productions ou excroissances charnues, situées entre les deux levres des parties naturelles de la femme. Voyez NYMPHES. Cicéron trouvoit de l'obscurité dans ces paroles, an illam dicam, à cause du rapport qu'elles ont avec lendica, d'où nous est venu le mot françois landie.
|
| LANDINOS | (Hist. mod.) c'est le nom sous lequel les Espagnols désignent les Indiens du Pérou qui ont été élevés dans les villes & dans les bourgs ; ils savent la langue espagnole, & exercent quelque métier : ils ont l'esprit plus ouvert & les moeurs plus réglées que ceux des campagnes ; cependant ils conservent presque toujours quelque chose des idées & des usages de leurs ancêtres. Il est sur tout un préjugé dont les Chrétiens n'ont point pû faire revenir les Indiens du Pérou ; ils sont persuadés que la personne qu'ils épousent a peu de mérite s'ils la trouvent vierge. Aussi-tôt qu'un jeune homme a demandé une fille en mariage, il vit avec elle comme si le mariage étoit fait, & il est le maître de la renvoyer s'il se repent de son choix après en avoir fait l'essai : ce repentir s'appelle amanarse. Les amans éprouvés se nomment ammanados. Les évêques & les curés n'ont jamais pû déraciner cet usage bizarre. Une autre disposition remarquable de ces indiens, est leur indifférence pour la mort ; ils ont sur cet objet, si effrayant pour les autres hommes, une insensibilité que les apprêts du supplice même ne peuvent point altérer. Les curés du Pérou exercent sur ces pauvres indiens une autorité très-absolue ; souvent ils leur font donner la bastonnade pour avoir manqué à quelques-uns de leurs devoirs religieux. M. d'Ulloa raconte qu'un curé ayant réprimandé un de ces indiens, pour avoir manqué d'aller à la messe un jour de fête, lui fit donner ensuite un certain nombre de coups. A peine la réprimande & la bastonnade furent-elles finies, que l'indien s'approchant du curé, d'un air humble & naïf, le pria de lui faire donner le même nombre de coups pour le lendemain, parce qu'ayant envie de boire encore, il prévoyoit qu'il ne pourroit assister à la messe. Voyez l'hist. générale des voyages, tom. XIII.
|
| LANDRECI | (Géograph.) dans les titres latins Landericiacum, Landericiae, petite & forte ville de France dans le Hainault. François I. s'en étant rendu maître, Charles V. la reprit en 1543. Louis XIV. la prit en 1655. Elle fut cédée à la France par le traité des Pyrénées. Ses fortifications sont du chevalier de Ville & du maréchal de Vauban. Elle est dans une plaine sur la Sambre, à 6 lieues N. E. de Maubeuge, 7 S. E. de Cambrai, 11 S. O. de Mons, 35 N. E. de Paris, Long. 21. 28. lat. 50. 4. (D.J.)
|
| LANDSASSE | S. m. (Hist. mod.) on appelle ainsi en Allemagne celui dont la personne & les biens sont soumis à la jurisdiction d'un souverain qui releve lui-même de l'empereur & de l'Empire, & qui a fixé son domicile dans les états de ce souverain : ou bien un landsasse est tout sujet médiat de l'Empire.
Il y a en Allemagne des pays où tous les sujets, tant ceux qui possedent des terres & des fiefs que les autres, sont landsasses, c'est-à-dire relevent du prince à qui ces états appartiennent. Telle est la Saxe, la Hesse, la Marche de Brandebourg, la Baviere, l'Autriche : on nomme ces états territoria clausa. Il y a aussi d'autres pays où ceux qui possedent des fiefs sont vassaux ou sujets immédiats de l'Empire, & ne sont soumis à aucune jurisdiction intermédiaire, tels sont la Franconie, la Souabe, le Rhin, la Weteravie & l'Alsace. Ces pays s'appellent territoria non clausa.
Il y a des pays fermés (territoria clausa) où il se trouve des vassaux qui ne sont point landsasses : ceux-là ne sont obligés de reconnoitre la jurisdiction de leur suzerain qu'en matiere féodale ; mais ceux qui sont vassaux & landsasses sont entierement soumis en tout à la jurisdiction du suzerain.
Un prince ou tout autre vassal immédiat de l'Empire peut être landsasse d'un autre, en raison des terres qu'il possede sur son territoire. Voyez Vitriarii Instit. juris publici.
|
| LANDSBERG | (Géogr.) nom de plusieurs villes d'Allemagne, l'une dans la Baviere sur la Leck, une autre dans la nouvelle Marche de Brandebourg, une troisieme dans la province de Natangen en Prusse, sur la Stein ; enfin une quatrieme en Misnie dans l'Osterland.
|
| LANDSCROON | (Géogr.) fort de France en haute Alsace, dans le Suntgau, à une lieue de Bâle, sur une hauteur. Long. 25. 7. lat. 47. 36.
|
| LANDSHUT | (Géogr.) en latin moderne Landsavia Bavarorum, ville forte d'Allemagne dans la basse Baviere, avec un château sur une côte voisine. Elle est sur l'Iser, à 14 lieues S. de Ratisbonne, 14 N. E. de Munich. Long. 29. 50. lat. 48. 53.
Landshut est encore le nom d'une petite ville de Bohême en Silésie, au duché de Schweidnitz, sur le ruisseau de Zieder.
C'est à Landshut en Baviere que nâquit Ziegler (Jacques) théologien, cosmographe & mathématicien qui fleurissoit dans le xvj. siecle. Sa description latine de la Palestine, Argent. 1536, in-folio, est très-estimée. Paul Jove parle avec grands éloges de l'élégance du tableau qu'il a fait des cruautés de Christiern II. roi de Danemark. Son ouvrage de la Scandinavie est aussi fort instructif. Enfin, ce qu'il a donné sur l'Astronomie, de constructione solidae sphaerae, Basil. 1536, in-4°. n'est point mauvais, non plus que son Commentaire latin sur le second livre de Pline, qui parut à Basle en 1531. La lecture de quelques-uns de ses ouvrages a été interdite par l'inquisition, sans qu'on en puisse trouver d'autres causes que l'ignorance des juges de ce tribunal. Ziegler mourut en 1549, âgé de 56 ans.
|
| LANDSKROON | (Géogr.) Corona, petite mais forte ville de Suede dans la province de Schon. Elle fut cédée à la Suede par le roi de Danemark en 1658, en conséquence du traité de Roschild. Elle est sur le détroit du Sund, à 5 lieues. N. O. de Lunden, 5 N. E. de Copenhague. Long. 30. 45. lat. 55, 50.
|
| LANDSTEIN | (Géog.) ville & château de Bohême dans le cercle de Bechin, sur les frontieres de la Moravie & de l'Autriche.
|
| LANDSTUL | (Géogr.) bourg d'Allemagne avec un fort château sur un rocher dans le Wasgow, entre Deux-Ponts & Keysers-Lautern. Long. 26. 20. lat. 49. 25.
|
| LANEBOURG | (Géog.) petite ville de Savoie dans le comté de Maurienne, sur la riviere d'Are, près du mont Cenis. (D.J.)
|
| LANERET | (Ornith.) Voyez LANIER.
|
| LANERK | (Géog.) ville de l'Ecosse méridionale, capitale de la province de Clydsdale, avec titre de vicomté. Elle est près de la Clyd, à 3 lieues S. O. d'Hamilton, 7 de Glasgow, 9 d'Edimbourg, 116 N. O. de Londres. Long. 44. 4. lat. 56. 10. (D.J.)
|
| LANGAGE | S. m. (Arts. Raisonn. Philos. Metaphys.) modus & usus loquendi, maniere dont les hommes se communiquent leurs pensées, par une suite de paroles, de gestes & d'expressions adaptées à leur génie, leurs moeurs & leurs climats.
Dès que l'homme se sentit entraîné par goût, par besoin & par plaisir à l'union de ses semblables, il lui étoit nécessaire de développer son ame à un autre, & lui en communiquer les situations. Après avoir essayé plusieurs sortes d'expressions, il s'en tint à la plus naturelle, la plus utile & la plus étendue, celle de l'organe de la voix. Il étoit aisé d'en faire usage en toute occasion, à chaque instant, & sans autre peine que celle de se donner des mouvemens de respiration, si doux à l'existence.
A juger des choses par leur nature, dit M. Warburthon, on n'hésiteroit pas d'adopter l'opinion de Diodore de Sicile, & autres anciens philosophes, qui pensoient que les premiers hommes ont vécu pendant un tems dans les bois & les cavernes à la maniere des bêtes, n'articulant comme elles que des sons confus & indéterminés, jusqu'à ce que s'étant reunis pour leurs besoins réciproques, ils soient arrivés par degrés & à la longue, à former des sons plus distincts & plus variés par le moyen de signes ou de marques arbitraires, dont ils convinrent, afin que celui qui parloit pût exprimer les idées qu'il desiroit communiquer aux autres.
Cette origine du langage est si naturelle, qu'un pere de l'Eglise, Grégoire de Nicée, & Richard Simon, prêtre de l'Oratoire, ont travaillé tous les deux à la confirmer ; mais la révélation devoit les instruire que Dieu lui-même enseigna le langage aux hommes, & ce n'est qu'en qualité de philosophe que l'auteur des Connoissances humaines a ingénieusement exposé comment le langage a pu se former par des moyens naturels.
D'ailleurs, quoique Dieu ait enseigné le langage, il ne seroit pas raisonnable de supposer que ce langage se soit étendu au-delà des nécessités actuelles de l'homme, & que cet homme n'ait pas eu par lui-même la capacité de l'étendre, de l'enrichir, & de le perfectionner. L'expérience journaliere nous apprend le contraire. Ainsi le premier langage des peuples, comme le prouvent les monumens de l'antiquité, étoit nécessairement fort stérile & fort borné : ensorte que les hommes se trouvoient perpétuellement dans l'embarras, à chaque nouvelle idée & à chaque cas un peu extraordinaire, de se faire entendre les uns aux autres.
La nature les porta donc à prévenir ces sortes d'inconvéniens, en ajoûtant aux paroles des significatifs. En conséquence la conversation dans les premiers siecles du monde fut soutenue par un discours entremêlé de gestes, d'images & d'actions. L'usage & la coutume, ainsi qu'il est arrivé dans la plûpart des autres choses de la vie, changerent ensuite en ornemens ce qui étoit dû à la nécessité ; mais la pratique subsista encore long-tems après que la nécessité eut cessé.
C'est ce qui arriva singulierement parmi les Orientaux, dont le caractere s'accommodoit naturellement d'une forme de conversation qui exerçoit si bien leur vivacité par le mouvement, & la contentoit si fort, par une représentation perpétuelle d'images sensibles.
L'Ecriture-sainte nous fournit des exemples sans nombre de cette sorte de conversation. Quand le faux prophete agite ses cornes de feu pour marquer la déroute entiere des Syriens, ch. iij. des Rois, 22. 11 : quand Jérémie cache sa ceinture de lin dans le trou d'une pierre, près l'Euphrate, ch. xiij : quand il brise un vaisseau de terre à la vûe du peuple, ch. xjx : quand il met à son col des liens & des joncs, ch. xxviij : quand Ezéchiel dessine le siége de Jérusalem sur de la brique, ch. jv : quand il pese dans une balance les cheveux de sa tête & le poil de sa barbe, ch. v : quand il emporte les meubles de sa maison, ch. xij : quand il joint ensemble deux bâtons pour Juda & pour Israël, ch. xxxviij ; par toutes ces actions les prophetes conversoient en signes avec le peuple, qui les entendoit à merveille.
Il ne faut pas traiter d'absurde & de fanatique ce langage d'action des prophetes, car ils parloient à un peuple grossier qui n'en connoissoit point d'autre. Chez toutes les nations du monde le langage des sons articulés n'a prévalu qu'autant qu'il est devenu plus intelligible pour elles.
Les commencemens de ce langage de sons articulés ont toûjours été informes ; & quand le tems les a polis & qu'ils ont reçu leur perfection, on n'entend plus les bégaiemens de leur premier âge. Sous le regne de Numa, & pendant plus de 500 ans après lui, on ne parloit à Rome ni grec ni latin ; c'étoit un jargon composé de mots grecs & de mots barbares : par exemple, ils disoient pa pour parte, & pro pour populo. Aussi Polybe remarque en quelqu'endroit que dans le tems qu'il travailloit à l'histoire, il eut beaucoup de peine à trouver dans Rome un ou deux citoyens qui, quoique très savans dans les annales de leur pays, fussent en état de lui expliquer quelques traités que les Romains avoient fait avec les Carthaginois ; & qu'ils avoient écrits par conséquent en la langue qu'on parloit alors. Ce furent les sciences & les beaux arts qui enrichirent & perfectionnerent la langue romaine. Elle devint, par l'étendue de leur empire, la langue dominante, quoique fort inférieure à celle des Grecs.
Mais si les hommes nés pour vivre en société trouverent à la fin l'art de se communiquer leurs pensées avec précision, avec finesse, avec énergie, ils ne surent pas moins les cacher ou les déguiser par de fausses expressions, ils abuserent du langage.
L'expression vocale peut être encore considérée dans la variété & dans la succession de ses mouvemens : voilà l'art musical. Cette expression peut recevoir une nouvelle force par la convention générale des idées : voilà le discours, la poésie & l'art oratoire.
La voix n'étant qu'une expression sensible & étendue, doit avoir pour principe essentiel l'imitation des mouvemens, des agitations & des transports de ce qu'elle veut exprimer. Ainsi, lorsqu'on fixoit certaines inflexions de la voix à certains objets, on devoit se rendre attentifs aux sons qui avoient le plus de rapport à ce qu'on vouloit peindre. S'il y avoit un idiome dans lequel ce rapport fût rigoureusement observé, ce seroit une langue universelle.
Mais la différence des climats, des moeurs & des tempéramens fait que tous les habitans de la terre ne sont point également sensibles ni également affectés. L'esprit pénétrant & actif des Orientaux, leur naturel bouillant, qui se plaisoit dans de vives émotions, durent les porter à inventer des idiomes dont les sons forts & harmonieux fussent de vives images des objets qu'ils exprimoient. De-là ce grand usage des métaphores & de figures hardies, ces peintures animées de la nature, ces fortes inversions, ces comparaisons fréquentes, & ce sublime des grands écrivains de l'antiquité.
Les peuples du nord vivans sous un ciel très-froid, durent mettre beaucoup moins de feu dans leur langage ; ils avoient à exprimer le peu d'émotions de leur sensibilité ; la dureté de leurs affections & de leurs sentimens dut passer nécessairement dans l'expression qu'ils en rendoient. Un habitant du nord dut répandre dans sa langue toutes les glaces de son climat.
Un françois placé au centre des deux extrémités, dut s'interdire les expressions trop figurées, les mouvemens trop rapides, les images trop vives. Comme il ne lui appartenoit pas de suivre la véhémence & le sublime des langues orientales, il a du se fixer à une clarté élégante, à une politesse étudiée, & à des mouvemens froids & délicats, qui sont l'expression de son tempérament. Ce n'est pas que la langue françoise ne soit capable d'une certaine harmonie & de vives peintures, mais ces qualités n'établissent point de caractere général.
Non-seulement le langage de chaque nation, mais celui de chaque province, se ressent de l'influence du climat & des moeurs. Dans les contrées méridionales de la France, on parle un idiome auprès duquel le françois est sans mouvement, sans action. Dans ces climats échauffés par un soleil ardent, souvent un même mot exprime l'objet & l'action ; point de ces froides gradations, qui lentement examinent, jugent & condamnent : l'esprit y parcourt avec rapidité des nuances successives, & par un seul & même regard, il voit le principe & la fin qu'il exprime par la détermination nécessaire.
Des hommes qui ne seroient capables que d'une froide exactitude de raisonnemens & d'actions, y paroîtroient des êtres engourdis, tandis qu'à ces mêmes hommes il paroîtroit que les influences du soleil brûlant ont dérangé les cerveaux de leurs compatriotes. Ce dont ces hommes transplantés ne pourroient suivre la rapidité, ils le jugeroient des inconséquences & des écarts. Entre ces deux extrémités, il y a des nuances graduées de force, de clarté & d'exactitude dans le langage, tout de même que dans les climats qui se suivent il y a des successions de chaud au froid.
Les moeurs introduisent encore ici de grandes variétés ; ceux qui habitent la campagne connoissent les travaux & les plaisirs champêtres : les figures de leurs discours sont des images de la nature ; voilà le genre pastoral. La politesse de la cour & de la ville inspire des comparaisons & des métaphores prises dans la délicate & voluptueuse métaphysique des sentimens ; voilà le langage des hommes polis.
Ces variétés observées dans un même siecle, se trouvent aussi dans la comparaison des divers tems. Les Romains, avec le même bras qui s'étoit appesanti sur la tête des rois, cultivoient laborieusement le champ fortuné de leurs peres. Parmi cette nation féroce, disons mieux guerriere, l'agriculture fut en honneur. Leur langage prit l'empreinte de leurs moeurs, & Virgile acheva un projet qui seroit très-difficile aux François. Ce sage poëte exprima en vers nobles & héroïques les instrumens du labourage, la plantation de la vigne & les vendanges ; il n'imagina point que la politesse du siecle d'Auguste pût ne pas applaudir à l'image d'une villageoise qui avec un rameau écume le mout qu'elle fait bouillir pour varier les productions de la nature.
Puisque du différent génie des peuples naissent les différens idiomes, on peut d'abord décider qu'il n'y en aura jamais d'universel. Pourroit-on donner à toutes les nations les mêmes moeurs, les mêmes sentimens, les mêmes idées de vertu & de vice, & le même plaisir dans les mêmes images, tandis que cette différence procede de celle des climats que ces nations habitent, de l'éducation qu'elles reçoivent, & de la forme de leur gouvernement ?
Cependant la connoissance des diverses langues, du moins celle des peuples savans, est le véhicule des sciences, parce qu'elle sert à démêler l'innombrable multitude des notions différentes que les hommes se sont formées : tant qu'on les ignore, on ressemble à ces chevaux aveugles dont le sort est de ne parcourir qu'un cercle fort étroit, en tournant sans-cesse la roue du même moulin. (D.J.)
|
| LANGE | S. m. (Gramm.) on comprend sous ce nom tout ce qui sert à envelopper les enfans en maillot. Les langes qui touchent immédiatement à l'enfant & qui servent à la propreté, sont de toile ; ceux de dessus & qui servent à la parure, sont de satin ou d'autres étoffes de soie ; les langes d'entre deux, qui servent à tenir la chaleur & qui sont d'utilité, sont de laine.
LANGES, à l'usage des imprimeurs en taille-douce, voyez l'article IMPRIMERIE en taille-douce.
|
| LANGEAC | (Géog.) Langiacum, petite ville de France dans la basse Auvergne, diocèse de Clermont, élection de Riom, proche l'Allier, entre des montagnes, à 8 lieues N. E. de Saint-Flour, 17 S. E. de Clermont. Long. 21. 10. lat. 45. 5.
|
| LANGELAND | (Géog.) Langelandia, petite île de Danemark dans la mer Baltique. Elle produit du blé, a des paturages & du poisson en abondance. Le nom de Langeland, c'est-à-dire long-pays, marque la figure de l'île, qui a 6 à 7 milles dans sa longueur, & 1 mille dans sa largeur. Il n'y a dans cette île qu'un bourg nommé Rutcoping, un château & six villages. Long. 28. 45. lat. 54. 52. 55.
|
| LANGENSALTZA | (Géogr.) ville & château d'Allemagne en Thuringe, dans les états de Saxe-Weissenfels.
|
| LANGESTRAAT | (Géog.) petit pays de la Hollande méridionale qui se trouve entre les villes de Heusden & la Mayerie de Bois-le-duc.
|
| LANGETS | ou plutôt LANGEAY, LANGEY, (Géog.) en latin Alingavia, Lingia, Langiacum, ancienne petite ville de France en Touraine sur la Loire, à 4 lieues O. de Tours. Long. 17. 58. lat. 47. 20. (D.J.)
|
| LANGHARE | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbrisseau de l'île de Madagascar, dont les feuilles sont déchiquetées comme celles du châtaignier, mais plus dures & plus piquantes. Ses fleurs naissent sur l'écorce du tronc sans avoir de queue ; ce tronc qui est droit en est tout couvert : elles sont rouges comme du sang, d'un goût âcre qui excite la salive : elles purgent violemment au point que les habitans les regardent comme un poison.
|
| LANGIONE | (Géogr.) ville d'Asie, capitale du royaume de Lar, avec un grand palais où le roi fait sa résidence. Les Talapoins seuls ont le droit de bâtir leurs couvens & leurs maisons de pierres & de briques ; cette ville est sur une petite riviere à 54 lieues N. E. d'Ava. Long. 116. 20. lat. 18. 38.
|
| LANGO | (Géog.) nom que les Grecs & les Italiens donnent à l'île de Cos des anciens. Les Turcs l'appellent Stanchio, Stango ou Stancou : c'est une des Sporades, à 20 milles de la terre ferme de Natolie. Voyez COS & STANCOU.
LANGO, (Géogr.) une des Iles de l'Archipel, avec une ville de même nom vers les côtes de la Natolie.
|
| LANGON | (Géogr.) petite ville ou bourg de France en Gascogne dans le Bazadois, sur la Garonne, près de Cadillac, à 5 lieues au-dessus de Bordeaux. Long. 16. 46. lat. 44. 51.
|
| LANGONE | S. f. (Monnoie) libra lingonica, nom d'une monnoie du xiij. siecle, qui se battoit à Langres ; car l'évêque de cette ville avoit obtenu de Charles le Chauve la permission de battre monnoie, & ce privilege lui fut confirmé par Charles le Gros, empereur. Dans des lettres de l'année 1255, on lit dix livres d'estevenane, ou de langoines, c'est-à-dire dix livres d'étiennes ou de langones. Ces étiennes étoient des écus de Dijon, ainsi nommés du nom de saint Etienne de cette ville, comme les langones étoient ainsi nommées de la ville de Langres. Les étiennes & les langones avoient, comme on le voit, la même valeur & le même cours dans le commerce du pays. (D.J.)
|
| LANGOU | S. m. (Hist. nat. Bot.) fruit de l'île de Madagascar, qui ressemble à une noix auguleuse ; elle croît sur une plante rampante. Les habitans la mâchent pour se noircir les dents, les gencives & les levres, ce qui est une beauté parmi eux.
|
| LANGOUSTE | S. f. locusta, (Hist. nat. Icthyolog.) animal crustacée, qui a beaucoup de rapport à l'écrevisse, mais qui est beaucoup plus grand, &c. La langouste a deux longues cornes placées au-devant des yeux, qui sont grosses, raboteuses, garnies d'aiguillons à leur origine & mobiles par quatre jointures ; elles diminuent de grosseur jusqu'à leur extrémité qui est très-menue & pointue. Au-dessous de ces deux longues cornes, il y en a deux plus courtes, plus petites, lisses & divisées par des articulations. Les yeux sont durs comme de la corne, très-saillans & entourés de piquans ; le front a une grande pointe, & le dos est hérissé de pointes plus petites ; il y a de chaque côté de la bouche un petit pié, & de chaque côté du corps un bras terminé par une pince, & quatre piés ; la queue est lisse & composée de cinq tables, & terminée par cinq nageoires. La langouste se sert de sa queue comme d'une rame, lorsqu'elle nage ; cette partie est très-forte. La femelle differe du mâle en ce qu'elle a le premier pié fourchu à l'extrémité, & qu'il se trouve sous sa queue des naissances doubles qui soutiennent les oeufs. Ces animaux ont deux grandes dents placées une de chaque côté. Les langoustes se dépouillent de leur taie. Voyez Rond. Hist. des poissons, l. XVIII.
|
| LANGOUTI | S. m. terme de relation ; c'est, selon M. de la Boulaye, une petite piece d'étoffe ou de linge, dont les Indiens se servent pour cacher les parties qui distinguent le sexe.
|
| LANGRES | (Géog.) ancienne ville de France, en Champagne, capitale du Bassigny. Du tems de Jules César, elle étoit aussi la métropole du peuple, appellé Lingones, dont nous parlerons sous ce mot, & se nommoit Andematunum ou Audumatunum. Dans le même tems, cette ville appartenoit à la Celtique, mais elle devint une cité de la Belgique sous Auguste, & y demeura jointe jusqu'à ce que Dioclétien la rendit à la Lyonnoise.
Langres, comme tant d'autres villes de France, a été exposée à diverses révolutions. Elle fut prise & brûlée dans le passage d'Attila, se rétablit & éprouva le même sort, lors de l'irruption des Vandales, qui massacrerent S. Didier son évêque, l'an de J. C. 407. Après que les Barbares eurent envahi l'empire romain, Langres tomba sous le pouvoir des Bourguignons, & continua de faire partie de ce royaume sous les Francs, vainqueurs des Bourguignons. Elle échut à Charles le chauve par le partage des enfans de Louis le débonnaire. Elle eut ensuite ses comtes particuliers jusqu'à ce qu'Hugues III. duc de Bourgogne, ayant acquis ce comté d'Henri duc de Bar, le donna, vers l'an 1179, à Gautier son oncle, évêque de Langres, en échange du domaine de Dijon ; & dans la suite, le roi Louis VII. érigea ce comté en duché, en annexant la ville à la couronne.
C'est de cette maniere que les évêques de Langres réunirent Langres au domaine de leur église, & devinrent très-puissans en qualité de seigneurs féodaux, dans toute l'étendue de leur diocese. Odon, comte de Nevers & de Champagne, leur fit hommage pour le comté de Tonnerre ; & cet hommage leur fut renouvellé par Marguerite, reine de Suede & femme du roi Charles. Les rois de Navarre, les ducs de Bourgogne pour leurs terres de la montagne, & les comtes de Champagne pour plusieurs villes & seigneuries se virent aussi leurs feudataires, desorte qu'ils comptoient parmi leurs vassaux non seulement des ducs, mais encore des rois.
Il n'est donc pas étonnant que l'évêque de Langres ait obtenu de Charles le chauve le droit de battre monnoie, & que ce privilege lui ait été confirmé par Charles le gros. Enfin, quoique la face des affaires ait bien changé, ces prélats ont toujours eu l'honneur, depuis Philippes le bel, d'être ducs & pairs de France, jusqu'à nos jours. L'évêque de Langres est resté, comme autrefois, suffragant de l'archevêché de Lyon. Son diocese, qui comprend la ville de Tonnerre, est en tout composé de cent quarante-cinq cures sous six archidiacres.
Venons aux antiquités de la ville de Langres, qui nous intéressent plus que l'évêché. Lorsqu'on travailloit dans cette ville, en 1670, 1671 & 1672, à faire des chemins couverts sur la contrescarpe, on y trouva trente-six pieces curieuses, consistant en statues, pyramides, piédestaux, vases, tombeaux, urnes & autres antiquités romaines, qui passerent entre les mains de M. Colbert.
On a encore trouvé depuis, en fouillant les terres voisines, quantité de médailles antiques, d'or, d'argent, & de bronze ; plusieurs vases & instrumens qu'on employoit dans les sacrifices, comme un couteau de cuivre, servant à écorcher les victimes ; un autre couteau, appellé secespita, servant à les égorger ; un chauderon, pour en contenir les entrailles ; deux pateres, pour en recevoir le sang : deux préféricules ; un manche d'aspersoir, pour jetter l'eau lustrale ; une boëte couverte pour l'encens ; trois petites cuilleres d'argent pour le prendre ; deux coins ; & un morceau de succin jaune, substance qui entroit, comme à présent, dans les parfums.
Enfin, on a trouvé à Langres ou dans son voisinage, pendant les deux derniers siecles, plusieurs inscriptions antiques, bas-reliefs, statues, fragmens de colonnes, ruines d'édifices, & autres monumens propres à illustrer l'histoire de cette ville. Dans le nombre de ceux qui y subsistent encore, les uns sont enchâssés d'espace en espace dans le corps des murs, qui lui tiennent lieu de remparts ; les autres se voient dans des jardins particuliers, & dans des villages circonvoisins. Il y en a même que certaines familles regardent comme le palladium de leurs maisons.
Mais comme le sort de la plûpart de ces morceaux antiques est d'être enlevés de leur pays natal, s'il est permis de se servir de ce terme, pour aller grossir le recueil qu'en font les curieux étrangers, les magistrats de la ville de Langres se sont depuis long-tems précautionnés contre ces pertes, en marquant dans les registres publics non seulement l'époque & les circonstances de toutes les découvertes, mais encore en y ajoutant le dessein des bas-reliefs & des statues : & la copie des inscriptions qu'on a successivement déterrées. Un pareil plan devroit être suivi dans toutes les villes de l'Europe, qui se vantent de quelque antiquité, ou qui peuvent tirer quelque avantage de ces sortes de monumens.
Gruter, Reynesius, le P. Vignier jésuite, & Gautherot dans son histoire de la ville de Langres, qu'il a intitulé, l'Anastase de Langres, tirée du tombeau de son antiquité, ont, à la vérité, rassemblé plusieurs inscriptions de cette ville, mais ils ne les ont pas toujours lues ni rapportées avec exactitude ; & pour Gautherot en particulier, ses recherches sont aussi mal digérées que peu judicieuses.
L'academie royale des belles-lettres de Paris a expliqué quelques-unes des inscriptions, dont nous parlons, dans le tome V. de son histoire, & cela d'après des copies fideles qu'elle en a reçues de M. l'évêque de Langres. On desireroit seulement qu'elle eût étendu ses explications sur un plus grand nombre de monumens de cette cité.
En effet, une de ces inscriptions nous apprend qu'il y eut dans cette ville une colonie romaine ; une autre nous confirme ce que César dit de la vénération que les Gaulois avoient pour Pluton, & de leur usage de compter par nuits, au lieu de compter par jours ; une troisieme nous instruit qu'il y a eu pendant long-tems dans cette ville un théâtre public, & par conséquent des spectacles réglés ; une quatrieme nous fait connoitre que la famille des Jules avoit de grandes possessions à Langres, ou aux environs : une cinquieme nous certifie qu'il partoit de cette capitale des peuples de la gaule celtique, appellés Lingones, beaucoup de chemins pavés, & construits en forme de levées, qui conduisoient à Lyon, à Toul, à Besançon, pour aller de celle-ci aux Alpes. De tels monumens ne sont pas indignes d'être observés ; mais il faut dire un mot de la position de Langres.
Elle est située sur une haute montagne, près de la Marne, aux confins des deux Bourgognes, à 14 lieues N. O. de Dijon, 25 S. E. de Troyes, 40 S. E. de Rheims, 63 N. E. de Paris. Long. suivant Cassini, 22d. 51'. 30''. lat. 47. 51.
Julius Sabinus, si connu par sa revolte contre Vespasien, & plus encore par la beauté, le courage, la tendresse, la fidélité & l'amour conjugal de sa femme Epponina, étoit natif de Langres. Il faut lire dans les Mémoires de l'acad. des insc. t. IX. les aventures également singulieres & attendrissantes de cette illustre dame & de son mari. M. Secousse en a tiré toute l'histoire de Tacite & de Plutarque ; c'est un des plus beaux morceaux de celle des Gaules, par les exemples de vertus qu'elle présente, & par la singularité des évenemens. Il a été écrit, ce morceau, peu de tems après la mort tragique de Sabinus & d'Epponina, par les deux anciens auteurs que nous venons de nommer ; par Tacite, Hist. l. IV. n° 55. & par Plutarque, In amator. p. 770. leur témoignage, dont on prise la fidélité, ne doit laisser aucun doute sur les circonstances mêmes qui paroissent les plus extraordinaires.
Langres moderne a produit plusieurs gens de lettres célebres, & tous heureusement ne sont pas morts ; mais je n'en nommerai qu'un seul du siecle passé, M. Barbier d'Aucourt, parce que c'est un des meilleurs sujets que l'academie françoise ait jamais eu.
Barbier d'Aucourt (Jean) étoit d'une famille pauvre, qui ne put lui donner aucun secours pour ses études ; mais son génie & son application y suppléerent. Il est connu par ses malheurs, par sa défense du nommé le Brun, accusé faussement d'avoir assassiné la dame Mazel, dont il étoit domestique, & par les sentimens de Cléanthe sur les entretiens d'Ariste & d'Eugene, critique vive, ingénieuse, délicate & solide ; le P. Bouhours tenta de la faire supprimer, & ses démarches en multiplierent les éditions. Barbier d'Aucourt fut ami de Mrs. de Port-royal, & composa plusieurs écrits contre les Jésuites qu'il haïssoit. Il mourut fort pauvre en 1694, dans sa 53e année. " Ma consolation, (dit-il aux députés de l'académie, qui vinrent le visiter dans sa derniere maladie, & qui lui parurent attendris de le trouver si mal logé,) " ma consolation, répéta-t-il, & ma très-grande consolation, c'est que je ne laisse point d'héritiers de ma misere ".
|
| LANGUE | S. f. (Anatom.) corps charnu, mollet, capable d'une infinité de mouvemens, & situé dans la cavité de la bouche.
La langue y occupe en devant l'intervalle de toute l'arcade du bord alvéolaire de la machoire inférieure ; & à mesure qu'elle s'étend en arriere, elle y devient plus épaisse & plus large.
On la distingue en base, en pointe, en face supérieure qu'on nomme le dessus, en face inférieure qu'on appelle dessous, & en portions latérales ou bords.
La base en est la partie postérieure, & la plus épaisse ; la pointe en est la partie antérieure & la plus mince ; la face supérieure est une convéxité plate, divisée par une ligne enfoncée superficiellement, appellée ligne médiane de la langue ; les bords ou côtés sont plus minces que le reste, & un peu arrondis, de même que la pointe ; la face inférieure n'est que depuis la moitié de la longueur de la langue jusqu'à sa pointe.
La langue est étroitement attachée par sa base à l'os hyoïde, qui l'est aussi au larynx & au pharynx ; elle est attachée par-devant le long de sa face inférieure par un ligament membraneux, appellé le frein ou filet ; enfin elle est attachée à la machoire inférieure, & aux apophyses styloïdes des os temporaux au moyen de ses muscles.
La membrane, qui recouvre la langue & qui est continue à celle qui revêt toute la bouche, est parsemée le long de sa face supérieure de plusieurs éminences que l'on nomme les mamelons de la langue, & que l'on regarde communément comme l'extrémité des nerfs qui se distribuent à cette partie ; cependant il y en a qui paroissent plutôt glanduleux que nerveux ; tels sont ceux qui se remarquent à la base de la langue, & qui sont les plus considérables par leur volume ; ils ont la figure de petits champignons, & sont logés dans les fossettes superficielles. M. Winslow les regarde comme autant de glandes salivaires.
Les seconds mamelons sont beaucoup plus petits, peu convexes, & criblés de plusieurs trous ; ils occupent la partie supérieure, antérieure, & surtout la pointe de la langue ; ce sont des especes de gaînes percées, dans lesquelles se trouvent les houpes nerveuses qui constituent l'organe du goût.
Les mamelons de la troisieme espece sont formés par de petits cônes très-pointus, semés parmi les autres mamelons ; mais on ne les apperçoit pas dans la surface latérale inférieure de la langue.
Toutes ces diverses especes de mamelons sont affermies par deux membranes ; la premiere est cette membrane très-fine, qui tapisse la bouche entiere ; sous cette membrane est une enveloppe particuliere à la langue, dont le tissu est plus serré. Quand on l'enleve, elle paroit comme un crible, parce qu'elle est arrachée de la circonférence des mamelons, & c'est ce qui a fait dire qu'elle étoit réticulaire ; sous cette membrane, on en trouve une autre, ou plutôt on trouve une espece de tissu fongueux, formé par les racines des mamelons, par les nerfs, & par une substance qui paroît médullaire.
On voit en plusieurs sujets, sur la face supérieure de la langue, du côté de sa base, un trou particulier, plus ou moins profond, dont la surface interne est toute glanduleuse, & remplie de petits boutons, semblables aux mamelons de la premiere espece : on l'appelle le trou aveugle, le trou coecum de Morgagni, qui l'a le premier découvert.
Valther a été plus loin, & il y a indiqué des conduits qui lui ont paru salivaires ; enfin Heister a trouvé distinctement deux de ces conduits, dont les orifices étoient dans le fonds du trou coecum, l'un à côté de l'autre ; il en a donné la figure dans son anatomie.
La langue est peut-être la partie musculaire la plus souple, & la plus aisément mobile du corps humain : elle doit cette souplesse & cette mobilité à la variété singuliere qui regne dans la disposition des fibres qui constituent sa structure ; elle la doit encore aux muscles génio-stylo-hyoglosses, ainsi qu'à tous ceux qui tiennent à l'os hyoïde qui lui sert de base. C'est à l'aide de tous ces muscles différens qu'elle est capable de se mouvoir avec tant d'aisance, de rapidité, & selon toutes les directions possibles. Ces muscles reçoivent eux-mêmes leur force motrice, ou la faculté qu'ils ont d'agir de la troisieme branche de la cinquieme paire des nerfs qui se distribue, par ses ramifications, à toutes les fibres charnues de la langue.
Entrons dans les autres détails. Les principaux de ces muscles sont les génio-glosses ; ils partent de la partie postérieure de la symphise de la machoire inférieure, & marchent en arriere séparés par une membrane cellulaire ; quand ils sont parvenus à l'os hyoïde, les fibres inférieures de ces muscles s'y attachent, les moyennes forment des rayons en haut & latéralement, & les autres vont à la pointe de la langue.
Les muscles stylo-glosses se jettent à sa partie latérale supérieure ; ils viennent de l'apophyse styloïde, & vont cotoyer la langue.
Les hyo-glosses partent de la base de l'os hyoïde, des cornes & de la symphise ; c'est à cause de ces diverses origines qu'on les a divisés en trois portions différentes ; l'externe marche intérieurement à côté du stylo-glosse le long de la langue, & les autres bandes musculeuses en forment la partie moyenne supérieure.
On fait mention d'une quatrieme paire de muscles, qu'on nomme mylo-glosses ; ils viennent de la base de la machoire au-dessus des dents molaires ; mais on les rencontre très-rarement, & toujours avec quelque variété.
Les muscles qui meuvent l'os hyoïde, doivent être censés appartenir aussi à la langue, parce qu'elle en suit les mouvemens.
Outre cela, la langue est composée de plusieurs fibres charnues, disposées en tous sens, dont la totalité s'appelle communément muscle lingual ; nous en parlerons tout-à-l'heure.
C'est des muscles génio-glosses, stylo-glosses & hyo-glosses, & de ceux de l'os hyoïde, que dépendent les mouvemens de la langue. La partie des génio-glosses, qui va du menton à la base de la langue, porte cet organe en avant, & le fait sortir de la bouche. Les stylo-glosses, en agissant séparément, portent la langue vers les côtés, & en-haut ; lorsqu'ils agissent ensemble, ils la tirent en arriere, & ils l'élevent : chacun des hyo-glosses, en agissant séparément, la tire sur les côtés, & lorsqu'ils agissent tous les deux, ils la tirent em-bas. Elle devient plus convexe par l'action de toutes les fibres des génio-glosses, agissant en même tems, sur-tout lorsque les stylo-glosses sont en contraction.
On sent bien encore que la langue aura différens mouvemens, suivant que les différentes fibres qui composent le muscle lingual, agiront ou seules, ou avec le secours des autres muscles, dont nous venons de parler. Ces fibres du muscle lingual ont toutes sortes de situations dans la composition de la langue ; il y en a de longitudinales, de verticales, de droites, de transverses, d'obliques, d'angulaires ; ce sont en partie les épanouissemens des muscles génio-glosses, hyo-glosses & stylo-glosses.
Les fibres longitudinales racourcissent la langue ; les transverses la retrécissent ; les angulaires la tirent en-dedans ; les obliques de côté ; les droites compriment sa base, & d'autres servent à baisser son dos. C'est par l'action de toutes ces fibres musculaires, qui est différente selon leur direction, selon qu'elles agissent ensemble ou séparément, que la langue détermine les alimens solides, entre les molaires, & porte ce qu'on mange & ce qu'on boit vers le gosier, à quoi concourt en même tems le concert des muscles propres de cet organe.
On découvre en gros la diversité & la direction des fibres qui composent le muscle lingual, en coupant la langue longitudinalement & transversalement après l'avoir fait macérer dans du fort vinaigre ; mais il est impossible de démêler l'entrelacement singulier de toutes ces fibres, leur commencement & leur fin. On a beau macérer, ou cuire une langue de boeuf dans une eau souvent renouvellée, pour en ôter toute la graisse : on a beau la dépouiller adroitement de son épiderme, de son corps réticulaire & papillaire, on ne parvient point à dévoiler la structure parfaite de cet organe dans aucun des animaux, dont la langue destinée à brouter des plantes seches, est garnie de fibres fortes, beaucoup plus grandes & beaucoup plus évidentes que dans l'homme.
La langue humaine ainsi que celle des animaux, est parsemée de quantité de glandes dans sa partie supérieure & postérieure, outre celles qu'on nomme sublinguales, qui sont les principales & qu'il suffit d'indiquer ici.
Les vaisseaux sanguins de la langue, sont ses arteres & ses veines ; les arteres lui sont fournies par la carotide externe, & ses veines vont se décharger dans les jugulaires externes : on les appelle veines & arteres sublinguales, ou arteres & veines ranines. Les veines sont à côté du frein, & les arteres à côté des veines. On ouvre quelquefois ces veines ranines dans l'esquinancie ; mais il faut prendre garde alors de ne pas plonger la lancette trop profondement, de peur d'ouvrir les arteres, dont l'hémorrhagie seroit difficile à réprimer.
La langue reçoit de chaque côté des nerfs très-considérables, qui viennent de la cinquieme & de la neuvieme paire du cerveau, & qui se distribuent dans les membranes & dans le corps de la langue. La petite portion du nerf symphatique moyen, ou de la huitieme paire, produit aussi un nerf particulier à chaque côté de la langue.
Tel est cet instrument merveilleux, sans lequel les hommes seroient privés du plaisir & de l'avantage de la société. Il forme les différences des sons essentiels pour la parole ; il est le principal organe du goût ; il est absolument nécessaire à la mastication. Tantôt la langue par sa pointe qui est de la plus grande agilité, donne les alimens à broyer aux dents ; tantôt elle va les chercher pour cet effet entre les dents & les joues ; quelquefois d'un seul tour, avec cette adresse qui n'appartient qu'à la nature, elle les prend sur son dos pour les voiturer en diligence au fond du palais.
Elle n'est pas moins utile à la déglutition des liquides que des solides. Enfin elle sert tellement à l'action de cracher, que cette action ne peut s'exécuter sans son ministere, soit par le ramas qu'elle fait de la sérosité qui s'est séparée des glandes de la bouche, soit par la disposition dans laquelle elle met la salive qu'elle a ramassée, ou la matiere pituiteuse rejettée par les poumons.
Je sais que M. de Jussieu étant en Portugal en 1717, y vit une pauvre fille alors âgée de 15 ans, née sans langue, & qui s'acquitoit, dit-il, passablement de toutes les fonctions dont nous venons de parler. Elle avoit dans la bouche à la place de la langue, une petite éminence en forme de mamelon, qui s'élevoit d'environ trois ou quatre lignes de hauteur du milieu de la bouche. Il en a fait le récit dans les Mém. de l'acad. des Sciences, ann. 1718.
Le sieur Roland, chirurgien à Saumur, avoit déjà décrit en 1630 une observation semblable dans un petit traité intitulé Aglossostomographie, ou description d'une bouche sans langue, laquelle parloit, & faisoit les autres fonctions de cet organe. La seule différence qui se trouve entre les deux sujets ; est que celui dont parle Roland, étoit un garçon de huit à neuf ans, qui par des ulceres survenus dans la petite vérole avoit perdu la langue, au lieu que la fille vûe par M. de Jussieu, étoit née sans en avoir.
Cependant, malgré ces deux observations singulieres, je pense que les personnes à qui il ne reste que la base de la langue ne peuvent qu'ébaucher quelques-uns de ces sons, pour lesquels l'action des levres, & l'application du fond de la langue au palais sont seulement nécessaires ; mais les sons qui ne se forment que par la pointe de la langue, par son recourbement, ou par d'autres mouvemens composés ; ces sortes de sons, dis-je, me paroissent impossibles, quand la langue est mutilée au point d'être réduite à un petit moignon.
Une langue double n'est pas un moindre obstacle à la parole. Les Transactions philosophiques. Février & Mars 1748, rapportent le cas d'un garçon né avec deux langues. Sa mere ne voulut jamais permettre qu'on lui retranchât ni l'une ni l'autre, la nature fut plus avisée que cette mere, ou si l'on veut seconda ses vûes. La langue supérieure se dessécha, & se réduisit à la grosseur d'un pois, tandis que l'autre se fortifia, s'aggrandit, & vint par ce moyen à exécuter toutes ses fonctions.
Les éphémerides des curieux de la nature en citant long-tems auparavant, savoir en 1684, le cas d'une fille aimable qui vint au monde avec deux langues, remarquerent que la nature l'auroit plus favorisée en ne lui en donnant qu'une, qu'en multipliant cet organe, puisqu'elle priva cette fille de la parole, dont le beau sexe peut tirer tant d'usages pour son bonheur & pour le nôtre.
Théophile Protospatarius, medecin grec du xj siecle, est le premier qui a regardé la langue comme musculaire ; Jacques Berengarius a connu le premier les glandes sublinguales & leurs conduits ; Malpighi a le premier développé toute la texture de la langue ; Bellini a encore perfectionné ce developpement ; Ruisch s'est attaché à dévoiler la fabrique des mamelons & des houpes nerveuses ; les langues qu'il a injectées, laissent passer la matiere céracée par l'extrémité des poils artériels. Walther a décrit les glandes dont la langue est parsemée, & qui filtrent les sucs destinés à l'humecter continuellement ; enfin Trew a représenté ses conduits salivaires, & ses vaisseaux sanguins. On doit encore consulter sur cet organe le célebre Morgagni, Santorini, & les tables d'Eustache & de Cowper.
La langue de plusieurs animaux a encore occupé les regards de divers anatomistes, & même il nous en ont donné quelquefois la description, comme s'ils l'avoient tirée de la langue humaine. Mais nous connoissons assez imparfaitement celle des léopards, des lions, des tigres & autres bêtes féroces, qui ont la tunique externe du dessus de la langue hérissée de petites pointes dures, tournées en dedans, différentes de celles de la langue des poissons, dont les pointes sont seulement rangées le long des bords du palais.
Il y a une espece de baleine qui a la langue & le palais si âpre par un poil court & dur, que c'est une sorte de décrotoir. La langue du renard marin est toute couverte de petites pieces osseuses de la grosseur d'une tête d'épingle ; elles sont d'une dureté incroyable, d'une couleur argentine, d'une figure quarrée, & point du-tout piquantes.
Personne jusqu'ici n'a développé la structure de la langue du caméléon ; on sait seulement qu'elle est très longue ; qu'il peut l'allonger, la raccourcir en un instant, & qu'il la darde au dehors comme s'il la crachoit.
A l'égard des oiseaux, il n'y a presque que la langue du pic-verd qu'on ait décrit exactement. Enfin il reste bien des découvertes à faire sur cet organe des animaux de toute espece ; mais comme les maladies & les accidens de la langue humaine nous intéressent encore davantage, nous leur reservons un article à part. (D.J.)
LANGUE ; (Sémiotique) " Ne vous retirez jamais, conseille fort sagement Baglivi, d'auprès d'un malade sans avoir attentivement examiné la langue ; elle indique plus sûrement & plus clairement que tous les autres signes, l'état du sang. Les autres signes trompent souvent, mais ceux ci ne sont jamais ou que très rarement fautifs ; & à moins que la couleur, la saveur & autres accidens de la langue ne soient dans leur état naturel, gardez-vous poursuit-il, d'assurer la guérison de votre malade, sans quoi vous courez risque de nuire à votre réputation ". prax. medic. lib. I. cap. xiij. w. 3. Quoiqu'il faille rabattre de ces éloges enthousiastiques, on doit éviter l'excès opposé dans lequel est tombé Santorius, qui traite l'art de juger par la langue, d'inutile, de nul & purement arbitraire. Il est très-certain qu'on peut tirer des différens états & qualités de la langue beaucoup de lumieres pour le diagnostic & le prognostic des maladies aigues, mais ces signes ne sont pas plus certains que les autres qu'on tire du pouls, des urines, &c. Ainsi on auroit tort de s'y arrêter uniquement. On doit lorsqu'on veut atteindre au plus haut point de certitude médicinale, c'est-à-dire une grande probabilité, rassembler, combiner & consulter tous les différens signes, encore ne sont-ils pas nécessairement infaillibles, mais ils se vérifient le plus ordinairement.
C'est dans la couleur principalement & dans le mouvement de la langue que l'on observe de l'altération dans les maladies aiguës. 1°. La couleur peut varier de bien des façons ; la langue peut devenir blanche, pâle, jaune, noire, livide, d'un rouge vif, &c. ou fleurie, comme l'appelle Hippocrate. Comme ces couleurs pourroient dépendre de quelque boisson ou aliment précédent, il faut avoir attention lorsque l'on soupçonne pareille cause, de faire laver la bouche au malade ; & quand on examine la langue, on doit la faire sortir autant qu'il est possible, afin d'en voir jusqu'à la racine ; il est même des occasions où il faut regarder par-dessous, car, quelquefois, remarque Hippocrate lib. II. de morb. la langue est noire dans cette partie, & les veines qui y sont se tuméfient & noircissent.
1° La tumeur blanche de la langue provient d'une croûte plus ou moins épaisse, qui se forme sur la surface ; on peut s'en assurer par la vûe & le tact : cette croûte est quelquefois jaune & noire. Les modernes ont regardé cet état de la langue, qu'ils ont appellée chargée, comme un des principaux signes de pourriture dans les premieres voies, & comme une indication assurée de purger ; ils ont cru que l'estomac & les intestins étoient recouverts d'une croûte semblable. Cette idée n'est pas tout-à-fait sans fondement, elle est vraie jusqu'à un certain point ; mais elle est trop généralisée, car dans presque toutes les maladies inflammatoires, dans les fievres simples, ardentes, &c. on observe toujours la langue enduite d'une croûte blanche ou jaunâtre, sans que pour cela les premieres voies soient infectées, & qu'on soit obligé de purger. Dans les indigestions, dans de petites incommodités passageres, la langue se charge ; elle indique assez sûrement de concert avec les autres signes, le mauvais état de l'estomac ; mais encore dans ces circonstances il n'est pas toujours nécessaire de purger ; un peu de diete dissipe souvent tous ces symptomes, j'ai même souvent observé dans les maladies aiguës, la croûte de la langue diminuer & disparoître peu-à-peu pendant des excrétions critiques, autres que les selles, par l'expectoration, par exemple, j'ai vu des cas où les purgatifs donnés sous cette fausse indication, augmentoient & faisoient rembrunir cette croûte ; enfin il arrive ordinairement dans les convalescences que cette croûte subsiste pendant quelques jours ; ne s'effaçant qu'in sensiblement : on agiroit très-mal pour le malade, si on prétendoit l'emporter par les purgatifs.
" Si la langue est enduite d'une humeur semblable à de la salive blanche vers la ligne qui sépare la partie gauche de la droite, c'est un signe que la fievre diminue. Si cette humeur est épaisse, on peut espérer la remission le même jour, sinon le lendemain. Le troisieme jour, la croûte qu'on observe sur l'extrémité de la langue indique la même chose, mais moins sûrement ". Hippocrate, coac. praen. cap. vij. n °. 2. Le véritable sens de ce passage me paroit être celui-ci : lorsque la croûte qui enduisoit toute la langue s'est restreinte à la ligne du milieu ou à l'extrémité, c'est une marque que la maladie va cesser.
2° La langue est couverte d'une croûte jaunâtre, bilieuse, & imprime aux alimens un goût amer dans la jaunisse, les fievres bilieuses & ardentes, dans quelques affections de poitrine ; si la langue est jaune ou bilieuse, remarque Hippocrate, dans ses coaques au commencement des pleurésies, la crise se fait au septieme jour.
3° La noirceur de la langue est un symptome assez ordinaire aux fievres putrides, & sur-tout aux malignes pestilentielles ; la langue dans celles-ci noire & seche, ou brûlée adusta, est un très-mauvais signe ; il n'est cependant pas toujours mortel. Quelquefois il indique une crise pour le quatorzieme jour, Hippocrate praenot. coac. chap. vij. n °. 1. Mais, cependant, ajoûte Hippocrate dans le même article, la langue noire est très dangereuse : & plus bas il dit, dans quelques-uns la noirceur de la langue présage une mort prochaine n °. 5.
4°. La pâleur, la rougeur & la lividité de la langue dépendent de la lésion qui est dans son tissu même & non de quelque humeur arrêtée à sa surface ; ces caracteres de la langue sont d'autant plus mauvais, qu'ils s'éloignent de l'état naturel. La pâleur est très-pernicieuse, sur-tout si elle tire sur le verd, que quelques auteurs mal instruits ont traduit par jaune. 2°. Si la langue, dit toujours Hippocrate, qui a été au commencement seche, en gardant sa couleur naturelle, devient ensuite rude & livide, & qu'elle se fende, c'est un signe mortel. coac. Praenot. cap. vij. Si dans une pleurésie il se forme dès le commencement une bulle livide sur la langue, semblable à du fer teint dans l'huile, la maladie se résout difficilement, la crise ne se fait que le quatorzieme jour, & ils crachent beaucoup de sang. Hippocrate, ibid. cap. xvj. n °. 6.
On a observé que la trop grande rougeur de la langue est quelquefois un mauvais signe dans l'angine inflammatoire & la péripneumonie ; cette malignité augmente & se confirme par d'autres signes. Hippocrate a vu cet état de la langue suivi de mort au cinquieme jour, dans une femme attaquée d'angine, (epidem. lib. III. sect. I). & au neuvieme jour dans le fils de Bilis. (ibid. lib. vij. text. 19.) Cette rougeur est souvent accompagnée d'une augmentation considérable dans le volume de la langue ; plusieurs malades qui avoient ce symptome sont morts ; cette enflure de la langue accompagnée de sa noirceur est regardée comme un signe mortel. Tel sur le cas d'une jeune femme, dont Hippocrate donne l'histoire (epid. lib. V. text. 53.), qui mourut quatre jours après avoir pris un remede violent pour se faire avorter.
2°. Le mouvement de la langue est vicié dans les convulsions, tremblemens, paralysie, incontinence de cette partie : tous ces symptomes survenans dans les maladies aiguës, sont d'un mauvais augure ; la convulsion de la langue annonce l'aliénation d'esprit (coac. praen. cap. 11. n °. 24.). Lorsque le tremblement succede à la secheresse de la langue, il est certainement mortel. On l'observe fréquemment dans les pleurésies qui doivent se terminer par la mort. Hippocrate semble douter s'il n'indique pas lui-même une aliénation d'esprit (ibid. cap. vij n °. 5.) Dans quelques uns ce tremblement est suivi de quelques selles liquides. Lorsqu'il se rencontre avec une rougeur aux environs des narines sans signes (critiques) du côté du poumon, il est mauvais ; il annonce pour lors des purgations abondantes & pernicieuses. (n °. 3.) Les paralysies de la langue qui surviennent dans les maladies aiguës, sont suivies d'extinction de voix : Voyez VOIX. Enfin les mouvemens de la langue peuvent être génés lorsqu'elle est seche, rude, âpre, aspera, lorsqu'elle est ulcérée, pleine de crevasses. La sécheresse de la langue est regardée comme un très-mauvais signe, sur-tout dans l'esquinancie. Hippocrate rapporte qu'une femme attaquée de cette maladie qui avoit la langue seche, mourut le septiéme jour (epid. lib. III.). La soif est une suite ordinaire de cette sécheresse, & il est bon qu'on l'observe toujours ; car si la langue étoit seche sans qu'il y eût soif, ce seroit un signe assuré d'un délire présent ou très-prochain ; la rudesse, l'âpreté de la langue, n'est qu'un degré plus fort de sécheresse. Hippocrate surnomme phrénétiques les langues qui sont seches & rudes, faisant voir par-là que cet état de la langue est ordinaire dans la phrénésie (prorrhet. lib. I. sect. 1. n °. 3.). Il faut prendre garde de ne pas confondre la sécheresse occasionnée par bienfait immédiat de l'air, dans ceux qui dorment la bouche ouverte, avec celle qui est vraiment morbifique ; & d'ailleurs pour en déduire un prognostic fâcheux, il faut que les autres signes conspirent, car sans cela les malades avec une langue seche & ridée, échappent des maladies les plus dangereuses, comme il est arrivé à la fille de Larissa (epid. lib. I. sect. 7.). La langue qui est ulcérée, remplie de crevasses, est un symptome très-fâcheux, & très-ordinaire dans les fievres malignes. Prosper Alpin assure avoir vu fréquemment des malades guérir parfaitement malgré ce signe pernicieux. Rasis veut cependant que les malades qui ont une fievre violente, & la langue chargée de ces pustules, meurent au commencement du jour suivant. La langue ramollie sans raison & avec dégoût après une diarrhée, & avec une sueur froide, préjuge des vomissemens noirs, pour lors la lassitude est d'un mauvais augure, Hippocrate, coac. praenot. cap. vij. n °. 4. Si la langue examinée paroît froide au toucher, c'est un signe irrévocable de mort très-prochaine, il n'y a aucune observation du contraire. Riviere en rapporte une qui lui a été communiquée par Paquet, qui confirme ce que nous avançons. Baglivi assure avoir éprouvé quelquefois lui-même la réalité de ce prognostic.
Tels sont les signes qu'on peut tirer des différens états de la langue ; nous n'avons fait pour la plûpart que les extraire fidelement des écrits immortels du divin Hippocrate : cet article n'est presque qu'une exposition abrégée & historique de ce qu'il nous apprend là-dessus. Nous nous sommes bien gardés d'y mêler aucune explication théorique, toujours au-moins incertaine ; on peut, si l'on est curieux d'un peu plus de détail, consulter un traité particulier fait ex professo sur cette matiere par un nommé Prothus Casulanus, dans lequel on trouvera quelques bonnes choses, mêlées & enfouies sous un tas d'inutilités & de verbiages. Art. de M. Ménuret.
|
| LANGU | adj. dans le Blazon, se dit des animaux dont les langues paroissent sortir de leurs bouches, & sont d'une couleur différente de celle du corps de l'animal.
Dufaing aux Pays-bas, d'or à l'aigle au vol abaissé langué & membré de gueules.
|
| LANGUEDOC | LE, Occitania, (Géog.) province maritime de France, dans sa partie méridionale. Elle est bornée au nord par le Quercy & le Rouergue ; à l'orient, le Rhône la distingue du Dauphiné, de la Provence, & de l'état d'Avignon ; à l'occident la Garonne la sépare de la Gascogne ; elle se termine au midi par la Méditerranée, & par les comtés de Foix & de Roussillon. On lui donne environ 40 lieues dans sa plus grande largeur, & 90 depuis sa partie la plus septentrionale, jusqu'à sa partie la plus méridionale. Les principales rivieres qui l'arrosent, sont le Rhône, la Garonne, le Tarn, l'Allier, & la Loire ; Toulouse en est la capitale.
Je ne dirai qu'un mot des révolutions de cette province, quoique son histoire soit très-intéressante ; mais elle a été faite dans le dernier siecle par Catel, & dans celui-ci, par Dom Joseph Vaisset, & Dom Claude Vic, en 2 vol. in -fol. dont le premier fut mis au jour à Paris en 1730, & le second en 1733.
Le Languedoc est de plus grande étendue que n'étoit la seconde Narbonnoise ; & les peuples qui l'habitoient autrefois, s'appelloient Volsques, Volcae.
Les Romains conquirent cette province, sous le consulat de Quintus Fabius Maximus, 636 ans après la fondation de Rome. Mais quand l'empire vint à s'affaisser sous Honorius, les Goths s'emparerent de ce pays, qui fut nommé Gothie, ou Septimanie, dès le v. siecle ; & les Goths en jouirent sous 30 rois, pendant près de 300 ans.
La Gothie ou Septimanie, après la ruine des Wisigoths, tomba sous la domination des Maures, Arabes ou Sarrazins, Mahométans, comme on voudra les appeller, qui venoient d'asservir presque toute l'Espagne. Fiers de leurs conquêtes, ils s'avancerent jusqu'à Tours ; mais ils furent entierement défaits par Charles Martel, en 725. Cette victoire suivie des heureux succès de son fils, soumit la Septimanie à la puissance des rois de France. Charlemagne y nomma dans les principales villes, des ducs, comtes, ou marquis, titres qui ne désignoient que la qualité de chef ou de gouverneur. Louis le Debonnaire continua l'établissement que son pere avoit formé.
Les ducs de Septimanie régirent ce pays jusqu'en 936, que Pons Raimond, comte de Toulouse, prit tantôt cette qualité, & tantôt celle de duc de Narbonne ; enfin, Amaury de Montfort céda cette province en 1223, à Louis VIII. roi de France. Cette cession lui fut confirmée par le traité de 1228 ; ensorte que sur la fin du même siecle, Philippe le Hardi prit possession du comté de Toulouse, & reçut le serment des habitans, avec promesse de conserver les privileges, usages, libertés, & coutumes des lieux.
On ne trouve point qu'on ait donné le nom de Languedoc à cette province, avant ce tems-là. On appella d'abord Languedoc, tous les pays où l'on parloit la langue toulousaine, pays bien plus étendus que la province de Languedoc ; car on comprenoit dans les pays de Languedoc, la Guyenne, le Limousin, & l'Auvergne. Ce nom de Languedoc vient du mot oc, dont on se servoit en ces pays-là pour dire oui. C'est pour cette raison qu'on avoit divisé dans le xjv. siecle toute la France en deux langues ; la langue d'oui, dont Paris étoit la premiere ville, & la langue d'oc, dont Toulouse étoit la capitale. Le pays de cette langue d'oc est nommé en latin dans les anciens monumens, pairia occitana ; & dans d'autres vieux actes, la province de Languedoc est appellée lingua d'oc.
Il est vrai cependant qu'on continua de la nommer Septimanie, à cause qu'elle comprenoit sept cités ; savoir, Toulouse, Beziers, Nismes, Agde, Maguelone aujourd'hui Montpellier, Lodeve, & Usez.
Enfin en 1361 le Languedoc fut expressément réuni à la couronne, par lettres-patentes du roi Jean. Ainsi le Languedoc appartient au roi de France par droit de conquête, par la cession d'Amaury de Montfort en 1223, & par le traité de 1228.
C'est un pays d'états, & en même tems la province du royaume où le clergé est le plus nombreux & le plus riche. En effet on y compte trois archevêchés, & vingt évêchés.
Ce pays est généralement fertile en grains, en fruits, & en excellens vins. Son histoire naturelle est très-curieuse par ses eaux minérales, ses plantes, ses pétrifications, ses carrieres de marbre, ses mines de turquoises, & autres singularités.
Le commerce de cette province, qui consiste principalement en denrées, & en manufactures de soie, de draps, & de petites étoffes de laine, est un commerce considérable, mais qu'il importe de rendre plus florissant, en faisant cesser ces regles arbitraires établies sous les noms de traite-foraine & traite-domaniale ; ces regles forment une jurisprudence très-compliquée, qui déroute le commerce, décourage le négociant, occasionne sans-cesse des procès, des saisies, des confiscations, & je ne sais combien d'autres sortes d'usurpations. D'ailleurs, la traite-foraine du Languedoc, sur les frontieres de Provence, est abusive, puisqu'elle est établie en Provence. La traite domaniale est destructive du commerce étranger, & principalement de l'agriculture.
Il est, selon la remarque judicieuse de l'auteur moderne des considérations sur les finances, il est un autre vice intérieur en Languedoc, dont les riches gardent le secret, & qui doit à la longue porter un grand préjudice à cette belle province. Les biens y ont augmenté de valeur, à mesure que les progrès du commerce, soit intérieur ou extérieur, ont haussé le prix des denrées. Les impôts n'y ont pas augmenté de valeur intrinseque, dans la même progression, ni en proportion des dépenses nécessaires de l'état. Cependant les manoeuvriers, fermiers, ouvriers, laboureurs, y sont dans une position moins heureuse que dans d'autres provinces qui payent davantage. La raison d'un fait si extraordinaire en apparence, vient de ce que le prix des journées, des corvées, n'y a point haussé proportionnellement à celui des denrées. Il n'est en beaucoup d'endroits de cette province, que de six sols, comme il y a cent ans. Les propriétaires des terres, par l'effet d'un intérêt personnel mal-entendu, ne veulent pas concevoir que la consommation du peuple leur reviendroit avec bénéfice ; que d'ailleurs sans aisance il ne peut y avoir d'émulation ni de progrès dans la culture, & dans les arts ; mais s'il arrive un jour que dans les autres provinces on vienne à corriger l'arbitraire, le Languedoc sera vraisemblablement desert, ou changera de principe. (D.J.)
LANGUEDOC, canal de, (Méchan. Hydraul. Architect.) On le nomme autrement canal de la jonction des deux mers, canal royal, canal de Riquet ; & la raison de tous ces noms sera facile à voir par la suite. C'est un superbe canal qui traverse la province de Languedoc, joint ensemble la Méditerranée & l'Océan, & tombe dans le port de Cette, construit pour recevoir ses eaux.
L'argent ne peut pénétrer dans les provinces & dans les campagnes, qu'à la faveur des commodités établies pour le transport & la consommation des denrées ; ainsi tous les travaux de ce genre qui y concourront, seront l'objet des grands hommes d'état, dont le goût se porte à l'utile.
Ce fut en 1664 que M. Colbert qui vouloit préparer de loin des sources à l'abondance, fit arrêter le projet hardi de joindre les deux mers par le canal de Languedoc. Cette entreprise déjà conçue du tems de Charlemagne, si l'on en croit quelques auteurs, le fut certainement sous François I. Dès-lors on proposa de faire un canal de 14 lieues, de Toulouse à Narbonne, d'où l'on eût navigué par la riviere d'Aude, dans la Méditerranée. Henri IV. & son ministre y songerent encore plus sérieusement, & trouverent la chose possible, après un mûr examen ; mais la gloire en étoit réservée au regne de Louis XIV. D'ailleurs l'exécution de l'entreprise, a été bien plus considérable que le projet de M. de Sully, puisqu'on a donné à ce canal 60 lieues de longueur, afin de favoriser la circulation d'une plus grande quantité de denrées. L'ouvrage dura 16 ans ; il fut commencé en 1664, & achevé en 1680, deux ou trois ans avant la mort de M. Colbert ; c'est le monument le plus glorieux de son ministere, par son utilité, par sa grandeur, & par ses difficultés.
Riquet osa se charger des travaux & de l'exécution, sur le plan & les mémoires du sieur Andréossi son ami, profond méchanicien, qui avoit reconnu en prenant les niveaux, que Naurause, lieu situé près de Castelnaudari, étoit l'endroit le plus élevé qui fut entre les deux mers. Riquet en fit le point de partage, & y pratiqua un bassin de deux cent toises de long, sur cent-cinquante de large. C'est un des plus beaux bassins que l'on puisse voir ; il contient en tout tems sept piés d'eaux que l'on distribue par deux écluses, l'une du côté de l'Océan, & l'autre du côté de la Méditerranée. Pour remplir ce bassin, de maniere qu'il ne tarisse jamais, on a construit un réservoir nommé le réservoir de S. Ferréol, qui a douze cent toises de longueur, sur cinq cent de largeur, & vingt de profondeur. La forte digue qui lui sert de base, porte l'eau au bassin de Naurause.
L'inégalité du terrein, les montagnes & les rivieres qui se rencontrent sur la route, sembloient des obstacles invincibles au succès de cette entreprise. Riquet les a surmontés ; il a remédié à l'inégalité du terrein, par plusieurs écluses qui soutiennent l'eau dans les descentes. Il y en a quinze du côté de l'Océan, & quarante-cinq du côté de la Méditerranée. Les montagnes ont été entr'ouvertes, ou percées par ses soins ; il a pourvû à l'incommodité des rivieres & des torrens, par des ponts & des aqueducs sur lesquels passe le canal, en même tems que des rivieres & des torrens passent par-dessous. On compte 37 de ces aqueducs, & huit ponts. En un mot les bateaux arrivent de l'embouchure de la Garonne, qui est dans l'Océan, au port de Cette, qui est dans la Méditerranée, sans être obligés de passer le détroit de Gibraltar. Riquet termina sa carriere & son ouvrage presqu'en même tems, laissant à ses deux fils le plaisir d'en faire l'essai en 1681.
Ce canal a coûté environ treize millions de ce tems-là, qu'on peut évaluer à vingt-cinq millions de nos jours, qui ont été payés en partie par le roi, & en partie par la province de Languedoc.
Il n'a manqué à la gloire de l'entrepreneur, que de n'avoir pas voulu joindre son canal à celui de Narbonne fait par les Romains, & qui n'en est qu'à une lieue ; il eut alors rendu service à tout un pays, en sauvant même une partie de la dépense qu'il consomma à percer la montagne de Malpas. Mais Riquet eut la foiblesse de préférer l'utilité de Beziers, où le hasard l'avoit fait naître, au bien d'une province entiere. C'est ainsi qu'il a privé Narbonne, Carcassonne, & Toulouse, des commodités, des ressources, & des avantages de son canal. (D.J.)
|
| LANGUETTE | S. f. (Gramm. & Art méchaniq.) se dit de tout ce qui est taillé en forme de petite langue.
LANGUETTE, (Hydr.) Voyez CLOISON.
LANGUETTE, terme d'Imprim. C'est une petite piece de fer mince, d'un pouce & demi de large, & d'un pouce de long, arrondie par l'extrémité, laquelle est attachée hors d'oeuvre du chassis de la frisquette, pour fixer à l'ouvrier un endroit certain par où la lever & l'abaisser à mesure qu'il imprime chaque feuille de papier : quelques personnes lui donnent le nom d'oreille. Voyez les Pl. d'Imprimerie.
LANGUETTE, (Luth.) petite soupape à ressort qui fait ouvrir & parler, fermer & taire les trous d'un instrument à vent.
LANGUETTES, en Maçonnerie, séparation de deux ou plusieurs tuyaux de cheminée, lesquelles se font de plâtre pur, de brique, ou de pierre.
LANGUETTE, en Menuiserie, se dit de la partie la plus menue d'un panneau, qui se place dans les rainures, lorsqu'on assemble.
LANGUETTE, terme d'Orfévre, petit morceau d'argent laissé exprès en saillie & hors d'oeuvre aux ouvrages d'orfévrerie, & que le bureau de l'Orfévrerie retranche & éprouve par le feu, avant que de le contre-marquer du poinçon de la ville.
Les Orfévres ont introduit cet usage, afin que les gardes ne détériorent point une piece, en coupant quelquefois d'un côté qui doit être ménagé ; cependant les gardes ont le droit de couper arbitrairement à chaque piece le morceau d'essai.
LANGUETTE, dans les Orgues, sont de petites pieces de laiton flexible & élastique, dont on couvre l'anche. Voyez TROMPETTE, & l'art. ORGUE, & les Planches de luth & orgue. La languette est affermie dans la noix avec l'anche, par un coin de bois, & elle est réglée par la rasette. Voyez RASETTE.
LANGUETTE, Potier d'étain, piece placée sur le couvercle d'un vaisseau, attachée à l'anse, & destinée à faire lever le couvercle par l'action du pouce qu'on pose dessus, quand on veut ouvrir le vaisseau.
|
| LANGUEUR | (Mor.) il se dit des hommes & des sociétés. L'ame est dans la langueur, quand elle n'a ni les moyens ni l'espérance de satisfaire une passion qui la remplit ; elle reste occupée sans activité. Les états sont dans la langueur quand le dérangement de l'ordre général ne laisse plus voir distinctement au citoyen un but utile à ses travaux.
LANGUEUR, s. f. (Méd.) est un mode ou espece de foiblesse plus facile à sentir qu'à définir ; elle est universelle ou particuliere ; on sent des langueurs d'estomac. Voyez INDIGESTION, ESTOMAC. On éprouve des langueurs générales, ou un anéantissement de tout le corps ; on ne se sent propre à aucune espece d'exercice & de travail ; les muscles semblent refuser leur action ; on n'a pas même la volonté de les mouvoir, parce qu'on souffre un malaise quand on le fait ; c'est un symptome propre aux maladies chroniques, & particulierement à la chlorose ; il semble être approprié aux maladies dans lesquelles le sang & les humeurs qui en dérivent, sont vapides, sans ton & sans activité. Le corps, ou pour mieux dire, les fonctions corporelles ne sont pas les seules langueurs ; mais les opérations de l'esprit, c'est-à-dire, les facultés de sentir, de penser, d'imaginer, de raisonner, sont dans un état de langueur singulier ; telle est la dépendance où sont ces fonctions du corps. Ce symptome n'aggrave point les maladies chroniques ; il semble indiquer seulement l'état atonique du sang & des vaisseaux, la diminution du mouvement intestin putréfactif. Les remedes les plus appropriés par conséquent sont ceux qui peuvent réveiller & animer ce ton, qui peuvent augmenter la fermentation ou le mouvement intestin du sang, & l'action des vaisseaux sur les liquides ; tels sont l'équitation, les martiaux, les plantes cruciformes, les alkalis fixes & volatils, & généralement tous ceux qui sont réellement convenables dans les maladies dont la langueur est le symptome. Voyez CHLOROSE, FORCE, FOIBLESSE, &c. (M)
|
| LANGUEYER | v. act. (Comm.) visiter un porc pour s'assurer s'il n'est point ladre. Ce qui se reconnoît à la langue.
|
| LANGUEYEUR | S. m. (Comm.) officier établi dans les foires & marchés, pour visiter ou faire visiter les porcs, & pour qu'il ne s'en vende point de ladres.
|
| LANGUIR | (Jardinage) se dit d'un arbre qui est dans un état de langueur, c'est-à-dire, qui pousse foiblement. On doit en rechercher la cause pour la faire cesser, & rétablir l'arbre dans la premiere vigueur.
|
| LANHOSO | (Géog.) ville de Portugal, avec château dans la province, entre Minho & Duro, à trois lieues de Brague.
|
| LANIA | ou LANISSE, s. f. (Couv.) il ne se dit guere que de la bourre que les laineurs, esplaigneurs & couverturiers levent de dessus les draps, couvertures & autres étoffes de laine. Il est défendu aux Tapissiers de mêler de la bourre-lanisse avec de la laine dans leurs ouvrages.
|
| LANIER | S. m. lanarius, (Hist. nat. Ornithol.) oiseau de proie un peu moins grand que le faucon gentil. Albin le donne sous le nom de petit lanier, dans son histoire naturelle des oiseaux. Il a le bec, les jambes & les piés bleus ; toutes les parties supérieures de l'oiseau sont de couleur brune, approchante de celle de la rouille de fer, quelquefois avec de petites taches rondes & blanches. Il a sur le front une bande blanche, qui s'étend de chaque côté au-dessus de l'oeil. Les parties inférieures du corps sont blanches avec des taches noires, qui suivent les bords de chaque plume. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, la face inférieure de l'aîle étendue paroit parsemée de taches blanches & rondes. Les piés ont moins de longueur, à proportion que ceux des faucons, des éperviers, du gerfaut, &c. Le mâle est plus petit que la femelle ; on lui donne le nom de laneret. Cet oiseau niche sur les grands arbres des forêts, & sur les rochers élevés. On l'apprivoise & on le dresse aisément ; il prend non-seulement les cailles, les perdrix, les faisans, &c. mais aussi les canards, & même les grives. Il reste en France pendant toute l'année. Voyez Willugh. Ornith. & l'Ornithologie de M. Brisson, où sont les descriptions de deux autres especes de lanier, savoir le lanier blanc & le lanier cendré. Voyez OISEAU.
|
| LANIERE | S. f. (Gramm. & art méchan.) bande de cuir mince & longue, qu'on emploie à différens usages.
|
| LANIFERE | adj. masc. & fem. lanigerus, (Bot.) épithete que l'on donne aux arbres qui portent une substance laineuse, telle que celle que l'on trouve ordinairement dans les chatons du saule ; on nomme coton, le duvet qui couvre certains fruits, comme la pêche ou le coing ; on dit aussi en parlant des feuilles, qu'elles sont cotonneuses, ou velues. L'étude de la Botanique a enrichi notre langue de tous ces divers mots. (D.J.)
|
| LANION | (Géogr.) petite ville de France, en basse Bretagne, vers la côte de la Manche, au diocèse de Treguier, à trois lieues de cette ville, en allant à Morlaix. Long. 14. 20. lat. 48. 42. (D.J.)
|
| LANISTE | S. m. lanista, (Hist. rom.) on appelloit lanistes à Rome, les maîtres qui formoient les gladiateurs, & qui les fournissoient par paires au public. C'étoit eux qui les exerçoient, qui les nourrissoient, qui les encourageoient, & qui les faisoient jurer de combattre jusqu'à la mort ; de-là vient que Pétrone nomme plaisamment les gladiateurs, lanistita familia ; mais nous avons parlé suffisamment des lanistes au mot GLADIATEUR, p. 695 du Tome VII. (D.J.)
|
| LANKAN | (Géogr.) grande riviere d'Asie, qui a sa source dans la Tartarie, au royaume de Lassa ou de Boutan, & qui après un long cours, se perd dans le golfe de la Cochinchine, vis-à-vis l'ile de Hainaut. Le P. Gaubil détermine le lac que fait cette riviere, à 29d 50' de latitude. (D.J.)
|
| LANNOY | Alnetum, (Géograph.) petite ville de France, avec titre de comté, dans la Flandre Wallonne, à deux lieues de Lille & trois de Tournay. Elle fut cédée à la France en 1667. Long. 20. 55. lat. 50. 40.
Rapheling (François) naquit dans la petite ville de Lannoy, & lui fit honneur, non par sa fortune ; ou la noblesse de son extraction, présens du hasard, mais par sa conduite & son savoir. De correcteur de l'imprimerie des Plantins, il devint professeur en langues orientales, dans l'université de Leyde. Le dictionnaire chaldaïque, le dictionnaire arabe, le dictionnaire persique, & autres ouvrages de ce genre qu'il avoit faits auparavant, lui valurent cette charge honorable ; mais le chagrin de la perte de sa femme abrégea ses jours, qui finirent en 1597, à l'âge de cinquante-huit ans. (D.J.)
|
| LANO-NIGER | (Monnoie) c'étoit une espece de petite monnoie qui étoit en vogue du tems d'Edouard I.
|
| LANSPESSADE | (Art milit.) Voyez ANSPESSADE.
|
| LANSQUENET | (Jeu de hasard) voici en général comme il se joue. On y donne à chacun une carte, sur laquelle on met ce qu'on veut ; celui qui a la main se donne la sienne. Il tire ensuite les cartes ; s'il amene la sienne, il perd ; s'il amene celles des autres, il gagne. Mais pour concevoir les avantages & desavantages de ce jeu, il faut expliquer quelques regles particulieres que voici.
On nomme coupeurs, ceux qui prennent cartes dans le tour, avant que celui qui a la main se donne la sienne.
On nomme carabineurs, ceux qui prennent cartes, après que la carte de celui qui a la main est tirée.
On appelle la réjouissance, la carte qui vient immédiatement après la carte de celui qui a la main. Tout le monde y peut mettre, avant que la carte de celui qui a la main soit tirée ; mais il ne tient que ce qu'il veut, pourvu qu'il s'en explique avant que de tirer sa carte. S'il la tire sans rien dire, il est censé tenir tout.
Le fonds du jeu réglé, celui qui a la main donne des cartes aux coupeurs, à commencer par sa droite, & ces cartes se nomment cartes droites, pour les distinguer des cartes de reprise & de réjouissance. Il se donne une carte, puis il tire la réjouissance. Cela fait, il continue de tirer toutes les cartes de suite ; il gagne ce qui est sur la carte d'un coupeur, lorsqu'il amene la carte de ce coupeur, & il perd tout ce qui est au jeu lorsqu'il amene la sienne.
S'il amene toutes les cartes droites des coupeurs avant que d'amener la sienne, il recommence & continue d'avoir la main, soit qu'il ait gagné ou perdu la réjouissance.
Lorsque celui qui a la main donne une carte double à un coupeur, c'est-à-dire une carte de même espece qu'une autre carte qu'il a déja donnée à un autre coupeur qui est plus à la droite, il gagne le fonds du jeu sur la carte perdante, & il est obligé de tenir le double sur la carte double.
Lorsqu'il donne une carte triple à un coupeur, il gagne ce qui est sur la carte perdante, & il est tenu de mettre quatre fois le fonds du jeu sur la carte triple.
Lorsqu'il donne une carte quadruple à un coupeur, il reprend ce qu'il a mis sur les cartes simples ou doubles, s'il y en a ; il perd ce qui est sur la carte triple de même espece que la quadruple qu'il amene, & il quitte la main sur le champ, sans donner d'autres cartes.
S'il se donne à lui-même une carte quadruple, il prend tout ce qu'il y a sur les cartes des coupeurs, & sans donner d'autres cartes, il recommence la main.
Lorsque la carte de réjouissance est quadruple, elle ne va point.
C'est encore une loi du jeu, qu'un coupeur dont la carte est prise, paye le fonds du jeu à chaque coupeur qui a une carte devant lui, ce qui s'appelle arroser ; mais avec cette distinction que quand c'est une carte droite, celui qui perd paye aux autres cartes droites le fonds du jeu, sans avoir égard à ce que la sienne, ou la carte droite des autres coupeurs soit simple, double ou triple ; au lieu que si c'est une carte de reprise, on ne paye & on ne reçoit que selon les regles du parti. Or à ce jeu, les partis sont de mettre trois contre deux, lorsqu'on a carte double contre carte simple ; deux contre un, lorsqu'on a carte triple contre carte double ; & trois contre un, lorsqu'on a carte triple contre carte simple.
Ces regles bien conçues, on voit que l'avantage de celui qui a la main, en renferme un autre, qui est de conserver les cartes autant de fois qu'il aura amené toutes les cartes droites des coupeurs avant que d'amener la sienne ; or comme cela peut arriver plusieurs fois de suite, quelque nombre de coupeurs qu'il y ait, il faut, en appréciant l'avantage de celui qui tient les cartes, avoir égard à l'espérance qu'il a de faire la main un nombre de fois quelconque indéterminément. D'où il suit qu'on ne peut exprimer l'avantage de celui qui a la main, que par une suite infinie de termes qui iront toujours en diminuant.
Qu'il a d'autant moins d'espérance de faire la main, qu'il y a plus de coupeurs & plus de cartes simples parmi les cartes droites.
Qu'obligé de mettre le double du fonds du jeu sur les cartes doubles, & le quadruple sur les triples, l'avantage qu'il auroit en amenant des cartes doubles ou triples, avant la sienne, diminue d'autant ; mais qu'il est augmenté par l'autre condition du jeu, qui lui permet de reprendre en entier ce qu'il a mis sur les cartes doubles & triples, lorsqu'il donne à un des coupeurs une carte quadruple.
S'il y a trois coupeurs A, B, C, & que le fonds du jeu soit F, & que le jeu soit aux pistoles, ou F = à une pistole, on trouve que l'avantage de celui qui a la main, est de 2 liv. 15 s. & environ 10 den. 490/503 de deniers.
S'il y a quatre coupeurs, cinq coupeurs, cet avantage varie.
Pour quatre coupeurs, son avantage est de 4 liv. 19 sols 1 den. 2569/3079 de deniers.
Pour cinq coupeurs, il est de 7 liv. 14 sols 7 den. 4955/3303301 de deniers.
Pour six coupeurs, il est de 10 liv. 12 s. 10 den. 328372137818918/375333882047233 de deniers.
Pour sept coupeurs, il est de 14 liv. 16 s. 5 den. 1276210397023/9756210003115796 de deniers.
D'où l'on voit que l'avantage de celui qui a la main ne croit pas dans la même raison que le nombre de joueurs.
S'il y a quatre coupeurs, le desavantage de A ou du premier, est 2 l. 16 s. 11 d. 2343/3079 de deniers.
Le desavantage de B ou du second, est 1 l. 14 s. 1 den. 1689/3079 de deniers.
Le desavantage de C ou de troisieme, est 8 sols. 0 den. 1616/3079 de deniers.
La probabilité que celui qui a la main la conservera, diminue à mesure qu'il y a un plus grand nombre de coupeurs, & l'ordre de cette diminution depuis trois coupeurs jusqu'à sept inclusivement, est à peu-près comme 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.
Il se trouve souvent des coupeurs qui se voyant la main malheureuse, ou pour ne pas perdre plus d'argent qu'ils n'en veulent hasarder, passent leur main, sans quitter le jeu. On voit que c'est un avantage qu'ils font à chaque coupeur.
Il en est de même quand un coupeur quitte le jeu.
Voici une table pour divers cas, où Pierre qui a la main, auroit carte triple. Elle marque combien il y a à parier qu'il la conservera.
S'il n'y a au jeu qu'une carte simple, celui qui a la main peut parier 3 contre 1.
S'il y a deux cartes simples, 9 contre 5.
S'il y a trois cartes simples, 81 contre 59.
S'il y a quatre cartes simples, 243 contre 212.
S'il y a cinq cartes simples, 279 contre 227.
S'il n'y a qu'une carte double, 2 contre 1.
S'il y a une carte simple & une carte double, 7 contre 5.
S'il y a deux cartes doubles, 8 contre 7.
S'il y a deux cartes simples & une double, 67 contre 59.
S'il y a six cartes simples, 6561 contre 7271.
S'il y a une carte simple & deux doubles, 59 contre 61.
C'est un préjugé que la carte de réjouissance soit favorable à ceux qui y mettent. Si cette carte a de l'avantage dans certaines dispositions des cartes des coupeurs, elle a du desavantage dans d'autres, & elle se compense toujours exactement.
La dupe est une espece de lansquenet, où celui qui tient la dupe se donne la premiere carte ; celui qui a coupé est obligé de prendre la seconde ; les autres joueurs peuvent prendre ou refuser la carte qui leur est présentée, & celui qui prend une carte double en fait le parti ; celui qui tient la dupe ne quitte point les cartes, & conserve toujours la main. On appelle dupe celui qui a la main, parce que la main ne change point, & qu'on imagine qu'il y a du desavantage à l'avoir. Mais quand on analyse ce jeu, on trouve égalité parfaite, & pour les joueurs entre eux, & pour celui qui tient la main, eu égard aux joueurs.
LANSQUENETS, subst. masc. (Art milit.) corps d'infanterie allemande, dont on a fait autrefois usage en France. Lansquenet est un mot allemand, qui signifie un soldat qui sert en Allemagne dans le corps d'infanterie. Pedes germanicus.
|
| LANTEAS | subst. masc. (Commerce) grandes barques Chinoises, dont les Portugais de Macao se servent pour faire le commerce de Canton. Les lanteas sont de 7 à 800 tonneaux. Les commissionnaires n'en sortent point tant que dure la foire de Canton ; & il n'est pas permis à de plus grands bâtimens de s'avancer davantage dans la riviere.
|
| LANTER | (Art méc.) Voyez LENTER & LENTURE.
|
| LANTERNE | S. f. (Gram. & Art méchaniq.) il se dit en général d'une petite machine faite ou revêtue de quelque chose de solide & de transparent, ouverte par sa partie supérieure & fermée de toute autre part ; au centre de laquelle on puisse placer un corps lumineux, de maniere qu'il éclaire audessus, que sa fumée s'échappe & que le vent ne l'éteigne pas. Il y en a de gaze, de toile, de peau, de vessie de cochon, de corne, de verre, de papier, &c.
LANTERNE, (Hydr.) se dit d'un petit dome de treillage élevé au-dessus d'un grand, auquel il sert d'amortissement. Dans une machine hydraulique, c'est une piece à jour faite en lanterne avec des fuseaux qui s'engrenent dans les dents d'un rouet, pour faire agir les corps de pompe. (K)
LANTERNE MAGIQUE, (Dioptr.) machine inventée par le P. Kircker, jésuite, laquelle a la propriété de faire paroître en grand sur une muraille blanche des figures peintes en petit sur des morceaux de verre minces, & avec des couleurs bien transparentes.
Pour cet effet, on éclaire fortement par-derriere le verre peint, sur lequel est placé la représentation de l'objet ; & on place par-devant à quelque distance de ce verre qui est placé, deux autres verres lenticulaires, qui ont la propriété d'écarter les rayons qui partent de l'objet, de les rendre divergens, & par conséquent de donner sur la muraille opposée une représentation de l'image beaucoup plus grande que l'objet. On place ordinairement ces deux verres dans un tuyau, où ils sont mobiles, afin qu'on puisse les approcher ou les éloigner l'un de l'autre, suffisamment pour rendre l'image distincte sur la muraille.
Ce tuyau est attaché au-devant d'une boëte quarrée dans laquelle est le porte-objet ; & pour que la lanterne fasse encore plus d'effet, on place dans cette même boëte un miroir sphérique, dont la lumiere occupe à peu-près le foyer ; & au-devant du porte-objet, entre la lumiere & lui, on place un troisieme verre lenticulaire. Ordinairement on fait glisser le porte-objet par une coulisse pratiquée en M, tout auprès du troisieme verre lenticulaire. Voyez la figure 10. d'Optique, où vous verrez la forme de la lanterne magique. NO est le porte-objet, sur lequel sont peintes différentes figures qu'on fait passer successivement entre le tuyau & la boëte, comme la figure le représente. On peut voir sur la lanterne magique l'essai physique de M. Muschenbrock §. 1320 & suivans, & les leçons de Physique de M. l'Abbé Nollet, tome V. vers la fin. La théorie de la lanterne magique est fondée sur une proposition bien simple ; si on place un objet un peu au-delà du foyer d'une lentille, l'image de cet objet se trouvera de l'autre côté de la lentille, & la grandeur de l'image sera à celle de l'objet, à peu-près comme la distance de l'image à la lentille est à celle de l'objet à la lentille. Voyez LENTILLE. Ainsi on pourroit faire des lanternes magiques avec un seul verre lenticulaire ; la multiplication de ces verres sert à augmenter l'effet. (O)
LANTERNE, (Méchaniq.) est une roue, dans laquelle une autre roue engrene. Elle differe du pignon en ce que les dents du pignon sont saillantes, & placées au-dessus & tout-autour de la circonférence du pignon, au lieu que les dents de la lanterne (si on peut les appeller ainsi) sont creusées au-dedans du corps même, & ne sont proprement que des trous où les dents d'une autre roue doivent entrer. Voyez DENT, ROUE, ENGRENAGE & PIGNON. Voyez aussi l'article CALCUL des nombres. (O)
LANTERNE la (Fortification) est un instrument pour charger le canon. On l'appelle quelquefois cuillere. Elle est ordinairement de cuivre rouge elle sert à porter la poudre dans la piece, & elle est faite en forme d'une longue cuillere ronde. On la monte sur une tête, masse, ou boëte emmanchée d'une hampe ou long bâton. Elle est ainsi composée de deux parties ; savoir, de sa boëte qui est de bois d'orme, & qui est tournée selon le calibre de la piece pour laquelle elle est destinée : elle a de longueur un calibre & demi de la piece. L'autre partie est un morceau de cuivre attaché à la boëte avec des clous aussi de cuivre à la hauteur d'un demi-calibre.
La lanterne doit avoir trois calibres & demi de longueur, deux de largeur, & être arrondie par le bout de devant pour charger les pieces ordinaires.
La hampe est de bois de frêne ou de hêtre d'un pouce & demi de diametre, sa longueur est de douze piés jusqu'à dix. Voyez nos Planches d'Art militaire, & leur explic.
LANTERNE de corne, (Hist. des inventions) on prétend qu'on en faisoit autrefois de corne de boeuf sauvage, mais on n'en donne point de preuve ; Pline dit seulement, l. VIII. c. xv. que cette corne coupée en petites lames minces, étoit transparente. On cite Plaute dans son Prologue de l'Amphitrion, & Martial, l. XIV. épict. 16. Il est vrai que ces deux auteurs, dans les endroits que l'on vient de nommer, parlent des lanternes, mais ils n'en indiquent point la matiere ; je pense donc qu'on doit attribuer l'invention des lanternes de corne à Alfred le grand, qui, comme on sait, régnoit avec tant de gloire sur la fin du neuvieme siecle ; alors on mesuroit le tems en Angleterre avec des chandelles allumées ; l'usage même des clepsydres y étoit inconnu ; mais comme le vent faisoit brûler la lumiere inégalement, & qu'il rendoit la mesure du tems très-fautive, Alfred imagina de faire ratisser de la belle corne en feuilles transparentes, & de les encadrer dans des chassis de bois ; cette invention utile à tant d'égards devint générale ; & bientôt on la perfectionna par le secours du verre. (D.J.)
LANTERNE, les Balanciers appellent lanterne une boëte assemblée, où, au lieu de panneaux de bois, ce sont des verres, dans laquelle on suspend un trébuchet, lorsque l'on veut peser bien juste quelque chose, comme quand on essaye de l'or ou quelque chose de précieux. Voyez les Planches du Balancier, & celles de Chimie.
LANTERNE, terme de Boutonnier, ce sont deux especes de cylindres creux & à jour, formés par deux petites planches rondes & minces, percées de trous à leur circonférence, & placées à une certaine distance l'une de l'autre au moyen de plusieurs petites baguettes qui passent dans ces trous, ce qui forme une espece de cage ronde & oblongue. Les deux planches qui servent de fond à la cage sont percées au centre d'un trou, dans lequel on passe une broche qui sert d'axe au cylindre. Le mouvement que la roue du rouet imprime au rochet, arrange le fil autour du rochet, & par conséquent tire l'écheveau qui étant placé autour des lanternes, leur communique le mouvement qu'il a reçu. Voyez Planches du Boutonnier, qui représente une femme qui devide au moyen d'un rouet un écheveau sur un rochet ; l'écheveau est monté sur les deux lanternes ou tournettes, qui sont elles-mêmes montées sur un petit banc ou billot.
LANTERNE, (Gazier) qu'on nomme aussi plioir, est un terme de Gazier. C'est un instrument dessus qui sert à ces ouvriers pour ôter la soie de rond, l'ourdissoir, & la mettre sur les deux ensubles qui sont au haut du métier à gaze. Voyez GAZE.
LANTERNE de Graveur est une machine propre à mettre de la lumiere pour travailler la nuit ; elle consiste en une partie qui forme le chandelier, & une feuille de papier huilée qui est collée sur un petit chassis. Voyez nos Pl. de Gravure, & l'art. CHASSIS DE GRAVEUR.
LANTERNE, (Horlog.) nom que l'on donne à une sorte de pignon ; on s'en sert particulierement dans les grandes machines. Voyez PIGNON A LANTERNE, & les Planches des machines hydrauliques.
LANTERNE d'Essayeur (à la Monnoie) est une espece de boëte terminée en chapiteau pointu en forme de quarré long, trois des côtés sont armés intérieurement de glaces, au-dessus des glaces & avant le chapiteau regne une petite conduite d'un lacet de soie qui va répondre au-bas & vis-à-vis le petit tiroir qui sert de base à la lanterne. Ce lacet a pour objet de lever une petite balance ou trébuchet. Cette lanterne ainsi préparée est pour que l'air ou autre corps ne fasse trébucher la balance. Voyez les Planches de Chimie.
LANTERNE, les Orfevres appellent ainsi la partie d'une crosse d'évêque, ou d'un bâton de chantre, qui est grosse & à jour, & représente en quelque façon une lanterne.
LANTERNE de l'Ourdissoir, (Ruban.) c'est positivement la cage pour loger le moulin servant à ourdir ; cette lanterne est composée de quatre grands piliers montant de la hauteur de six piés, larges de trois pouces, & épais de deux. Le pilier de devant porte dans le haut de son extrémité, & aussi pardevant, une entaille quarrée pour loger une poulie, sur laquelle doit passer la ficelle du blin ; ce même pilier a encore deux rainures de haut en bas des côtés de son épaisseur pour recevoir les arêtes du blin qui doit monter & descendre le long d'elles, deux traverses emmortaises l'une dans l'autre à leur centre, & dont les extrémités terminées en tenons viennent aboutir à quatre mortaises pratiquées haut & bas dans chacun des quatre piliers dont on vient de parler. Ces mortaises sont à quatre pouces des extrémités de ces piliers ; la traverse d'en-haut est percée d'outre en outre directement à son centre d'un trou pour recevoir la broche de l'arbre du moulin ; cette traverse est encore percée de trois trous, mais non pas d'outre en outre comme le précédent ; ces trois trous sont pour recevoir les bouts des piés de la couronne ; les bras de cette traverse qui vient aboutir au pilier de devant, n'a point ce trou à cause du passage de la ficelle du blin, qui doit s'aller entortiller autour de la broche de l'arbre du moulin ; la traverse croisée d'em-bas a à son centre une petite entaille quarrée pour recevoir le tourillon quarré de la grande table ronde du fond. Voyez BLIN, ARBRE DU MOULIN, &c.
LANTERNES fête des, (Hist. de la Chine) fête qui se célebre à la Chine le quinzieme jour du premier mois, en suspendant ce jour-là dans les maisons & dans les rues un très-grand nombre de lanternes allumées.
Nos missionnaires donnent pour la plûpart des descriptions si merveilleuses de cette fête chinoise, qu'elles sont hors de toute vraisemblance ; & ceux qui se sont contentés d'en parler plus simplement, nous représentent encore cette fête comme une chose étonnante, par la multiplicité des lampes & des lumieres, par la quantité, la magnificence, la grandeur, les ornemens de dorure, de sculpture, de peinture & de vernis des lanternes.
Le P. le Comte prétend que les belles lanternes qu'on voit dans cette fête, sont ordinairement composées de six faces ou panneaux, dont chacun fait un cadre de quatre piés de hauteur, sur un pié & demi de large, d'un bois verni, & orné de dorures. Ils y tendent, dit-il, une fine toile de soie transparente, sur laquelle on a peint des fleurs, des rochers, & quelquefois des figures humaines. Ces six panneaux joints ensemble, composent un hexagone, surmonté dans les extrémités de six figures de sculpture qui en font le couronnement. On y suspend tout autour de larges bandes de satin de toutes couleurs, en forme de rubans, avec d'autres ornemens de soie qui tombent par les angles sans rien cacher de la peinture ou de la lumiere. Il y a tel seigneur, continue le voyageur missionnaire, qui retranche toute l'année quelque chose de sa table, de ses habits & de ses équipages, pour être ce jour-là magnifique en lanternes. Ils en suspendent à leurs fenêtres, dans leurs cours, dans leurs salles & dans les places publiques. Il ne manquoit plus au R. P. le Comte, pour embellir son récit, que d'illuminer encore toutes les barques & les vaisseaux de la Chine, des jolies lanternes de sa fabrique.
Ce qu'on peut dire de vrai, c'est que toutes les illuminations qui de tems immémorial se font de maniere ou d'autre par tout pays, sont des coutumes que le monde conserve des usages du feu, & du bien qu'il procure aux hommes. (D.J.)
|
| LANTERNIER | S. m. (Gramm. Art. méch.) c'est l'ouvrier qui fait les lanternes : l'on dit ferblantier, lanternier, voyez FERBLANTIER. On donne encore le nom de lanternier à celui qui allume les lanternes qui éclairent la nuit les rues de Paris.
|
| LANTERNISTE | S. m. (Hist. litt.) nom d'académiciens établis à Toulouse. Ils prirent ce nom des petites lanternes avec lesquelles ils se rendoient à leurs assemblées qui se tenoient la nuit.
|
| LANTHU | S. m. (Hist. mod.) nom d'une secte de la religion des Tunquinois, peuple voisin des Chinois. C'est la même que ceux-ci nomment lançu ou lanzu. Voyez LANÇU.
Les peuples du Tunquin ont encore plus de vénération pour le philosophe auteur de cette secte, que n'en témoignent les Chinois. Elle est principalement fondée sur ce qu'il leur a enseigné une partie de la doctrine de Chacabout, voyez CHACABOUT.
Tavernier dans son voyage des Indes, ajoûte que ce prétendu prophete se concilia l'affection des peuples, en excitant les grands & les riches à fonder des hôpitaux dans les villes où avant lui on ne connoissoit pas ces sortes d'établissemens. Il arrive souvent que des seigneurs du royaume & des bonzes s'y retirent pour se consacrer au service des malades.
|
| LANTIONE | S. f. (Marine) c'est un bâtiment en usage dans les mers de la Chine, sur-tout pour les corsaires de ce pays. Il approche beaucoup de nos galeres ; il a seize rangs de rameurs, huit à chaque côté, & six hommes à chaque rang.
|
| LANTOR | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbre qui croît dans l'île de Java ; il est d'une hauteur extraordinaire ; ses feuilles ont cinq ou six piés de longueur ; elles sont très-fermes & très-unies, au point qu'on peut s'en servir pour y tracer avec un crayon ou un poinçon de fer : aussi servent-elles de papier aux habitans de l'île de Java.
|
| LANUGI | (Géogr.) marquisat d'Italie dépendant du grand duché de Toscane.
|
| LANUGINEUX | adj. (Gramm. & Botan.) qui est velu & couvert d'un duvet semblable à la laine. On dit de quelques plantes qu'elles ont la feuille lanugineuse.
|
| LANUSURE | S. f. (Plombier) piece de plomb qui se place au droit des arrêtieres & sous les amortissemens. On l'appelle aussi basque.
|
| LANUVIUM | (Géogr. anc.) aujourd'hui Civita Indovina ; petite ville d'Italie dans le Latium, à 15 milles de Rome, sur la voie Appienne, Il y avoit un temple à Lanuvium dédié à Junon Conservatrice. Tite-Live, liv. XXII. ch. j. fait mention des sacrifices qui y furent décernés ; mais les anciens auteurs parlent encore davantage du champ de divination, nommé solonius campus, qui se trouvoit dans le territoire de cette ville.
Ce champ servoit d'asyle à un vieux & redoutable serpent, qui toutes les années dans la saison du printems, lorsque la terre reprend une nouvelle vie, venoit demander de la nourriture à certain jour fixe. Une fille du lieu, encore vierge, étoit chargée de la lui offrir ; cependant avec quelle crainte ne devoit-elle pas approcher du serpent terrible, & quelle épreuve pour son honneur ! Ce reptile ne vouloit recevoir d'aliment que d'une main pure & chaste. Malheur aux jeunes filles qui lui en auroient offert après avoir eu des foiblesses ! Pour les autres, elles étoient rendues à leurs parens ; elles étoient comblées de caresses, & l'air retentissoit de cris de joye qui sur ce favorable augure annonçoient au pays la récolte la plus abondante.
Properce, Eleg. 8. liv. IV. a décrit cette cérémonie, & le roi de France possede dans son cabinet une belle pierre gravée qui en donne la représentation. Un jeune homme, dit M. Mariette, se baisse pour prendre la corbeille mystérieuse dans laquelle est le serpent : cet animal va paroître ; & la fille aussi modeste que timide, s'avance tenant une paterre & un vase rempli de lait ou de miel. Son pere & sa mere qui l'accompagnent, semblent implorer sur elle l'assistance des dieux ; & le satyre qui les suit & qui leve le bras en signe d'acclamation, nous apprend le succès de l'épreuve, & les avantages que les habitans de la campagne en vont retirer.
Je trouve dans les Annales historiques que Quirinus (Publius Sulpicius), consul romain, mort l'an 22 de Jesus-Christ, naquit à Lanuvium ; il acheva le dénombrement de la Judée qu'avoit commencé Sentius Saturnius ; du-moins nous avons lieu de présumer que c'est le même qui est appellé Cyrénius dans l'évangile de saint Luc. Il mérita l'honneur du triomphe par ses victoires, & devint gouverneur de Caïus, petit-fils d'Auguste.
Mais Lanuvium avoit encore plus sujet de se glorifier d'avoir donné la naissance à l'empereur Marc Antonin, ce prince admirable, qui par sa sagesse & sa modération s'attira l'amour de ses sujets & les hommages des barbares. Il mourut dans le sein du repos l'an 161 de l'ere chrétienne, comblé d'années & regretté de l'univers.
Les tyrans inhumains périssent dans la rage ;
Mais Antonin, Trajan, Marc-Aurele, Titus,
Ont eu des jours sereins sans nuit & sans orage,
Purs comme leurs vertus. (D.J.)
|
| LANZO | Axima, (Géogr.) ville d'Italie au Piémont, sur la Sture, à 8 lieues de Suze, 5 N. O. de Turin. Long. 25. 8. lat. 45. 2.
|
| LA | ou LAOS, (Géogr.) grand royaume d'Asie au-delà du Gange. Il est situé sous le même climat que Tonquin, & séparé des états voisins par des forêts & par des deserts : aussi trouve-t-on de grandes difficultés à y aller par terre, à cause des hautes montagnes ; & par eau, à cause des rochers & des cataractes dont la riviere est pleine.
Ce royaume est borné au nord par la province chinoise nommée Yunnam ; à l'orient, par des monts élevés, par le Tonquin & par la Cochinchine ; au midi, par Cambodia ; & au couchant, par de nouvelles montagnes qui le séparent des royaumes de Siam & d'Ava. Un bras du Gange traverse le pays, qu'il rend navigable : desorte que les habitans de Cambodin y vont tous les ans dans leurs proues ou bateaux pour trafiquer. La capitale est nommée Lanchang par M. Delisle, & Landjam par Koempfer.
Le pays de Lao produit en abondance la meilleure espece de riz, de musc, de benjoin & de gomme laque qu'on connoisse ; il procure quantité d'ivoire par le grand nombre d'éléphans qui s'y trouvent ; il fournit aussi beaucoup de sel, quelques perles & quelques rubis. Les rivieres y sont remplies de poisson.
Le roi de Lao est le prince le plus absolu qu'il y ait au monde ; car son pouvoir est despotique dans les affaires religieuses & civiles : non-seulement toutes les charges, honneurs & emplois dépendent de lui, mais les terres, les maisons, les héritages, les meubles, l'or & l'argent de tous les particuliers lui appartiennent, sans que personne en puisse disposer par testament. Il ne se montre à son peuple que deux fois l'année ; & quand il lui fait cette grace, ses sujets par reconnoissance tâchent de le divertir de leur mieux par des combats de lutteurs & d'éléphans.
Il n'y a que sept grandes dignités ou vice-royautés dans ses états, parce que son royaume n'est divisé qu'en sept provinces : mais il y a un viceroi général pour premier ministre, auquel tous les autres vicerois obéissent : ceux-ci commandent à leur tour aux mandarins ou seigneurs du pays de leur district.
La religion des Langiens, c'est ainsi qu'on appelle les peuples de Lao, est la même que celle des Siamois, une parfaite idolatrie, accompagnée de sortileges & de mille superstitions. Leurs prêtres, nommés talapoins, sont des misérables, tirés d'ordinaire de la lie du peuple ; leurs livres de cérémonies religieuses sont écrits comme ceux des Pégans & des Malabariens, sur des feuilles de palmier, avec des touches de terre.
La polygamie regne dans ce pays-là, & les jeunes garçons & filles y vivent dans la plus grande incontinence. Lorsqu'une femme est nouvellement accouchée, toute la famille se rend chez elle & y passe un mois en repas, en festins & en jeux, pour écarter de sa maison les magiciens, les empêcher de faire perdre le lait à la mere & d'ensorceler l'enfant.
Ces peuples font encore une autre fête pendant trente jours au décès de leurs parens. D'abord ils mettent le mort dans un cercueil bien enduit partout de bitume ; il y a festin tous les jours pour les talapoins, qui emploient une partie du tems à conduire, par des chansons particulieres, l'ame du mort dans le chemin du ciel. Le mois expiré, ils élevent un bucher, y posent le cercueil, le brûlent & ramassent les cendres du mort, qu'ils transportent dans le temple des idoles. Après cela, on ne se souvient plus du défunt, parce que son ame est passée, par la transmigration, au lieu qui lui étoit destiné.
Les Langiens ressemblent aux Siamois de figure, avec cette seule différence qu'ils sont plus déliés & plus basanés ; ils ont de longues oreilles comme les Pégouans & les habitans des côtes de la mer ; mais le roi de Lao se distingue personnellement par le vuide des trous de ses oreilles. On commence à les lui percer dès la premiere enfance, & l'on augmente chaque mois l'ouverture, en employant toûjours de plus grosses cannules, jusqu'à ce qu'enfin les oreilles trouées de sa majesté aient atteint la plus grande longueur qu'on puisse leur procurer. Les femmes qui ne sont pas mariées portent à leurs oreilles des pieces de métal ; les hommes se font peindre les jambes depuis la cheville du pié jusqu'au genou, avec des fleurs inéffaçables à la maniere des bras peints des Siamois : c'est-là la marque distinctive de leur religion & de leur courage ; c'est-à-peu près celle que quelques fermiers d'Angleterre mettent à leurs moutons qu'ils font parquer dans des communes. (D.J.)
|
| LAO-KIUN | (Hist. mod. & Philosophie) c'est le nom que l'on donne à la Chine à une secte qui porte le nom de son fondateur. Lao-Kiun naquit environ 600 ans avant l'ere chrétienne. Ses sectateurs racontent sa naissance d'une maniere tout-à-fait extraordinaire ; son pere s'appelloit Quang ; c'étoit un pauvre laboureur qui parvint à soixante & dix ans, sans avoir pu se faire aimer d'aucune femme. Enfin, à cet âge, il toucha le coeur d'une villageoise de quarante ans, qui sans avoir eu commerce avec son mari, se trouva enceinte par la vertu vivifiante du ciel & de la terre. Sa grossesse dura quatre-vingt ans, au bout desquels elle mit au monde un fils qui avoit les cheveux & les sourcils blancs comme la neige ; quand il fut en âge, il s'appliqua à l'étude des Sciences, de l'Histoire ; & des usages de son pays. Il composa un livre intitulé Tau-Tsé, qui contient cinquante mille sentences de Morale. Ce philosophe enseignoit la mortalité de l'ame ; il soutenoit que Dieu étoit matériel ; il admettoit encore d'autres dieux subalternes. Il faisoit consister le bonheur dans un sentiment de volupté douce & paisible qui suspend toutes les fonctions de l'ame. Il recommandoit à ses disciples la solitude comme le moyen le plus sûr d'élever l'ame au-dessus des choses terrestres. Ces ouvrages subsistent encore aujourd'hui ; mais on les soupçonne d'avoir été altérés par ses disciples ; leur maître prétendoit avoir trouvé le secret de prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes ordinaires ; mais ils allerent plus loin, & tâcherent de persuader qu'ils avoient un breuvage qui rendoit les hommes immortels, & parvinrent à accréditer une opinion si ridicule ; ce qui fit qu'on appella leur secte la secte des Immortels. La religion de Lao-Kiun fut adoptée par plusieurs empereurs de la Chine : peu-à-peu elle dégénera en un culte idolâtre, & finit par adorer des demons, des esprits, & des génies ; on y rendit même un culte aux princes & aux héros. Les prêtres de cette religion donnent dans les superstitions de la Magie, des enchantemens, des conjurations ; cérémonies qu'ils accompagnent de hurlemens, de contorsions, & d'un bruit de tambours & de bassins de cuivre. Ils se mêlent aussi de prédire l'avenir. Comme la superstition & le merveilleux ne manquent jamais de partisans, toute la sagesse du gouvernement chinois n'a pu jusqu'ici décréditer cette secte corrompue.
|
| LAOCOON LE | (Sculpt. antiq.) c'est un des plus beaux morceaux de sculpture grecque que nous possédions ; il est de la main de Polydore, d'Athénodore & d'Agesandre, trois excellens maîtres de Rhodes, qui le taillerent de concert d'un seul bloc de marbre.
Cet ouvrage célebre fut trouvé à Rome dans les ruines du palais de Titus, au commencement du xvj. siecle, sous le pontificat de Jules II. & passa depuis dans le palais Farnese. De tous ceux qui l'ont pu voir, il n'est personne qui doute de l'art supérieur des anciens à donner une ame vraiment noble, & prêter la parole au marbre & au bronze.
Laocoon, dont tout le monde sait l'histoire, est ici représenté avec ses deux fils, dans le tems que les deux affreux serpens, sortis de l'île de Ténédos, l'embrassent, se replient au-tour de son corps, le rongent & l'infectent de leur venin : lisez ce qu'en dit Virgile.
Serpens amplexus uterque
Implicat & miseros morsu depascitur artus ;
Corripiunt, spirisque ligant ingentibus, & jam
Bis medium amplexit, bis collo squamea circùm
Terga dati, superant capite, & cervicibus altis.
Mais que l'expression des figures du Laocoon de la Grece est supérieure au tableau du poëte de Rome ! vous n'en douterez point après avoir vû le jugement brillant qu'en porte un moderne, connoisseur en ces matieres. Je vais le laisser parler lui-même.
Une noble simplicité, nous dit-il, est sur-tout le caractere distinctif des chefs-d'oeuvre des Grecs : ainsi que le fond de la mer reste toûjours en repos, quelqu'agitée que soit la surface, de même l'expression que les Grecs ont mise dans leurs figures fait voir dans toutes les passions une ame grande & tranquille : cette grandeur, cette tranquillité regnent au milieu des tourmens les plus affreux.
Le Laocoon en offre un bel exemple : lorsque la douleur se laisse appercevoir dans tous les muscles & dans tous les nerfs de son corps, au point qu'un spectateur attentif ne peut presque pas s'empêcher de la sentir ; en ne considérant même que la contraction douloureuse du bas ventre, cette grande douleur ne se montre avec furie ni dans le visage ni dans l'attitude. Laocoon, prêtre d'Apollon & de Neptune, ne jette point de cris effroyables, comme nous l'a représenté Virgile : l'ouverture de sa bouche ne l'indique pas, & son caractere aussi ferme qu'héroïque ne souffre point de l'imaginer ; il pousse plûtôt des soupirs profonds, auxquels le comble du mal ne semble pas permettre un libre cours ; & c'est ainsi que le frere du fondateur de Troie a été dépeint par Sadolet. La douleur de son corps & la grandeur de son ame sont pour ainsi dire combinées la balance à la main, & repandues avec une force égale dans toute la configuration de la statue. Laocoon souffre beaucoup, mais il souffre comme le Philoctete de Sophocle : son malheur nous pénetre jusqu'au fond de l'ame, mais nous souhaitons en même tems de pouvoir supporter le malheur comme ce grand homme le supporte : l'expression d'une ame si sublime surpasse de beaucoup la représentation de la nature. Il falloit que l'artiste de cette expression sentît en lui-même la force de courage qu'il vouloit imprimer à son marbre. C'est encore un des avantages de l'ancienne Grece, que d'avoir possédé des artistes & des philosophes dans les mêmes personnes. La sagesse prêtant la main à l'art, mettoit dans les figures des ames élevées au-dessus des ames communes.
Si l'artiste eût donné une draperie à Laocoon, parce qu'il étoit revêtu de la qualité de prêtre, il nous auroit à peine rendu sensible la moitié de la douleur que souffre le malheureux frere d'Anchise. De la façon au contraire dont il l'a représenté, l'expression est telle, que le Bernin prétendoit découvrir dans le roidissement de l'une des cuisses de Laocoon le commencement de l'effet du venin du serpent. La douleur exprimée toute seule dans cette statue de Laocoon auroit été un défaut. Pour réunir ce qui caractérise l'ame & ce qui la rend noble, l'artiste a donné à ce chef-d'oeuvre une action qui dans l'excès de douleur approche le plus de l'état du repos, sans que ce repos dégénere en indifférence ou en une espece de léthargie.
Il est des censeurs qui n'applaudissant qu'à des ouvrages où dominent des attitudes extraordinaires & des actions rendues avec un feu outré, n'applaudissent point à ce chef-d'oeuvre de la Grece : de tels juges ne veulent sans-doute que des Ajax & des Capanées. Il faudroit pour mériter leurs suffrages que les figures eussent une ame semblable à celle qui sort de son orbite, mais on connoîtra le prix solide de la statue de Laocoon en se familiarisant avec les ouvrages des Grecs, & en contractant pour ainsi dire l'habitude de vivre avec eux. Prens mes yeux, disoit Nicomaque à un homme qui osoit critiquer l'Helene de Zeuxis, prens mes yeux, & tu la trouveras divine.
Pline prit les yeux de Nicomaque pour juger du Laocoon. Selon lui la peinture ni la fonte n'ont jamais rien produit de si parfait. Opus omnibus, dit-il, & picturae & statuariae artis, praeferendum, lib. XXXVI. ch. v. C'est aussi le premier des morceaux qui ayent été représentés en taille-douce dans le livre des anciennes statues de la ville de Rome, mis au jour par Laurent Vaccarius en 1584. On a en France quelques copies de celui du palais Farnese, & en particulier celle qui est en bronze à Trianon. Ce fameux grouppe se trouve encore sur une gravure antique du cabinet du roi ; on remarque sur le devant un brasier, & dans le fond le commencement du frontispice du temple pour le sacrifice que ce grand-prêtre & ses enfans faisoient à Neptune lorsque les deux horribles serpens vinrent les envelopper & leur donner la mort. Enfin le Laocoon a été gravé merveilleusement sur un amétyste par le célebre Sirlet, & cet ouvrage passe pour son chef-d'oeuvre. (D.J.)
|
| LAODICÉE | (Géog. anc.) , Laodicea ; les Géographes nomment sept villes de ce nom, qu'il importe de distinguer ici.
1°. Laodicée sur le Lycus, Laodicea ad Lycum, & les habitans Laodiceni dans Tacite, est une ville célebre d'Asie, dans la Carie, située près du fleuve Lycus, qui se perd dans le Méandre, à dix lieues de la ville de Colosse au N. E. & à deux lieues d'Hiérapolis au S. Pline assure que ses murs étoient baignés par l'Asopus & le Caprus. Il ajoute qu'elle fut d'abord appellée Diospolis, & ensuite Rhoas.
L'origine du nom Laodicée, vient de ce qu'elle avoit été établie par Antiochus fils de Stratonice, dont la femme s'appelloit Laodicée. S. Paul en parle dans son épître aux Colossiens, & l'auteur de l'Apocalypse la nomme entre les sept églises, auxquelles l'Esprit-Saint adresse ses reproches. Ciceron, liv. II. ép. 17. liv. III. ép. 5. & 20. la représente comme une ville fameuse & de grand commerce, où l'on changeoit son argent, & Tacite dit quelque part : " la même année, Laodicée, l'une des villes illustres de l'Asie, étant presque abîmée par un tremblement de terre, se releva sans nous, & par ses propres forces ".
Il y a une médaille de l'empereur Commode, où Laodicée & les deux rivieres, le Lycus & le Caprus, sont spécifiées .
On voit encore aujourd'hui par ses décombres, que c'étoit une fort grande ville ; il y avoit trois théatres de marbre, dont il subsiste même de beaux restes. Près d'un de ces théatres, on lit une inscription greque à l'honneur de Tite-Vespasien. Les Turcs appellent les ruines de cette ville eskihissar, c'est-à-dire vieux château : elle étoit archiépiscopale. On y a tenu divers conciles, dont le plus considérable fut en 314, selon Baronius, & selon d'autres auteurs, en 352. Suivant Ptolomée, sa longitude est 59. 15. latitude 38. 40.
LAODICEE, près du Liban, ville d'Asie en Syrie, dans un pays qui en prenoit le nom de Laodicene, selon Ptolomée, l. V. c. xv. qui la distingue par le nom de Cabiosa Laodicea. Elle étoit sur l'Oronte, entre Emese & Paradisus, peu loin du Liban. Elle est nommée sur les médailles d'Antonin, de Caracalla, & de Severe, ; elle est aussi nommée dans le Digeste lege I. de Censibus, §. 3. où il est dit, qu'elle étoit dans la Caelésyrie, & que l'empereur Severe lui avoit accordé les droits attachés aux villes d'Italie, à cause des services qu'elle avoit rendus pendant la guerre civile. Long. selon Ptolomée, 69. 40. lat. 33. 45.
LAODICEE sur la mer, ville de Syrie, située au bord de la mer : elle est bien bâtie, dit Strabon, avec un bon port, & jouit d'un territoire fertile en grains, & en bons vignobles, qui lui produisent beaucoup de vin. Lentulus le fils, mande dans une lettre à Ciceron, lib. XII. epist. xiv, que Dolabella exclus d'Antioche, n'avoit point trouvé de ville plus sûre pour s'y retirer, que Laodicée en Syrie sur la mer.
Il y a des médailles expresses de cette Laodicée, & sur lesquelles on lit , Laodicensium qui sunt ad mare. Pline, l. V. c. xxj. nous désigne sa situation sur une pointe de terre, & l'appelle Laodicée libre, promontorium in quo Laodicea libera. Ammien Marcellin la met du nombre des quatre villes qui faisoient l'ornement de la Syrie, Antioche, Laodicée, Apamée, & Séleucie. Elle avoit ainsi que les trois autres, reçu son nom de Seleucus ; il nomma la premiere du nom de son pere, la seconde de celui de sa mere, la troisieme de celui de sa femme, & la quatrieme du sien propre. Le P. Hardouin croit que c'est présentement Latakie. La long. selon Ptolomée, 68. 30. lat. 35. 6.
LAODICEE, surnommée la Brûlée, Laodicea combusta, , ville d'Asie, que les uns mettent dans la Pisidie, d'autres en Phrygie ; d'autres enfin dans la Lycaonie, parce qu'elle étoit aux confins de ces différens pays. Son surnom lui vient de la nature de son terrein, qui paroissoit brûlé, & qui étoit fort sujet aux tremblemens de terre. Ptolomée fixe sa long. à 62. 40. sa lat. à 39. 40.
LAODICEE, ville d'Asie, aux confins de la Médie & de la Perse propre. Strabon & Etienne le géographe placent cette ville en Médie.
LAODICEE, ville de la Mésopotamie, bâtie par Seleucus, & à laquelle il avoit donné le nom de sa mere.
LAODICEE, cette septieme Laodicée étoit au Péloponnèse, dans la Mégapolitide, selon Polybe, l. II. ou dans l'Orestide, selon Thucydide, l. IV. c'est la même que la Ladoncea de Pausanias. (D.J.)
|
| LAON | (Géog.) prononcez Lan, en latin Laodunum, ou Lodunum ; mais on voit que les plus anciens l'appelloient Lugdunum, qui étoit surnommée Clavatum, ville de France en Picardie, capitale du Laonnois, petit pays auquel elle donne son nom, avec un évêché suffragant de Rheims ; son commerce consiste en blé. Laon a été le siége des rois de la seconde race dans le x. siecle ; il est situé fort avantageusement sur une montagne, à 12 lieues N. O. de Rheims, 9 N. E. de Soissons, 31 N. E. de Paris. Long. 21d. 17'. 29''. lat. 49d. 33'. 52''.
Laon fut, dit-on, érigé en évêché l'an 496, sous le regne de Clovis ; il faisoit auparavant une partie du diocèse de Rheims.
Au-bas de Laon est une abbaye de filles, appellée Montreuil-les-Dames : cette abbaye est principalement connue par la Véronique ou sainte Face de Jesus-Christ, que l'on y conserve avec soin, & qui y attire en tout tems un grand concours de peuple ; l'original de cette image est à Rome ; celle-ci n'est qu'une copie, qui fut envoyée aux religieuses en 1249, par Urbain IV, qui n'étoit alors qu'archidiacre de Laon, & chapelain d'Innocent IV. Au-bas du cadre où cette image est enchâssée, on voit une inscription, qui dans ces derniers tems, a donné de l'exercice à nos érudits, & a fait voir combien ils doivent se défier de leurs conjectures ingénieuses. Le P. Mabillon avoua cependant que les caracteres lui étoient inconnus ; mais le P. Hardouin y découvrit un vers grec héxametre, & publia pour preuve une savante dissertation, qui eût entraîné tous les suffrages, sans un carme déchaussé, appellé le P. Honoré de sainte Catherine, lequel dit naturellement que l'inscription n'étoit point en grec, mais en sclavon. On méprisa le bon homme, son ignorance, & celle des Moscovites, de l'autorité desquels ils s'appuyoit. Le Czar vint à Paris avec le prince Kourakin, & les princes Narisquin : on leur demanda par pure curiosité, s'ils connoissoient la langue de l'inscription ; ils répondirent tous, que l'inscription portoit en caracteres sclavons, les trois mots obras gospoden naoubrons, qui signifient en latin, imago Domini in limen, " l'image de notre Seigneur est ici encadrée ". On fut bien surpris de voir que le bon carme avoit eu raison contre tous les Savans du royaume, & on finit par se moquer d'eux.
Charles I. duc de Lorraine, fils de Louis d'Outremer, naquit à Laon en 953. On sait que Hugues Capet trouva le secret de se faire nommer à sa place roi de France en 987. Charles tenta vainement de soutenir son droit par les armes ; il y réussit si mal, qu'il fut arrêté, pris, & enfermé dans une étroite prison à Orléans, où il finit sa carriere trois ans après, c'est-à-dire en 994. (D.J.)
|
| LAONNOIS | (Géog.) petit pays de France en Picardie : il est borné au Nord par la Thiérarche, au Levant par la Champagne, au Couchant & au Midi par le Soissonnois. La capitale de ce petit pays est Laon. Les autres lieux principaux sont Corbigny, Liesse, Coussi, Follenbray, Novion le Vineux. Ce dernier endroit n'est aujourd'hui qu'un village, dont les habitans doivent à leur seigneur une espece de taille de plusieurs muids de vin par an. Il intervint arrêt du parlement de Paris en 1505, confirmatif d'une sentence qui déboute les habitans de Novion-le-Vineux de leur demande, à ce que cette rente annuelle de vin fût fixée en argent. La fin de cet arrêt qui est en latin, mérite d'être remarquée : " Sauf toutefois à l'intimé, de faire aux appellans telle grace qu'il avisera bon être, à cause de la misere & calamité du tems ", Cette clause, qui sembleroit de nos jours inutile & ridicule, étoit alors sans-doute de quelque poids, pour insinuer à un homme de qualité des considérations d'équité que le parlement n'osoit prescrire lui-même. (D.J.)
|
| LAOR | (bois de), Hist. nat. espece de bois des Indes, d'un goût fort amer, & à qui on attribue un grand nombre de propriétés médicinales qui n'ont point été suffisamment constatées.
|
| LAOSYNACTE | S. m. (Hist. ecclés.) officier dans l'Eglise greque, dont la charge étoit de convoquer & d'assembler le peuple, ainsi que les diacres dans les occasions nécessaires. Ce mot vient de , peuple, & , j'assemble. (D.J.)
|
| LAPER | v. n. (Gram.) il se dit de la maniere dont les animaux quadrupedes de la nature des chiens, des loups, des renards, &c. boivent l'eau ou mangent les choses fluides.
|
| LAPEREAU | S. m. (Gram.) petit du lapin. Voyez LAPIN.
|
| LAPHISTIEN | Laphistius (Littérat.) surnom de Jupiter, tiré du temple qu'on bâtit en son honneur, & de la statue de pierre qu'on lui érigea sur le mont Laphistius en Béotie. Voyez LAPHISTIUS. D. J.)
|
| LAPHISTIUS, MONS | (Géog. anc.) montagne de Grece en Béotie : Pausanias, l. V. c. xxxiv. en parle ainsi. " Il y a vingt stades, c'est-à-dire deux milles & demi, de Coronée au mont Laphistius, & à l'aire de Jupiter Laphistien ; la statue du dieu est de pierre. Lorsque Athamas étoit sur le point d'immoler Hellé & Phrixus en cet endroit, on dit que Jupiter fit paroître tout-à-coup un bélier à toison d'or, sur lequel ces deux enfans monterent, & se sauverent. Plus haut est l'Hercule nommé Charops, c'est-à-dire aux yeux bleus. Les Béotiens prétendent qu'Hercule monta par-là, lorsqu'il traînoit Cerbère, le chien de Pluton. A l'endroit par où l'on descend le mont Laphistius, pour aller à la chapelle de Minerve Itonienne, est le Phalare, qui se dégorge dans le lac de Céphise ; au-delà du mont Laphistius, est Orchomene, ville célebre, &c. (D.J.)
|
| LAPHRIENNE | Laphria, (Littér.) surnom que les anciens habitans d'Aroé, ville du Péloponnèse, donnerent à Diane, après l'expiation du crime de Ménalippe & de Cométho, qui avoit prophané le temple de cette déesse par leurs impudiques amours. Ils lui érigerent pour lors une statue d'or & d'ivoire, qu'ils gardoient précieusement dans leur citadelle ; ensuite lorsqu'Auguste eut soumis cette ville à l'empire romain, & qu'elle eut pris le nom de Patras, Colonia Augusta, Aroë Patrensis, ses habitans rebâtirent un nouveau temple à Diane Laphrienne, & établirent en son honneur une fête dont Pausanias nous a décrit les cérémonies dans son voyage de Grece. (D.J.)
|
| LAPHYRE | Laphyra, (Littér.) surnom de Minerve, tiré du mot grec , dépouilles, butin ; parce que comme déesse de la guerre, elle faisoit faire du butin ; elle faisoit remporter des dépouilles sur les ennemis aux troupes qu'elle favorisoit. (D.J.)
|
| LAPIDAIRE | S. f. (Arts méchaniq.) ouvrier qui taille les pierres précieuses. Voyez DIAMANT & PIERRE PRECIEUSE.
L'art de tailler les pierres précieuses est très-ancien, mais son origine a été très-imparfaite. Les François sont ceux qui y ont réussi le mieux, & les Lapidaires ou Orfevres de Paris, qui forment un corps depuis l'an 1290, ont porté l'art de tailler les diamans, qu'on appelle brillans, à sa plus haute perfection.
On se sert de différentes machines pour tailler les pierres précieuses, selon la nature de la pierre qu'on veut tailler. Le diamant, qui est extrêmement dur, se taille & se façonne sur un rouet d'un acier doux, qu'on fait tourner au moyen d'une espece de moulin, & avec de la poudre de diamant qui trempe dans de l'huile d'olive ; cette méthode sert aussi-bien à le polir, qu'à le tailler. Voyez DIAMANT.
Les rubis orientaux, les saphirs & les topases se taillent & se forment sur un rouet de cuivre qu'on arrose avec de la poudre de diamant & de l'huile d'olive. Leur poliment se fait sur une autre roue de cuivre, avec du tripoli détrempé dans de l'eau. Voyez RUBIS.
Les émeraudes, les jacinthes, les amétistes, les grenats, les agathes, & les autres pierres moins précieuses, moins dures, on les taille sur une roue de plomb, imbibée de poudre d'émeril détrempée avec de l'eau : on les polit ensuite sur une roue d'étain avec le tripoli.
La turquoise de vieille & de nouvelle roche, le lapis, le girasol & l'opale se taillent & se polissent sur une roue de bois avec le tripoli.
Maniere de graver sur les pierres précieuses & les crystaux. La gravure sur les pierres précieuses, tant en creux que de relief, est fort ancienne, & l'on voit plusieurs ouvrages de l'une & de l'autre espece, où l'on peut admirer la science des anciens sculpteurs, soit dans la beauté du dessein, soit dans l'excellence du travail.
Quoiqu'ils ayent gravé presque toutes les pierres précieuses, les figures les plus achevées que nous voyons sont cependant sur des onices ou des cornalines, parce que ces pierres sont plus propres que les autres à ce genre de travail, étant plus fermes, plus égales, & se gravent nettement ; d'ailleurs on rencontre dans les onices différentes couleurs disposées par lits les unes au-dessus des autres, au moyen de quoi on peut faire dans les pieces de relief que le fond reste d'une couleur & les figures d'une autre, ainsi qu'on le voit dans plusieurs beaux ouvrages que l'on travaille à la roue & avec de l'émeril, de la poudre de diamant & les outils, dont on parlera ci-dessous.
A l'égard de ceux-ci qui sont gravés en creux, ils sont d'autant plus difficiles, qu'on y travaille comme à tâtons & dans l'obscurité, puisqu'il est nécessaire pour juger de ce qu'on fait, d'en faire à tous momens des épreuves avec des empreintes de pâte ou de cire. Cet art, qui s'étoit perdu comme les autres, ne commença à reparoître que sous le pontificat du pape Martin V. c'est-à-dire au commencement du quinzieme siecle. Un des premiers qui se mit à graver sur les pierres, fut un Florentin, nommé Jean, & surnommé delle Corgnivole, à cause qu'il travailloit ordinairement sur ces sortes de pierres. Il en vint d'autres ensuite qui graverent sur toutes sortes de pierres précieuses, comme fit un Dominique, surnommé de Camaï, milanois, qui grava sur un rubis balais le portrait de Louis dit le Maure, duc de Milan. Quelques autres représenterent ensuite de plus grands sujets sur des pierres fines & des crystaux.
Pour graver sur les pierres & les crystaux, l'on se sert du diamant ou de l'émeril. Le diamant, qui est la plus parfaite & la plus dure de toutes les pierres précieuses, ne se peut tailler que par lui-même, & avec sa propre matiere. On commence par mastiquer deux diamans bruts au bout de deux bâtons assez gros pour pouvoir les tenir fermes dans la main, & les frotter l'un contre l'autre, ce que l'on nomme égriser, ce qui sert à leur donner la forme & la figure que l'on desire.
En frottant & égrisant ainsi les deux pierres brutes, il en sort de la poudre que l'on reçoit dans une espece de boëte, que l'on nomme gresoir ou égrisoir ; & c'est de cette même poudre dont on se sert après pour polir & tailler les diamans, ce que l'on fait avec un moulin qui fait tourner une roue de fer doux. On pose sur cette roue une tenaille aussi de fer, à laquelle se rapporte une coquille de cuivre. Le diamant est soudé dans la coquille avec de la soudure d'étain ; & afin que la tenaille appuie plus fortement sur la roue, on la charge d'une grosse plaque de plomb. On arrose la roue sur laquelle le diamant est posé, avec de la poudre sortie du diamant, & délayée avec de l'huile d'olive. Lorsqu'on veut le tailler à facettes, on le change de facette en facette à mesure qu'il se finit, & jusqu'à ce qu'il soit dans sa derniere perfection.
Lorsqu'on veut scier un diamant en deux ou plusieurs morceaux, on prend de la poudre de diamant bien broyée dans un mortier d'acier avec un pilon de même métal : on la délaye avec de l'eau, du vinaigre, ou autre chose que l'on met sur le diamant, à mesure qu'on le coupe avec un fil de fer ou de laiton, aussi délié qu'un cheveu. Il y a aussi des diamans que l'on fend, suivant leur fil, avec des outils propres pour cet effet.
Quant aux rubis, saphirs & topases d'orient, on les taille & on les forme sur une roue de cuivre qu'on arrose de poudre de diamant avec de l'huile d'olive. Le poliment s'en fait sur une autre roue de cuivre, avec du tripoli détrempé dans de l'eau. On tourne d'une main un moulin qui fait agir la roue de cuivre, pendant qu'on forme de l'autre la pierre mastiquée ou cimentée sur un bâton, qui entre dans un instrument de bois, appellé quadrant, parce qu'il est composé de plusieurs pieces qui quadrent ensemble & se meuvent avec des visses, qui, faisant tourner le bâton, forment régulierement les différentes figures que l'on veut donner à la pierre.
Pour les rubis balais, espinelles, émeraudes, jacynthes, amétistes, grenats, agathes, & autres pierres moins dures, on les taille, comme on a dit au commencement de l'article, & on les polit ensuite sur une roue d'étain avec le tripoli.
Il y a d'autres sortes de pierres, comme la turquoise de vieille & de nouvelle roche, le lapis, le girasol & l'opale, que l'on polit sur une roue de bois avec le tripoli.
Pour former & graver les vases d'agathe, de crystal, de lapis, ou d'autres sortes de pierres dures, on a une machine, qu'on appelle un tour, exactement semblable à ceux des Potiers d'étain, excepté que ceux-ci sont faits pour y attacher les vases & les vaisselles que l'on veut travailler, au lieu que les autres sont ordinairement disposés pour recevoir & tenir les différens outils qu'on y applique, & qui tourne par le moyen d'une grande roue qui fait agir le tour. Ces outils, en tournant, forment ou gravent les vases que l'on présente contre, pour les façonner & les orner de relief ou en creux, selon qu'il plaît à l'ouvrier, qui change d'outils selon qu'il en a besoin.
Il arrose aussi ses outils & sa besogne avec de l'émeril détrempé dans de l'eau, ou avec de la poudre de diamant délayée avec de l'huile, selon le mérite de l'ouvrage & la qualité de la matiere ; car il y a des pierres qui ne valent pas qu'on dépense la poudre de diamant à les tailler, & même qui se travaillent plus promtement avec l'émeril, comme sont le jade, le girasol, la turquoise, & plusieurs autres qui paroissent être d'une nature grasse.
Lorsque toutes ces différentes pierres sont polies, & qu'on veut les graver, soit en relief, soit en creux ; si ce sont de petits ouvrages, comme médailles ou cachets, l'on se sert d'une machine, appellée touret, qui n'est autre chose qu'une petite roue de fer, dont les deux bouts des aissieux tournent, & sont enfermés dans deux pieces de fer mises debout, comme les lunettes des Tourneurs, ou les chevalets des Serruriers, lesquelles s'ouvrent & se ferment comme l'on veut, étant pour cet effet fendues par la moitié, & se rejoignant par le haut avec une traverse qui les tient, ou faits d'une autre maniere. A un bout d'un des aissieux de la roue l'on met les outils dont on se sert, lesquels s'y enclavent & s'y affermissent par le moyen d'une visse qui les serre & les tient en état. On fait tourner cette roue avec le pié, pendant que d'une main l'on présente & l'on conduit l'ouvrage contre l'outil, qui est de fer doux, si ce n'est quelques-uns des plus grands que l'on fait quelquefois de cuivre.
Tous les outils, quelque grands ou petits qu'ils soient, sont ou de fer, ou de cuivre, comme je viens de dire. Les uns ont la forme d'une petite pirouette, on les appelle des scies ; les autres qu'on nomme bouts, bouterolles, ont une petite tête ronde comme un bouton. Ceux qu'on appelle de charniere, sont faits comme une virole, & servent à enlever les pieces ? il y en a de plats, & d'autres différentes sortes que l'ouvrier fait forger de diverses grandeurs, suivant la qualité des ouvrages. On applique l'outil contre la pierre qu'on travaille, soit pour ébaucher, soit pour finir, non pas directement opposée au bout de l'outil, mais à côté, en sorte que la scie ou bouterolle l'use en tournant contre, & comme la coupant. Soit qu'on fasse des figures, des lettres, des chiffres, ou autre chose, l'on s'en sert toujours de la même maniere, les arrosant avec de la poudre de diamant & de l'huile d'olive ; & quelquefois, lorsqu'on veut percer quelque chose, on rapporte sur le tour de petites pointes de fer, au bout desquelles il y a un diamant serti, c'est-à-dire enchâssé.
Après que les pierres sont gravées ou de relief, ou en creux, on les polit sur des roues de brosses faites de poil de cochon, & avec du tripoli, à cause de la délicatesse du travail ; & quand il y a un grand champ, on fait exprès des outils de cuivre ou d'étain propres à polir le champ avec le tripoli, lesquels on applique sur le touret de la même maniere que l'on met ceux qui servent à graver. Voyez nos Planches de Diam. & de Lapid.
|
| LAPIDATION | S. f. (Théolog.) l'action de tuer quelqu'un à coups de pierre ; terme latinisé de lapis, pierre.
La lapidation étoit un supplice fort usité parmi les Hébreux ; les rabbins font un grand dénombrement des crimes soumis à cette peine. Ce sont en général tous ceux que la loi condamne au dernier supplice, sans exprimer le genre de la mort ; par exemple, l'inceste du fils avec la mere, ou de la mere avec son fils, ou du fils avec sa belle-mere, ou du pere avec sa fille, ou de la fille avec son pere, ou du pere avec sa belle-fille, ou d'un homme qui viole une fille fiancée, ou de la fiancée qui consent à ce violement, ceux qui tombent dans le crime de sodomie ou de bestialité, les idolâtres, les blasphémateurs, les magiciens, les nécromanciens, les violateurs du sabbat, ceux qui offrent leurs enfans à Moloch, ceux qui portent les autres à l'idolâtrie, un fils rebelle à son pere, & condamné par les juges. Les rabbins disent que quand un homme étoit condamné à mort, il étoit mené hors de la ville, ayant devant lui un huissier avec une pique en main, au haut de laquelle étoit un linge pour se faire remarquer de plus loin, & afin que ceux qui avoient quelque chose à dire pour la justification du coupable, le pussent proposer avant qu'on fût allé plus avant. Si quelqu'un se présentoit, tout le monde s'arrêtoit, & on ramenoit le criminel en prison, pour écouter ceux qui vouloient dire quelque chose en sa faveur. S'il ne se présentoit personne, on le conduisoit au lieu du supplice, on l'exhortoit à reconnoître & à confesser sa faute, parce que ceux qui confessent leur faute, ont part au siecle futur. Après cela on le lapidoit. Or la lapidation se faisoit de deux sortes, disent les rabbins. La premiere, lorsqu'on accabloit de pierres le coupable, les témoins lui jettoient les premiers la pierre. La seconde, lorsqu'on le menoit sur une hauteur escarpée, élevée au moins de la hauteur de deux hommes, d'où l'un des deux témoins le précipitoit, & l'autre lui rouloit une grosse pierre sur le corps. S'il ne mourroit pas de sa chûte, on l'achevoit à coups de pierres. On voit la pratique de la premiere façon de lapider dans plus d'un endroit de l'Ecriture ; mais on n'a aucun exemple de la seconde ; car celui de Jézabel, qui fut jettée à bas de la fenêtre, ne prouve rien du tout.
Ce que nous avons dit que l'on lapidoit ordinairement les criminels hors de la ville, ne doit s'entendre que dans les jugemens réglés : car, hors ce cas, souvent les Juifs lapidoient où ils se trouvoient ; par exemple, lorsque, emportés par leur zele, ils accabloient de pierres un blasphémateur, un adultere, ou un idolâtre. Ainsi lorsqu'on amena à Jesus une femme surprise en adultere, il dit à ses accusateurs dans le temple où il étoit avec eux & avec la femme : Que celui d'entre vous qui est innocent, lui jette la premiere pierre. Et une autre fois, les Juifs ayant prétendu qu'il blasphémoit, ramasserent des pierres dans le temple même pour le lapider. Ils en userent de même un autre jour, lorsqu'il dit : Moi & mon pere ne sommes qu'un. Dans ces rencontres, ils n'observoient pas les formalités ordinaires, ils suivoient le mouvement de leur vivacité ou de leur emportement ; c'est ce qu'ils appelloient, le jugement du zele.
On assûre qu'après qu'un homme avoit été lapidé, on attachoit son corps à un pieu par les mains jointes ensemble, & qu'on le laissoit en cet état jusqu'au coucher du soleil. Alors on le détachoit, & on l'enterroit dans la vallée des cadavres avec le pieu avec lequel il avoit été attaché. Cela ne se pratiquoit pas toujours, & on dit qu'on ne le faisoit qu'aux blasphémateurs & aux idolatres ; & encore seroit-il bien mal-aisé d'en prouver la pratique par l'écriture. Calmet, Diction. de la Bibl. tome II. p. 503.
|
| LAPIDIFICATION | (Hist. nat. Minér.) c'est en général l'opération par laquelle la nature forme des pierres, voyez PIERRES. Il faut la distinguer de la pétrification, qui est une opération par laquelle la nature change en pierres des substances qui auparavant n'appartenoient point au regne minéral. Voyez PETRIFICATION.
|
| LAPIDIFIQUE | MATIERE ou SUC, (Hist. nat. Minér.) nom générique donné par les Physiciens aux eaux ou aux sucs chargés de particules terreuses, qui, en se déposant, en s'amassant, ou en se crystallisant, forment les pierres. On expliquera à l'article PIERRES la maniere dont ces eaux agissent & contribuent à la formation de ces substances.
|
| LAPIN | S. m. cuniculus, (Hist. nat. Zoolog.) animal quadrupede, qui a beaucoup de rapport avec le lievre dans la conformation du corps ; car le lapin a, comme le lievre, la levre supérieure fendue jusqu'aux narines, les oreilles allongées, les jambes de derriere plus longues que celles de devant, la queue courte, &c. le dos, les lombes, le haut des côtés du corps, & les flancs du lapin sauvage ont une couleur mêlée de noir & de fauve, qui paroît grise, lorsque l'on ne le regarde pas de près ; les poils les plus longs & les plus fermes sont en partie noirs & en partie de couleur cendrée ; quelques-uns ont du fauve à la pointe ; le duvet est aussi de couleur cendrée près de la racine, & fauve à l'extrémité : on voit les mêmes couleurs sur le sommet de la tête. Les yeux sont environnés d'une bande blanchâtre, qui s'étend en arriere jusqu'à l'oreille, & en avant jusqu'à la moustache ; les oreilles ont des teintes de jaune, de brun, de grisâtre ; l'extrêmité est noirâtre : les levres, le dessous de la mâchoire inférieure, les aisselles, la partie postérieure de la poitrine, le ventre & la face intérieure des bras, des cuisses & des jambes sont blancs, avec quelques teintes de couleur cendrée ; la face postérieure ou inférieure de la queue est blanche ; l'autre est noire ; l'entredeux des oreilles & la face supérieure ou antérieure du cou a une couleur fauve-roussâtre : la croupe & la face antérieure des cuisses ont une couleur grise mêlée de jaune : le reste du corps a des teintes de jaunâtre, de fauve, de roussâtre, de blanc & de gris.
Le lapin domestique est pour l'ordinaire plus grand que le sauvage ; ses couleurs varient comme celles des autres animaux domestiques. Il y en a de blancs, de noirs, & d'autres qui sont tachés de ces deux couleurs ; mais tous les lapins, soit sauvages, soit domestiques, ont un poil roux sous la plante des piés.
Le lapin, appellé riche, est en partie blanc, & en partie de couleur d'ardoise plus ou moins foncée, ou de couleur brune & noirâtre.
Les lapins d'Angora ont le poil beaucoup plus long que les autres lapins ; il est ondoyant & frisé comme de la laine ; dans le tems de la mue, il se pelotonne, & il rend quelquefois l'animal très-difforme. Les couleurs varient comme celle des autres lapins domestiques.
Les lapins sont très-féconds, ils peuvent engendrer & produire dès l'âge de cinq à six mois. La femelle est presque toujours en chaleur ; elle porte trente ou trente-un jours ; les portées sont de quatre, cinq ou six, & quelquefois de sept ou huit petits. Les lapins creusent dans la terre des trous, que l'on appelle terriers ; ils s'y retirent pendant le jour, & les habitent avec leurs petits. Quelques jours avant de mettre bas, la femelle fait un nouveau terrier, non pas en ligne droite, mais en zigzag ; elle pratique dans le fond une excavation, & la garnit d'une assez grande quantité de poils qu'elle s'arrache sous le ventre : c'est le lit qui doit recevoir les petits. La mere ne les quitte pas pendant les deux premiers jours, & pendant plus de six semaines, elle ne sort que pour prendre de la nourriture ; alors elle mange beaucoup & fort vîte. Pendant tout ce tems, le pere n'approche pas de ses petits, il n'entre pas même dans le terrier où ils sont ; souvent la mere, lorsqu'elle en sort, bouche l'entrée avec de la terre détrempée de son urine : mais lorsque les petits commencent à venir à l'entrée du terrier, le pere semble les reconnoître, il les prend entre ses pattes les uns après les autres, il leur lustre le poil, & leur leche les yeux.
Les lapins sont très-timides ; ils ont assez d'instinct pour se mettre dans leurs terriers, à l'abri des animaux carnassiers, mais lorsque l'on met des lapins clapiers, c'est-à-dire domestiques, dans des garennes, ils ne se forment qu'un gîte à la surface de la terre comme les lievres ; ce n'est qu'après un certain nombre de générations qu'ils viennent à creuser un terrier. Ces animaux vivent huit ou neuf ans, leur chair est blanche ; celle des lapreaux est très-délicate ; celle des vieux lapins est seche & dure. Les lapins sont originaires des climats chauds ; il paroît qu'anciennement de tous les pays de l'Europe il n'y avoit que la Grece & l'Espagne où il s'en trouvât : on les a transportés en Italie, en France, en Allemagne, ils s'y sont naturalisés ; mais, dans les pays du nord, on ne peut les élever que dans les maisons. Ils aiment la chaleur même excessive, car il y a de ces animaux dans les contrées les plus méridionales de l'Asie & de l'Afrique : ceux qui ont été portés en Amérique, s'y sont bien multipliés. Hist. nat. gén. & part. tome VI. Voyez QUADRUPEDE.
Le lapin ressemble beaucoup au lievre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; mais ces deux especes sont différentes, puisqu'elles ne se mêlent pas ensemble, & que d'ailleurs il y a une grande différence entre leurs inclinations & leurs moeurs.
Les lapins ont une demeure fixe ; ils vivent en société ; ils habitent ensemble des demeures soûterraines qu'ils ont creusées ; ces retraites divisées en différens clapiers qui tous ont communication les uns avec les autres, annoncent une intention marquée d'être ensemble. Les mâles ne s'isolent point à un certain âge, comme cela arrive dans beaucoup d'autres especes. En un mot les lapins paroissent avoir un besoin absolu d'une demeure commune, puisqu'on tente envain d'en établir dans les pays où le terrein est trop ferme pour qu'ils puissent y creuser. Cependant il ne paroît pas que la société serve beaucoup à augmenter leur industrie. Cela vient sans-doute de ce que leurs besoins sont simples, de ce qu'ils sont trop foibles & trop mal armés pour que de leur union puisse résulter une meilleure défense, & de ce que le terrier les met promtement à couvert de tous les périls qu'ils peuvent éviter.
Quoique la sociabilité soit un caractere distinctif des lapins, quelques-uns d'entr'eux se mettent seuls au gîte pendant les beaux jours, & cela arrive surtout lorsqu'ils ont été inquiétés dans le terrier par le furet, la belette &c. mais dans tous les cas ils passent la meilleure partie de la journée dans un état de demi sommeil. Le soir ils sortent pour aller au gagnage, & ils y emploient une partie de la nuit. Alors ils s'écartent quelquefois jusqu'à un demi-quart de lieue pour chercher la nourriture qui leur convient. Ils relevent aussi ordinairement une fois le jour, surtout lorsque le tems est serein, mais sans s'écarter beaucoup du terrier ou du bois qui leur sert de retraite. Pendant l'été, les nuits étant courtes, les lapins relevent souvent plus d'une fois par jour, surtout les lapereaux encore jeunes, les hazes pleines & celles qui alaitent.
S'il doit arriver un orage pendant la nuit, il est pressenti par les lapins ; ils l'annoncent par un empressement prématuré de sortir & de paître ; ils mangent alors avec une activité qui les rend distraits sur le danger, & on les approche très aisément. Si quelque chose les oblige de rentrer au terrier, ils resortent presque aussi-tôt. Ce pressentiment a pour eux l'effet du besoin le plus vif.
Ordinairement les lapins ne se laissent pas si aisément approcher sur le bord du terrier : ils ont l'inquiétude qui est une suite naturelle de la foiblesse. Cette inquiétude est toûjours accompagnée du soin de s'avertir réciproquement. Le premier qui apperçoit frappe la terre, & fait avec les piés de derriere un bruit dont les terriers retentissent au loin. Alors tout rentre précipitamment : les vieilles femelles restent les dernieres sur le bord du trou, & frappent du pié sans relâche jusqu'à ce que toute la famille soit rentrée.
Les lapins sont extrémement lascifs, on dit aussi qu'ils sont constans, mais cela n'est pas vraisemblable : il est même certain qu'un mâle suffit à plusieurs femelles. Celles-ci sont presque toûjours en chaleur, & cette disposition subsiste quoiqu'elles soient pleines ; cependant elles paroissent être importunées par les mâles lorsqu'elles sont prêtes à mettre bas. La plûpart sortent alors du terrier & vont en creuser un nouveau au fond duquel elles déposent leurs petits. Ce terrier, qu'on nomme rabouillere, est fait en ziz-zag. Pendant les premiers jours la mere n'en sort que quand elle est pressée par l'extrême besoin de manger : elle en bouche même avec soin l'entrée. Au bout de quelques jours elle y laisse une petite ouverture qu'elle aggrandit par degrés, jusqu'à ce que les lapereaux soient en état de sortir eux-mêmes du trou ; ils ont alors à-peu-près trois semaines.
Dans l'espece du lapin les femelles portent depuis quatre jusqu'à sept & huit petits. Le tems de la gestation est de trente ou trente & un jours. A cinq mois ils sont en état d'engendrer. Il est très-commun de voir pleines à la fin de Juin des femelles de l'année : la multiplication de ces animaux seroit donc excessive s'ils n'étoient pas destinés à servir de nourriture à d'autres especes ; mais heureusement ils ont beaucoup d'ennemis. Le putois, le furet, l'hermine ou roselet, la belette, la fouine, vivent principalement de lapins, les loups & les renards leur font aussi la guerre ; mais ils sont moins dangereux que les autres qui les attaquent jusques dans le terrier. Lorsqu'on détruit avec soin les animaux carnassiers, il faut détruire aussi les lapins qui sans cela ravagent les récoltes pendant l'été, & font périr les bois pendant l'hiver. On chasse les lapins au fusil, avec le secours du furet & celui des filets. Voyez GARENNE. Mais quand on a dessein de les détruire, ces moyens sont infideles. Ces animaux s'instruisent par expérience, un grand nombre évitent les filets, & ils se laissent tourmenter dans le terrier par les furets sans vouloir sortir. Il faut donc défoncer les terriers mêmes ; c'est dans les pays exactement gardés le seul moyen de prévenir une multiplication dont l'excès est une imprudence à l'égard de soi, & un crime à l'égard des autres.
LAPIN, (Diete & Mat. medic.) Le lapin sauvage ou libre qui se nourrit dans les terreins secs, élevés & fertiles en herbes aromatiques peu aqueuses, est un aliment très-délicat, très-succulent, & d'un goût très-relevé. Le lapin domestique ; ou celui qui se nourrit dans les pays gras ou dans les terreins couverts d'herbes fades & grasses, comme les bords des ruisseaux, les prés arrosés, les potagers ou marais, &c. est au contraire d'un goût plat, fade & quelquefois même d'un fumet desagréable, sur-tout lorsqu'il a vécu de chou ; car l'odeur bonne ou mauvaise de certaines herbes qui se communique aisément à la chair de plusieurs animaux qui les broutent, exerce éminemment cette influence sur la chair du lapin : ensorte qu'il est tout ordinaire d'en trouver qui sentent le thim ou le chou, comme on dit communément à plein nez ou à pleine bouche.
Le bon lapin est mis par les experts en bonne chere au rang du gibier le plus exquis, même les meilleurs connoisseurs le mettent au premier rang dans les pays où le petit gibier est le plus parfait, comme en Provence & en Languedoc.
Quoique le goût du lapin soit bien différent de celui du lievre, cependant lorsqu'on considere ces deux alimens médicinalement, les observations & les regles diététiques leur sont à peu-près communes, parce que l'estomac n'est pas pourvu d'un sentiment aussi exquis que le palais. Cependant comme on n'a pas observé dans le lapin la qualité laxative que possede le lievre, le premier me paroît en général plus salutaire que le second, plus propre à être donné aux valétudinaires & aux convalescens qui commencent à user de viande. Le lapin se digere bien & très-bien, plus généralement que le lievre. D'ailleurs il est plus communément bon, & même lorsqu'il est vieux ; & quoique le lapereau soit plus tendre que le vieux lapin, cependant on trouve de ces animaux excellens à tout âge.
Les Pharmacologistes ont presqu'oublié le lapin dans leurs excursions dans le regne animal, non pas absolument pourtant, ils ont vanté sa graisse, sa tête brûlée & même le charbon de son corps entier, & son cerveau ; mais cet éloge est fort modéré en comparaison de celui de plusieurs animaux, du lievre, par exemple. Voyez LIEVRE. (b)
LAPIN, peaux de, (Pelletterie) les peaux de lapin revêtues de leur poil, bien passées & bien préparées, servent à faire plusieurs sortes de fourrures, comme aumusses, manchons, doublures d'habit.
Quand les peaux de lapin sont d'un beau gris cendré, on les appelle quelquefois, mais improprement, petit-gris, parce qu'alors elles ressemblent par la couleur à de certaines fourrures de ce nom beaucoup plus précieuses, faites de peaux de rats ou écureuils qu'on trouve dans les pays du Nord. Voyez PETIT-GRIS.
Le poil de lapin, après avoir été coupé de dessus la peau de l'animal, mêlé avec de la laine de vigogne, entre dans la composition des chapeaux appellés vigognes ou dauphins. Voyez l'art. CHAPEAU.
Le poil des lapins de Moscovie & d'Angleterre est le plus estimé, ensuite celui qui vient de Boulogne ; car pour celui qui se tire du dedans du royaume, les chapeliers n'en font pas beaucoup de cas, & ils ne s'en servent tout au plus que pour faire des chapeaux communs, en le mêlant avec quelqu'autre poil ou laine.
|
| LAPIS | (Littér.) surnom que les Latins donnerent à Jupiter, & sous lequel il étoit ordinairement confondu avec le dieu Terme. Voyez JUPITER-LAPIS. (D.J.)
LAPIS FABALIS, (Hist. nat.) pierre ainsi nommée par les anciens, à cause qu'elle ressembloit à une feve ; elle se trouvoit, dit-on, dans le Nil, & étoit noire. Les modernes connoissent aussi des pierres qui ont la même figure, & on les appelle pierres de feves ; il y a une mine de fer en globules allongés ou en ovoïdes, que l'on nomme mine de feves ; ce sont des petites étites ou pierres d'aigles. Voy. POIS MARTIAUX.
LAPIS-LAZULI, (Hist. nat.) c'est un jaspe ou une pierre dure & opaque, d'un bleu plus ou moins pur, qui est quelquefois parsemé de points ou de taches brillantes & métalliques, & quelquefois de taches blanches qui viennent des parties de la pierre qui n'ont point été colorées en bleu : cette pierre prend un beau poli.
Les petits points brillans & les petites veines métalliques & jaunes qu'on remarque dans le lapis-lazuli, ont été pris pour de l'or par beaucoup de gens qui croient voir ce métal par-tout, mais le plus souvent ce ne sont que des particules de pyrites jaunes ou cuivreuses qui ont pu elles-mêmes produire la couleur bleue de cette pierre. Cependant plusieurs auteurs assurent qu'on a trouvé de l'or dans le lapis, ce qui n'est pas surprenant, vû que le quartz qui fait la base du lapis est la matrice ordinaire de l'or.
On ne peut douter que ce ne soit à une dissolution du cuivre que le lapis est redevable de sa couleur bleue, & l'on doit le regarder comme une vraie mine de cuivre qui en contient une portion tantôt plus, tantôt moins forte.
Les Lapidaires distinguent le lapis-lazuli en oriental & en occidental ; cette distinction suivant eux est fondée sur la dureté & la beauté de cette pierre. En effet, ils prétendent que le lapis oriental est plus dur, plus compact, d'une couleur plus vive & moins sujette à s'altérer que le lapis d'occident, que l'on croit sujet à verdir, & dont la couleur est moins uniforme. Le lapis oriental se trouve en Asie & en Afrique ; celui d'occident se trouve en Espagne, en Italie, en Bohême, en Sibérie, &c.
Quelques naturalistes ont mis le lapis-lazuli au rang des marbres, & par conséquent au rang des pierres calcaires, parce qu'ils ont trouvé qu'il faisoit effervescence avec les acides ; on ne peut point nier qu'il n'y ait du marbre qui puisse avoir la couleur du lapis ; vû que toute pierre peut être colorée par une dissolution de cuivre, mais ces sortes de pierres n'ont ni la consistance ni la dureté du vrai lapis, qui est un jaspe & qui prend un très-beau poli beaucoup plus beau que celui du marbre.
Quelques auteurs ont prétendu que le vrai lapis exposé au feu y conservoit sa couleur bleue ; mais il y a tout lieu de croire qu'ils n'ont employé qu'un feu très-foible pour leur expérience : en effet il est certain que cette pierre, mise sous une moufle, perd totalement sa couleur. Si on pulvérise du lapis, & qu'on verse dessus de l'acide vitriolique, on lui enlevera pareillement sa partie colorante, & il s'en dégagera une odeur semblable à celle du soufre.
C'est du lapis pulvérisé que l'on tire la précieuse couleur du bleu d'outremer, payée si chérement par les Peintres, & à laquelle il seroit bien à souhaiter que la Chimie pût substituer quelque préparation qui eût la même solidité & la même beauté, sans être d'un prix si excessif. On peut voir la maniere dont cette couleur se tire du lapis, à l'article BLEU D'OUTREMER.
On a voulu attribuer des vertus medicinales au lapis-lazuli, mais il est certain que le cuivre qui y abonde doit en rendre l'usage interne très-dangereux : à l'égard de la pierre qui lui sert de base ; comme elle est de la nature du quartz ou du caillou, elle ne peut produire aucun effet. Quant à l'usage extérieur, on dit que le lapis est styptique comme toute sa substance cuivreuse, & l'on peut employer en sa place des matieres moins cheres & plus efficaces.
Pline & les anciens de signoient le lapis sous le nom de saphyrus ou sappirus, que les modernes donnent à une pierre precieuse bleue & transparente. Voyez SAPHIRE. Les Arabes l'appelloient azul ou haget.
On peut contrefaire le lapis en faisant fondre du verre blanc, rendu opaque en y mêlant des os calcinés ; on joindra ensuite à ce mêlange une quantité suffisante de bleu de saffre ou de smalte : lorsque le tout sera bien entré en fusion, on jettera dans le creuset de l'or en feuilles, & on remuera le mélange ; par ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera assez bien le lapis, & qui sera même quelquefois plus beau que lui.
Le celebre M. Marggraf vient de publier, dans le recueil de ses oeuvres chimiques, imprimé à Berlin en 1761, une analyse exacte qu'il a faite du lapis. Les expériences de ce savant chimiste prouvent que la plûpart de ceux qui ont parlé de cette pierre se sont trompés jusqu'ici. 1°. M. Marggraf a trouvé que ce n'étoit point au cuivre qu'étoit dûe la couleur bleue du lapis ; il le pulvérisa d'abord dans du papier plié en plusieurs doubles & ensuite dans un mortier de verre, afin d'éviter les soupçons qu'on auroit pû jetter sur son expérience s'il se fût servi d'un mortier de fer ou de cuivre. Il versa sur ce lapis en poudre de l'esprit de sel ammoniac qui, après y avoir été en digestion pendant vingt-quatre heures, ne se chargea en aucune façon de la couleur bleue. Il essaya ensuite de calciner la même poudre sous une moufle, & il assure qu'elle conserva sa couleur après la calcination. Il remit encore de l'alkali volatil sur cette poudre calcinée, & le dissolvant ne fut pas plus coloré que dans la premiere expérience : ce qui prouve d'une maniere incontestable que la couleur du lapis n'est point dûe au cuivre.
Ayant versé de l'acide vitriolique affoibli sur le lapis en poudre, il se fit une petite effervescence, & il en partit une odeur semblable à celle que produit le mélange de l'huile de vitriol étendue d'eau lorsqu'on en mêle avec de la limaille de fer. En versant de l'eau-forte ou de l'esprit de nitre non concentré sur une portion de la même poudre, l'effervescence fut plus forte qu'avec l'acide vitriolique, mais il n'en partit point d'odeur sulphureuse. Avec l'esprit de sel concentré il se fit aussi une effervescence, & il s'éleva une odeur très-sensible d'hepar sulphuris : ces dissolutions mises en digestion ne prirent aucune couleur, quoique le lapis eut perdu la sienne.
Quelques gouttes de la dissolution du lapis, faite dans l'acide vitriolique, mises sur du fer, ne lui firent point prendre la couleur du cuivre. L'alkali volatil versé dans cette même dissolution, ne la fit point devenir bleue, non plus que celles qui avoient été faites par l'acide nitreux & l'acide de sel marin ; cet alkali volatil précipita simplement une poudre blanche. M. Marggraf versa ensuite dans chacune de ces dissolutions de la dissolution d'alkali & de sang de boeuf, comme pour le bleu de Prusse, la dissolution du lapis dans l'acide nitreux donna un précipité d'un plus beau bleu que les autres, ce qui prouvoit la présence du fer. Ce qui arrive encore plus lorsqu'on a employé dans la dissolution des morceaux de lapis qui ont beaucoup de ces taches brillantes comme de l'or, que M. Marggraf regarde comme des pyrites sulfureuses.
En versant un peu d'acide vitriolique dans les dissolutions du lapis faites avec l'acide nitreux & l'acide du sel marin, il se précipite une espece de sélénite, ce qui prouve, suivant M. Marggraf, que le lapis contient une portion de terre calcaire qui, combinée avec l'acide vitriolique, forme de la sélénite.
Il fit ces mêmes expériences avec le lapis calciné, elles réussirent à-peu-près de même, excepté qu'il n'y eut plus d'effervescence. La dissolution dans l'acide du sel marin devint très-jaune ; & le mélange de la dissolution d'alkali & de sang de boeuf produisit un précipité d'un bleu très-vif. Une autre différence, c'est que les dissolutions du lapis calciné dans ces trois acides devinrent comme de la gelée, au lieu que celles qui avoient été faites avec le lapis non calciné demeurerent fluides : de plus, l'acide nitreux étoit celui qui avoit agi le plus fortement sur le lapis brut, au lieu que c'étoit l'acide du sel marin qui avoit extrait le plus de parties ferrugineuses du lapis calciné.
Quoique le lapis donne des étincelles lorsqu'on le frappe avec un briquet, ce qui annonce qu'il est de la nature du jaspe ou du caillou, M. Marggraf conjecture qu'il contient aussi une terre gypseuse ou sélénitique formée par la combinaison de l'acide vitriolique avec une terre calcaire ou avec du spath fusible, vu qu'un morceau de lapis tenu dans un creuset à une chaleur modérée, répandoit une lumiere phosphorique, & étoit accompagné de l'odeur du phosphore ; en poussant le feu jusqu'à faire rougir le lapis, la lumiere phosphorique disparut. On éteignit cette pierre à six ou sept reprises dans de l'eau distillée, qui fut filtrée ensuite, vû que ces extinctions réitérées l'avoient rendue trouble. On versa une dissolution de sel de tartre dans cette eau, & sur le champ il se précipita une poudre blanche qui, après avoir été édulcorée, se trouva être une vraie terre calcaire ; la dissolution qui surnageoit donna, par l'évaporation, du tartre vitriolé.
M. Marggraf ayant exposé au feu un morceau de lapis d'un beau bleu pendant une bonne demi-heure dans un creuset couvert, trouva qu'il n'avoit rien perdu de sa couleur. Un autre morceau tenu pendant une heure dans un creuset fermé & luté, se convertit en une masse poreuse d'un jaune foncé, sur laquelle étoient répandues quelques taches bleuâtres. Un autre morceau de lapis d'un beau bleu exposé à une chaleur plus forte excitée par le vent du soufflet, se changea entierement en une masse vitreuse blanche, sur laquelle on voyoit encore quelques marques bleues. M. Marggraf prouve par là la solidité de la couleur bleue de cette pierre ; & sa vitrification prouve encore selon lui, que le lapis est une pierre mélangée, vû que ni la pierre à chaux, ni le caillou, ni même le spath fusible, n'entrent point seuls en fusion.
En mêlant par la trituration un demi-gros de sel ammoniac, avec un gros de lapis en poudre & calciné, il en partit une odeur urineuse. Ce mélange ayant été exposé dans une retorte à un feu violent, il se sublima un sel ammoniac jaune, semblable à ce qu'on appelle fleurs de sel ammoniac martiales. Le résidu de cette sublimation pesoit exactement un gros, & étoit d'un beau bleu violet. Ce résidu fut lavé dans de l'eau distillée que l'on filtra ensuite, alors en y versant goutte à goutte une dissolution alkaline, il se précipita une assez grande quantité d'une poudre blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui s'étoit sublimé ayant été dissous dans de l'eau déposa au bout de quelque tems une très-petite quantité de poudre d'un jaune orangé, semblable à de l'ochre martiale.
Ce lapis calciné & pulvérisé, mêlé avec des fleurs de soufre, & mis en sublimation, ne souffrit aucun changement, le résidu demeura toujours d'un beau bleu. La même chose arriva en le mêlant avec parties égales de mercure sublimé, qui ne fut point révirifié non plus que le cinnabre que l'on y avoit joint pour une autre expérience, & le résidu demeura toujours bleu.
Un mélange d'une partie de sel de tartre avec deux parties de lapis calciné & pulvérisé, exposé au grand feu pendant une heure dans un creuset bien luté, se convertit en une masse poreuse d'un verd jaunâtre ; mais en mettant parties égales de lapis & de sel de tartre, & en faisant l'expérience de la même maniere, on obtint une masse blanchâtre poreuse, couverte par-dessus d'une matiere jaunâtre.
Une partie de lapis mêlée avec trois parties de nitre pur entre peu-à-peu en fusion : en augmentant le feu, le lapis conserve sa couleur bleue ; en le poussant encore davantage, le mêlange s'épaissit & se change enfin en une masse grise ; qui jettée toute chaude dans de l'eau distillée lui donne une couleur d'un verd bleuâtre, qui disparoît en peu de tems & laisse l'eau limpide, mais lui donne un goût alkalin, & alors elle fait un forte effervescence avec les acides : quant au lapis il a perdu entierement sa couleur.
En mêlant un gros de caillou pulvérisé avec un demi-gros de sel de tartre & dix grains de lapis en poudre, M. Marggraf ayant mis le tout dans un creuset couvert, ce mêlange donna un verre transparent d'un jaune de citron. Un gros de borax calciné, mêlé avec dix grains de lapis étant fondu, a donné un verre de la couleur de la chrysolite, d'où M. Marggraf conclud que le lapis ne contient pas la moindre portion de cuivre, mais que sa couleur vient d'une petite quantité de fer.
On voit par ce qui précede que les expériences de M. Marggraf détruisent presque tout ce qui avoit été dit jusqu'ici sur le lapis lazuli. (-)
LAPIS LEBETUM, (Hist. nat.) c'est le nom que quelques naturalistes donnent à la pierre que l'on nomme plus communément pierre ollaire, ou pierre à pots. Voyez ces articles.
LAPIS LUCIS, ou LAPIS LUMINIS, (Hist. nat.) nom donné par les medecins arabes à une pyrite ou marcassite, que l'on calcinoit & que l'on employoit pour les maladies des yeux, ce qui semble lui avoir fait donner son nom ; ou peut être lui est-il venu de ce que ces sortes de pyrites donnent beaucoup d'étincelles lorsqu'on les frappe avec l'acier. Voyez PYRITE.
|
| LAPITHES | LES, (Géog. anc.) Lapithae, ancien peuple de Macédoine, près du mont Olympe selon Diodore de Sicile, l. IV. c. 71. mais il n'en dit rien que ce que la Fable en a publié. Ce peuple excelloit à faire des mords, des caparaçons, & à bien manier un cheval ; c'est Virgile qui nous l'apprend en très-beaux vers ; au III liv. de ses Géorgiques.
Fraena Pelethronii Lapithae gyrosque dedêre
Impositi dorso ; atque equitem docuêre sub armis
Insultare solo, & gressus glomerare superbos.
Ils étoient assez courageux, mais si vains, qu'au rapport de Plutarque & d'Eustathius, pour signifier un homme bouffi de vanité, on disoit en proverbe, il est plus orgueilleux qu'un Lapithe. (D.J.)
|
| LAPONIE | LA ou LAPPONIE, (Géog.) grand pays au nord de l'Europe & de la Scandinavie, entre la mer Glaciale, la Russie, la Norwege & la Suede. Comme il est partagé entre ces trois couronnes, on le divise en Laponie russienne, danoise & suédoise : cependant cette derniere est la seule qui soit un peu peuplée, du moins relativement au climat rigoureux.
Saxon le grammairien qui fleurissoit sur la fin du xij siecle, est le premier qui ait parlé de ce pays & de ses habitans ; mais comme le dit M. de Voltaire (dont le lecteur aimera mieux trouver ici les réflexions, que l'extrait de l'histoire mal digérée de Scheffer), ce n'est que dans le xvj siecle qu'on commença de connoître grossierement la Laponie, dont les Russes, les Danois & les Suédois même n'avoient que de foibles notions.
Ce vaste pays voisin du pole avoit été seulement désigné par les anciens géographes sous le nom de la contrée des Cynocéphales, des Himantopodes, des Troglotites & des Pygmées. En effet nous apprîmes par les relations des écrivains de Suede & de Danemark, que la race des pygmées n'est point une fable, & qu'ils les avoient retrouvés sous le pole dans un pays idolâtre, couvert de neige, de montagnes & de rochers, rempli de loups, d'élans, d'ours, d'hermines & de rennes.
Les Lapons, continue M. de Voltaire (d'après le témoignage de tous les voyageurs), ne paroissent point tenir des Finlandois dont on les fait sortir, ni d'aucun autre peuple de leurs voisins. Les hommes en Finlande, en Norwege, en Suede, en Russie, sont blonds, grands & bienfaits ; la Laponie ne produit que des hommes de trois coudées de haut, pâles, basanés, avec des cheveux courts, durs & noirs ; leur tête, leurs yeux, leurs oreilles, leur nez, leur ventre, leurs cuisses & leurs piés menus, les différencient encore de tous les peuples qui entourent leurs déserts.
Ils paroissent une espece particuliere faite pour le climat qu'ils habitent, qu'ils aiment, & qu'eux seuls peuvent aimer. La nature qui n'a mis les rennes que dans cette contrée, semble y avoir produit les Lapons ; & comme leurs rennes ne sont point venues d'ailleurs, ce n'est pas non plus d'un autre pays que les Lapons y paroissent venus. Il n'est pas vraisemblable que les habitans d'une terre moins sauvage, ayent franchi les glaces & les déserts pour se transplanter dans des terres si stériles, si ténébreuses, qu'on n'y voit pas clair trois mois de l'année, & qu'il faut changer sans-cesse de canton pour y trouver dequoi subsister. Une famille peut être jettée par la tempête dans une île déserte, & la peupler ; mais on ne quitte point dans le continent des habitations qui produisent quelque nourriture, pour aller s'établir au loin sur des rochers couverts de mousse, au milieu des frimats, des précipices, des neiges & des glaces ; où l'on ne peut se nourrir que de lait de rennes & de poissons secs, sans avoir aucun commerce avec le reste du monde.
De plus, si des Finlandois, des Norwingiens, des Russes, des Suédois, des Islandois, peuples aussi septentrionaux que les Lapons, s'étoient transplantés en Laponie, y auroient-ils absolument changé de figure ? Il semble donc que les Lapons sont une nouvelle espece d'hommes qui se sont présentés pour la premiere fois à nos regards & à nos observations dans le seizieme siecle ; tandis que l'Asie & l'Amérique nous faisoient voir tant d'autres peuples, dont nous n'avions pas plus de connoissance. Dès-lors la sphere de la nature s'est aggrandie pour nous de tous côtés, & c'est par-là véritablement que la Laponie mérite notre attention. Essai sur l'Histoire universelle, tome III. (D.J.)
|
| LAPPA | (Géog. anc.) , ville de l'île de Crete dans les terres, entre Artacine & Subrita, selon Ptolomée, l. III. cap. 17. Dion nous dit que Metellus la prit d'assaut. Hieroclès nomme cette ville Lampae, & la met entre les siéges épiscopaux de l'île. (D.J.)
|
| LAPS | S. m. (Jurisprud.) signifie qui est tombé ; on ne se sert de ce terme qu'en parlant d'un hérétique. On dit laps & relaps pour dire qui est tombé & retombé dans les erreurs.
Laps de tems, signifie l'écoulement du tems : on ne prescrit point contre le droit naturel par quelque laps de tems que ce soit. Il y a des cas où on obtient en chancellerie des lettres de relief de laps de tems pour parer à une fin de non-recevoir, qui sans ces lettres seroit acquise. Voyez LETTRES DE RELIEF DE LAPS DE TEMPS. (A)
|
| LAPSES | adj. pris subst. (Théol.) c'étoient dans les premiers tems du christianisme ceux qui retournoient du christianisme au paganisme. On en compte de cinq sortes désignées par ces noms latins, libellatici, mittentes, turificati, sacrificati & blasphemati, On appelloit stantes les persévérans dans la foi. Le mot lapses se donnoit aux hérétiques & aux pécheurs publics.
|
| LAPTO | ou GOURMETS, s. m. pl. (Com.) matelots mores qui aident à remorquer les barques dans les viviers de Gambie & de Sénégal.
|
| LAPURDUM | (Géog. anc.) ancienne ville de la Gaule, dans la Novempopulanie. Sidonius Apollinaris, l. VIII. epist. xij. appelle lapurdenas locustas une sorte de poisson qui est fort commun dans ce pays-là, qu'on nomme langouste.
Il paroit que Bayonne est sûrement le Lapurdum des anciens : au treizieme siecle cette ville s'appelloit encore Lapurdum, & ses évêques & ses vicomtes étoient nommés plus souvent en latin Lapurdenses, que Bayonenses. Oyhenart, écrivain gascon, pense que Lapurdum étoit un nom gascon ou basque, donné à ce pays-là à cause des brigandages des habitans & de leurs pirateries, dont il est parlé dans la vie de S. Léon, évêque de Lapurdum au commencement du ve. siecle.
Le canton où est Bayonne s'appelle encore aujourd'hui l e pays de Labourd ; de-là vient que dans les anciens monumens les évêques de Bayonne sont appellés Lapurdenses, parce que Lapurdum & Bayonne sont deux noms d'une même ville.
Il est arrivé à celle-ci la même chose qu'à Daramasia & à Ruscino, villes qui ont cédé leurs noms aux pays dont elles étoient les capitales, & en ont pris d'autres. Ainsi Tarantaise, Roussillon & Labourd, qui étoient des noms de villes, sont devenus des noms de pays ; & au contraire, Paris, Tours, Rheims, Arras, &c. qui étoient des noms de peuples, sont devenus les noms de leurs capitales. Voyez de plus grands détails dans Oyhenart, notice de Gascogne ; Pierre de Marca, hist. de Béarn, & Longuerue, description de la France. (D.J.)
|
| LAQS | S. m. (terme de Chirurgie) especes de bandes plus ou moins longues, faites de soie, de fil ou de cuir, suivant quelques circonstances, destinées à fixer quelque partie, ou à faire les extensions & contre-extensions convenables pour réduire les fractures ou les luxations. Voyez EXTENSION, FRACTURE, LUXATION.
On ne se sert pas de laqs de laine, parce qu'étant susceptibles de s'allonger, ils seroient infideles ; & que c'est par l'éloignement des laqs qui tirent à contre-sens, qu'on juge assez souvent que les extensions sont suffisantes.
Quelques praticiens ont établi qu'avec une parfaite connoissance de la disposition des parties, une expérience suffisante & une grande dextérité, on peut réussir à réduire les luxations par la seule opération de la main ; & que les laqs qui servent aux extensions doivent être regardés comme des liens qui garotent les membres, qui les meurtrissent & y causent des douleurs inouies. Les laqs sont cependant des moyens que les chirurgiens anciens & modernes ont jugé très-utiles. Oribase a composé un petit traité sur cette matiere que les plus grands maîtres ont loué ; il décrit la maniere d'appliquer les laqs, & leur donne différens noms qu'il tire de leurs auteurs, de leurs usages, de leurs noeuds, de leurs effets, ou de leur ressemblance avec différentes choses ; tels sont le nautique, le kiaste, le pastoral, le dragon, le loup, l'herculien, le carchese, l'épangylote, l'hyperbate, l'étranglant, &c. mais toutes ces différences, dont l'explication est superflue, parce qu'elles sont inutiles, ne donnent pas au sujet le mérite qu'il doit aux réflexions solides de quelques chirurgiens modernes, & principalement de M. Petit, qui dans son traité des maladies des os, a exposé les regles générales & particulieres de l'application des laqs. 1°. Ils doivent être placés près des condyles des malleoles, ou autres éminences capables de les retenir en leur place au moyen de la prise : ils glisseroient & ne seroient d'aucun effet si on les plaçoit ailleurs. 2°. Il faut qu'un aide tire avec ses deux mains la peau autant qu'il lui sera possible pendant l'application du laqs du côté opposé à l'action qu'il aura ; sans quoi il arriveroit que dans l'effort de l'extension, la peau pourroit être trop considérablement tirée, & le tissu cellulaire qui la joint aux muscles étant trop allongé, il s'y feroit rupture de quelques petits vaisseaux ; ce qui produiroit une échymose & autres accidens. La douleur de cette extension forcée de la peau est fort vive, & on l'épargne au malade par la précaution prescrite. 3°. On liera les laqs un peu plus fortement aux personnes grasses, pour l'approcher plus près de l'os, sans quoi la graisse s'opposeroit à la sureté du laqs, qui glisseroit avec elle par-dessus les muscles. 4°. Enfin il faut garantir les parties sur lesquelles on applique les laqs ; pour cet effet on les garnit de coussins & de compresses ; on en met particuliérement aux deux côtés de la route des gros vaisseaux : on doit s'en servir aussi aux endroits où il y a des contusions, des excoriations, des cicatrices, des cauteres, &c. pour éviter les impressions fâcheuses & les déchiremens qu'on pourroit y causer.
Les regles particulieres de l'application des laqs sont décrites aux chapitres des luxations & des fractures de chaque membre. On les emploie simples ou doubles, & on tire par leur moyen la partie également ou inégalement, suivant le besoin. Le noeud qui les retient est fixe ou coulant : ces détails s'apprennent par l'usage, seroient très-difficiles à décrire, & on ne les entendroit pas aisément sans démonstration.
Les laqs ne servent pas seulement pendant l'opération nécessaire pour donner à des os fracturés ou luxés leur conformation naturelle ; on s'en sert aussi quelquefois pendant la cure, pour contenir les parties dans un degré d'extension convenable : c'est ainsi que dans la fracture oblique de la cuisse on soutient le corps par des laqs qui passent dans le pli de la cuisse, & d'autres sous les aisselles, & qui s'attachent vers le chevet du lit ; d'autres laqs placés au-dessus du genou, sont fixés utilement à une planche qui traverse le lit à son pié. Dans une fracture de la jambe, avec déperdition considérable du tibia fracassé, M. Coutavoz parvint à consolider le membre dans sa longueur naturelle, au moyen d'un laqs qu'on tournoit sur un treuil avec une manivelle, pour le contenir au degré convenable. Voyez le second tome des mémoires de l'académie royale de Chirurgie. (Y)
|
| LAQUAIS | S. m. (Gram.) homme gagé à l'année pour servir. Ses fonctions sont de se tenir dans l'anti-chambre, d'annoncer ceux qui entrent, de porter la robe de sa maîtresse, de suivre le carosse de son maître, de faire les commissions, de servir à table, où il se tient derriere la chaise ; d'exécuter dans la maison la plûpart des choses qui servent à l'arrangement & à la propreté ; d'éclairer ceux qui montent & descendent, de suivre à pié dans la rue, la nuit avec un flambeau, &c. mais surtout d'annoncer l'état par la livrée & par l'insolence. Le luxe les a multipliés sans nombre. Nos antichambres se remplissent, & nos campagnes se dépeuplent ; les fils de nos laboureurs quittent la maison de leurs peres & viennent prendre dans la capitale un habit de livrée. Ils y sont conduits par l'indigence & la crainte de la milice, & retenus par la débauche & la fainéantise. Ils se marient ; ils font des enfans qui soutiennent la race des laquais ; les peres meurent dans la misere, à moins qu'ils n'ayent été attachés à quelques maîtres bienfaisans qui leur ayent laissé en mourant un morceau de pain coupé bien court. On avoit pensé à mettre un impôt sur la livrée : il en eût résulté deux avantages au moins ; 1°. le renvoi d'un grand nombre de laquais ; 2°. un obstacle pour ceux qui auroient été tentés de quitter la province pour prendre le même état : mais cet impôt étoit trop sage pour avoir lieu.
|
| LAQUE | S. f. On donne ce nom à plusieurs especes de pâtes seches dont les Peintres se servent ; mais ce qu'on appelle plus proprement laque, est une gomme ou résine rouge, dure, claire, transparente, fragile, qui vient du Malabar, de Bengale & de Pegu. Son origine A, sa préparation B, & son analyse chimique C, sont ce qu'il y a de plus curieux à observer sur ce sujet.
A, son origine. Suivant les mémoires que le P. Tachard, jésuite, missionnaire aux Indes orientales, envoya de Pondichery à M. de la Hire en 1709, la laque se forme ainsi : de petites fourmis rousses s'attachent à différens arbres, & laissent sur leurs branches une humidité rouge qui se durcit d'abord à l'air par sa superficie, & ensuite dans toute sa substance en cinq ou six jours. On pourroit croire que ce n'est pas une production des fourmis, mais un suc qu'elles tirent de l'arbre, en y faisant de petites incisions ; & en effet, si on pique les branches proche de la laque, il en sort une gomme ; mais il est vrai aussi que cette gomme est d'une nature différente de la laque. Les fourmis se nourrissent de fleurs ; & comme les fleurs des montagnes sont plus belles & viennent mieux que celles des bords de la mer, les fourmis qui vivent sur les montagnes sont celles qui font la plus belle laque, & du plus beau rouge. Ces fourmis sont comme des abeilles, dont la laque est le miel. Elles ne travaillent que huit mois de l'année, & le reste du tems elles ne font rien à cause des pluies continuelles & abondantes.
B, sa préparation. Pour préparer la laque, on la sépare d'abord des branches où elle est attachée ; on la pile dans un mortier ; on la jette dans l'eau bouillante ; & quand l'eau est bien teinte, on en remet d'autre jusqu'à ce qu'elle ne se teigne plus. On fait évaporer au soleil une partie de l'eau qui contient cette teinture, après quoi on met la teinture épaissie dans un linge clair ; on l'approche du feu, & on l'exprime au-travers du linge. Celle qui passe la premiere est en gouttes transparentes, & c'est la plus belle laque. Celle qui sort ensuite, & par une plus forte expression, ou qu'on est obligé de racler de dessus le linge avec un couteau, est plus brune & d'un moindre prix.
C, son analyse chimique. M. Lemery l'a faite, principalement dans la vûe de s'assurer si la laque étoit une gomme ou une résine. Ces deux mixtes, assez semblables, different en ce que le soufre domine dans les résines, & le sel ou l'eau dans les gommes. Il trouva que l'huile d'olive ne dissolvoit point la laque, & n'en tiroit aucune teinture ; que l'huile étherée de térébenthine & l'esprit-de-vin n'en tiroient qu'une légere teinture rouge, ce qui fait voir que la laque n'est pas fort résineuse, & n'abonde pas en souffre ; que d'ailleurs une liqueur un peu acide, comme l'eau alumineuse, en tiroit une teinture plus forte, quoiqu'elle n'en fît qu'une dissolution fort légere, & que l'huile de tartre y faisoit assez d'effet ; ce qui marque qu'elle a quelque partie saline, qu'elle est imparfaitement gommeuse, & que par conséquent c'est un mixte moyen entre la gomme & la résine. Il est à remarquer que les liqueurs acides foibles tiroient quelque teinture de la laque, & que les fortes, comme l'esprit-de-nitre & de vitriol, n'en tiroient aucune. Cependant la laque, qui ne leur donnoit point de couleur, y perdoit en partie la sienne, & devenoit d'un jaune pâle. La Physique est trop compliquée pour nous permettre de prévoir sûrement aucun effet par le raisonnement. Hist. de l'Acad. Royale, en 1710, pag. 58. 60.
Laque fine. La laque ou lacque est une gomme résineuse, qui a donné son nom à plusieurs especes de pâtes seches, qu'on emploie également en huile & en miniature. Celle qu'on appelle laque fine de Venise est faite avec de la cochenille mesteque, qui reste après qu'on a tiré le premier carmin : on la prépare fort bien à Paris, & l'on n'a pas besoin de la faire venir de Venise : on la forme en petits throchisques rendus friables de couleur rouge foncé.
Il y a de trois sortes de laque ; la laque fine, l'émeril de Venise ; la laque plate ou colombine, & la laque liquide. La laque fine a conservé son nom de Venise, d'où elle fut d'abord apportée en France ; mais on la fait aussi bien à Paris ; nous n'avons pas besoin d'y recourir. Elle est composée d'os de seche pulvérisés, que l'on colore avec une teinture de cochenille mesteque, de bois de Brésil de Fernambouc, bouillis dans une lessive d'alun d'Angleterre calciné, d'arsenic, de natrum ou soude blanche, ou soude d'Alicante, que l'on réduit ensuite en pâte dans une forme de throchisque ; si on souhaite qu'elle soit plus brune, on y ajoute de l'huile de tartre : pour être bonne il faut qu'elle soit tendre & friable, & en petits throchisques. Dictionn. de Commerce.
Laque commune. La laque colombine ou plate est faite avec les tondures de l'écarlate bouillie dans une lessive de soude blanche, avec de la craie & de l'alun ; on forme cette pâte ou tablette, & on la fait sécher ; on la prépare mieux à Venise qu'ailleurs ; elle doit être nette, ou le moins graveleuse qu'il se pourra, haute en couleur. Lemery.
La laque plate ou colombine est faite de teinture d'écarlate bouillie dans la même lessive dont on se sert pour la laque de Venise, & que l'on jette après l'avoir passée, sur de la craie blanche & de l'alun d'Angleterre en poudre, pourri, pour en former ensuite des tablettes quarrées, de l'épaisseur du doigt. Cette espece de laque vaut mieux de Venise que de Paris & de Hollande, à cause que le blanc dont les Venitiens se servent, est plus propre à recevoir ou à conserver la vivacité de la couleur.
La laque liquide n'est autre chose qu'une teinture de bois de Fernambouc qu'on tire par le moyen des acides.
On appelle aussi laque, mais assez improprement, certaines substances colorées dont se servent les enlumineurs, & que l'on tire des fleurs par le moyen de l'eau-de-vie, &c. Dict. du Com.
Gomme laqueuse. La gomme laque découle des arbres qui sont dans le pays de Siam, Cambodia & Pegu.
|
| LAQUEARIUS | subst. m. (Hist. anc.) espece d'athlete chez les anciens. Il tenoit d'une main un filet ou un piege dans lequel il tâchoit d'embarrasser ou d'entortiller son antagoniste, & dans l'autre main un poignard pour le tuer. Voyez ATHLETE. Le mot dérive du latin laqueus, filet, corde nouée. LAQUE. Voyez LACQUE.
|
| LAQUEDIVES | (Géog.) cet amas prodigieux de petites îles connues sous le nom de Maldives & de Laquedives, s'étend sur plus de 200 lieues de longueur nord & sud ; plus de 50 ou 60 lieues en-deçà de Malabar & du cap Comorin ; on en a distribué la position sur presque toutes nos cartes géographiques, confusément & au hasard. (D.J.)
|
| LAQUIA | (Géogr.) grande riviere de l'Inde, au-delà du Gange. Elle sort du lac de Chiamai, coule au royaume d'Acham ou Azem, le traverse d'orient en occident, passe ensuite au royaume de Bengale, se divise en trois branches qui forment deux îles, dans l'une desquelles est située la ville de Daca sur le Gange, & c'est là que se perd cette riviere. (D.J.)
|
| LAR | (Géogr.) ville de Perse, capitale d'un royaume particulier qu'on nommoit Laristan : elle faisoit le lieu de la résidence du roi, lorsque les Guebres, adorateurs du feu, étoient maîtres de ce pays-là. Le grand Schach Abas leur ôta cette ville, & maintenant il y a un khan qui y réside, & commande à toute la province que l'on nomme Ghermés, & qui s'étend jusqu'aux portes de Gommeron. Lar en est situé à quatre journées, à mi-chemin de Schiras à Mina, sur un rocher, dans un terroir couvert de palmiers, d'orangers, de citronniers & de tamarisques ; elle est sans murailles, & n'a rien qui mérite d'être vû, que la maison du khan, la place, les bazars & le château ; cependant Thevenot, Gemelli Carreri, Lebrun, Tavernier & Chardin ont tous décrit cette petite ville. Les uns ortographient Laar, d'autres Laer, d'autres Lar, & d'autres Lara. Corneille en fait trois articles, aux mots Laar, Lar & Lara. La Martiniere en parle deux fois sous le mot Laar & Lar ; mais le second article contient des détails qui ne sont pas dans le premier. Long. de cette ville 72. 20. lat. 27. 17. (D.J.)
|
| LARACHE | (Géogr.) ancienne & forte ville d'Afrique, au royaume de Fez, à l'embouchure de la riviere de même nom, nommée Lusso par quelques voyageurs, avec un bon port. Muley Xec, gouverneur de la place, la livra aux Espagnols en 1610 ; mais les Maures l'ont reprise. Larache est un mot corrompu de l'Arays-Beni-Aroz, qui est le nom que les habitans lui donnent. Grammaye s'est follement persuadé que la ville de Larache est le jardin des hespérides des anciens ; & Sanut prétend que c'est le palais d'Antée, & le lieu où Hercule lutta contre ce géant ; mais c'est vraisemblablement la Lixa de Ptolomée, & le Lixos de Pline. Voyez LIXA. (D.J.)
|
| LARAIRE | S. m. lararium, (Littér.) espece d'oratoire ou de chapelle domestique, destinée chez les anciens Romains, au culte des Dieux lares de la famille ou de la maison ; car chaque maison, chaque famille, chaque individu avoit ses dieux lares particuliers, suivant sa dévotion ou son inclination ; ceux de Marc-Aurele étoient les grands hommes qui avoient été ses maîtres. Il leur portoit tant de respect & de vénération, dit Lampride, qu'il n'avoit que leurs statues d'or dans son laraire, & qu'il se rendoit même souvent à leurs tombeaux, pour les honorer encore, en leur offrant des fleurs & des sacrifices. Ces sentimens sans-doute devoient se trouver dans le prince sous le regne duquel on vit l'accomplissement de la maxime de Platon, " que le monde seroit heureux si les philosophes étoient rois, ou si les rois étoient philosophes ". (D.J.)
|
| LARANDA | (Géog. anc.) Laranda, gen. orum. ancienne ville d'Asie en Cappadoce, dans l'Antiochiana, selon Ptolomée, l. V. c. vj. lequel joint ce canton à la Lycaonie ; en effet, cette ville étoit aux confins de la Lycaonie, de la Pisidie & de l'Isaurie. Delà vient que les anciens la donnent à ces diverses provinces. Elle conserve encore son nom, si l'on en croit M. Baudrand ; car il dit que Larande est une petite ville de la Turquie asiatique, en Natolie, dans la province de Cogni, assez avant dans le pays, sur les frontieres de la Caramanie, & à la source de la riviere du Cydne, ou du Carason, avec un évêché du rit grec. (D.J.)
|
| LARARIES | S. f. pl. lararia, (Littér.) fêtes des anciens Romains, en l'honneur des dieux lares ; elle se célébroit l'onzieme des Calendes de Janvier, c'est-à-dire le 21 Décembre. (D.J.)
|
| LARCIN | S. m. (Jurisprud.) est un vol qui se commet par adresse, & non à force ouverte ni avec effraction. Le larcin a quelque rapport avec ce que les Romains appelloient furtum nec manifestum, vol caché ; ils entendoient par là celui où le voleur n'avoit pas été pris dans le lieu du délit, ni encore saisi de la chose volée, avant qu'il l'eût portée où il avoit dessein ; mais cette définition pouvoit aussi convenir à un vol fait à force ouverte, ou avec effraction, lorsque le voleur n'avoit pas été pris en flagrant délit : ainsi ce que nous entendons par larcin n'est précisément la même chose que le furtum nec manifestum. Voyez VOL. (A)
|
| LARD | en terme de Cuisine, est cette graisse blanche qu'on voit entre la couenne du porc & sa chair. Les Cuisiniers n'apprêtent guere de mets où il n'entre du lard.
LARD, (Diete. & Mat. méd.) cette espece de graisse se distingue par la solidité de son tissu. Ce caractere la fait différer essentiellement dans l'usage diététique des autres graisses, & éminemment de celles qui sont tendres & fondantes ; au lieu que ces dernieres ne peuvent convenir qu'aux organes délicats des gens oisifs & accoutumés aux mets succulens & de la plus facile digestion. Voyez GRAISSE, DIETE, &c. Le lard au contraire est un aliment qui n'est propre qu'aux estomacs robustes des gens de la campagne, & des manoeuvres : aussi les sujets de cet ordre s'accommodent-ils très-bien de l'usage habituel du lard, & sur-tout du lard salé, état dans lequel on l'emploie ordinairement. Parmi les sujets de l'ordre opposé, il s'en trouve beaucoup que le lard incommode, non-seulement comme aliment lourd & de difficile digestion, mais encore par la pente qu'il a à contracter dans l'estomac l'altération propre à toutes les substances huileuses & grasses, savoir la rancidité. Voyez RANCE. Ces personnes doivent s'abstenir de manger des viandes piquées de lard. Il est clair qu'il leur sera encore d'autant plus nuisible, qu'il sera moins récent, & qu'il aura déja plus ou moins ranci en vieillissant. Le lard fondu a toutes les propriétés médicamenteuses communes des graisses. Voyez GRAISSE, DIETE, T MAT. MED. (B)
LARD, Pierre de, (Hist. nat.) nom donné communément à une pierre douce & savonneuse au toucher, qui se taille très-aisément, & dont sont faites un grand nombre de figures, de magots & d'animaux qui nous viennent de la Chine. Elle a plus ou moins de transparence ; mais cette espece de transparence foible est comme celle de la cire ou du suif ; c'est-là ce qui semble lui avoir fait donner le nom qu'elle porte en françois. Sa couleur est ou blanche, ou d'un blanc sale, ou grisâtre, ou tirant sur le jaunâtre & le brun ; quelquefois elle est entremêlée de veines comme du marbre.
La pierre de lard est du nombre de celles qu'on appelle pierres ollaires, ou pierres à pots, à cause de la facilité avec laquelle on peut la tailler pour faire des pots. M. Pott a prouvé que cette pierre qu'il appelle stéatite, étoit argilleuse ; en effet elle se durcit au feu ; après avoir été écrasée, on peut en former des vases, comme une vraie argile, & on peut la travailler à la roue du potier. Les acides n'agissent point sur cette pierre, lorsqu'elle est pure. Voyez la lithogéognosie, tom. I. pag. 278 & suiv.
Les Naturalistes ont donné une infinité de noms différens à cette pierre. Les uns l'ont appellée stéatites, d'autres smectis ; les Anglois l'appellent soap-rock ou roche savonneuse. Les Allemands l'appellent speckstein, pierre de lard, smeerstein, pierre savonneuse, topfstein, ou pierre à pots. Le lapis syphnius des anciens, la pierre de come des modernes, ainsi que la pierre appellée lavezze, sont de la même nature. Quelquefois en Allemagne cette pierre est connue sous le nom de craie d'Espagne ; les Tailleurs s'en servent comme de la craie de Briançon, ou du talc de Venise, pour tracer des lignes sur les étoffes.
Suivant M. Pott, elle se trouve communément près de la surface de la terre, & l'on n'a pas besoin de creuser profondément pour la rencontrer. Il s'en trouve en Angleterre, en Suede, en plusieurs endroits d'Allemagne & de la France. Il semble que cette pierre pourrait entrer avec succès dans la composition de la porcelaine.
|
| LARDER | v. act. (Cuisine) c'est avec l'instrument pointu appellé lardoire, piquer une viande de lardons, ou la couvrir entierement de petits morceaux de lard coupés en long. On dit piquer. Voyez PIQUER, & une piece piquée.
LARDER les bonnettes, (Marine) Voyez BONNETTES.
LARDER un cheval de coups d'éperon, (Maréch.) c'est lui donner tant de coups d'éperon, que les plaies y paroissent.
LARDER, (Rubanerie, Soirie, &c.) se dit lorsque la navette au lieu de passer franchement dans la levée du pas, passe à travers quelque portion de la chaine levée ou baissée ; ce qui seroit un défaut sensible dans l'ouvrage si l'on n'y remédioit, ce qui se fait ainsi : l'ouvrier s'appercevant que sa navette a lardé, ouvre le même pas où cet accident est arrivé, & contraignant sa trame avec ses deux mains en la levant en-haut si la navette a lardé em-bas, ou en baissant si la navette a lardé en-haut ; il repasse sa navette à-travers cette partie de chaîne que la trame ainsi tendue fait hausser ou baisser, & le mal est réparé.
|
| LARDOIRE | S. f. en terme de Cuisine ; c'est un morceau de fer ou de cuivre creux, & fendu par un bout en plusieurs branches pour contenir des lardons de diverses grosseurs, & aigu par l'autre bout pour piquer la viande & y laisser le lardon. Les lardoires de cuivre sont très-dangereuses ; la graisse reste dans l'ouverture de la lardoire & y forme du verd-de-gris.
|
| LARDON | S. m. (Cuisine) c'est le petit morceau de lard dont on arme la lardoire pour piquer une viande. Voyez LARDER, PIQUER, LARDOIRE.
LARDONS, (Horlogerie) nom que les Horlogers donnent à de petites pieces qui entrent en queue d'aronde dans le nez & le talon de la potence des montres. Voyez POTENCE.
LARDON, (Artificier) les Artificiers appellent ainsi des serpentaux un peu plus gros que les serpenteaux ordinaires ; apparemment parce qu'on les jette ordinairement par grouppes sur les spectateurs, pour exciter quelques risées sur les vaines terreurs que ces artifices leur causent. Voyez SERPENTEAUX.
Ces especes de petites fusées, appellées des lardons, sont faites d'une, de deux, ou de trois cartes ; ceux d'une carte s'appellent vetilles ; ils ont trois lignes de diametre intérieur : à deux cartes, on leur donne trois lignes & demi ; & à trois cartes, quatre lignes : les lardons qui ont un plus grand diametre, doivent être faits en carton ; on leur donne d'épaisseur le quart du diametre de la baguette, sur laquelle on les roule lorsqu'ils sont chargés de la premiere des compositions suivantes, & le cinquieme, lorsqu'on emploie la seconde, qui est moins vive, & qui convient dans certains cas ; leur hauteur est de six à sept diametres.
Voici leur composition : composition premiere ; aigremoine huit onces, poussier deux livres, salpètre une, souffre quatre onces quatre gros.
Seconde composition moins vive, salpètre deux livres douze onces, aigremoine une livre, soufre quatre onces.
La vetille doit être nécessairement chargée de la composition en poudre ; celle en salpètre brûleroit lentement & sans l'agiter ; lorsque les lardons sont chargés en vrillons, on les appelle serpentaux. Voyez SERPENTEAU. (D.J.)
LARDON, (Serrurerie, & autres ouvriers en fer,) morceau de fer ou d'acier que l'on met aux crevasses qui se forment aux pieces en les forgeant. Le lardon sert à rapprocher les parties écartées & à les souder.
|
| LAREDO | (Géog.) petite ville maritime d'Espagne, dans la Biscaie, avec un port, à 25 lieues N. O. de Burgos, 10 O. de Bilbao. Long. 13. 55. lat. 33. 22. (D.J.)
|
| LARÉNIER | S. m. (Menuiserie) piece de bois qui avance au bas d'un chassis dormant d'une croisée ou du quadre de vitres, pour empêcher que l'eau ne coule dans l'intérieur du bâtiment, & pour l'envoyer en-dehors ; cette piece est communément de la forme d'un quart de cylindre coupé dans sa longueur. Dictionnaire de Trévoux. (D.J.)
|
| LARENTALES | S. f. pl. (Littérat.) c'est le nom que Festus donne à une fête des Romains. Ovide & Plutarque l'appellent Laurentales, & Macrobe, Larentalia, Laurentalia, Laurentiae feriae, ou Larentinalia ; car, selon l'opinion de Paul Manuce, de Goltzius, de Rosinus, & de la plupart des littérateurs, tous ces divers noms désignent la même chose.
Les Larentales étoient une fête à l'honneur de Jupiter ; elle tomboit au 10 des calendes de Janvier, qui est le 23 de Décembre. Cette fête avoit pris son nom d'Acca Larentia, nourrice de Rémus & de Romulus ; ou selon d'autres, (les avis se trouvant ici fort partagés) d'Acca Laurentia, célebre courtisanne de Rome, qui avoit institué le peuple romain son héritier, sous le regne d'Ancus Martius. Quoi qu'il en soit de l'origine de cette fête, on la célebroit hors de Rome, sur les bords du Tibre, & le prêtre qui y présidoit s'appelloit larentialis flamen, la flamme larentiale. (D.J.)
|
| LARES | S. m. plur. (Mythol. & Littérat.) c'étoient chez les Romains les dieux domestiques, les dieux du foyer, les génies protecteurs de chaque maison, & les gardiens de chaque famille. On appelloit indifféremment ces dieux tutélaires, les dieux Lares ou Pénates ; car pour leur destination, ces deux mots sont synonymes.
L'idée de leur existence & de leur culte, paroit devoir sa premiere origine, à l'ancienne coutume des Egyptiens, d'enterrer dans leurs maisons les morts qui leur étoient chers. Cette coutume subsista chez eux fort long-tems, par la facilité qu'ils avoient de les embaumer & de les conserver. Cependant l'incommodité qui en résultoit à la longue ; ayant obligé ces peuples & ceux qui les imiterent, de transporter ailleurs les cadavres, le souvenir de leurs ancêtres & des bienfaits qu'ils en avoient reçus, se perpétua chez les descendans ; ils s'adresserent à eux comme à des dieux propices, toujours prêts à exaucer leurs prieres.
Ils supposerent que ces dieux domestiques daignoient rentrer dans leurs maisons, pour procurer à la famille tous les biens qu'ils pouvoient, & détourner les maux dont elle étoit menacée ; semblables, dit Plutarque, à des athletes, qui ayant obtenu la permission de se retirer, à cause de leur grand âge, se plaisent à voir leurs éleves s'exercer dans la même carriere, & à les soutenir par leurs conseils.
C'est de cette espece qu'est le dieu Lare, à qui Plaute fait faire le prologue d'une de ses comédies de l'Aulularia ; il y témoigne l'affection qu'il a pour la fille de la maison, assurant qu'en considération de sa piété, il songe à lui procurer un mariage avantageux, par la découverte d'un trésor confié à ses soins, dont il n'a jamais voulu donner connoissance ni au pere de la fille, ni à son ayeul, parce qu'ils en avoient mal usé à son égard.
Mais les particuliers qui ne crurent pas trouver dans leurs ancêtres des ames, des génies assez puissans pour les favoriser & les défendre, se choisirent chacun suivant leur goût, des patrons & des protecteurs parmi les grandes & les petites divinités, auxquelles ils s'adresserent dans leurs besoins ; ainsi s'étendit le nombre des dieux Lares domestiques.
D'abord Rome effrayée de cette multiplicité d'adorations particulieres, défendit d'honorer chez soi des dieux, dont la religion dominante n'admettoit pas le culte. Dans la suite, sa politique plus éclairée, souffrit non-seulement dans son sein l'introduction des dieux particuliers, mais elle crut devoir l'autoriser expressément.
Une loi des douze tables enjoignit à tous les habitans de célebrer les sacrifices de leurs dieux Pénates, & de les conserver sans interruption dans chaque famille, suivant que les chefs de ces mêmes familles l'avoient prescrit.
On sait que lorsque par adoption, quelqu'un passoit d'une famille dans une autre, le magistrat avoit soin de pourvoir au culte des dieux qu'abandonnoit la personne adoptée : ainsi Rome devint l'asile de tous les dieux de l'univers, chaque particulier étant maître d'en prendre pour ses Pénates, tout autant qu'il lui plaisoit, quum singuli, dit Pline, ex semetipsis, totidem deos faciant, Junones, geniosque.
Non-seulement les particuliers & les familles, mais les peuples, les provinces & les villes, eurent chacune leurs dieux Lares ou Pénates. C'est pour cette raison, que les Romains avant que d'assiéger une ville, en évoquoient les dieux tutelaires, & les prioient de passer de leur côté, en leur promettant des temples & des sacrifices, afin qu'ils ne s'opposassent pas à leurs entreprises ; c'étoit-là ce qu'on nommoit évocation. Voyez ce mot.
Après ces remarques, on ne sera pas surpris de trouver dans les auteurs & dans les monumens, outre les Lares publics & particuliers ; les Lares qu'on invoquoit contre les ennemis, Lares hostilii ; les Lares des villes, Lares urbani ; les Lares de la campagne, Lares rurales ; les Lares des chemins, Lares viales ; les Lares des carrefours, Lares compitales, &c. En un mot, vous avez dans les inscriptions de Gruter & autres livres d'antiquités, des exemples de toutes sortes de Lares ; il seroit trop long de les rapporter ici.
C'est assez de dire que le temple des Lares de Rome en particulier, étoit situé dans la huitieme région de cette ville. Ce fut Titus roi des Sabins, qui le premier leur bâtit ce temple : leur fête nommée Lararies, arrivoit le onze avant les calendes de Janvier. Macrobe l'appelle assez plaisamment la solemnité des petites statues, celebritas sigillariorum ; cependant Asconius Pédianus prétend que ces petites statues étoient celles des douze grands dieux ; mais la plaisanterie de Macrobe n'en est pas moins juste.
Les Lares domestiques étoient à plus forte raison représentés sous la figure de petits marmousets d'argent, d'ivoire, de bois, de cire, & autres matieres ; car chacun en agissoit envers eux, suivant ses facultés. Dans les maisons bourgeoises, on mettoit ces petits marmousets derriere la porte, ou au coin du foyer, qui est encore appellé la lar dans quelques endroits du Languedoc. Les gens qui vivoient plus à leur aise, les plaçoient dans leurs vestibules ; les grands seigneurs les tenoient dans une chapelle nommée Laraire, & avoient un domestique chargé du service de ces dieux ; c'étoit chez les empereurs l'emploi d'un affranchi.
Les dévots aux dieux Lares leurs offroient souvent du vin, de la farine, & de la desserte de leurs tables ; ils les couronnoient dans des jours heureux ; ou dans certains jours de fêtes, d'herbes & de fleurs, sur-tout de violettes, de thym, & de romarin ; ils leur brûloient de l'encens & des parfums. Enfin, ils mettoient devant leurs statues, des lampes allumées : je tire la preuve de ce dernier fait peu connu, d'une lampe de cuivre à deux branches, qu'on trouva sous terre à Lyon en 1505. Les mains de cette lampe entouroient un petit pié-d'estal de marbre, sur lequel étoit cette inscription : Laribus sacrum, P. F. Rom. qui veut dire, publicae felicitati Romanorum. Il eut été agréable de trouver aussi le dieu Lare, mais apparemment que les ouvriers le mirent en pieces en fouillant.
Quand les jeunes enfans de qualité étoient parvenus à l'âge de quitter leurs bulles, petites pieces d'or en forme de coeur, qu'ils portoient sur la poitrine, ils venoient les pendre au cou des dieux Lares, & leur en faire hommage. " Trois de ces enfans, revétus de robes blanches, dit Pétrone, entrerent alors dans la chambre : deux d'entr'eux poserent sur la table les Lares ornés de bulles ; le troisieme tournant tout-autour avec une coupe pleine de vin, s'écrioit : Que ces dieux nous soient favorables " !
Les bonnes gens leur attribuoient tous les biens & les maux qui arrivoient dans les familles, & leur faisoient des sacrifices pour les remercier ou pour les adoucir ; mais d'autres d'un caractere difficile à contenter, se plaignoient toûjours, comme la Philis d'Horace, de l'injustice de leurs dieux domestiques.
Et Penates
Moeret iniquos.
Caligula que je dois au-moins regarder comme un brutal, fit jetter les siens par la fenêtre, parce qu'il étoit, disoit-il, très-mécontent de leur service.
Les voyageurs religieux portoient toûjours avec eux dans leurs hardes quelque petite statue de dieux Lares ; mais Cicéron craignant de fatiguer sa Minerve dans le voyage qu'il fit avant que de se rendre en exil, la déposa par respect au Capitole.
La victime ordinaire qu'on leur sacrifioit en public, étoit un porc : Plaute appelle ces animaux en badinant porcs sacrés. Ménechme, Act. II. sc. 2. demande combien on les vend, parce qu'il en veut acheter un, afin que Cylindrus l'offre aux dieux Lares, pour être délivré de sa démence.
La flaterie des Romains mit Auguste au rang des dieux Lares, voulant déclarer par cette adulation, que chacun devoit le reconnoître pour le défenseur & le conservateur de sa famille. Mais cette déification parut dans un tems peu favorable ; personne ne croyoit plus aux dieux Lares, & l'on n'étoit pas plus croyant aux vertus d'Auguste : on ne le regardoit que comme un heureux usurpateur de la tyrannie.
J'ai oublié d'observer que les Lares s'appelloient aussi Praestites, comme qui diroit gardiens des portes, quòd praestant oculis omnia tuta suis, dit Ovide dans ses Fastes. J'ajoute que les auteurs latins ont quelquefois employé le mot Lar, pour exprimer une famille entiere, l'état & la fortune d'une personne, parvo sub lare, paterni laris inops, dit Horace.
On peut consulter sur cette matiere, les dictionnaires d'antiquités romaines, les recueils d'inscriptions & de monumens, les recherches de Spon, Casaubon sur Suetone, Lambin ; sur le prologue de l'Aulularia de Plaute, & si l'on veut Vossius de l'Idololatriâ ; mais je doute qu'on prenne tant de peine dans notre pays. (D.J.)
|
| LARGE | adj. (Gramm.) voyez l'article LARGEUR.
LARGE, pour au large, (Marine) cri que fait la sentinelle pour empêcher une chaloupe, ou un autre bâtiment, d'approcher du vaisseau.
Courir au large, c'est s'éloigner de la côte ou de quelque vaisseau.
Se mettre au large, c'est s'élever & s'avancer en mer.
La mer vient du large, c'est-à-dire que les vagues sont poussées par le vent de la mer, & non pas par celui de la terre.
LARGE, grand & petit large, (Draperie) voyez l'article DRAPERIE.
LARGE, (Maréch.) se dit du rein, des jarrets, de la croupe, & des jambes. Voyez ces mots, Aller large : voyez ALLER.
LARGE, LARGEMENT, (Peinture) peindre large n'est pas, ainsi qu'on le pourroit croire, donner de grands coups de pinceau bien larges ; mais en n'exprimant point trop les petites parties des objets qu'on imite, & en les réunissant sur des masses générales de lumieres & d'ombres qui donnent un certain spécieux à chacune des parties de ces objets, & conséquemment au tout, & le font paroître beaucoup plus grand qu'il n'est réellement ; faire autrement, c'est ce qu'on appelle avoir une maniere petite & mesquine, qui ne produit qu'un mauvais effet.
LARGE, (Vénérie) faire large se dit en Fauconnerie de l'oiseau lorsqu'il écarte les aîles, ce qui marque en lui de la santé.
|
| LARGESSES | S. f. pl. (Hist.) dons, présens, libéralités. Les largesses s'introduisirent à Rome avec la corruption des moeurs, & pour lors les suffrages ne se donnerent qu'au plus libéral. Les largesses que ceux des Romains qui aspiroient aux charges, prodiguoient au peuple sur la fin de la république, consistoient en argent, en blé, en pois, en féves ; & la dépense à cet égard étoit si prodigieuse que plusieurs s'y ruinerent absolument. Je ne citerai d'autre exemple que celui de Jules-César, qui, partant pour l'Espagne après sa préture, dit qu'attendu ses dépenses en largesses il auroit besoin de trois cent trente millions pour se trouver encore vis-à-vis de rien, parce qu'il devoit cette somme au-delà de son patrimoine. Il falloit nécessairement dans cette position qu'il pérît ou renversât l'état, & l'un & l'autre arriverent. Mais les choses, étoient montées au point que les empereurs, pour se maintenir sur le trône, furent obligés de continuer à répandre des largesses au peuple : ces largesses prirent le nom de congiaires ; & celles qu'ils faisoient aux troupes, celui de donatifs. Voyez CONGIAIRES & DONATIFS.
Enfin dans notre histoire on appella largesses quelques legeres libéralités que nos rois distribuoient au peuple dans certains jours solemnels. Ils faisoient apporter des hanaps ou des coupes pleines d'especes d'or & d'argent ; & après que les hérauts avoient crié largesses, on les distribuoit au public. Il est dit dans le Cérémonial de France, tom. II. p. 742, qu'à l'entrevûe de Francois I. & d'Henri VIII. près de Guignes, l'an 1520, " pendant le festin il y eut largesses criées par les rois & hérauts d'armes, tenant un grand pot d'or bien riche ".
C'est la derniere fois de ma connoissance qu'il est parlé de largesses dans notre histoire, & au fond, la discontinuation de cet usage frivole n'est d'aucune importance à la nation. Les vraies largesses des rois consistent dans la diminution des impots qui accablent le malheureux peuple. (D.J.)
|
| LARGEUR | S. f. (Géom.) c'est une des trois dimensions des corps, voyez DIMENSION. Dans une table, par exemple, la largeur est la dimension qui concourt avec la longueur pour former l'aire ou la surface du dessus de la table. Les Géometres appellent assez communément hauteur ce que l'on nomme vulgairement largeur : ainsi, dans l'évaluation de l'aire d'un parallélogramme ou du triangle, quand ils disent multiplier la base par la hauteur, il faut entendre qu'il s'agit de multiplier la longueur par la largeur.
Ordinairement la largeur d'une surface se distingue de la longueur, en ce que la largeur est la plus petite des deux dimensions de la surface, & que la longueur est la plus grande. Ainsi on dit d'une surface qu'elle a, par exemple, vingt toises de long & quatre de large. (E)
LARGEUR se dit dans l'Ecriture de l'étendue horisontale des caracteres & de celle des pleins & des déliés.
LARGEUR, (Rubanier) se dit lorsque les soies, après être passées en lisses & en peigne, sont toutes prêtes à être travaillées ; pour lors l'ouvrier fait environ une douzaine de pas sur ses marches, en se servant de menue ficelle au lieu de trame, seulement pour disposer cette chaîne à prendre sa largeur. On prend encore pour le même effet de vieilles dents de peigne ou même des allumettes, quand elles peuvent suffire pour la largeur nécessaire : cette opération est d'autant plus indispensable, que toutes les soies de chaîne étant attachées ensemble par un seul noeud sur le vergeon de la corde à encorder, on seroit trop long-tems à leur faire prendre la largeur requise si on travailloit réellement avec la trame qui en outre seroit perdue.
|
| LARGO | adv. terme de Musique, qui, placé à la tête d'un air, indique un mouvement d'une lenteur modérée, & moyen entre l'andante & l'adagio. Ce mot marque qu'il faut tirer de grands sons, donner de grands coups d'archet, &c.
Le diminutif larghetto annonce un mouvement un peu plus animé que le largo, mais plus lent que l'andante. Voyez ADAGIO, ANDANTE, &c. (S)
|
| LARGUE | S. m. (Marine) vent largue ; c'est un air de vent compris entre le vent arriere & le vent de bouline. Il est le plus favorable pour le sillage, car il donne dans toutes les voiles ; au lieu que le vent en poupe ne porte que dans les voiles d'arriere, qui dérobent le vent aux voiles des mats d'avant. L'expérience a appris en géneral qu'un vaisseau qui fait trois lieues par heure avec un vent largue, n'en fait que deux avec un vent en poupe.
Largue, haute mer. On dit prendre le largue, tenir le largue, faire largue, pour dire prendre la haute mer, tenir la haute mer, &c.
|
| LARGUER | v. act. (Marine) laisser aller & filer les manoeuvres quand elles sont hâlées. Larguer les écoutes, c'est détacher les écoutes pour leur donner plus de jeu. Larguer une amarre, c'est détacher une corde d'où elle est attachée. On se sert encore du verbe larguer pour exprimer l'état du vaisseau, lorsque ses membres ou ses bordages se séparent, lorsqu'il s'ouvre en quelqu'endroit, on dit alors que le vaisseau est largué.
|
| LARIGOT | S. m. (Lutherie) jeu d'orgue, c'est le plus aigu de tous les jeux de l'orgue ; il sonne la quinte au-dessus de la doublette. Voyez la table du rapport de l'étendue des jeux de l'orgue, & nos Pl. d'orgue. Ce jeu, qui est de plomb, a quatre octaves d'étendue.
|
| LARIN | S. m. (Monn. étrang.) monnoie de compte & monnoie courante de la même valeur. Elle regne au Mogol, en Arabie, en Perse, & principalement dans les golfes persiques & de Cambaye. Cette monnoie a reçu son nom de la ville de Lar, capitale du Laristan, où l'on en a d'abord fabriqué : sa figure est assez singuliere, c'est un fil d'argent de la grosseur d'un tuyau de plume de pigeon, long d'environ un travers de doigt, replié de sorte qu'un bout est un peu plus grand que l'autre. L'empreinte est marquée au coude du repli, mais il s'en trouve de plusieurs empreintes différentes, parce que plusieurs princes en font frapper. Le larin est d'un titre plus haut que l'argent de France ; & comme on le prend au poids, son usage est très-commode dans tout l'Orient. Dix larins valent une piastre, c'est-à-dire cinq de nos livres ; huit larins font un hor, & dix hors font un toman. Ainsi le larin peut s'évaluer à environ dix sols de France. (D.J.)
|
| LARINO | (Géogr.) petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Capitanate, avec un évêché suffragant de Bénevent, dont elle est à 15 lieues. Elle étoit de l'ancien Samnium. C'est le Larinum de Ciceron & de Méla. Les habitans sont nommés Larinas au singulier, & par Pline au pluriel Larinates Le territoire de la ville, Larinas ager par Tite-Live, & Larinus ager par Cicéron. Longitude 32. 35. lat. 41. 48. (D.J.)
|
| LARISSE | (Géogr. anc.) La seule Grece avoit plusieurs villes de ce nom ; une dans la Méonie, aux confins de l'Eolide, sur l'Hermus ; une dans la Troade au bord de la mer ; une dans la Lydie sur le Caïstre, au-dessus de Sardes, remarquable par un temple d'Apollon ; une dans l'île de Crete, une autre dans la Carie, une autre près d'Argos, &c.
Mais la fameuse Larisse, la capitale de Thessalie, mérite seule de nous arrêter ici. Elle étoit située sur la rive droite du fleuve Pénée, dans la Pélasgiotide, dix milles au-dessus d'Astrax ; elle est nommée Larissa dans Lucain, & Larissae dans Horace. Les Latins ont dit également Larissei & Larissenses, pour en désigner les habitans. Jupiter y étoit particulierement honoré, d'où il fut surnommé Larissus. Elle a pour symbole dans ses médailles un cheval qui court ou qui paît.
Philippe, pere d'Alexandre, ayant résolu de tourner ses armes contre les Grecs, après avoir fait une paix captieuse avec les Illyriens & les Pannoniens, choisit sa demeure dans notre Larisse, & par ce moyen gagna l'affection des Thessaliens, qui contribuerent tant par leur excellente cavalerie au succès de ses projets ambitieux. César rapporte qu'avant la bataille de Pharsale, Scipion occupoit Larisse avec une légion ; ce fut aussi la premiere place où Pompée se rendit après sa défaite : cependant il ne voulut point s'y arrêter ; il vint sur le bord de la riviere & prit un petit bateau pour aller du côté de la mer, où il trouva un navire prêt à lever l'ancre qui le reçut volontiers.
Mais ce qui immortalise encore davantage la Larisse de Thessalie, c'est d'avoir été la patrie d'Achille. Voilà pourquoi Racine fait dire à ce héros, dans Iphigénie, act. jv. sc. 6.
Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre,
Aux champs thessaliens oserent-ils descendre ?
Et jamais dans Larisse un lâche ravisseur
Me vint-il enlever ou ma femme ou ma soeur ?
Larisse subit le sort du pays dont elle étoit la métropole ; elle perdit sa splendeur & son lustre, atque olim Larisse potens ! s'écrioit Lucain, en considérant les vicissitudes des choses humaines.
Cependant Larisse subsiste encore présentement, & conserve, sous l'empire turc, le nom de ville dans la province de Janna. On la nomme aujourd'hui Larze. Le sieur Paul Lucas, qui y étoit en 1706, dit que Larze est située assez avantageusement dans une plaine fertile & arrosée d'une belle riviere qui passe au pié de ses maisons. Cette riviere, le Pénée des anciens, est nommée par les Grecs modernes, Salembria, & par les Turcs Licouston. Elle a un pont de pierre fort bien construit ; Larze est habitée par des Turcs, des Grecs, & principalement des Juifs, qui y font un commerce assez considérable. Il n'y a qu'une seule église pour les chrétiens grecs, & cette seule église porte le nom d'évêché. (D.J.)
LARISSE, (Géog.) montagne de l'Arabie pétrée ; le long de la mer Méditerranée. Il ne faut pas croire Thevel, qui prétend que c'est-là le mont Casius ou Cassius des anciens, lieu célebre, dit Strabon, parce que c'est sur cette montagne que repose le corps du grand Pompée, & qu'on voit le temple de Jupiter Cassius.
LARISSE, (Géograph.) riviere de la Turquie européenne dans la Romanie. Elle a sa source entre Andrinople & Chiourlick, & se jette dans l'Archipel.
|
| LARISSUS | (Geogr. anc.) fleuve du Péloponnèse qui séparoit l'Achaïe proprement dite d'avec l'Elide. Près du bord de cette riviere étoit un temple à Minerve Larissienne.
|
| LARISTAN | (Géog.) contrée de Perse aux environs de la ville de Lar ; cette contrée appartenoit autrefois aux princes des Guebres, qui faisoient profession de la religion des Mages. Les Arabes les en dépouillerent sans abolir le culte du pays : ceux-ci furent chassés par les Curdes l'an 500 de l'hégire ; & ces derniers s'y maintinrent jusqu'au regne de Schach-Abas. Le Laristan s'étend depuis le 25d de latit. jusqu'au 27. (D.J.)
|
| LARIX | (Littér. Bot.) nom d'un bois dont parle Vitruve, liv. I. ch. ix. Il dit que César étant campé près des Alpes, voulut se rendre maître d'une forteresse nommée Larignum (Isidore liv. XVII. ch. vij. écrit Laricium), devant laquelle il y avoit une tour de bois d'où on pouvoit incommoder ses troupes. Il y fit mettre le feu, & en peu de tems elle parut toute embrasée, mais ensuite le feu s'éteignit de lui-même sans avoir consommé le bois de la tour. César voyant son projet manqué, fit une tranchée, & les ennemis furent obligés de se rendre. Ils lui apprirent alors que la tour étoit construite du bois larix, qui avoit donné le nom au château, & que ce bois ne pouvoit être endommagé par les flammes. M. Perrault, incertain si le larix dont il s'agit ici est notre mélese, a conservé le terme latin dans sa traduction, son doute mérite des louanges, & c'est bien le doute d'un vrai savant ; car quoique la mélese soit un bois très-dur & très-durable ; excellent pour la construction des vaisseaux, on a de la peine à se persuader qu'un bois plein de résine & de térébenthine ait la propriété de résister aux flammes, comme Vitruve le raconte du larix. (D.J.)
|
| LARME | S. m. (Anat.) lymphe claire, limpide, salée, qui, par le mouvement des paupieres, se répand sur tout le globe de l'oeil, humecte la cornée, & l'entretient nette & transparente.
En effet, la glace qui fait l'entrée du globe de l'oeil, n'est pas un crystal solide ; c'est, je l'avoue, une membrane dure & polie, mais c'est toujours une membrane, elle doit tout son poli, toute sa transparence, non seulement à l'humeur aqueuse qu'elle contient, mais encore à une autre humeur limpide, qui l'abreuve sans-cesse par dehors & en remplit exactement les pores ; sans cette eau, la cornée transparente exposée à l'air se sécheroit, se rideroit, se terniroit, & cesseroit de laisser passer les rayons ; or cette eau si essentielle à la transparence de la cornée à la vue ce sont les larmes.
On leur donne pour source une glande plate, nommée glande lacrymale, située au côté extérieur & supérieur de l'oeil. Voyez LACRYMALE, GLANDE.
Les larmes sont versées de cette glande sur le devant de l'oeil par des conduits très-fins ; & le mouvement fréquent des paupieres les répand, & en arrose toute la surface polie de l'oeil ; ensuite elles sont charriées vers l'angle qui regarde le nez, qu'on appelle le grand angle, par les rebords saillans des paupieres, qui font séparément l'office de gouttiere, & qui, jointes ensemble, font l'office de canal, & en même tems de siphon.
Sur chaque paupiere, vers ce grand angle où sont charriées les larmes, on trouve une espece de petit puits perdu, dont on appelle l'ouverture le point lacrymal ; chacun de ces petits canaux se réunit au grand angle à un réservoir commun, appellé sac lacrymal ; ce sac est suivi d'un canal, qu'on nomme conduit lacrymal ; ce conduit descend, logé dans les os, jusques dans le nez, où il disperse les larmes qui concourent à humecter cet organe, quand elles ne sont pas trop abondantes ; mais lorsqu'on pleure, on est obligé de moucher souvent, pour débarrasser le nez des larmes qui s'y jettent alors en trop grande quantité.
Les larmes qui coulent quelquefois dans la bouche, passent par les trous incisifs, qui sont situés au milieu de la mâchoire supérieure, & qui vont se rendre dans les cavités du nez. Ces trous se trouvant toujours ouverts, laissent passer dans la bouche le résidu des larmes, ainsi que la portion la plus subtile des mucosités du nez.
Il suit de ce détail que quand les points lacrymaux sont obstrués ; il en arrive nécessairement un épanchement de larmes ; & que quand le conduit nazal est bouché, il en résulte différentes especes de fistules lacrimales. Quelquefois aussi, par l'abondance ou l'acrimonie de la lymphe, le sac lacrymal vient à être dilaté ou rongé, ce qui produit des sistules lacrymales d'une espece différente des autres. Leur cure consiste à donner aux sérosités de l'oeil une issue artificielle, au defaut de la naturelle qui est détruite.
Il y a des larmes de douleur & de tristesse ; & combien de causes qui les font couler ! Mais il est aussi des larmes de joie ; ce furent ces dernieres qui inonderent le visage de Zilia, quand elle apprit que son cher Aza venoit d'arriver en Espagne : " Je cachai, dit-elle, à Déterville mes transports de plaisirs, il ne vit que mes larmes "
Il y a des larmes d'admiration ; telles étoient celles que le grand Condé, à l'âge de vingt ans, étant à la premiere représentation de Cinna, répandit à ces paroles d'Auguste : Je suis maître de moi, comme de l'univers, &c. Le grand Corneille faisant pleurer le grand Condé d'admiration, est une époque célebre dans l'histoire de l'esprit humain, dit M. de Voltaire. (D.J.)
LARME DE JOB, lacrima Job, (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur sans pétales, composée de plusieurs étamines qui sortent d'un calice, disposée en forme d'épi & stérile : les embryons naissent séparément des fleurs, & deviennent des semences enveloppées d'une membrane, & renfermées dans une coque. Tournef. Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Elle ressemble au roseau, ses fleurs sont à pétales, ornées d'un calice ; elles sont mâles, & en épi du côté de la plante, son ovaire est situé de l'autre côté ; il est garni d'un long tube, & de deux cornes ; il dégénere en une coque pierreuse qui contient une semence. Voilà les caracteres de cette plante, il faut maintenant sa description.
Elle a plusieurs racines partagées en beaucoup de fibres, longues d'une ou de deux coudées, noueuses. Ses feuilles sont semblables à celles du blé de Turquie, quelquefois longues d'une coudée & plus, larges de deux pouces ; mais les feuilles qui naissent sur les rameaux, sont moins grandes ; il sort des aisselles de ses feuilles de petits pédicules, qui soutiennent chacun un grain ou un noeud, rarement deux, contenant l'embryon du fruit : il part de ces noeuds des épis de fleurs à étamines, renfermées dans un calice à deux bulles, sans barbe. Ces fleurs sont stériles, car les embryons naissent dans les noeuds, & deviennent chacun une graine unie, polie, luisante, cendrée avant la maturité, rougeâtre quand elle est mûre, dure comme de la pierre, de la grosseur d'un pois chiche, pointue à sa partie supérieure, & composée d'une coque dure & ligneuse ; cette coque renferme une amande farineuse, enveloppée d'une fine membrane.
Cette plante qui est une sorte de blé, vient originairement de Candie, de Rhodes, & autres îles de l'Archipel ; elle y croît d'elle-même, ainsi qu'en Syrie & dans d'autres contrées orientales. On la cultive quelquefois en Portugal & en Italie. On dit que le petit peuple dans des années de disette y fait du pain passable des semences qu'elle porte : ce qui est plus certain, c'est que les religieuses font de petites chaînes & des chapelets avec cette graine, qu'elles amollissent dans de l'eau bouillante, & la passent ensuite dans un fil. Comme cette graine n'a point de vertu en Médecine, nous n'en cultivons la plante que par pure curiosité, & même rarement. Ses semences ne mûrissent guere bien dans nos climats tempérés. (D.J.)
LARME DE JOB, (Mat. méd.) voyez GREMIL.
LARMES pierre de ; (Hist. nat.) en allemand thraenenstein. Quelques Auteurs ont donné ce nom à une pierre de forme ovale, d'un blanc salé, & remplie de taches semblables à des gouttes d'eau ou à des larmes que la hasard y a formées. On dit qu'il s'en trouve en Hongrie, & qu'on les tire du lit de la riviere de Moldave. Voyez Bruckmanni, Epistol. itinerariâ.
LARMES DE VERRE, (Phys.) sons de petits morceaux de verre ordinaire qu'on tire du vase où le verre est en fusion avec l'extrémité d'un tuyau de fer. On en laisse tomber les gouttes, qui sont extrêmement chaudes, dans un vase où il y a de l'eau froide, & on les y laisse refroidir. Là elles prennent une forme assez semblable à celle d'une larme, & c'est pour cette raison qu'on les appelle larmes de verre ; elles sont composées d'un corps assez gros & rond, qui se termine par un petit filet ou tuyau fermé. On fait avec ces larmes une expérience fort surprenante ; c'est qu'aussi-tôt qu'on en casse l'extrémité, toute la larme se brise en pieces avec un grand bruit, & quelques morceaux sont même réduits en poussiere. Le Dr. Hook, dans sa Micrographie, a donné une dissertation particuliere sur ce sujet. La cause de cet effet n'est pas encore trop bien connue ; voici une des explications qu'on en a imaginées. Quand la larme se refroidit & devient dure, il reste au centre de cette larme un peu d'air extrêmement raréfié par la chaleur ; & on voit en effet les bulles de cet air renfermées au-dedans de la larme de verre, desorte que l'intérieur de cette larme, depuis le bout jusqu'au fond, est creux, & rempli d'air beaucoup moins condensé que l'air extérieur. Or, quand on vient à rompre le bout du tuyau ou filet qui termine la larme, on ouvre un passage à l'air extérieur, qui ne trouvant point de résistance dans le creux de la larme, s'y jette avec impétuosité, & par cet effort la brise. Cette explication souffre de grandes difficultés, & doit être au moins regardée comme insuffisante ; car les larmes de verre se brisent dans le vuide.
Ces larmes de verre s'appellent aussi larmes bataviques ; parce que c'est en Hollande qu'on a commencé à en faire. On peut voir en différens auteurs de physique les explications qu'ils ont tenté de donner de ce phénomene, & que nous ne rapporterons point ici, comme étant toutes hypothétiques & conjecturales. (O)
LARMES, terme d'Architecture. Voyez GOUTTES.
LARMES, (Verrerie) ce sont des gouttes qui tombent des parois & des voûtes des fourneaux vitrifiés par la violence du feu. Si ces gouttes se mêlent à la matiere contenue dans les pots, comme elles sont très-dures & qu'elles ne s'y mêlent pas, elles gâtent les ouvrages. Le moyen, sinon de prévenir entierement leur formation, du-moins de les rendre rares, c'est de bien choisir les pierres & les terres dont on fait les fourneaux. Voyez l'art. VERRERIE.
LARMES, (chasse) on appelle larmes de cerf l'eau qui coule des yeux du cerf dans ses larmieres, où elle s'épaissit en forme d'onguent, qui est de couleur jaunâtre, & souverain pour les femmes qui ont le mal-de-mere, en délayant cet onguent & en le prenant dans du vin blanc, ou dans de l'eau de chardon beni.
Larmes de plomb, c'est une espece de petit plomb dont on se sert pour tirer aux oiseaux ; ce terme est fort usité parmi les chasseurs.
|
| LARMIER | S. m. (Maçonnerie) c'est l'avance ou espece de petite corniche qui est au haut du toît, & qui préserve les murs de la chûte des eaux qu'elle écarte. L'extrémité des tuiles, des ardoises & des chevrons pose sur le larmier, qu'on appelle aussi couronne, mouchelle & gouttiere.
Larmier se dit aussi du chaperon ou sommet d'une muraille de clôture. Il est fait en talud. Il donne lieu à l'écoulement des eaux. Lorsque le talud est double, on en conclut que le mur est mitoyen.
Le couronnement d'une souche de cheminée s'appelle le larmier.
Un larmier est encore une espece de planche en champfrain & faucillée en dessous en canal rond, pour éloigner plus facilement les eaux du mur.
Le larmier bombé & réglé d'une porte ou d'une croisée, c'est dans un hors-d'oeuvre un linteau cintré par le devant & droit par son profil.
Ces fenêtres ébrasées, qu'on pratique aux cuisines & aux caves, s'appellent larmiers. Voyez nos Pl. de Charpente.
LARMIERS, (Maréchallerie) on appelle ainsi dans le cheval l'espace qui va depuis le petit coin de l'oeil jusqu'au derriere des oreilles ; c'est, pour ainsi dire, les tempes du cheval. Ce mot se prend aussi pour une veine auprès de l'oeil du cheval.
LARMIER, (Chasse) ce sont deux fentes qui sont au-dessous des yeux du cerf, il en sort une liqueur jaune.
|
| LARMOIEMENT | S. m. (Séméiotique) le larmoiement est un effet assez ordinaire & un signe presqu' assûré de l'impulsion plus forte du sang vers la tête ; les enfans, dans qui les humeurs ont particulierement cette tendance, ont les yeux toujours baignés de larmes, & ils fondent en pleurs à la moindre occasion. Le larmoiement, dans les maladies aiguës, est presque toujours un mauvais signe, il présage le délire ou l'hémorragie du nez ; mais, pour être signe, il faut qu'il ne dépende d'aucun vice local dans les yeux, & qu'il ne puisse être attribué à aucune cause évidente, ; alors, dit Hippocrate, il est , c'est-à-dire qu'il marque une grande aliénation d'esprit ; car les larmes qui sont excitées par quelque affection de l'ame, n'indiquent rien d'absurde, . Aphor. 52. lib. IV. Et en outre pour que le larmoiement soit un signe fâcheux, il faut qu'il paroisse dans un tems à critique ; car, lorsqu'on l'observe pendant les jours destinés aux efforts critiques, il est l'avant-coureur & le signe d'une hémorragie du nez prochaine, qui sera salutaire & indicatoire, sur-tout si les autres signes conspirent.
Lorsque le larmoiement se rencontre au commencement d'une fievre aiguë avec des nausées, vomissement, mal de tête, douleurs dans les reins, &c. sur-tout dans des enfans, c'est un signe assez certain que la rougeole va paroitre. Ce symptome ne s'observe que très-rarement, quand l'éruption varioleuse se prépare. On ignore quelle est la liaison entre ces deux effets, & par quel méchanisme l'un précéde aussi ordinairement l'autre ; & ce n'est pas le seul cas en Médecine, où la conjecture ne puisse pas même avoir lieu. (M)
|
| LARNUM | (Géogr. anc.) riviere de l'Espagne Tarragonoise, selon Pline, l. III. c. iij. Cette riviere se nomme présentement Tornera. (D.J.)
|
| LARRONS | S. m. (Hist. anc.) en latin latro. C'étoient originairement des braves, qu'on engageoit par argent ; ceux qui les avoient engagés les tenoient à leurs côtés ; de-là ils furent appellés laterones & par ellipse latrones. Mais la corruption se mit bientôt dans ces troupes ; ils pillerent, ils volerent, & latro se dit pour voleur de grand chemin. Il y en avoit beaucoup au tems de Jésus-Christ ; ils avoient leur retraite dans les rochers de la Trachonite, d'où Hérode eut beaucoup de peine de les déloger. Les environs de Rome en étoient aussi infestés. On appella latrones ceux qui attaquoient les passans avec des armes ; grassatores ceux qui ne se servoient que de leurs poings.
LARRON, (Jardinage) est une branche gourmande. Voyez GOURMAND.
LARRON, terme d'Imprimerie, c'est un pli qui se trouve dans une feuille de papier, lequel, quand les Imprimeurs n'ont pas soin de l'ôter avant que la feuille passe sous la presse, cause une défectuosité qui se manifeste lorsqu'on donne à cette feuille son étendue naturelle, par un blanc déplacé, ou interruption d'impression ; les Imprimeurs entendent aussi par larron le même effet produit par un petit morceau de papier qui se trouve sur la feuille qu'ils impriment, & qui vient à se détacher au sortir de la presse, ce cas est même plus fréquent que le premier.
LARRONS les îles des (Géogr.) Voyez MARIANES îles.
LARVES, s. m. pl. (Mythol.) c'étoient, dans le sentiment des anciens Romains, les ames des méchans qui erroient çà & là, pour effrayer & tourmenter les vivans ; larva signifie proprement un masque ; & comme autrefois on les faisoit si grotesques, qu'ils épouvantoient les enfans : on s'est servi de ce nom pour désigner les mauvais génies, que l'on croyoit capables de nuire aux hommes. On les appelloit autrement lémures. Voyez LEMURES, LEMURIES, LARES, LUTINS & GENIES.
|
| LARYMNA | (Géogr. anc.) ville maritime de Grece dans la Béotie, à l'embouchure du Céphise, selon Pausanias. Comme elle étoit aux confins de la Locride & de la Béotie, Strabon en a fait deux villes au bord de la mer, l'une en Locride, l'autre en Béotie. Il est vrai cependant qu'il y avoit deux Larymnes, mais l'une étoit dans les terres près du lac Copaïde, & l'autre au bord de la mer. (D.J.)
|
| LARYNGOTOMIE | en Chirurgie, est une incision à la trachée artere entre deux de ses anneaux, pour donner passage à l'air lorsqu'il y a danger de suffocation par une esquinancie ou autre cause que ce soit. Voyez ANGINE & ESQUINANCIE. Le mot est grec , formé de , larynx, & de , je coupe.
La laryngotomie est la même chose que la bronchotomie. Voyez BRONCHOTOMIE & TRACHEOTOMIE. (I)
|
| LARYNX | S. m. en Anatomie est la partie supérieure ou la tête de la trachée artere. Il est situé audessous de la racine de la langue, & devant le pharinx. Voyez TRACHEE ARTERE.
Le larynx est un des organes de la respiration, & le principal instrument de la voix. Voyez RESPIRATION, &c.
Il est presque entierement cartilagineux & il doit être toujours ouvert pour donner passage à l'air dans l'inspiration & l'expiration. Sa figure est circulaire, quoiqu'il s'avance un peu antérieurement ; il est légerement applati par-derriere, pour ne pas incommoder l'oesophage sur lequel il se trouve placé.
Le larinx est d'un différent diametre, suivant les divers âges. Dans les jeunes gens il est étroit : de-là vient qu'ils ont une voix aiguë. Dans un âge plus avancé, il est plus ample, ce qui rend la voix plus grosse & plus forte. Dans les hommes il est plus grand que dans les femmes ; c'est pourquoi la voix des hommes est plus grave que celle des femmes.
Il paroit moins dans les femmes, parce que les glandes situées à sa partie inférieure sont plus grosses dans les femmes que dans les hommes. V. Voix.
Le larynx se meut dans le tems de la déglutition. Lorsque l'oesophage s'abaisse pour recevoir les alimens, le larynx s'éleve pour les comprimer & les faire descendre plus aisément. V. DEGLUTITION.
Le larynx est composé de cinq sortes de parties, savoir de cartilages, de muscles, de membranes, de nerfs & de glandes. Les cartilages sont le thyroïde, le cricoïde, l'aryténoïde & l'épiglotte ; par le moyen desquels il peut aisément s'élargir & se resserrer, se fermer & s'ouvrir. Ces cartilages forment tout le corps du larynx ; ils se séchent & se durcissent à mesure que l'on devient vieux ; & alors le larynx paroit quelquefois osseux.
Le plus grand des cartilages est le thyroïde ou scutiforme ; il est situé à la partie antérieure du larynx ; & il est ainsi nommé à cause de la ressemblance qu'on lui suppose avec un bouclier. Il est concave & convexe & de figure quarrée ; sa partie concave est tournée en-dedans, & sa partie convexe en dehors, ayant dans son milieu une petite éminence appellée pomme d'Adam, comme si un morceau du fruit défendu s'étoit arrêté dans le gosier d'Adam, & avoit causé cette élévation.
Le second cartilage s'appelle cricoïde ou annulaire à cause de sa ressemblance avec un anneau ; il est fort étroit à sa partie antérieure qui est placée sous le cartilage cricoïde ; mais il est large, épais & fort à sa partie postérieure, etant comme la base des autres cartilages.
Le troisieme & le quatrieme se nomment aryténoïdes, parce qu'étant joints ensemble ils ressemblent à une espece d'aiguiere. A leur jonction est une petite ouverture ou fente en forme d'une petite langue, & qui à cause de cela est appellée glotte. C'est par cette fente que l'air descend dans les poumons, & que sort la pituite que l'on crache dans les rhumes en toussant. Elle sert aussi à modifier la voix, & on l'imite dans les flûtes & les tuyaux d'orgue. V. GLOTTE.
Sur la glotte est un cinquieme cartilage nommé épiglotte, qui est très-mince & très-flexible, & qui dans ceux qui ne sont pas encore adultes se trouve presque membraneux ; il est concave inférieurement & convexe supérieurement ; il couvre l'entrée du larynx & empêche les liquides qui en buvant glissent par dessus pour entrer dans l'oesophage, de tomber dans la trachée artere. Voyez EPIGLOTTE,
Le larynx a sept paires de muscles qui servent à mouvoir ses divers cartilages, & à les contracter ou les dilater selon qu'il plait à la volonté. Il y a deux paires de muscles communs & cinq de propres. Les muscles propres sont ceux qui ont leur origine & leur insertion au larynx ; les communs n'y ont que leur insertion.
Entre les muscles propres du larynx sont le crico-thyroïdien, qui fait mouvoir la cartilage thyroïde, le crico-aryténoïdien postérieur, qui en se contractant écarte les cartilages aryténoïdes & ouvre la glotte, l'aryténoïdien, qui sert à joindre ensemble les deux cartilages aryténoïdes & à fermer la glotte, le crico-aryténoïdien latéral, le thyro-ariténoïdien, qui ferme le larynx.
Les muscles communs du larynx sont les sterno-thyroïdiens qui tirent en bas le cartilage thyroïde, & les hyo-thyroïdiens qui le tirent en haut. Voyez-en la description à leur article particulier.
Le larynx n'a que deux membranes, une externe qui est une continuation de celle de la trachée artere, l'autre interne, qui est une continuation de celle qui tapisse toute la bouche.
Le larynx reçoit deux branches de nerfs des recurrens, & il est humecté par quatre grosses glandes, deux situées en haut, appellées amygdales, & deux en bas, appellées thyroïdes. Voy. AMYGDALES, &c.
Le larynx est fort utile non-seulement pour former & modifier la voix par les diverses ouvertures de la glotte : mais encore pour comprimer plus ou moins les poumons au moyen de l'air. En effet, si le diametre interne du larynx avoit été égal à celui de la trachée artere, les poumons n'auroient souffert que peu ou point du tout de compression, & par conséquent sans le larynx nous n'aurions retiré aucun avantage de l'inspiration ; parce que l'air n'auroit pu résister à la force avec laquelle il est chassé dehors dans l'expiration, & en conséquence les poumons n'auroient pu être comprimés ; ce qui est néanmoins nécessaire pour briser les globules du sang, & pour produire le mélange de l'air avec ce liquide. Voyez RESPIRATION.
Quant à l'action du larynx dans la formation des sons, voyez GLOTTE & SON. Voy. aussi EPIGLOTTE, TRACHEE ARTERE. &c.
|
| LARYSIUS | (Géog. anc.) , montagne du Péloponnèse dans la Laconie, au-dessus de Migonium, contrée qui est vis-à-vis de Cranaé. Il y avoit sur cette montagne un temple dédié à Bacchus, à l'honneur de qui on y célébroit une fête tous les printems. (D.J.)
|
| LAS | adj. (Gramm.) voyez LASSITUDE.
LAS ou LASSIEN, (Econom. rust.) c'est la partie d'une grange à côté de l'aire où l'on entasse les gerbes.
|
| LAS | LAS
|
| LASCIVETÉ | S. f. (Morale) espece de mollesse, fille de l'oisiveté, de l'aisance & du luxe ; de-là vient que l'auteur de l'Andrienne appelle les plaisirs des grands, lascivia nobilium. La lasciveté est à parler proprement un vice qui blesse la pureté des moeurs. Le Brame inspiré va vous tracer d'une main légere son caractere & ses effets.
Couchée mollement sous un berceau de fleurs, elle mandie les regards des enfans des hommes, elle leur tend des piéges & des amorces dangereuses.
Son air est délicat, sa complexion foible, sa parure est un négligé touchant, la volupté est dans ses yeux, & la séduction dans son ame.
Fuis ses charmes, fermes l'oreille à l'enchantement de ses discours : si tes yeux rencontrent la langueur des siens ; si sa voix douce passe jusqu'à ton coeur ; si dans ce moment elle jette ses bras autour de ton col, te voilà son esclave, elle t'enchaîne à jamais.
La honte, la maladie, la misere & le repentir marchent à sa suite.
Affoibli par la débauche, endormi par la molesse, énervé par l'inaction, tu tomberas dans la langueur, le cercle de tes jours sera étroit, celui de tes peines étendu ; le premier sera sans gloire, l'autre n'excitera ni larmes ni pitié. (D.J.)
|
| LASER | (Bot. mod.) V. LASERPITIUM. Ce genre de plante ombellifere est appellé laserpitium par les Botanistes, & c'est d'une plante semblable qu'on tire en Perse l'assa-foetida des boutiques. Tournefort compte quatorze especes de laser, & Boërhaave seize. Nous décrirons dans ce nombre celle de Marseille, qui est la plus commune : on l'appelle laserpitium gallicum massiliense.
Elle pousse une tige haute ressemblant à celle de la péruse, cannelée, noueuse & fongueuse ; ses feuilles sont disposées en aîles fermes, charnues, roides, divisées & subdivisées en lobes, garnies par derriere de quelques poils rudes ; ses sommets soutiennent de grandes ombelles de fleurs disposées en rose, & composées de cinq pétales faits en coeur, & arrangés circulairement autour du calice. Quand ces fleurs sont tombées, il leur succede des graines assez grandes, bossues, jaunâtres, odorantes, jointes deux à deux, & garnies chacune de quatre aîles feuillues ; sa racine est longue, d'un gris cendré en dehors, blanche en-dedans, molle, grasse, succulente & odorante. Cette plante croît en Provence, comme aux environs de Marseille ; sa racine passe pour atténuante & résolutive, mais elle est de peu d'usage. (D.J.)
LASER, (Bot. anc.) la plante de Cirène, de Perse, de Médie & d'Arménie, que les Grecs nommoient silphium, & les Latins laserpitium, répandoit de sa tige & de sa racine un suc précieux appellé par excellence, c'est-à-dire le suc des sucs, ou simplement , le suc du silphium ; & les Latins donnerent à ce suc le nom de laser. M. Geoffroi paroit convaincu que le silphium, le laser, le suc cyréniaque, le suc de Médie, le suc d'Arménie, le suc de Perse des anciens, & l'assa-foetida des modernes, ne sont point des sucs de différens genres, ou du moins qu'il y a peu de différence entr'eux. Voyez là-dessus ASSA FOETIDA & SILPHIUM. (D.J.)
LASER, (Mat. med.) L'opinion commune où l'on est que les mêmes choses qui nous paroissent aujourd'hui agréables ou désagréables au goût ou à l'odorat, doivent avoir toujours fait le même effet sur tous les autres hommes, est cause qu'on a cru dans ces derniers siecles avoir perdu le silphium ou le laser, drogue qui entroit dans plusieurs compositions médicinales des anciens, & même dans plusieurs de leurs ragoûts. On sait qu'il y avoit anciennement de deux sortes de laser, l'un qui croissoit en Cyrene, qui étoit le plus cher & de la meilleure odeur ; l'autre qui venoit de Syrie ou de Perse, qui étoit le moins estimé & d'une odeur plus puante. On ne trouvoit déjà plus du premier du tems de Pline, qui tâche de rendre raison du manquement de cette drogue ; mais on avoit abondamment du second, & les Medecins ne faisoient pas difficulté de s'en servir au défaut de l'autre. Presque tous ceux qui ont écrit de la matiere médicinale depuis un siecle ou deux, ont soutenu qu'on ne connoissoit plus ni les plantes qui produisoient ce suc, ni ce suc lui-même ; cela peut être véritable à l'égard du laser de Cyrene : mais Saumaise croit que toutes les marques de celui de Syrie se rencontrent dans cette espece de gomme qu'on appelle assa foetida, le mot assa ou asa ayant été tiré du vieux mot laser. Leclerc, Histoire de la Medecine. Voyez ASSA FOETIDA. (M)
|
| LASERPITIUM | S. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en rose & en ombelle, composée de plusieurs pétales en forme de coeur, disposés en rond & soutenus par le calice qui devient un fruit composé de deux semences assez grandes, plates d'un côté, convexes de l'autre, & garnies de quatre feuillets. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LASKO | (Géog.) ville de Pologne dans le palatinat de Siradie.
|
| LASSA | (Géog.) ville de l'Ile de Candie, dans le territoire de Retimo.
LASSA, le, (Géog.) pays d'Asie dans la Tartarie, entre la Chine à l'orient, les états du roi d'Ava au midi, ceux du grand-mogol au couchant, & le royaume de Tangut au nord. On le considere comme faisant partie de ce dernier. Lassa ou Baratola, située selon les PP. Gerbillon & Dorville, par le 106d 41' de longitude, & 29. 6' de latitude, en est la capitale. Poutola, forteresse qui fait la résidence du dalai-lama, chef de la religion des Lamas, Couti & Tachelinbou en sont les principaux lieux. Le Lassa se nomme autrement le royaume de Bontan, dont nous n'avons presque aucune connoissance. (D.J.)
|
| LASSAN | (Géog.) ville de Poméranie sur la riviere de Péene ; entre Anclam & Wolgast.
|
| LASSE | ou LACER UNE VOILE, (Marine) c'est saisir la voile avec une petite corde nommée querantouer, qui passe par les yeux de pie. On fait cette manoeuvre lorsqu'on est surpris par un gros vent & qu'il n'y a point de garcettes aux voiles.
|
| LASSERET | S. m. (Charpente) c'est une petite tariere de huit lignes de diametre. Voyez TARIERE. Elle sert aux Charpentiers, pour faire les petites mortoises, & enlasser les tenons & les mortois ensemble. Voyez les Pl. de Charp.
LASSERET TOURNANT, c'est celui qui traverse une barre où il est arrêté par une contre-rivure, & laisse tourner toujours. Tel est le lasseret qui porte la verge des aubronniers des fleaux de grandes portes.
LASSERET, (Serrurerie) espece de piton à vis, à pointe molle, & ordinairement à double pointe, parce qu'il faut l'ouvrir pour y placer la piece qu'il doit retenir, comme on voit aux boucles des portes qui sont arrêtées par un lasseret.
Lasseret se dit encore des pieces qui arrêtent les espagnolettes sur le battant des croisées, & dans lesquelles elles se meuvent.
Le lasseret a différentes formes, selon l'usage auquel il est destiné.
|
| LASSERIE | S. f. (Vannerie) Les Vanniers comprennent sous ce terme généralement tout ce qu'ils font de plus fin & de plus beau, comme corbeilles de table, en lasserie ou damassées, dorées, ou brodées en soie, & garnies de morceaux de sculpture en bois doré, de gravure sur cuivre, &c.
Ils donnent encore ce nom à cette tissure d'osier mince & serré, qui remplit le corps d'une corbeille.
|
| LASSITUDE | S. f. (Mor.) c'est l'état de l'homme quand il n'a plus la volonté & la force d'agir. Tout travail fatigue ; il ne lasse que quand il cesse de plaire ; après la fatigue l'homme répare ses forces par le repos, & quelquefois il sort de la lassitude en changeant de travail.
LASSITUDE, lassitudo, , (Med.) est un sentiment désagréable qu'on éprouve pour l'ordinaire, après avoir fait des exercices immodérés en force ou en longueur : le sentiment est joint à une inaptitude au mouvement ; on en distingue deux especes : l'une plus proprement fatigue, defatigatio, est la suite & l'effet d'un mouvement excessif ; l'autre est spontanée, c'est-à-dire, n'est précédée d'aucun exercice, du moins violent. La premiere espece qui a une cause évidente considérée en soi, n'est pas maladie ; à peine est elle incommodité, à moins qu'elle ne soit extrème ; aussi pour la dissiper ne faut-il que du repos ; c'est le remede le plus simple & le plus assuré ; c'est le fameux d'Hippocrate ; lorsqu'on " s'est fatigué, dit-il, aphor. 48. lib. II. par quelque mouvement que ce soit, le repos est un promt délassement ; on doit en outre avoir attention de ne pas manger avant que la lassitude soit un peu dégagée & soluta par le repos, sans quoi l'on court le risque prochain d'une indigestion. Voyez INDIGESTION ". Quelques auteurs attribuent aux bains, demi-bains, incessus, préparés avec la décoction d'armoise, une vertu singulierement délassante ; ils assurent en avoir observé des effets admirables. D'autres fondés, disent-ils, sur leur expérience, ou plûtôt sur leur inexpérience, contestent à l'armoise cette propriété, & la traitent de chimérique ; il n'est pas, comme on voit, jusqu'aux faits, qui ne soient à présent matiere de dispute.
Les lassitudes spontanées qu'on ne peut attribuer à aucun mouvement considérable précédent, sont au moins incommodité, le plus souvent symptome ou présage de maladie. Ces lassitudes annoncent toujours un dérangement dans la machine, une révolution prochaine, une foiblesse dans les nerfs, &c. Presque toutes les maladies aiguës sont précédées & accompagnées de lassitude ; c'est le principal symptome qui constitue l'état neutre qu'on remarque avant que ces maladies se déclarent. On l'observe aussi quelquefois dans leurs cours, & sur-tout dans les fievres malignes, dont il augmente le danger, , dit Hippocrate, prorrhet. n°. 41. lib. I.
Il y a différens degrés ou especes de lassitude, désignés par le sentiment plus ou moins désagréable qu'on éprouve quand on veut se mouvoir. Lorsque le mouvement ou les efforts destinés à cela, impriment un sentiment d'érosion, on appelle cette lassitude ulcéreuse. Il semble aux malades que tout leur corps est couvert d'ulceres ; si ce sentiment se réduit à une tension, on lui donne l'épithete de tensive ; & si le malade ne sent qu'un poids incommode, on dit que la lassitude est gravative.
Ces distinctions doivent avoir sans-doute quelque utilité. Quelques écrivains s'imaginent que les lassitudes ulcéreuses indiquent une grande acrimonie ; les gravatives, un simple épaississement des humeurs ; celles qui sont tensives, un état moyen, fides sit penès auctores. L'avantage qu'on peut retirer de l'attention aux lassitudes spontanées, considérées généralement, n'est pas aussi hypothétique ; nous n'avons qu'à consulter le prince de la médecine, le divin Hippocrate ; il nous apprendra 1°. que ces lassitudes présagent les maladies. 2°. Que ceux qui les éprouvent dans le cours de la maladie, sont en danger. 3°. Que si après des sueurs critiques, avec lassitude & frisson, la chaleur revient, c'est un mauvais signe, soit qu'il y ait en même tems hémorrhagie du nez ou non. 4°. Que les lassitudes jointes à des anxiétés, frissons, douleurs dans les reins, sont une marque que le ventre est libre. 5°. Que dans cet état de lassitude il est bon que le malade ait des selles rougeâtres, sur-tout dans le tems critique. 6°. Que les lassitudes qui persistent pendant & après la fievre, donnent lieu d'attendre des abscès aux joues & aux articulations. 7°. Les lassitudes spontanées dans les vieillards, avec engourdissement & vertige, sont les avant-coureurs de l'apoplexie.
Ces lassitudes sont aussi un symptome bien familier dans les maladies chroniques ; elles sont sur-tout propres au scorbut, dont elles caractérisent presque seules le premier degré : il y a lassitude dans toutes les maladies où il y a langueur ; ces deux états paroissent cependant différer en ce que la langueur affaisse & anéantit l'esprit & le corps, & précede le mouvement ; au lieu que la lassitude en est une suite, & ne semble affecter que la machine, ou pour mieux dire, les mouvemens animaux.
Les lassitudes spontanées n'exigent en elles-mêmes aucun remede, soit qu'elles annoncent ou accompagnent les maladies. Dans le premier cas elles avertissent de prévenir, s'il est possible, la maladie dont elles menacent. Il est alors prudent de se mettre à un régime un peu rigoureux, de faire diete ; l'émétique pourroit peut-être faire échouer la maladie : dans le second cas elles doivent engager un medecin à se tenir sur ses gardes, à ne pas trop donner à la nature, à s'abstenir des remedes qui pourroient l'affoiblir, & à recourir sur-tout à ceux qui peuvent tirer le corps de l'engourdissement où il commence à être plongé. Ces lassitudes dans les maladies chroniques, indiquent aussi des remedes actifs, invigorans, toniques, &c. propres à corriger & changer l'état vicieux du sang & des solides qui ont donné naissance au symptome, & qui l'entretiennent. (M)
|
| LAS | ou LASTE, s. m. (Marine) c'est le poids de deux tonneaux. Les Hollandois mesurent ordinairement la charge de leurs vaisseaux par lastes. On dit un vaisseau de 150 lastes, c'est-à-dire, qu'il est de 300 tonneaux.
Dans quelques pays du nord, laste est un terme général, qui se prend pour la charge entiere du vaisseau. Il signifie quelquefois un poids ou une mesure particuliere ; mais cette mesure change nonseulement eu égard aux lieux, mais même eu égard à la différence des marchandises ; desorte que pour déterminer ce que contient un laste, il faut savoir de quel endroit & de quelle sorte de marchandise on veut parler.
|
| LAST-GELT | S. m. (Commerce) nom qu'on donne en Hollande à un droit qu'on leve sur chaque vaisseau qui entre ou qui sort, & on l'appelle ainsi de ce qui se paye à proportion de la quantité de lest ou last que chaque bâtiment entrant ou sortant peut contenir. Ce droit est de 5 sols ou stuyvers par lest en sortant, & de 10 sols en entrant. Mais il est bon d'observer que ce droit étant une fois payé, le vaisseau qui l'a acquité se trouve franc pendant une année entiere, & qu'on peut le faire rentrer ou sortir de nouveau, & autant de fois qu'on le juge à-propos, sans que pendant cette année il soit sujet au last-gelt. Voyez le Dict. de Com.
LAST-GELD, (Com.) est un droit de fret qui se leve à Hambourg sur les marchandises & vaisseaux étrangers qui y arrivent ou qui en partent. Par l'art. 41 du traité de commerce conclu à Paris, le 28 Décembre 1716, entre la France & les villes anséatiques, les vaisseaux françois qui vont trafiquer à Hambourg, sont déchargés de ce droit, qu'on ne peut exiger d'eux sous quelque nom ou prétexte que ce puisse être. Voyez le Dict. de Commerce.
|
| LATAKIÉ | ou LATAQUIE, & LATICHEZ, selon Maundrell, (Géog.) ville de Syrie, sur la côte, à 15 lieues de Tortose, & 30 d'Alep. C'est un reste de l'ancienne Laodicée sur la mer. Voyez LAODICEE, num. 3.
Le sieur Paul Lucas dit y avoir trouvé par-tout des colonnes sortant de terre presqu'à moitié, & de toutes sortes de marbre, il ajoute que tous les lieux des environs ne sont que plaines & collines plantées d'oliviers, de mûriers, de figuiers, & arbres semblables. Il y passe un bras de l'Oronte, qui arrose en serpentant une bonne partie du pays.
Cette ville a été rétablie par Coplan-Aga, homme riche & amateur du commerce, qui en a fait l'endroit le plus florissant de la côte. Long. 54. 25. lat. 35. 30. (D.J.)
|
| LATANIER | S. m. (Botan.) sorte de palmier des îles Antilles, & de l'Amérique équinoxiale. Il pousse une tige d'environ six à sept pouces de diametre, haute de 30 à 35 piés, & plus, toujours droite comme un mat, sans aucune diminution sensible. Le bois de cet arbre est roide & fort dur, mais il diminue de solidité en approchant du centre, n'étant dans cette partie qu'un composé mollasse de longues fibres qu'il est aisé de séparer du reste de l'arbre, lorsqu'il a été coupé & fendu dans sa longueur. Le sommet du latanier est enveloppé d'un rézeau composé d'une multitude de longs filets droits, serrés, & croisés par d'autres filets de même espece, formant un gros cannevas qui semble avoir été tissu de mains d'hommes, entre les circonvolutions de cette espece de toile, sortent des branches disposées en gerbe ; elles sont plates, extrèmement droites, fermes, lisses : d'un verd jaunâtre, longues d'environ trois piés & demi, larges à-peu-près d'un pouce, épaisses de deux ou trois lignes dans le milieu de leur largeur, & tranchantes sur les bords, ressemblant parfaitement à des lames d'espadon ; chaque branche n'est proprement qu'une longue queue d'une très-grande feuille qui dans le commencement ressemble à un éventail fermé, mais qui se développant ensuite, forme un grand éventail ouvert, dont les plis sont exactement marqués, & non pas un soleil rayonnant, ainsi que le disent les RR. PP. Dutertre & Labat, qui en ont donné des figures peu correctes.
Le tronc de l'arbre, après avoir été fendu & nettoyé de sa partie molle, comme on l'a dit ci-dessus, sert à faire de longues gouttieres ; on emploie les feuilles pour couvrir les cazes ; plusieurs de ces feuilles étant réunies ensemble, & leurs queues après avoir été fortement liées, composent des balais fort-commodes : on en fait aussi des especes de jolis parasols, en forme d'écrans ou de grands éventails que les Asiatiques peignent de diverses couleurs & les Caraïbes ou Sauvages des îles, se servent de la peau solide & unie des queues, pour en fabriquer le tissu de leurs ébichets, matatous, paniers, & autres petits meubles très-propres.
|
| LATENT | adj. (Jurisprud.) signifie occulte, & qui n'est pas apparent : on appelle vice latent celui qui n'est pas extérieur, & ne se connoît que par l'usage : par exemple, en fait de chevaux, la pousse, la morve, & la courbature sont des vices latens dont le vendeur doit la garantie pendant neuf jours.
Les servitudes latentes sont celles qui ne sont pas en évidence, comme un droit de passage. Il n'est pas nécessaire de s'opposer au decret pour des servitudes apparentes, telles que des rues & égouts, mais bien pour les servitudes latentes. Voyez DECRET & SERVITUDE. (A)
|
| LATÉRAL | adj. (Géom.) mot qui ne s'emploie guere qu'avec d'autres mots avec lesquels il forme des composés, comme équilatéral, &c. Ce mot vient de latus, côté, & il a rapport aux lignes qui forment la circonférence des figures. Voyez EQUILATERAL.
Une équation latérale dans les anciens auteurs d'algebre, est une équation simple ou qui n'est que d'une dimension, & n'a qu'une racine. Voyez EQUATION.
On ne dit plus équation latérale, on dit équation simple ou linéaire, ou du premier degré. (O)
LATERAL, droit de la tête. Voyez l'article DROIT.
LATERALE, paralysie LATERALE. Voyez PARALYSIE.
LATERALE, opération LATERALE. Voyez LITHOTOMIE.
Les sinus latéraux & la dure-mere sont comme deux branches du sinus longitudinal supérieur, qui vont l'une à droite & l'autre à gauche, le long de la grande circonférence de la tente du cervelet, jusqu'à la base de l'apophyse pierreuse des os des tempes ; delà ils descendent, en faisant d'abord un grand contour, & ensuite un petit, étant fortement attachés dans les grandes gouttieres latérales de la base du crane, & suivent la route de ces gouttieres jusqu'aux trous déchirés & aux fossettes des veines jugulaires. Voyez JUGULAIRE.
|
| LATERCULUM | (Littér.) ce terme signifioit, sous les empereurs de Rome, le rôle de tous les magistrats & officiers militaires, contenant l'état des fonctions de leurs charges, & des appointemens qui y étoient annexés ; l'origine de ce mot bizarre nous est inconnue. (D.J.)
|
| LATERE | (Jurisprud.) legat à latere. Voyez ci-après LEGAT.
|
| LATIAL | Latialis, (Littérat.) surnom de Jupiter, ainsi nommé du Latium, contrée d'Italie, où ce maître des dieux étoit singulierement honoré par des fêtes, des offrandes & des sacrifices. Voyez LATIAR. (D.J.)
|
| LATIAR | S. m. (Litterat.) c'est le nom de la fête instituée par Tarquin le superbe, en l'honneur de Jupiter Latial. Ce prince ayant fait un traité d'alliance avec les peuples du Latium, proposa dans le dessein d'en assurer la perpétuité, d'ériger un temple commun, où tous les alliés, les Romains, les Latins, les Herniques, & les Volsques s'assemblassent tous les ans pour y faire une foire, se régaler les uns les autres, & y célébrer ensemble des fêtes & des sacrifices ; telle fut l'origine du latiar. Tarquin n'avoit destiné qu'un jour à cette fête ; les premiers consuls en établirent un second après qu'ils eurent confirmé l'alliance avec les Latins ; on ajouta un troisieme jour lorsque le peuple de Rome, qui s'étoit retiré sur le mont sacré, fut rentré dans la ville, & finalement un quatrieme, après qu'on eut appaisé la sédition qui s'étoit élevée entre les Plébéïens & les Patriciens à l'occasion du consulat ; ces quatre jours étoient ceux qu'on nommoit Féries latines : & tout ce qui se faisoit pendant ces féries, fêtes, offrandes, sacrifices, tout cela s'appelloit latiar, dit Gronovius dans ses observations, liv. IV. c. xxv. (D.J.)
|
| LATICLAVE | S. m. (Littérat.) latus clavus, tunica laticlava ; tunique à large bordure de pourpre par-devant, & qui faisoit un habillement particulier de distinction & de dignité chez les Romains.
Tout le monde reconnoît que le laticlave étoit l'habit de marque de certaine magistrature ; mais il n'y a rien, en fait d'habits, sur quoi les savans soient si peu d'accord que sur la forme du laticlave & de l'angusticlave.
Les uns ont imaginé que le laticlave étoit une bande de pourpre entierement détachée des habits, qu'on la passoit sur le col, & qu'on la laissoit pendre tout du long par-devant & par-derriere, comme le scapulaire d'un religieux. D'autres ont pensé que c'étoit un manteau de pourpre qui couvroit seulement les épaules, comme les manteaux d'hermine de nos rois ; mais ces deux opinions sont également insoutenables. Indiquons-en une troisieme qui ait plus de vraisemblance ; & cela ne sera pas difficile.
On distinguoit chez les Romains plusieurs sortes de robes ou de tuniques, & entr'autres la tunique nommée tunica clavata. C'étoit une maniere de veste avec des bandes de pourpre, appliquées en forme de galon sur le devant, au milieu de la veste & dans toute sa longueur, desorte que quand la veste étoit fermée, ces deux bandes se joignoient & sembloient n'en faire qu'une. Si la bande étoit large, la tunique s'appelloit laticlave, latus clavus, tunica laticlavia. Si elle étoit étroite, la tunique prenoit le nom d'angusticlave, angustus clavus, tunica angusticlavia.
Ces deux sortes de tuniques qui servoient à distinguer les emplois parmi les gens de qualité, étoient opposées à celle qui étoit toute unie sans bandes, qu'on nommoit tunica recta, & dont l'usage n'étoit que pour les personnes qui n'avoient point de part à l'administration des affaires.
Il résulte de-là, que le laticlave étoit une large bordure de pourpre, cousue tout du long sur la partie de devant d'une tunique, ce qui la distinguoit de celle des chevaliers qui étoit à la vérité une bordure de la même couleur & de la même maniere, mais beaucoup plus étroite ; d'où vient qu'on l'appelloit angusticlave.
Plusieurs savans se sont persuadés que les bandes ou galons de ces tuniques étoient comme brochées de têtes de clous, quasi clavis intertextae ; cela peut être. Cependant M. Dacier qui n'est pas de cet avis, remarque pour le réfuter, que les anciens appelloient clavus, clou, tout ce qui étoit fait pour être appliqué sur quelque chose.
Ce qui est plus sûr, c'est qu'on a confondu à tort, le laticlave avec la prétexte, peut-être parce que la prétexte avoit un petit bordé de pourpre ; mais outre que ce bordé de pourpre régnoit tout-au-tour, il est certain que ces deux robes étoient différentes à d'autres égards, & même que la prétexte se mettoit sur le laticlave. Varron l'a dit quelque part ; d'ailleurs on sait que quand le préteur prononçoit un arrêt de mort, il quittoit la prétexte & prenoit la robe laticlave.
Elle se portoit sans ceinture, & étoit un peu plus longue que la tunique ordinaire, c'est pourquoi Suétone observe comme une chose étrange que Cesar ceignoit son laticlave, " Il étoit, dit cet historien, fort singulier dans ses habits ; son laticlave avoit de longues manches avec des franges au bout ; il se ceignoit toujours, & toujours sa ceinture étoit lâche, ce qui donna lieu à ce mot de Sylla, qu'il avertissoit les grands de se donner garde du jeune homme mal-ceint, ut malè 'praecinctum puerum caverent. "
Comme les sénateurs avoient droit de porter le laticlave, le même Suétone remarque qu'on les appelloit d'un seul nom laticlavii. Les consuls, les préteurs, & ceux qui triomphoient jouissoient aussi de cette décoration : Isidore nous apprend que sous la république, les fils des sénateurs n'en étoient honorés qu'à l'âge de 25 ans ; César fut le premier qui ayant conçu de grandes espérances d'Octave son neveu, & voulant l'élever le plutôt possible au timon de l'état, lui donna le privilege du laticlave avant le tems marqué par les lois.
Octave étant parvenu à la suprème puissance, crut à son tour devoir admettre de bonne heure les enfans des sénateurs dans l'administration des affaires ; pour cet effet, il leur accorda libéralement la même faveur qu'il avoit reçue de son oncle. Par ce moyen, le laticlave devint sous lui l'ordre de l'empereur ; il en revêtoit à sa volonté les personnes qu'il lui plaisoit, magistrats, gouverneurs de provinces, & les pontifes mêmes.
Sacrificam lato vestem distinguere clavo.
Il paroît que, sous ses successeurs, les premiers magistrats des colonies & des villes municipales obtinrent la même grace. Ensuite les Césars la prodiguerent à toutes leurs créatures & à quantité de chevaliers.
Enfin, les dames à leur tour ne furent point privées de cette décoration, qui passa même jusqu'aux étrangeres : Flavius Vopiscus nous rapporte qu'Aurélien fit épouser à Bonosus, l'un de ses capitaines, Humila, belle & aimable princesse. Elle étoit prisonniere, & d'une des plus illustres familles des Goths ; les frais de la noce furent pris sur l'épargne publique. Le prince voulut avoir le soin d'en régler les habits, & parmi des tuniques de toute espece, il ordonna pour cette dame celle du laticlave, tunicam auro clavatam.
Rubens (Albert) en latin Rubenius, fils du célebre Rubens, a écrit un traité plein d'érudition sur le laticlave & l'angusticlave, de latoclavo & angusticlavo tractatus. On soupçonne que M. Graevius qui a mis ce petit ouvrage au net & au jour, n'en partage pas le moindre honneur. (D.J.)
|
| LATICZOW | (Géog.) ville de Pologne dans la Podolie, sur la riviere de Bug, avec une châtellenie.
|
| LATINS | EMPIRE DES, (Hist. mod.) on nomme ainsi l'espece d'empire que les Croisés fonderent en 1204, sous le regne d'Alexis Comnène ; en s'emparant de Constantinople, où depuis long-tems régnoit un malheureux schisme qui avoit mis une haine implacable entre les nations des deux rites. L'ambition, l'avarice, un faux zele déterminerent les François & les Italiens à se croiser contre les Grecs au commencement du xiij. siecle.
L'objet des Croisés, dit M. Hainaut, étoit la délivrance de la Terre-sainte ; mais comme en effet ils ne cherchoient que des avantures, ils fonderent, chemin faisant, l'empire des Latins ; & les François étant maîtres de Constantinople, éleverent, pour empereur des Grecs, Baudouin comte de Flandres, dont les états éloignés ne pouvoient donner aucune jalousie aux Italiens. Alors, laissant l'expédition de la Terre-sainte, ils tenterent de maintenir dans l'obéissance l'empire qu'ils venoient de conquérir, & qu'on appella l'empire des Latins ; empire qui ne dura que 58 ans.
Au bout de ce tems-là, les Grecs se révolterent, chasserent les François, & élurent pour empereur, Michel Paléologue. Ainsi fut rétabli l'empire grec, qui subsista près de 200 ans jusqu'au regne de Mahomet II. Ce foudre de guerre prit Constantinople le 29 Mai 1455, conquit Trébizonde, se rendit maître de douze royaumes, emporta plus de deux cent villes, & mourut à 51 ans, au moment qu'il se proposoit de s'emparer de l'Egypte, de Rhodes & de l'Italie. (D.J.)
LATIN, (Maréch.) piquer en latin. Voyez PIQUER.
LATINE, (Eglise) est la même chose que l'église romaine ou l'église d'occident, par opposition à l'église grecque ou église d'orient. Voyez EGLISE GRECQUE.
LATINS dans l'histoire ecclésiastique, sur-tout depuis le ix siecle & le schisme des Grecs, signifie les Catholiques romains répandus en occident. On travailla à la réunion des Latins & des Grecs dans les conciles de Lyon & de Florence. Du tems des croisades, les Latins s'emparerent de Constantinople & y dominerent plus de soixante ans sous des empereurs de leur communion. On nommoit ainsi les Catholiques d'occident, parce qu'ils ont retenu dans l'office divin l'usage de la langue latine.
LATINE, langue. Voyez l'article LANGUE.
LATINE, (Marine) voile latine, voile à oreille de lievre, voile à tiers point. Cette sorte de voiles est fort en usage sur la Méditerranée ; elles sont en triangle ; les galeres n'en portent point d'autres. Voyez au mot VOILES.
|
| LATITER | (Jurisprud.) en termes de pratique, signifie cacher & receler une personne ou quelques effets : on dit d'un débiteur, qu'il se latite, lorsqu'il se cache de crainte d'être arrêté ; on dit aussi d'une veuve ou d'un héritier, qu'ils ont caché & latité quelques effets de la communauté ou succession du défunt, lorsqu'ils ont commis quelque recelé. Voyez DIVERTISSEMENT & RECELE. (A)
|
| LATITUDE | S. f. (Géogr.) la latitude marque la distance d'un lieu à l'équateur, ou l'arc du méridien, compris entre le zénith de ce lieu & l'équateur. La latitude peut donc être ou septentrionale ou méridionale, selon que le lieu, dont il est question, est situé en-deçà ou au-delà de l'équateur ; savoir en-deçà, dans la partie septentrionale que nous habitons, & au-delà, dans la partie méridionale. On dit, par exemple, que Paris est situé à 48 degrés 50 minutes de latitude septentrionale.
Les cercles paralleles à l'équateur sont nommés paralleles de latitude, parce qu'ils font connoître les latitudes des lieux au moyen de leur intersection avec le méridien. Voyez PARALLELE.
Si l'on conçoit un nombre infini de grands cercles qui passent tous par les poles du monde, ces cercles seront autant de méridiens ; & par leur moyen on pourra déterminer, soit sur la terre, soit dans le ciel, la position de chaque point par rapport au cercle équinoxial, c'est-à-dire la latitude de ce point.
Celui de ces cercles qui passe par un lieu marqué de la terre, est nommé le méridien de ce lieu, & c'est sur lui qu'on mesure la latitude du lieu. Voyez MERIDIEN.
La latitude d'un lieu & l'élévation du pole sur l'horison de ce lieu sont des termes dont on se sert indifféremment l'un pour l'autre, parce que les deux arcs qu'ils désignent, sont toujours égaux. Voyez POLE & ÉLEVATION.
Ceci paroîtra facilement par la Pl. d'Astron. fig. 5. où le cercle H Z Q représente le méridien, H O l'horison, A Q l'équateur, Z le zénith ; & P le pole.
La latitude du lieu, ou sa distance de l'équateur, est ici l'arc Z A, & l'élévation du pole ou la distance du pole à l'horison est l'arc P O ; mais l'arc P A, compris entre le pole & l'équateur, est un quart de cercle, & l'arc Z O, compris entre le zénith & l'horison, en est aussi un. Ces deux arcs P A, Z O, sont donc égaux, & ainsi ôtant de chacun d'eux la partie Z P qui leur est commune, il restera l'arc Z A, égal à l'arc P O, c'est-à-dire la latitude du lieu égale à l'élévation du pole sur l'horison de ce lieu.
On tire de-là une méthode pour mesurer la circonférence de la terre, ou pour déterminer au-moins la quantité d'un degré sur sa surface en la supposant sphérique. En effet, il n'y a qu'à aller directement du sud au nord, ou du nord au sud, jusqu'à ce que le pole se soit élevé ou abaissé d'un degré, & mesurant alors l'intervalle compris entre le terme d'où on sera parti, & celui où on sera arrivé, on aura le nombre de milles, de toises &c. que contient un degré du grand cercle de la terre. C'est ainsi que Fernel, médecin de Henri II, mesura un degré de la terre ; il alla de Paris vers le nord en voiture, en mesurant le chemin par le nombre des tours de roue, & retranchant de la quantité de chemin une certaine portion, à cause des détours de la voiture & des chemins, il détermina par cette opération le degré à environ 57000 toises, & ce calcul grossier est celui qui s'approche le plus du calcul exact fait par l'Académie. Au reste, comme la terre n'est pas sphérique, il est bon de remarquer que tous les degrés de latitude ne sont pas égaux, & la comparaison exacte de quelques-uns de ces degrés peut servir à déterminer la figure de la terre. Voyez DEGRE & FIGURE DE LA TERRE.
Il s'agit maintenant de savoir comment on détermine la latitude, ou, ce qui revient au même, la hauteur ou l'élévation du pole.
Cette connoissance est de la plus grande conséquence en Géographie, en Navigation & en Astronomie ; voici les moyens de la déterminer tant sur terre que sur mer.
Comme le pole est un point mathématique, & qui ne peut être observé par les sens, sa hauteur ne sauroit non plus être déterminée de la même maniere que celle du soleil & des étoiles, & c'est pourquoi on a imaginé un autre moyen pour en venir à bout.
On commence par tirer une méridienne. Voyez au mot MERIDIENNE, la méthode qu'il faut suivre pour cela.
On place un quart de cercle sur cette ligne, de façon que son plan soit exactement dans celui du méridien : on prend alors quelque étoile voisine du pole, & qui ne se couche point, par exemple, l'étoile polaire, & on en observe la plus grande & la plus petite hauteur. Voyez QUART DE CERCLE.
Supposons, par exemple, que la plus grande hauteur fût désignée par S O, & que la plus petite fût s O ; la moitié P S ou P s de la différence de ces deux arcs étant ôtée de la plus grande hauteur S O, ou ajoutée à la plus petite s O, donneroit P O la hauteur du pole sur l'horison, qui est, comme on l'a dit, égale à la latitude du lieu. On peut aussi trouver la latitude en prenant avec un quart de cercle, ou un astrolabe, ou une arbalestrille, &c. voyez ces mots, la hauteur méridienne du soleil ou d'une étoile. En voici la méthode.
Il faut d'abord observer la distance méridienne du soleil au zénith, laquelle est toujours le complément de la hauteur méridienne du soleil : & cela fait, il pourra arriver deux cas, ou bien que le soleil & le zénith du lieu se trouvent placés de différens côtés de l'équateur ; en ce cas, pour avoir la latitude, il faudra toujours soustraire la déclinaison connue du soleil de sa distance au zénith : ou bien le soleil & le zénith se trouveront placés du même côté de l'équateur, & alors il pourroit arriver encore que la déclinaison du soleil doive être ou plus grande ou plus petite que la latitude, ce qu'on reconnoîtra en remarquant si le soleil à midi se trouve plus près ou plus loin que le zénith du pole qui est élevé sur l'horison. Si la déclinaison est plus grande, comme il arrive souvent dans la zone-torride, alors il faudra pour avoir la latitude, soustraire de la déclinaison du soleil la distance de cet astre au zénith du lieu ; mais si la déclinaison du soleil doit être plus petite que la latitude, (le soleil & le zénith étant toûjours supposés d'un même côté de l'équateur) dans ce dernier cas, pour avoir la latitude, il faudra ajouter la déclinaison du soleil à la distance de cet astre au zénith.
Si le soleil ou l'étoile n'ont point de déclinaison, ou, s'agissant du soleil, si l'observation se fait un jour où cet astre se meuve dans l'équateur, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe, alors l'élévation de l'équateur deviendra égale à la hauteur méridienne de l'astre, & par conséquent cette hauteur sera nécessairement le complément de la latitude.
Cette derniere méthode est plus propre aux usages de la navigation, par ce qu'elle est plus praticable en mer ; mais la premiere est préférable sur terre.
La connoissance de la latitude donne le moyen de monter le globe horisontalement pour un lieu, c'est-à-dire de terminer l'horison de ce lieu, pour répondre aux questions qu'on peut faire sur l'heure actuelle, sur le lever ou le coucher du soleil dans cet horison un tel jour de l'année ; sur la durée des jours, des nuits, des crépuscules. On demande, par exemple, quelle heure il est à Tornéo de Laponie, lorsqu'il est midi à Paris le 10 Mai. Après avoir attaché sur le méridien le petit cercle horaire avec son aiguille, j'amene Tornéo sous le méridien, le trouvant à 66 1/2 d. de latitude, je donne au pole autant d'élévation, je cherche dans le calendrier de l'horison le 10 Mai, & j'apperçois qu'il répond au 19 degré du lion. J'amene sous le méridien ce point du ciel, que je remarque avec soin, & sous lequel est actuellement le soleil. Si après avoir appliqué l'aiguille horaire sur midi, c'est-à-dire sur la plus élevée des deux figures marquées XII. je fais remonter le globe à l'orient ; au moment que le 19 degré de l'écliptique joindra l'horison, l'aiguille horaire montrera deux 1/2 heures pour le lever du soleil sur cet horison. Le même point conduit de-là au méridien, & du méridien au bord occidental de l'horison, exprimera la trace ou l'arc diurne du soleil sur l'horison de Tornéo : l'aiguille horaire marquera 9 1/2 heures au moment que le 19 degré du taureau descendra sous l'horison. J'apprens ainsi sur le champ, que la durée du jour le 10 Mai, est de 19 heures à Tornéo, & la nuit de cinq. La connoissance de la latitude d'un lieu donne encore celle de l'élévation de l'équateur pour l'horison de ce lieu. Le globe monté horisontalement pour Paris, vous avez 49 degrés de distance entre le pole & l'horison, comme vous les avez en latitude entre l'équateur & le zénith ; or du zénith à l'horison, il n'y a que 90 degrés de part & d'autre. Si de ces 90 vous retranchez les 49 de latitude, il reste 41, nombre qui exprime la hauteur de l'équateur sur l'horison de Paris. La hauteur de l'équateur sur l'horison est donc ce qui reste depuis la hauteur du pole jusqu'à 90. Spectacle de la Nature, tome IV. pag. 400. Voyez GLOBE.
LATITUDE, en Astronomie, est la distance d'une étoile ou d'une planete à l'écliptique ; ou c'est un arc d'un grand cercle perpendiculaire à l'écliptique, passant par le centre de l'étoile.
Pour mieux entendre cette notion, il faut imaginer une infinité de grands cercles qui coupent l'écliptique à angles droits, & qui passent par ses poles. Ces cercles s'appellent cercles de latitude, ou cercles secondaires de l'écliptique ; & par leur moyen, ou peut rapporter à l'écliptique telle étoile ou tel point du ciel qu'on voudra, c'est-à-dire déterminer le lieu de cette étoile ou de ce point par rapport à l'écliptique ; c'est en quoi la latitude differe de la déclinaison qui est la distance de l'étoile à l'équateur, laquelle se mesure sur un grand cercle qui passe par les poles du monde & par l'étoile, c'est-à-dire qui est perpendiculaire non pas à l'écliptique, mais à l'équateur. Voyez DECLINAISON.
Ainsi la latitude géographique est la même chose que la déclinaison astronomique, & elle est fort différente de la latitude astronomique.
La latitude géocentrique d'une planete, Pl. astr. fig. 26. est un angle connu P, T, R, sous lequel la distance de la planete à l'écliptique P, R, est vue de la terre T.
Le soleil n'a donc jamais de latitude, mais les planetes en ont, & c'est pour cela que dans la sphere on donne quelque largeur au zodiaque ; les anciens ne donnoient à cette largeur que six degrés de chaque côté de l'écliptique ou 12 degrés en tout ; mais les modernes l'ont poussée jusques à neuf degrés de chaque côté, ce qui fait dix-huit degrés en total.
La latitude héliocentrique d'une planete est l'angle P S R, sous lequel elle est vue du soleil S, la ligne R S, étant supposée dans le plan de l'écliptique, la plus grande latitude héliocentrique d'une planete est égale à l'inclinaison de l'orbite de cette planete avec l'écliptique. Cette latitude ou inclinaison à-peu-près constante à quelques petites altérations près, qui viennent de l'action des planetes les unes sur les autres. Voyez NEWTONIANISME, LUNE, &c.
Quand on a dit ci-dessus que le soleil n'a point de latitude, cela ne doit pas s'entendre à la rigueur ; car si on suppose un plan fixe qui passe par le soleil & par la terre, lorsqu'elle est dans une position quelconque, & qu'on pourra appeller le plan de l'écliptique, le soleil, ou plutôt la terre, aura un mouvement en latitude par rapport à ce plan. Voyez l'article ECLIPTIQUE à la fin.
Pour trouver la latitude & la longitude d'une étoile. Voyez l'article LONGITUDE.
Quand les planetes n'ont point de latitude, on dit qu'elles sont alors dans les noeuds de l'écliptique, ce qui veut dire dans l'intersection de leur orbite avec celle du soleil ; & c'est dans cette situation qu'elles peuvent souffrir des éclipses, ou être cachées par le soleil, ou bien passer sur son disque. Voyez NOEUD & ECLIPSE.
Cercle de latitude, est un grand cercle quelconque, qui passe par les poles de l'écliptique.
Latitude septentrionale ascendante de la lune, se dit de la latitude de cet astre lorsqu'il va de son noeud ascendant vers sa limite septentrionale, ou sa plus grande élongation. Voyez LIMITE, LUNE, &c.
Latitude septentrionale descendante, c'est celle qu'a la lune lorsqu'elle retourne de sa limite septentrionale à son noeud descendant.
Latitude méridionale descendante, c'est celle qu'a la lune, lorsqu'elle va de son noeud descendant à sa limite méridionale.
Enfin latitude méridionale ascendante, se dit de la lune, lorsqu'elle retourne de sa limite méridionale à son noeud ascendant.
Et les mêmes termes ont lieu à l'égard des autres planetes. Voyez ASCENDANT & DESCENDANT.
Il y a dans les Transactions philosophiques quelques observations du docteur Halley, qui peuvent servir à prouver que les latitudes de quelques étoiles fixes s'alterent à la longue, en particulier celles de Polilicium, de Sirius, Arcturus, d'où quelques astronomes concluent qu'il en peut être de même des autres étoiles, quoique leurs variations puissent être moins remarquables, parce qu'on les suppose à une plus grande distance de nous.
Ce qu'on peut assurer en général, c'est que la latitude de la plûpart des étoiles fixes, ou leur distance écliptique, est sensiblement constante, au moins dans un certain nombre de siecles, sauf les petites irrégularités qui viennent de la nutation de l'axe de la terre. Voyez NUTATION & ECLIPTIQUE.
Parallaxe de latitude, voyez PARALLAXE.
Réfraction de latitude, voyez REFRACTION. Chambers. (O)
|
| LATITUDINAIRE | S. m. f. du latin latus, large, ou latitudo, largeur, (Théol.) nom que les Théologiens donnent à une certaine espece de Tolérans, qui applanissent & facilitent extrêmement le chemin du ciel à tous les hommes, & qui ne veulent pas que la différence de sentimens en fait de religion soit une raison pour en exclure les sectaires même les moins soumis à l'Evangile. Le ministre Jurieu entr'autres étoit de ce nombre, comme il paroit par l'ouvrage que Bayle a publié contre lui sous le titre de janua coelorum omnibus reserata ; la porte du ciel ouverte à tous. Voyez ADIAPHORISTE & TOLERANCE. (G)
|
| LATIUM LE | (Géog. anc.) c'est-à-dire le pays des Latins ; mais heureusement nous avons plus accoutumé nos yeux & nos oreilles au mot même qu'à la périphrase. Le Latium est une contrée de l'ancienne Italie, située au levant du Tibre, & au midi du Téverone, aujourd'hui Anio.
Ovide nous dit d'après la Fable, que Saturne ayant été chassé du ciel par son fils Jupiter, se tint caché quelque tems dans cette contrée d'Italie, & que du mot latere, se cacher, étoit venu le nom de Latium, & celui de Latini, que prirent le pays & les habitans. Mais Varron aime mieux tirer l'origine du mot Latium, de ce que ce pays est en quelque façon caché entre les précipices des Alpes & de l'Appennin ; & quant aux Latins, ils dérivent leur nom du roi Latinus, que Virgile a ingénieusement supposé beau-pere d'Enée, pour lui faire jouer un grand rôle dans son Enéïde.
Rien n'est plus obscur ni plus incertain que l'ancienne histoire du Latium, quoique Denis d'Halicarnasse ait fait tous ses efforts pour la débrouiller, & réduire les fables ainsi que les traditions populaires à des vérités historiques.
Strabon prétend que l'ancien Latium renfermoit un très-petit pays, qui s'accrut insensiblement par les premieres victoires de Rome contre ses voisins ; desorte que de son tems le Latium comprenoit plusieurs peuples qui n'appartenoient point à l'ancien Latium, comme les Rutules, les Volsques, les Eques, les Herniques, les Aurunces ou Ausones, jusqu'à Sinuesse, c'est-à-dire une partie de la terre de Labour, jusqu'au couchant du golfe de Gaëte.
Il faut donc distinguer le Latium ancien du Latium nouveau ou augmenté. Les Rutules, les Volsques, les Eques, les Herniques, les Aurunces exclus de l'ancien Latium, sont compris dans le second ; & ni l'un ni l'autre Latium ne quadre exactement avec ce que nous appellons la campagne de Rome, quoi qu'en disent Ortelius & les modernes qui l'ont copié. L'ancien Latium est trop petit pour y répondre, & le second est trop grand, puisque le Liris aujourd'hui le Garillan, y naissoit & n'en sortoit point depuis ses sources jusqu'à son embouchure. On juge bien que dans l'Enéïde il n'est question que de l'ancien Latium pris dans sa plus petite étendue. Virgile le surnomme Hesperium, mais Horace l'appelle ferox, féroce.
Il faut convenir que jamais épithete n'a mieux peint l'ancien Latium que celle d'Horace, s'il est vrai qu'autrefois on y sacrifioit tous les ans deux hommes à Saturne, & qu'on les précipitoit dans le Tibre de la même maniere que les Leucadiens précipitoient un criminel dans la mer. C'est Ovide qui nous rapporte cette tradition ; ensuite il ajoûte qu'Hercule ayant été témoin de ce sacrifice en passant par le Latium, n'en put soutenir la cruauté, & qu'il fit substituer des hommes de paille à de véritables hommes. (D.J.)
|
| LATMICUS SINUS | (Géog. anc.) golfe de la mer Méditerranée sur la côte d'Asie, aux confins de l'Ionie & de la Carie ; on le nomme à présent le golfe de Palatchia. (D.J.)
|
| LATMOS | (Géog. anc.) ancienne ville de l'Ionie dans l'Asie mineure. Elle fut du nombre de celles qui brisa ses chaînes lors de la défaite de Xerxès par les Grecs sous les ordres de Miltiade ; mais Artémise, reine de Carie, s'en rendit maîtresse par un de ces stratagèmes que la politique autorise, & que l'honneur & la probité condamnent très justement. La mort de cette reine & les mauvais succès des Grecs dans l'Asie, fournirent à la ville de Latmos les moyens de recouvrer son ancienne liberté. Elle la maintint quelque tems par son courage, & ne la perdit une seconde fois, qu'en se laissant tromper par les artifices de Mausole. (D.J.)
LATMOS ou LATMUS, (Géog. anc.) montagne d'Asie, partie dans l'Ionie, & partie dans la Carie. Pomponius Mela, l. I. c. xvij, dit qu'elle étoit célebre par l'avanture fabuleuse d'Endymion, pour qui la Lune eut de l'amour. De-là vient qu'il est nommé latmius heros par Ovide, Trist. l. II. v. 299. & latmius venator, par Valerius Flaccus, l. VIII. v. 28. Le nom moderne de cette montagne est Palatchia selon M. Baudrand. (D.J.)
|
| LATOBIUS | (Littér.) nom d'un dieu des anciens Noriques, qu'on suppose être le dieu de la santé. Quoiqu'il en soit, il n'en est parlé que dans deux inscriptions de Gruter trouvées en Carinthie ; l'une de ces inscriptions, est un voeu qu'une mere fait pour la santé de son fils & de sa fille, en ces mots : Latobio sac. pro salute Nam. Sabiniani & Julitae Babilloe Vindona mater, V. S. L. L. M. Nous n'avons aucun autre monument qui nous instruise du dieu Latobius, & nous ignorons si ce mot est grec, latin ou sclavon. (D.J.)
|
| LATOBRIGES | Les, en latin Latobrigi & Latobrici, (Géogr. anc.) ancien peuple de la Gaule au voisinage des Helvétiens. Quelques critiques les ont placés à Lausanne, d'autres dans le Vallais, & d'autres dans le Kletgow ; mais Nicolas Sanson les met avec plus d'apparence, près de Rauraci, peuple aux environs de Bâle, & des Tulingi, peuple du pays de Duttlingen. Dans cette supposition, il estime que les Latobrigi ne se peuvent mieux choisir que pour le Brisgaw contigu au territoire de Bâle, & à celui de Duttlingen. Sanson ajoute que son sentiment s'accorde à l'ordre de César, quand il parle des peuples auxquels les Helvétiens avoient persuadé de quitter le pays, & d'en chercher un plus avant dans les Gaules, & qui fut hors des courses continuelles des Germains : persuadent Rauracis, Tulingis & Latobrigis finitimis suis, ut eodem usi consilio, oppidis suis vicisque exustis, unà cum iis proficiscantur. " Ils persuadent à ceux de Bâle, de Duttlingen & de Brisgaw leurs voisins, de suivre le même conseil, & de se joindre avec eux après avoir brûlé toutes leurs villes & leurs bourgades ". (D.J.)
|
| LATOMIES | S. f. pl. (Géog. histor.) chez les Latins latomiae, mot qu'ils emprunterent des Grecs, pour signifier un lieu où l'on coupoit les pierres. Comme ce nom devint commun à toutes les grandes carrieres, il arriva que les anciens nommerent latomies divers endroits de l'Italie, de la Sicile, de l'Afrique, &c. En effet les latomies de Sicile étoient d'abord une carriere ; mais elles devinrent fameuses parce que les tyrans du pays en firent une prison, dans laquelle ils envoyoient ceux qui avoient le malheur de leur déplaire. Ces prisonniers y demeuroient quelquefois si long-tems, que quelques-uns s'y sont mariés. Celle que Denys tyran de Syracuse, fit creuser dans le roc, avoit un stade de long, sur deux cent pas de large. Le poëte Philoxene y fut mis par ordre de ce prince, pour n'avoir pas approuvé ses vers ; & l'on croit que ce fut là qu'il composa sa piece sanglante, intitulée le Cyclope. Cicéron reproche à Verrès d'avoir fait enfermer dans cette même prison des citoyens romains : cet endroit s'appelle aujourd'hui le Tagliate. (D.J.)
|
| LATONE | S. f. (Mythol.) déesse du paganisme sur laquelle je serai très-court ; son histoire est fort cachée, & répond à l'étymologie qu'on donne du nom de cette divinité. On sait qu'Hésiode la fait fille du Titan Coëus & de Phébé sa soeur. La fable ajoûte qu'elle eut de Jupiter Apollon & Diane, qui lui valurent une place dans le ciel, malgré la haine de Junon. Les autres avantures de cette déesse se trouvent dans Ovide, Apollodore, Noël le Comte & ailleurs.
Latone étoit hyperboréenne selon Diodore de Sicile ; Hérodote la fait égyptienne, & pourroit bien avoir raison : car il semble que les Grecs n'ont fait que déguiser sous le nom de Latone une histoire véritable des Egyptiens. Il est certain qu'elle avoit un culte & un oracle très-respecté dans la ville de Buto en Egypte. Les habitans de Delos lui bâtirent un temple, mais celui qu'elle eut dans Argos l'emporta de beaucoup par la magnificence, outre que sa statue étoit l'ouvrage de Praxiteles. Les Tripolitains & les Gaulois lui rendirent aussi de grands honneurs. Elle avoit part aux jeux apollinaires, où on lui sacrifioit une génisse aux cornes dorées ; enfin Latone, Diane & Vénus devinrent les trois divinités les plus vénérées chez les Romains par le beau sexe ; elles faisoient toutes trois la matiere la plus ordinaire de leurs cantiques. (D.J.)
|
| LATONÉ | (Géog.) ville d'Egypte sur le Nil, selon Ptolomée, l. IV. c. 5. Le nom grec est , c'est-à-dire la ville de Latone, parce que Latone mere d'Apollon y avoit un temple & un culte particulier. Elle étoit la capitale d'un nome qui en prenoit le nom de Latapolite, Latapalites nomos. On croit que cette ville est présentement Dérote. (D.J.)
|
| LATONIGENE | (Mythol.) Latonigena, Ovide, Seneque ; épithete d'Apollon & de Diane, nés de Latone & de Jupiter selon la fable. (D.J.)
|
| LATOVICI | (Géogr. anc.) ancien peuple de la haute Pannonie. Antonin place praetorium Latovicorum sur la route d'Aemona à Sirmich ; cette position répond aux environs du confluent de la Save & de la Sane. (D.J.)
|
| LATOWITZ | (Géog.) ville & château du royaume de Pologne, à peu de distance de Varsovie.
|
| LATRAN | (Théol.) originairement nom propre d'homme, de Plautius Lateranus consul désigné, que Néron fit mourir, qui a passé dans la suite à un ancien palais de Rome, que Constantin, selon Baronius, donna au pape Melchiade, & aux bâtimens que l'on a faits à sa place, sur-tout à l'église de saint Jean de Latran qui est le principal siége de la papauté. Voyez PAPE.
On appelle conciles de Latran ceux qui se sont tenus à Rome dans la basilique de Latran en 1123, 1139, 1179, 1215 & 1513. Voyez CONCILE.
Chanoines réguliers de la congrégation de saint Sauveur de Latran, est une congrégation de chanoines réguliers dont l'église de saint Jean de Latran étoit le chef-lieu.
On prétend qu'il y a eu depuis les apôtres une succession non-interrompue de clercs vivans en commun ; & que c'est de ces clercs que les papes établirent à saint Jean de Latran après que Constantin l'eût fait bâtir. Mais ce ne fut que sous Léon I. vers le milieu du viij siecle, que les chanoines réguliers commencerent à vivre en commun. Ils posséderent cette église pendant 800 ans jusqu'à Boniface VIII. qui la leur ôta l'an 1294 pour y mettre des chanoines réguliers ; Eugene IV les y rétablit 150 ans après. Voyez le Dictionnaire de Trévoux.
|
| LATRIE | S. f. terme de Théologie. Culte de religion qui n'appartient qu'à Dieu seul. Voyez CULTE, ADORATION.
Les Chrétiens adorent Dieu d'un culte de latrie ; ils honorent les saints d'un culte de dulie. On confond quelquefois les termes honorer, adorer. Voyez SAINT, RELIQUE, &c.
Cette adoration intérieure que nous rendons à Dieu en esprit & en vérité a ses marques extérieures, dont la principale est le sacrifice qui ne peut être offert qu'à Dieu seul, parce que le sacrifice est établi pour faire un aveu public & une protestation solemnelle de la souveraineté de Dieu, & de notre dépendance de lui. Voyez SACRIFICE.
M. Daillé est convenu que les peres du iv. siecle ont reconnu la distinction que nous faisons de latrie & de dulie. Dictionnaire de Trevoux.
|
| LATRINE | S. f. (Littér.) latrina, ae, dans Varron ; lieu public chez les Romains, où alloient ceux qui n'avoient point d'esclave pour vuider ou pour laver leurs bassins. On ne trouve point dans les écrits ni dans les bâtimens qui nous sont restés des anciens, qu'ils eussent dans leurs maisons des fosses à privés, telles que nous en avons aujourd'hui.
Leurs lieux publics, & il y en avoit plusieurs de cette espece à Rome, étoient nommés latrinae ou lavatrinae, de lavando, selon l'étymologie de Varron : Plaute se sert aussi du mot latrinae pour désigner le bassin ; car il parle de la servante qui lave le bassin, quae latrinam lavat. Or dans ce passage du poëte, latrina ne peut être entendu de la fosse à privé des maisons, puisqu'il n'y en avoit point, ni de la fosse des privés publics, puisqu'elle étoit nettoyée par des conduits souterreins, dans lesquels le Tibre passoit.
Non-seulement les latrines publiques étoient en grand nombre à Rome, mais de plus on les avoit en divers endroits de la ville pour la commodité. On les nommoit encore très-bien sterquilinia ; elles étoient couvertes & garnies d'éponges comme nous l'apprenons de Seneque dans ses épîtres.
On avoit pour la nuit l'avantage des eaux coulantes dans toutes les rues de Rome, où l'on jettoit les ordures ; mais les riches avoient pour leur usage des bassins, que les bas esclaves alloient vuider à la brune dans les égoûts, dont toutes les eaux se rendoient au grand cloaque, & de-là dans le Tibre. (D.J.)
|
| LATRIS | (Géog. anc.) isle de la Germanie, à l'embouchure de la Vistule, selon Pline, liv. IV. ch. xiij. Niger croit que c'est le grand Werder-Groszwerder, isle auprès de Dantzig. Ortelius pense que c'est Frischnarung ; enfin le P. Hardouin estime que c'est l'isle d'Oësel, & il explique le Cylipenus sinus de Pline par le golfe de Riga. (D.J.)
|
| LATRUNCULI | (Littérat.) On nommoit latrunculi un jeu des soldats, fort en vogue à Rome du tems des empereurs, & qui ne dépendoit point du hasard, mais de la science des joueurs. On s'y servoit de certaines figures, qu'on arrangeoit sur une espece de damier comme on fait les échecs, avec lesquels quelques auteurs ont confondu ce jeu mal-à-propos ; je dis mal-à-propos, car les échecs sont de l'invention des Indiens, qui porterent en Perse ce nouveau jeu au commencement du vj. siecle. Voyez ECHECS, (jeu des) (D.J.)
|
| LATSKY | (Géog.) ville de Pologne, dans le palatinat de Russie.
|
| LATTE | S. f. (Art méchaniq.) c'est un morceau de bois de chêne, coupé de fente dans la forêt sur peu de largeur, peu d'épaisseur, & quatre à cinq piés de longueur. La latte fait partie de la couverture des maisons ; elle s'attache sur les chevrons, & sert d'arrêt & de soutien à l'ardoise, à la tuile, & autres matieres qui forment le dessus des couvertures. La latte pour l'ardoise s'appelle volice ; celle qu'on met aux pans de charpente pour recevoir & tenir un enduit de plâtre, s'appelle latte jointive. Toute latte doit être sans aubier. Il y en a 25 à la botte. La contrelatte se dit de la latte attachée en hauteur sur la latte, & la coupant à angle droit ou oblique. La latte de fente est celle qui est mise en éclat avec l'instrument tranchant ; la latte de sciage est celle qui est taillée à la scie.
On appelle encore latte les échelons des ailes des moulins à vent sur lesquels la toile est tendue. Du mot latte on a fait le verbe latter.
LATTES, (Marine) petites pieces de bois fort minces, qu'on met entre les baux, les barrats & les barratins du vaisseau.
Lattes de caillebotis ; ce sont de petites planches resciées qui servent à couvrir les barratins des caillebotis.
Lattes de gabarit ; ce sont des lattes qui servent à former les façons d'un vaisseau auquel elles donnent la rondeur ; elles sont minces & ovales en tirant de l'avant vers le milieu, quarrées au milieu, & rondes par l'avant, & aux flutes, elles ont cette derniere forme à l'avant & à l'arriere.
Lattes de galeres ; traverses ou longues pieces de bois qui soutiennent la couverte des galeres.
LATTE A ARDOISE, autrement LATTE VOLICE, doit être de chêne de bonne qualité, comme celle de la tuile. Elle est attachée de même sur quatre chevrons. Une botte de latte fait environ une toise & demie de couverture.
Contrelatte à ardoise est de bois de sciage, & se met au milieu de l'entredeux des chevrons, & est attachée à la latte.
LATTES, (Couvreur) petites pieces de bois dont se servent les Couvreurs pour mettre sous les tuiles pour les tenir sur la charpente des combles des maisons.
Latte quarrée doit être de coeur de bois de chêne, sans aubier, est celle dont les Couvreurs se servent pour la tuile ; elle doit porter sur quatre chevrons & être attachée avec quatre clous : c'est ce qu'on appelle des quatre à la latte.
Contrelatte est une latte de même qu'on met au milieu de l'espace d'un chevron à un autre, & qui est attachée avec un clou de deux en deux aux lattes.
|
| LATUS RECTUM | (Géom.) terme latin dont on se sert dans les sections coniques, & qui veut dire la même chose que parametre. Voyez PARAMETRE.
LATUS TRANSVERSUM, c'est une ligne comprise entre les deux sommets de la section, s'il s'agit de l'ellipse ; ou s'il s'agit de l'hyperbole, entre les sommets des sections opposées ; c'est ce qu'on nomme aussi grand axe, ou premier axe ; telle est la ligne E D, Pl. conique, figure 1. Apollonius appelle aussi la ligne dont nous parlons, axe transverse. Voyez AXE.
Les anciens géometres ont appellé latus primarium la ligne E E ou D D tirée au-dedans du cone, parallelement à la base du cone, & dans le même plan que l'axe transverse D E. Au reste, ces dénominations de latus rectum & transversum ne sont plus guere en usage, surtout depuis qu'on n'écrit plus en latin les livres de Géométrie ; dans ceux même qu'on écrit en latin, on préfere à latus rectum le mot parametre & à latus transversum le mot axis primus ou major ; savoir major dans l'ellipse, & primus dans l'hyperbole. (O)
|
| LAUBACH | Laubacum, (Géog.) ville d'Allemagne, capitale de la Carniole, avec un évêché suffragant d'Aquilée, mais exempt de sa jurisdiction. Les Italiens nomment cette ville Lubiana : elle est sur la petite riviere de Laubach, à 12 lieues S. E. de Clagenfurt, 20 N. E. d'Aquilée, 62 S. O. de Vienne. Long. 32. 22. lat. 46. 20. (D.J.)
|
| LAUBINGUÉ | S. m. (Hist. nat. Bot.) plante de l'isle de Madagascar, qui prise en décoction ou appliquée extérieurement, est un remede souverain contre les diarrhées.
|
| LAUDA | (Géog.) place d'Allemagne en Franconie, sur le Tauber, dans l'évêché de Wurtzbourg, à 5 milles de cette ville, & à 2 de Mariendal. Long. 27. 20. lat. 49. 36. (D.J.)
LAUDA, (Géog. anc.) fleuve navigable de la Mauritanie Tangitane, selon Pline, liv. V. II. Le P. Hardouin croit que le nom moderne est Gomera. (D.J.)
|
| LAUDANUM | S. m. (Pharm.) le laudanum qui est encore appellé extrait d'opium, n'est autre chose que ce suc épaissi, auquel on a fait subir une purification au moins fort inutile. Cette purification ou prétendue extraction consiste à faire fondre l'opium dans de l'eau sur un petit feu, à le passer à travers un linge pour en séparer quelques ordures, & à le rapprocher de nouveau sur un feu doux. La dose & les vertus du laudanum sont les mêmes que celles de l'opium. Voyez OPIUM. (b)
LAUDANUM LIQUIDE de Sydenham (Pharmacie) Prenez opium choisi coupé par tranches, deux onces ; safran une once, canelle & gérofle en poudre, de chacun un gros ; mettez-les dans un vaisseau convenable ; versez par-dessus vin d'Espagne une livre ; digérez pendant quelques jours au bain-marie, remuant le vaisseau de tems en tems ; passez & gardez pour l'usage.
Dix grains de laudanum liquide répondent à-peu-près à un grain d'opium : les vertus réelles de cette teinture sont les mêmes que celles de l'opium, voyez OPIUM, malgré la prétendue correction opérée ici par les aromates. Voyez CORRECTIF. (b)
|
| LAUDE | S. m. (Jurisp.) dans la basse latinité lauda ou leuda, leda, leida, est un droit qui se paye en certains lieux pour la vente des marchandises dans les foires & marchés : quasi propter laudandam venditionem, c'est-à-dire pour le placage & permission de vendre ; ce droit est aussi appellé laide ou layde, lede ou leude, selon l'idiome de chaque pays. On donne aussi quelquefois ce nom à diverses autres sortes de prestations, comme à des droits de péage, &c. (A)
|
| LAUDERDALE | (Géog.) vallée d'Ecosse, où coule la riviere de Lauder ; cette contrée qui fait partie de la province de Mers, donne le titre de duc à la principale branche de la famille de Maitland. (D.J.)
|
| LAUDES | S. f. (Lithurgie) du latin laudes, louanges, terme de breviaire, qui signifie la seconde partie de l'office qui suit immédiatement les matines & précéde les heures canoniales.
Les laudes sont composées de cinq pseaumes, dont le quatrieme est un cantique, & le cinquieme toujours un de ces pseaumes intitulés dans l'hébreu, alleluia, ce que quelques-uns rendent par psalmus laudum, sous une ou plusieurs antiennes, selon le tems, d'un capitule, d'une hymne, d'un verset, du cantique Benedictus suivi de son antienne, & d'une oraison. C'est par les laudes que finit l'office de la nuit. Voyez MATINES, BREVIAIRE, OFFICE.
|
| LAUDICAENI | (Littér.) en grec , c'étoient, parmi les Grecs & les Romains, des gens gagés pour applaudir aux pieces de théatre, ou aux harangues publiques. Ces sortes de gens étoient instruits à donner leurs applaudissemens de concert, avec art, avec harmonie, & même il y avoit des maîtres exprès pour leur en enseigner les regles & la pratique. On plaçoit les laudicènes sur le théatre, opposés les uns aux autres, comme nous faisons nos choeurs ; & à la fin du spectacle, ils formoient leur chorus d'applaudissemens, qui succédoit aux autres acclamations générales. Ils venoient toujours offrir leurs services aux orateurs, aux acteurs & aux poëtes curieux de la fumée d'une vaine gloire qu'on achetoit pour son argent. (D.J.)
|
| LAUDICK | (Géog.) petite ville de la grande Pologne, sur la riviere de Warte, dans le palatinat de Kalish, à 12 lieues N. de Kalish. Long. 35. 58. lat. 51. 50. (D.J.)
|
| LAUFFEN | Laviacum, (Géog.) petite ville de Suisse, dans la seigneurie de Zwingen, au canton de Bâle.
Il ne faut pas confondre ce lieu avec un village de Suisse, au canton de Zurich, à une petite lieue au-dessous de Schaffouse. C'est dans ce village de Lauffen qu'on voit la fameuse cataracte du Rhin, où l'eau tombant d'environ 40 coudées de haut, se précipite entre des rochers, avec un très-grand bruit.
Il y a un autre Lauffen, bourg d'Allemagne en Franconie, sur la Prégnitz, à 4 lieues de Nuremberg.
Enfin il y a un Lauffen en Souabe, au duché de Wirtemberg, sur le Necker, à 2 lieues d'Hailbron. Long. 26. 56. lat. 49. 11. (D.J.)
|
| LAUFFENBOURG | Lauffenburgum, (Géog.) ville d'Allemagne dans la Souabe ; & l'une des quatre villes forestieres. Le duc de Saxe-Weimar la prit en 1638 ; elle appartient présentement à la maison d'Autriche, & est sur le Rhin, qui coupe la ville en deux parties presqu'égales, à sept lieues sud-est de Bâle, 10 nord-est de Zurich, 10 sud-est de Schaffouse. Long. 25. 45. lat. 47. 36. (D.J.)
|
| LAUMELINE | LA, (Géogr.) canton d'Italie, au duché de Milan, entre Pavie & Casal, le long du Pô, qui la sépare en deux parties. Elle a pris son nom de l'ancienne Laumellum, aujourd'hui Lumello, qui n'est plus qu'un village du Milanez, sur la Gogna, entre Vigevano & Valence. La Laumeline a été cédée au roi de Sardaigne en 1707. (D.J.)
|
| LAU | ou LAUNU, (Géog.) ville de Bohême près de l'Egra, sur la route de Leipsic à Prague, dans un terroir qui produit du bon froment, des pâturages, & des pommes renommées dans toute la Boheme. Long. 31. 35. lat. 50. 25. (D.J.)
|
| LAUNCESTON | (Géog.) vulgairement LAUNSTON, fanum sancti Stephani, ville à marché d'Angleterre, au pays de Cornouailles, près du Tamer, qui sépare cette province de celle de Dévonshire, à 170 milles de Londres ; elle envoie un député au parlement. Long. 13. 16. lat. 50. 40. (D.J.)
|
| LAURACES | S. f. (Hist. nat.) pierre dont on n'a aucune description : on nous apprend seulement qu'elle guérissoit les maux de tête & beaucoup d'autres maladies. Boece de Boot.
|
| LAURAGUAIS LE | Lauracensis ager, (Géog.) car il a pris son nom de Laurac, autrefois place considérable, & qui n'est plus rien aujourd'hui. Le Lauraguais n'est qu'une petite contrée de France avec titre de comté, dans le haut Languedoc, entre l'Ariege & l'Agenne, à l'E. du Toulousain. Il se divise en haut & en bas, & abonde en millet & en vins ; Castelnaudari en est la capitale ; les autres lieux de ce petit canton sont Lavaur, Pui-Laurent, & Saint-Papoul. (D.J.)
|
| LAURE | S. f. (Hist. ecclésiast.) nom qu'on a donné aux résidences des anciens moines.
Ce nom vient originairement du grec , place, rue, village, hameau.
Les auteurs ne conviennent point de la différence qu'il y a entre laure & monastere. Quelques-uns prétendent que laure signifioit un vaste édifice qui pouvoit contenir jusqu'à mille moines & plus. Mais il paroit par toute l'antiquité ecclésiastique, que les anciens monasteres de la Thébaïde n'étoient pas de cette étendue. L'opinion la plus probable est que les anciens monasteres étoient comme ceux d'aujourd'hui composés de grands bâtimens divisés en salles, chapelles, cloîtres, dortoirs, & cellules pour chaque moine ; au lieu que les laures étoient des especes de villages ou hameaux, dont chaque maison étoit occupée par un ou deux moines au plus. Desorte que les couvents des chartreux d'aujourd'hui paroissent représenter les laures ; au lieu que les maisons des autres moines répondent aux monasteres proprement dits.
Les différens quartiers d'Alexandrie furent d'abord appellés laures ; mais depuis l'institution de la vie monastique, le terme laure ne se disoit que des couvents d'Egypte & de l'Orient, dans lesquels chaque moine avoit sa maison à part avec un accinct, & qui n'étoient point clos comme les monasteres. Les moines ne s'y assembloient en public qu'une fois la semaine ; & ce qu'on avoit d'abord appellé laure dans les villes, fut ensuite nommé paroisse. Voyez PAROISSE. (G)
|
| LAURÉATION | S. f. (Littérat.) terme en usage dans quelques universités, & qui marque l'action par laquelle on prend le degré de maître-ès-Arts, communément après deux ans d'étude en Philosophie. Voyez DEGRE & BACHELIER.
Ce mot est tiré de laurus, laurier, laurea, couronne de laurier, arbre que les Poëtes ont consacré à Apollon le dieu des beaux Arts, & qu'on a toûjours regardé comme le symbole de la gloire littéraire.
|
| LAURENT | LAURENT
|
| LAURENT ST | (Géog.) grande riviere de l'Amérique septentrionale, appellée aussi par ceux du pays riviere du Canada. On n'en connoît pas la source, quoiqu'on l'ait, dit-on, remontée jusqu'à 5 ou 600 lieues. On sait seulement que ce fleuve va se perdre dans un golfe auquel il donne son nom, après avoir arrosé une immense étendue de pays. (D.J.)
|
| LAURENT-LES-CHALONS | ST. (Géog.) ville de France en Bourgogne, au diocèse de Châlons, dans le comté d'Auxonne. Louis XI. y avoit établi un parlement qui a été uni à celui de Dijon ; cette ville est en partie dans une île, en partie sur la Sône, à une lieue E. de Châlons, 15 N. E. de Dijon. Long. 22. 26. lat. 46. 45. (D.J.)
|
| LAURENTUM | à présent SAN-LORENZO, (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie dans le Latium, dont elle fut quelque tems la capitale & la résidence du roi Latinus. Elle étoit entre Ardée & Ostie, près de Lavinie. Tibulle, lib. II. éleg. 5. l'indique, quand il dit ante oculos Laurens castrum, c'est-à-dire, Laurentum murusque Lavini est. Virgile qui embellissoit tout à son gré, donne un palais superbe à Latinus, dans la ville de Laurente.
Tectum augustum, ingens, centum sublime columnis
Urbe fuit, summâ Laurentis regia Pici.
Cependant cette ville étoit bien peu de chose du tems de Trajan, puisque même les métairies voisines tiroient leur subsistance de la colonie d'Ostie.
Les habitans sont nommés Laurentes par Virgile, & le rivage Laurentinum littus, par Martial.
Les poëtes latins nous parlent souvent des sangliers de Laurente, laurens aper, dit Horace ; c'est que ce canton avoit une forêt qui s'étendoit le long de la côte du Latium, entre le lac d'Ostie & le ruisseau de Numique. Cette forêt avoit pris son nom de la ville de Laurente ; ou plutôt l'une & l'autre furent ainsi appellés du grand nombre de lauriers dont le pays étoit couvert, au rapport d'Hérodien, dans la vie de l'empereur Commode.
C'est dans ce canton de lauriers, qu'étoit cette maison de campagne de Pline le jeune, dont il a fait une description si belle, & si détaillée, qu'un railleur a dit, qu'il sembloit qu'il la vouloit vendre. (D.J.)
|
| LAURÉOL | ou GAROU, laureola, s. f. (Hist. nat.) petit arbrisseau toûjours verd, qui se trouve dans les bois de la partie septentrionale de l'Europe. Il s'éleve à trois ou quatre piés ; il fait rarement plus d'une tige à-moins qu'il ne soit excité à se diviser en plusieurs branches, soit par la bonne qualité du terrein ou par des soins de culture : son écorce est épaisse, lisse, & cendrée ; ses feuilles sont longues, épaisses, lisses, sans aucunes dentelures, & rassemblées au bout des branches ; leur verdure quoique foncée, est très-brillante. Dès la fin de Décembre, la lauréole donne quantité de fleurs en petites grappes, qui par leur couleur & leur position ne sont d'aucune apparence ; elles sont herbacées & cachées sous les feuilles qui font le seul agrément de cet arbrisseau. Les fleurs sont remplacées par de petites baies noires plus longues que rondes, succulentes : elles couvrent un noyau qui renferme la semence ; le mois de Juillet est le tems de leur maturité.
La lauréole résiste aux plus grands hivers : elle se plait aux expositions du Nord, dans les lieux froids, montagneux, & incultes ; parmi les rochers, dans les terres franches & humides, mêlées de sable ou de pierrailles ; elle vient sur-tout à l'ombre, & même sous les arbres.
On peut très-aisément multiplier cet arbrisseau de boutures, de branches couchées, & de graines qu'il faut semer dans le tems de sa maturité, si on veut la voir lever au printems suivant ; car si on attendoit la fin de l'hiver pour la semer, elle ne leveroit qu'à l'autre printems. On peut encore faire prendre des jeunes plants dans les bois ; mais ils reprennent difficilement, & j'ai remarqué qu'en faisant des boutures, on réussissoit plus promtement que d'aucune autre façon. Le mois d'Avril est le tems le plus convenable pour les faire ; elles feront suffisamment racines pour être transplantées un an après.
Tout le parti que l'on puisse tirer de cet arbrisseau pour l'agrément, c'est de le mettre dans les bosquets d'arbres toûjours verds, pour y faire de la garniture & en augmenter la variété. On peut aussi en former de petites haies, quoi qu'il ait peu de disposition à prendre cette forme.
L'écorce, les feuilles, & les fruits de la lauréole, ont tant d'âcreté qu'ils brûlent la bouche après qu'on en a mangé. Toutes les parties de cet arbrisseau sont un violent purgatif ; cependant le fruit sert de nourriture aux oiseaux qui en sont très-avides ; la perdrix entr'autres. Les Teinturiers se servent de cette plante pour teindre en verd les étoffes de laines.
On ne connoît qu'une variété de cet arbrisseau qui a les feuilles panachées de jaune ; on peut la multiplier par la greffe en écusson ou en approche sur l'espece commune ; & ces arbrisseaux peuvent également se greffer sur le mezereon ou bois-joli, qui est du même genre. Voyez MEZEREON.
LAUREOLE, (Mat. méd.) on comprend sous ce nom, dans les listes des remedes, deux plantes différentes ; savoir la lauréole, ou lauréole mâle ; & la lauréole femelle ou bois gentil.
Toutes les parties de ces plantes prises intérieurement, évacuent par haut & par bas avec tant de violence, & leur action est accompagnée de tant de symptomes dangereux, qu'elles doivent être regardées comme un poison plutôt que comme un remede. Le médecin ne doit donc les employer dans aucun cas, pas même dans le dernier degré d'hydropisie, encore moins se mettre en peine de les corriger, puisque les évacuans plus sûrs & suffisamment efficaces ne lui manquent point.
Quelques pharmacologistes croient que les grains de cnide, dont Hippocrate & les anciens grecs font souvent mention, ne sont autre chose que les baies de lauréole ; d'autres prétendent au contraire que ces grains de cnide étoient les fruits de l'espece de thymelea que nous appellons garou. Voyez GAROU. (b)
|
| LAURESTA | ou LORESTAN, LOURESTAN, (Géog.) pays de Laur, Lor ou Lour ; c'est un pays de Perse, autrefois enclavé dans la Khousistan, qui est l'ancienne Susiane. M. Sanson, missionnaire apostolique sur les lieux, & par conséquent plus croyable que M. Delisle, dit que le Laurestan est le royaume des Elamites ; qu'il confine à la Susiane au midi, au fleuve Tigre à l'occident, & qu'il a la Médie inférieure au septentrion. Courbabat, forteresse où loge le gouverneur, en est le lieu principal. (D.J.)
|
| LAURETS | S. m. (Hist. mod.) étoient les pieces d'or frappées en 1619, sur lesquelles étoit représentée la tête du roi couronnée de lauriers. Il y en avoit à 20 schellings, marquées X, X, à 10 schellings, marquées X, & à 5 schellings, marquées V. Harris, Supplém.
|
| LAURIACUM | (Géog. anc.) ville principale du Norique, qu'Antonin met à 26 mille pas d'Ovilabis. Lazius & Brunschius croient que c'est Ens en Autriche ; Simler pense que c'est Lorch, qui n'est plus qu'un village sur le Danube, vis-à-vis de Mathausen. (D.J.)
|
| LAURIER | laurus, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale, faite en forme de bassin & découpée ; il sort du fond de la fleur un pistil qui devient dans la suite un fruit en forme d'oeuf ou une baie ; il y a sous l'écorce de cette baie une coque qui renferme une semence presque de la même forme que la baie. Tournefort. Inst. rei herb. V. PLANTE.
Le laurier est un arbrisseau dont il y a différens genres qui se divisent en plusieurs especes ou variétés. Par le mot laurier simplement, on entend ordinairement l'espece de laurier qui a été connue dans la plus haute antiquité, & que l'on nomme laurier-franc, laurier commun ou laurier-jambon, & en Bourgogne laurier-sauce ; mais il y a encore plusieurs autres arbrisseaux, auxquels on donne aussi le nom de laurier, quoique d'un genre tout différent, & quoiqu'ils n'aient aucune analogie ni ressemblance avec le laurier-franc ; tels sont le laurier-royal, le laurier-cerise, le laurier-tin, le laurier-rose, le laurier-alexandrin ; tous ces arbrisseaux ont une qualité qui leur est commune : ils sont toujours verds ; mais il y a tant de différence dans leur culture, leur tempérament & leurs propriétés, dans la façon de les multiplier, de les cultiver & conduire, qu'il faut traiter de chacun séparément.
Le laurier-franc est connu de tout le monde. C'est un arbre toujours verd, de moyenne grandeur, qui se plaît dans les pays chauds : on le trouve communément en Grece & en Italie. Il ne s'éleve dans nos provinces septentrionales qu'à environ vingt piés ; mais plus ordinairement, on ne l'y voit que sous la forme d'un arbrisseau. Il prend une tige droite & sans noeuds, dont l'écorce est brune & unie ; ses feuilles sont entieres, luisantes & fermes ; elles sont placées alternativement sur les branches & de la plus belle verdure. Ses fleurs d'un blanc jaunâtre, ont peu d'agrément ; elles paroissent au commencement de Mai, & elles durent près d'un mois. Les fruits qui leur succedent, sont de la grosseur d'une petite cerise ; ce sont des baies oblongues, vertes au commencement & noires en murissant ; elles sont odorantes, aromatiques, huileuses & ameres au goût. Cet arbre vient dans tous les terreins ; mais il se plaît sur-tout dans une terre fraîche, bien substantielle, & il aime l'ombre. On peut le multiplier de semences, de branches couchées & de boutures. Ce dernier moyen est aussi long qu'incertain ; on avance un peu plus en couchant les branches, mais elles ne produisent que des plans défectueux & languissans ; il vaut mieux semer, c'est la voie la plus courte, la plus sure & la plus satis faisante à tous égards. Il faut cueillir les baies du laurier au mois de Janvier, qui est le tems de leur maturité. On peut les semer tout de suite, ou les mettre dans du sable pour attendre le mois de Mars. On fera bien de les faire tremper dans l'eau pendant vingt-quatre heures avant de les semer. Dans ce dernier cas, elles leveront au bout de deux mois : les jeunes plants prendront cette premiere année trois ou quatre pouces de hauteur, & la plûpart s'éleveront l'année suivante à environ un pié. Alors ils seront plus en état qu'à tout autre âge, d'être transplantés dans la place qu'on leur destine. Pendant les trois ou quatre premieres années, l'hiver est un tems bien critique pour ces arbres ; il faudra avoir grand soin de les couvrir de paille dans cette saison, & sur-tout durant le hâle de Mars qui est le fléau des arbres toujours verds, lorsqu'ils sont jeunes ou nouvellement transplantés. Le laurier est peut-être de tous les arbres de cette qualité celui qui réussit le moins à la transplantation. Le mois d'Avril est le tems le plus convenable pour cette opération ; c'est-à-dire un peu avant qu'il ne commence à pousser. Si on vouloit en faire des plantations un peu considérables, en avancer le progrès, s'assurer du succès & se procurer de beaux arbres ; il faudroit les semer sur la place & dans l'arrangement où ils devroient rester. Le plus grand agrément qu'on puisse tirer de cet arbre, c'est de le mettre en palissade pour garnir un mur. On fait quelqu'usage des baies du laurier ; elles servent aux teinturiers ; on en tire une huile qui est de quelqu'utilité en Médecine ; mais les maréchaux l'appliquent dans bien des cas. Ses feuilles lorsqu'elles sont séches, entrent dans plusieurs ragoûts de la vieille cuisine. Il y a plusieurs variétés de cet arbre. Le laurier à large feuilles, qui est le plus robuste de tous : le laurier à fleur double, dont la rareté fait le mérite : le laurier à feuilles ondées ; minutie dont on fait peu de cas : & le laurier à feuilles panachées de jaune, qui a plus d'agrément que les autres, mais aussi il est plus délicat ; il faut le traiter comme les arbrisseaux de l'orangerie. On peut le multiplier par la greffe comme les autres variétés.
Le laurier-cerise est un bel arbre de moyenne grandeur, qui est toujours verd : il nous est venu de la Natolie en Turquie, son pays naturel, il y a environ deux cent ans. On ne voit guere ce laurier sous la forme d'un arbre dans la partie septentrionale de ce royaume, parce qu'il n'est pas assez robuste pour y prendre tout son accroissement ; & comme on est réduit à le tenir en palissade à des expositions qui lui conviennent, on ne le connoit que sous la forme d'un arbrisseau. Il pousse des tiges assez droites, grosses & fermes. Son écorce est brune & unie sur le vieux bois, mais elle est d'un verd jaunâtre sur les nouvelles branches. Ses feuilles sont grandes, oblongues, unies, douces & fermes au toucher, d'un verd tendre des plus brillans. Ses fleurs paroissent au commencement de Mai ; elles sont blanches, sans odeur, & disposées en longues grappes. Les fruits qui en viennent sont rouges, charnus, & ressemblent à une cerise ; ce qui a fait donner à l'arbre le nom de laurier-cerise : ils sont doux, assez agréables au goût ; on peut les manger sans inconvénient. Cet arbre s'accommode de tous les terreins, pourvû qu'il y ait de la profondeur, de la fraîcheur & de l'ombre. Il se plait sur-tout parmi les autres arbres. Il croît très-promtement, il lui faut peu de culture, & il se multiplie aisément de semence, de branches couchées, de boutures, & par les rejettons qui croissent au pié des vieux arbres. On seme les noyaux du fruit en automne, les branches couchées se font au printems ; & les boutures au mois de Juillet : par ce dernier moyen on peut avoir au bout de quatre ans des plants de 8 à 9 piés de haut. Cet arbre réussira difficilement à la transplantation ; si les plants sont âgés de plus de deux ou trois ans. L'automne est le tems le plus propre à cette opération. Suivant les auteurs anglois qui ont écrit sur la culture des arbres, le laurier-cerise se greffe sur le cerisier, & il forme un bel arbre ; cependant par quantité d'épreuves que j'ai vû faire à ce sujet, cette greffe ne réussit que pendant deux ou trois années, & souvent dès la seconde la greffe meurt avec le sujet. Ce laurier n'est pas assez robuste pour résister au froid dans des places isolées ; il seroit souvent exposé dans ce cas à être mutilé par les gelées des hivers rigoureux, & même à être desséché jusqu'au pié. Il est vrai que ses racines donnent de nouveaux rejettons, mais cela ne dédommage pas suffisamment. Le meilleur parti qu'on en puisse tirer pour l'agrément, c'est de le placer dans des bosquets d'arbres toujours verds, où il se fera distinguer par la brillante verdure de son feuillage. On peut aussi en former de hautes palissades contre des murs à l'exposition du nord, il y sera moins sujet à être endommagé par la gelée que s'il étoit placé au midi. La feuille de ce laurier est de quelque usage à la cuisine pour donner au lait & à la crême un goût d'amandes ameres. Mais la liqueur tirée de ces mêmes feuilles par la distillation, peut produire des effets très-pernicieux. On connoît deux variétés & deux especes différentes de cet arbre ; l'une des variétés a les feuilles panachées de jaune, & l'autre de blanc. Toutes les deux n'ont pas grande beauté. Les autres especes de ce laurier sont le laurier-cerise de la Louisiane ou laurier-amande : cet arbre est encore si rare en France, qu'on ne peut entrer dans un détail circonstancié à son sujet. Il y a lieu de croire qu'il pourra venir en plein air dans ce climat, puisqu'il a déja passé plusieurs hivers en pleine terre dans les jardins de M. le duc d'Ayen à Saint-Germain-en-laye. Sa feuille a beaucoup de ressemblance avec celle du laurier-franc, néanmoins elle a l'odeur & le goût de l'amande amere. Le seconde espece est le laurier-cerise de Portugal, ou l'azarero des Portugais ; c'est l'un des plus jolis arbrisseaux toujours verds. Il s'éleve bien moins que le laurier-cerise ordinaire ; sa feuille est aussi moins grande, mais elle est d'un verd encore plus brillant : la queue des feuilles & l'écorce des jeunes rejettons sont d'une couleur rougeâtre fort vive. L'arbrisseau se couvre au mois de Juin de grosses grappes de fleurs, dont la blancheur & la douce odeur frappent & saisissent de loin ; & en automne, les fruits ne font pas un moindre agrément lors de leur maturité. L'azarero est plus délicat que l'espece commune ; il lui faut un bon terrein, qui ne soit ni trop sec, ni trop humide, & la meilleure exposition pour résister en pleine terre à nos hivers ordinaires. On peut le multiplier par les mêmes moyens, & aussi facilement que le laurier-cerise commun, sur lequel on peut aussi le greffer. Cet arbrisseau se garnit au pié de beaucoup de branches qui s'étendent & s'inclinent, ensorte qu'il faut le soigner pour lui faire prendre une tige & lui former une tête ; encore en viendra-t-on difficilement à bout, s'il a été élevé de boutures ou de branches couchées ; ce n'est qu'en le faisant venir de semence, qu'on peut l'avoir dans sa perfection. L'azarero est encore rare en France.
Le laurier-rose, arbrisseau toujours verd, d'un grand agrément, & qui est fort connu. Si on le laisse croître sans le conduire, il pousse quantité de tiges de pié qui ne forment qu'un buisson. Il se garnit de beaucoup de feuilles longues, étroites & pointues, elles sont sans dentelures, fort unies en-dessus, mais relevées en-dessous d'une seule nervûre ; elles conservent toujours la même verdure, qui est terne & foncée. L'arbrisseau donne aux mois de Juillet & d'Août une grande quantité de fleurs rassemblées par bouquets à l'extrémité des branches, qui sont d'une belle apparence. Lorsqu'elles sont passées, il leur succede de longues siliques qui renferment des semences garnies d'aigrettes, mais ce n'est que dans les années chaudes & bien favorables que cet arbrisseau donne de la graine dans ce climat. Il faut soigner ce laurier dans sa jeunesse pour lui faire prendre une tige droite ; & il ne faut pas moins d'attention par la suite pour lui former une tête par rapport à l'irrégularité qu'il contracte naturellement. On connoit à présent sept especes différentes de cet arbrisseau ; comme elles ne sont pas également robustes, il sera plus convenable de les traiter séparément, & d'en faire deux classes. La premiere comprendra ceux qui exigent moins de précaution pour passer les hivers ; tels sont le laurier-rose ordinaire à fleurs rouges, celui à fleurs blanches, & celui dont les fleurs sont mêlées de rouge & de blanc ; il faut à ces arbrisseaux les mêmes ménagemens que pour les grenadiers, c'est-à-dire, qu'il faut les serrer pendant l'hiver, & que la plus mauvaise place de l'orangerie leur suffit : il est vrai qu'on en a vû dans le climat de Paris qui ont passé plusieurs hivers de suite en plein air ; mais les plants qu'on avoit ainsi exposés en ont été quelquefois si endommagés & si fatigués, qu'ils perdoient beaucoup de leur agrément. L'usage est de les tenir ou dans des pots ou dans des caisses, & c'est le meilleur parti. Rien de plus aisé que de multiplier ce laurier, soit par les rejettons qu'il produit au pié, soit en semant ses graines, soit en couchant des jeunes branches, ou en greffant ses especes les unes sur les autres. Tous ces moyens sont bons, si ce n'est que celui de semer sera le plus difficile & le plus long. Le commencement d'Avril est le tems propre pour faire les branches couchées ; il sera presque égal de ne les faire qu'au mois de Juillet, elles feront des racines suffisantes pour être transplantées au printems suivant. Il faut à ces arbrisseaux beaucoup d'eau pendant l'été, sans quoi ils feroient peu de progrès, & ne produiroient pas beaucoup de fleurs. Si l'on veut même en tirer tout le parti possible, c'est de les ôter des caisses, & de les mettre en pleine terre pendant toute la belle saison jusqu'au 20 d'Octobre qu'il faudra les remettre dans leur premier état ; on leur donne par ce moyen de la vigueur, de la durée, de la hauteur, & infiniment plus de beauté. Les lauriers-rose de la seconde classe sont infiniment plus délicats que ceux dont on vient de parler, il leur faut une serre chaude pour passer l'hiver & des soins tous différens : ceux-ci sont le laurier rose à fleurs rougeâtres, simples & odorantes, le même à fleurs doubles, celui à fleurs doubles, mêlées de rouge & de blanc, & un autre à grandes fleurs rouges. Ces arbrisseaux viennent de la Nouvelle Espagne, d'où ils ont passé aux colonies angloises d'Amérique, & de-là en Europe. Les deux variétés à fleurs doubles sont de la plus grande beauté ; elles donnent pendant tout l'été de gros bouquets de fleurs très-doubles, dont la vive couleur, l'élégance & la bonne odeur rendent ces arbrisseaux très-précieux. Mais il faut des précautions pour les faire fleurir ; car si on les laisse en plein air pendant l'été, quoique dans la meilleure exposition, ils ne donneront point de fleurs ; il faut absolument les mettre sous des chassis, & les traiter durant cette saison comme les plantes les plus délicates des pays chauds. Ces arbrisseaux, dans les pays d'où on les a tirés, croissent naturellement sur les bords des rivieres & le long des côtes maritimes ; on ne sauroit donc trop recommander de les faire arroser souvent. Du reste on peut les multiplier comme les especes qui sont plus robustes.
Le laurier-tin, arbrisseau toujours verd, l'un des plus jolis que l'on puisse employer pour l'agrément dans les jardins ; il prend de lui-même une tige droite, il se garnit de beaucoup de rameaux, la verdure de son feuillage ne change point ; & quoiqu'un peu brune, elle plaît aux yeux par son brillant ; ses fleurs blanchâtres & sans odeur viennent en ombelles au bout des branches, elles sont d'un ordre assez commun, mais ce laurier en donne une grande quantité, elles sont de longue durée ; elles paroissent dès que la saison s'adoucit à la fin de l'hiver, & l'arbrisseau en produit encore quelques-unes pendant l'automne. Les fruits qui succedent sont de petites baies d'un noir bleuâtre & luisant, qui renferment chacune une semence presque ronde. Cet arbrisseau n'est nullement délicat sur la qualité du terrein ; & quoique dans les pays où il vient naturellement, comme en Espagne, en Portugal, en Italie & en France, aux environs de Narbonne, il croisse de lui-même dans des lieux escarpés, pierreux & incultes, cependant il se plaira encore mieux dans une terre franche & humide, à l'exposition du nord & à l'ombre des autres arbres ; qualité très-avantageuse dont on pourroit profiter pour former dans des endroits couverts & serrés, des haies, des séparations & des palissades qui s'éleveroient facilement à huit ou dix piés, ou que l'on pourra retenir, si l'on veut, à hauteur d'appui. Il n'y a peut-être aucun arbrisseau que l'on puisse multiplier aussi aisément que celui-ci ; il vient de rejettons, de semence, de branches couchées, de boutures & par la greffe comme bien d'autres : mais on peut encore le multiplier par ses racines, & même en piquant dans la terre ses feuilles, qui font racine assez promtement ; la queue de la feuille fait de petites racines, il s'y forme ensuite un oeil qui donne bien-tôt une tige. Il ne faut presque aucune culture à ce laurier, & peu d'attention sur le tems propre à coucher ses branches, ou à en faire des boutures ; tous les tems conviennent pour cela, pourvû que la saison soit douce, & il arrive souvent que les branches qui touchent contre terre y font racine, sans qu'il soit besoin de les couvrir de terre. Si l'on vouloit se procurer une grande quantité de ces arbrisseaux, il faudroit en semer des graines, quoique ce soit le parti le plus long & le plus incertain : le tems de les semer est en automne, aussi-tôt qu'elles sont en maturité. Cet arbrisseau est susceptible de toutes les formes qu'on veut lui faire prendre. Il faut le tailler au printems, après que les fleurs sont passées ; si on le faisoit plûtôt, on supprimeroit les fleurs de l'arriere saison. La serpette convient mieux pour cette opération que le ciseau qui dégrade les feuilles. Sa transplantation demande des précautions, il participe en cela du défaut qui est commun aux arbres toujours verds, qui reprennent difficilement. La meilleure saison de le transplanter est au commencement d'Avril, immédiatement avant qu'il pousse ; on ne peut être assuré de la reprise que quand on a enlevé ces arbrisseaux avec la motte de terre. On doit les arroser souvent, & les tenir couverts de paille jusqu'à ce qu'ils commencent à pousser. Ce laurier n'est pas aussi robuste qu'on pourroit le désirer ; il est quelquefois endommagé par les hivers rigoureux, mais il s'en releve aisément.
Les différentes especes de ce laurier que l'on connoît jusqu'à present, sont 1°. le laurier ordinaire. Sa fleur est blanche, & ses feuilles sont d'un verd luisant en-dessus, mais qui est terne en-dessous.
2°. Le laurier-tin ordinaire à feuilles panachées de blanc. C'est une belle variété qui est fort rare.
3°. Le laurier-tin ordinaire à feuilles d'un verd brun très-luisant. Ses fleurs sont plus grandes, & ont plus d'apparence que celles des autres especes, mais il fleurit plus tard, & il est un peu moins robuste.
4°. Le laurier-tin à feuilles rudes & à fleurs purpurines. Il est plus branchu que les précédens, ses feuilles sont plus étroites & plus longues ; l'écorce des jeunes rejettons est rougeâtre.
5°. Le laurier-tin à petites feuilles. Cette espece s'éleve moins que les autres ; il se garnit de beaucoup plus de feuilles, & son fruit est bien plus âcre & plus brûlant à la bouche que celui des especes précédentes. Les deux dernieres especes sont plus robustes que les autres, fleurissent plûtôt, & donnent une plus grande quantité de fleurs.
6°. Le laurier-tin à feuilles rudes panachées de jaune & à fleurs purpurines. Cette variété est de la plus grande beauté ; elle est encore très-rare.
On observe que les deux variétés panachées ne sont pas assez robustes pour passer les hivers en pleine terre, & qu'il faut les mettre dans l'orangerie.
Le laurier royal ou laurier des Indes, arbre toujours verd, dont le feuillage fait toute la beauté. Il est trop délicat pour passer les hivers en plein air dans ce climat : il faut le traiter comme les orangers. Il prend de lui-même une tige fort droite ; il se garnit de quantité de feuilles assez ressemblantes à celles du laurier-cerise, mais plus grandes & moins brillantes ; ses fleurs sont blanches, & viennent en gros bouquets ; elles n'ont point d'odeur, & il n'y a nul goût aromatique dans toutes les parties de cet arbre. On le cultive beaucoup dans le Portugal, où on l'emploie à faire des allées. Il vient aisément de graines qui ne mûrissent point dans ce climat, & qu'il faut tirer de Portugal : il demande pour la culture les même soins que l'oranger ; tout ce qu'il y a de particulier pour le laurier royal, c'est qu'il craint la sécheresse, & qu'il lui faut de fréquens arrosemens. On peut aussi le multiplier de branches couchées, qu'il faudra marcotter, & qui n'auront de bonnes racines qu'au bout de deux ans.
Le laurier-alexandrin, c'est une sorte de plante vivace dont les tiges durent deux années, & qui se renouvelle tous les ans à-peu-près comme le framboisier. Ce laurier pousse de bonne heure au printems de nouvelles tiges qui sortent des racines & qui s'élevent à environ deux piés ; chaque tige se divise en plusieurs branches, qui sont garnies de feuilles ressemblantes à celles du mirthe à large feuille. Dans la plûpart des especes de ce laurier, la graine sort du milieu de la feuille, & cette graine est une baie de la grosseur d'une petite cerise & d'un rouge assez vif : cette singularité jointe à ce que ce laurier conserve ses feuilles, ses fruits & ses tiges pendant l'hiver suivant, voilà ce qui en fait tout le mérite ; on peut le multiplier de graine, mais il sera plus court & plus aisé d'en tirer du plant en divisant ses racines au printems avant qu'il commence à pousser. Cette plante se plaît à l'ombre, & n'exige aucun soin particulier. C'est bien gratuitement qu'on lui a donné le nom de laurier ; elle n'a ni rapport ni ressemblance avec les arbres de ce nom, & elle ne mérite pas d'ailleurs de leur être associée : il y a plusieurs especes de cette plante.
1°. La premiere se nomme fragon, houx, frelon, buis piquant, brusque, housson, houx-fragon, & petit houx en Bourgogne. Elle vient naturellement dans plusieurs provinces de ce royaume ; elle ne s'éleve qu'à un pié environ, & elle est de quelqu'usage en Medecine.
2°. Le laurier-alexandrin à larges feuilles.
3°. Le laurier-alexandrin à feuilles étroites.
Dans ces trois especes les fruits sortent du milieu des feuilles.
4°. Le laurier-alexandrin à feuilles étroites, qui porte son fruit à l'extrémité de ses branches. Cette espece s'éleve un peu plus que les autres ; aussi la nomme-t-on le grand laurier-alexandrin.
5°. Le laurier-alexandrin à larges feuilles, dont les fruits viennent aux aisselles des feuilles.
Quoique les quatre dernieres especes soient originaires de l'Egypte, elles résistent très-bien au froid de ce climat : il arrive quelquefois qu'une partie des branches sont flétries dans les hivers rigoureux, mais les racines n'en souffrent point.
6°. Le laurier-alexandrin à larges feuilles, dont le fruit vient sur le bord de la feuille. Cette espece est originaire de Madere : elle n'est pas assez robuste pour passer en pleine terre ; il lui faut l'abri de l'orangerie pendant l'hiver. Elle s'éleve à sept ou huit piés. Article de M. DAUBENTON.
LAURIER-CERISE, lauro-cerasus, genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond. Le calice a la forme d'un entonnoir ; il en sort un pistil qui devient dans la suite un fruit mou, assez semblable à une cerise. Il renferme une coque qui contient une semence arrondie. Ajoutez aux caracteres de ce genre le port de la plante. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LAURIER-FRANC, (Botaniq.) plante du genre du laurier. Voyez LAURIER.
LAURIER-ROSE, nerion, genre de plante à fleur monopétale découpée, & presqu'en forme d'entonnoir ; il sort du calice un pistil qui est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & qui devient dans la suite un fruit presque cylindrique, composé de deux graines ou siliques remplies de semences à aigrettes. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LAURIER-TIN, tinus, genre de plante à fleur monopétale rayonnée & découpée ; le milieu est percé par l'extrémité du calice, qui devient un fruit en forme d'olive avec un ombilic ; il renferme une semence qui a la figure d'une poire. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LAURIER, (Chymie, Pharm. Mat. med. & Diete.) On se sert indifféremment des deux especes, ou plûtôt des deux variétés de laurier, connues dans les boutiques sous le nom de laurier-franc & de laurier-royal.
Le laurier étoit d'un grand usage dans la pratique des anciens medecins, qui le regardoient comme une espece de panacée. Ils employoient les feuilles, les baies & l'écorce des racines ; cette derniere partie est absolument inusitée aujourd'hui, les feuilles sont assez communément employées pour l'usage extérieur ; on les fait entrer dans les décoctions & les infusions pro-foetu ; on emploie aussi la décoction de ces feuilles en lavement pour dissiper la colique : ce secours est cependant peu usité. On les fait entrer aussi dans les especes pour les fumigations, qu'on emploie quelquefois dans les descentes & les relâchemens de matrice, & dans la stérilité des femmes.
Les baies de laurier sont plus employées que les feuilles ; on s'en sert intérieurement & extérieurement ; elles sont regardées comme stomachiques, vulnéraires, résolutives, excitant les urines & les regles ; elles passent surtout pour utiles dans les concrétions bilieuses du foie : on peut les ordonner dans ce cas en infusion ou en substance à la dose de trois ou quatre. Appliquées extérieurement elles résolvent & fortifient puissamment, & appaisent les douleurs.
On peut s'appuyer des connoissances que l'analyse chymique nous en fournit, pour établir la réalité de la plûpart de ces vertus. En effet, les baies de laurier contiennent une quantité considérable d'une huile grasse de la nature des huiles par expression (voyez HUILE,) & une autre huile éthérée & aromatique, qu'on peut séparer de ces baies par une seule & même opération ; savoir, la distillation avec l'eau ; car l'huile grasse ou beurre de baie de laurier en est séparée par la décoction, & vient nager sous la forme d'une graisse verdâtre, & ensuite se figer sur la surface de l'eau employée dans la distillation.
C'est cette derniere huile ou beurre qui constitue la partie médicamenteuse vraiment spéciale de ces baies ; elle est résolutive, adoucissante, discussive, vulnéraire.
Les baies de laurier épuisées des deux huiles dont nous venons de parler, en fournissent encore une troisieme si on les pile & qu'on les mette à la presse : celle-ci est principalement fournie par la semence ou amende contenue dans le noyau de la baie ; elle est moins douce que les huiles ordinaires tirées par expression des semences émulsives, parce qu'elle est chargée d'un peu de beurre ou d'huile essentielle, on l'emploie, mais très-rarement, dans les linimens, les onguens & les emplâtres.
On recommande ces deux dernieres huiles contre la galle ; mais elles ne fournissent par elles-mêmes qu'un secours fort impuissant contre cette maladie. Si on les mêle avec du soufre, qui est dans ce cas le véritable spécifique, elles pourront être utiles, comme correctif de l'odeur desagréable.
Les feuilles, les baies de laurier, & les trois différentes huiles dont nous venons de parler, entrent dans un grand nombre de préparations officinales, tant extérieures qu'intérieures. Les baies donnent leur nom à un électuaire stomachique, hystérique & emménagogue, qui est fort peu employé dans la pratique ordinaire de la Medecine.
Outre les huiles de baies de laurier dont nous avons parlé ci-dessus, on en prépare encore une quatrieme en les faisant infuser & bouillir dans de l'huile d'olive : on emploie celle-ci aux mêmes usages que l'huile par décoction & l'huile par expression ; elle est parfaitement analogue à la matiere qui résulteroit du mélange de ces deux dernieres.
On connoît assez l'emploi qu'on fait dans nos cuisines des feuilles de laurier. La consommation en est assez considérable à Paris pour que certains paysans trouvent moyen de gagner leur vie en apportant de plus de 50 lieues de grosses branches de laurier avec leurs feuilles, qu'ils y viennent vendre. On les fait entrer sur-tout comme assaisonnement dans les sauces que l'on fait à certains poissons. Plusieurs medecins ont prétendu qu'elles étoient nuisibles à l'estomac ; d'autres ont cru au contraire qu'elles le fortifioient & qu'elles aidoient la digestion. L'opinion des premiers paroît pouvoir tirer quelque appui de l'analogie du laurier-franc avec le laurier-rose, qui a été de tous les tems reconnu pour un poison, & de la découverte qu'on a faite depuis quelques années en Angleterre, des qualités dangereuses d'un autre arbre de la même classe ; savoir, le laurier-cerise. Voyez LAURIER-ROSE & LAURIER-CERISE. Cependant cette induction ne suffit point assurément pour rendre l'usage des feuilles de laurier suspect. (b)
LAURIER-ROSE, (Medecine) le laurier-rose doit être regardé comme un poison non-seulement pour les hommes, mais encore pour toute sorte d'animaux qui en mangent, selon le sentiment de Galien, & contre celui de Dioscoride & de Pline qui disent que les fruits & les feuilles du laurier-rose sont un poison pour la plûpart des quadrupedes, mais que les hommes peuvent en user intérieurement contre les morsures des serpens, &c.
Les remedes contre ce poison sont ceux qu'on prescrit contre tous les poisons corrosifs en général ; savoir, les huiles par expression, le lait, le beurre, la décoction des fruits doux, des racines & des graines mucilagineuses, &c.
Les feuilles de laurier-rose écrasées & appliquées extérieurement, sont bonnes, selon Galien, contre la morsure des bêtes venimeuses.
Ces mêmes feuilles sont employées dans la poudre sternutatoire de la pharmacopée de Paris. Extrait de la suite de la mat. med. de Geoffroy.
LAURIER, (Littér. & Mythol.) cet arbre, nommé daphné () par les Grecs, est de tous les arbres celui qui fut le plus en honneur chez les anciens. Ils tenoient pour prodige un laurier frappé de la foudre. Admis dans leurs cérémonies religieuses, il entroit dans leurs mysteres, & ses feuilles étoient regardées comme un instrument de divination. Si jettées au feu elles rendoient beaucoup de bruit, c'étoit un bon présage ; si au contraire elles ne pétilloient point du tout, c'étoit un signe funeste. Vouloit-on avoir des songes sur la vérité desquels on pût compter, il falloit mettre des feuilles de cet arbre sous le chevet de son lit. Vouloit-on donner des protecteurs à sa maison il falloit planter des lauriers au-devant de son logis. Les Laboureurs, intéressés à détruire ces sortes de mouches si redoutées des boeufs pendant l'été, qu'elles les jettent quelquefois dans une espece de fureur, ne connoissoient point de meilleurs remedes que les feuilles de laurier. Dans combien de graves maladies son suc préparé, ou l'huile tirée de ses baies, passoient-ils pour des contre-poisons salutaires ? On mettoit des branches de cet arbre à la porte des malades ; on en couronnoit les statues d'Esculape. Tant de vertus qu'on attribue au laurier, le firent envisager comme un arbre divin, & comme l'arbre du bon génie.
Mais personne n'ignore qu'il étoit particulierement consacré à Apollon, & que c'est pour cela qu'on en ornoit ses temples, ses autels & le trépié de la Pythie. L'amour de ce dieu pour la nymphe Daphné, est la raison qu'en donnent les Mythologistes ; cependant la véritable est la croyance où l'on étoit qu'il communiquoit l'esprit de prophétie & l'enthousiasme poétique. De-là vint qu'on couronnoit les Poëtes de laurier, ainsi que ceux qui remportoient les prix aux jeux pythiques. On prétend que sur la coupole du tombeau de Virgile, qui est près de Pouzzoles, il est né des lauriers qui semblent couronner l'édifice, & que ceux qu'on a coupés sont revenus, comme si la nature même eût voulu célébrer la gloire de ce grand poëte.
Les faisceaux des premiers magistrats de Rome, des dictateurs & des consuls, étoient entourés de lauriers, lorsqu'ils s'en étoient rendus dignes par leurs exploits. Plutarque parlant de l'entrevue de Lucullus & de Pompée, nous apprend qu'on portoit devant tous les deux des faisceaux surmontés de lauriers, en considération de leurs victoires.
Virgile fait remonter jusqu'au siecle de son héros la coûtume d'en ceindre le front des vainqueurs : il est du moins certain que les Romains l'adoptérent de bonne heure ; mais c'étoit dans les triomphes qu'ils en faisoient le plus noble usage. Là les généraux le portoient non-seulement autour de la tête, mais encore dans la main, comme le prouvent les médailles. On décoroit même de laurier ceux qui étoient morts en triomphant : ce fut ainsi qu'Annibal en usa à l'égard de Marcellus.
Parmi les Grecs, ceux qui venoient de consulter l'oracle d'Apollon, se couronnoient de laurier s'ils avoient reçu du dieu une réponse favorable ; c'est pourquoi dans Sophocle, Oedipe voyant Oreste revenir de Delphes la tête ceinte de lauriers, conjecture qu'il rapporte une bonne nouvelle. Ainsi chez les Romains tous les messagers qui en étoient porteurs, ornoient de lauriers la pointe de leurs javelines. La mort de Mithridate fut annoncée de cette maniere à Pompée. On entouroit semblablement de laurier les lettres & les tablettes qui renfermoient le récit des bons succès : on faisoit la même chose pour les vaisseaux victorieux. Cet ornement se mettoit à la poupe, parce que c'étoit là que résidoient les dieux tutelaires du vaisseau, & que c'étoit à ces dieux que les matelots menacés du naufrage adressoient leurs voeux & leurs prieres. J'ajoute encore que le laurier étoit un signe de paix & d'amitié, car au milieu de la mêlée l'ennemi le tendoit à son ennemi, pour marquer qu'il se rendoit à lui.
Enfin l'adulation pour les empereurs introduisit l'usage de planter des branches de laurier aux portes de leurs demeures : voilà d'où vient que Pline appelle cet arbre, le portier des Césars, le seul ornement & le fidele gardien de leurs palais, gratissima domibus janitrix, quae sola & domos exornat, & ante limina Caesarum excubat. Voyez si vous êtes curieux de plus grands détails, la Dissertation de Madrisio dell' Alloro, e suoi vari usi presso gli Antichi.
Mais parcourez tant que vous voudrez tout ce qu'on a pris soin de recueillir en littérature à l'honneur du laurier, vous ne trouverez rien au dessus de l'éloge charmant qu'Ovide en a fait. Je ne connois point de morceau dans ses ouvrages sur un pareil sujet, qui soit plus joli, plus agréable & plus ingénieux ; c'est dans l'endroit de ses métamorphoses, où Apollon ayant atteint Daphné déjà changée en laurier, la sent encore palpiter sous la nouvelle écorce qui l'enveloppe : lisez cette peinture.
Complexusque suis ramos, ut membra lacertis,
Oscula dat ligno : refugit tamen oscula lignum.
Cui deus : At quoniam conjux mea non potes esse,
Arbor eris certè, dixit, mea ; semper habebunt
Te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae.
Tu ducibus laetis aderis, cum laeta triumphum
Vox canet ; & longas visent capitolia pompas.
Postibus augustis, eadem fidissima custos,
Ante fores stabis, mediamque tuebere quercum.
Utque meum intonsis caput est juvenile capillis,
Tu quoque perpetuos semper gere frondis honores ;
Finierat Poean : factis modo laurea ramis,
Annuit, utque caput, visa est agitasse cacumen.
" Apollon serre entre ses bras les rameaux du laurier, comme si c'étoit encore la belle nymphe qu'il vient de poursuivre. Il applique au bois des baisers que le bois semble dédaigner. Ce dieu lui adresse alors ces paroles : puisque tu ne peux être mon épouse, tu seras du moins mon arbre chéri ; laurier, tu seras à jamais l'ornement de ma tête, de ma lyre & de mon carquois. Tu seras l'ornement des généraux qui monteront triomphans au capitole, au milieu d'une pompe magnifique, & des chants de victoire & d'allégresse. Tu décoreras l'entrée de ces demeures augustes où sont renfermées les couronnes civiques que tu prendras sous ta protection. Enfin, comme la chevelure de ton amant ne vieillit jamais, & qu'elle n'est jamais coupée, je veux que tes rameaux soient toujours verds & toujours les mêmes. Ainsi parla le Dieu. Le laurier applaudit à ce discours, & parut agiter son sommet, comme si la nymphe encore vivante eut fait un signe de tête ". (D.J.)
|
| LAURIUM | (Géog. anc.) montagne de Grece, dans l'Attique, entre le promontoire Sunium & le port de Pyrée.
Les mines d'argent de l'Attique étoient dans cette montagne, & l'on frappoit une monnoie du métal que l'on en tiroit. Xénophon & Plutarque pretendent qu'elles devenoient plus fécondes à mesure qu'on y creusoit davantage, & qu'elles sembloient redoubler leur libéralité en faveur de ceux qui travailloient à les épuiser ; cependant ce bonheur ne dura pas toujours, les mines du mont Laurium s'épuiserent & tarirent à la fin ; c'est Strabon lib. IX. qui le dit en termes formels. Au reste ces précieuses mines appartenoient originairement à des particuliers d'Athènes ; mais Thémistocle les unit au domaine de la république, & commença par les employer à l'armement de la flotte pour la guerre d'Egine. (D.J.)
|
| LAURO | ou LAURON, (Géog. anc.) ancienne ville de l'Espagne Tarragonoise, où les troupes de Jules-César défirent celles de Sextus Pompée qui y périt. C'est présentement ou le bourg de Liria dans le royaume de Valence, à cinq lieues de la capitale, où Laurigi qui n'en est pas loin. (D.J.)
|
| LAUS | (Géog. anc.) riviere & petite ville d'Italie, dans la Lucanie, selon Pline, lib. III. cap. v. Collenius & D. Mathezo Egitio prétendent que la riviere Laus est aujourd'hui le Sapri, & que le Laus sinus est le golfe de Poliastro, qui prenoit ce nom du fleuve Laus.
|
| LAUSANNE | Lausanna, ou Lausanum, (Géog) ville de Suisse, capitale du pays de Vaud, au canton de Berne.
C'est un lieu très-ancien, puisqu'il est désigné dans l'itinéraire d'Antonin entre la colonie équestre qui est Nyon, & Urba qui est Orbe. On y voit marqué lacus lausonius, ce qui prouve que le lac Léman a porté le nom de lac de Lausanne avant que de prendre celui de Geneve. Selon quelques auteurs Valerius Aurelianus bâtit Lausanne des ruines d'Arpentine ; mais on ne sait rien de certain sur son origine.
Cette ville a eu les mêmes révolutions & les mêmes seigneurs que le pays de Vaud, jusqu'à la mort de Bertold V duc de Zéringen : elle étoit déjà franche & libre ; ensuite l'évêque de Lausanne devint prince de la ville, mais avec la conservation de tous les privileges des habitans.
Les Bernois ayant conquis sur Charles II. duc de Savoie le pays de Vaud, se rendirent maîtres de Lausanne, d'où ils bannirent l'exercice de la religion romaine, donnerent à leur baillif les revenus de la manse épiscopale, & ceux de la manse du chapitre au college qu'ils établirent, & que l'on nomme académie : elle fleurit dès le commencement de son établissement, & n'a point dégénéré.
L'évêque Sébastien de Montfaucon qui tenoit alors le siege épiscopal de Lausanne, fut contraint de se retirer à Fribourg, avec le vain titre d'évêque de Lausanne & de prince de l'empire, n'ayant pour vivre que ce qu'il recevoit de Savoie. Ses successeurs qui prennent toujours les mêmes titres, sont nommés par les rois de Sardaigne qui pourvoient à leur subsistance.
On croit que le siege épiscopal de cette ville avoit été établi au commencement du vij. siecle par l'évêque Marius, appellé vulgairement saint Maire, après la destruction d'Avanches (Aventicum) où ce siége étoit auparavant.
L'église cathédrale fut dédiée par le pape Grégoire XX, l'an 1275 en présence de l'empereur Rodolphe de Habsbourg.
Les peres du concile de Bâle ayant quitté Bâle en 1449, allerent siéger à Lausanne, où ils tinrent quelques séances. La bibliotheque de l'académie de Lausanne conserve un volume manuscrit des actes de ce concile. C'est ici que Felix V céda la thiare pontificale à Nicolas, pour se retirer au couvent de Ripailles, qu'il avoit fait bâtir auparavant dans le Chablais au bord du lac, & il y mourut hermite l'an 1452.
Le territoire de Lausanne est un pays admirablement cultivé, plein de vignes, de champs & de fruits ; tout y respire l'aisance, la joie & la liberté. La vûe à un quart de lieue de la ville, se promene sur la ville même, sur le lac Léman, sur la Savoie, & sur le pays entier jusqu'à Geneve : rien n'en borne l'étendue que les Alpes mêmes & le mont Jura.
Enfin Lausanne est bâtie à demi-lieue au-dessus du lac, sur trois collines qu'elle occupe entierement, avec les vallons qui sont entre-deux ; sa situation est bien plus belle que n'étoit celle de Jérusalem. Elle est à 20 lieues S. O. de Berne, 12 N. E. de Geneve. Long. 24. 20. lat. 46. 30.
Lausanne n'est pas une des villes de Suisse où les sciences soient le moins heureusement cultivées dans le sein du repos & de la liberté ; mais entre les savans dont elle est la patrie, je ne dois pas oublier M. Crouzas (Jean Pierre) associé étranger de l'académie des Sciences de Paris. Il s'est fait un nom célebre dans la république des Lettres ; comme philosophe, logicien, métaphysicien, physicien & géometre. Tout le monde connoît ses ouvrages, son examen du pyrrhonisme ancien & moderne in-fol. sa logique dont il s'est fait plusieurs éditions, & dont lui-même a donné un excellent abregé ; son traité du beau, celui de l'éducation des enfans, qui est plein d'esprit & d'une ironie délicate ; enfin plusieurs morceaux sur des sujets de physique & de mathématique. Il est mort comblé d'estime & d'années en 1748, à l'âge de 85 ans. (D.J.)
|
| LAUTER LA | (Géogr.) il y a deux rivieres de ce nom, l'une dans le Palatinat, & l'autre en Alsace. La Lauter du Palatinat a sa source au bailliage de Kayserlauter, se perd dans la riviere de Glann, & se jette dans la Nave. La Lauter en Alsace prend sa source dans les montagnes de Vosge & passe à Lauterbourg, où elle se jette dans le Rhin. (D.J.)
|
| LAUTERBOURG | Lautraburgum, (Géogr.) petite ville de France en basse Alsace sur la Lauter, à demi-lieue du Rhin, 10 N. E. de Strasbourg. Long. 26. 47. lat. 48. 56.
|
| LAUTIA | (Litter.) le mot Lautia, gén. orum, dans Tite-Live, désigne la dépense de l'entretien que les Romains faisoient aux ambassadeurs des nations étrangeres pendant leur résidence à Rome. Dès le premier jour de leur arrivée, on leur fournissoit un domicile, des vivres, & quelquefois des présens ; c'est ainsi qu'on en agit vis-à-vis d'Attalus, & c'est du mot lautia que vint celui de lautitia, magnificence, somptuosité en habits, en table & en meubles. (D.J.)
|
| LAVADEROS | en françois LAVOIRS, (Minér.) Les Espagnols d'Amérique nomment ainsi certains lieux dans les montagnes du Chily & dans quelques provinces du Pérou, où se fait le lavage d'une terre qui contient de l'or. Ils appellent aussi lavaderos les bassins où se fait ce lavage : ils sont d'une figure oblongue, & assez semblable à celle d'un soufflet à forge. Voyez OR.
|
| LAVAGE | LAVAGE
Il y a plusieurs manieres de laver les mines ; la premiere, qui est la plus commune, est celle qu'on appelle le lavage à la sibille ; on se sert pour cela d'une sibille qui est une cuvette de bois ronde & concave, dans le fond de laquelle se trouvent des rainures ou des especes de filons ; on met dans cette sibille une certaine quantité de la mine écrasée ; on verse de l'eau pardessus ; on remue le tout en donnant une secousse à chaque fois : par là on fait tomber une portion de l'eau qui s'est chargée de la partie terreuse ou pierreuse la plus légere de la mine : de cette maniere on la sépare de la partie métallique, qui étant plus pesante, reste au fond de la sibille : on réitere cette opération autant que cela est nécessaire, & jusqu'à ce qu'on voie que la mine ou le métal soient purs. Pour plus d'exactitude on fait cette opération audessus d'une cuve, dans laquelle retombe l'eau qu'on laisse échapper à chaque secousse qu'on donne à la sibille ; par ce moyen on retrouve la partie métallique qui auroit pû s'échapper. Le lavage de cette espece ne peut être que très-long ; & ne peut point avoir lieu dans le travail en grand, ni pour les mines des métaux les moins précieux : aussi ne le met-on en usage que pour les métaux précieux, natifs ou vierges. Ce lavage à la sibille est celui que pratiquent les Orpailleurs, c'est-à-dire les ouvriers qui vont chercher les paillettes d'or qui peuvent être répandues dans le sable des rivieres, qu'ils séparent de la maniere qui vient d'être décrite de ce métal précieux. Cet or s'appelle or de lavage ; voyez OR.
Le lavage des métaux précieux se fait encore au moyen de plusieurs planches unies, jointes ensemble, garnies d'un rebord, & placées de maniere qu'elles forment un plan incliné. On garnit les planches avec du feutre ou avec une étoffe de laine bien velue, & quelquefois même avec des peaux de mouton ; on fait tomber sur ces planches, à l'aide d'une gouttiere, de l'eau en telle quantité qu'on le juge convenable : de cette façon les métaux précieux qui sont divisés en particules déliées, s'accrochent aux poils de l'étoffe, & l'eau entraîne les particules les plus légéres dans une cuve ou dans une espece de réservoir qui est placé à l'extrémité de ce lavoir, où on laisse s'amasser les particules que l'eau a pû entraîner. On sent qu'il est important de ne point faire tomber une trop grande masse d'eau à la fois sur la mine qui a été étendue sur un lavoir de cette espece, parce que sa trop grande force pourroit entraîner une partie du métal que l'on veut y faire rester. Quand on a opéré de cette maniere, on détache les morceaux de feutre ou les peaux de moutons qui étoient sur les planches, & on les lave avec soin dans des cuves pour en détacher les particules métalliques qui ont pû s'y arrêter.
Sur les lavoirs de cette espece on n'attache communément que deux morceaux d'étoffe ; l'un est à la partie la plus élevée du plan incliné, l'autre à la partie inférieure. La portion de la mine qui s'attache au morceau d'étoffe supérieur, est regardée comme la plus pure ; celle qui s'attache au morceau d'étoffe inférieur est moins pure, & celle que l'eau entraîne dans la cuve ou réservoir qui est audessous du plan incliné ou lavoir, est encore moins pure que celle qui est restée sur le second morceau d'étoffe ; c'est pourquoi l'on assortit séparément ces différens résultats du lavage.
Il y a des lavoirs qui sont construits de planches de la même maniere que les précédens, mais on n'y attache point d'étoffe ; il y a seulement de distance en distance de petites rainures ou traverses de bois destinées à arrêter la mine pulvérisée, & à retarder son cours lorsqu'elle est entraînée par l'eau.
Enfin il y a des lavoirs faits avec des planches toutes unies ; on n'y fait tomber précisément que la quantité d'eau qui est nécessaire : on peut s'en servir pour le lavage des mines les plus subtilement divisées.
Voici comment l'opération du lavage se fait, tant sur les lavoirs garnis, que sur ceux qui ne le sont pas : on fait tomber de l'eau par la gouttiere sur la mine pulvérisée qui est étendue sur le lavoir ; quand l'eau tombe trop abondamment ou avec trop de force, on rompt l'impétuosité de sa chûte en lui opposant quelques baguettes de bois. Pendant que l'eau tombe, un ouvrier remue la mine pulvérisée qui est sur le lavoir avec un crochet fait pour cet usage, ou bien avec une branche de sapin, ou avec une espece de goupillon de crin, afin que l'eau la puisse pénétrer, entraîner plus aisément la partie non métallique, & la séparer de celle qui est plus chargée de métal. Il faut sur-tout, à la fin de l'opération, ne faire tomber l'eau que très-doucement, de peut de faire soulever de nouveau la partie de la mine qui s'est déjà déposée ou affaissée, ou qui s'est accrochée au morceau de feutre ou d'étoffe supérieur, lorsqu'il y en a sur le lavoir, ou à la partie supérieure du lavoir, si l'on ne l'a point garni d'étoffe.
Quelquefois on a pratiqué au-dessous de ces lavoirs des auges quarrées pour recevoir l'eau qui en tombe ; on y laisse séjourner cette eau pour qu'elle dépose la partie de la mine qu'elle peut avoir entraînée. Si la mine vaut la peine qu'on prenne beaucoup de précautions, on fait plusieurs de ces sortes de réservoirs, qui sont placés les uns au dessous des autres, afin que l'eau des réservoirs supérieurs puisse se décharger par des rigoles dans ceux qui sont plus bas : en les multipliant de cette maniere, on peut être assuré que l'on retire de l'eau toute la partie métallique qu'elle a pû entraîner. Voyez nos Pl. de Métallurgie.
Au défaut de lavoirs construits comme on vient de dire, on se sert quelquefois de tamis pour le lavage de la mine, & on la fait passer successivement par des tamis dont les mailles sont de plus en plus serrées : cette opération se fait dans des cuves pleines d'eau, au fond desquelles la partie la plus chargée de métal tombe, & celle qui l'est moins reste sur le tamis. Mais le lavage de cette derniere espece est long & coûteux ; c'est pourquoi il est plus convenable de se servir des lavoirs ordinaires, pour peu que la mine soit considérable.
Il est à propos que les lavoirs soient près du moulin à pilons du bocard, pour éviter la peine & les frais du transport ; c'est pourquoi l'on a imaginé des lavoirs qui touchent à ces moulins. Voyez LAVOIR. (-)
LAVAGE, (terme de Boyaudier) c'est la premiere préparation que ces ouvriers donnent aux boyaux dont ils veulent faire des cordes ; elle consiste à en faire sortir toute l'ordure qui y est contenue ; pour cet effet ils prennent les boyaux les uns après les autres par un bout de la main gauche, & ils glissent la main droite le long du boyau jusqu'à l'autre bout pour en faire sortir toute l'ordure ; après quoi ils les mettent amortir dans un chauderon.
LAVAGE des draps, (Draperie) Voyez l'article MANUFACTURE EN LAINE.
LAVAGE des chiffons, (Papeterie) c'est l'action par laquelle on nettoie avec de l'eau toutes les saletés dont les chiffons sont couverts ; la façon ordinaire de laver les chiffons est de les mettre dans un poinçon ou cuve dont le fond est percé d'une grande quantité de petits trous, & qui a sur le côté des grillages de fil d'archal bien forts ; on y remue souvent ces morceaux de linge afin que la saleté s'en sépare, & même on en change souvent l'eau. Quand ils sont suffisamment lavés on les porte au pourrissoir. Voyez l'article PAPETERIE.
LAVAGE, (Salpêtre) voyez SALPETRE.
|
| LAVAGNA | (Hist. nat.) c'est une espece d'ardoise qui se tire aux environs de Gènes sur la côte de Lavagna, à deux ou trois lieues de Rapallo. On couvre les maisons de cette ardoise, & on en fait du pavé. Elle est encore propre par sa grandeur & son épaisseur à des tableaux de peinture au défaut de la toile, & dans les lieux où l'on craindroit que la toile ne vint à pourrir. On en a fait l'expérience avec succès, car il y a des tableaux peints sur cette espece d'ardoise dans l'église de saint Pierre de Rome, entr'autres un de Civoli, représentant saint Pierre qui guérit un boiteux à la porte du temple de Jérusalem. (D.J.)
LAVAGNA, (Géogr.) riviere d'Italie dans l'état de Gènes ; elle a sa source dans l'Apennin, & se jette dans la mer entre le bourg de Lavagna & Chiavari.
|
| LAVAL | (Géograph.) On la nomme aujourd'hui Laval-Guyon, en latin Vallis-Guidonis ; ville de France dans le bas Maine, avec titre de comté-pairie. Elle est à 6 lieues de Mayenne, 16 N. O. du Mans ; 14 de Rennes, d'Angers & de la Fleche ; 58 S. O. de Paris. Long. 16. 45. lat. 48. 4.
Laval n'est point dépourvûe de gens de lettres nés dans son sein : ma mémoire me fournit les quatre suivans.
Bigot (Guillaume), qui fleurissoit sous François I. Ce prince, ayant oui parler de sa grande érudition, voulut lui faire du bien, mais on trouva le secret de l'en détourner par une méchanceté qui n'a que trop souvent réussi à la cour. On dit au roi que Bigot étoit un politique aristotélicien, préférant, comme ce grec, le gouvernement démocratique à la monarchie. Alors François I. se récria qu'il ne vouloit plus voir ni favoriser de ses graces un fou qui adhéroit à de pareils principes.
Rivault (David), sieur de Flurance, devint précepteur de Louis XIII. & fit entr'autres ouvrages des élémens d'artillerie, imprimés en 1608 in-8°, qui sont rares & assez curieux. Il mourut en 1616 âgé de 45 ans.
Tauvry (Daniel), de l'académie des sciences, ingénieux anatomiste, mais trop épris de l'amour des systèmes, qui lui fit adopter des erreurs pour des vérités. Il mourut en 1700 à la fleur de son âge, à 31 ans.
Paré (Ambroise) s'est immortalisé dans la Chirurgie. Il finit ses jours en 1592, & peu s'en fallut que ce ne fût 20 ans plûtôt, je veux dire dans le massacre de la S. Barthélemi ; mais Charles IX. dont il étoit le premier chirurgien, le sauva de cette boucherie, soit par reconnoissance ou pour son intérêt personnel. (D.J.)
|
| LAVANCHES | LAVANGES ou AVALANCHES, s. m. (Hist. nat.) en latin labina, en allemand lauwinen. On se sert en Suisse de ces différens noms pour désigner des masses de neige qui se détachent assez souvent du haut des Alpes, des Pyrénées, & des autres montagnes élevées & couvertes de neiges, qui, après s'être peu-à-peu augmentées sur la route, forment quelquefois, sur-tout lorsqu'elles sont aidées par le vent, des masses immenses, capables d'ensevelir entierement des maisons, des villages, & même des villes entieres qui se trouvent au bas de ces montagnes. Ces masses de neige, sur-tout quand elles ont été durcies par la gélée, entraînent les maisons, les arbres, les rochers, en un mot, tout ce qui se rencontre sur leur passage. Ceux qui voyagent en hiver & dans des tems de dégel dans les gorges des Alpes, sont souvent exposés à être ensevelis sous ces lavanches ou éboulemens de neige. La moindre chose est capable de les exciter & de les mettre en mouvement ; c'est pour cela que les guides qui conduisent les voyageurs, leur imposent un silence très-rigoureux, lorsqu'ils passent dans de certains défilés de ces pays qui sont dominés par des montagnes presque perpétuellement couvertes de neige.
On distingue deux sortes de lavanches : celles de la premiere espece sont occasionnées par des vents impétueux ou des ouragans qui enlevent subitement les neiges des montagnes, & les répandent en si grande abondance que les voyageurs en sont étouffés & les maisons ensevelies. Les lavanches de la seconde espece se produisent lorsque les neiges amassées sur le haut des montagnes & durcies par les gelées, tombent par leur propre poids le long du penchant des montagnes, faute de pouvoir s'y soutenir plus long-tems ; alors ces masses énormes écrasent & renversent tout ce qui se rencontre sur leur chemin.
Rien n'est plus commun que ces sortes de lavanches, & l'on en a vû un grand nombre d'effets funestes. En l'année 1755, à Bergemoletto, village situé dans la vallée de Stura en Piémont, plusieurs maisons furent ensevelies sous des lavanches ; il y eut entr'autres une de ces maisons dans laquelle deux femmes & deux enfans se trouverent renfermés par la neige. Cette captivité dura depuis le 19 du mois de Mars jusqu'au 25 d'Avril, jour auquel ces malheureux furent enfin délivrés. Pendant ces trente-six jours ces pauvres gens n'eurent d'autre nourriture que quinze châtaignes, & le peu de lait que leur fournissoit une chêvre qui se trouva aussi dans l'étable où la lavanche les avoit ensevelis. Un des enfans mourut, mais les autres personnes eurent le bonheur de réchapper, par les soins qu'on en prit lorsqu'elles eurent été tirées de cette affreuse captivité.
On donne aussi le nom de lavanches de terre aux éboulemens des terres qui arrivent assez souvent dans ces mêmes pays de montagnes ; cela arrive surtout lorsque les terres ont été fortement détrempées par le dégel & par les pluies : ces sortes de lavanches causent aussi de très-grands ravages. Voyez Scheuchzer, hist. nat. de la Suisse, & le journal étranger du mois d'Octobre 1757. (-)
|
| LAVANDE | lavandula, s. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale labiée, dont la levre supérieure est relevée, arrondie & ordinairement fendue ; la levre inférieure est partagée en trois parties : il sort du calice un pistil attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré de quatre embrions ; ils deviennent dans la suite autant de semences renfermées dans une capsule qui a été le calice de la fleur. Ajoutez aux caracteres de ce genre que les fleurs naissent à la cime des tiges & des branches, & qu'elles sont disposées en épi. Tournefort inst. rei herb. Voyez PLANTE.
M. de Tournefort compte dix especes de ce genre de plante, mais nous ne décrirons ici que la lavande mâle & la lavande femelle, employées indifféremment dans la Medecine & dans les Arts.
La lavande mâle, le nard commun, le spic, s'appelle en Languedoc & en Provence l'aspic, & par les Botanistes lavandula major ou latifolia.
Sa racine ligneuse, divisée en plusieurs fibres, pousse des jets ligneux de la hauteur d'une coudée & demie ou de deux coudées, garnis de plusieurs rameaux grêles, quadrangulaires, noueux : ses feuilles inférieures sont nombreuses & placées presque sans ordre ; celles qui sont plus haut sont au nombre de deux, rangées alternativement en sautoir, charnues, blanches, larges de deux lignes, quelquefois de six, longues de deux ou trois pouces, garnies d'une côte dans leur milieu d'une odeur forte & agréable, d'une saveur amere.
Ses fleurs sont au sommet des rameaux, disposées en épi & par anneaux, bleues, d'une seule piece, en gueule, dont la levre supérieure est redressée, arrondie, découpée en partie, & l'inférieure partagée en trois. Leur calice est oblong & étroit ; il en sort un pistil attaché en maniere de clou à la partie postérieure de la fleur, accompagné de quatre embryons qui se changent en autant de grains renfermés dans une capsule, laquelle servoit de calice à la fleur.
Ses feuilles sont beaucoup plus longues, plus larges, plus blanches & plus nombreuses sur les tiges & les rameaux, que dans la lavande femelle.
Les pédicules portent aussi des épics deux fois plus gros, plus longs & recourbés, & des fleurs plus petites, ce qui est assez surprenant : l'odeur de toute cette plante est aussi plus forte.
La lavande femelle, lavandula minor, lavandula angustifolia, est presque en tout semblable à la précédente pour la figure, mais un peu plus petite & plus basse, d'ailleurs également touffue. Ses feuilles sont plus petites, plus étroites & plus courtes ; elles ne sont pas si blanches & leur odeur n'est pas si forte. Les épics qui portent les fleurs sont, comme on l'a déjà dit, plus courts & plus droits ; les fleurs cependant sont plus grandes ; la couleur des fleurs de l'une & de l'autre varie, & est quelquefois blanche.
Ces deux especes viennent d'elles-mêmes dans les pays chauds, mais on les cultive dans les climats tempérés, parce qu'on en tire des préparations d'un grand usage. Voyez LAVANDE Chimie, Pharmacie, Medecine. (D.J.)
LAVANDE, (Chimie, Pharm. & Mat. med.) ce sont les épics des fleurs de la petite lavande ou lavande femelle, qui sont le sujet de cet article.
On retire par la distillation des calices de ces fleurs, cueillies quand le plus grand nombre est épanoui, une huile essentielle, abondante & très-aromatique, voyez HUILE, qui a passé presqu'entierement des autres parties de la plante dans celle-ci par le progrès de la végétation, voyez VEGETATION.
Les pétales de ces fleurs ne contiennent point de ce principe : la même observation a été faite sur toutes les fleurs de la classe des labiées de Tournefort. Voyez ANALYSE VEGETALE au mot VEGETAL.
Quand on fait la récolte des fleurs ou plûtôt des calices de lavande, on doit avoir grand soin de ne pas les garder en tas, car ces fleurs s'échauffent promtement, & perdent par cette altération, qui peut arriver en moins de quatre heures, tout l'agrément de leur parfum ; une partie de leur huile essentielle peut même être dissipée ou détruite par ce mouvement intestin.
On doit donc, si on les destine à la distillation, y procéder immédiatement après qu'elles sont cueillies, ou les mettre à sécher sur-le-champ en les clairsement sur des linges ou sur des tamis, si on se propose de les garder.
On prépare aussi avec ces calices une eau spiritueuse connue sous le nom d'esprit de lavande, voyez EAUX DISTILLEES, & une teinture avec l'esprit-de-vin ou l'eau-de-vie, connue sous le nom d'eau-de-vie de lavande.
La liqueur appellée eau de lavande, dont l'usage pour les toilettes est assez connu, qui blanchit avec l'eau, & que les religieuses de la Madelaine de Treinel sont en possession de vendre à Paris ; cette eau, dis-je, n'est autre chose qu'une dissolution d'huile essentielle de lavande dans l'esprit-de-vin. On préfere avec raison cette liqueur à l'esprit & à l'eau de vie de lavande ; son parfum est plus doux & plus agréable. Lorsqu'on la frotte entre les mains, elle ne laisse point de queue, c'est-à-dire qu'elle n'exhale point une odeur forte & résineuse qu'on trouve dans ces deux autres liqueurs.
Pour faire de la bonne eau de lavande de Treinel (comme on l'appelle à Paris), il n'y a qu'à verser goutte à goutte de l'huile récente de lavande dans du bon esprit-de-vin, & la mêler en battant la liqueur dans une bouteille, la dose de l'huile se détermine par l'odeur agréable qu'acquiert le mélange. Un gros d'huile suffit ordinairement pour une pinte d'esprit-de-vin.
L'eau distillée de lavande, celle qui s'est élevée avec l'huile dans la distillation, est fort chargée du principe aromatique, mais elle est d'une odeur peu agréable.
Les Apoticaires préparent avec les fleurs de lavande une conserve qui est fort peu usitée. Les préparations chimiques dont nous venons de parler, ne sont aussi que fort rarement mises en usage dans le traitement des maladies ; on se sert seulement de l'esprit de l'eau ou de l'eau-de-vie de lavande contre les meurtrissures, les plaies legeres, les écorchures, &c. mais on se sert de ces remedes parce qu'on les a plûtôt sous la main que de l'esprit-de-vin ou de l'eau-de-vie pure.
C'est par la même raison qu'on flaire un flacon d'eau de lavande dans les évanouissemens ; que les personnes, dis-je, qui sont assez du vieux tems pour avoir de l'eau de lavande dans leur flacon, les flairent, &c. plûtôt qu'une autre eau spiritueuse quelconque, qui seroit tout aussi bonne. Il n'est personne qui ne voye que ce sont ici des propriétés très-génériques.
Les calices de lavande, soit frais, soit séchés, sont presque absolument inusités dans les prescriptions magistrales ; mais ils sont employés dans un très-grand nombre de préparations officinales, tant intérieures qu'extérieures, parmi lesquelles celles qui sont destinées à échauffer, à ranimer, à exciter la transpiration, à donner du ton aux parties solides, &c. empruntent réellement quelques propriétés de ces calices, qui possedent éminemment les vertus dont nous venons de faire mention : celles au contraire qu'on ne sauroit employer dans ces vûes, telles que l'emplâtre de grenouilles & le baume tranquille, n'ont dans les fleurs de lavande qu'un ingrédient très-inutile. (b)
|
| LAVANDIER | S. m. (Hist. mod.) officier du roi, qui veille au blanchissage du linge. Il y a deux lavandiers du corps, servant six mois chacun ; un lavandier de pannetterie-bouche ; un lavandier de pannetterie commun ordinaire ; deux lavandiers de cuisine-bouche & commun.
|
| LAVANDIERE | S. f. (Hist. nat. Ornitholog.) motacilla alba, petit oiseau qui a environ sept pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout de la queue, & onze pouces d'envergeure. Le bec est noir, mince & pointu ; les ongles sont longs, & celui du doigt postérieur est, comme dans les allouettes, le plus long de tous. Il y a autour de la piece supérieure du bec & autour des yeux des plumes blanches qui s'étendent de chaque côté, presque jusqu'à l'aîle. Le sommet de la tête, le dessus & le dessous du cou sont noirs, & le milieu du dos est mêlé de noir & de cendré ; la poitrine & le ventre sont blancs ; le croupion est noir. Cet oiseau agite continuellement sa queue, c'est pourquoi on lui a donné le nom de motacilla. Il reste dans les lieux où il y a de l'eau, le long des rivieres & des ruisseaux ; il se nourrit de mouches & de vermisseaux ; il suit la charrue pour se saisir des vers qu'elle découvre. Willugh. Ornith. Voyez OISEAU.
|
| LAVANT-MUN | ou LAVAND-MYND, (Géog.) petite ville d'Allemagne au cercle d'Autriche, en Carinthie, à l'embouchure du Lavant dans la Drave. Elle a titre d'évêché, & appartient à l'archevêque de Saltzbourg, dont elle est suffragante ; sa position est à 16 lieues N. O. de Pettaw. Long. 32. 45. latit. 46. 44. (D.J.)
|
| LAVARET | S. m. (Hist. nat. Icthyol.) espece de saumon ou de truite qui se trouve dans les lacs du Bourget & d'Aiguebelle en Savoie. Le lavaret a le dernier aîleron du dos gras & rond comme le saumon & la truite ; il est de la longueur d'un pié ; son corps est poli, applati comme au hareng & à l'alose ; couvert d'écailles claires & argentées, & traversé d'une ligne depuis les ouies jusqu'à la queue. Il a près des ouies deux aîles ; deux au ventre près de l'anus, une autre sur le dos assez grande, & une sixieme grasse comme aux truites ; sa queue faite en deux pointes noires par le bout ; il a de chaque côté quatre ouies doubles ; le coeur fait à angles ; le foie sans fiel ; point de dents ; la chair blanche, molle, de bon goût, point gluante, d'un suc salubre & moyennement nourrissant. Il fait ses oeufs en automne. Rondelet.
|
| LAVATERA | S. f. (Hist. nat. Botan.) genre de plante dont la fleur est tout-à-fait semblable à celle de la mauve ; mais le pistil devient un fruit d'une structure toute différente. C'est une espece de bouclier membraneux, enfoncé sur le devant, garni en dessous d'un rang de semences, disposées en maniere de cordon, de la forme d'un petit rein sans enveloppe, attachées par leur échancrure à un petit filet. " Tournefort, Mem. de l'acad. Roy. des Scienc. année 1706. Voyez PLANTE.
|
| LAVATION | S. f. (Littérat.) fête des Romains, en l'honneur de la mere des dieux. On portoit ce jour-là, sur un char, la statue de la déesse, & on alloit ensuite la laver dans le ruisseau Almont, à l'endroit où il se jette dans le Tibre ; cette solemnité qu'on célébroit le 25 de Mars, fut instituée en mémoire du jour que le culte de Cybele fut apporté de Phrygie à Rome. (D.J.)
|
| LAVATRA | lavatra, gen. orum. (Géog. anc.) ancien lieu de la grande Bretagne, selon l'itinéraire d'Antonin, entre Caractoni & Verteris. Comme on place Caractoni à Cattarie, & Verteris à Brongh, on croit que Lavatra étoit à Bow ; mais il semble, dit M. Gale, qu'il reste encore des vestiges du nom de Lavatra dans celui de Lartingten, bourgade voisine, située sur le ruisseau de Laver. (D.J.)
|
| LAVAUR | (Géog.) Ce mot est composé du nom même, & de l'article, desorte qu'il devroit s'écrire La-Vaur ; car le nom latin est Vaurum, Vaurium, ou Castrum vauri, ville de France dans le haut-Languedoc, avec un évêché érigé par Jean XXII en 1316, suffragant de Toulouse. Il s'y tint, vers l'an 1212, un concile contre les Albigeois, dont elle embrassoit la doctrine. Cette ville est sur l'Agoût, à 8 lieues S. O. d'Alby, 8 N. E. de Toulouse, 160 S. O. de Paris. Long. 19. 32. lat. 43. 42.
|
| LAVE | S. f. (Hist. nat.) en italien lava, nom générique que l'on donne aux matieres liquides & vitrifiées que le Vésuve, l'Etna & les autres volcans vomissent dans le tems de leurs éruptions. Ce sont des torrens embrasés qui sortent alors, soit par le sommet, soit par des ouvertures latérales qui se forment dans les flancs de ces montagnes. Ces matieres devenues liquides par la violence du feu, coulent comme des ruisseaux le long de la pente du volcan ; elles consument & entraînent les arbres, les roches, le sable & tout ce qui se trouve sur leur passage, & vont quelquefois s'étendre jusqu'à la distance de plus d'une lieue de l'endroit d'où elles sont sorties ; elles couvrent des campagnes fertiles d'une croûte souvent fort épaisse, & produisent les ravages les plus grands.
Ces matieres fondues sont très-long-tems à se refroidir ; & quelquefois plusieurs mois après leur éruption, on voit encore qu'il en part de la fumée, ce qui vient de la chaleur excessive dont les laves ont été pénétrées, & de la grandeur énorme de leur masse, qui fait que la chaleur s'y est conservée. Plus d'un mois après la grande éruption du Vésuve, arrivée en 1737, on voulut dégager le grand chemin que la lave sortie de ce volcan avoit embarrassé ; mais les ouvriers furent bientôt forcés d'abandonner leur entreprise, parce qu'ils trouverent l'intérieur de la lave encore si embrasée, qu'elle rougissoit & amollissoit les outils de fer dont ils se servoient pour ce travail.
Quant à la masse des laves, elle est quelquefois d'une grandeur énorme. Dans l'éruption du mont Etna, de 1669, qui détruisit entierement la ville de Catane en Sicile, le torrent liquide alla si avant dans la mer, qu'il y forma un mole ou une jettée assez grande pour servir d'abri à un grand nombre de vaisseaux. Voyez l'histoire du mont Vésuve. Suivant ce même ouvrage, qui est dû aux académiciens de Naples, la longueur du torrent principal de lave qui sortit du Vésuve en 1737, étoit de 3550 cannes napolitaines, dont chacune porte 8 palmes, c'est-à-dire 80 pouces de Paris. Ce même torrent dans l'espace occupé par les 750 premieres cannes, à compter depuis sa source, avoit aussi 750 cannes de largeur, & 8 palmes ou 80 pouces d'épaisseur. A l'égard des 2800 cannes restantes, elles avoient valeur commune 188 cannes de largeur, & environ 30 palmes d'épaisseur. De ce torrent énorme, il en partoit des rameaux, ou comme des ruisseaux plus petits, qui se répandirent dans la campagne. On calcula alors toutes les laves que le Vésuve vomit dans cette occasion, & l'on trouva que la somme totale de la matiere fondue alloit à 595948000 palmes cubiques, sans compter les cendres & les pierres détachées, vomies par ce volcan dans la même éruption. Cet exemple peut suffire pour donner une idée de la grandeur & de l'étendue des laves. Voyez l'hist. du Vésuve, pag. 135. & suiv.
La lave ne peut être regardée que comme un mélange de pierres, de sable, de terres, de substances métalliques, de sels, &c. que l'action du feu des volcans a calcinées, mises en fusion & changées en verre : mais comme toutes les matieres qui éprouvent l'action du feu ne sont point également propres à se vitrifier, les combinaisons qui résultent de cette action du feu ne sont point les mêmes ; voilà pourquoi la lave, après avoir été refroidie, se montre sous tant de formes différentes, & présente une infinité de nuances de couleurs & de variétés. La lave la plus pure ressemble parfaitement à du verre noir, tel que celui des bouteilles ; de cette espece est la pierre que l'on trouve en plusieurs endroits du Pérou, & que les Espagnols nomment pedra di Gallinaço. C'est un verre dur, noir, homogene & compact, on ne peut être embarrassé de deviner l'origine de cette pierre, quand on sait que le Pérou est exposé à de fréquentes éruptions des volcans, dont il n'est point surprenant de rencontrer par-tout des traces.
Une autre espece de lave est dure, pesante, compacte comme du marbre, & susceptible comme lui de prendre un très-beau poli. Telle est la lave décrite par M. de la Condamine, dans la relation curieuse de son voyage d'Italie, que cet illustre académicien a lûe en 1757 à l'académie des Sciences de Paris. Cette lave est d'un gris sale, parsemée de taches noires comme quelques especes de serpentine ; on y remarque quelques particules talqueuses & brillantes. On en fait à Naples des tables, des chambranles, & même des tabatieres, &c. Ce curieux voyageur dit en avoir vû des tables d'un pouce d'épaisseur, qui s'étoient voilées & déjettées comme feroit une planche ; ce qui vient, suivant les apparences, des sels contenus dans cette lave, sur lesquels l'air est venu à agir.
Il y a de la lave qui, sans être aussi compacte que la précédente, & sans être susceptible de prendre le poli comme elle, ne laisse point d'avoir beaucoup de consistance & de solidité ; celle-là ressemble à une pierre grossiere, elle est communément d'un gris de cendre, quelquefois elle est rougeâtre. Elle est très-bonne pour bâtir ; c'est d'une lave de cette espece que la ville de Naples est pavée.
Enfin, il y a une espece de lave encore plus grossiere, qui se trouve ordinairement à la surface des torrens liquides d'une lave plus dense ; elle est inégale, raboteuse, spongieuse, & semblable aux scories qui se forment à la surface des métaux qu'on traite dans les fourneaux des fonderies. Cette espece de lave prend toutes sortes de formes bisarres & de couleurs différentes ; les inégalités qu'elle forme font que les endroits couverts de cette lave présentent le coup-d'oeil d'une mer agitée, ou d'un champ profondément sillonné. Souvent cette lave contient du soufre, de l'alun, du sel ammoniac, &c.
Entre les différentes especes de laves qui viennent d'être décrites, il y a encore un grand nombre de nuances & d'états sous lesquels cette matiere se présente ; & l'on y remarque des différences presque infinies pour la couleur, la consistance, la forme & les accidens qui les accompagnent.
La ville d'Herculaneum, ensevelie depuis environ dix-sept siecles sous les cendres & les laves du Vésuve, est un monument effrayant des ravages que peuvent causer ces inondations embrasées. Mais une observation remarquable est celle qu'a fait M. de la Condamine, qui assure que les fondemens de plusieurs maisons de cette ville infortunée ont eux-mêmes été bâtis avec de la lave, ce qui prouve l'antiquité des éruptions du Vésuve. A ce fait on en peut joindre un autre, c'est que M. le marquis de Curtis, seigneur napolitain, qui avoit une maison de campagne à quelque distance du Vésuve, voulant faire creuser un puits, fut plusieurs années avant que de réussir, & on rencontra jusqu'à trois couches très-épaisses de lave, séparées par des lits de terre & de sable intermédiaires qu'il fallut percer avant que de trouver de l'eau.
Il n'est point surprenant que les endroits voisins du Vésuve soient remplis de laves ; mais l'Italie presque entiere, suivant la remarque de M. de la Condamine, en renferme dans son sein, dans les endroits même les plus éloignés de ce volcan ; ce qui semble prouver que dans des tems de l'antiquité la plus reculée, l'Apennin a été une chaîne de volcans dont les éruptions ont cessé. Suivant ce savant voyageur, la pierre qu'on tire des carrieres du voisinage de Rome est une véritable lave, que l'on prend communément pour une pierre ordinaire. La fameuse voie appienne, à en juger par ce qui en reste, paroît avoir été faite de lave. La prison tullienne, que l'on regarde comme le plus ancien édifice de Rome, est bâtie d'une pierre qui, ainsi que le tevertino ou la pierre de Tivoli, semble être une vraie lave ou pierre formée par les volcans. De toutes ces observations, M. de la Condamine conclut que " ces plaines aujourd'hui riantes & fertiles, couvertes d'oliviers, de mûriers & de vignobles, ont été comme les côteaux du Vésuve, inondés de flots brûlans, & portent comme eux dans leur sein, non seulement les traces de ces torrens de feu, mais leurs flots mêmes refroidis & condensés, témoins irrécusables de vastes embrasemens antérieurs à tous les monumens historiques ".
Ce n'est point seulement pour l'Italie que ces réflexions doivent avoir lieu, plusieurs autres pays sont dans le même cas ; & l'on y bâtit avec de la lave, sans se douter de la cause qui a produit les pierres que l'on employe à cet usage, & sans savoir qu'il y ait eu anciennement des volcans dans le pays où ces pierres se trouvent. En effet, il y a bien des pierres à qui la lave ressemble ; & il est aisé, suivant ce qu'on a dit, de la prendre quelquefois pour du marbre, ou pour de la serpentine, ou pour quelques pierres poreuses assez communes. M. Guétard, de l'académie des Sciences, a reconnu que des pierres trouvées en Auvergne sur le Puits de Dome & sur le Mont-d'or, étoient de la vraie lave, semblable à celle du Vésuve & de l'Etna. M. de la Condamine présume que la pierre dont on bâtit à Clermont en Auvergne est de la même nature que celle de Tivoli dont on a parlé. Voyez le Mercure du mois de Septembre 1757, & les mémoires de l'académie royale des Sciences, ann. 1752. & 1757. (-)
Ces découvertes doivent exciter l'attention des Naturalistes, & les engager à considérer plus soigneusement certaines pierres qu'ils ne soupçonnent point d'être de la lave ou des produits des volcans, parce que l'histoire ne nous a quelquefois point appris qu'il y ait eu jamais de volcans dans les cantons où on les trouve. Voyez VOLCANS.
|
| LAVÉ | (Maréchallerie) le poil lavé se dit de certains poils du cheval qui sont pâles ou de couleur fade. Les extrémités lavées. Voyez EXTREMITES.
|
| LAVEDA | (LE), Levitanensis pagus ou Levitania, (Géog.) vallée de France dans le Bigorre, entre les Pyrénées. Elle a 10 à 12 lieues de long, sur 7 à 8 de large, & est très-fertile. Lourde en est la place principale, son territoire, & la vallée de Bareige située au pié de la montagne de Tormales, à une lieue du royaume d'Aragon, dont il est séparé par les Pyrénées, s'est acquis de la célébrité par ses eaux bourbeuses médicinales. Voyez sur le Lavedan, Hadrien Valler, notit. Galliae p. 84. & l'abbé de Longuerue, I. part. p. 205. (D.J.)
|
| LAVEG | ou LAVEZZI, s. f. (Hist. nat.) nom d'une pierre du genre de celles qu'on nomme pierres ollaires ou pierres à pot ; elle est grisâtre, rarement marbrée ou mélée de différentes couleurs. On connoît trois carrieres de cette pierre : l'une est à Pleurs en Suisse ; l'autre, dans la Valteline au comté de Chiavenne, & la troisieme dans le pays des Grisons. Cette pierre a la propriété de se tailler très-aisément & de se durcir au feu ; on en fait des marmites, des pots, & d'autres ustensiles de ménage, dont on fait un très-grand commerce dans la Suisse & le Milanois ; on prétend que l'eau chauffe beaucoup plus promtement dans ces sortes de vaisseaux que dans ceux qui sont métalliques. Cette pierre est douce au toucher ; on la tire avec beaucoup de peine du sein de la terre, parce que les ouvriers sont obligés de travailler couchés, vû que les passages qui sont pratiqués dans cette carriere sont fort étroits. L'on tourne au tour les masses de lavege qui ont été tirées de la terre, & formées en cylindres. C'est un moulin à eau qui fait mouvoir ce tour ; il est arrangé de façon que l'ouvrier qui tourne, peut arrêter la machine à volonté. Voyez PIERRE OLLAIRE.
|
| LAVELLO | Labellum, (Géogr.) ancienne petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Basilicate, aux confins de la Capitanate, avec un évêché suffragant de Bari, à 6 lieues N. O. de Cirenza, 18 S. O. de Bari, 30 N. E. de Naples. Longit. 33. 30. latit. 41. 3. (D.J.)
|
| LAVEMENT | LAVEMENT
Les Orientaux avoient coutume de laver les piés aux étrangers qui venoient de voyage, parce que pour l'ordinaire on marchoit les jambes nues & les piés seulement garnis d'une sandale. Ainsi Abraham fit laver les piés aux trois Anges, Genese xviij. v. 4. On lava aussi les piés à Eliéser & à ceux qui l'accompagnoient lorsqu'ils arriverent à la maison de Laban, & aux freres de Joseph lorsqu'ils vinrent en Egypte, Genese xxiv. v. 32. & xliij. v. 24. Cet office s'exerçoit ordinairement par des serviteurs & des esclaves. Abigaïl témoigne à David qui la demandoit en mariage, qu'elle s'estimeroit heureuse de laver les piés aux serviteurs du roi, I. Reg. xxv. v. 41.
Jesus-Christ, après la derniere cene qu'il fit avec ses apôtres, voulut leur donner une leçon d'humilité en leur lavant les piés. Et cette action est devenue depuis un acte de piété. Ce que le Sauveur dit en cette occasion à saint Pierre : Si je ne vous lave, vous n'aurez point de part avec moi, a fait croire à plusieurs anciens que le lavement des piés avoit des effets spirituels. Saint Ambroise, lib. de Myster. c. vj. témoigne que de son tems on lavoit les piés aux nouveaux baptisés au sortir du bain sacré, & il semble croire que, comme le baptême efface les péchés actuels, le lavement des piés, qui se donne ensuite, ôte le péché originel, ou du moins diminue la concupiscence. Ideò, dit-il, planta abluitur ut haereditaria peccata tollantur : nostra enim propria per baptismum relaxantur. Il dit la même chose sur le Pseaume xlviij. Alia est iniquitas nostra, alia calcanei nostri.... unde Dominus discipulis lavit pedes ut lavaret venena serpentis. Mais il explique lui-même sa pensée en ajoutant que ce qui est nettoyé par le lavement des piés, est plutôt la concupiscence ou l'inclination au péché, que le péché même : unde reor iniquitatem calcanei magis lubricum delinquendi, quam reatum aliquem nostri est delicti.
L'usage de laver les piés aux nouveaux baptisés n'étoit pas particulier à l'église de Milan. On le pratiquoit aussi dans d'autres églises d'Italie, des Gaules, d'Espagne & d'Afrique. Le concile d'Elvire le supprima en Espagne par la confiance superstitieuse que le peuple y mettoit, & il paroît que dans les autres églises on l'a aboli à mesure que la coutume de donner le baptême par immersion a cessé. Quelques anciens lui ont donné le nom de Sacrement, & lui ont attribué la grace de remettre les péchés véniels ; c'est le sentiment de saint Bernard & d'Eunalde abbé de Bonneval. Saint Augustin croit que cette cérémonie pratiquée avec foi peut effacer les péchés veniels ; & un ancien auteur, dont les sermons sont imprimés dans l'appendix du V. vol. des ouvrages de ce pere, soutient que le lavement des piés peut remettre les péchés mortels. Cette derniere opinion n'a nul fondement dans l'Ecriture : quant au nom de sacrement donné à cette cérémonie par saint Bernard & d'autres, on l'explique d'un sacrement improprement dit, du signe d'une chose sainte, c'est-à-dire de l'humilité, mais auquel Jesus-Christ n'a point attaché de grace sanctifiante comme aux autres sacremens.
Les Syriens célebrent la fête du lavement des piés le jour du jeudi-saint. Les Grecs font le même jour le sacré niptere, ou le sacré lavement. Dans l'Eglise latine, les évêques, les abbés, les curés dans quelques dioceses, les princes même lavent ce jour-là les piés à douze pauvres qu'ils servent à table, ou auxquels ils font des aumônes. On fait aussi le même jour la cérémonie du lavement des autels, en répandant de l'eau & du vin sur la pierre consacrée, & en récitant quelques prieres & oraisons. Calmet, Diction. de la Bible, tome II. pages 507 & 508.
LAVEMENT des mains, voyez MAIN.
LAVEMENT, Pharmacie, voyez CLYSTERE.
|
| LAVENBOURG | (Géog.) petite ville d'Allemagne dans la Poméranie ultérieure, & dans les états du roi de Prusse, électeur de Brandebourg. Long. 35. 28. lat. 54. 45. (D.J.)
|
| LAVENZA | (Géog.) ville d'Italie, sur une riviere de même nom, qui s'y jette dans la mer.
|
| LAVER | v. act. (Gram.) ce verbe désigne l'action de nettoyer avec un fluide ; mais il a d'autres acceptions, dont nous allons donner quelques-unes.
LAVER, en terme de Boyaudier, c'est démêler les boyaux sortant de la boucherie les uns d'avec les autres : quand on sait la maniere dont les bouchers arrachent ces boyaux du ventre de l'animal, cette opération n'a rien de difficile.
LAVER, (Draperie) voyez l'article MANUFACTURE EN LAINE.
LAVER, en terme d'Epinglier, c'est ôter dans une seconde eau le reste de la gravelle qui s'étoit attachée aux épingles dans le blanchissage. Le baquet est suspendu à deux crochets, & l'ouvrier le remue comme on feroit un crible à froment. Voyez les Planches de l'Epinglier.
LAVER LES FORMES dans l'Imprimerie : on est obligé de laver les formes ; pour cet effet, on les porte au baquet, on verse dessus une quantité de lessive capable de les y cacher, on les y brosse dans toute leur étendue ; après quoi, on les rinse à l'eau nette : cette fonction essentielle se doit faire avant de mettre les formes sous la presse, quand le tirage en est fini & tous les soirs en quittant l'ouvrage. Voyez LESSIVE, BAQUET.
LAVER AU PLAT, (à la Monnoie) c'est séparer par plusieurs lotions les parties les plus fortes du métal qui se trouve au fond des plateaux, que l'on apperçoit facilement à l'oeil, & qui peuvent se retirer à la main sans y employer d'autre industrie.
LAVER, (Peinture) c'est passer avec un pinceau de l'encre de la Chine délayée dans de l'eau, ou une autre couleur délayée dans de l'eau gommée, sur des objets dessinés au crayon, ou à la plume sur du papier ou sur du vélin. Lorsqu'on lave à l'encre de la Chine, ou avec une couleur seulement, la blancheur du papier ou vélin fait les lumieres ou rehauts, & les ombres perdent insensiblement de leur force en approchant des lumieres suivant qu'on met plus ou moins d'eau dans l'encre, ou couleur qu'on y emploie. Et lorsqu'on lave sur du papier coloré, l'on rehausse avec du blanc pareillement délayé dans de l'eau gommée. L'on lave quelquefois aussi les desseins ou plans, de coloris, c'est-à-dire, en donnant à chaque objet la couleur qui lui convient, autant que cette façon de peindre peut se comporter, & alors on peut se servir généralement de toutes les couleurs dont usent les Peintres, en observant néanmoins qu'elles doivent être délayées dans de l'eau gommée, presque aussi liquides que l'eau même. Les fossés remplis d'eau se lavent d'un bleu clair, les briques & les toiles d'une couleur rougeâtre, les murailles d'un gris un peu jaune, les chemins d'un gris roussâtre, les arbres & les gazons de verd, &c.
L'on dit laver à l'encre de la Chine, desseins, plan, laver de brun, de rouge, de bistre, &c.
LAVER ; en terme de Plumassier, c'est rinser les plumes dans de l'eau nette après les avoir savonnées.
|
| LAVERNE | (Mythol. & Littérat.) en latin Laverna, déesse des voleurs & des fourbes chez les Romains.
Les voleurs se voyant persécutés sur la terre, songerent à s'appuyer de quelque divinité dans le ciel : la haine que l'on a pour les larrons, sembloit devoir s'étendre sur une déesse qui passoit pour les protéger ; mais comme elle favorisoit aussi tous ceux qui desiroient que leurs desseins ne fussent pas découverts, cette raison porta les Romains à honorer Laverne d'un culte public. On lui adressoit des prieres en secret & à voix basse, & c'étoit-là sans-doute la partie principale de son culte.
Elle avoit, dit Varron, un autel proche une des portes de Rome, qui se nomma pour cela la porte lavernale, porta lavernalis ab arâ Lavernae, quod ibi ara ejus deae.
On lui donne encore un bois touffu sur la voie salarienne ; les voleurs, ses fideles sujets, partageoient leur butin dans ce bois, dont l'obscurité & la situation pouvoient favoriser leur évasion de toutes parts. Le commentateur Acron ajoute qu'ils venoient y rendre leurs hommages à une statue de la déesse, mais il ne nous dit rien de la figure sous laquelle elle étoit représentée ; l'épithete pulchra, employée par Horace, epist. xvj. l. I. semble nous inviter à croire qu'on la représentoit avec un beau visage.
Enfin une ancienne inscription de l'an de Rome 585, recueillie par Dodwel dans ses Praelect. acad. page 665, nous fournit la connoissance d'un monument public, qui fut alors érigé en l'honneur de Laverne proche du temple de la terre, & nous apprend la raison pour laquelle on lui dressa ce monument. Voici la copie de cette inscription singuliere : IV. K. Aprileis Fasciis penès Licinium.... C. Titinius Aed. Fl. Mulcavit Lanios Quòd Carnem Vendidissent Populo Non Inspectam. De Pecuniâ Mulcatitiâ, Cella Extructa AD TELLURIS Lavernae, c'est-à-dire, Cella Extructa Lavernae, Ad Aedem Telluris.
Cicéron écrivant à Atticus, parle d'un Lavernium, qui étoit apparemment un lieu consacré à Laverne ; mais on ne sait si c'étoit un champ, un bois, un autel ou un temple ; je dis un temple, car si cette déesse avoit des adorateurs qui en attendoient des graces, on la regardoit aussi comme une de ces divinités nuisibles, qu'il falloit invoquer pour être garanti du mal qu'elle pouvoit faire. Cependant c'est seulement comme protectrice des voleurs de toute espece, qu'un de nos savans, M. de Foncemagne, l'a envisagée dans une dissertation particuliere qu'on trouvera dans les mémoires de l'académie des Belles-lettres, tome VII.
Laverna, nom latin de la déesse Laverne, a reçu bien des étymologies, entre lesquelles on donne ce mot pour venir de laberna, qui est le ferramentum latronum, selon les gloses ; & laberna peut dériver de , dépouilles, butin, ou de , prendre.
Quoi qu'il en soit, les voleurs furent appellés laverniones, parce qu'ils étoient sub tutelâ deae Lavernae, dit Festus. (D.J.)
|
| LAVERNIUM | (Géog. anc.) lieu d'Italie dont il est parlé dans une des lettres de Cicéron à Atticus, liv. I. & dans les saturnales de Macrobe, l. III. Il prenoit ce nom d'un temple de la déesse Laverne, comme ceux de Diane & de Minerve avoient donné lieu aux noms Dianium & Minervium. (D.J.)
|
| LAVETTE | S. f. (Gram. Cuisine) guenille dont le marmiton se sert dans la cuisine pour nettoyer les ustensiles.
|
| LAVINGÉE | en Anatomie, nom d'une artere produite par la carotide externe. Voyez CAROTIDE.
Elle se distribue au larynx, aux glandes thyroïdes, au pharinx, & produit quelquefois l'artere épineuse, &c. on la nomme aussi gutturale supérieure. Voyez GUTTURALE.
|
| LAVINIUM | (Géog. anc.) ville d'Italie dans le Latium, à 10 milles de Rome selon Appien, & à 8 milles de la mer selon Servius, fort-près de Laurente. Enée trouva Laurentum bâti ; c'étoit la résidence du roi dont il épousa la fille Lavinie. Il fonda pour lors une nouvelle ville par ses Troyens, & la nomma Lavinium en l'honneur de son épouse. Sous son fils les Laviniens bâtirent la ville d'Albe, qui fut la résidence de ses descendans, jusqu'à la fondation de Rome. (D.J.)
|
| LAVINO | en latin Labinius, (Géog.) riviere d'Italie dans le territoire de Bologne, à huit milles de la ville de ce nom, en tirant vers Modène. Appien civil. lib. IV. dit que ce fut dans une île de cette riviere, que les Triumvirs s'aboucherent, & partagerent entr'eux l'empire romain ; mais Appien se trompe, ce fut dans une île du Reno, auprès de Bologne, que se fit leur entrevûe, qui dura trois jours entiers. (D.J.)
|
| LAVIS | LE, (dans la Fortification) consiste dans l'art d'employer les couleurs dont on illumine les plans & les profils des différens ouvrages qu'on y construit. Laver un plan, c'est étendre sur les différentes parties les couleurs qu'on est convenu d'employer pour distinguer chacune de ses parties.
Les couleurs dont on se sert pour cet effet, sont,
1°. L'encre de la Chine.
2°. Le rouge appellé carmin.
3°. Le jaune appellé gomme gutte.
4°. Le verd de vessie.
5°. Le verd de gris liquide, communément appellé couleur d'eau.
6°. Le bistre ou couleur de terre.
7°. Le bleu appellé indigo.
L'encre de la Chine sert à tirer toutes les lignes des plans & des profils, à l'exception néanmoins de celles qui représentent une épaisseur de maçonnerie, lesquelles se marquent avec le carmin. Telle est la ligne magistrale, ou le premier trait de la fortification, la contrescarpe, &c. lorsque la place est revêtue. Quand elle n'est point revêtue, ces lignes sont aussi marquées avec l'encre de la Chine, & dans ce cas toutes les lignes du plan sont noires ; autrement il y en a de noires & de rouges. L'encre de la Chine sert encore à ombrer les parties du plan qui en ont besoin.
Le carmin sert à mettre au trait toutes les lignes qui expriment des épaisseurs de maçonnerie, comme on vient de le dire. Il sert aussi à laver les coupes des revêtemens, contre-forts, &c. marquées dans les profils ; l'emplacement des maisons dans les plans, les casernes, & enfin tous les ouvrages qui sont de maçonnerie.
Le jaune sert à marquer les ouvrages projettés dans les plans, c'est-à-dire, ceux que l'on propose à exécuter, & qui sont distingués par cette couleur, de ceux qui sont construits.
Le verd de vessie sert à laver les parties qui sont en gason, les taluds, les glacis, &c.
La couleur d'eau sert à laver les fossés dans lesquels il y a de l'eau, les rivieres, &c.
Le bistre est employé pour laver les coupes des terres ; il sert aussi de couleur de bois, pour laver les ponts.
Le bleu ou l'indigo sert à marquer les ouvrages qui sont de fer, &c.
L'encre de la Chine est en bâton ; on la détrempe en la frottant dans une coquille, dans laquelle on a versé un peu d'eau. On frotte le bâton sur cette coquille, jusqu'à ce que l'eau ait pris la force nécessaire pour l'usage que l'on en veut faire. Lorsqu'on veut s'en servir pour mettre au trait, on lui donne beaucoup plus de force que pour laver.
Le carmin est en poudre ; il se détrempe avec de l'eau gommée. Cette eau se fait en mettant fondre environ un gros de gomme arabique blanche, la plus propre que l'on peut trouver, dans un verre plein d'eau. La gomme étant fondue, on met le carmin dans une coquille, & l'on verse de cette eau dessus. On délaye le carmin avec le petit doigt ou un pinceau, & on le mêle bien avec l'eau, jusqu'à ce que toutes les parties en soient imprégnées ; après quoi on laisse sécher le carmin dans la coquille, & lorsqu'on veut s'en servir, on en détrempe avec de l'eau commune, & l'on en met dans une autre coquille la quantité dont on croit avoir besoin. On évite d'en détremper beaucoup à la fois, parce qu'il se noircit, & qu'il perd de sa beauté lorsqu'il est détrempé trop souvent. Celui dont on se sert pour mettre au trait, doit être beaucoup plus foncé que celui qu'on prépare pour laver.
L'indigo se détrempe avec de l'eau gommée, comme le carmin.
La gomme gutte se détrempe avec de l'eau commune, de même que le verd de vessie, & le bistre, parce que ces couleurs portent leur gomme avec elles.
La couleur d'eau s'emploie sans aucune préparation. Il faut seulement observer que lorsqu'elle se trouve trop foible, on lui donne de la force en la versant dans une coquille, & en la laissant ainsi exposée pendant quelque tems à l'air ; & qu'au contraire lorsqu'elle se trouve trop forte, on l'affoiblit en la mêlant avec un peu d'eau commune. Elémens de Fortification. M. Buchotte, ingénieur du roi, a donné un traité des regles du dessein, & du lavis des plans.
|
| LAVOIR | S. m. (Minéralogie) les Espagnols disent lavandero ; c'est le nom qu'ils donnent à l'endroit d'où l'on tire de l'or des terres par le lavage, soit au Chili, soit au Pérou. Selon M. Frezier, on creuse au fond du lavoir plusieurs coulées dans les lieux où l'on juge par de certaines marques connues des gens du métier, qu'il peut y avoir de l'or ; car il ne paroît point à l'oeil dans les terres où il se trouve. Pour faciliter l'excavation, on y fait passer un ruisseau, & pendant qu'il coule, on remue la terre que le courant détrempe & entraîne aisément : enfin, quand on est parvenu au banc de terre aurifere, on détourne le ruisseau pour creuser cette terre à force de bras. On la porte ensuite sur des mulets dans un bassin façonné comme un soufflet de forge. On fait couler rapidement dans ce bassin un nouveau ruisseau pour délayer cette terre qu'on y a apportée, & pour en détacher l'or, que sa pesanteur précipite au fond du bassin parmi le sable noir : on l'en sépare ensuite selon les regles de l'art.
Il y a des lavoirs tels que ceux d'Andecoll, à dix lieues de Coquimbo, dont l'or est de 22 à 23 karats. Les lavoirs de cet endroit sont fort abondans, dumoins l'étoient-ils au commencement de ce siecle ; & l'on y a trouvé des pepitas, ou grains d'or vierge, d'une grosseur singuliere, même du poids de trois à quatre marcs, mais jamais de quarante-cinq, moins encore de soixante & quatre marcs, quoi qu'en dise M. Frezier. C'est une de ses exagérations hyperboliques, à joindre à celle des cent mille mules qu'il amene tous les ans de Tocuman & du Chili, pour remplacer celles qui meurent dans les montagnes de la traverse du Pérou, & qui se réduisent à dix ou douze mille au plus. Voyez un lavoir dans nos Planches de Métallurgie. (D.J.)
LAVOIR, (Hydr.) c'est un bassin public pour faire la lessive, lequel est fourni par une source ou par la décharge de quelque bassin. Souvent dans les campagnes on voit des lavoirs au milieu des prés. (K)
LAVOIR, (Architecture) c'est une cour ou un passage qui emporte les immondices de toute une maison : à proprement parler, c'est un égoût commun. Voyez CLOAQUE.
Le lavoir est aussi près d'une cuisine ; il se dit & du lieu & de l'auge de pierre quarrée & profonde qui sert à rinser la vaisselle, laquelle ordinairement est près du lévier, en latin lavacrum.
On dit aussi lavoir, en parlant d'un bassin pratiqué dans une basse-cour, & qui est bordé de pierre avec égoût, où on lave le linge.
LAVOIR, (Outil d'Arquebusier) c'est une verge de fer qui est un peu plus large, ronde & plate par en-bas, comme la baguette d'un fusil ; l'autre bout est uni & fendu comme la tête d'une aiguille à emballer, dans laquelle on passe un morceau de linge mouillé, & on le met dans le canon d'un fusil pour le laver & le nettoyer. Voyez nos Pl. d'Arq.
|
| LAVOT | S. m. (Commerce) mesure dont on se sert à Cambrai pour la mesure des grains. Il faut quatre lavots pour la rasiere : la rasiere rend sept boisseaux 1/3 de Paris. Voyez RASIERE, Dictionnaire de Commerce.
|
| LAVURE | S. f. (Monn. & Orfévrerie) On donne ce nom à l'opération qui se fait pour retirer l'or & l'argent des cendres, terres ou creusets dans lesquels on a fondus & des instrumens & vases qui ont servi à cet usage par le moyen de l'amalgamation avec le mercure. Ceux qui travaillent ces précieux métaux conservent les balayures de leur laboratoire, parce qu'en travaillant il est impossible qu'il ne s'en écarte pas quelques parties, soit en forgeant, laminant, limant, tournant, &c. c'est pourquoi ils ont soin que leur laboratoire soit maintenu bien propre, & que le sol soit garni de planches cannelées en rainures ou jalousies, afin qu'en marchant on n'emporte pas avec les piés les parties qui se sont écartées. Toutes les semaines on rassemble les balayures de chaque jour, on les brûle, on trie à mesure le plus gros de la matiere qui est dedans, & tout ce qu'on y peut voir, pour s'en servir tout de suite sans lui faire passer l'opération de la lotion du triturage. On garde soigneusement ces cendres jusqu'à ce qu'il y en ait une quantité suffisante pour dédommager des frais qu'il faut faire pour retrouver l'or & l'argent qui sont dedans. Les uns font cette opération tous les six mois, & d'autres toutes les années ; cela peut dépendre du besoin que l'on a de matieres, ou des facilités que l'on a de faire ces opérations ; mais elles ne conviennent jamais dans un tems froid, parce qu'il faut beaucoup manier l'eau, ce qui se fait plus facilement dans la belle saison.
Le meilleur & le plus sûr moyen de retirer tout l'or & l'argent qui sont dedans les cendres brûlées, seroit de les fondre si l'on avoit à sa portée une fonderie où il y eût des fourneaux à manches bien établis, mais c'est par le moyen du vif-argent que se fait cette opération, en broyant les terres avec lui, parce qu'il a la propriété de se saisir, avec une grande facilité, de l'or & l'argent, de dégager ces métaux des terres avec lesquelles ils sont mêlés ; de s'y unir sans le secours du feu, par la simple trituration, & de les restituer ensuite en le faisant passer au-travers d'une peau de chamois, & l'exposant après cela à un feu léger pour faire évaporer ce qui en est resté.
Pour que le mercure puisse s'amalgamer avec l'or ou l'argent, il faut que les matieres parmi lesquelles ils sont mêlés soient bien brûlées, lavées & dessalées.
Premier procédé. On doit commencer par ratisser tous les instrumens qui ont touché l'or ou l'argent dans leur fusion, ensuite il faut piler les creusets dans lesquels on a fondu, ou les autres vases qui ont servi à cet usage, parce qu'ordinairement il reste des grains attachés aux parois, & que d'ailleurs les creusets de la terre la moins poreuse boivent toujours un peu de matiere ; il faut aussi piler le lut qui est autour des fourneaux à fondre, sur-tout la forge à recuire ; il faut passer toute la poudre dans un tamis de soie le plus fin qu'il est possible ; ce qui ne peut pas passer au-travers du tamis doit être de la matiere qui a été applatie en pilant, & qu'il faut mettre à part. La matiere qui a traversé le tamis doit être lavée à la main, parce qu'elle ne fait jamais un objet considérable, & que les parties de métal qui sont dedans sont toujours pesantes ; on peut les retirer par la simple lotion ; il faut laver cette matiere dans un vase de terre cuite & vernissée, en forme de coupe un peu platte. Cette coupe doit être posée dans un autre grand vase que l'on emplit d'eau : on met la matiere dans la petite coupe, & on la plonge dans le grand vase en l'agitant doucement avec les doigts jusqu'à ce que toute la poudre soit sortie. Ce qui se trouve après cette lotion au fond de la petite coupe comme des points noirs ou autres couleurs, mais pesant, doit être joint avec ce qui n'a pas pu passer au travers du tamis, & fondu ensemble avec un bon flux. Si on mêloit ce produit avec les cendres de la lavure qui doivent essuyer toutes les opérations nécessaires pour retrouver l'or & l'argent, il y auroit du danger de le perdre, ou pour le moins un certain déchet. La terre restante qui a passé au travers du tamis doit être mise dans une grande cuve destinée à recevoir tout ce qui doit être lavé, & dans laquelle on aura soin de mettre les sables qui ont servi à mouler, car ces sables contiennent de la matiere ; mais comme elle y a été jettée etant en fusion, elle a par conséquent assez de pesanteur pour favoriser l'amalgamation avec le mercure.
Second procédé. Une des principales choses que l'on doive faire dans la préparation d'une lavure c'est de brûler si parfaitement tout ce qui doit passer dans le moulin au vif-argent, que toutes les parties métalliques soient réduites en gouttes ou grains, ne pas épargner pour cela le charbon ni les soins, parce qu'ils se retrouvent bien avec usure. Premierement, le propriétaire de cette lavure jouit d'abord, après le procédé de la lotion, de la plus grande partie de ce qui est dans ses terres, comme on le verra au troisieme procédé, mais encore il ne perd rien des matieres qui y sont contenues, dont il perdroit une partie s'il les brûloit mal ; car on a observé après plusieurs essais faits sur la terre que les ouvriers appellent regrets de lavure, qui avoient été passés trois fois sur le mercure, qu'il restoit cependant depuis deux jusqu'à quatre grains d'or sur chacune livre de terre seche, provenant de lavures d'ouvriers travaillant en or ; ce qui ne vient d'autre cause que parce qu'on les avoit mal brûlées. On conçoit aisément que si on laisse ces petites parties d'or qui sont presque imperceptibles, & qui ont une grande surface en comparaison de leur poids, sans les réduire en grain, leur légereté les fera flotter sur l'eau & les empêchera d'aller au fond de la bassine du moulin à mercure, pour s'amalgamer avec lui : au contraire si on a assez brûlé les cendres pour fondre ces petites particules, elles prennent une forme en raison de leur poids, qui les fait précipiter, quelques petites qu'elles soient, & le mercure s'en saisit avec une très-grande facilité.
Les terres, balayures ou débris d'un laboratoire dans lequel on travaille des matieres d'or ou d'argent, doivent être brûlées dans un fourneau à vent fait exprès : ce fourneau est sphérique de six pouces de diametre sur quatre piés de hauteur ; il consume très-peu de charbon & donne beaucoup de chaleur ; le vent entre de tous côtés par des trous d'un pouce de diametre faits tout autour, & par le cendrier qui est tout ouvert ; il a trois foyers les uns sur les autres, & trois portes pour mettre le charbon, avec trois grilles pour le retenir à la distance de huit pouces les unes des autres. On met la terre à brûler dans le fourneau supérieur par-dessus le charbon & après qu'il est allumé. Comme ce fourneau donne très-chaud, la terre se brûle déjà bien dans ce premier foyer ; mais à mesure que le charbon se consume, la terre descend dans le second fourneau à-travers de la grille, où elle se brûle encore mieux ; & enfin dans le troisieme, où elle se perfectionne. Il faut avoir soin, lorsque le charbon du fourneau supérieur est brûlé, d'ôter la porte, de nettoyer & faire tomber toutes les cendres qui sont autour : on en fait de même du second & de celui d'en bas, après quoi on continue l'opération. Par ce moyen-là les cendres sont très-bien brûlées, & presque toutes les paillettes reduites en grain, ce qui est un des points essentiels. Lorsqu'on ne brûle les cendres que dans un seul fourneau, il est presque impossible qu'elles soient bien brûlées, parce qu'elles ne peuvent pas rester sur le charbon qui se dérange en se consumant ; les cendres glissent au-travers, passent par les intervalles, & tombent dans le cendrier, quelque serrée que soit la grille. Par conséquent la matiere reste dans le même état qu'on l'a mise : on croit avoir bien calciné, & on n'a rien fait. Le fourneau à trois foyers doit être préféré à un simple fourneau dans lequel on brûleroit trois fois les cendres, parce qu'à chaque fois elles se réfroidissent, & c'est un ouvrage à recommencer ; au lieu que par l'autre méthode l'opération n'est point discontinuée ; elle est plus promte & plus parfaite.
Les cendres étant bien brûlées, il faut faire l'opération qu'on a faite sur les creusets, tamiser & conserver ce qui ne peut pas passer au-travers du tamis sans le mêler avec les cendres passées, mais en faire l'assemblage avec celles provenues du premier procédé.
Troisieme procédé. S'il est nécessaire de bien brûler les terres, cendres, &c. que l'on veut broyer avec le mercure, il n'est pas moins important de les bien dessaler, afin que le mercure puisse mordre dessus ; c'est pourquoi il convient de laisser tremper dans l'eau pendant trois jours au-moins les cendres qu'on veut laver, en changeant d'eau toutes les vingtquatre heures ; l'on doit porter beaucoup de soin à cette lotion, parce qu'en lavant d'une maniere convenable on retire la plus grosse portion du contenu dans les cendres.
Pour bien laver il faut une machine faite exprès, & sur-tout lorsque l'on a beaucoup à laver, comme dans les monnoies ou autres atteliers considérables : cette machine est une espece de tonneau à peu-près de la figure des moulins à mercure, dont le fond qui est cependant de bois est un peu en sphere creuse : l'arbre de fer qui est au milieu, comme celui des moulins à mercure, porte des bandes de fer plates & larges d'environ deux pouces qui le traversent de haut en bas, en croix, à la distance de six pouces les uns des autres, ayant de même une manivelle en haut de l'arbre que l'on tourne pour agiter la matiere, ce qui contribue merveilleusement à la diviser, laver & dessaler. Il faut placer le tonneau à laver au milieu d'une grande cuve vuide qui ait des trous à ses douves pour écouler l'eau depuis le bas jusqu'en haut, à la distance d'un pouce les uns des autres ; il faut faire cette opération, s'il est possible, proche d'une pompe ou d'un puits dont l'eau soit nette & pure.
On doit commencer par mettre de l'eau dans le tonneau ; car si l'on met la matiere épaisse la premiere, elle s'engorge, on ne peut point tourner la manivelle & faire mouvoir l'arbre : elle se doit mettre peu-à-peu. Quand on a agité cette premiere matiere l'espace d'un quart d'heure, il faut la laisser reposer pendant une heure au moins, après quoi on fait jouer la pompe de façon que l'eau coule très-doucement dans le tonneau à laver. Pendant qu'on tourne la manivelle, ce qui peut se faire par le moyen d'un long tuyau, mettez assez d'eau pour qu'elle regorge du tonneau & entraîne avec elle toutes les cendres légeres dans la cuve, & il ne restera presque que la matiere métallique que sa pesanteur y aura fait précipiter ; il faut la retirer & la mettre à part pour être achevée d'être lavée à la main, suivant le procédé de la premiere opération. Laissez après cela reposer la matiere qui est dans la cuve jusqu'à ce que l'eau soit claire, après quoi ouvrez un des bouchons qui est à la cuve à la hauteur de la matiere que vous jugez être dedans, que l'on peut mesurer, & plûtôt le bouchon supérieur que l'inférieur, parce que vous êtes toujours à tems d'ouvrir celui de dessous ; & au contraire si vous ouvrez trop bas vous laisserez échapper la matiere. Continuez l'opération sur le reste des cendres jusqu'à ce qu'elles ayent toutes été lavées de cette maniere ; mettez ensuite cette terre lavée dans la grande cuve où vous avez déjà placé le reste de la terre provenant des creusets pour le tout être passé & broyé avec le vif argent.
Pour ce qui est des matieres métalliques qui sont restées à chaque lotion au fond du tonneau, & que l'on acheve de laver à la main, on en fait l'assemblage, comme il est dit ci-devant, pour la matiere provenant des creusets : par cette lotion, on retire non-seulement les trois quarts de la matiere contenue dans les terres ou cendres, mais encore le reste se trouve beaucoup mieux préparé pour être moulu ; car lorsque la matiere est salée, cela lui donne un gras qui la fait glisser sur le mercure, & ne sauroit s'amalgamer avec lui, c'est inutilement qu'on fait cette trituration sans cette condition.
Quatrieme procédé. Après ces trois procédés de piler, brûler & laver, il faut broyer les cendres lavées dans le moulin à mercure, & observer que le mercure soit bien propre & pur ; il en faut mettre assez pour que toute la surface de la bassine en soit couverte, & à proportion de la pesanteur des croisées ; après cela on charge les moulins de cendres à broyer, on en met environ quinze livres mouillées, ce qui revient à dix livres de seches sur trente livres de vif argent, & l'on broye cela très-lentement pendant douze heures, si c'est une lavure en or ; & six heures seulement, si c'est une lavure d'argent ; ensuite on laisse reposer un peu la matiere, car si on la sortoit tout de suite, on couroit risque que des petites parties de mercure ne sortissent avec, ce qui feroit une perte non-seulement sur la quantité du mercure, mais encore parce que ce mercure est toujours enrichi : après que la matiere a été reposée, ôtez le bouchon du moulin, afin qu'elle sorte & se jette dans la cuve qui est placée vis-à-vis & un peu dessous, autour de laquelle on range la quantité de moulins dont on veut se servir pour l'opération : si on a beaucoup de cendres à passer, il faut prendre beaucoup de moulins, afin d'accélérer l'opération qui est très-ennuyeuse. Un particulier qui a une lavure un peu forte, ne sauroit mieux faire pour ses intérêts que de laver ses cendres dans la machine nouvellement établie à Paris sur le quai d'Orçay ; elle remplit toutes les conditions que l'on peut desirer, tant pour la promtitude avec laquelle elle travaille, ayant quarante-huit moulins qui vont jour & nuit, & marchent tout-à-la-fois par un seul moteur, que pour la perfection avec laquelle elle opere, la construction de ces moulins étant beaucoup plus parfaite à tous égards que ceux que l'on a eu jusqu'à présent ; ils ramassent mieux la matiere, & il est démontré qu'elle rapporte plus, opérant dans cette machine, que si on la faisoit dans les anciens moulins, ceux qui en ont la direction, sont des gens de confiance très-entendus, & la situation des lieux donne une grande commodité qu'on trouve rarement chez soi.
Plusieurs personnes sont dans l'usage de repasser une seconde fois cette terre qu'ils appellent regrets, sur-tout si c'est une lavure un peu considérable : mais si l'on a pris toutes les précautions indiquées dans les trois premiers procédés, c'est en pure perte ; & pour ne pas risquer les frais d'une seconde opération, on doit faire l'essai de ces regrets en en fondant au moins trois onces dans un creuset avec le flux noir, & la litharge de plomb que l'on aura essayé auparavant pour savoir ce qu'elle contient de fin ; on coupelle ensuite le culot de plomb provenu de cette fonte, & l'on sait si ces regrets contiennent encore de la matiere ; il faut aussi examiner soigneusement s'il n'y a point de mercure dedans ; pour cet effet, faites sécher à l'air & bien parfaitement une certaine quantité de regrets, observez si vous ne voyez point de mercure, pesez-les exactement lorsqu'ils sont bien secs ; exposez-les après cela à un feu doux, pour évaporer le mercure ; voyez ensuite si vos cendres ont fait un déchet considérable, par-là vous jugerez du mercure qui est resté, & s'il y en a beaucoup, n'hésitez pas de les repasser, ne fut-ce que pour reprendre le mercure qui est dedans, parce qu'il est chargé de matiere ; mais prenez bien vos précautions à cette seconde opération, pour qu'il ne passe point de mercure avec vos cendres, ou le moins possible, lorsque vous levez les moulins.
Toutes les cendres étant passées, on leve les moulins, c'est-à-dire on retire tout le mercure, on le lave, on le fait sécher, on le passe au travers d'une peau de chamois, dans une machine faite exprès, ce qui reste dans la peau est la matiere qui étoit contenue dans vos cendres ; cependant il ne faut point se défaire de ce mercure, il convient même à ceux qui ont de fortes lavures d'avoir leur mercure à eux, au lieu qu'ordinairement ce sont les laveurs qui le fournissent, & il ne se peut pas faire autrement qu'il ne reste toujours chargé d'un peu d'or ou d'argent, ce qui est autant de perte pour celui à qui appartient la lavure.
Cinquieme procédé. Les boules qui sont restées dans la peau de chamois contenant encore du mercure, il faut le faire évaporer ou distiller ; pour cet effet on met ces boules de matiere dans des cornues de verre ; il seroit cependant mieux d'en avoir de fer, & faites exprès ; elles doivent être de deux pieces qui s'ouvrent environ à moitié de leur hauteur, qui est à-peu-près de huit pouces, la partie supérieure qui forme une espece de chapiteau, porte un tuyau au col dans le côté, qu'on adapte ou fait entrer dans une cornue de verre qui sert de recipient ; on a soin de bien lutter la jointure de cette cornue de fer, soit dans l'endroit où elle est brisée, soit au col où elle est jointe avec celle de verre, par ce moyen on évite les accidens qui sont assez fréquens, lorsqu'on se sert des cornues ou matras de verres sujets à se casser, ce qui cause des pertes considérables, & expose les personnes qui ont la conduite de l'opération à recevoir des éclats du verre & être blessés : on économiseroit aussi ; car la dépense de la cornue de fer une fois faite, c'est pour toujours, au lieu qu'il faut casser celle de verre à chaque opération. On commence par faire un feu très-léger ; cette opération doit se faire sur un bain de sable dans une capsule de fer, le feu s'y ménage beaucoup mieux & augmente insensiblement ; il convient aussi que la cornue de verre, qui sert de récipient, contienne moitié de sa capacité d'eau.
Après que la distillation est faite, on laisse refroidir les cornues, on casse celle qui contient la matiere métallique, qui étoit dans les cendres de lavure, si elle est de verre ; & si elle est de fer, on la délute avec soin & propreté, on enleve le dessus par deux anses qu'elle doit avoir, & on retire la matiere qui est au fond. On fond tout cela ensemble avec du borax & du salpêtre raffiné, on laisse la matiere en fusion pendant un quart-d'heure, on la remue souvent avec une baguette de bois, pour la bien mêler, ensuite on la jette dans une lingotiere préparée à cet effet ; quelques-uns sont dans l'usage de laisser la premiere fonte en culot au fond du creuset, ce qui est encore mieux : on affine cette matiere, si l'on est à portée de le faire, & l'on fait le départ des deux fins ; il vaut beaucoup mieux que les ouvriers qui font des ouvrages fins & délicats vendent le produit de leurs lavures à un affineur ; car il est assez ordinaire que cet or contienne de l'émeri ou grain d'émail formé par la fonte des métaux vitrifiables qui se sont trouvés parmi l'or ou l'argent, ce qui cause beaucoup de dommage à leurs ouvrages, & les empêche souvent de rendre leur or doux & malléable.
Description du nouveau moulin chimique, ou moulin à lavure. Nous avons vu par le mémoire précédent l'objet que se propose le nouveau moulin chimique ; il nous reste à donner la description du méchanisme qui le compose.
La force motrice, suivant le modele en petit, est représentée par une manivelle au lieu d'une roue, à laquelle on donne, dans son exécution en grand, plus ou moins de diametre, suivant la force du courant d'eau, qui doit lui communiquer le mouvement.
L'axe de cette roue porte vers son milieu une roue plane dentée à sa circonférence d'un nombre quelconque, laquelle engrene par sa partie inférieure dans une lanterne aussi d'un nombre quelconque, ménagée sur un cylindre parallele à l'axe de la premiere roue : ce cylindre est destiné à faire lever un nombre de marteaux quelconque, au moyen d'un nombre de chevilles, égal au nombre des marteaux, placées de distance en distance sur la circonférence du cylindre & en ligne spirale, de maniere que la révolution du cylindre étant faite, chaque marteau ait frappé un coup, sans néanmoins que le cylindre soit dans aucun des points de l'espace qu'il parcourt chargé de plus d'un marteau à la fois ; d'où l'on voit que les coups se succedent, & que lorsque le premier quitte par sa chûte le lévier qui agissoit sur lui, le second commence à être élevé par le levier qui lui répond, & ainsi de suite. Ces marteaux sont rangés sur une même ligne, & sont suspendus dans un clavier aux deux tiers de la longueur de leurs manches, d'où il résulte les bascules dont on vient d'expliquer l'effet ; chacun de ces marteaux frappe dans un pilon, & ils ont un poids commun quelconque. Nous en avons expliqué l'usage dans le mémoire précédent, mais, avant d'abandonner le cylindre & son action sur les marteaux, nous dirons un mot sur chacun des deux effets qu'il produit encore : à l'extrémité d'un de ses essieux, on a pratiqué un excentrique ou manivelle d'un rayon quelconque, laquelle à chaque révolution fait monter & descendre une piece qui est suspendue par un trou libre dans le manche de la manivelle, laquelle piece répond par son extrémité inférieure à un bras du levier réservé sur un second cylindre, que l'on peut appeller cylindre de renvoi, lequel ne fait qu'une portion de révolution ; c'est-à-dire qu'il ne décrit qu'un arc d'environ 45 degrés alternatifs, mais ce mouvement est suffisant pour faire mouvoir par le moyen d'un second bras du levier une pompe foulante & aspirante qui communique dans la riviere, & dont le produit est destiné à entretenir plein d'eau un réservoir exhaussé au-dessus des moulins particuliers à mercure pour le besoin de l'opération générale. Nous en parlerons plus en détail ci-après.
Ce même cylindre de renvoi fait aussi agir un soufflet qui répond au fourneau destiné à fondre le métal produit de chaque lavure, & celle-ci est la derniere de toutes les opérations d'une lavure.
Nous avons vu par ce qui précede, l'effet de la batterie des marteaux, celui de la pompe, & celui du soufflet : nous allons donc présentement expliquer le méchanisme des moulins à broyer & des moulins à mercure.
Dans le modele en petit, il y a 30 moulins à mercure, & 6 à broyer ; le plan de ces 36 moulins est un polygone exagone, dont chaque côté contient 5 moulins à mercure ; & vis-à-vis du milieu de chacun de ces côtés dans le dedans du polygone, il se trouve un moulin à broyer ; ce qui fait 36 moulins ; ce nombre n'est pas essentiel ; il peut être augmenté ou diminué, suivant l'exigence des cas particuliers ; une seule roue fait tourner ces 36 moulins.
Nous avons observé en premier lieu que l'arbre de la roue à l'eau portoit, vers son milieu, une roue plane, servant à faire tourner le cylindre inférieur & parallele à son axe : cette roue est donc verticale, mais sur son plan est pratiqué une seconde roue à champs, ou simplement des chevilles à distances égales, lesquelles sont arrondies en forme de dents, pour faciliter un engrenement dans une lanterne réservée sur un arbre qui est placé au centre du polygone. Cet arbre vertical fait tourner tous les moulins, tant à broyer qu'à mercure, fussent-ils un nombre infini, si la force étoit elle-même infinie ; le moyen que l'auteur a employé a paru ingénieux, simple, solide & même nouveau aux artistes les plus expérimentés dans les méchaniques : voici en quoi il consiste.
Au sommet supérieur de l'arbre du centre, ou plutôt sur son essieu, est appliqué une manivelle d'un rayon quelconque : les arbres particuliers des moulins à broyer & à mercure, lesquels sont paralleles à l'arbre du centre, sont exhaussés à la même hauteur, & ont une platine ou un plancher commun, dans lequel ils sont fixés, par un trou qui leur laisse la liberté de tourner librement ; ces 36 arbres particuliers portent aussi chacun une manivelle de même rayon que celle qui est appliquée sur l'essieu de l'arbre du centre : il s'agit présentement d'expliquer comment par le moyen de ces 36 manivelles, celle du centre, qui fait la 37e, ayant essentiellement un même rayon, communique le mouvement circulaire à toutes les autres ; une seule piece produit cet effet. Cette piece, qui est en cuivre jaune ou en laiton, dans le modele en petit dont nous avons parlé, est elle-même un exagone, que j'appellerai, le chassis de la machine, parce qu'il est à jour, ayant un centre & une circonférence pleine, réunis par 6 rayons ; exactement au centre de ce chassis est un trou, dans lequel entre juste & libre le manche de la manivelle, portée par l'essieu de l'arbre du centre.
Sur la circonférence du chassis, sont autant de trous qu'il y a de moulins à mercure, c'est-à-dire 30 ; mais comme ces 30 moulins ne sont pas dans un cercle, qu'au contraire ils sont 5 à 5 sur des lignes droites, répétées 6 fois, ce qui forme l'exagone ; il s'ensuit que les 30 trous, destinés à recevoir les 30 manches des manivelles des 30 moulins à mercure, ne sont pas également éloignés du centre du poligone : ils s'en éloignent, comme les angles du polygone s'en éloignent eux-mêmes ; mais le moyen infaillible de placer convenablement tous les trous du chassis, c'est de séparer la platine qui reçoit & fixe les arbres, ce qui est facile ; car on conçoit que cette platine doit être soutenue par un certain nombre de colonnes, par exemple, six aux six angles de l'exagone, à peu près comme la platine supérieure d'une montre est soutenue par ces quatre piliers. Cette platine étant ainsi séparée, & supposant tous ses trous posés, de maniere que chaque arbre soit bien perpendiculaire dans leur cage commune, il n'y a alors qu'à appliquer le chassis sur cette platine avant qu'il y ait aucun trou de percé, & marquer sur ce chassis, au travers des trous de la platine, autant de points qu'il y a de trous dans la platine, ou de moulins à faire tourner ; mais pour le faire avec succès, il faut prendre la précaution de marquer ces trous avec un instrument qui remplisse ceux de la platine sans jeu, & sans leur causer de dommage. Tous les trous étant marqués, c'est-à-dire, dans cet exemple-ci, celui du centre, les six qui répondent aux six moulins à broyer, & qui peuvent être considérés comme étant un cercle inscrit dans le polygone, & les 30 qui répondent aux 30 moulins à mercure, on les percera pour y faire entrer les manches des 37 manivelles, avec la précaution de laisser le manche de celle du centre un peu plus fort, puisqu'il éprouve seul 37 fois plus de résistance que chacun des autres en particulier, communiquant le mouvement à tout. En cet état, si l'on remet la platine en place, & qu'on rapporte sur chaque essieu la manivelle qui doit y être ajustée en quarré ; qu'ensuite on applique le chassis de maniere que ces 37 trous soient remplis par les 37 manches des 37 manivelles ; il est certain qu'en faisant faire à l'arbre du centre une révolution ; cette révolution en fera faire une à chaque moulin, tant à broyer qu'à mercure, & cela dans le même sens, & avec des vîtesses égales, c'est-à-dire, parcourant des espaces égaux dans des tems égaux, contre l'opinion de quelques méchaniciens qui ne sont pas géometres ; mais de l'avis de M. de Parcieux qui a démontré cette vérité par le secours de la Géométrie.
On conçoit que ce chassis n'étant retenu sur les 37 manivelles que par son propre poids, il pourroit arriver que dans l'action, quelqu'effort tendit à l'élever, ce qui occasionneroit le démanchement de quelques manches de manivelles : mais on prévient cet inconvénient en opposant à ce chassis 3 ou 6 ponts qui ne lui laissent que la liberté de se mouvoir horisontalement, & qui lui ôtent celle de s'élever.
Il nous reste deux mots à dire sur la distribution des eaux, si nécessaire à l'opération des lavures : nous avons parlé plus haut de la pompe & du réservoir : ce réservoir est élevé au-dessus des moulins, étant appliqué sous le plancher supérieur de la machine ; celui-là même qui sert de platine à tous les arbres : la pompe l'entretient continuellement plein d'eau, & ces eaux sont distribuées par le moyen de 6 tuyaux de métal, dont chacun répond au milieu des six côtés de l'exagone.
Ces six tuyaux sont garnis à leur extrémité d'un second tuyau, posé dans la direction des côtés du polygone, ce qui forme un T. A ce second tuyau, on y en applique 3 de cuir, armés à leur extrémité d'un robinet qu'on lâche quand la nécessité le requiert, dans les moulins à broyer & à mercure, au moyen de leur mobilité, comme on le fait dans l'usage des pompes à feu.
Nous croyons qu'il manqueroit quelque chose à la description de cette machine utile & ingénieuse, si nous gardions le silence sur son aspect, relativement à la partie qui rentre dans l'art de l'Architecture.
Le modele en petit, présenté & expliqué au Roi par l'auteur, & soumis au jugement de l'académie royale des Sciences, par l'ordre de Monseigneur le comte de Saint-Florentin, est d'une figure très-agréable, & d'une exécution supérieure : il y a trois planchers de même grandeur & de même forme, ayant chacun 6 côtés égaux. Sa hauteur est de 18 pouces, & son diametre de 14.
Le premier de ces planchers est soutenu par 6 piés tournés, en forme de boule, d'environ 2 pouces & demi de diametre. C'est sous ce premier plancher que l'on a pratiqué le cylindre à bascule, ou cylindre de renvoi. Sur le dessus, c'est-à-dire, entre le premier & le second plancher, qui est soutenu par 6 colonnes à 5 pouces d'élévation, on y voit les 12 mortiers, la batterie des 12 marteaux, le cylindre qui les fait agir, le bras de levier qui communique le mouvement au cylindre de renvoi, la moitié de la pompe, l'effet de son mouvement, la moitié de la roue plane qui fait tourner le cylindre à marteau, la moitié de la roue de champ qui lui est jointe, le soufflet & le fourneau destiné à fondre le produit d'une lavure, &c.
Sur le second plancher, c'est-à-dire, entre le second & le troisieme plancher, qui est également soutenu par 6 colonnes, tournées avec propreté, à 6 pouces d'élévation ; on y voit dans chacun des intervalles de 6 colonnes, 5 bassines, fixées sur ce plancher, & dans lesquelles tourne une croisée, dont l'arbre porte sur une espece de crapaudine attachée au centre des bassines, s'éleve & passe au travers du plancher supérieur pour recevoir la manivelle dont nous avons parlé.
Ce sont ces bassines réunies avec leurs croisées en mouvement, que j'ai jusqu'ici nommées moulin à mercure, à cause que c'est-là proprement que se fait, par le moyen du mercure, du mouvement de la croisée & de l'eau, la séparation des métaux d'avec les cendres qui les contiennent ; on y voit les 6 bassines destinées à broyer la matiere des lavures avant d'être apportée dans les moulins à mercure dont on vient de parler. Elles sont d'un volume un peu plus considérable que les premieres, & le broyement se fait par le moyen d'un cylindre qui tourne sur lui-même dans le fond de chacune de ces bassines, indépendamment de son mouvement horisontal ; on y voit l'arbre de la roue, qui porte la grande manivelle, qui représente la roue à eau, cet arbre, qui est horisontal, est placé dans l'épaisseur même de ce second plancher, dans lequel on a pratiqué une entaille. On y voit par conséquent l'autre moitié des deux roues jointes ensemble, & portées par cet arbre ; on y voit l'arbre du centre, portant la lanterne, qui est menée par la roue de champ, & c'est aussi dans cet intervalle que se laisse voir l'autre moitié de la pompe, qui fournit le réservoir, qui est attachée sous le troisieme plancher, & qui paroît dans la même cage, ainsi que tous ses tuyaux.
Sur le troisieme plancher est logé ce que l'auteur appelle la cadrature, qui est composé, comme nous l'avons dit, de 37 essieux limés par leurs bouts saillans en quarrés ; des 37 manivelles appliquées sur les 37 essieux du chassis, & de six pans, à ses six angles, pour l'empêcher de s'élever. Cette partie est sans contredit la plus curieuse, & celle qui a le plus couté à l'imagination de l'inventeur ; le dessus est recouvert d'un couvercle de menuiserie, orné de six pommelles, & d'une septieme à son centre qui domine sur les 6 des 6 angles : toutes les parties tant de métal que de bois, sont ornées de moulures polies, & d'une exécution qui fait autant d'honneur à la main-d'oeuvre de l'auteur, que la composition en fait à son génie.
LAVURE. Les Fondeurs appellent ainsi le métal qu'ils retirent des cendrures, allézures & sciures qui sont tombées dans la poussiere des fonderies & atteliers où ils travaillent, en les lavant.
|
| LAWENBOURG | Leoburgum, (Géog.) ville d'Allemagne, dans le cercle de basse Saxe, capitale d'un duché de même nom, qui appartient à l'électeur d'Hanover ; elle tire son nom de son fondateur Heinrickder-Lauwz, & ce nom veut dire la ville du lion ; le prince surnommé de même, enleva ce canton aux Vendes. Lawenbourg est sur la rive droite de l'Elbe, à 4 lieues nord-est de Lunebourg, 10 sud-est de Hambourg, 6 sud de Lubeck. Long. 28. 26. lat. 53. 56. (D.J.)
|
| LAWERS | en latin Lavica, (Géog.) petite riviere des Provinces-unies des pays-bas. Elle sépare la province de Frise de celle de Groningue, traverse le canal de Groningue à Dokum, & va se perdre dans un petit golfe, à l'extrémité de ces deux provinces. Cette riviere a été aussi nommée Labeke, en latin Labica. (D.J.)
|
| LAWINGEN | Lavinga, (Géog.) ville d'Allemagne en Souabe, autrefois impériale, mais ensuite sujette au duc de Neubourg. Elle est sur le Danube, à 3 lieues nord-ouest de Burgaw, 5 nord-est d'Ulm, 6 de Donavert, & 12 nord-est d'Augsbourg. Long. 28. 4. lat. 48. 32.
Albert-le-grand, Albertus-magnus, qui a fait tant de bruit dans le treizieme siecle, & qui en feroit si peu dans le dix-huitieme, étoit de Lawingen. Ses prétendus ouvrages parurent à Lyon en 1651, en 2 vol. in-fol. mais les sept huitiemes de cette édition ne sont pas de lui. Dans son Commentaire du maître des sentences, l'on trouve au sujet du devoir conjugal, des questions qui révoltent la pudeur la moins délicate ; il faut peut-être en attribuer la cause à la grossiereté des tems auxquels il a vécu ; mais c'est mal le justifier, que de dire qu'il avoit appris tant de choses monstrueuses au confessionnal, qu'il ne pouvoit se dispenser d'en traiter quelques-unes. (D.J.)
|
| LAWKS | (Com. de Russie) ce mot est russe, & signifie les boutiques. C'est ainsi que l'on nomme le marché public établi par le czar Pierre Alexiowitz à Petersbourg, pour y débiter toutes les marchandises qui y arrivent du dehors, ou qui s'y fabriquent, ensorte qu'il n'est permis à personne de garder des marchandises dans sa maison, ni d'en vendre dans aucun autre endroit qu'aux lawks.
Ce marché public est composé d'une grande cour, avec un bâtiment de bois à deux étages, couvert de tuiles, & partagé en deux portions, par une muraille qui le coupe d'un bout à l'autre, dans sa longueur. Il y a un double rang de boutiques, tant en bas qu'en haut, dont l'un donne sur la rue, & l'autre sur la cour. Le long des boutiques regnent des galeries, où ceux qui viennent acheter sont à couvert.
Cette maison appartient au souverain qui en loue cherement les boutiques aux marchands auxquels pourtant il est défendu d'y loger. Il y a des sentinelles & des corps-de-garde aux quatre coins & aux quatre portes de ce marché.
Les inconvéniens d'un établissement de cette nature, sans aucun avantage, sautent aux yeux de tout le monde ; c'est le fruit de l'esprit d'un prince encore barbare, & bien mal éclairé dans la science du commerce. Le czar devoit songer à faire une douanne de son bâtiment, & non pas un marché exclusif qui génât les négocians à y porter leurs effets, & à ne pouvoir les vendre chez eux. Il auroit tiré beaucoup plus d'argent par des droits modérés d'entrée & de sortie sur les marchandises, que par la cherté du loyer de ses boutiques. D'ailleurs rien de si fou que d'exposer les biens de ses sujets à être consumés sans ressource par un incendie. Ce malheur arriva en 1710, & peut sans-doute arriver encore, malgré toutes les précautions humaines. (D.J.)
|
| LAXATIF | adj. (Med. Thér.) ce mot est à peu-près synonyme avec le mot purgatif. On l'emploie seulement dans un sens moins général que le dernier : on ne s'en sert point pour désigner les purgatifs violens. Voyez PURGATIF. (B)
|
| LAXITÉ | S. f. (Med.) ce n'est autre chose que la cohésion des parties de la fibre qui est susceptible d'un changement capable de l'allonger. C'est donc un degré de foiblesse, & le principe d'où dépend la flexibilité. La débilité des fibres est excessive, lorsqu'elles ne peuvent, sans que leur cohésion cesse, soutenir l'effort qui résulte des actions d'un corps en santé, ou qui, quoique capable de suffire à celles qui ont coutume d'arriver dans un état ordinaire, se rompent si le mouvement est plus impétueux que de coutume. Or l'on connoît que la laxité est trop grande, quand les fibres soutenant simplement l'effort du mouvement vital, sans que leur cohésion soit interrompue, s'allongent au moindre effort.
Les causes antécédentes de cette laxité sont 1°. le défaut de nutrition, qui provient ou d'une trop grande dissipation des bons liquides, & du peu d'action des solides sur les fluides, ou de ce qu'on prend des alimens trop tenaces, pour qu'ils puissent se convertir en bonnes humeurs. 2°. La cohésion trop foible d'une molécule avec une autre molécule, qu'il faut attribuer à la trop grande foiblesse de la circulation, laquelle vient elle-même ordinairement du défaut du mouvement musculaire. 3°. La distension de la fibre, si excessive, qu'elle est prête à céder.
Les petits vaisseaux composés de ces fibres, n'agissant que bien foiblement sur leurs liquides, se dilatent & se rompent facilement. Voilà l'origine des tumeurs, du croupissement, de l'extravasation des fluides, de la putréfaction, & d'une infinité d'autres effets qui en résultent.
Les causes particulieres de la laxité sont un air chaud & humide, l'habitation dans des fonds marécageux, le manque de forces, le repos, les maladies chroniques, la trop grande extension des fibres, les émanations métalliques de mercure, d'antimoine ; l'abus des savonneux, des aqueux ; la colliquation, la ténuité des humeurs, & l'évacuation abondante de celles qui détruisent la circulation.
De-là procede la foiblesse dans les actions générales, la lenteur du mouvement, la circulation moindre, la débilité du pouls, la lassitude, la paresse, la promte fatigue, l'engourdissement, le penchant au sommeil, les évacuations abondantes ou arrêtées, la pesanteur, le froid, le rachitis.
De-là naissent dans les humeurs la crudité, le scorbut, l'acrimonie nitreuse & acide, l'hydropisie, la leucophlegmatie, les tumeurs molles, froides des bras ou des jambes, les maladies catarrheuses, les urines blanches, épaisses, crues, claires.
Il faut rapprocher, soutenir modérément les parties lâches, les animer par des frictions, les resserrer, les renforcer, les réchauffer par les aromatiques, ainsi que par l'exercice.
La guérison générale consiste 1°. à se nourrir d'alimens substantiels, & qui soient déja aussi bien préparés qu'ils le sont dans un corps sain & robuste. Il faut mettre au nombre de ces alimens le lait, les oeufs, les bouillons de viande, le pain bien fermenté, bien cuit, les vins austeres, dont on usera souvent & en petite quantité. 2°. Il faut augmenter le mouvement des solides & des fluides, par les exercices du corps, la promenade à pié, à cheval, en voiture. 3°. Il faut presser légerement les vaisseaux par des frictions, & repousser doucement les fluides. 4°. Faire un usage prudent & modéré de médicamens acides, austeres, & de spiritueux qui aient fermenté. 5°. Enfin, mettre en oeuvre tous les moyens propres à remédier au tiraillement des fibres. (D.J.)
|
| LAY | (Géog.) riviere de France ; on en distingue deux de ce même nom, le grand Lay & le petit Lay ; la premiere prend sa source au Poitou au vieux Pousanges, & après un cours de 15 lieues, va tomber dans la mer, à côté de l'abbaye de Jar. Le petit Lay vient de Saint-Paul en Pareda, & tombe dans le grand Lay ; mais l'un & l'autre Lay sont plutôt des ruisseaux que des rivieres. (D.J.)
|
| LAYDE | LAIDE, ou LEIDE, (Jurisprud.) est la même chose que lande ; on dit plus communément layde. Voyez LANDE. (A)
|
| LAYE | S. f. (Architect.) c'est une petite route qu'on fait dans un bois pour former une allée, ou pour arpenter ; c'est en lever le plan quand on en veut faire la vente.
LAYE, (Jeu d'orgue) dans l'orgue est la boëte E E, fig. 4. 6. 7. 9. 10, qui renferme les soupapes & le vent qui vient des soufflets par le gros porte-vent de bois qui s'abouche à une des extrémités de la laye, l'autre bout est bouché par une planche. Cette boëte qui n'a que trois côtés, la partie du sommier où sont les soupapes faisant le quatrieme, est composée d'une planche de bois de chêne, ainsi que tout le reste, de trois ou quatre pouces de largeur, un pouce ou trois quarts de pouce d'épaisseur, & aussi longue que le sommier ; cette barre est appliquée sur une partie des pieces X X, fig. 2. Orgue. Le côté F opposé à cette barre s'appelle le devant de la laye ; il est composé de deux planches entaillées à mi-bois dans tout leur circuit : cette entaille ou drageoir est fait avec un guillaume, aussi-bien que celui du chassis qui reçoit les deux devans de la laye ; voyez la fig. 6. qui est le profil, & les fig. 7 & 10. Les devants de la laye sont revêtus de peau de mouton collée par son côté glabre sur toute la surface qui regarde l'intérieur de la laye, afin de la fermer exactement. Chaque devant de laye a deux anneaux G G, fig. 7. 10. 14. qui servent à la pouvoir retirer quand on veut rétablir quelque soupape : les devants de la laye sont retenus dans leurs cadres par des tourniquets de fer p p, fig. 7 ; le dessous de la laye qui est le côté opposé aux soupapes est assemblé à rainure & languette avec le fond E de la laye, & à tenons & mortaises avec les trois morceaux de bois E E E, qui forment avec le chassis du sommier, les deux cadres entaillés en drageoir dans tout leur pourtour qui reçoivent les deux devants de la laye. A la partie intérieure du dessous de la laye est collée une barre de bois m, fig. 6, aussi longue que l'intérieur de la laye. Cette barre, qu'on appelle guide, est traversée par des traits de scie m m, fig. 7, paralleles & directement placés vis-à-vis ceux des soupapes qui doivent les regarder, voy. GUIDE. Ces traits de scie, tant ceux du guide m que des soupapes, servent à loger un ressort f g e, fig. 6 & 9, de laiton fort élastique. Ces ressorts ont la forme d'un U d'Hollande, & sont posés horisontalement en cette sorte ; ils servent à renvoyer & à tenir appliquées les soupapes contre le sommier, voyez RESSORT. Entre le guide m & le devant de la laye, sont des trous d e qui servent à passer les boursettes (voyez BOURSETTES) qui communiquent, par le moyen d'une S, aux anneaux f des soupapes. Les boursettes sont tirées par le moyen de la gette du sommier & de celles du clavier, voyez ABREGE. Tous les joints de la laye & du porte-vent sont couverts de peau de mouton parée (voyez PARER) ou de parchemin qui, lorsqu'il est bien collé, retient également le vent. Voyez les Pl. de Lut.
|
| LAYER | v. act. (Droit (féodal franc.) layer, selon Lalande, c'est marquer les bois qui doivent être laissés dans l'abattis des bois de haute futaie ou dans la coupe des taillis, soit baliveaux, soit piés cormiers, &c. pour laisser lesdits bois croître ensuite en haute futaie. Présentement on entend l'article 75 de la coutume d'Orléans, qui déclare " que le seigneur de fief emmeublit & fait les fruits siens quand ils seront en coupe, mesurés, arpentés, layés, criés, &c. ". Je ne dis point que la coutume d'Orléans décide bien, j'explique seulement le terme layer, & l'on n'en trouve que trop de semblables qui sont des restes de notre barbarie. (D.J.)
LAYER, (Coupe des Pierres) du latin laevigare, polir ; c'est tailler une pierre avec une espece de hache brételée, c'est-à-dire dentée en façon de scie, qu'on appelle laye, laquelle rend la surface unie quoique rayée de petits sillons uniformes qui lui donnent une apparence agréable.
|
| LAYETIER | S. m. (Ouvrier) qui fait & vend des layettes & toutes sortes d'autres boëtes de menue menuiserie.
Les maîtres de la communauté des Layetiers de Paris, se qualifient maîtres Layetiers-Ecrainiers de la ville & faubourgs de Paris.
Leurs premiers statuts sont assez anciens, comme on le peut voir par les quinze articles mentionnés dans la sentence du prevôt de Paris, auquel les maîtres Layetiers avoient été renvoyés par François I. en 1521, pour donner son avis sur les nouveaux statuts qu'ils avoient fait dresser.
Cette sentence, du 31 Janvier 1522, n'ayant été présentée au roi que quatre ans après, le même François I. donna de nouvelles lettres portant encore renvoi au prevôt de Paris pour confirmer & homologuer les nouveaux statuts que ledit prevôt avoit vus, réformés & approuvés en 1522 ; ce qui fut fait par une autre sentence du 27 Juin 1527. Enfin ces statuts, contenant vingt-neuf articles, furent encore augmentés de cinq autres, sur lesquels il y a des lettres d'Henri III. du 7 Janvier 1582.
Cette communauté a ses jurés pour veiller à ses priviléges, faire les visites & donner les lettres d'apprentissage & de maîtrise. Ces charges ayant été érigées en titre d'office par l'édit de 1691, furent l'année suivante réunies & incorporées, & le droit de l'élection rétabli.
L'apprentissage est de quatre années, & l'aspirant à la maîtrise est sujet au chef-d'oeuvre, à moins qu'il ne soit fils de maître.
Les Layetiers se servent de presque tous les outils des Menuisiers, étant en effet des menuisiers de menus ouvrages. Ils en ont cependant qui leur sont propres, tels que la colombe, le poinçon, le plioir & deux enclumes, l'une à main, l'autre montée sur un billot. Voyez le Dictionnaire de Commerce.
|
| LAYETTE | S. f. en terme de Layetier est un petit coffret ou boëte fait d'un bois fort léger & fort mince, ordinairement de hêtre, dans lequel on serre du linge ou autres choses semblables.
|
| LAYETTERIE | S. f. (Art méch.) l'art ou le métier des Layetiers. Cet art est aussi nécessaire qu'il est commode ; c'est par ces ouvrages que l'ordre & la propreté regnent dans les maisons, on peut même ajoûter le repos, car sans plusieurs petits ustensiles qu'il nous fournit, nous vivrions au milieu d'une multitude d'animaux bruyans & incommodes, dont nous ne sommes délivrés pour la plûpart que par l'industrie des Layetiers. C'est encore à eux qu'on doit la facilité de transporter toutes sortes de marchandises sans être exposés à les voir briser ; ce qui arriveroit sans-doute sans les caisses dans lesquelles les Layetiers les emballent très-surement.
|
| LAYLA | LAYLA-CHIENS, (Chasse) termes dont le piqueur doit user pour tenir les chiens en crainte lorsqu'il s'apperçoit que la bête qu'ils chassent est accompagnée, pour les obliger à en garder le change.
|
| LAYTON | (Géog.) bourg d'Angleterre dans le comté d'Essex, aux confins de celui de Middlesex. Plusieurs savans le prennent pour l'ancien Durolitum, petite ville des Trinobantes ; mais Cambden prétend que Durolitum est Oldfoord ubon lec, dans le même comté d'Essex. (D.J.)
|
| LAZACH | (Géog.) ville & royaume d'Asie dans l'Arabie heureuse, sous la domination du grand-seigneur.
|
| LAZARE | SAINT, (Hist. mod.) ordre militaire institué à Jérusalem par les chrétiens d'occident lorsqu'ils se furent rendus maîtres de la Terre-sainte. Les fonctions de cet ordre étoient d'avoir soin des pélerins, de les garder & de les défendre sur leur route des insultes des Mahométans. Quelques auteurs disent qu'il a été institué en 1119. Le Pape Alexandre IV. le confirma par une bulle en 1255, & lui donna la regle de saint Augustin. Les chevaliers de cet ordre ayant été chassés de la Terre-sainte, il s'en retira une partie en France, où ils possédoient déjà la terre de Boigny, près d'Orléans, que le roi Louis VII. leur avoit donnée, & dans laquelle ils fixerent leur résidence, garderent leurs titres, & tinrent leurs assemblées. En 1490 Innocent VIII. supprima en Italie l'ordre de Saint Lazare, ou plûtôt il l'unit à celui de Malte. Léon X. le retablit en Italie au commencement du xvj. siecle. En 1572 Grégoire XIII. l'unit en Savoie à l'ordre de S. Maurice, que le duc Emmanuel Philibert venoit d'instituer. En 1608 cet ordre fut uni en France à celui de Notre-Dame de Mont-Carmel, & Louis XIV. lui accorda depuis plusieurs priviléges. Les chevaliers de Saint Lazare peuvent se marier & posséder en même tems des pensions sur bénéfices : on l'appelle maintenant l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem. Il est composé d'environ 650 laïques-prieurs & freres servant d'armes, qui jouissent des commanderies & des mêmes privileges que les chevaliers, ainsi que des pensions sur bénéfices. Les premiers portent la croix émaillée de pourpre & de vert, fleurdelisée d'or, attachée à un grand cordon de soie moiré, pourpré ; & les autres portent la croix émaillée & fleurdelisée d'or aux mêmes émaux, en forme de médaille, attachée à une chaîne d'or à la boutonniere, avec la devise de l'ordre au haut de l'écusson de leurs armoiries, Dieu & mon Roi. M. le duc d'Orléans en a été le grand-maître ; c'est présentement monseigneur le duc de Berry, second fils de monseigneur le Dauphin.
LAZARE, Saint, (Prêtres de) nommés aussi Lazaristes, clercs séculiers d'une congrégation instituée en France dans le xvij. siecle, par M. Vincent de Paule. Ils prennent leur nom d'une maison qu'ils ont dans le faubourg saint Denis à Paris, qui étoit autrefois un prieuré sous le titre de Saint Lazare. Ils ne font que des voeux simples, & ils peuvent en être entierement dispensés au besoin. Leur institut est de former des missionnaires & des directeurs capables de conduire les jeunes ecclésiastiques dans les séminaires, dont plusieurs en France sont confiés à leurs soins. Leur maison de Saint Lazare, où réside le général, est aussi une maison de force pour renfermer les jeunes gens dont les débauches & la mauvaise conduite obligent leurs parens de sévir contr'eux. Ces prêtres dirigent aussi quelques cures en France, entr'autres celles de Versailles & des Invalides, de Fontainebleau, &c.
|
| LAZARET | S. m. (Hist. mod. & Mar.) bâtiment public en forme d'hôpital, où l'on reçoit les pauvres malades.
Lazaret dans d'autres pays est un édifice destiné à faire faire la quarantaine à des personnes qui viennent de lieux soupçonnés de la peste.
C'est un vaste bâtiment assez éloigné de la ville à laquelle il appartient, dont les appartemens sont détachés les uns des autres, où on décharge les vaisseaux, & où l'on fait rester l'équipage pendant quarante jours, plus ou moins, selon le lieu d'où vient le vaisseau & le tems auquel il est parti. C'est ce qu'on appelle faire quarantaine. Voyez QUARANTAINE.
Il y a des endroits où les hommes & les marchandises payent un droit pour leur séjour au lazaret.
Rien, ce me semble, n'est plus contraire au but d'une pareille institution. Ce but, c'est la sûreté publique contre les maladies contagieuses que les commerçans & navigateurs peuvent avoir contractées au loin. Or n'est-ce pas les inviter à tromper la vigilance, & à se soustraire à une espece d'exil ou de prison très-désagréable à supporter, sur-tout après un long éloignement de son pays, de sa famille, de ses amis, que de la rendre encore dispendieuse ?
Le séjour au lazaret devroit donc être gratuit. Que d'inconvéniens resultent de nos longs voyages sur mer, & de notre connoissance avec le nouveau monde ! Des milliers d'hommes sont condamnés à une vie mal-saine & célibataire, &c.
|
| LAZ | ou LESGI, (Géog.) & par quelques-uns de nos voyageurs LESQUI, c'est un peuple Tartare qui habite les montagnes du Daghestan, du côté de la mer Caspienne, à vingt ou trente lieues de cette mer. Ce peuple tartare & sauvage a le teint basané, le corps robuste, le visage effroyablement laid, des cheveux noirs & gras qui tombent sur les épaules ; ils reçoivent la circoncision, comme s'ils étoient mahométans. Leurs armes sont aujourd'hui le sabre & le pistolet. Ils pillent & volent de tous côtés tous les marchands qui passent par leur pays, guerroient contre les Tartares Nogais & Circasses, font de fréquentes incursions sur les Géorgiens, & se gouvernent sous l'autorité du roi de Perse par un chef particulier qu'ils nomment schemkal, lequel réside à Tarku. Ce chef a sous lui d'autres petits seigneurs qu'on appelle beghs ; mais voyez sur ces barbares orientaux Chardin, Oléarius, & les mém. des missions du Levant, tome IV.
|
| LAZIQUE | (Géog. anc.) peuple & pays d'Asie de l'un & de l'autre côté du Phase, dans la Colchide. Procope a décrit ce pays dans son histoire de la guerre des Perses, liv. II. chap. xxix. La Lazique devint une province écclésiastique où étoient cinq évêchés, au nombre desquels Phaside la métropole. La Mingrelie répond à la Lazique des anciens. (D.J.)
|
| LAZIVRARD | S. m. (Litholog.) C'est un des plus anciens noms du lapis qui soient dans les auteurs ; mais il désigne indifféremment la pierre lazuli & la couleur qu'elle donne : d'où vient que dans les siecles qui suivirent, tout bleu fut appellé lazivrard. De ce mot sont venus celui d'alazarad qu'Avicenne emploie, ceux de lazurad, d'azuri, de lazurd, & finalement de lazuli, sous lequel nous connoissons aujourd'hui cette pierre. On en trouvera l'article au mot LAPIS. (D.J.)
|
| LE | (Grammaire) article masculin des noms substantifs. Voyez l'article ARTICLE.
|
| LÉ | S. m. (Commerce) largeur d'une étoffe ou d'une toile entre les deux lisieres, ainsi l'on dit un ou plusieurs lés d'une étoffe, pour signifier une ou plusieurs fois sa largeur. Un lé de drap, deux lés de satin, trois lés de gros-de-Tours, quatre lés de taffetas. Dictionnaire de Commerce.
LE, (terme de riviere) espace que les propriétaires des terres doivent laisser le long des rivieres pour le tirage des hommes & des chevaux qui remontent des bateaux. Il est de 24 piés.
|
| LE BESCHE | ou SUD-OUEST, s. m. (Marine) c'est le nom qu'on donne sur la Méditerranée au vent qui souffle entre le couchant & le midi, nommé sur l'Océan Sud-Ouest.
|
| LE TURGUS | S. m. (Litt. greq.) On nommoit en grec , & en latin tenuarii, des ouvriers qui s'occupoient à faire ces pallia bombicina, ces robes fines, ces habits transparens, ces gazes de Cos, si fort en vogue dans le tems de la dépravation des moeurs des Grecs & des Romains.
Rosinus nous décrit l'usage & la variété de ces nuages de lin ou de soie, qu'un poëte nommoit si heureusement ventos textiles. Les planches en grand nombre d'Herculanum, tab. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, du tome I. nous représentent de très-jolies bacchantes revêtues en dansant de ces robes de gaze ; c'est dans ce même habit qu'Apulée dépeint Vénus, qualis erat dùm virgo, nudo & intecto corpore, perfectam formositatem professa, nisi quod tenui pallio bombicino inumbrabat spectabilem pubem. Voyez GAZE DE COS. (D.J.)
|
| LÉAM | S. m. (Commerce) morceau d'argent qui se prend au poids, & qui est à la Chine une espece de monnoie courante. Les Portugais l'appellent tel ou tail. Voyez TAIL Dictionn. de commerce.
|
| LÉANDRE | LA TOUR DE, (Géog. Littér. Antiq. Médail.) tour d'Asie en Natolie, dans le Bosphore de Thrace auprès du cap de Scutari. Les Turcs n'ont dans cette tour pour toute garnison qu'un concierge. M. de Tournefort dit que l'empereur Manuel la fit bâtir, & en éleva une autre semblable du côté de l'Europe, au monastere de S. George, pour y tendre une chaîne qui fermât le canal de la mer Noire.
Cette tour de Scutari est nommée par les Turcs tour de la Pucelle ; mais les Francs ne la connoissent que sous le nom de la tour de Léandre, quoique la vraie tour, la fameuse tour qui porte indifféremment dans l'histoire, le nom de tour de Léandre, ou celui de tour de Héro, comme Strabon l'appelle , fût située sur les bords du canal des Dardanelles.
Cette tour du canal des Dardanelles a été immortalisée par les amours d'Héro & de Léandre. Héro étoit une jeune prêtresse de Vénus dans la ville de Sestos, & Léandre étoit un jeune homme d'Abydos. Ces deux villes, bâties dans le lieu le plus étroit de l'Hellespont, vis-à-vis l'une de l'autre, au bord des deux rivages opposés, ne se trouvoient séparées que par un espace de 7 à 800 pas. Une fête qui attiroit à Sestos les habitans du voisinage, fit voir à Léandre la belle Héro, dans le temple même, où elle s'acquitoit de ses fonctions : elle le vit aussi, & leurs coeurs furent d'intelligence.
Ils se donnerent de fréquens rendez-vous dans la tour du lieu, qui depuis mérita de porter leur nom, & où la prêtresse avoit son appartement. Pour mieux cacher leur intrigue, Léandre, à la faveur de la nuit, passoit le détroit à la nage ; mais leur commerce ne dura pas long-tems : la mauvaise saison étant venue, Léandre périt dans les flots, & Héro ne pouvant survivre à cette perte, se précipita du haut de sa tour, Heroâ lacrymoso littore turri ! C'étoit du sommet de cette tour, dit Stace, que la prêtresse de Sestos avoit continuellement ses yeux attachés sur les vagues de la mer : sedet anxia turre supremâ, Sestias in speculis.
On sait combien d'autres poëtes & d'anciens écrivains ont chanté cette avanture. Virgile y fait une belle allusion dans ses géorgiques, liv. III. v. 258 & suiv. Quid juvenis, &c. Dans Martial, Léandre prie les ondes de daigner l'épargner dans sa course vers Héro, & de ne le submerger qu'à son retour, parcite dum propero, mergite dùm redeo. Antipater de Macédoine, parlant des naufrages arrivés sur l'Hellespont, s'écrie dans l'anthologie, l. I. c. lv. épig. 7. " malheureuse Héro, & vous infortuné Déimaque, vous perdîtes dans ce trajet de peu de stades, l'une un époux, & l'autre une épouse chérie ".
Tout le monde a lû dans les héroides attribuées à Ovide, les épîtres de Léandre & d'Héro, & personne n'ignore que l'histoire de ces deux amans est racontée avec toutes les graces de la Poësie dans un écrivain grec, qui porte le nom de Musée : c'est un ouvrage de goût & de sentiment, plein de tendresse & d'élégance. Nous en avons des traductions dans presque toutes les langues vivantes de l'Europe ; mais nous n'en avons point qui égale la noblesse & la pureté de l'original.
Enfin, les médailles ont rendu célebre la tour de Léandre : on en possede un grand nombre qui portent les noms des deux amans, & d'autres où l'on voit Léandre précédé de Cupidon le flambeau à la main, nager vers Héro, qui l'accueille du haut d'une tour.
|
| LÉANE | LA, (Géog.) riviere d'Irlande ; elle a sa source dans la province de Meinster, au comté de Kerry, court à l'ouest, & se jette dans la baie de Dingle. (D.J.)
|
| LÉAO | S. m. (Hist. nat. Minéralogie,) espece de pierre bleue qui se trouve dans les Indes orientales, sur-tout dans les endroits où il y a des mines de charbon de terre. Les Chinois s'en servent pour donner la couleur bleue à leur porcelaine ; ils commencent par laver cette pierre, afin de la dégager de toute partie terrestre & impure ; ils la calcinent dans des fourneaux pendant deux ou trois heures, après quoi ils l'écrasent dans des mortiers de porcelaine, & versent de l'eau par-dessus, qu'ils triturent avec la pierre ; ils décantent l'eau qui s'est chargée de la partie la plus déliée, & continuent ainsi à triturer & à décanter jusqu'à ce que toute la couleur soit enlevée : après cette préparation ils s'en servent pour peindre en bleu leur porcelaine.
On croit que le léao n'est qu'un vrai lapis lazuli ; mais il y a lieu d'en douter, attendu que la couleur du lapis n'est point en état de résister à l'action du feu, qui la fait disparoître. Voyez LAPIS LAZULI, observations sur les coûtumes de l'Asie. Et voyez l'article AZUR. (-)
LEAO, (Géog.) autrement LEAOTUNG, riviere de la Tartarie, où elle a sa source, au-delà de la grande muraille, & se perd dans la mer.
|
| LÉAOTUNG | (Géog.) vaste contrée de la Chine, dont elle est séparée par la grande muraille & le golfe de Cang, tandis que la Corée & les montagnes d'Yalo la séparent du pays des Tartares Bogdois du Niuchèz. Ses habitans, plus guerriers & moins industrieux que les Chinois, n'aiment ni le Commerce ni l'Agriculture, quoique leur pays y soit propre.
Il a plusieurs montagnes, entr'autres celle de Changpé, qui court jusque dans la Tartarie, depuis la grande muraille, & qui est célebre par son lac de 80 stades d'étendue. C'est dans cette montagne que le Yalo, & le Quentung prennent leurs sources.
Les lieux de la province où il n'y a point de montagnes, sont stériles en froment, millet, légumes & fruits.
Ce pays produit le gin-sing, ainsi que le Canada, & fournit de même des fourrures de castors, de martes & de zibelines. Chan-Yang a de nos jours usurpé la place de Léaoyang, qui en étoit la métropole.
On sait les étranges révolutions que le royaume de Léaogund éprouva dans le dernier siecle. M. de Voltaire en a peint toute l'histoire en quatre pages.
Au nord-est de cette province il y avoit quelques hordes de tartares Mantcheoux, que le vice-roi de Léaogund traita durement. Ils firent, comme les anciens scythes, des représentations hardies. Le gouverneur, pour réponse, brûla leurs cabanes, enleva leurs troupeaux, & voulut transplanter les habitans. Alors ces tartares, qui étoient libres, se choisirent un chef pour se vanger. Ce chef, nommé Taitsou, battit les Chinois, entra victorieux dans la contrée de Léaotung, & se rendit maître de la capitale en 1622.
Taitsou mourut en 1626 au milieu de ses conquêtes ; mais son fils Taitsong marchant sur ses traces, prit le titre d'empereur des Tartares, & s'égala à l'empereur de la Chine.
Il reconnoissoit un seul dieu comme les lettrés chinois, & l'appelloit le tien comme eux. Il s'exprime ainsi dans une de ses lettres circulaires aux Mandarins des provinces chinoises. " Le tien éleve qui il lui plaît ; il m'a peut-être choisi pour être votre maître ". Il ne se trompoit pas ; depuis 1628 il remporta victoires sur victoires, établit des lois au milieu de la guerre, & enleva au dernier empereur du sang chinois toutes ses provinces du nord, tandis qu'un mandarin rebelle, nommé Litsching, se saisit de celles du midi : ce Litsching fut tué au milieu de ses succès.
Les Tartares ayant perdu leur empereur Taitsong en 1642, nommerent pour chef un de ses neveux encore enfant, qui s'appelloit Changti. Sous ce chef, qui périt à l'âge de 24 ans en 1661, & sous Cham-hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de 8 ans, ils conquirent pié-à-pié tout le vaste empire de la Chine. Le tems n'a pas encore confondu la nation conquérante avec le peuple vaincu, comme il est arrivé dans nos Gaules, en Angleterre & ailleurs ; mais les Tartares ayant adopté sous Cham-hi les lois, les usages & la religion des Chinois, les deux nations n'en composeront bien-tôt qu'une seule.
|
| LÉAOYANG | (Géog.) c'étoit dans le dernier siecle la capitale du Léaotung ; à-présent Chan-Yang a pris sa place. Léaoyang est une grande ville assez peuplée. Long. 5. 33. lat. 39. 40.
|
| LÉAWAVIA | (Géog.) port de mer, sur la côte orientale de l'isle de Ceylan, dans le pays du même nom.
|
| LÉBADIE | (Géog. anc.) ; en latin Lebadia, ancienne ville de Grece en Béotie, entre l'Hélicon & Chéronée, auprès de Coronée. Il y avoit à Lébadie le célebre oracle de Trophonius, qui étoit dans un antre de rocher, où l'on descendoit avec peine. Ce lieu s'appelle encore Livadia, & donne son nom à toute la contrée. Voyez LIVADIA & LIVADIE. (D.J.)
|
| LEBEDA | Leptis, (Géog.) ancienne ville d'Afrique, au royaume de Tripoli, avec un assez bon port sur la mer Méditerranée, à 34 lieues de Tripoli. On en a tiré pour la France de belles colonnes de marbre ; celles du grand autel de S. Germain-des-Prés à Paris, sont de ce marbre. Plusieurs croyent que Lebeda est la partie de l'empereur Severe, & de S. Fulgence : Leptis est l'ancien nom de cette ville. Long. 32. 25. lat. 32. 10.
|
| LEBEDUS | (Géog. anc.) ville ancienne de l'Asie proprement dite, dans l'Ionie, sur l'isthme, ou du-moins auprès de l'isthme, entre Smirne & Colophone.
Strabon, liv. XIV. parle des jeux que l'on y célébroit tous les ans en l'honneur de Bacchus ; c'est à quoi se rapporte une médaille de Géta avec la figure de Bacchus, & ce mot . Lysimaque renversa Lebedus, & en transporta les habitans à Ephèse, comme le raconte Pausanias, Attic. c. ix. Depuis ce tems-là, cette ville ne put se relever, & demeura moins un bourg, qu'un pauvre village. Horace nous l'indique assez, quand il dit, lib. I. epist. xj. v. 5.
An Lebedum laudas odio maris, atque viarum ?
Scis Lebedus quam sit Gabiis desertior, atque
Fidenis vicus.
" Ennuyé de courir les mers n'êtes-vous point tenté de vous fixer à Lebedus ? ce séjour n'a-t-il point d'attrait pour vous ? Bull. Savez-vous ce que c'est que Lebedus, un séjour plus desert que Gabies & que Fidene ".
En effet ce lieu restoit desert plus des trois quarts de l'année, & n'étoit fréquenté que pendant que les comédiens y séjournoient pour jouer leurs pieces, & célébrer les fêtes de Bacchus.
Enfin, cette ville, dont Hérodote, Strabon, & Pomponius Méla, nous parlent comme de l'une des douze anciennes villes de l'Ionie, n'étoit plus du tems d'Auguste qu'une méchante bicoque.
|
| LÉBENA | (Géog. anc.) , ville de l'île de Crete, sur la côte méridionale, voisine du promontoire de Léon. Elle servoit de port à Gortyne, dont elle étoit à 90 stades. Il y avoit un temple d'Esculape, , bâti sur le modele de celui qui étoit à Cyrène, & selon Philostrate, l. IV. c. xj. toute la Crete se rendoit à ce temple, de même que toute l'Asie se rendoit à Pergame.
|
| LÉBER | (Géog.) riviere de la haute Alsace ; elle a sa source à l'orient des montagnes du Vosge, aux confins de la Lorraine, & se jette dans l'Ill ; la vallée qu'elle arrose s'appelle le Libéraw, ou Leberthall. (D.J.)
|
| LEBINI | S. m. (Onomat. des drog.) nom donné par les anciens Arabes à une des especes de storax ; nous tâcherons d'éclaircir cette dénomination avec les autres qu'on trouve dans leurs écrits au mot STORAX. (D.J.)
|
| LEBINTHUS | (Géog. anc.) île de la mer de Crete, voisine de Calymne & de Nisyros ; c'est présentement Lévita, île de l'Archipel.
|
| LÉBITON | S. m. (Littér.) ; c'étoit un habit de moine fait de poil, selon Suidas ; selon d'autres auteurs, c'étoit une tunique de lin sans manches, & assez semblable à un sac que portoient les solitaires de l'Egypte & de la Thébaïde. (D.J.)
|
| LEBRET | ou LEBRIT, en latin Leporetum, (Géog.) ancien nom de la ville & du pays d'Albret en Gascogne ; sur quoi voyez M. de Marca, Hist. de Béarn. liv. VII. c. x. not. 3, 4, & 5. L'origine de ce nom vient des lievres ou lapins, qui fourmilloient alors dans les landes du pays.
|
| LEBRIXA | Nebrissa, (Géogr.) ancienne ville d'Espagne, dans l'Andalousie. Elle est dans un pays admirable, abondant en grains, en vins excellens, & en oliviers, dont on fait la meilleure huile d'Espagne, à quatre lieues N. E. de S. Luçar de Baraméda, à deux du Guadalquivir. Elle étoit connue des anciens sous le nom de Nebrissa, qu'elle porte encore, avec un fort leger changement, long. 12. 3. lat. 36. 56.
|
| LEBUI | (Géog. anc.) peuple de la gaule-Cispadane, qui occupoit le pays où sont Brixia & Vérone. Tite-Live, l. XXI. c. xxxviij. en parle en plus d'un endroit.
|
| LEBUNI | (Géog. anc.) ancien peuple de l'Espagne Tarragonoise, selon Pline, l. III. c. iij. L'Espagne étoit divisée sous les Romains en assemblées, conventus, & les Lebuni étoient sous l'assemblée de Lugos.
|
| LEBUS | ou LEBUSS, Lebussa, (Géog.) petite ville d'Allemagne, dans le cercle de la haute Saxe, au marquisat de Brandebourg, avec un évêché, autrefois suffragant de Gnesne, qui a été sécularisé en 1556, pour la maison de Brandebourg. Elle est sur l'Oder, à huit lieues de Custrin, & à deux de Francfort. Voyez sur cette ville Zeyler, Brandb. Topog. p. 71, & Chytraei, Saxonia, p. 955. Long. 32. 30. lat. 52. 28. (D.J.)
|
| LECANOMANCIE | S. f. (Divin.) sorte de divination qui se pratiquoit en jettant dans un bassin plein d'eau des pierres précieuses marquées de caracteres magiques & des lames d'or & d'argent aussi constellées, de maniere qu'on entendoit sortir du fond du bassin la question à ce qu'on demandoit. Glycas rapporte, liv. II. de ses Annales que ce fut par ce moyen que Nectanebe roi d'Egypte, connut qu'il seroit détrôné par ses ennemis, & Delrio ajoute que de son tems cette espece de divination étoit encore en vogue parmi les Turcs. Delrio, Disquisit. magicar. lib. IV. cap. ij. quaest. VI. sect. iv. p. 545. (G)
|
| LECCÉ | Aletium, (Géog.) ville d'Italie, au royaume de Naples ; dans la terre d'Otrante, dont elle est la principale ; & la résidence du gouverneur, avec un évêché suffragant d'Otrante. Elle est à 4 lieues du golfe de Venise, 8 N. O. d'Otrante, 8 S. E. de Brindisi, 78 S. E. de Naples. Long. 36. 55. lat. 40. 38.
Leccé est la patrie de Ammirato Scipione, que le grand-duc de Toscane accueillit obligeamment à Florence ; il publia en italien l'histoire de cette ville, & de ses familles illustres : il y mourut en 1603.
Palmis Abraham juif, & docteur en Medecine au commencement du xvj. siecle. Je le nomme ici, parce qu'il est, je pense, le premier qui ait donné au public une grammaire hébraïque. Il n'en avoit point encore paru en Europe avant la sienne ; il est vrai qu'aujourd'hui cette grammaire de Palmis n'est point estimée, mais elle en a occasionné de bonnes, sans lesquelles on ne peut apprendre l'hébreu.
|
| LECCO | (Géog.) petite ville d'Italie, en Lombardie, dans le Milanez, vers la frontiere de l'état de Venise, & du Bergamasque, sur l'Addar, à 9 milles de Come. Long. 26. 33. lat. 45. 46.
|
| LECH | (Géog.) riviere d'Allemagne ; elle a sa source au Tirol, sur les frontieres des Grisons, & se jette dans le Danube, un peu au-dessous de Donavert. (D.J.)
|
| LECHE | Cyperoides, s. f. (Bot.) genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ; elle est composée de deux étamines, stérile & soutenue par un calice d'une seule piece en forme d'écaille. L'embryon est renfermé dans une capsule qui vient d'un autre calice assez semblable au premier. Cet embryon devient dans la suite une semence ordinairement triangulaire. Lorsque cette semence n'est encore qu'un embryon, elle est terminée par un filament qui est branchu par son extrémité, & qui passe par l'ouverture des capsules. Ajoutez aux caracteres de ce genre que les calices des fleurs sont disposés en épi cylindrique, de même que les calices des semences ; ce qui fait la plus grande différence qu'il y ait entre la leche & le carex. Micheli, Nov. plant. gen. Voyez PLANTE.
LECHE, s. m. (Commerce) c'est une espece de vernis de lie que l'on donne en Amérique, mais surtout au Mexique, aux piastres que les Espagnols y fabriquent. Voyez l'art. LECHEUM. Cette variété tantôt de nomenclature, tantôt d'orthographe, doit occasionner dans un ouvrage de l'étendue de celui-ci, des redites, contre lesquelles il est difficile d'être en garde ; d'ailleurs il vaut mieux redire qu'omettre.
|
| LECHEFRITE | S. f. (Cuisine) ustensile ou espece de vaisseau plat de tôle ou fer battu, oblong, à pié ou sans pié, à une ou plusieurs mains ou poignées, & terminé par l'une & l'autre de ses extrémités par une goulette, ou un bec qui sert à verser la graisse & le jus qu'il reçoit des pieces qu'on fait rôtir & sous lesquelles il y a toujours une lechefrite.
|
| LECHER | verbe act. (Gram.) c'est polir, nettoyer, sucer avec la langue. L'ours leche son petit ; l'auteur son ouvrage. On n'aime pas les peintures léchées. Voyez LECHER, Peinture.
LECHER en Peinture, c'est finir extrémement les tableaux, mais d'une façon froide & insipide ; & où l'on connoît par-tout la peine que cela a coûté au peintre. Bien terminer ses ouvrages, est une bonne qualité ; les lécher est un vice. Ce peintre leche trop ses ouvrages ; cet ouvrage n'a point d'ame, il est trop léché.
|
| LECHEUM | on pourroit dire en françois LÉCHÉE, (Géogr. anc.) port sur le golfe de Corinthe, servant de port à la ville même de Corinthe. Tous les anciens, Polybe, Strabon, Pausanias, Ptolomée, & autres en font mention. Corinthe quoique située entre deux mers (ce qui fait dire à Horace bimaris Corinthi), n'étoit pourtant sur le bord ni de l'une ni de l'autre ; mais elle avoit de chaque côté un lieu qui lui servoit de port, savoir Cenchrées au levant, & Lechoeum au couchant ; c'est présentement Lesteiocori. (D.J.)
|
| LECHI | (Géog. sacr.) c'étoit une ville de la tribu de Dan dans la Terre-sainte, & ce n'est aujourd'hui qu'un misérable village ; mais l'on recueille dans le territoire voisin beaucoup de coton, de dattes & d'olives, au rapport du P. Roger, Aquila, Symmaque & Glycas nomment Léchi, en grec .
|
| LECHO | S. m. (Monnoie) on nomme ainsi dans le monnoyage de l'Amérique espagnole, particulierement au Mexique, une espece de couche de vernis de lie que l'on donne à certaines piastres qui s'y fabriquent, afin de les rendre d'un plus bel oeil. Cependant ce vernis fait qu'on préfere dans le commerce les piastres dites colonnes à celles qu'on appelle mexicaines, non pas que les piastres colonnes ainsi nommées, parce qu'elles portent pour revers les colonnes d'Hercule, avec la fameuse devise du nec plus ultrà ; non pas, dis-je, que ces dernieres piastres soient d'un titre plus fin que les méxicaines ; mais à cause de leur lécho, qui à la refonte laisse un déchet de près d'un pour cent.
|
| LECHONA-GEEZ | (Hist. mod.) ce mot signifie langue savante. Les Ethiopiens & les Abissins s'en servent pour désigner la langue dans laquelle sont écrits leurs livres sacrés ; elle n'est point entendue par le peuple, étant réservée aux seuls prêtres qui souvent ne l'entendent pas mieux que les autres. On croit que cette langue est l'ancien éthiopien ; le roi s'en sert dans ses édits : elle a dit-on, beaucoup d'affinité avec l'hébreu & le syriaque.
|
| LECHT | S. m. (Comm. & Mar.) mesure fort en usage sur les mers du nord : elle contient douze barrils.
|
| LECK | LE, en flamand, DE LECK, & LYCIAS dans Ptolomée, (Géog.) riviere des Pays-bas. A proprement parler, c'est moins une riviere qu'un bras du Rhin. Cluvier, de tribus Rheni alveis, c. vj. remarque que le nouveau canal dans lequel Civilis fit couler le Rhin, est présentement le Leck, Lecca, qui passant à Culembourg, à Viane, à Schoonhove, se perd dans la Meuse près du village de Krimpen. M. Corneille a confondu le Leck avec la fosse de Corbulon, fossa Corbulonis. Un diplome de Charlemagne en 776, nomme le Leck Lockia. Heda dit dans sa chronique de Hollande, que ce fut en 841 que l'on releva ses bords de fortes digues. (D.J.)
|
| LEÇON | S. f. (Gram. Mor.) c'est l'action d'instruire. Les maîtres de la jeunesse en s'écartant trop de la maniere dont la nature nous instruit, donnent des leçons qui fatiguent l'entendement & la mémoire sans les enrichir & sans les perfectionner.
Les leçons la plupart ne sont qu'un assemblage de mots & de raisonnemens, & les mots sur quelque matiere que ce soit, ne nous rendent qu'imparfaitement les idées des choses. L'écriture hiérogliphique des anciens egyptiens étoit beaucoup plus propre à enrichir promptement l'esprit de connoissances réelles, que nos signes de convention. Il faudroit traiter l'homme comme un être organisé & sensible ; & se souvenir que c'est par ses organes qu'il reçoit ses idées, & que le sentiment seul les fixe dans sa mémoire. En Métaphysique, Morale, Politique, principes des Arts, &c. il faut que le fait ou l'exemple suive la leçon, si vous voulez rendre la leçon utile. On formeroit mieux la raison en faisant observer la liaison naturelle des choses & des idées, qu'en donnant l'habitude de faire des argumens ; il faut mêler l'Histoire naturelle & civile, la Fable, les emblèmes, les allégories, à ce qu'il peut y avoir d'abstrait dans les leçons qu'on donne à la jeunesse ; on pourroit imaginer d'exécuter une suite de tableaux, dont l'ensemble instruiroit des devoirs des citoyens, &c.
Quand les abstractions deviennent nécessaires, & que le maître n'a pu parler aux sens & à l'imagination pour insinuer & pour graver un précepte important, il devroit le lier dans l'esprit de son éleve à un sentiment de peine ou de plaisir, & le fixer ainsi dans sa mémoire ; enfin dans toutes les instructions il faudroit avoir plus d'égard qu'on n'en a eu jusqu'à présent au méchanisme de l'homme.
LEÇON, (Théol.) dans la Bible, les peres & les auteurs ecclésiastiques sont les termes différens dans lesquels le texte d'un même auteur est rendu dans différens manuscrits anciens ; différences qui viennent pour l'ordinaire de l'altération que le tems y a apportée, ou de l'ignorance des copistes. V. TEXTE.
Les versions de l'Ecriture portent souvent des leçons différentes du texte hébreu ; & les divers manuscrits de ces versions présentent souvent des leçons différentes entr'elles.
La grande affaire des critiques & des éditeurs est de déterminer laquelle de plusieurs leçons est la meilleure ; ce qui se fait en confrontant les différentes leçons de plusieurs manuscrits ou imprimés, & choisissant pour bonne, celle dont les expressions font un sens plus conforme à ce qu'il paroît que l'auteur avoit intention de dire, ou qui se rencontre dans les manuscrits, ou les imprimés les plus corrects.
LEÇONS, en terme de breviaire, ce sont des fragmens soit de l'Ecriture, soit des PP. qu'on lit à matines. Il y a des matines à neuf leçons, à trois leçons.
On dit aussi leçons de Théologie, comme leçon d'arabe, de grec, &c.
LEÇON, (Maréchallerie) se dit également du cavalier & du cheval, qu'on instruit dans les maneges. Le cavalier donne leçon au cheval en lui apprenant ses airs de manege, & le maître en parlant à l'académiste à cheval, sur la situation de son corps, & sur la façon de conduire son cheval. En donnant leçon à un cheval, il faut le prendre toujours plutôt par les caresses & la douceur, que par la rigueur & le châtiment.
|
| LECTEUR | (Littérat. mod.) terme général ; c'est toute personne qui lit un livre, un écrit, un ouvrage,
Un auteur à genoux dans une humble préface,
Au lecteur qu'il ennuie, a beau demander grace,
il ne doit pas l'espérer lorsque son livre est mauvais, parce que rien ne le forçoit à le mettre au jour ; on peut être très estimable, & ignorer l'art de bien écrire. Mais il faut aussi convenir que la plûpart des lecteurs sont des juges trop rigides, & souvent injustes. Tout homme qui sait lire se garde bien de se croire incompétent sur aucun des écrits qu'on publie ; savans & ignorans, tous s'arrogent le droit de décider ; & malgré la disproportion qui est entr'eux sur le mérite, tous sont assez uniformes dans le penchant naturel de condamner sans miséricorde. Plusieurs causes concourent à leur faire porter de faux jugemens sur les ouvrages qu'ils lisent ; les principales sont les suivantes, discutées attentivement par un habile homme du siecle de Louis XIV. qui n'a pas dédaigné d'épancher son coeur à ce sujet.
Nous lisons un ouvrage, & nous n'en jugeons que par le plus ou le moins de rapport qu'il peut avoir avec nos façons de penser. Nous offre-t-il des idées conformes aux nôtres, nous les aimons & nous les adoptons aussi-tôt ; c'est-là l'origine de notre complaisance pour tout ce que nous approuvons en général. Un ambitieux, par exemple, plein de ses projets & de ses espérances, n'a qu'à trouver dans un livre des idées qui retracent avec un éloge de pareilles images, il goûte infiniment ce livre qui le flatte. Un amant possédé de ses inquiétudes & de ses desirs, va cherchant des peintures de ce qui se passe dans son coeur, & n'est pas moins charmé de tout ce qui lui représente sa passion, qu'une belle personne l'est du miroir qui lui représente sa beauté. Le moyen que de tels lecteurs fassent usage de leur esprit, puisqu'ils n'en sont pas les maîtres ? hé, comment puiseroient-ils dans leurs fonds des idées conformes à la raison & à la vérité quand une seule idée les remplit, & ne laisse point de place pour d'autres ?
De plus, il arrive souvent que la partialité offusque nos foibles lumieres & nous aveugle. On a des liaisons étroites avec l'auteur dont on lit les écrits, on l'admire avant que de le lire ; l'amitié nous inspire pour l'ouvrage la même vivacité de sentiment que pour la personne. Au contraire notre aversion pour un autre, le peu d'intérêt que nous prenons à lui (& c'est malheureusement le plus ordinaire), fait d'avance du tort à son ouvrage dans notre ame, & nous ne cherchons, en le lisant, que les traits d'une critique amere. Nous ne devrions avec de semblables dispositions porter notre avis que sur des livres dont les auteurs nous sont inconnus.
Un défaut particulier à notre nation qui s'étend tous les jours davantage, & qui constitue présentement le caractere des lecteurs de notre pays, c'est de dépriser par air, par méchanceté, par la prétention à l'esprit les ouvrages nouveaux qui sont vraiment dignes d'éloges. Aujourd'hui (dit un Philosophe dans un ouvrage de ce genre qui durera long-tems) " aujourd'hui que chacun aspire à l'esprit, & s'en croit avoir beaucoup ; aujourd'hui qu'on met tout en usage pour être à peu de frais spirituel & brillant, ce n'est plus pour s'instruire, c'est pour critiquer & pour ridiculiser qu'on lit. Or il n'est point de livre qui puisse tenir contre cette amere disposition des lecteurs. La plûpart d'entr'eux, occupés à la recherche des défauts d'un ouvrage, sont comme ces animaux immondes qu'on rencontre quelquefois dans les villes, & qui ne s'y promenent que pour en chercher les égoûts. Ignoreroit-on encore qu'il ne faut pas moins de lumieres pour appercevoir les beautés que les défauts d'un ouvrage ? Il faut aller à la chasse des idées quand on lit, dit un anglois, & faire grand cas d'un livre dont on en rapporte un certain nombre. Le savant sait lire pour s'éclairer encore, & s'enquiert sans satyre & sans malignité ".
Joignez à ces trois causes de nos faux jugemens en ouvrages le manque d'attention & la répugnance naturelle pour tout ce qui nous attache long-tems sur un même objet. Voilà pourquoi l'auteur de l'Esprit des loix, tout intéressant qu'est son ouvrage, en a si fort multiplié les chapitres ; la plûpart des hommes, & les femmes sans-doute y sont comprises, regardent deux ou trois choses à la fois, ce qui leur ôte le pouvoir d'en bien démêler une seule ; ils parcourent rapidement les livres les plus profonds, & ils décident. Que de gens qui ont lu de cette maniere l'ouvrage que nous venons de nommer, & qui n'en ont apperçu ni l'enchaînement, ni les liaisons, ni le travail ?
Mais je suppose deux hommes également attentifs, qui ne soient ni passionnés, ni prévenus, ni portés à la satyre, ni paresseux, & cette supposition même est rare ; je dis que quand la chose se rencontre par bonheur, le différent degré de justesse qu'ils auront dans l'esprit formera la différente mesure du discernement ; car l'esprit juste juge sainement de tout, au lieu que l'imagination séduite ne juge sainement de rien ; l'imagination influe sur nos jugemens à-peu-près comme une lunette agit sur nos yeux, suivant la taille du verre qui la compose. Ceux qui ont l'imagination forte croient voir de la petitesse dans tout ce qui n'excede point la grandeur naturelle, tandis que ceux dont l'imagination est foible voient de l'enflure dans les pensées les plus mesurées, & blâment tout ce qui passe leur portée : en un mot, nous n'estimons jamais que les idées analogues aux nôtres.
La jalousie est une autre des causes les plus communes des faux jugemens des lecteurs. Cependant les gens du métier qui par eux-mêmes connoissent ce qu'il en coûte de soins, de peines, de recherches & de veilles pour composer un ouvrage, devroient bien avoir appris à compâtir.
Mais que faut-il penser de la bassesse de ces hommes méprisables qui vous lisent avec des yeux de rivaux, & qui, incapables de produire eux-mêmes, ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ouvrages supérieurs, & d'en décréditer les auteurs jusque dans le sein du sanctuaire ? " Ennemis des beaux génies, & affligés de l'estime qu'on leur accorde, ils savent que semblables à ces plantes viles qui ne germent & ne croissent que sur les ruines des palais, ils ne peuvent s'élever que sur les débris des grandes réputations ; aussi ne tendent-ils qu'à les détruire ".
Le reste des lecteurs, quoiqu'avec des dispositions moins honteuses, ne juge pas trop équitablement. Ceux qu'un fastueux amour des livres a teint, pour ainsi dire, d'une littérature superficielle, qualifient d'étrange, de singulier, de bizarre tout ce qu'ils n'entendent pas sans effort, c'est-à-dire, tout ce qui excede le petit cercle de leurs connoissances & de leur génie.
Enfin d'autres lecteurs revenus d'une erreur établie parmi nous quand nous étions plongés dans la barbarie ; savoir, que la plus légere teinture des sciences dérogeoit à la noblesse, affectent de se familiariser avec les muses, osent l'avouer, & n'ont après tout dans leurs décisions sur les ouvrages qu'un goût emprunté, ne pensant réellement que d'après autrui. On ne voit que des gens de cet ordre parmi nos agréables & ces femmes qui lisent tout ce qui paroît. Ils ont leurs héros de littérature, dont ils ne sont que l'écho ; ils ne jugent qu'en seconds, entêtés de leurs choix, & séduits par une sorte de présomption d'autant plus dangereuse qu'elle se cache sous une espece de docilité & de déférence. Ils ignorent que pour choisir de bons guides en ce genre, il ne faut guere moins de lumieres que pour se conduire par soi-même ; c'est ainsi qu'on tâche de concilier son orgueil avec les intérêts de l'ignorance & de la paresse. Nous voulons presque tous avoir la gloire de prononcer, & nous fuyons presque tous l'attention, l'examen, le travail & les moyens d'acquérir des connoissances.
Que les auteurs soient donc moins curieux de suffrages de la plus grande, que de la plus saine partie du public !
Neque te ut miretur turba ; labores ;
Contentus paucis lectoribus. (D.J.)
LECTEUR, s. m. (Littérat.) lector, quelquefois à studiis, & en grec , c'étoit chez ces deux peuples un domestique dans les grandes maisons destiné à lire pendant les repas. Il y avoit même un domestique lecteur dans les maisons bourgeoises, où l'on se piquoit de goût & d'amour pour les lettres. Servius, dans ses Commentaires sur Virgile, liv. XII. v. 159, parle d'une lectrice, lectrix.
Quelquefois le maître de la maison prenoit l'emploi de lecteur ; l'empereur Sévere, par exemple, lisoit souvent lui-même au repas de sa famille. Les Grecs établirent des anagnostes qu'ils consacrerent à leurs théatres, pour y lire publiquement les ouvrages des poëtes. Les anagnostes des Grecs & les lecteurs des Romains avoient des maîtres exprès qui leur apprenoient à bien lire, & on les appelloit en latin praelectores.
Le tems de la lecture étoit principalement à souper dans les heures des vacations, au milieu même de la nuit, si l'on étoit réveillé & disposé à ne pas dormir davantage : c'étoit du moins la pratique de Caton, dont il ne faut pas s'étonner, car il étoit affamé de cette nourriture. Je l'ai rencontré, dit Cicéron, dans la bibliotheque de Lucullus, assis au milieu d'un tas de livres de Stoïciens, qu'il dévoroit des yeux : Erat in eo inexhausta aviditas legendi, nec satiare poterat, quippe nec reprehensionem vulgi inanem reformidans, in ipsâ curiâ soleret saepiùs legere, dùm senatus cogeretur, ità ut helu librorum videbatur.
Atticus ne mangeoit jamais chez lui en famille, ou avec des étrangers, que son lecteur n'eût quelque chose de beau, d'agréable & d'intéressant à lire à la compagnie ; desorte, dit Cornelius Népos, qu'on trouvoit toujours à sa table le plaisir de l'esprit réuni à celui de la bonne chere. Les historiens, les orateurs, & sur-tout les poëtes étoient les livres de choix pendant le repas, chez les Romains comme chez les Grecs.
Juvenal promet à l'ami qu'il invite à venir manger le soir chez lui, qu'il entendra lire les vers d'Homere & de Virgile durant le repas, comme on promet aujourd'hui aux convives une reprise de brelan après le souper. Si mon lecteur, dit-il n'est pas des plus habiles dans sa profession, les vers qu'il nous lira sont si beaux, qu'ils ne laisseront pas de nous faire plaisir.
Nostra dabunt alios hodie convivia ludos,
Conditor iliados cantabitur atque Maronis
Altisoni, dubiam facientia carmina palmam :
Quid refert tales versus quâ voce legantur ?
Satyr. II.
Je finis, parce que cette matiere de lecteurs, d'anagnostes & de lecture a été épuisée par nos savans ; ceux qui seront curieux de s'instruire à fond de tous les détails qui s'y rapportent peuvent lire Fabricii Biblioth. antiq. cap. xix. Graevii Thes. antiq. rom. Pignorius de Servis. Meursii Glossarium. Alexandri ab Alexandro Genial. dier. l. II. c. xxx. Puteanus de Stylo, t. XII. p. 258. Gelli l. XVIII. c. v. Bilbergii Dissert. acad. de anagnostis, Upsal. 1689, in -8°. & finalement Th. Raynaud de Anagnostis ad mensam religiosam, in operib. edit. Lugd. 1665, in-fol. (D.J.)
LECTEURS dans l'Eglise romaine, (Théol.) clercs revêtus d'un des quatre ordres mineurs. Voyez ORDRES MINEURS.
Les lecteurs étoient anciennement & en commençant les plus jeunes des enfans qui entroient dans le clergé. Ils servoient de secrétaires aux évêques & aux prêtres, & s'instruisoient en écrivant ou en lisant sous eux. On formoit ainsi ceux qui étoient plus propres à l'étude, & qui pouvoient devenir prêtres. Il y en avoit toutefois qui demeuroient lecteurs toute leur vie. La fonction des lecteurs a toujours été nécessaire dans l'Eglise, puisque l'on a toujours lu les écritures de l'ancien & du nouveau Testament, soit à la Messe, soit aux autres offices, principalement de la nuit. On lisoit aussi des lettres des autres évêques, des actes des martyrs, ensuite des homélies des peres, comme on le pratique encore. Les lecteurs étoient chargés de la garde des livres sacrés, ce qui les exposoit fort pendant les persécutions. La formule de leur ordination marque qu'ils doivent lire pour celui qui prêche, & chanter les leçons, benir le pain & les fruits nouveaux. L'évêque les exhorte à lire fidélement & à pratiquer ce qu'ils lisent, & les met au rang de ceux qui administrent la parole de Dieu. La fonction de chanter les leçons, qui étoit autrefois affectée aux lecteurs, se fait aujourd'hui indifféremment par toutes sortes de clercs, même par des prêtres. Fleury, Instit. au droit ecclés. tome I. part. I. chap. vj. p. 61. & suiv.
Il paroît, par le concile de Chalcédoine, qu'il y avoit dans quelques églises un archi-lecteur, comme il y a eu un archi-acolyte, un archi-diacre, un archiprêtre, &c. Le septieme concile général permet aux abbés, qui sont prêtres & qui ont été bénis par l'évêque d'imposer les mains à quelques-uns de leurs religieux pour les faire lecteurs.
Selon l'auteur du supplément de Morery, la charge de lecteur n'a été établie que dans le troisieme siecle. M. Cotelier dit que Tertullien est le premier qui fasse mention des lecteurs. M. Basnage croit qu'avant que cet emploi eût lieu, l'Eglise chrétienne suivoit dans la lecture des divines Ecritures la méthode de la Synagogue, où le jour du sabbat un sacrificateur, un lévite, & cinq d'entre le peuple, choisis par le président de l'assemblée, faisoient cette lecture ; mais Bingham, dans ses antiquités de l'Eglise, t. II. p. 28. & suiv. remarque qu'il ne paroît pas qu'il y ait eu aucune église, excepté celle d'Alexandrie, où l'on ait permis aux laics de lire l'Ecriture-sainte en public : cette permission étoit accordée même aux catéchumenes dans cette église. Son sentiment est que tantôt les diacres, tantôt les prêtres, & quelquefois les évêques s'acquittoient de cette fonction.
Dans l'église grecque, les lecteurs étoient ordonnés par l'imposition des mains ; mais, suivant Habert cette cérémonie n'avoit pas lieu dans l'Eglise romaine. Le quatrieme concile de Carthage ordonne que l'évêque mettra la Bible entre les mains du lecteur en présence du peuple, en lui disant : Recevez ce livre, & soyez lecteur de la parole de Dieu : si vous remplissez fidélement votre emploi, vous aurez part avec ceux qui administrent la parole de Dieu.
C'est à l'ambon & sur le pupitre que la lecture se faisoit ; de-là ces expressions de saint Cyprien, super pulpitum imponi, ad pulpitum venire. Des personnes de considération se faisoient honneur de remplir cette fonction. Témoin Julien, depuis empereur, & son frere Gallus, qui furent ordonnés lecteurs dans l'église de Nicomédie. Par la novelle 123 de Justinien, il fut défendu de choisir pour lecteurs des personnes au-dessous de dix-huit ans. Mais avant ce réglement, on avoit vu cet emploi rempli par des enfans de 7 à 8 ans : ce qui venoit de ce que les parens ayant consacré de bonne heure leurs enfans à l'église ; on vouloit par là les mettre en état de se rendre capable s des fonctions les plus difficiles du sacré ministere. Voyez le Diction. de Moreri.
|
| LECTICAIRES | lecticarii, s. m. terme d'histoire ecclésiastique, c'étoient dans l'église grecque, des clercs dont la fonction consistoit à porter les corps morts sur une espece de brancard nommé lectum ou lectica, & à les enterrer. On les appelloit aussi copiates & doyens. Voyez ces mots à leur place.
Chez les anciens Romains, il y avoit aussi des lecticaires, c'est-à-dire des porteurs de litieres, qui étoient à-peu-près ce que sont chez nous les porteurs de chaise. Voyez LITIERE.
LECTICAIRE, lecticarius, (Littérat.) par Suétone, porteur de litiere ; les Romains avoient deux sortes de lecticaires, les uns qui étoient de leur train, de leur maison, qu'ils avoient à leurs gages, comme nos grands seigneurs ont à Versailles des porteurs de chaise à eux ; les autres lecticaires étoient au public, on les louoit quand on vouloit se faire porter en litiere, comme on loue à Paris des porteurs de chaise qu'on prend sur la place, & qu'on paye pour se faire porter où l'on veut. Ces lecticaires publics étoient à Rome dans la douzieme région au-delà du Tibre ; le nom de lecticaire fut ensuite appliqué dans l'église grecque à ceux qui portoient les morts en terre pour les enterrer, parce qu'on portoit quelquefois le corps mort au bucher dans des litieres chez les Romains. (D.J.)
|
| LECTIONNAIRE | S. m. (Gramm. & Lithurg.) livre d'Eglise qui contient les leçons qui se lisent à l'office. Le plus ancien lectionnaire a été composé par saint Jérôme.
|
| LECTISTERNE | S. m. lectisternium (Antiq. romaines) cérémonie religieuse pratiquée chez les anciens Romains dans des tems de calamités publiques, afin d'en obtenir la cessation.
L'an de Rome 354, un mal contagieux qui faisoit mourir tous les bestiaux, jetta la consternation dans la ville. Les duumvirs, après avoir consulté les livres sacrés des sibylles, ordonnerent le lectisterne.
Cette cérémonie ancienne avoit déjà été mise en usage au rapport de Valere-Maxime, liv. II. chap. iv. sous le consulat de Brutus & de Valerius Publicola.
Pendant cette cérémonie on descendoit les statues des dieux de leurs niches ; on les couchoit sur des lits autour des tables dressées dans leurs temples ; on leur servoit alors pendant huit jours, aux dépens de la république, des repas magnifiques, comme s'ils eussent été en état d'en profiter. Les citoyens, chacun selon leurs facultés, tenoient table ouverte. Ils y invitoient indifféremment amis & ennemis, les étrangers sur-tout y étoient admis. On mettoit en liberté les prisonniers, & on se seroit fait un scrupule de les faire arrêter de nouveau, après que la fête étoit finie.
Le soin & l'ordonnance de cette fête furent confiés aux duumvirs sibillins jusqu'à l'an 558 de Rome, qu'on créa les épulons, à qui l'on attribua l'intendance de tous les festins sacrés.
Tite-Live, en nous apprenant ce détail, ne dit point si le célebre lectisterne de l'an de Rome 354 produisit l'effet qu'on en espéroit ; mais le troisieme lectisterne qu'on dressa environ trente-six ans après l'an 390, pour obtenir des dieux la fin d'une peste cruelle, eut si peu d'efficace, que l'on recourut à un autre genre bien singulier de dévotion ; ce fut à l'institution des jeux scéniques ; on se flatta que ces jeux n'ayant point encore paru à Rome, ils en seroient plus agréables aux dieux.
Casaubon a le premier remarqué sur un passage du scholiaste de Pindare, Olymp. ode I. que les lectisternes étoient en usage chez les Grecs, avant que d'être connus des Romains. Mais les Grecs mêmes avoient pris cette coûtume des Medes & autres peuples orientaux, qui couchoient leurs dieux sur des oreillers, pulvinaria, & leur servoient de magnifiques repas.
M. Spon a vu à Athenes un bas-relief de marbre, qu'il croit être la figure d'un lectisterne. Ce bas-relief représente un lit élevé d'un pié, & long de deux, sur lequel est le dieu Sérapis, tenant une corne d'abondance. Il a des fruits devant lui, & son boisseau sur la tête ; plus bas est Isis, & autour d'elle quatre ou cinq figures d'hommes.
Lectisterne est un mot purement latin, qui signifie l'action de dresser, de préparer des lits, à lectis sternendis ; ces lits étoient ainsi préparés dans les fêtes ou pour inviter les dieux à s'y rendre pendant la nuit, ou pour y placer leurs statues & leurs images. Quant à la desserte des mets qu'on leur offroit pendant la durée du lectisterne, comme ils n'y touchoient pas, les prêtres de leurs temples en faisoient leur profit. (D.J.)
|
| LECTOURE | ou LEICTOURE, ou LEITOUR, ou LAICTOURE, en latin Lactora, gen. Lactorum, Lectora, Lectura, Lectorium & Lecturum, (Géogr.) ancienne & forte ville de France en Gascogne, capitale de l'Armagnac, avec un vieux château, & un évêché suffragant d'Ausch. Elle est sur une montagne, au pié de laquelle passe la riviere de Gers, à 5 lieues E. de Condom, 8 S. O. d'Agen, 8 N. E. d'Auch, 145 S. O. de Paris.
Cette ville étoit le chef-lieu du peuple Lactorates, dont le nom est marqué dans une inscription romaine ; mais il ne se trouve indiqué nulle part avant l'itinéraire d'Antonin, où l'on voit la ville Lectoure sur le chemin qui, passant par Ausch, alloit à Comminges. Depuis le cinquieme siecle, le nom Lactora & celui des évêques de cette ville, se lisent dans les signatures des conciles. Philippe le Bel acquit Lectoure en 1300 d'Elie Talleiran, comte de Périgord. On lit dans Gruter des copies d'inscriptions antiques trouvées à Leictoure dans l'une desquelles il y a R. P. LACTORAT, & dans une autre CIVIT. LACTORAT. Ces titres de cité & de république marquent une ville libre.
On a aussi découvert un très-grand nombre d'inscriptions tauroboliques à Lectoure ; presque toutes ont été faites sous Gordien III. qu'on nomme autrement Gordien Pie, pour le retour de la santé de cet empereur, quoique cette ville y prit le plus petit intérêt du monde. Voyez sur Laictoure moderne, Had. de Valois, not. Gall. p. 259. & M. de Marca dans son hist. de Béarn, liv. I. ch. 10. Long. 18. 16. 53. latit. 43. 56. 2.
|
| LECTURE | S. f. (Arts) c'est l'action de lire, opération que l'on apprend par le secours de l'art.
Cette opération une fois apprise, on la fait des yeux, ou à haute voix. La premiere requiert seulement la connoissance des lettres, de leur son, & de leur assemblage ; elle devient promte par l'exercice, & suffit à l'homme de cabinet. L'autre maniere demande, pour flater l'oreille des auditeurs, beaucoup plus que de savoir lire pour soi-même ; elle exige, pour plaire à ceux qui nous écoutent, une parfaite intelligence des choses qu'on leur lit, un son harmonieux, une prononciation distincte, une heureuse fléxibilité dan les organes de la voix, tant pour le changement des tons que pour les pauses nécessaires.
Mais, quel que soit le talent du lecteur, il ne produit jamais un sentiment de plaisir aussi vif que celui qui naît de la déclamation. Lorsqu'un acteur parle, il vous anime, il vous remplit de ses pensées, il vous transmet ses passions ; il vous présente, non une image, mais une figure, mais l'objet même. Dans l'action tout est vivant, tout se meut ; le son de la voix, la beauté du geste, en un mot tout conspire à donner de la grace ou de la force au discours. La lecture est toute dénuée de ce qui frappe les sens ; elle n'emprunte rien d'eux qui puisse ébranler l'esprit, elle manque d'ame & de vie.
D'un autre côté, on juge plus sainement par la lecture ; ce qu'on écoute passe rapidement, ce qu'on lit se digere à loisir. On peut à son aise revenir sur les mêmes endroits, & discuter, pour ainsi dire, chaque phrase.
Nous savons si bien que la déclamation, la récitation, en impose à notre jugement, que nous remettons à prononcer sur le mérite d'un ouvrage jusqu'à la lecture que nous ferons, comme on dit, l'oeil sur le papier. L'expérience que nous avons de nos propres sens, nous enseigne donc que l'oeil est un censeur plus severe & un scrutateur bien plus exact que l'oreille. Or l'ouvrage qu'on entend réciter, qu'on entend lire agréablement, séduit plus que l'ouvrage qu'on lit soi-même & de sens froid dans son cabinet. C'est aussi de cette derniere maniere que la lecture est la plus utile ; car pour en recueillir le fruit tout entier, il faut du silence, du repos & de la méditation.
Je n'étalerai point les avantages qui naissent en foule de la lecture. Il suffit de dire qu'elle est indispensable pour orner l'esprit & former le jugement ; sans elle, le plus beau naturel se desséche & se fane.
Cependant la lecture est une peine pour la plûpart des hommes ; les militaires qui l'ont négligée dans leur jeunesse sont incapables de s'y plaire dans un âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes & de dés qui occupent leur ame, sans qu'il soit besoin qu'elle contribue à son plaisir par une attention suivie. Les financiers, toujours agités par l'amour de l'intérêt, sont insensibles à la culture de leur esprit. Les ministres, les gens chargés d'affaires, n'ont pas le tems de lire ; ou s'ils lisent quelquefois, ce n'est, pour me servir d'une image de Platon, que comme des esclaves fugitifs qui craignent leurs maitres. (D.J.)
LECTURES ou DISCOURS DE BOYLE, (Théol.) c'est une suite de discours fondés par Robert Boyle en 1691, dans le dessein, comme lui-même l'annonce, de prouver la vérité de la religion chrétienne contre les Infideles, sans entrer dans aucune des controverses ou disputes qui divisent les Chrétiens. Le but de cet ouvrage est aussi de résoudre les difficultés, & de lever les scrupules qu'on peut opposer à la profession du Christianisme.
|
| LEDA | (Mytholog.) femme de Tyndare, roi de Sparte ; ses trois enfans Castor, Pollux & Hélene furent nommés Tyndarides par les Poëtes. Son histoire fabuleuse, connue de tout le monde, n'a point encore eu d'explications raisonnables ; mais la ruse que Jupiter employa, selon la Fable, pour séduire cette reine, nous a procuré des chef-d'oeuvres en peinture. Il faut couvrir d'or le tableau de la Léda du Corrège pour se le procurer ; il se vendit vingt mille livres il y a dix ans dans la succession de M. Coypel, premier peintre du Roi, quoique la tête de la Léda fût endommagée. M. Coypel n'avoit jamais osé toucher à cette belle tête, & mêler son pinceau à celui du Corrège. (D.J.)
|
| LEDE | LE, le léde ou le ledum, (Botan.) est une espece de ciste qui porte le ladanum.
Tournefort l'appelle cistus ladanifera, cretica, flore purpureo, coroll. I. R. H. 19. Belon le nomme cistus è quâ ladanum in Cretâ colligitur, observ. lib. I. c. vij. Prosper Alpin le désigne en deux mots, ladanum creticum, plant. exot. 88. cistus laurinis foliis par Weeler, itin. 219. cistus laudanifera, cretica, vera, par Park. theat. 666. The Gumbearing rock-rose en anglois. Voici sa description très-exacte.
C'est un arbrisseau branchu, touffu, couché sur la terre, haut d'un ou de deux piés. Sa racine est ligneuse, blanchâtre en-dedans, noirâtre en-dehors, longue d'environ un pié, fibrée & chevelue. L'écorce est rougeâtre intérieurement, brune extérieurement & gercée. Elle pousse beaucoup de branches grosses comme le doigt, dures, brunes, grisâtres, & couvertes d'une écorce gercée. Ces branches se subdivisent en d'autres rameaux d'un rouge foncé, dont les petits jets sont velus & d'un verd-pâle. Les feuilles y naissent opposées deux à deux, oblongues, vert-brunes, ondées sur les bords, épaisses, veinées & chagrinées. Elles sont longues d'un pouce, larges de huit ou neuf lignes, terminées en pointes mousses, portées par une queue longue de trois ou quatre lignes sur une ligne de largeur.
Les fleurs qui naissent à l'extrémité des rameaux, ont un pouce & demi de diametre ; elles sont composées de cinq pétales de couleur pourpre, chifonnés, arrondis, quoique étroits à leur naissance, marqués d'un onglet jaune, & bien souvent déchirés sur les bords.
Du centre de ces fleurs sort une touffe d'étamines jaunes, chargées d'un petit sommet, feuillemorte. Elles environnent un pistil long de deux lignes, & terminé par un filet arrondi à son extrémité.
Le calice est à cinq feuilles longues de sept ou huit lignes, ovalaires, veinées, velues sur les bords, pointues, & le plus souvent recourbées en bas.
Quand la fleur est passée, le pistil devient un fruit ou une coque, longue d'environ cinq lignes, presque ovale, dure, obtuse, brune, couverte d'un duvet soyeux & enveloppée des feuilles du calice.
Cette coque est partagée dans sa longueur en cinq loges, qui sont remplies de graines menues, anguleuses, rousses, ayant près d'une ligne de diametre. Toute la plante est un peu styptique, & d'un goût d'herbes. Elle vient en abondance dans les montagnes qui sont auprès de la Canée, autrefois Cydon, capitale de l'île de Crète. Dioscoride l'a fort bien connue, & l'a marquée sous le nom de Ledon.
M. de Tournefort a observé dans le Pont un autre ciste ladanifere ; ou plûtôt une variété de celui-ci, avec cette seule différence que sa fleur est plus grande, flore purpureo majore.
La résine qui découle en été des feuilles de ces arbrisseaux se nomme labdanum ou ladanum. Voyez LADANUM.
Le ciste d'Espagne à feuilles de saule, & à fleurs blanches, marquetées au milieu d'une tache pourpre, cistus ladanifera, hispanica, salicis folio, flore albo, maculâ punicante insignito, est encore un ciste ladanifere, qui ne le cede en rien à ceux de Candie. Ses fleurs, aussi grandes que la rose, sont d'une extrème beauté ; la substance douce, résineuse, que nous appellons ladanum, exude dans les chaleurs de l'été à-travers les pores des feuilles de ce ciste en telle abondance que toute leur surface en est couverte. (D.J.)
|
| LEDESMA | (Géogr.) forte ville d'Espagne au royaume de Léon, sur la riviere de Tormes, avec une jurisdiction considérable, à 8 lieues S. O. de Salamanque. Elle est ancienne, & paroît avoir été connue des Romains sous le nom de Bletisa. Sa longit. 12. 10. latit. 47. 2. (D.J.)
|
| LEDUS | (Géog. anc.) riviere de la Gaule narbonnoise ; c'est aujourd'hui le Lez qui coule à Montpellier, dans le Languedoc.
|
| LEEDS | (Géog.) ville d'Angleterre en Yorckshire, avec titre de duché, autrefois la résidence des rois de Northumberland, durant l'heptarchie. Elle est sur la riviere d'Are, à 20 milles S. O. d'Yorck, 139 N. O. de Londres. Long. 15. 58. latit. 53. 43. (D.J.)
|
| LEERDAM | Géog.) Lauri, petite ville des Pays-bas dans la Hollande, sur la Linge, à 2 lieues de Gorkum, & environ autant de Viane. Long. 22. 23. lat. 51. 56.
Cette ville est bien moins connue comme un fief de la maison d'Arkel, que pour avoir été la patrie de Corneille Jansen, si fameux sous le nom de Jansénius, mort évêque d'Ypres en 1639, âgé de 54 ans. Son livre, où il se propose d'expliquer les sentimens inintelligibles de S. Augustin sur les matieres abstruses de la grace, a donné lieu à un malheureux schisme, dont l'Eglise romaine, & sur-tout celle de France, a souffert de grandes plaies, qui saignent encore, & qui devroient bien se cicatriser.
|
| LEEUWIN | LA TERRE DE (Géog.) c'est-à-dire terre de la Lionne ; pays de la Nouvelle Hollande, dans les terres australes, entre la terre d'Endracht ou de la Concorde, & de la terre de Nuitz, entre le 125 & le 136d de longitude, & entre le 30 & le 35d de latit. sud. La côte n'en est pas encore découverte au nord.
|
| LÉGAL | adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui dérive de la loi, comme un augment ou douaire légal. Voyez AUGMENT & DOUAIRE. Il y a des peines légales, c'est-à-dire qui sont fixées par les lois, & d'autres qui sont arbitraires. (A)
|
| LÉGALISATION | S. f. (Jurisprud.) littera testimonialis, est un certificat donné par un officier public, & par lui muni du sceau dont il a coûtume d'user, par lequel il atteste que l'acte au bas duquel il donne ce certificat est authentique dans le lieu où il a été passé, & qu'on doit y ajoûter même foi. L'effet de la légalisation est, comme l'on voit, d'étendre l'authenticité d'un acte d'un lieu dans un autre, où elle ne seroit pas connue sans cette formalité.
L'idée que présente naturellement le terme de légalisation, est qu'il doit tirer son étymologie de loi & de légal, & que légaliser, c'est rendre un acte conforme à la loi ; ce n'est cependant pas là ce que l'on entend communément par légalisation ; ce terme peut venir plûtôt de ce que cette attestation est communément donnée par des officiers de justice, que dans quelques provinces on appelle gens de loi, desorte que légalisation seroit l'attestation des gens de loi.
Nous trouvons dans quelques dictionnaires & dans quelques livres de pratique, que la légalisation est un certificat donné par autorité de justice, ou par une personne publique, & confirmé par l'attestation, la signature & le sceau du magistrat, afin qu'on y ajoute foi par-tout, testimonium autoritate publicâ firmatum ; que légaliser, c'est rendre un acte authentique, afin que par tout pays on y ajoûte foi, autoritate publicâ firmare.
Ces définitions pourroient peut-être convenir à certaines légalisations particulieres, mais elles ne donnent pas une notion exacte des légalisations en général, & sont défectueuses en plusieurs points.
1°. On ne devroit pas omettre d'y observer que les légalisations ne s'appliquent qu'à des actes émanés d'officiers publics ; actes qui par conséquent sont originairement authentiques, & dont la légalisation ne fait, comme on l'a dit, qu'étendre l'authenticité dans un autre lieu où elle ne seroit pas connue autrement.
2°. La légalisation n'est pas toujours donnée par un officier de justice, ni munie de l'attestation & de la signature du magistrat ; car il y a d'autres officiers publics qui en donnent aussi en certains cas, quoiqu'ils ne soient ni magistrats ni officiers de justice, tels que les ambassadeurs, envoyés, résidens, agens, consuls, vice-consuls, chanceliers & vice-chanceliers, & autres ministres du prince dans les cours étrangeres.
Les officiers publics de finance, tels que les trésoriers, receveurs & fermiers généraux, légalisent pareillement certains actes qui sont de leur compétence ; savoir les actes émanés de leurs directeurs, préposés & commis.
Il y a aussi quelques officiers militaires qui légalisent certains actes, comme les officiers généraux des armées de terre & navales, les gouverneurs & lieutenans généraux des provinces, villes & places, les lieutenans de roi, majors, & autres premiers officiers qui commandent dans les citadelles, lesquels légalisent, tant les actes émanés des officiers militaires qui leur sont inférieurs, que ceux des autres officiers qui leur sont subordonnés, & qui exercent un ministere public, tels que les aumôniers d'armées, des places, des hôpitaux, les écrivains des vaisseaux, &c.
3°. Il n'est pas de l'essence de la légalisation qu'elle soit munie du sceau du magistrat ; on y appose au contraire ordinairement le sceau du prince, ou celui de la ville où se fait la légalisation.
Enfin la légalisation ne rend point un acte tellement authentique, que l'on y ajoûte foi par tout pays ; car si l'acte qu'on légalise n'étoit pas déja par lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu, la légalisation ne le rendroit authentique dans aucun endroit, son effet n'étant que d'étendre l'authenticité de l'acte d'un lieu dans un autre, & non pas de la lui donner : d'ailleurs la légalisation n'est pas toujours faite pour que l'on ajoute foi par tout pays à l'acte légalisé ; elle n'a souvent pour objet que d'étendre l'authenticité de l'acte d'une jurisdiction dans une autre ; & il n'y a même point de légalisation qui puisse rendre un acte authentique par tout pays ; parce que dans chaque état où on veut le faire valoir comme tel, il faut qu'à la relation des officiers du pays dont il est émané, il soit attesté authentique par les officiers du pays où l'on veut s'en servir ; ensorte qu'il faut autant de légalisations particulieres que de pays où l'on veut faire valoir l'acte comme authentique.
Les lois romaines ne parlent en aucun endroit des légalisations ni d'aucune autre formalité qui y ait rapport ; ce qui fait présumer qu'elles n'étoient point alors en usage, & que les actes reçus par des officiers publics, étoient reçus par-tout pour authentiques jusqu'à ce qu'ils fussent argués de faux. Cependant chez les Romains, l'authenticité des actes reçus par leurs officiers publics ne pouvoit pas être partout pays aussi notoire qu'elle le seroit parmi nous, parce que les officiers publics ni les parties contractantes, ni les témoins ne mettoient aucune signature manuelle au bas de l'acte ; ils y apposoient seulement l'empreinte de leur cachet ; chacun avoit alors son sceau ou cachet particulier appellé signum, sigillum, ou annulus signatorius. Mais l'apposition de ces sceaux particuliers étoit peu utile pour prouver l'authenticité de l'acte ; car outre que c'étoient des sceaux particuliers qui pouvoient être peu connus même dans le lieu où se passoit l'acte, on pouvoit sceller un acte avec le cachet d'autrui, & tous les témoins pouvoient sceller avec le même cachet, suivant ce que dit Justinien aux Institutes, lib. II. tit. x. §. 5. ensorte que les différens cachets apposés sur un acte, ne dénotoient point d'une maniere certaine quelles étoient les personnes qui avoient eu part à cet acte, & sur-tout n'y ayant alors aucun sceau public chez les Romains, ainsi que l'observe M. Charles Loyseau en son traité des offices, ch. jv. n. 10.
Les légalisations auroient donc été alors plus nécessaires que jamais pour constater l'authenticité des actes, puisqu'il n'y avoit aucune formalité qui en fit connoître l'auteur d'une maniere certaine ; mais encore une fois, on ne trouve rien dans le droit romain d'où l'on puisse induire que l'on pratiquât alors aucune espece de légalisation.
Il n'est point parlé non plus des légalisations dans le droit canon, quoique la plûpart des lois dont il est composé, aient été faites dans un tems où les légalisations étoient déjà en usage. En effet, le decret de Gratien parut en 1151 ; les décretales de Grégoire IX. l'an 1230 ; le sexte en 1298 ; les clémentines en 1317, & les extravagantes de Jean XXII. en 1334 : or je trouve que les légalisations étoient dès-lors en usage.
Comme il n'y a aucune loi qui ait établi la formalité des légalisations, on ne sait pas précisément en quel tems on a commencé à légaliser. Mais il y a au trésor des chartes, registre 80 pour les an. 1350, 1351, une copie des statuts des tailleurs de Montpellier, délivrée par deux notaires royaux de la même ville, au-bas de laquelle sont deux légalisations datées de l'année 1323 ; la premiere donnée par le juge royal de Montpellier ; la seconde par l'official de Maguelonne.
Il paroit même que l'usage des légalisations étoit déja fréquent, car on en trouve plusieurs de toute espece données dans les années 1330 & suivantes, qui sont aussi au trésor des chartes ; ce qui fait présumer que celles données en 1323 n'étoient pas les premieres, & que l'usage en étoit déja ancien.
Quelques docteurs ultramontains ont parlé des légalisations à l'occasion de ce qui est dit dans les lois romaines, des tabellions & de la foi dûe aux actes publics ; tels sont Ange Balde sur la novelle 44 de tabellionibus ; Paul de Castro en son conseil 394 ; Felin sur le chap. coram. versic. dubium, de officio delegati. Matthoeus de afflictis in decision. napolit. 251 ; & Alberic sur le titre du code de fide instrum. Ces auteurs proposent l'espece d'un testament reçu dans un pays éloigné par un notaire dont on revoque en doute la qualité dans le lieu où le testament est présenté ; ils demandent si la légalisation, qu'ils nomment litteram testimonialem donnée par l'official ou par le juge qui atteste que celui qui a reçu l'acte est réellement notaire, est suffisante pour prouver sa qualité, & ils décident pour l'affirmative.
Alberic de Rosate, jurisconsulte de Bergame dans le Milanois, qui vivoit au commencement du xje. siecle, dit au même endroit qu'il a toujours vû pratiquer en justice qu'on n'ajoûtoit pas foi par provision à un acte passé dans un endroit éloigné ; mais que l'on s'adresse au juge du lieu où le tabellion qui a reçu l'acte exerce ses fonctions, pour qu'il atteste si celui qui a reçu l'acte est réellement tabellion, ou bien que l'on prouve sa qualité de tabellion en représentant d'autres actes émanés de lui.
Pour prévenir l'embarras d'une légalisation, Balde, au même endroit, conseille à ceux qui passent des actes qu'ils doivent envoyer dans des endroits éloignés, de les faire écrire par un notaire, & de les faire signer par trois notaires, gens de probité, afin qu'en quelqu'endroit que l'on présente ces actes, on ne puisse point révoquer en doute qu'ils ont été reçus par un notaire.
Felin sur le chap. post cessionem de probationibus, & Caepola Vérone cautelâ 54, proposent le même expédient, lequel, suivant Felin, est conforme à la 152e des nouvelles décisions de la Rote ; mais Caepola indique aussi la voie de prendre une attestation du juge du lieu où l'acte a été passé, que celui qui l'a reçu étoit réellement notaire ; & M. Boyer, dans sa décision 154, dit que cette voie est la plus sûre.
Voilà tout ce que ces docteurs ont dit des légalisations dont ils n'ont parlé qu'en passant, & fort légerement : nos auteurs françois n'en ont parlé en aucune maniere.
Il ne faut pas confondre les légalisations avec les lettres de vidimus qui étoient anciennement usitées en France ; ces sortes de lettres n'étoient autre chose que des expéditions authentiques tirées sur l'original d'un acte, ou des copies collationnées sur une expédition : on les appelloit lettres de vidimus, parce qu'elles commençoient ordinairement par ces termes, vidimus quasdam litteras integras & non cancellatas, quarum tenor sequitur, ensuite on transcrivoit l'acte : tel étoit alors le style des expéditions & copies collationnées, & c'est de-là qu'en quelques provinces on dit encore copie vidimée pour copie collationnée ; on sent assez la différence qu'il y a entre ces lettres de vidimus, & les légalisations, puisque ces sortes de lettres n'étoient autre chose qu'une collation des expéditions ou copies avec l'original, laquelle collation se pouvoit faire par le même officier qui avoit reçu l'acte, & qui l'expédioit, ce qui par conséquent n'ajoutoit rien à l'authenticité de l'acte original ni de la copie ; au lieu que les légalisations ont pour objet de faire mieux connoître l'authenticité de l'expédition ou copie qui en a été tirée, en la munissant du témoignage & du sceau de quelque officier, qui par son caractere soit plus connu que celui qui a reçu ou expédié l'acte.
Lorsqu'il s'agit de constater la vérité des faits contenus dans les actes, on distingue ces actes qui sont d'écriture privée, de ceux qui sont émanés de quelque officier public.
Pour ce qui est des actes d'écriture privée, comme l'auteur n'en est pas certain, on n'y a point d'égard, jusqu'à ce que l'écriture en soit reconnue ou tenue pour telle avec celui contre lequel on veut s'en servir.
Quoique ces sortes d'actes ne forment qu'une preuve peu certaine des faits qui y sont mentionnés, néanmoins on ne les légalise point, par ce que l'effet de la légalisation n'étant pas de donner l'authenticité à un acte, mais seulement de faire connoître qu'il est authentique, & pour ainsi dire d'étendre son authenticité d'un lieu dans un autre ; elle seroit inutile aux écritures privées, lesquelles dans leur principe ne sont point authentiques.
A l'égard des actes émanés des officiers publics, on les a appellés authentiques, du mot grec , qui veut dire, dont l'auteur est connu ; parce qu'en effet la signature de l'officier public est plus connue que celle des particuliers, & que son témoignage constate quelle est la personne qui a passé l'acte : c'est pour cela que l'on ajoûte foi par provision à ces sortes d'actes, jusqu'à ce qu'ils soient inscrits de faux, & c'est en quoi consiste l'effet de l'authenticité.
Mais les actes émanés des officiers publics, tels que les notaires, greffiers, procureurs huissiers ne sont par eux-mêmes authentiques que dans le lieu où les officiers ont leur résidence, parce que l'authenticité des actes n'est fondée que sur ce que l'auteur en est connu, & que le caractere public de ces sortes d'officiers n'est censé connu que dans le lieu où ils ont leur résidence.
C'est pour remédier à cet inconvénient, que l'on a introduit les légalisations, & afin d'étendre l'authenticité d'un acte d'un lieu dans un autre ; car les légalisations sont une preuve de l'authenticité des actes & tiennent lieu d'une enquête sommaire que l'on feroit pour constater la qualité & la signature de l'officier public qui a reçu l'acte dans les lieux où son authenticité ne seroit pas connue sans cette formalité.
Par exemple un acte reçu par un notaire au châtelet de Paris, n'est par lui-même authentique que dans le ressort du châtelet, parce que la signature de ce notaire n'est pas censée connue hors des lieux où il exerce ses fonctions ; mais si le juge royal auquel ce notaire est soumis, légalise l'acte, en attestant que celui qui l'a reçu est réellement notaire au châtelet de Paris, que la signature apposée à l'acte est la sienne, & que l'on ajoute foi aux actes émanés de lui, alors la qualité de l'acte étant constatée par le certificat du juge royal, l'acte sera authentique par tout le royaume, & même dans les pays étrangers, parce que le sceau des juges royaux est censé connu par tout pays.
La légalisation ne donne à l'acte aucun droit d'hypotheque ni d'exécution parée, s'il ne l'a par lui-même ; elle ne sert, comme on l'a dit, qu'à faire connoître son authenticité.
L'acte de légalisation est lui-même authentique en ce qu'il contient, dans le pays où le caractere de l'officier qui l'a donné, est connu ; & cet acte fait foi par provision, jusqu'à ce qu'il soit inscrit de faux.
Ce n'est pas seulement en France que les légalisations sont en usage ; elles le sont pareillement chez toutes les nations policées ; mais elles s'y pratiquent diversement.
Dans toute l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, & l'Espagne, un acte reçu par un notaire devient authentique à l'égard de tous les pays de leur domination, par le certificat & la signature de trois autres notaires qui attestent la signature & la qualité du premier : j'ai vû quelques légalisations de cette espece, à la suite desquelles étoit une seconde légalisation donnée par les officiers municipaux des villes, & munies de leur sceau, lesquels attestoient la signature & la qualité des trois notaires qui avoient donné la premiere légalisation ; mais cette seconde légalisation n'avoit été ajoutée que pour faire valoir l'acte en France, où l'on n'étoit pas obligé de connoître la signature ni la qualité des trois notaires qui avoient donné la premiere légalisation.
J'ai vu pareillement plusieurs actes passés en Pologne, & que l'on faisoit valoir en France comme authentiques, lesquels n'étoient munis que d'une seule légalisation, quelques-uns légalisés par les officiers municipaux des villes, d'autres par les officiers de la chancellerie du prince : je n'en ai vu aucun qui fût légalisé par des notaires, & je ne crois pas que cela y soit en usage.
En France on pratique diverses légalisations, & il y a plusieurs sortes d'officiers publics qui ont le pouvoir de légaliser, selon la qualité des actes ; mais les notaires n'en légalisent aucun.
Il seroit trop long d'entrer dans le détail de tous les actes qui peuvent être légalisés ; & des cas dans lesquels la légalisation est nécessaire ; il suffit d'observer en général qu'à la rigueur tous actes émanés d'un officier public, tel qu'un notaire, commissaire, huissiers, &c. quand on les produit hors du lieu où l'officier qui les a reçus fait ses fonctions, ne sont point authentiques s'ils ne sont légalisés.
On exige sur-tout que les procurations soient légalisées, lorsque l'on s'en sert hors du lieu de l'exercice des notaires qui les ont reçûes : cette formalité est expressément ordonnée par tous les édits & déclarations rendus au sujet des rentes viageres, qui portent que les procurations passées en province par les rentiers, seront légalisées par le juge royal du lieu de leur résidence ; & ce sont-là les seules lois qui parlent des légalisations : encore n'est-ce qu'en passant, & en les supposant déja usitées.
Les officiers qui ont caractere pour légaliser, ne doivent faire aucune légalisation, qu'ils ne connoissent la qualité de l'officier qui a reçu l'acte, sa signature, & le sceau qu'il avoit coutume d'apposer aux actes qui se passoient par-devant lui : s'ils n'en ont pas une connoissance personnelle, ils peuvent légaliser l'acte suivant ce qu'ils tiennent par tradition, ou à la relation d'autrui, pourvû qu'ils s'informent des faits qu'il s'agit d'attester, à des témoins dignes de foi.
De-là suit naturellement, que l'on peut légaliser non-seulement les actes expédiés par les officiers qui sont encore vivans, mais aussi ceux qui ont été expédiés anciennement par des officiers qui sont morts au tems de la légalisation, pourvû que la qualité, la signature, & le sceau de ces officiers soient connus par tradition ou autrement.
Pour connoître plus particulierement par quels officiers chaque espece d'actes doit être légalisée, il faut d'abord distinguer les actes émanés des officiers publics ecclésiastiques, d'avec ceux émanés des officiers publics séculiers.
Les actes émanés d'officiers publics ecclésiastiques, tels que les curés, vicaires desservans, les vice-gérens, promoteurs, greffiers, notaires, & procureurs apostoliques, appariteurs, & autres officiers de cette qualité, peuvent être légalisés par les supérieurs ecclésiastiques de ces officiers, soit l'évêque ou archevêque, ou l'un de ses grands vicaires ; ou son official ; & une telle légalisation est valable non-seulement à l'égard des autres supérieurs ou officiers ecclésiastiques, mais aussi à l'égard de tous officiers séculiers royaux ou autres, parce que l'évêque & ses préposés sont compétens pour attester à toutes sortes de personnes l'authenticité des actes émanés des officiers ecclésiastiques, que personne ne peut mieux connoître que l'évêque, son official, ou ses grands vicaires.
Il faut seulement observer que si c'est l'official qui a fait la légalisation, & que l'on veuille la faire sceller pour plus grande authenticité, comme cela se pratique ordinairement, il faut la faire sceller ou par l'évêque ou par celui qui est préposé par lui pour apposer son sceau, car ordinairement les officiaux n'ont point de sceau même pour sceller leurs jugemens.
On peut aussi faire légaliser des actes émanés des officiers ecclésiastiques, par le juge royal du lieu de leur résidence, & sur-tout lorsqu'on veut produire ces actes en cour laie, ou devant des officiers séculiers, royaux ou autres, parce que le juge royal est présumé connoître tous les officiers qui exercent un ministere public dans son ressort ; & une telle légalisation est valable même à l'égard des officiers ecclésiastiques auprès desquels on veut faire valoir l'acte, parce qu'ils ne peuvent méconnoître la légalisation du juge royal, dont le sceau est connu par-tout.
A l'égard des actes émanés d'officiers publics seculiers, anciennement lorsqu'on vouloit les faire légaliser, on s'adressoit à l'évêque, son official ou ses grands vicaires, plûtôt qu'au juge royal ; ou si l'on faisoit d'abord légaliser l'acte par le juge royal du lieu, on y ajoutoit, pour plus grande authenticité, la légalisation de l'évêque, ou de son official ou grand-vicaire.
C'est ainsi, par exemple, que sont légalisés les statuts des tailleurs de Montpellier, dont j'ai déjà parlé ; ces statuts sont d'abord légalisés par le juge royal de Montpellier, & ensuite est une seconde légalisation donnée par l'official de Maguelone (à présent Mauguio), ville où étoit autrefois le siége des évêques du bas Languedoc, qui est présentement à Montpellier, cette légalisation est conçue en ces termes : Et ad majorem omnem firmitatem ; videlicet perdictus magister Simon de Tornaforti, sit notarius publicus regius pro ut se subscripsit, & instrumentis per eum confectis plena fides adhibeatur in judicio & extra, & ad ipsum recurratur, pro conficiendis publicis instrumentis tanquam ad personam publicam : nos Hugo Augerii, juris utriusque professor, officialis Magalonensis, sigillum authenticum nostrae officialitatis huic instrumento publico duximus apponendum, anno domini 1323, quarto nonas Augusti.
Ce qui avoit introduit l'usage de faire ainsi légaliser, par les officiaux ou autres officiers ecclésiastiques, toutes sortes d'actes, même ceux reçus par des officiers royaux, c'est que les ecclésiastiques, profitant de l'ignorance de ces tems-là, s'étoient attribué la connoissance de presque toutes sortes d'affaires civiles, sous prétexte que la religion ou l'église y étoit intéressée, soit par la qualité des personnes ou des choses dont elles disposoient, soit par la solemnité du serment que l'on inséroit dans tous les actes ; ensorte que la signature & le sceau des évêques, leurs grands-vicaires ou official étoient réellement plus connus & plus authentiques que ceux des officiers royaux, parce que le pouvoir des premiers étoit plus étendu.
Mais depuis que les choses ont été rétablies en France dans leur ordre naturel par l'article 2 de l'ordonnance de 1539, les évêques, leurs grands-vicaires ou official ne légalisent plus que les actes reçus par des officiers ecclésiastiques, encore ces mêmes actes peuvent-ils aussi être légalisés par le juge royal, & l'on a le choix de s'adresser à l'un ou à l'autre, & même leurs légalisations ne servent point en cour laie si elles ne sont attestées par les juges laïcs ordinaires.
Pour ce qui est des actes émanés d'officiers publics séculiers, il faut distinguer ceux qui sont reçus par des officiers des seigneurs, de ceux qui sont reçus par des officiers royaux.
Les actes reçus par des officiers de justices seigneuriales, tels que les greffiers, notaires, procureurs, huissiers & autres officiers fiscaux, peuvent être légalisés par le juge seigneurial de la justice en laquelle ces officiers sont immatriculés, & cette légalisation est suffisante pour étendre l'authenticité de l'acte dans le ressort de la justice supérieure, soit royale ou seigneuriale, du moins à l'égard du juge supérieur qui doit connoître la signature & le sceau des juges de son ressort ; mais s'il s'agit de faire valoir l'acte auprès d'autres officiers que le juge supérieur, en ce cas il faut une seconde légalisation donnée par le juge supérieur, qui atteste que le juge inférieur qui a légalisé est réellement juge, & que ce sont sa signature & son sceau qui sont apposés à la premiere légalisation.
Si cette seconde légalisation n'est donnée que par un juge de seigneur, elle ne rend l'acte authentique que dans son ressort, parce que l'on n'est pas obligé ailleurs de connoître la signature ni le sceau de tous les juges de seigneurs ; mais si cette seconde légalisation est donnée par un juge royal, l'acte devient authentique dans tout le royaume, & même dans les pays étrangers, parce que le sceau royal est connu par-tout.
Quant aux actes émanés d'officiers publics royaux, lorsqu'on veut les rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus, on les fait légaliser par le juge royal du lieu où ces officiers font leur résidence, lequel y appose le sceau de la jurisdiction.
On peut aussi les faire légaliser par les officiers municipaux des villes où ces officiers royaux font leur résidence, auquel cas ces officiers municipaux apposent le sceau de la ville & non le sceau royal, ces sortes de légalisations sont les plus authentiques, sur-tout pour faire valoir un acte en pays étranger, parce que les sceaux des villes ne changeant jamais, sont plus connus que les sceaux particuliers de chaque jurisdiction ; & que d'ailleurs le sceau de la ville est en quelque sorte plus général & plus étendu que celui de la jurisdiction, puisque la jurisdiction est dans la ville & même qu'il y a souvent plusieurs jurisdictions royales dans une même ville.
L'ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine, du mois de Novembre 1707 (réglement touchant les officiers, article 20), dit que la légalisation des actes des notaires & tabellions sera faite par le lieutenant général seul qui y apposera le petit sceau des sentences dont il a la garde ; que dans les lieux où il y aura prevôté ayant jurisdiction avec le bailliage, le droit de légalisation appartiendra au prevôt. A l'égard des actes des notaires & tabellions établis dans l'étendue de sa prevôté, & qui auront été reçus devant lui, à la reserve néanmoins de ceux qui seront résidens dans le lieu de l'établissement du bailliage dont la légalisation appartiendra au lieutenant général quoiqu'il y ait un prevôt établi, l'article 23 ajoûte que la légalisation des actes des greffiers appartiendra au chef de la compagnie où servira le greffier dont l'acte devra être légalisé.
Les actes émanés d'officiers publics des finances, comme les certificats, quittances, procès-verbaux des commis, receveurs, directeurs & préposés dans les bureaux du roi, doivent être légalisés par les officiers supérieurs des finances, tels que les receveurs généraux, trésoriers généraux, payeurs des rentes & autres semblables officiers, selon la nature des actes qu'il s'agit de rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus.
Les actes émanés des officiers militaires, comme les quittances, congés, &c. donnés par les capitaines, lieutenans, majors, doivent, pour faire foi, être légalisés par les officiers généraux leurs supérieurs, & ensuite l'on fait légaliser par le ministre de la guerre la légalisation donnée par ces officiers supérieurs.
Il en est de même pour ce qui concerne la Marine, le commerce, les universités, & toutes les autres affaires civiles : ce sont les officiers supérieurs qui légalisent les actes émanés des officiers subalternes.
Lorsqu'on veut faire connoître l'authenticité d'un acte dans les pays étrangers, outre les légalisations ordinaires que l'on y appose pour le rendre authentique par tout le royaume, on le fait encore légaliser pour plus grande sureté par l'ambassadeur, envoyé, consul, résident, agent ou autre ministre de l'état dans lequel on veut faire valoir l'acte.
L'ordonnance de la Marine, titre des consuls, article 23, porte que tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls, ne feront aucune foi en France s'ils ne sont par eux légalisés.
Lorsqu'on produit en France des actes reçus en pays étranger par des officiers publics, & légalisés dans le pays par l'ambassadeur ou autre ministre de France, on légalise au bureau des affaires étrangeres la légalisation donnée par l'ambassadeur envoyé ou autre personne ayant caractere public. Le ministre du roi qui a le département des affaires étrangeres, atteste que celui qui a légalisé l'acte en pays étranger a réellement le caractere mentionné en la légalisation, que c'est sa signature & le sceau dont il a coutume d'user.
Quand on veut faire valoir en France un acte reçu dans certains pays étrangers où le roi n'a point de ministres, on peut le faire légaliser par quelque françois qui s'y rencontre fortuitement, pourvu que ce soit une personne attachée à la France par quelque dignité connue, auquel cas cette personne, à defaut de ministre de France, a caractere représentatif pour légaliser ; il y en a un exemple tout récent. Un françois étant dans les états de Moscovie sur les côtes de la mer de Lenskogo, y passa une procuration pour toucher des rentes à lui dûes sur l'hôtel-de-ville de Paris. N'y ayant point de ministre du roi dans ces pays si éloignés, il fit légaliser sa procuration par un chef d'escadre des vaisseaux du roi qui se rencontra sur les côtes de cette mer. La légalisation fut faite dans le bord de cet officier ; lorsqu'on la présenta au payeur, il fit d'abord difficulté de déférer à une telle légalisation, néanmoins il fut décidé par les officiers supérieurs qu'elle étoit valable.
Tout ce que l'on vient de dire des légalisations ne doit s'appliquer qu'aux actes extrajudiciaires : car ordinairement on ne légalise point les jugemens quand il s'agit de les mettre à exécution hors du ressort de la jurisdiction de laquelle ils sont émanés, mais dans l'intérieur du royaume ; le juge qui les a rendus délivre une commission rogatoire adressée au juge du lieu où on veut faire l'exécution, lequel délivre de sa part un paréatis ou commission exécutoire en vertu de laquelle on met le jugement à exécution.
Ces paréatis ne sont pas proprement des légalisations, mais ils équivalent à une légalisation, puisqu'ils mettent en état d'exécuter le jugement dans un pays où son authenticité ne seroit pas connue sans paréatis, & ils renferment une légalisation tacite en ce qu'ordinairement le juge à qui l'on s'adresse pour les obtenir ne les accorde qu'autant qu'il reconnoît pour authentiques la signature & le sceau dont le jugement est revêtu.
A l'égard des jugemens rendus dans une souveraineté étrangere, que l'on veut faire valoir dans une autre souveraineté, on ne prend ni commission rogatoire, ni paréatis, parce qu'on ne peut pas les mettre à exécution ; ils ne produisent que l'action personnelle ex judicato, en vertu de laquelle il faut obtenir un jugement dans le lieu où on veut faire l'exécution, & dans ce cas je crois que dans la regle les jugemens auroient besoin d'être légalisés comme les actes extrajudiciaires, pour devenir authentiques dans le lieu où l'on s'en sert comme d'un titre pour se pourvoir par action ex judicato, mais je n'ai point vu de telles légalisations.
Il y a quelques états, tels que les Pays-bas, la Lorraine, & la principauté souveraine de Dombes, qui ont avec la France un droit réciproque d'entrecours de jurisdiction, c'est-à-dire que les jugemens émanés de ces états étant revêtus d'une commission rogatoire du juge qui les a rendus, s'exécutent dans les autres états où ce droit d'entre-cours a lieu, pourvu qu'ils soient revêtus d'un pareatis du juge du lieu où on veut mettre le jugement à exécution.
Comme les paréatis qui s'obtiennent soit dans le royaume, soit dans les pays étrangers, n'ont été introduits que pour pouvoir mettre le jugement à exécution, je crois que lorsqu'on les produit soit dans le royaume, soit ailleurs, non pas pour les mettre à exécution, mais seulement pour la preuve de certains faits qui en résultent, que ce seroit plûtôt le cas de les faire légaliser que de prendre un paréatis.
En effet, outre que le paréatis n'est pas une véritable attestation de l'authenticité du jugement, il peut arriver que l'on ne puisse pas accorder de paréatis, soit parce que le jugement dont il s'agit auroit déjà été exécuté & qu'on ne le produit que pour la preuve de certains faits qui en résultent, soit parce qu'il ne seroit pas exécutoire au profit de la personne qui le produit, soit enfin parce que l'expédition que l'on en représente n'est pas dans une forme exécutoire : dans tous ces cas où il s'agit de faire connoître l'authenticité du jugement, & où l'on ne peut pas prendre de paréatis, la légalisation me paroîtroit nécessaire, soit à l'égard des jugemens rendus dans les justices seigneuriales lorsqu'on veut qu'ils fassent foi hors de leur ressort, parce que le sceau du seigneur justicier n'est pas censé connu hors de son ressort, soit à l'égard des jugemens émanés de juges royaux pour en constater l'authenticité dans les pays étrangers ; j'avoue néanmoins que je n'ai point vu de telles légalisations.
Voyez l'édit du mois d'Octobre 1706, concernant le contrôle des registres des baptêmes, mariages & sépultures, article 2 ; l'arrêt du conseil du 30 Novembre suivant ; l'édit du mois d'Août 1717, articles 6 & 7 ; l'arrêt du conseil du 16 Mai 1720, articles 7 & 9 ; l'édit du mois de Juillet 1723, portant création de 1 rentes viageres, articles 4 & 6 ; l'arrêt du conseil du 29 Août 1724, au sujet des droits de péages & autres semblables ; la déclaration du 27 Décembre 1727, pour la perception des rentes viageres ; l'édit de création de rentes de tontines de Novembre 1733, article 13, & autres édits & déclarations concernant les rentes viageres & de tontine, dans lesquels il est parlé de légalisation des procurations, certificats de vie, &c. (A)
|
| LÉGALISE | (Jurisprud.) c'est certifier l'authenticité d'un acte public, afin que l'on y ajoûte foi, même hors le district des officiers dont il est émané. Voyez ci-devant LEGALISATION. (A)
|
| LÉGAT | legatus, s. m. (Jurisprud.) légat du pape ou du saint siege, est un ecclésiastique qui fait les fonctions de vicaire du pape, & qui exerce sa jurisdiction dans les lieux où le pape ne peut se trouver.
Le pape donne quelquefois le pouvoir de légat sans en conférer le titre ni la dignité.
Le titre de légat paroît emprunté du droit romain, suivant lequel on appelloit légats les personnes que l'empereur ou les premiers magistrats envoyoient dans les provinces pour y exercer en leur nom la jurisdiction. Quand ces légats ou vicaires étoient tirés de la cour de l'empereur, on les nommoit missi de latere, d'où il paroît que l'on a aussi emprunté le titre de légats à latere.
Les premiers légats du pape dont l'histoire ecclésiastique fasse mention, sont ceux que les papes envoyerent, dès le iv. siecle, aux conciles généraux. Vitus & Vincent, prêtres, assisterent au concile de Nicée comme légats du pape Sylvestre. Le pape Jules ne pouvant assister en personne au concile de Sardique, y envoya à sa place deux prêtres & un diacre. Au concile de Milan le pape Tibere envoya trois légats ; Lucifer, évêque de Cagliari ; Pancrace, prêtre ; & Hilaire, diacre.
Au sixieme concile de Carthage, tenu en 419 sous le pape Boniface, assisterent les légats qui avoient été envoyés dès l'année précédente par le pape Zozime, son prédécesseur, pour instruire l'affaire d'Apiarius, prêtre de la ville de Sicque en Mauritanie, lequel ayant été excommunié par Urbain, son évêque, s'étoit pourvu devant le pape. Ces légats étoient chargés d'une instruction qui contenoit plusieurs chefs qui furent contestés par les évêques d'Afrique, savoir celui qui concernoit les appellations des évêques à Rome, & celui qui vouloit que les causes des clercs fussent portées devant les évêques voisins, en cas que leur évêque les eût excommuniés mal-à-propos.
S. Cyrille vint au concile d'Ephese en 431 à la place de Célestin. Il y eut aussi des légats envoyés par le pape S. Léon au faux concile d'Ephese en 449. Les légats voulurent y faire la lecture de la lettre dont ils étoient chargés pour le concile, mais cette assemblée séditieuse, où tout se passa contre les regles, n'eut point d'égard à la demande des légats. Pascalin & Lucentius, avec deux autres ecclésiastiques, présiderent pour le pape Léon au concile de Chalcédoine en 451.
Les papes envoyoient quelquefois des évêques & même de simples prêtres dans les provinces éloignées, pour examiner ce qui s'y passoit de contraire à la discipline ecclésiastique, & leur en faire leur rapport. Ce fut ainsi que le pape Zozime envoya l'évêque Faustin en Afrique pour y faire recevoir le decret du concile de Sardique, touchant la révision du procès des évêques jugés par le concile provincial. Les Africains se récrierent, disant qu'ils n'avoient vu aucun canon qui permit au pape d'envoyer des légats à sanctitatis suae latere ; néanmoins l'évêque Potentius fut encore délégué en Afrique pour examiner la discipline de cette église & la réformer.
Les légats envoyés par le pape Félix à Constantinople en 484 pour travailler à la réunion, ayant communiqué, malgré sa défense, avec Acace & Pierre Monge, tous deux successivement patriarches de Constantinople, le pape à leur retour les déposa dans un concile. Il y eut en 517 une seconde légation à Constantinople aussi malheureuse que la premiere. La troisieme légation, faite en 519, eut enfin un heureux succès, & fit cesser le schisme qui séparoit l'église de Constantinople de celle de Rome depuis la condamnation d'Acace.
Au concile de Constantinople tenu en l'an 680, les légats furent assis à la gauche de l'empereur, qui étoit la place la plus honorable : ce furent eux qui firent l'ouverture du concile.
On trouve dès l'an 683 des légats ordinaires ; le pape Léon envoya cette année à Constantinople Constantin, soudiacre régionnaire du saint siége, pour y résider en qualité de légat.
Les légats extraordinaires dont la mission se bornoit à un seul objet particulier, n'avoient aussi qu'un pouvoir très-limité.
Ceux qui avoient des légations ordinaires ou vicariats apostoliques, avoient un pouvoir beaucoup plus étendu ; l'évêque de Thessalonique, en qualité de légat ou vicaire du saint siege, gouvernoit onze provinces, confirmoit les métropolitains, assembloit les conciles, & décidoit toutes les causes majeures. Le ressort de ce légat fut fort resserré lorsque Justinien obtint du pape Vigile un vicariat du saint siége pour l'évêque d'Acride ; ce vicariat fut ensuite supprimé lorsque Léon l'Isaurien soumit l'Illyrie au patriarche d'Antioche.
Le pape Symmaque accorda de même à S. Cesaire, archevêque d'Arles, la qualité de vicaire & l'autorité de la légation sur toutes les Gaules. Auxanius & Aurelien, tous deux archevêques de la même ville, obtinrent du pape Vigile le même pouvoir ; il fut continué par Pélage I. à Sabandus, & par S. Grégoire à Vigile, sur tous les états du roi Childebert.
Les archevêques de Rheims prétendent que saint Remy a été établi vicaire apostolique sur tous les états de Clovis.
Les légations particulieres étoient alors très-rares. S. Grégoire voulant réformer quelques abus dans les églises de France, pria la reine Brunehaut de permettre qu'il envoyât un légat pour assembler un concile, ce qui lui fut accordé.
On trouve aussi que S. Boniface étant en France avec la qualité de légat du saint siége, présida de même au concile qui fut tenu pour la réformation de l'église gallicane.
Ceux que le pape Nicolas I. envoya en France du tems de Charles-le-Chauve, parurent avec une autorité beaucoup plus grande que ceux qui les avoient précédés. Ce pape leur permit de décider toutes les affaires de l'église de France, après néanmoins qu'ils auroient communiqué leur pouvoir à Charles-le-Chauve ; il leur ordonna de renvoyer les questions les plus difficiles au saint siége, avec les actes de tout ce qu'ils auroient réglé de sa part.
A mesure que l'autorité des légats augmenta, on leur rendit aussi par-tout de plus grands honneurs : en effet, on voit que ceux que le pape Adrien II. envoya en 869 à Constantinople pour assister au concile général, firent leur entrée dans cette ville le dimanche 25 Septembre, accompagnés de toutes les écoles ou compagnies des officiers du palais, qui allerent au-devant d'eux jusqu'à la porte de la ville en chasubles ; ils étoient suivis de tout le peuple, qui portoit des cierges & des flambeaux. L'empereur Basile leur donna audience deux jours après, & se leva lorsqu'ils entrerent ; ils étoient au nombre de trois, lesquels au concile tinrent la premiere place : après eux étoient les légats des patriarches d'Orient. Trois années auparavant Photius supposant un concile, y avoit fait de même assister les légats des patriarches d'Orient, croyant par-là donner à ce prétendu concile plus d'authenticité.
On remarque aussi que le légat Frédéric, cardinal prêtre de l'Eglise romaine, lequel en 1001 présida au concile de Polden, arriva en Allemagne revêtu des ornemens du pape, avec les chevaux enharnachés d'écarlate, pour montrer qu'il le représentoit.
Sous la troisieme race de nos rois, l'autorité des légats fit tomber celle des métropolitains & des conciles provinciaux ; ils s'attribuoient le pouvoir de suspendre & de déposer les évêques, d'assembler les conciles dans l'étendue de leur légation, & d'y présider ; cependant les decrets du concile que Grégoire VII. tint à Rome en 1074, ayant été portés en Allemagne par des légats qui demanderent la liberté de tenir eux-mêmes un concile ; les Allemands s'y opposerent, déclarant qu'ils n'accorderoient jamais la prérogative de se laisser présider en concile qu'au pape en personne. Les légats présiderent pourtant depuis à divers conciles.
Les légats porterent leurs prétentions jusqu'à soutenir, que leur suffrage contrebalançoit seul celui de tous les évêques.
Dans la suite ils déciderent presque tout par eux-mêmes, sans assembler de concile ; & l'on voit que dès l'an 876, au concile de Paris auquel assisterent deux légats du pape avec 50 évêques françois, il y eut plusieurs contestations touchant quelques prêtres de divers diocèses qui prétendoient s'adresser aux légats du pape, & reclamer la jurisdiction du saint siége.
Au concile de Clermont, tenu en 1095, Adhemar évêque du Pui, fut choisi pour conduire les croisés avec les pouvoirs de légat ; desorte qu'il fut le chef ecclésiastique de la croisade, comme Raimond comte de Toulouse, en fut le chef séculier. On nomma de même dans la suite d'autres légats, tant pour cette croisade, que pour les suivantes.
Les premiers légats n'exigeoient aucun droit dans les provinces de leur légation ; mais leurs successeurs ne furent pas si modérés. Grégoire VII. fit promettre à tous les métropolitains en leur donnant le pallium, qu'ils recevroient honorablement les légats du saint siége ; ce qui fut étendu à toutes les églises dont les légats tirerent des sommes immenses. Quelque respect que S. Bernard eût pour tout ce qui avoit quelque rapport avec le saint siége, il ne put s'empêcher, non plus que les autres auteurs de son tems, de se récrier contre les exactions & les autres excès des légats. Ces plaintes firent que les papes rendirent les légations moins fréquentes, voyant qu'elles s'avilissoient ; néanmoins ces derniers légats ont eu plus d'autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui les avoient précédés, attendu que les papes qui s'en étoient attribué la disposition par plusieurs voies différentes, au préjudice des collateurs ordinaires, donnerent aux légats le pouvoir d'en disposer comme ils faisoient eux-mêmes.
On remarque que dès le xij. siecle, on distinguoit deux sortes de légats ; les uns étoient des évêques ou abbés du pays ; d'autres étoient envoyés de Rome ; les légats pris sur les lieux étoient aussi de deux sortes ; les uns établis par commission particuliere du pape, les autres par la prérogative de leur siége, & ceux-ci se disoient légats nés, tels que les archevêques de Mayence & de Cantorbéry, &c.
Les légats envoyés de Rome se nommoient légats à latere, pour marquer que le pape les avoit envoyés d'auprès de sa personne. Cette expression étoit tirée du concile de Sardique en 347 ; nos rois donnoient aussi ce titre à ceux qu'ils détachoient d'auprès de leur personne, pour envoyer en différentes commissions, ainsi qu'on le peut voir dans Grégoire de Tours, liv. IV. ch. xiij. & dans la vie de Louis-le-Débonnaire, qui a été ajoutée à la continuation d'Aimoin.
Les légats à latere tiennent le premier rang entre ceux qui sont honorés de la légation du saint siége ; suivant l'usage des derniers siecles, ce sont des cardinaux que le pape tire du sacré collége, qui est regardé comme son conseil ordinaire, pour les envoyer dans différens états avec la plénitude du pouvoir apostolique. Comme ils sont supérieurs aux autres en dignité, ils ont aussi un pouvoir beaucoup plus étendu, & singulierement pour la collation des bénéfices, ainsi qu'il résulte du chapitre officii, de officio legati, in-4°.
Ceux qui sont honorés de la légation sans être cardinaux, sont les nonces & les internonces, lesquels exercent une jurisdiction dans quelques pays. Leurs pouvoirs sont moins étendus que ceux des légats cardinaux : on ajoute dans leurs facultés qu'ils sont envoyés avec une puissance pareille à celle des légats à latere, lorsqu'avant de partir ils ont touché le bout de la robe du pape, ou qu'ils ont reçu eux-mêmes leur ordre de la propre bouche de sa sainteté.
Les nonces n'exerçant en France aucune jurisdiction, on n'y reconnoît de légats envoyés par les papes, que ceux qui ont la qualité de légats à latere.
Les légats nés sont des archevêques aux siéges desquels est attachée la qualité de légat du saint siége ; nous avons déja parlé de ceux de Mayence & de Cantorbéry ; en France, les archevêques de Rheims & d'Arles prennent aussi ce titre ; ce qui vient de ce que leurs prédécesseurs ont été vicaires du saint siége. Saint Remy est le seul entre les archevêques de Rheims, qui ait eu cette dignité sur tout le royaume de Clovis. A l'égard des archevêques d'Arles, plusieurs d'entr'eux ont été successivement honorés de la légation. A présent ce n'est plus qu'un titre d'honneur pour ces deux prélats, & qui ne leur donne aucune prééminence, ni aucune fonction.
La légation des cardinaux donnant atteinte au droit des ordinaires, dont le roi est le protecteur, & attribuant une grande autorité à celui qui en est revêtu, le pape est obligé avant que d'envoyer un légat en France, de donner avis au roi de la légation, des motifs qui l'engagent à envoyer un légat, & de savoir du roi si la personne chargée de cet emploi, lui sera agréable.
Cet usage précieux est exprimé dans l'article 2. de nos libertés, qui porte que le pape n'envoye point en France de légats à latere, avec faculté de réformer, juger, conférer, dispenser, & telles autres qui ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roi très-chrétien, ou de son consentement.
Aussi n'a-t-on point reçu en France la constitution de Jean XXII. qui prétendoit avoir le droit d'envoyer des légats quand il lui plairoit dans tous les états catholiques sans la permission des souverains. On peut voir dans le chap. xxiij. des preuves de nos libertés, les permissions accordées par nos rois pour les légations depuis Philippe-le-Bel : ces papes eux-mêmes avoient observé d'obtenir cette permission sous la premiere race de nos rois. S. Grégoire qui étoit des plus attentifs à conserver les droits du saint siége, & même à les augmenter, voulant envoyer un légat en France, le proposa à la reine Brunehaut, & lui dit dans sa lettre ut personam, fi praecipitis, cum vestrae autoritatis assensu transmittamus.
Le légat arrivé en France avec la permission du roi, fait présenter au roi la bulle de sa légation contenant tous ses pouvoirs ; le roi donne des lettres-patentes sur cette bulle : ces deux pieces sont portées au parlement, lequel en enregistrant l'une & l'autre, met les modifications qu'il juge nécessaires pour la conservation des droits du roi, & des libertés de l'église gallicane.
Comme les papes ont toûjours souffert impatiemment ces modifications, on ne les met point sur le repli des bulles, on y marque seulement qu'elles ont été vérifiées, & l'on fait savoir au légat par un acte particulier les modifications portées par l'arrêt d'enregistrement.
La bulle des facultés du légat doit être enregistrée dans tous les parlemens sur lesquels doit s'étendre sa légation. Si la bulle ne faisoit mention que de la France, la légation ne s'étendroit pas sur les archevêchés de Lyon, de Vienne, & de Besançon, parce que ces provinces étoient autrefois du royaume de Bourgogne, suivant le style ordinaire de Rome, qui ne change guere. Le légat n'exerce sa jurisdiction dans ces provinces, que quand la bulle porte in Franciam & adjacentes provincias.
Aussi-tôt que les légats ont reçu l'enregistrement de leurs bulles, ils promettent & jurent au roi par un écrit sous seing-privé, qu'ils ne prendront la qualité de légats, & n'en feront les fonctions, qu'autant qu'il plaira à Sa Majesté, qu'ils n'useront que des pouvoirs que le roi a autorisés, & qu'ils ne feront rien contre les saints decrets reçus en France, ni contre les libertés de l'église gallicane.
Le légat, en signe de sa jurisdiction, fait porter devant lui sa croix levée ; en Italie, il la fait porter dès qu'il est sorti de la ville de Rome ; mais lorsqu'il arrive en France, il est obligé de la quitter, & ne la peut reprendre qu'après la vérification de ses bulles, & la promesse faite au roi de se conformer aux usages de France. Louis XI. fit ajoûter aux modifications des pouvoirs du cardinal de S. Pierre-aux-liens, qu'il ne pourroit faire porter sa croix haute en présence du roi.
Il est d'usage en France, lorsque le légat entre dans quelque ville de sa légation, de lui faire une entrée solemnelle. Lorsque le cardinal d'Amboise entra à Paris comme légat, le corps de ville & les députés des cours souveraines allerent au-devant de lui ; on lui donna le dais à la porte, comme on fit depuis en 1664 au cardinal Chigi, neveu d'Alexandre VII.
Les prétentions des légats vont jusqu'à soutenir que le roi doit les visiter avant qu'ils fassent leur entrée dans Paris. Cette prétention ne paroit appuyée que sur ce que Henri IV. alla à Chartres au-devant du cardinal de Médicis ; mais tout le monde sait que le roi fit ce voyage sur des chevaux de poste, sans être accompagné, & qu'il s'y trouva incognito ; ce qu'il n'auroit pas fait si c'eût été un devoir de bienséance. Ce prince ne rendit point de pareille visite au cardinal Aldobrandin, neveu de Clément VIII. ni ses successeurs aux autres légats.
Henri IV. envoya le prince de Condé, encore enfant, au devant du cardinal de Médicis ; ce qui pouvoit passer pour une action sans conséquence, & pour une simple curiosité d'enfant, que l'on veut faire paroître dans une action d'éclat : cependant la cour de Rome, qui tire avantage de tout, a pris de-là occasion d'exiger le même honneur pour les autres légats.
En effet, depuis ce tems il n'y a eu aucune entrée de légat qui n'ait été honorée de la présence de quelque prince du sang. Louis XIII. envoya le duc d'Orléans son frere au-devant du cardinal Barberin ; le prince de Condé & le duc d'Enguien son fils furent envoyés au-devant du cardinal Chigi, qui est le dernier légat que l'on ait vû en France. Cette légation fut faite en exécution du traité conclu à Pise le 12 Janvier 1664 ; la mission du légat étoit de faire au roi des excuses de l'insulte qui avoit été faite par les Corses à M. de Créqui, son ambassadeur à Rome.
Les archevêques, les primats, & même ceux qui ont le titre de légats nés du saint siége, ne portent point la croix haute en présence du légat à latere ; ce qu'ils observent ainsi par respect pour celui qui représente la personne du pape.
Les légats prétendent que les évêques ne doivent point porter devant eux le camail & le rochet ; cependant les évêques qui accompagnoient le cardinal Chigi à son entrée, portoient tous le rochet, le camail & le chapeau verd, que l'on regarde en Italie comme des ornemens épiscopaux.
Quoique le pape donne aux légats à latere une plénitude de puissance, ils sont néanmoins toujours regardés comme des vicaires du saint siége, & ne peuvent rien décider sur certaines affaires importantes sans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de leur légation ; telles sont les translations des évêques, les suppressions, les érections, les unions des évêchés, & les bulles des bénéfices consistoriaux dont la collation est expressément réservée à la personne du pape par le concordat.
Lorsqu'une affaire, qui étoit de la compétence du légat, est portée au pape, soit que le légat l'ait lui-même envoyée, ou que les parties se soient adressées directement au saint siége, le légat ne peut plus en connoître, à peine de nullité.
Le pouvoir général que le pape donne à ses légats dans un pays, n'empêche pas qu'il ne puisse ensuite adresser à quelqu'autre personne une commission particuliere pour une certaine affaire.
La puissance du légat ne peut pas être plus étendue que celle du pape ; ainsi il n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois, & ne peut délier leurs sujets du serment de fidélité ; il ne peut décider les contestations d'entre les séculiers pour les affaires qui regardent leur bien ou leur honneur ; juger le possessoire des bénéfices, donner des dispenses aux batards pour les effets civils, connoître du crime de faux & d'usure entre les laïcs, de la séparation de biens d'entre mari & femme, ni de ce qui regarde la dot, le douaire, & autres reprises & conventions matrimoniales, faire payer des amendes pour les crimes & délits, même ecclésiastiques, accorder des lettres de restitution en entier, ni restituer contre l'infamie.
Son pouvoir, par rapport au spirituel, doit aussi être tempéré par les saints decrets qui sont reçus dans le royaume ; d'où il suit qu'il ne peut constituer des pensions sur les bénéfices que pour le bien de la paix, en cas de permutation ou de résignation en faveur ; permettre de réserver tous les fruits des bénéfices au lieu de pension ; déroger à la regle de publicandis resignationibus, & à celle de verisimili notitia.
Il ne peut pareillement, lorsqu'il confere des bénéfices, ordonner que l'on ajoûtera foi à ses provisions sans que l'on soit obligé de rapporter les procurations pour résigner ou pour permuter ; conférer les bénéfices électifs, dans l'élection desquels on suit la forme du chapitre quia propter ; créer des chanoines avec attribution des premieres prébendes vacantes ; déroger aux fondations des églises, &c.
Le légat a latere peut conférer les bénéfices vacans par une démission pure & simple faite entre ses mains sur une permutation, & ceux qui vaquent par dévolution, par la négligence d'un collateur qui releve immédiatement du saint siége.
Ceux qui demandent au légat des provisions de quelque bénéfice, sont obligés d'énoncer dans leur supplique tous les bénéfices dont ils sont titulaires, à peine de nullité des provisions, de même que dans les signatures obtenues en cour de Rome.
Le légat doit, aussi-bien que le pape, conférer les bénéfices à ceux qui les requierent du jour qu'ils ont obtenu une date : en cas de refus de la part du légat, le parlement permet de prendre possession civile, même d'obtenir des provisions de l'évêque diocésain, qui ont la même date que la réquisition faite au légat.
Les expéditionnaires en cour de Rome ont aussi seuls droit de solliciter les expéditions des légations. Il faut que les dataires, registrateurs & autres expéditionnaires de la légation, soient nés françois, ou naturalisés.
La faculté de conférer les bénéfices par prévention dépouillant les collateurs ordinaires, & n'étant accordée qu'au pape par le concordat, on a rarement consenti en France que les légats usassent de ce droit ; & quand les papes le leur ont accordé, les parlemens ont ordinairement modifié cet article, ou même l'ont absolument retranché. Le vicelégat d'Avignon prévient pourtant les collateurs ordinaires ; c'est une tolérance que l'on a pour lui depuis long-tems dans les provinces de sa vice-légation.
Les résignations en faveur n'étant guere moins contraires au droit canonique que la prévention, on ne souffre pas non-plus ordinairement en France que les légats les admettent.
Les réserves générales & particulieres des bénéfices ne sont point permises au légat à latere non-plus qu'au pape ; il ne peut non-plus rien faire au préjudice du droit de régale, du patronage laïc, de l'indult du parlement, & des autres expectatives qui sont reçues dans le royaume.
Le légat à latere ne peut députer vicaires ou subdélégués pour l'exercice de sa légation, sans le consentement exprès du roi. Il est tenu d'exercer lui-même son pouvoir tant qu'il dure.
Il ne peut cependant, non plus que le pape, connoître par lui-même des affaires contentieuses ; mais il peut nommer des juges délégués in partibus pour décider les appellations des sentences rendues par les supérieurs ecclésiastiques qui relevent immédiatement du saint siege. Ces juges délégués ne doivent point connoître en premiere instance des affaires dont le jugement appartient aux ordinaires, ni des appellations, avant que l'on ait épuisé tous les degrés de la jurisdiction ecclésiastique qui sont audessous de celle du pape.
Les légats ne peuvent pas changer l'ordre de la jurisdiction ordinaire, ni adresser la commission pour donner le visa à d'autres qu'à l'évêque diocésain ou à son grand-vicaire, ni commettre la fulmination des bulles, & dispenser à d'autres qu'à l'official qui en doit connoître.
Les reglemens faits par un légat pendant le tems de sa légation, doivent continuer d'être exécutés, même après sa légation finie, pourvû qu'ils ayent été revêtus de lettres-patentes vérifiées par les parlemens.
Dès qu'un légat n'est plus dans le royaume, il ne peut plus conférer les bénéfices ni faire aucun autre acte de jurisdiction, quand même le tems de sa légation ne seroit pas encore expiré.
La légation finit par la mort du légat, ou avec le tems fixé pour l'exercice de sa légation par les lettres-patentes & arrêt d'enregistrement, ou quand le roi lui a fait signifier sa révocation, au cas que les lettres-patentes & arrêt d'enregistrement n'eussent pas fixé le tems de la légation. Les bulles du légat portent ordinairement que la légation durera tant qu'il plaira au pape ; mais ces légations indéfinies ne sont point admises en France : c'est pourquoi l'on fait promettre aux légats, avant d'exercer leur légation, qu'ils ne se serviront de leur pouvoir qu'autant qu'il plaira au roi.
C'est une question assez controversée de savoir si la légation finit par la mort du pape : cependant comme l'autorité des légats donne atteinte à celle des ordinaires qui est favorable, dans le doute on doit tenir que la légation est finie.
Quelquefois après la légation finie, le pape accorde une prorogation ; mais ces bulles sont sujettes aux mêmes formalités que les premieres, & les mêmes modifications y ont lieu de droit.
Lorsque le légat sort du royaume, il doit y laisser les registres de sa légation, & en remettre les sceaux à une personne nommée par le roi, qui en expédie les actes à ceux qui en ont besoin. Les deniers provenans de ces expéditions sont employés à des oeuvres de piété, suivant qu'il est reglé par le roi. Si le légat ne laissoit pas son sceau, le parlement commet une personne pour sceller les expéditions d'un sceau destiné à cet usage.
Outre les légats à latere que le pape envoie extraordinairement, selon les différentes occurrences, il y en a toujours un pour Avignon, qui exerce sa jurisdiction sur cette ville & sur le comté qui en dépend, & sur les provinces ecclésiastiques qui en dépendent. Cette commission est ordinairement donnée à un cardinal, qui a un subdélégué, connu sous le nom de vice-légat, lequel fait toutes les fonctions de cette légation.
Les facultés de quelques légats d'Avignon se sont aussi étendues sur la province de Narbonne ; mais ce n'a point été comme légats d'Avignon qu'ils y ont exercé leur pouvoir ; ç'a été en vertu de lettres-patentes, vérifiées au parlement de Toulouse, qui en contenoient une concession particuliere : cette distinction est expliquée dans les lettres-patentes de Charles IX, du 6 Juin 1565, sur les bulles de la légation du cardinal de Bourbon, dont les facultés s'étendoient sur la province de Narbonne : elle se trouve aussi dans les lettres-patentes du 10 Mai 1624 sur les bulles du cardinal Barberin.
Ce légat est une espece de gouverneur, établi au nom du pape pour la ville d'Avignon & les terres en dépendantes, qui ont été engagées au saint siége par une comtesse de Provence. Ce n'est que par une grace spéciale que le roi consent que ce légat ou son vice-légat exercent leur jurisdiction spirituelle sur les archevêchés des provinces voisines que l'on vient de nommer.
Les provinces ecclésiastiques de France qui dépendent du légat d'Avignon, sont les archevêchés de Vienne, d'Arles, d'Embrun & d'Aix.
Il ne paroît pas que les papes ayent eu en la ville d'Avignon leurs légats ni vice-légats avant que Clément V. eût transféré son siége en cette ville en 1348 ; mais depuis qu'Urbain VI. eut remis à Rome le siége apostolique, les papes établirent à Avignon leurs officiers pour le gouvernement spirituel & temporel de cette ville & de ses dépendances, & du comté venaissin dont ils étoient en possession.
Il est assez difficile de dire précisément quel étoit le pouvoir de ces officiers d'Avignon sous les premiers papes qui ont remis le saint siége à Rome, dans le gouvernement ecclésiastique de quelques provinces de France, & en quel tems leur autorité & qualité de légats & vice-légats y a été reconnue.
Quelques auteurs ont avancé qu'avant 1515 il n'y avoit point de légats à Avignon ; que le cardinal de Clermont, archevêque d'Ausch, envoyé par le pape Léon X, est le premier qui ait eu cette qualité, & que le cardinal Farneze fut le second. Les lettres-patentes du roi François I, du 23 Février 1515, données sur les bulles de légation du cardinal de Clermont, & l'arrêt d'enregistrement, paroissent favoriser cette opinion : cependant cette époque de 1515 ne s'accorde pas avec les lettres-patentes d'Henri II. du mois de Septembre 1551, ni avec la requête des états de Provence, qui y est énoncée, sur laquelle ces lettres-patentes ont été accordées. Par ces lettres, registrées au parlement d'Aix, sa majesté permet à ses sujets de Provence de recourir pardevers le légat ou vice-légat d'Avignon pour en obtenir, dans les matieres bénéficiales, les dispenses & dérogations à la regle des vingt jours.
Les légats & vice-légats d'Avignon sont obligés, avant que d'exercer leurs pouvoirs dans les provinces de France, d'obtenir des lettres-patentes sur les bulles de leur légation, & de les faire enregistrer dans tous les parlemens sur lesquels s'étend leur légation.
On leur fait ordinairement promettre par écrit de ne rien faire contre les libertés de l'église gallicane, & de se soumettre aux modifications qui ont été apposées à leurs facultés par l'arrêt de vérification : chaque parlement a ses formes & ses usages pour ces sortes d'enregistremens & de modifications.
Les decrets des papes rapportés dans les decretales au titre de officio legati, n'ont pas prévu toutes les questions qui se présentent sur l'étendue du pouvoir des légats & vice-légats d'Avignon.
L'étendue de leurs facultés, suivant les maximes du royaume, dépend 1°. des clauses des bulles de leur légation ; 2°. de la disposition des lettres-patentes accordées par le roi sur ces bulles ; 3°. des modifications apposées par les arrêts d'enregistrement.
Les bulles de la légation du cardinal Farneze, légat d'Avignon en 1542, lui donnant le pouvoir d'user dans sa légation des facultés du grand-pénitencier de Rome, & cette clause ayant paru insolite au parlement d'Aix, il ne les enregistra qu'à la charge de rapporter dans trois mois les facultés du grand-pénitencier de Rome.
Le parlement de Toulouse, en enregistrant le 20 Août 1565 les bulles de la légation d'Avignon, accordées au cardinal de Bourbon, mit les modifications suivantes : " Sans que ledit cardinal légat puisse procéder à la réformation ni mutation des statuts ou priviléges des églises de fondation royale, patronats ou autres, sans appeller le procureur général, les patrons, corps des universités, colléges & chapitres dont il traitera la réformation, ni procédant en icelle déroger aux fondations séculieres.... ni user des facultés de légitimer bâtards, sinon pour être promus aux ordres sacrés, bénéfices & états d'église.... Ne pourra aussi donner permission d'aliéner biens-immeubles des églises pour quelque nécessité que ce soit, mais seulement donner rescrits & délégations aux sujets du roi pour connoître & délibérer desdites aliénations.... Ne pourra réserver aucunes pensions sur bénéfices, encore que ce soit du consentement des bénéficiers, sinon au profit des résignans.... ni déroger à la regle de verisimili notitiâ, ni à celle de publicandis resignationibus, ni autrement contrevenir aux droits & prérogatives du royaume, saints decrets, droits des universités, &c. "
On ne reconnoît point en France que le légat d'Avignon puisse recevoir des résignations en faveur, mais on convient que la faculté de conférer sur une démission ou simple résignation ne lui est pas contestée.
Quoique les habitans d'Avignon soient réputés regnicoles, le vice-légat d'Avignon est réputé étranger : c'est pourquoi il peut fulminer les bulles expédiées en cour de Rome en faveur des François.
De officio legati, voyez le décret de Gratien, Distinct. 1. c. ix. Dist. 63. c. x. Dist. 94. & 97. 2. quest. 1. c. vij, & quest. 5. c. viij. 3. quest. 6. c. x. 11. quest. 1. c. xxxix. 25. quest. 1. c. x. Extrav. 1. 30. sext. 1, 15. Extr. comm. 1 & 6.
Voyez aussi les libertés de l'église gallicane, les mémoires du clergé, la bibliot. du droit franç. & canoniq. par Donchal ; celle de Jovet ; le recueil de Tournet ; les défin. canoniq. le recueil de M. Charles-Emmanuel Borjon, tom. II. les lois ecclésiastiq. de d'Héricourt, part. I. tit. des légats ; le dictionn. de Jean Thaurnas, au mot légats ; M. de Marca, concordia sacerdotii & imperii. (A)
LEGAT, s. m. du latin legatum, (Jurisprud.) est la même chose que legs ; ce terme n'est usité que dans les pays de Droit écrit. Voyez LEGS. (A)
|
| LÉGATAIRE | S. m. (Jurisprud.) est celui auquel on a laissé quelque chose par testament ou codicille.
Le légataire universel est celui auquel le testateur a légué tous ses biens, ce qui est néanmoins toujours restraint aux biens disponibles.
Le légataire particulier est celui auquel on a fait un simple legs, soit d'un corps certain, soit d'une certaine somme ou quantité de meubles, d'argent ou autres choses.
En pays coutumier les légataires universels tiennent lieu d'héritiers, cependant ils ne sont pas saisis par la loi ni par le testament, tout legs étant sujet à délivrance.
Le légataire universel n'est tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence des biens légués, pourvû qu'il en ait fait faire inventaire ; il ne peut pas être témoin dans le testament qui le nomme, à la différence du légataire particulier qui peut être témoin.
Plusieurs coutumes, comme celles de Paris, défendent d'être héritier & légataire d'une même personne. Voyez ci-après LEGS.
|
| LÉGATION | S. f. (Jurisprud.) est la charge ou fonction, ou dignité d'un légat du saint siege. On entend aussi quelquefois par-là son tribunal, sa jurisdiction ; quelquefois enfin le terme de légation est pris pour le territoire où s'étend son pouvoir. Il y a des légations ordinaires, qui sont proprement des vicariats apostoliques, comme la légation d'Avignon, en laquelle on obtient toutes les graces & expéditions bénéficiales pour la Provence, le Dauphiné, une partie du Lyonnois & du Languedoc ; ce qu'on appelle les trois provinces : la vicelégation est la charge du vicelégat. Les légations extraordinaires sont celles des légats que le pape envoie pour traiter quelque affaire particuliere. Voyez ci-devant LEGAT. (A)
|
| LÉGATNIES | (Com.) petites étoffes mêlées de poil, de fleuret, de fil, de laine ou de coton, sur trois largeurs ; demi-aune moins 1/16, demi-aune, ou demi-aune & 1/16.
|
| LÉGATOIRE | adj. (Hist. anc.) terme dont on se sert en parlant du gouvernement des anciens Romains : Auguste divisa les provinces de l'empire en consulaires, légatoires & présidiales.
Les provinces légatoires étoient celles dont l'empereur lui-même étoit gouverneur, mais où il ne résidoit pas, y administrant les affaires par ses lieutenans ou legati. Voyez LEGATUS.
|
| LEGATURE | LIGATURES, BROCATELLES ou MEZELINE, (Comm.) voyez LIGATURE.
|
| LEGATUS | S. m. (Hist. anc.) signifioit parmi les Romains un officier militaire qui commandoit en qualité de député du général. Il y en avoit de plusieurs especes ; savoir le legatus à l'armée sous l'empereur ou sous un général ; cette premiere espece répondoit à nos lieutenans généraux d'armée, & le legatus dans les provinces, sous le proconsul ou le gouverneur, étoit comme nos lieutenans de roi au gouvernement d'une province.
Lorsqu'une personne de marque parmi les citoyens romains avoit occasion de voyager dans quelque province, le sénat lui donnoit le titre de legatus, c'est-à-dire d'envoyé du sénat, pour lui attirer plus de respects, & en même tems afin qu'il fût défrayé par les villes & places qui se trouvoient sur son passage ; c'est ce qu'ils appellerent libera legatio, ambassade libre, parce que la personne qu'elle regardoit n'étoit chargée de rien, & pouvoit se dépouiller de ce titre aussi-tôt qu'elle le vouloit.
|
| LEGE | adj. (Marine) vaisseau qui fait un retour lege ; c'est un vaisseau qui revient sans charge. Si un vaisseau ayant été affrété allant & venant, est contraint de faire son retour lege ; l'intérêt du retardement & le fret entier sont dûs au maître.
LEGE, vaisseau lege ; c'est un vaisseau qui n'a pas assez de lest, ou qui est trop léger par quelqu'autre défaut, comme de construction, & qui par conséquent est trop haut sur l'eau : quelques-uns disent liege.
|
| LÉGENDAIRE | S. m. (Hist. ecclés.) auteur, écrivain d'une légende.
Le premier légendaire grec que l'on connoisse est Simon Métaphraste qui vivoit au x. siecle ; & le premier légendaire latin, est Jacques de Varase, plus connu sous le nom de Voragine, & qui mourut archevêque de Gènes en 1298, âgé de 96 ans.
La vie des saints par Métaphraste pour chaque jour du mois de l'année, paroît n'être qu'une pure fiction de son cerveau ; vous verrez au mot légende, que c'est à peu près le jugement qu'en portoit Bellarmin.
Jacques de Varase est auteur de cette fameuse légende dorée, qui fut reçue avec tant d'applaudissement dans les siecles d'ignorance, & que la renaissance des Lettres fit souverainement dédaigner. Voyez ce qu'en pensent Melchior Cano, Wicelius & Baillet.
Les ouvrages de Métaphraste & de Varase ne péchent pas seulement du côté de l'invention, de la critique & du discernement, mais ils sont remplis de contes puériles & ridicules.
Il faut avouer de bonne foi que plusieurs des légendaires qui les ont suivis, ont eu plus à coeur la réputation du saint dont ils entreprenoient l'éloge, que l'amour de la vérité, parce que plus elle est grande cette réputation, plus elle est capable d'augmenter le nombre des dévots & des charités pieuses.
C'est la chaleur du faux zele qui a rempli de tant de fables l'histoire des saints ; & je ne puis mieux faire que de justifier ces paroles, que l'irréligion ne me dicta jamais, qu'en les confirmant par un passage admirable de Louis Vivès, un des plus savans catholiques du xvj. siecle. Quae, dit-il, de iis sanctis sunt scripta, praeter pauca quaedam, multis sunt commentis faedata, dùm qui scribit affectui suo indulget, & non quae egit divus, sed quae ille egisse eum vellet, exponit ; ut vitam dictet animus scribentis, non veritas. Fuêre qui magnae pietatis loco ducere mendaciola pro religione confingere ; quod & periculosum est, ne veris adimatur fides propter falsa & minime necessarium. Quoniam pro pietate nostrâ, tam multa sunt vera, ut falsa tanquam ignavi milites atque inutiles, oneri sint magis quàm auxilio.
Ce beau passage est dans l'ouvrage de Vivès, de tradendis disciplinis, lib. V. p. 360. (D.J.)
LEGENDE, s. f. (Hist. ecclés.) on a nommé légendes les vies des saints & des martyrs, parce qu'on devoit les lire, legendae erant, dans les leçons de matines, & dans les réfectoires de communautés.
Tout le monde sait assez combien & par quels motifs, on a forgé après coup tant de vies de saints & de martyrs, au défaut des véritables actes qui ont été supprimés, ou qui n'ont point été recueillis dans le tems ; mais bien des gens ignorent peut-être une source fort singuliere de quantité de ces fausses légendes qui ont été transmises à la postérité pour des pieces authentiques, & qui n'étoient dans leurs principe que des jeux d'esprit de ceux qui les ont composées. C'est un fait dont nous devons la connoissance à l'illustre Valerio (Agostino), évêque de Vérone & cardinal, qui fleurissoit dans le xvj. siecle.
Ce savant prélat dans son ouvrage de Rhetoricâ christianâ, traduit en françois par M. l'abbé Dinuart, & imprimé à Paris en 1750 in -12, nous apprend qu'une des causes d'un grand nombre de fausses légendes de saints & de martyrs répandus dans le monde, a été la coutume qui s'observoit autrefois en plusieurs monasteres, d'exercer les religieux par des amplifications latines qu'on leur proposoit sur le martyre de quelques saints ; ce qui leur laissant la liberté de faire agir & parler les tyrans & les saints persécutés, dans le goût & de la maniere qui leur paroissoit vraisemblable, leur donnoit lieu en même tems de composer sur ces sortes de sujets des especes d'histoires, toutes remplies d'ornemens & d'inventions.
Quoique ces sortes de pieces ne méritâssent pas d'être fort considérées, celles qui paroissoient les plus ingénieuses & les mieux faites, furent mises à part. Il est arrivé de-là qu'après un long tems, elles se sont trouvées avec les manuscrits des bibliotheques des monasteres ; & comme il étoit difficile de distinguer ces sortes de jeux, des manuscrits précieux, & des véritables histoires conservées dans les monasteres, on les a regardées comme des pieces authentiques, dignes de la lecture des fideles.
Il faut avouer que ces pieux écrivains étoient excusables, en ce que n'ayant eu d'autres projets que de s'exercer sur de saintes matieres, ils n'avoient pu prévoir la méprise qui est arrivée dans la suite. Si donc la postérité s'est trompée, ç'a été plutôt l'effet de son peu de discernement, qu'une preuve de la mauvaise intention des bons religieux.
Il seroit difficile d'avoir la même indulgence pour le célebre Simon Métaphraste, auteur grec du ix. siecle, qui le premier nous a donné la vie des saints pour chaque jour des mois de l'année, puisqu'il est visible qu'il n'a pu par cette raison les composer que fort sérieusement. Cependant il les a remplies & amplifiées de plusieurs faits imaginaires, de l'aveu même de Bellarmin, qui dit nettement que Métaphraste a écrit quelques-unes de ses vies à la maniere qu'elles ont pu être : & non telles qu'elles ont été effectivement.
Mais comment cela ne seroit-il pas arrivé à des historiens ecclésiastiques, par un pieux zele d'honorer les saints, & de rendre leurs vies agréables au peuple, plus porté ordinairement à admirer ceux qu'il revere, qu'à les imiter, puisque cette liberté s'étoit autrefois glissée jusque dans la traduction de quelques livres de la Bible.
Nous apprenons de saint Jérôme dans sa préface sur celui d'Esther, que l'édition vulgate de ce livre de l'Ecriture qui se lisoit de son tems, étoit pleine d'additions, ce que je ne saurois mieux exprimer que par les termes de ce pere de l'Eglise, d'autant mieux qu'ils vont à l'appui de l'anecdote de Valerio. Quem librum, dit-il, parlant d'Esther, editio vulgata lacinosis hinc indè verborum finibus trahit, addens ea quae ex tempore dici potuerant & audiri, sicut solitum est scholaribus disciplinis sumpto themate, excogitare quibus verbis uti potuit qui injuriam passus, vel qui injuriam fecit. (D.J.)
LEGENDE, (Art numismat.) Elle consiste dans les lettres marquées sur la médaille dont elle est l'ame.
Nous distinguerons ici la legende de l'inscription, en nommant proprement inscription les paroles qui tiennent lieu de revers, & qui chargent le champ de la médaille, au lieu de figures. Ainsi nous appellerons légende, les paroles qui sont autour de la médaille, & qui servent à expliquer les figures gravées dans le champ.
Dans ce sens il faut dire que chaque médaille porte deux légendes, celle de la tête & celle du revers. La premiere ne sert ordinairement qu'à faire connoître la personne représentée, par son nom propre, par ses charges, ou par certains surnoms que ses vertus lui ont acquis. La seconde est destinée à publier soit à tort, soit avec justice, ses vertus, ses belles actions, à perpétuer le souvenir des avantages qu'il a procurés à l'empire, & des monumens glorieux qui servent à immortaliser son nom. Ainsi la médaille d'Antonin porte du côté de la tête, Antonius Augustus pius, pater patriae, trib. pot. cos. III. Voilà son nom & ses qualités. Au revers, trois figures, l'une de l'empereur assis sur une espece d'échafaud ; l'autre d'une femme debout, tenant une corne d'abondance, & un carton quarré, avec certain nombre de points. La troisieme est une figure qui se présente devant l'échafaud, & qui tend sa robe, comme pour recevoir quelque chose : tout cela nous est expliqué par la légende, liberalitas quarta, qui nous apprend que cet empereur fit une quatrieme libéralité au peuple, en lui distribuant certain nombre de mesures de blé, selon le besoin de chaque famille.
Cet usage n'est pas néanmoins si universel & si indispensable, que les qualités & les charges de la personne ne se lisent quelquefois sur le revers, aussi bien que du côté de la tête ; souvent elles sont partagées moitié d'un côté, moitié de l'autre, d'autres fois on les trouve sur le revers, où on ne laisse pas encore, quoique plus rarement, de rencontrer le nom même, celui d'Auguste par exemple, celui de Constantin & de ses enfans.
On trouve quelquefois des médailles sur lesquelles le nom se lit des deux côtés, même sans presqu'aucune différence dans la légende. Témoin un petit médaillon de potin frappé en Egypte, sur lequel on trouve des deux côtés, cabeina, ce bacth. L. I E, quoique sur un de ces côtés on voye la tête de Sabine, & sur l'autre une figure de femme assise, tenant de la main droite des épis, & une haste de la gauche. Tel est encore un médaillon d'argent de Constantin, où du côté de la tête on lit Constantinus max. Aug. au revers, Constantinus Aug. avec trois labarum, dans l'exergue sit ; & cet autre médaillon aussi d'argent, de l'empereur Julien, où autour de la tête sans couronne, on trouve FL. CL. Julianus Nob. Caes. au revers trois labarum pour légende, DN. Julianus Caes. dans l'exergue T. Con. Enfin une médaille de Maximien Daza, qu'on peut placer également dans le moyen & dans le petit bronze, où l'on voit d'un côté Maximien à mi-corps, ayant la tête couronnée de laurier, & la poitrine couverte d'une cuirasse ; il tient de la main droite un globe, sur lequel est une victoire ; sa gauche est cachée par son bouclier, dont la partie supérieure représente deux cavaliers courant à toute bride de gauche à droite, précédés par la Victoire. Dans la partie inférieure sont quatre petits enfans debout, qui désignent les quatre saisons de l'année. La légende de ce côté est Maximinus Nob. Caes. au revers un homme debout, vétu du paludament, tenant de la droite un globe sur lequel est une Victoire ; il s'appuie de la gauche sur une haste ; on lit autour, Maximinus nobilissimus Caes. dans le champ à gauche E, dans l'exergue A N T.
Quand les médailles n'ont point de têtes, les figures qui y sont représentées en tiennent lieu ; & alors la légende du revers est une espece d'inscription. Par exemple, dans la médaille de Tibere, en reconnoissance du soin qu'il prit de faire rétablir les villes d'Asie qu'un tremblement de terre avoit ruinées, il est représenté assis sur une chaise curule, avec ces mots : civitatibus Asiae restitutis, & le revers n'a qu'une simple légende, Tiberius Caesar divi Augusti filius Augustus Pont. Max. Tr. Pot. XXI.
Quant à ce qui concerne les médailles des villes & des provinces, comme elles portent ordinairement pour tête le génie de la ville, ou celui de la province, ou quelqu'autre déité qu'on y adoroit, la légende est aussi le nom de la ville, de la province, de la déïté, ou de tous les deux ensemble, , &c. , &c. soit que le nom de la ville se lise au revers, & que le nom de la déïté demeure du côté de la tête, soit que le nom de la ville serve de légende à la déïté, comme à Jupiter Hammon, à Hercule, &c.
Dans ces mêmes médailles, les revers sont toûjours quelques symboles de ces villes, souvent sans légende, plus souvent avec le nom de la ville, quelquefois avec celui de quelque magistrat, comme , &c. ensorte qu'il est vrai de dire que la légende dans ces sortes de médailles ne nous apprend que le nom de la ville, ou celui du magistrat qui la gouvernoit, lorsque la médaille a été frappée.
Par-tout ailleurs les belles actions sont exprimées sur le revers, soit au naturel, soit par des symboles, dont la légende est l'explication. Au naturel, comme quand Trajan est représenté mettant la couronne sur la tête au roi des Parthes, rex Parthis datus. Par symbole, comme lorsque la victoire de Jules & d'Auguste est représentée par un crocodile enchaîné à un palmier avec ces mots, Egypto captâ. L'on voit aussi dans Hadrien toutes les provinces qui le reconnoissent pour leur réparateur, & ceux qui n'en connoîtroient pas les symboles, apprendroient à les distinguer par les légendes ; restitutori Galliae, restitutori Hispaniae, &c. Ainsi les différentes victoires désignées par des couronnes, par des palmes, par des trophées, & par de semblables marques qui sont d'elles-mêmes indifférentes, se trouvent déterminées par la légende, Asia subacta d'Auguste, Alemannia devicta de Constantin le jeune, Judaea capta de Vespasien, Armenia & Mesopotamia in potestatem populi romani redactae de Trajan, ou simplement, de Germanis, de Sarmatis, de Marc Aurele ; car les légendes les plus simples ont ordinairement le plus de dignité.
Mettant donc à part les légendes de la tête destinées à marquer le nom, soit tout seul, comme Brutus, Caesar, soit avec les qualités, ainsi que nous venons de le dire ; les autres légendes ne doivent être que des explications, des symboles, qui paroissent sur les médailles, par lesquelles on prétend faire connoître les vertus des princes, certains évenemens singuliers de leur vie, les honneurs qu'on leur a rendus, les avantages qu'ils ont procurés à l'état, les monumens de leur gloire, les déités qu'ils ont le plus honorées, & dont ils ont cru avoir reçu une protection particuliere : car les revers n'étant chargés que de ces sortes de choses, les légendes y ont un rapport essentiel ; elles sont comme la clef des types, que l'on auroit bien de la peine à deviner sans leur secours, sur-tout dans les siecles éloignés, & dans des pays où les usages sont tout différens de ceux des anciens.
C'est en cela qu'excellent les médailles du haut empire, dont les types sont toûjours choisis & appliqués par quelque bonne raison que la légende nous découvre : au lieu que dans le bas empire on ne cesse de répéter les mêmes types & les mêmes légendes ; & l'on voit que les uns & les autres sont donnés indifféremment à tous les empereurs, plutôt par coutume que par mérite. Témoin le gloria exercitus, felix temporum renovatio.
Comme les vertus qui rendent les princes plus aimables & plus estimables à leurs peuples, sont aussi ce que les revers de leurs médailles représentent ordinairement, les légendes les plus communes sont celles qui font connoître ces vertus, tantôt par leur simple nom, comme dans ces revers de Tibere qu'il méritoit si mal, moderationi, clementiae, justitiae ; tantôt en les appliquant aux princes, ou par le nominatif ou par le génitif, spes Augusta, ou spes Augusti ; constantia Augusta, ou constantia Augusti, gardant aussi indifféremment le même régime à l'égard de la vertu même : virtus Aug. ou virtuti Aug. clementia, ou clementiae, &c.
Les honneurs rendus aux princes consistent particulierement dans les surnoms glorieux qu'on leur a donnés, pour marquer ou leurs actions les plus mémorables, ou leurs plus éminentes vertus ; c'est ainsi que je les distingue des monumens publics qui doivent être les témoins durables de leur gloire. Ces surnoms ne peuvent être exprimés que par la légende, soit du côté de la tête, soit du côté du revers.
Quant aux honneurs rendus aux princes après la mort, qui consistoient à les placer au rang des dieux, nous les connoissons par le mot de consecratio, par celui de pater, de divus, & de Deus. Divo pio, divus Augustus pater, Deo & Domino caro. Quelquefois autour des temples & des autels on mettoit memoria felix, ou memoriae aeternae. Quelquefois sur les médailles des princesses on lit aeternitas, ou syderibus recepta ; & du côté de la tête diva, ou en grec .
Les légendes qui expriment les bienfaits répandus sur les villes, sur les provinces, & sur l'empire, sont ordinairement fort courtes & fort simples ; mais elles ne laissent pas d'être magnifiques. Par exemple, conservator urbis suae, ampliator civium, fundator pacis, rector orbis, restitutor urbis, Hispaniae, Galliae, &c. pacator orbis, salus generis humani, gaudium reipublicae, gloria rom. hilaritas pop. rom. laetitia fundata, tellus stabilita, exuperator omnium gentium, gloria orbis terrae, bono reipublicae nati, gloria novi saeculi. Quelquefois la maniere en est encore plus vive, comme Roma renascens, & Roma renasces ; Roma resurgens, libertas restituta.
Les bienfaits plus particuliers sont quelquefois exprimés plus distinctement dans les légendes, comme restitutor monetae, remissa ducentesima, quadragesima remissa, vehiculatione Italiae remissa ; fisci judaïci calumnia sublata, congiarium pop. rom. datum, puellae faustinianae, via trajana, indulgentia in Carthaginenses, reliqua vetera H. S. novies millies abolita, c'est-à-dire douze millions, plebei urbanae frumento constituto. Telles sont les légendes de plusieurs médailles d'Alexandre Sévere, de Caligula, de Domitien, de Septime Sévere, d'Hadrien & de Nerva.
On distingue encore par les légendes, les évenemens particuliers à chaque province, lors même qu'ils ne sont représentés que par des symboles communs. Par exemple, une Victoire avec un trophée, une palme ou une couronne désignent une médaille de Vespasien, & sont déterminées par le mot victoria germanica, à signifier une victoire remportée sur les Germains ; il en est de même de ces autres légendes, victoria navalis, victoria parthica, praetoriani recepti, imperatore recepto, qu'on voit sur les médailles de Marc-Aurele. La légende nous marque la réception glorieuse que firent à Claude les soldats de son armée. La grace que l'on fit à Néron de l'aggréger dans tous les colleges sacerdotaux, a été conservée par celles-ci : sacerdos cooptatus in omnia collegia suprà numerum ; dans cet autre, pax fundata cum Persis, l'empereur Philippes nous a laissé un monument de la paix qu'il fit avec les Perses. La merveille qui arriva à Tarragone, lorsque de l'autel d'Auguste l'on vit sortir une palme, nous est connue par une médaille sur laquelle on voit le type du miracle, & les quatre lettres C. V. T. T. Colonia victrix togata, ou plutôt turrita Tarraco ; l'empereur Tibere fit à ce sujet une agréable raillerie, que Suetone rapporte.
Les monumens publics sont aussi connus & distingués par la légende, desorte que ceux qui ont été construits par le prince même, sont mis au nominatif ou au génitif, ou exprimés par un verbe, au lieu que ceux que l'on a bâtis ou consacrés en leur honneur sont mis au datif. Marcellum Augusti. Basilica Ulpia. Aqua Martia. Portus Ostiensis. Forum Trajani. Templum divi Augusti restitutum ; parce que ces édifices ont été élevés par Néron, par Trajan, par Antonin : au lieu que nous voyons Romae & Augusto, Jovi Deo, Divo Pio, Optimo Principi ; pour marquer les temples en l'honneur d'Auguste, & les colonnes élevées pour Antonin & pour Trajan.
L'attachement que les princes ont eu à certaines déités, & les titres sous lesquels ils les ont honorées en reconnoissance de leur protection en général, ou de quelques graces particulieres, nous est connue par les manieres différentes dont la légende est exprimée. Nous savons que Numérien honoroit singulierement Mercure, parce que ce dieu est au revers de la médaille avec ce mot Pietas Aug. Nous connoissons que Dioclétien honoroit Jupiter comme son protecteur, parce que nous voyons sur des médailles Jovi Conservatori, Jovi Propugnatori, & même le surnom de Jovius ; que Gordien attribuoit à ce dieu le succès d'une bataille où ses gens n'avoient point lâché le pié, Jovi Statori.
Sur les médailles des princesses, on mettoit l'image & le nom des déités de leur sexe, Cerès, Juno, Vesta, Venus, Diana. On marquoit le bonheur de leur mariage par Venus Felix ; la reconnoissance qu'elles avoient de leurs couches heureuses & de leur fécondité, Junoni Lucinae, Veneri genitrici.
La bonne fortune des princes qui a toujours été leur principale déité, se trouve aussi le plus souvent sur leurs médailles en toutes sortes de manieres : Fortuna Augusta, Perpetua. Fortunae Felici, Muliebri. Fortuna manens, Fortuna obsequens, Fortuna Redux, où le nom de la Fortune est indifféremment par le nominatif, par le datif, ou par l'accusatif : car nous voyons également Mars, Victor, Marti Ultori, Martem Propugnatorem, & même Martis Ultoris : mais cette derniere légende se rapporte au temple bâti pour vanger la mort de Jules, ce qui fait une différence notable.
Il ne faut pas oublier ici que les noms exprimés dans les légendes se lisent quelquefois au nominatif, Caesar Augustus, quelquefois au génitif Divi Julii, enfin au datif Imp. Nervae Trajano Germanico, &c. ou à l'accusatif , &c. On ne trouve guere d'exemples de l'accusatif sur les médailles latines, que dans celles de Galien, Gallienum Aug. au revers Ob conservationem salutis.
Ne parlons plus maintenant des personnes, mais des choses mêmes qui paroissent sur les médailles, où leurs noms & leurs qualités tiennent lieu de légende : je rangerai dans ce nombre,
1°. Les villes, les provinces, les rivieres, dont nous voyons les unes avec leur simple nom, Tiberis, Danuvius, Rhenus, Nilus, Aegyptos, Hispania, Italia, Dacia, Africa, Roma, Alexandrea, Valentia, Italica, Bilbilis. Les autres avec leurs titres particuliers, leurs qualités & leurs prérogatives : Colonia Julia Augusta, Felix Berytus. Colonia immunis illici Augusta. Colonia Aurelia. Metropolisidon. Colonia Prima Flavia Augusta Caesarensis. Municipium Ilerda, Celium Municipium Coillutanum Antoninianum.
Les villes grecques sur-tout étoient soigneuses d'exprimer les privileges dont elles jouissoient, . Pour marquer qu'elles étoient inviolables, c'est-à-dire qu'on ne pouvoit en retirer les criminels qui s'étoient réfugiés dans leurs murs, elles se qualifioient . Le droit qu'elles avoient conservé de se gouverner par leurs propres lois, s'exprimoit sur leurs médailles par le mot . Les villes qui n'étoient point soumises à la jurisdiction du magistrat envoyé de Rome pour gouverner la province dans laquelle elles étoient situées, s'appelloient libres, . C'est une observation du Marquis Mafféi. Le privilege d'avoir un port de mer & des vaisseaux se marquoit en légende sur les médailles par le mot . Celui d'être exempt des tributs & des impôts par le mot . Les privileges particuliers des colonies, tels que le droit du pays latin, ou le droit des citoyens romains par le mot . Ceux des Néocores, qu'elles étoient fort soigneuses. de marquer par les mots . Enfin les alliances qu'elles avoient avec d'autres villes, par le terme . Il faut consulter sur tous ces titres, les savantes remarques de M. Vaillant, dans son livre des médailles grecques, il seroit difficile d'y rien ajouter.
2°. Les légendes de médailles nous découvrent le nom des légions particulieres qui composoient les armées. Nous trouvons dans une médaille de M. Antoine, Leg. xxiv. dans une médaille du cabinet du P. Chamillart, qui est une médaille bien rare. La médaille qui porte Leg. I. l'est encore davantage ; car la plûpart de celles qu'on connoît, portoient dans leur origine un autre chiffre, & ne sont réduites à celui-ci que par la friponnerie de quelque brocanteur. Il est bon d'en avertir les curieux, pour qu'ils n'y soient pas trompés.
Les jeux publics marqués ordinairement par des vases, d'où il sort des palmes ou des couronnes, ne se distinguent que par la légende, qui contient ou le nom de celui qui les a institués, ou de celui en l'honneur duquel on les célébroit. Ainsi l'on apprend que Néron fut l'auteur des jeux qui se devoient donner à Rome de cinq en cinq ans, par la médaille où l'on lit, Certamen Quinquennale Romae Constitutum. Par la légende du revers de la médaille de Caracalla, ; on apprend qu'à Ancyre en Galatie on célébroit en l'honneur d'Esculape, dit le Sauveur, les mêmes jeux qui se célébroient dans l'isthme de Corinthe en l'honneur d'Apollon ; qu'on consulte là-dessus les lettres de Spanheim, publiées par M. Morel dans le projet qu'il nous a donné du plus beau dessein qu'on ait jamais formé pour la satisfaction des curieux.
On trouvera dans ce projet, Speciem universae rei nummariae, les légendes qui expriment les principaux jeux des anciens, & les savantes remarques que M. de Spanheim a faites sur ce sujet ; on nommoit , ceux qui se faisoient à Thessalonique en l'honneur des Cabires ; , ceux qui se célébroient principalement en Sicile, pour honorer le mariage de Proserpine & de Pluton ; , ceux qui avoient été institués par Septime Severe ; , ceux qu'on faisoit par l'ordre de Commode, &c. On trouve aussi les jeux marqués sur les médailles latines avec le tems de leur célébration. Nous avons sur la médaille de Memmius, Ced. Cerialia primus fecit. Nous trouvons sur-tout des jeux séculaires qui se célébroient à la fin de chaque siecle, marqués avec grand soin sur les médailles, Ludos Saeculares Fecit, dans celles de Domitien ; Saeculares Aug. ou Augg. dans Philippe ; &c. Les types en sont différens ; tantôt ils expriment des sacrifices, tantôt des combats, tantôt des animaux extraordinaires, dont on donnoit le spectacle au peuple dans ces jeux.
4°. Les voeux publics pour les empereurs, & qui sont marqués sur plusieurs médailles, soit en légende, soit en inscription, ont fait nommer ces sortes de médailles médailles votives. Voyez MEDAILLES VOTIVES.
5°. L'une des choses les plus curieuses que les médailles nous apprennent par les légendes, ce sont les différens titres que les empereurs ont pris, selon qu'ils ont vu leur puissance plus ou moins affermie. Jules-César n'osa jamais revêtir ni le titre de roi, ni celui de seigneur, il se contenta de celui d'Imperator, Dictator perpetuus, Pater Patriae. Ses successeurs réunirent insensiblement à leur dignité le pouvoir de toutes les charges. On les vit souverains pontifes, tribuns, consuls, proconsuls, censeurs, augures. Je ne parle que des magistratures ; car, pour les qualités, elles devinrent arbitraires, & le peuple s'accoutumant peu-à-peu à la servitude, laissa prendre au souverain tel nom que bon lui sembla, même ceux des divinités qu'il adoroit : témoin Hercules Romanus, dans Commode ; Sol Dominus Imperii Romani, dans Aurélien ; si toutefois ce nom est donné au prince, & non pas au soleil même, qui se trouve si souvent sur les médailles, Soli invicto Comiti.
Auguste ne se nomma d'abord que Caesar Divi Filius, & puis Imperator, ensuite Triumvir Reipublicae Constituendae, ensuite Augustus ; enfin il y ajouta la puissance de tribun qui le faisoit souverain. Caligula garda les trois noms, Imp. Caes. Aug. Claude y ajouta le titre de Censor. Domitien se fit Censor Perpetuus, sans que depuis lui on puisse rencontrer cette qualité sur les médailles. Aurélien, ou, selon d'autres Oemilien, s'arrogea le titre de Dominus, que les provinces accorderent à Septime Severe & à ses enfans. Après Carus, cette qualité devint commune à tous les empereurs, jusqu'à ce que ceux d'Orient prirent le nom de rois des Romains, . Il est bon d'apprendre ici que les Grecs donnerent quelquefois ce même nom aux Césars, quoiqu'ils n'ayent jamais souffert qu'ils prissent celui de Rex en latin. Le titre de Nobilissimus Caesar donné au prince destiné à l'empire, ne se vit pas pour la premiere fois sur les médailles de Philippe le jeune, comme tous les antiquaires l'ont cru ; M. l'abbé Belley prouve dans l'histoire de l'acad. des Inscrip. que ce titre parut dès le regne de Macrin sur les médailles de Diaduménien.
L'ambition des princes grecs & la flatterie de leurs sujets nous fournissent sur leurs médailles une grande quantité de titres, qui sont inconnus aux empereurs latins, , Nicator, Nicephorus, Evergetes, Eupator, Soter, Epiphanes, Cezaunus, Callinicus, Dionysius, Theopator. Ils ont été aussi bien moins scrupuleux que les Latins à se faire donner le nom de dieu. Démétrius s'étant appellé, , Antiochus, ; un autre Démétrius, . Ils ne faisoient pas non plus difficulté d'adopter les symboles des divinités, comme le foudre & les cornes de Jupiter Hammon, avec la peau de lion d'Hercule. Tous les successeurs d'Alexandre s'en firent même un point d'honneur.
Les princesses reçurent la qualité d'Augusta dès le haut empire, Julia Augusta, Antonia Agrippina, &c. On la trouve même sur les médailles de celles qui ne furent jamais femmes d'empereurs, Julia Titi, Marciana, Matidia, &c. Le titre de Mater Senatus & Mater Patriae se voient sur les médailles d'or & d'argent, de grand & de moyen bronze de Julie, femme de Septime Severe, dont le revers représente une femme assise, ou une femme debout, tenant d'une main un rameau, & de l'autre un bâton ou une haste, avec ces mots en abrégé, Mat. Augg. Mat. Sen. Mat. Pat.
6°. Les alliances se trouvent aussi marquées dans les légendes à la suite des noms, & non seulement les alliances par adoption qui donnoient droit de porter le nom de fils, mais celles mêmes qui ne procuroient que le titre de neveu & de niece. Nous n'entrerons point dans ce détail assez connu, ce qui d'ailleurs seroit long & ennuyeux.
7°. Les légendes nous découvrent encore le peu de tems que duroit la reconnoissance de ceux qui ayant reçu l'empire de leur pere, de leur mere, ou de leur prédecesseur qui les avoit adoptés, quittoient bientôt après le nom & la qualité de fils qu'ils avoient pris d'abord avec empressement. Trajan joignit à son nom celui de Nerva qui l'avoit adopté, mais peu de tems après il ne porta plus que celui de Trajan. D'abord c'étoit Nerva Trajanus Hadrianus, bientôt ce fut Hadrianus tout seul : & le bon Antonin, qui s'appelloit au commencement de son regne Titus Aelius Hadrianus Antoninus, s'appella peu après Antoninus Augustus Pius ; cependant la vanité & l'ambition leur faisoit quelquefois garder des noms auxquels ils n'avoient aucun droit, ni par le sang, ni par le mérite. Ainsi celui d'Antonin a été porté par six empereurs jusqu'à Eliogabale : celui de Trajan par Dèce, &c.
Ces noms propres devenus communs à plusieurs, ont causé beaucoup d'embarras aux antiquaires ; parce que ces sortes de médailles ne portent aucune époque, au lieu que les médailles grecques, beaucoup plus exactes, portent les surnoms, & marquent les années, & par-là facilitent extrèmement la connoissance de certains rois, dont on n'auroit jamais bien débrouillé l'histoire sans ce secours, comme les Antiochus, les Ptolomées, & les autres.
8°. N'oublions pas d'ajouter que dans les légendes des médailles, on trouve souvent le nom du magistrat sous lequel elles ont été frappées. M. Vaillant s'est donné la peine de faire le recueil des divers noms de magistrature grecque énoncés sur les médailles, & d'expliquer les fonctions de ces différentes charges. Dans les médailles de colonies latines, on voit les noms des duumvirs à l'ablatif.
Il est tems de parler de la position de la légende. L'ordre naturel qui la distingue de l'inscription est qu'elle soit posée sur le tour de la médaille, au-dedans du grenetis en commençant de la gauche à la droite, & cela généralement dans toutes depuis Nerva. Mais, dans les médailles des douze Césars, il est assez ordinaire de les trouver marquées de la droite à la gauche, ou même partie à gauche, partie à droite.
Il y en a qui ne sont que dans l'exergue, De Germanis, De Sarmatis, &c. Il y en a qui sont en deux lignes paralleles, l'une au-dessus du type, & l'autre au-dessous, comme dans Jules. Il y en a dans le même empereur posées en-travers, & comme en sautoir. Il y en a en pal, comme dans une médaille de Jules ; où la tête de Marc-Antoine sert de revers. Il y en a au milieu du champ, coupées par la figure comme dans un revers de Marc-Antoine, qui représente un fort beau trophée. On voit un autre revers du même, où un grand palmier au milieu d'une couronne de lierre coupe ces mots, Alexand. Aegyp. Enfin il y en a en baudrier, comme dans Jules ; tout cela prouve que la chose a toujours dépendu de la fantaisie de l'ouvrier.
C'est particulierement sur les grandes médailles grecques qu'on trouve les positions de légendes les plus bisarres, sur-tout quand il y a plus d'un cercle. Il n'est point de maniere de placer, de trancher, de partager les mots & de séparer les lettres que l'on n'y rencontre : ce qui donne bien de la peine à ceux qui ne sont pas assez intelligens pour les bien démêler.
On pourroit être trompé à certaines médailles où la légende est écrite à la maniere des Hébreux, les lettres posées de la droite à la gauche. Celle du roi Gelas est de cette sorte . Quelques-unes de Palerme & d'autres de Césarée, c'est ce qui a fait croire à quelques-uns que l'on avoit autrefois nommé Césarée, , au lieu de Flavia, . La médaille de Lipari est du même genre ; on a été longtems sans l'entendre, parce qu'on y lit pour .
Il ne paroît donc pas que les anciens ayent suivi de regles fixes dans la maniere de placer les légendes sur les médailles, & de plus toutes leurs médailles n'ont pas des légendes ; car encore qu'il soit vrai que la légende est l'ame de la médaille, il se trouve cependant quelques corps sans ames, non seulement dans les consulaires, mais aussi dans les impériales, c'est-à-dire, des médailles sans légende ni du côté de la tête, ni du côté du revers ; par exemple, dans la famille Julia, la tête de Jules se trouve souvent sans légende. On voit aussi des revers sans légende, & sur-tout dans cette même famille. Une médaille qui porte d'un côté la tête de la piété avec la cigogne, & de l'autre une couronne qui enferme un bâton augural & un vase de sacrificateur, est sans aucune légende.
Il s'en trouve qui ne sont que demi-animées, pour parler ainsi, parce que l'un des côtés est sans légende, tantôt celui de la tête & tantôt celui du revers. Nous avons plusieurs têtes d'Auguste sans inscription, comme celle qui porte au revers la statue équestre que le sénat fit ériger en son honneur, avec ce mot ; Caesar Divi filius. Nous avons aussi une infinité de revers sans légende ; quelquefois même des revers considérables pour la singularité du type, & pour le nombre des figures ; je crois qu'on peut mettre dans ce nombre ceux qui ne portent que le nom du monétaire, ou le simple S. C. puisque ni ce nom, ni ces lettres ne contribuent en rien à expliquer le type. Telles que sont trois ou quatre belles médailles de Pompée, avec des revers très curieux, qui n'ont que le nom de M. Minatius Sabinus proquestor. Deux de Jules César, dont l'une chargée d'un globe, de faisceaux, d'une hache, d'un caducée & de deux mains jointes, n'a que le nom L. Buca. L'autre qui porte une aigle militaire, une figure assise tenant une branche de laurier ou d'olivier, couronnée par derriere par une Victoire en pié, n'a que ex S. C. Une de Galba, dont le revers est une allocution de six figures, que quelques-uns croyent marquer l'adoption de Pison, se trouve aussi sans aucune légende. Les savans disent que le coin est moderne, & que la véritable médaille porte Allocutio.
Pour celles qui se trouvent avec les seules légendes sans tête, on les met dans la classe des inconnues ou des médailles incertaines, & on les abandonne aux conjectures des savans. Voyez MEDAILLE sans tête.
Il manqueroit quelque chose d'important à ce discours ; si je ne disois rien des deux langues savantes, la latine & la greque, dans lesquelles sont écrites les légendes & les inscriptions des médailles antiques.
Mais je dois observer d'abord que la langue ne suit pas toujours le pays, puisque nous voyons quantité de médailles impériales frappées en Grece ou dans les Gaules, dont les légendes sont en latin ; car le latin a toujours été la langue dominante dans tous les pays où les Romains ont été les maîtres ; & depuis même que le latin est devenu une langue morte, par la destruction de la monarchie romaine, il ne laisse pas de se conserver pour tous les monumens publics & pour toutes les monnoies considérables dans tous les états de l'Empire chrétien.
Il y a des médailles frappées dans les colonies, dont la tête porte l'inscription en latin, & le revers l'inscription en grec. Le P. Jobert parle d'un Hosticien M. B. qui d'un côté porte , avec la tête du prince rayonnée, & de l'autre côté Col. P. T. Caes. Metr. La tête du génie de la ville est surmontée d'un petit château tout entier ; c'est Césarée de Palestine. Enfin, les médailles, dont les légendes sont en deux langues différentes, ne sont pas extrèmement rares ; témoin celles d'Antioche, où l'on trouve des légendes latines du côté des têtes de Claude, de Néron & de Galba, & des légendes grecques au revers.
Le grec est, comme je l'ai dit, l'autre langue savante dont on s'est servi le plus universellement sur les médailles. Les Romains ont toujours eu du respect pour cette langue, & se sont fait une gloire de l'entendre & de la parler. C'est pourquoi ils n'ont pas trouvé mauvais que non seulement les villes de l'Orient, mais toutes celles où il y avoit eu des Grecs, la conservassent sur leurs médailles. Ainsi les médailles de Sicile & de plusieurs villes d'Italie ; celles des Provinces, & de tout le pays qu'on appelloit la grande Grèce, portent toutes des légendes greques, & ces sortes de médailles font une partie si considérable de la science des Antiquaires, qu'il est impossible d'être un parfait curieux, si l'on n'entend le grec comme le latin, & l'ancienne Géographie aussi-bien que la nouvelle.
Il ne nous reste plus, pour complete r cet article, qu'à faire quelques observations sur les lettres initiales des légendes.
1°. Il paroît qu'à proprement parler, les lettres initiales sont celles qui étant uniques, signifient un mot entier. Dès qu'on en joint plusieurs ce sont des abréviations, non pas des initiales : P. P. Aug. signifie Perpetuus Augustus par abréviation ; T. P. signifie tribunitia potestate par des initiales : Tr. Pot. le dit par abréviation : V. P. exprime vota populi par initiales : Vot. Po. par abréviation. Or dans un grand nombre de lettres, il n'est pas aisé de deviner celles qui doivent être jointes ensemble, & celles qui doivent demeurer seules ; & je ne crois pas qu'on puisse donner sur cela de regle certaine.
2°. L'usage des lettres initiales est de tous les tems & de toutes les nations depuis qu'on a commencé à écrire. Les Latins, les Grecs, les Hébreux, s'en sont servis, témoin l'arrêt fatal qui fut prononcé au roi Baltazar par trois lettres initiales, Man, Thau, Phe, que Daniel seul put expliquer, Mane, Thecel, Phares. On en a fait usage principalement sur les médailles, à cause du peu d'espace qu'il y a pour exprimer les légendes, la multiplicité des prénoms, des surnoms, des titres & des charges, n'a pu se marquer autrement, non pas même sur le G. B. La nécessité a été encore plus grande dans les longues inscriptions ; c'est pourquoi il n'est pas possible de donner aucun précepte : la vûe seule de plusieurs médailles & des inscriptions où les mots se lisent tout au long, en peut faciliter la connoissance. Ainsi personne ne doute que S. C. ne signifie senatus consulto, & que S. P. Q. R. ne signifie senatus, populusque romanus. On convient aussi que I. O. M. veut dire Jovi optimo, maximo ; mais on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ces deux lettres qui peuvent également signifier , tribunitia potestate, decreto provinciae, voto publico.
3°. Si l'on avoit toujours ponctué exactement les lettres initiales, il seroit aisé de les reconnoître, & de distinguer quand il en faut joindre quelques-unes ensemble pour un même mot : mais parce qu'on a souvent négligé de le faire, particulierement dans le bas empire & sur les petites médailles, on n'y trouve pas la même facilité. On dit, sans se tromper D. N. V. L. Licinius : dominus noster Valerius Licinianus Licinius ; mais il faut savoir d'ailleurs que DDNNIOVLICINVAUG & CAES. sur la médaille où les deux bustes sont affrontés, signifie domini nostri Jovii Licinii invicti Augustus & Caesar. Delà est venue la liberté qu'on s'est donnée de prendre pour des lettres initiales celles qui ne le sont point, & de faire plusieurs mots d'un seul : dans Con. Constantinopoli, on veut trouver civitates omnes Narbonenses, &c.
4°. Je crois qu'on peut donner pour constant, que toutes les fois que plusieurs lettres jointes ensemble ne forment aucun mot intelligible, il faut conclure que ce sont des initiales ; & que lorsque les mots ont quelques sens, il ne faut pas les séparer pour en faire plusieurs mots.
5°. Quand plusieurs lettres ne peuvent former aucun mot, & que ce sont clairement des lettres initiales, il s'agit d'en découvrir la signification. La difficulté ne consisteroit pas tant à donner un sens aux légendes les plus embarrassantes, puisqu'il suffiroit pour cela de se livrer à toutes les conjectures qui peuvent s'offrir à l'esprit d'un antiquaire exercé & ingénieux. Mais il ne seroit pas si aisé de faire adopter ces conjectures par des personnes accoutumées à demander des preuves de ce qu'on prétend leur persuader ; aussi la plûpart des explications paroissent peu vraisemblables au plus grand nombre des Savans. C'est ainsi que la priere à Jesus-Christ, que le P. Hardouin trouvoit le secret de lire sur la médaille de Decentius, n'est aux yeux d'un autre savant Jésuite, Froelich (diss. de numm. monet. culp. vitios. cap. ij. p. 381.) qu'une pure imagination uniquement fondée sur l'arrangement bizarre de quelques lettres transposées par l'ignorance de l'ouvrier qui a gravé le coin.
Il ne faut pas se persuader que les monétaires ayent été si savans, qu'ils n'ayent fait quelquefois de très-grosses fautes dans les légendes. Nous en avons en particulier des preuves trop évidentes sur certaines médailles frappées hors d'Italie, comme celles des Tetricus. &c. Ces méprises venoient, tantôt de précipitation, tantôt de ce que les ouvriers ne savoient pas assez le latin ou le grec, tantôt encore de ce que ceux qui leur donnoient des légendes, ne les écrivoient pas assez distinctement.
N'oublions pas de remarquer, en finissant cet article, qu'il y a des medailles dans la légende desquelles on lit le mot restitut. entier ou abrégé rest. On nomme ces médailles, médailles de restitution, ou médailles restituées. Voyez-en l'article. (D.J.)
|
| LÉGEREMENT | adv. ce mot en Musique indique un mouvement encore plus vif que le gai, un mouvement moyen entre le gai & le vîte. Il répond à-peu-près à l'Italien vivace. (S)
|
| LÉGERETÉ | S. f. (Phys.) privation ou défaut de pesanteur dans un corps, comparé avec un autre plus pesant. Voyez POIDS. En ce sens, la légereté est opposée à la pesanteur. V. PESANTEUR & GRAVITE.
L'expérience démontre que tous les corps sont pesans, c'est-à-dire tendent naturellement au centre de la terre, ou vers des points qui en sont très-proches. Il n'y a donc point de légereté positive & absolue, mais seulement une légereté relative, qui ne signifie qu'une pesanteur moindre.
Archimede a démontré, & on démontre dans l'Hydrostatique, qu'un corps solide s'arrêtera où on voudra dans un fluide de même pesanteur spécifique que lui, & qu'un corps plus léger s'élevera dans le même fluide. La raison en est que les corps qui sont dits d'une même pesanteur spécifique, sont ceux qui sous les mêmes dimensions ou le même volume, ne contiennent pas plus de pores ou d'intervalles destitués de matiere l'un que l'autre ; & par conséquent qui sous les mêmes dimensions renferment un même nombre de parties ; concevant donc que le solide & le fluide de même pesanteur spécifique soient divisés en un même nombre de parties égales, quelque grand que soit ce nombre, il n'y aura point de raison pour qu'une partie du solide fasse descendre une partie du fluide, qu'on ne puisse alléguer aussi pour qu'elle la fasse monter, & il en sera de même du solide total par rapport à une portion du fluide de même volume ; & comme ce solide ne sauroit en effet descendre sans faire élever un volume de fluide égal à celui qu'il déplaceroit, il s'ensuit de-là qu'il n'y a pas plus de raison pour que le solide descende, qu'il n'y en a pour qu'il monte ; & comme il n'y a pas non plus de raison pour qu'il se meuve latéralement plutôt à droite qu'à gauche, il s'ensuit enfin qu'il restera toûjours dans la place où on l'aura mis.
De-là on voit qu'un corps qui pese moins qu'un égal volume d'eau, doit être repoussé en-haut dès qu'il est placé dans l'eau ; car si ce corps étoit aussi pesant qu'un égal volume d'eau, il resteroit en la place où on le met, comme on vient de le voir. Or comme il est moins pesant par l'hypothèse qu'un égal volume d'eau, on peut supposer qu'il soit poussé en en-bas par une pesanteur égale à celle d'un pareil volume d'eau, & en en-haut par une pesanteur égale à l'excès de la pesanteur de ce volume d'eau sur celle du corps. Donc comme l'effet de la premiere de ces forces est détruit, il ne restera que la seconde qui fera par conséquent monter le corps en en-haut.
En général un corps est dit d'autant plus léger, que son poids est moindre ; & ce poids est proportionnel à la quantité de matiere qu'il contient, comme M. Newton l'a démontré. Voyez DESCENTE & FLUIDE, &c.
Les corps qui sous les mêmes dimensions ou le même volume ne pesent point également, ne doivent point contenir des portions égales de matiere. Ainsi lorsque nous voyons qu'un cube d'or s'enfonce dans l'eau, & qu'un cube de liége y surnage, nous sommes en droit de conclure que le cube d'or contient plus de parties que le même volume de liége, ou que le liége a plus de pores, c'est-à-dire de cavités destituées de matiere, que l'or ; nous pouvons assurer de plus, qu'il y a dans l'eau plus de ces vuides que dans un volume égal d'or, & moins que dans un même volume de liége. Voyez HYDROSTATIQUE & BALANCE.
Cela nous donne tout-à-la-fois une idée claire, soit de la pesanteur des corps, qui est la suite de leur densité, soit de leur légereté, & nous fait connoître que la derniere ne peut pas être regardée comme quelque chose de positif, mais que c'est une pure négation ou une absence de parties qui fait appeller un corps plus léger qu'un autre, lequel contient plus de matiere que lui.
Il est vrai que le docteur Hook semble soutenir qu'il y a une légereté positive ; c'est, si nous ne nous trompons, ce qu'il entend par le terme de lévitation, qui ne peut signifier autre chose qu'une propriété des corps directement contraire à celle qui les fait graviter.
Il croit avoir découvert cette propriété dans le cours de quelques cometes, qui devant descendre vers le soleil, s'en sont cependant retournées tout-à-coup en fuyant, pour ainsi dire, cet astre, quoiqu'elles en fussent à une prodigieuse distance, & sans que leur cours l'eût encore embrassé.
Mais cette apparence vient de la situation des cometes par rapport à la terre, & du mouvement de la terre dans son orbite combiné avec celui de la comete, & non d'aucun principe de répulsion. Car la comete est toûjours poussée vers le soleil par une force centrale ou centripete qui lui fait décrire une ellipse fort excentrique dont le soleil occupe le foyer. Voyez COMETE.
Quoi qu'il en soit, il pourroit n'être pas impossible qu'il y eût dans la nature une espece de légereté absolue ; car, selon M. Newton, où cesse la force de la gravitation, là paroîtroit devoir commencer une force contraire, & cette derniere force paroît se manifester dans quelques phénomenes. C'est ce que M. Newton a appellé vis repellens, & qui paroît être une des lois de la nature, sans laquelle il seroit difficile, selon lui, d'expliquer la raréfaction, & quelques autres effets physiques.
Nous avouerons cependant que les preuves sur lesquelles M. Newton cherche à établir cette force, ne nous paroissent pas fort convaincantes, & que ses raisonnemens sur ce sujet sont plus mathématiques que physiques. De ce qu'une quantité mathématique après avoir été positive, devient négative, s'ensuit-il qu'il en doit être la même chose des forces qui agissent dans la nature ? c'est conclure, ce me semble, de l'abstrait au réel, que de tirer cette conséquence. Voyez REPULSION. (O)
LEGERETE, (Mor.) ce mot a deux sens ; il se prend pour le contraire de grave, d'important ; & c'est dans ce sens qu'on dit de legers services, des fautes legeres. Dans l'autre sens, légereté est le caractere des hommes qui ne tiennent fortement ni à leurs principes, ni à leurs habitudes, & que l'intérêt du moment décide. On nomme des légeretés les actions qui sont l'effet de ce caractere : légereté dans l'esprit est quelquefois prise en bonne part ; d'ordinaire elle exclud la suite, la profondeur, l'application ; mais elle n'exclud pas la sagacité, la vivacité ; & quand elle est accompagnée de quelque imagination, elle a de la grace.
|
| LEGIFRAT | S. m. (Hist. mod.) territoire ou district soumis à un légifere ; ce terme est employé dans quelques auteurs suédois. Un roi de Suede ne pouvoit entrer autrefois dans un légifrat sans garde ; on l'accompagnoit aussi en sortant jusque sur la frontiere d'un autre légifrat. Les peuples lui présentoient comme un hommage les sages précautions qu'ils prenoient pour la conservation de leur liberté.
|
| LÉGION | S. f. (Art milit. des Romains) on formoit chez les Romains avec des soldats qui n'avoient que leurs bras pour tout bien, selon l'expression de Valere-Maxime, les corps de troupes appellés légions, du mot latin legere, choisir ; parce que quand on levoit des légions, on faisoit un choix, dit Végece, de la jeunesse la plus propre à porter les armes ; ce qui s'appelloit delectum facere, au rapport de Varron.
Dans les commencemens de la république, les seuls citoyens romains inscrits au rôle des tributs, soit qu'ils habitassent Rome, ou qu'ils demeurassent à la campagne, formerent ces légions invincibles, qui rendirent ce peuple le maître du monde.
Les légions étoient composées d'infanterie & de cavalerie, dont le nombre a varié sans-cesse, de sorte qu'on ne doit pas être surpris, si les auteurs qui en ont parlé, paroissent se contredire, puisque leurs contradictions ne viennent que de la différence des tems.
D'abord, sous Romulus instituteur de ce corps, la légion n'étoit que de trois mille hommes d'infanterie, & de trois cent chevaux. Sous les consuls, elle fut long-tems de quatre mille, ou de quatre mille deux cent fantassins, & de trois cent chevaux. Vers l'an de Rome 412, elle étoit de cinq mille hommes d'infanterie. Pendant la guerre que Jules-César fit dans les Gaules, ses légions se trouverent encore à-peu-près composées du même nombre d'hommes. Sous Auguste, les légions avoient six mille cent fantassins, & sept cent vingt-six chevaux. A la mort de ce prince, elles n'étoient plus que de cinq mille hommes d'infanterie, & de six cent chevaux. Sous Tibere, elles revinrent à six mille hommes de pié, & six cent cavaliers. Comme Septime Severe imagina de former, à l'imitation des Macédoniens, une phalange ou bataillon quarré de trente mille hommes, composé de six légions, nous apprenons de ce trait d'histoire, que la légion étoit alors de cinq mille hommes. Sous les empereurs suivans, elle reprit l'ancien état qu'elle avoit sous Auguste.
Il résulte évidemment de ce détail, que pour connoître la force des armées romaines dans les différens tems, il faut être au fait du nombre des légions que Rome levoit, & du nombre d'hommes qui composoit chaque légion. Les variations ont été fort fréquentes sur ce dernier point ; elles l'ont été de même par rapport au premier, du-moins sous les empereurs ; car du tems de la république, le nombre des légions fut long-tems limité à quatre légions romaines, dont chaque consul commandoit deux, avec autant des alliés.
Quand Annibal se fut emparé de la citadelle de Cannes, on fit à Rome, dit Polybe, ce qui ne s'étoit pas encore fait ; on composa l'armée de huit légions chacune de cinq mille hommes, sans les alliés. C'étoient alors des légions soumises à l'état ; mais quand le luxe eut fait des progrès immenses dans Rome, & qu'il eut consumé le bien des particuliers, le magistrat comme le simple citoyen, l'officier, & le soldat, porterent leur servitude où ils crurent trouver leur intérêt.
Les légions de la république non-seulement augmenterent en nombre, mais devinrent les légions des grands & des chefs de parti ; & pour attacher le soldat à leur fortune, ils dissimulerent ses brigandages, & négligerent la discipline militaire, à laquelle leurs ancêtres devoient leurs conquêtes & la gloire de Rome.
Ajoutons que les légions ne furent composées de citoyens de la ville de Rome, que jusqu'à la destruction de Carthage ; car après la guerre des alliés, le droit de bourgeoisie romaine ayant été accordé à toutes les villes d'Italie, on rejetta sur elles la levée des troupes légionaires, & très-peu sur Rome.
Ces troupes néanmoins s'appellerent romaines, parce que les alliés participant aux mêmes priviléges que les citoyens de Rome, étoient incorporés dans la république.
Mais l'empire s'étant aggrandi de toutes parts, les villes d'Italie ne purent fournir le nombre d'hommes nécessaire à la multiplicité des légions que les empereurs établirent. Ils les formerent alors des troupes de toutes les provinces, & les distribuerent sur les frontieres, où on leur assigna des camps, castra, dont quelques-uns sont devenus des villes par succession de tems ; de-là tant de noms géographiques, où le mot castra se trouve inséré.
Il nous faut présentement indiquer les différentes parties & les différentes sortes de soldats dont la légion romaine étoit composée.
Romulus à qui Rome doit cet établissement, la divisa en dix corps, qu'on nommoit manipules, du nom de l'enseigne qui étoit à la tête de ces corps, & qui consistoit en une botte d'herbes, attachée au bout d'une gaule. Ces corps devinrent plus forts, à mesure que la légion le devint ; & toutefois lorsqu'on eut pris d'autres enseignes, ils ne laisserent pas de retenir ce premier nom de manipule.
On fit avec le tems une nouvelle division de la légion qui néanmoins fut toûjours de dix parties, mais qu'on appella cohortes, dont chacune étoit commandée par un tribun : chaque cohorte étoit composée de trois manipules, forts à proportion de la légion.
On attribue cette nouvelle division à Marius. Elle continua depuis d'être toujours la même, tant sous la république, que sous les empereurs. La légion étoit donc composée de trente manipules & de dix cohortes ou régimens, pour parler suivant nos usages, plus ou moins nombreuses, selon que la légion l'étoit.
Mais il faut remarquer que la premiere cohorte étoit plus forte du double, & qu'on y plaçoit les plus grands hommes ; les neuf autres cohortes étoient égales en nombre de soldats. Ces dix cohortes formoient dix bataillons, qui se rangeoient sur trois lignes. Si la légion étoit de six mille hommes la manipule étoit de deux cent hommes ou deux centuries.
Une légion étoit composée indépendamment des cavaliers, de quatre sortes de soldats, qui tous quatre avoient différent âge, différentes armes, & différens noms. On les appelloit vélites, hastaires, princes & triaires ; voyez VELITES, HASTAIRES, PRINCES & TRIAIRES, car ils méritent des articles séparés.
Les légions sous la république, étoient commandées par un des consuls & par leurs lieutenans. Sous les empereurs, elles étoient commandées par un officier général qu'on nommoit préfet, praefectus exercituum. Les tribuns militaires commandoient chacun deux cohortes, & portoient par distinction l'anneau d'or comme les chevaliers. Chaque manipule avoit pour capitaine un officier, qu'on appelloit ducentaire, quand la légion fut parvenue à six mille hommes d'infanterie : de même qu'on nommoit centurion, celui qui commandoit une centurie. Les tribuns militaires élisoient les centurions, & ceux-ci élisoient leur lieutenant, qu'on nommoit succenturion, & qu'on appella dans la suite option. Voyez OPTION.
Quant aux légions que les alliés fournissoient, ceux qui les commandoient étoient appellés préfets du tems de la république, mais ils étoient à la nomination des consuls ou des généraux d'armées.
Chaque légion avoit pour enseigne générale une aigle les aîles déployées, tenant un foudre dans ses serres. Elle étoit postée sur un petit pié-destal de même métal, au haut d'une pique ; cette figure étoit d'or ou d'argent, de la grosseur d'un pigeon. Celui qui la portoit, s'appelloit le porte-aigle, & sa garde ainsi que sa défense, étoit commise au premier centurion de la légion.
Ce fut Marius, selon Pline, liv. X. c. iv. qui choisit l'aigle seule pour l'enseigne générale des légions romaines ; car outre l'aigle, chaque cohorte avoit ses propres enseignes faites en forme de petites bannieres, d'une étoffe de pourpre, où il y avoit des dragons peints. Chaque manipule & chaque centurie avoit aussi ses enseignes particulieres de même couleur, sur lesquelles étoient des lettres pour désigner la légion, la cohorte & la centurie.
On distinguoit les légions par l'ordre de leur levée, comme premiere, deuxieme, troisieme, ou par les noms des empereurs auteurs de leur fondation, comme legio Augusta, Claudia, Flavia, Trajana, Ulpia, Gordiana, &c. Elles furent encore distinguées dans la suite par des épithetes qu'elles avoient méritées pour quelque belle action, comme celle qui fit surnommer une légion la foudroyante, une autre la victorieuse ; ou même pour quelque défaut qui lui étoit propre, comme la paillarde. Enfin elles retinrent quelquefois le nom des provinces où elles servoient, comme l'illyrienne, la macédonienne, la parthique, la gauloise, &c.
Il nous reste à parler de la cavalerie qui composoit chaque légion. On lui donnoit le nom d'aîle, parce qu'on la plaçoit ordinairement de maniere, qu'en couvrant les flancs elle en formoit les aîles. On la divisoit en dix parties ou brigades, autant qu'il y avoit de cohortes ; & chaque brigade étoit forte, à proportion du total de la cavalerie de la légion. Si elle passoit six cent chevaux, chaque aîle ou brigade étoit de deux turmes ou compagnies de trente-trois chevaux chacune. La turme se subdivisoit en trois décuries ou dixaines, qui avoient chacune un décurion à leur tête, dont le premier commandoit à toute la turme, & en son absence le second. On prenoit toujours un de ces premiers décurions, pour commander chaque aîle ou brigade, & en cette qualité il étoit appellé préfet de cavalerie ; il avoit rang au-dessus du petit tribun, ou comme nous dirions du colonel d'infanterie.
Toute la cavalerie romaine qu'établit Romulus dans les légions qu'il institua, ne consistoit qu'en trois cent jeunes hommes, qu'il choisit parmi les meilleures familles, & qu'on nommoit celeres ; c'est là l'origine des chevaliers romains. Servius Tullius porta ce nombre à dix-huit cent cavaliers, & en forma dix-huit centuries. Ils avoient un cheval fourni & entretenu aux dépens de l'état. Cependant cette cavalerie n'étant pas suffisante, on l'augmenta en faisant les levées pour les légions, mais on observa de la tirer d'entre les plébéïens aisés, parce qu'on les obligea de se fournir de montures à leurs dépens. Ils n'avoient encore point d'autres armes défensives qu'un mauvais bouclier de cuir de boeuf, & pour armes offensives qu'un foible javelot.
Mais comme on éprouva les desavantages de cette armure, on les arma à la grecque ; c'est-à-dire de toutes pieces ; leurs chevaux même étoient bardés au poitrail & aux flancs. Le cavalier avoit un casque ouvert, sur lequel étoit un grand panache de plume, ou un ornement relevé qui en tenoit lieu.
Une cotte de mailles ou à écaille le couvroit jusqu'au coude & descendoit jusqu'aux genoux ; avec des gantelets ou un épais bouclier.
Les armes offensives étoient une grosse javeline ferrée par les deux bouts, & une épée beaucoup plus longue que celle de l'infanterie ; c'est ainsi que Polybe, l. VI. c. jv. nous décrit l'armure de la cavalerie des légions romaines.
Elle ne se servoit point d'étriers, & n'avoit que des selles rases. Les cavaliers pour monter à cheval étoient obligés de se lancer dessus tout armés, & ils apprenoient à faire cet exercice à droite comme à gauche ; il n'étoit pas non plus d'usage de ferrer leurs chevaux, quoiqu'on le pratiquât pour les mules.
Parmi les légionnaires romains il n'y avoit point de cavalerie légere, elle n'étoit connue que dans leurs troupes auxiliaires, mais les empereurs en établirent sous le nom d'archers, lesquels pour être plus agiles, ne portoient aucune armure, & n'avoient que le carquois plein de fleches, l'arc & l'épée. Quant aux étendarts & cornettes de la cavalerie, on les distinguoit de celles de l'infanterie, par la couleur qui étoit bleue, & parce qu'elles étoient taillées en banderolles.
On mettoit sous la garde du premier capitaine les étendarts & cornettes de la cavalerie dans un asyle assuré, ainsi que les aigles ou drapeaux de l'infanterie étoient sous la garde du porte-aigle. Les cavaliers & les soldats des légions portoient leur argent en dépôt dans ces deux endroits. Végece, c. xx. l. II. nous apprend qu'on y déposoit encore la moitié des gratifications qu'on faisoit aux troupes, de peur qu'elles ne se dissipassent tout en débauches & en folles dépenses.
Ce furent les empereurs qui imaginerent l'usage de faire aux légions des donatifs, pour me servir des mêmes termes des auteurs. On partageoit ces donatifs en dix portions, une pour chaque cohorte, sur quoi toute la légion mettoit quelque chose à part dans un onzieme sac, pour la sépulture commune ; quand un soldat mouroit, on tiroit de ce sac dequoi faire ses funérailles.
Enfin, lorsque les légions avoient remporté quelque victoire, on ornoit de lauriers les aigles romaines, les étendarts de la cavalerie, les enseignes où étoit le portrait de l'empereur, & on faisoit brûler des parfums devant elles.
Voilà les particularités les plus importantes sur cette matiere ; je les ai recueillies avec quelque soin de Tite Live, de Denys d'Halicarnasse, de César, de Polybe, de Végece, de Frontin, & d'autres auteurs, en y mettant de l'ordre, j'ai pris pour guide des gens du métier. (D.J.)
LEGION FULMINANTE, (Hist. rom.) étoit une légion de l'armée romaine, & composée de soldats chrétiens qui, dans l'expédition de l'empereur Marc-Aurele contre les Sarmates, Quades & Marcomans, sauverent toute l'armée prette à périr de soif, & qui obtinrent par leurs prieres une pluie abondante pour l'armée romaine, tandis que l'ennemi essuyoit de l'autre côté une grêle furieuse, accompagnée de foudre & d'éclairs épouvantables.
C'est ainsi que les historiens ecclésiastiques rapportent ordinairement ce fait, & toute cette histoire est sculptée en bas-relief sur la colonne Antonine. C'est de-là qu'est venu le nom de fulminant, quoiqu'il y en ait qui prétendent que la légion composée de ces chrétiens, s'appelloit déja auparavant la légion fulminante. Voyez LEGION.
LEGION THEBEENNE, (Hist. eccl.) nom donné par quelques auteurs à une légion des armées romaines, qui résolue de ne point sacrifier aux idoles, souffrit le martyre sous les empereurs Dioclétien & Maximilien, vers l'an de J. C. 297.
Maximilien, disent ces auteurs, se trouvant à Octodurum, bourg des Alpes cottiennes dans le bas Vallais, aujourd'hui nommé Martinach, voulut obliger son armée de sacrifier aux fausses divinités. Les soldats de la légion thébéenne pour s'en dispenser, s'en allerent à huit milles de là à Agaunum, qu'on appelle à présent Saint-Maurice, du nom du chef de cette légion. L'empereur leur envoya dire de venir sacrifier, ils le refuserent nettement, & l'on les décima sans qu'ils fissent aucune résistance. Ensuite Maximilien répéta le même ordre aux soldats qui restoient ; même refus de leur part. On les massacra ; & tout armés qu'ils étoient & en état de résister, ils se présenterent à leurs persécuteurs la gorge nue, sans se prévaloir de leur nombre, & de la facilité qu'ils avoient de défendre leur vie à la pointe de leur épée. Comme leur ame n'étoit occupée que de la gloire de confesser le nom de celui qui avoit été mené à la boucherie sans ouvrir la bouche non plus qu'un agneau, ils se laisserent déchirer à des loups furieux.
Cependant toute la relation attendrissante du martyre de la légion thébéenne n'est qu'une pure fable. Le plaisir de grossir le nombre des martyrs, dit l'auteur moderne de l'Histoire universelle, a fait ajoûter des persécutions fausses & incroyables à celles qui n'ont été que trop réelles. Quand même il y auroit eû une légion thébéenne ou thébaine, ce qui est fort douteux, puisqu'elle n'est nommée dans aucun historien, comment Maximien Hercule auroit-il détruit une légion qu'il faisoit venir d'Orient dans les Gaules, pour y appaiser une sédition ? Pourquoi se seroit-il privé par un massacre horrible de six mille six cent soixante & six braves soldats dont il avoit besoin pour réprimer une grande révolte. Comment cette légion se trouva-t-elle toute composée de chrétiens martyrs, sans qu'il y en ait eu un seul, qui pour sauver sa vie, n'ait fait l'acte extérieur du sacrifice qu'on exigeoit ? A quel propos cette boucherie dans un tems où l'on ne persécutoit aucun chrétien, dans l'époque de la plus grande tranquillité de l'Eglise ? La profonde paix, & la liberté dont nous jouissions, dit Eusebe, nous jetta dans le relâchement. Cette profonde paix, cette entiére liberté s'accorde-t-elle avec le massacre de six mille six cent soixante-six soldats ? Si ce récit incroyable pouvoit être vrai, Eusebe l'eût-il passé sous silence ? Tant de martyrs ont scellé l'Evangile de leur sang, qu'on ne doit point faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas partagé leurs souffrances.
Il est certain que Dioclétien, dans les dernieres années de son empire, & Galerius ensuite, persécuterent violemment les chrétiens de l'Asie mineure & des contrées voisines ; mais dans les Gaules, dans les Espagnes & dans l'Angleterre, qui étoient alors le partage ou de Severe, ou de Constance Chlore, loin d'être poursuivis, ils virent leur religion dominante.
J'ajoûte à ces réflexions, que la premiere relation du martyre de la légion thébéenne, attribuée à saint Eucher évêque de Lyon, est une piéce supposée. Pour prouver que ce petit livre qu'on donne à ce bon évêque n'est point de lui, il suffit d'observer que saint Eucher finit ses jours en 454 ; & que dans son prétendu livre il y est fait mention de Sigismond roi de Bourgogne, comme mort depuis plusieurs années : or l'on sait que ce prince fut jetté dans un puits près d'Orléans, où il périt misérablement vers l'an 523.
On a démontré que les actes du concile d'Agaunum que Pierre François Chifflet a publié dans son édition de Paulin, sont aussi fictifs que ceux qu'ont suivi Surius & Baronius.
Les premieres écrivains qui ont parlé du martyre de la légion Thébéenne, sont Grégoire de Tours & Vénance Fortunat, qui liés d'une étroite amitié, vivoient tous deux sur la fin du vj. siecle. Mais, comme le cardinal Baronius en convient lui-même, il faut donner ces choses & plusieurs autres, d'une part à la crédulité de l'auteur des miracles de la vie des saints, & de l'autre à la simplicité de l'auteur du poëme de la vie de saint Martin.
S'il est encore quelqu'un qui desire une réfutation plus complete du roman de la légion thébéenne, nous le renverrons pour se convaincre à la fameuse dissertation de Dodwel, de paucitate martyrum, qui est la onzieme des dissertationes cyprianicae, imprimées à part ; & à la fin de l'édition de saint Cyprien, publiée par Jean Fell évêque d'Oxford. Que si ce quelqu'un crédule & amateur du merveilleux, n'entend pas le latin, nous pouvons pour lever ses doutes, lui recommander la lecture du savant petit ouvrage de M. du Bourdieu sur le martyre de la légion thébéenne. Cet écrit vit d'abord le jour en anglois en 1696, & a paru depuis traduit en françois en 1705. (D.J.)
LEGION, (Art numismat.) nom de certaines médailles.
Une légion, en terme de médaillistes, est une médaille qui a au revers deux signes ou étendarts militaires, une aigle romaine au milieu, & pour inscription, le nom de la légion, LEGIO I. II. X. XV. &c. Par exemple, ANT. AVG. III. VIR. RPC, un navire ; au revers deux signes appellés pila, & une aigle romaine au milieu, LEG. II. ou XV. &c. & une autre LEG. XVII CLASSICAE. Antoine est le premier, & Carausius le dernier sur les médailles desquelles on trouve des légions. Il y a jusqu'à la XXIVe. légion sur les médailles que nous possédons, mais pas au-delà. Voyez les recueils de Mezzabarba & du P. Banduri. Trévoux, Chambers.
LEGION, (Géog. anc.) ville de la Palestine, au pié du mont-Carmel, à 15 milles de Nazareth. Elle est célebre dans les écrits d'Eusebe & de St. Jérôme : c'est apparemment le même lieu qui est encore aujourd'hui nommé Légune. Les Romains y entretenoient une légion de soldats, pour garder le passage de Ptolomaïde à Césarée de Palestine ; c'étoit pour ainsi dire la clé du pays de ce côté-là. Il s'est donné plusieurs combats aux environs de cet endroit. (D.J.)
|
| LÉGIONAIRE | S. m. (Hist. anc.) soldats des légions romaines ; c'est le nom qu'on donnoit sur-tout aux fantassins, car les cavaliers retenoient le nom d'equites. On distinguoit dans chaque légion de quatre especes de soldats dans l'infanterie : les vélites, les hastaires, les princes & les triaires. Les vélites, autrement nommés antesignani, parce qu'on les plaçoit avant les enseignes, aux premiers rangs, & qu'ils commençoient le combat, étoient armés à la légere d'un petit bouclier rond, d'un pié & demi de diametre, & d'un petit casque d'un cuir fort ; du reste, sans armure pour être plus dispos. Leurs armes offensives étoient l'épée, le javelot & la fronde. Ils ne servoient que pour escarmoucher. Ils se rangeoient d'abord à la queue des troupes, & de-là, par les intervalles ménagés entre les cohortes, ils s'avançoient sur le front de la bataille pour harceler les ennemis ; mais dès qu'ils étoient une fois poussés, ils rentroient par les mêmes intervalles ; & de derriere les bataillons qui les couvroient, ils faisoient voler sur l'ennemi une grêle de pierres ou de traits. Ils étoient aussi chargés d'accompagner la cavalerie pour les expéditions brusques & les coups de main. On croit que les Romains n'instituerent les vélites dans leurs légions qu'après la seconde guerre punique, à l'exemple des Carthaginois, qui dans leur infanterie avoient beaucoup de frondeurs & de gens de trait. Selon Tite Live, il n'y avoit que 20 vélites par manipule ; ce qui faisoit soixante par cohorte, & six cent par légion, quand la légion étoit de six mille hommes. Avant qu'ils fussent admis, les soldats qui composoient l'infanterie légere, s'appelloient rorarii & accensi. On supprima les vélites quand on eut accordé le droit de bourgeoisie romaine à toute l'Italie ; mais on leur en substitua d'autres armés à la légere. Le second corps des légionaires étoient ceux qu'on nommoit hastaires, d'un gros javelot qu'ils lançoient, & que les Latins appellent hasta, arme différente de la pique punique : celle-ci est trop longue & trop pesante pour être lancée avec avantage. Ils étoient pesamment armés du casque, de la cuirasse & du bouclier, de l'épée espagnole & du poignard. Ils faisoient la premiere ligne de l'armée. Après eux venoient les princes, armés de même aussi-bien que les triaires, à l'exception que ceux-ci portoient une espece d'esponton court, dont le fer étoit long & fort. On les opposoit ordinairement à la cavalerie, parce que cette arme étoit plus de résistance que les javelines & les dards des princes & des hastaires. On donna aux triaires ce nom, parce qu'ils formoient la troisieme ligne & l'élite de l'armée : mais dans les nouveaux ordres de bataille qu'introduisit Marius, on plaça les triaires aux premiers rangs : c'étoient toujours les plus vieux & les plus riches soldats qui formoient les triaires, & c'étoit devant eux qu'on portoit l'aigle de la légion. On ne pouvoit entrer dans ce corps avant l'âge de 17 ans, & outre cela il falloit être citoyen romain : cependant il y eut des circonstances où l'on y admit des affranchis ; & après l'âge de 46 ans on n'étoit plus obligé de servir. Le tems du service des légionaires n'étoit pourtant que de 16 ans. Avant Septime Severe il n'étoit pas permis aux légionaires de se marier, ou du moins de mener leurs femmes en campagne avec eux. La discipline militaire de ces soldats étoit très-sévere ; ils menoient une vie dure, faisoient de longues marches chargés de pesans fardeaux : & soit en paix, soit en guerre, on les tenoit continuellement en haleine, soit en fortifiant des places & des camps, soit en formant ou en réparant les grands chemins : aussi voit-on peu d'occasions où cette infanterie romaine ne soit demeurée victorieuse.
|
| LEGIS | soies legis, (Comm.) elles viennent de Perse, & sont les plus belles après les sousbassi ou cherbassi. Elles sont en balles de 20 battemens chacune, le battement de six ocos, ou 18 livres 12 onces, poids de Marseille, & 15 livres poids de marc. Il y a les legis vourines, les legis bourmes ou bourmeo, les legis ardasses. Ces dernieres sont les plus grosses. Voyez le dictionn. de Commerce.
|
| LÉGISLATEUR | S. m. (Politiq.) Le législateur est celui qui a le pouvoir de donner ou d'abroger les lois. En France, le roi est le législateur ; à Genève, c'est le peuple ; à Venise, à Gènes, c'est la noblesse ; en Angleterre, ce sont les deux chambres & le roi.
Tout législateur doit se proposer la sécurité de l'état & le bonheur des citoyens.
Les hommes, en se réunissant en société, cherchent une situation plus heureuse que l'état de nature qui avoit deux avantages, l'égalité & la liberté, & deux inconvéniens, la crainte de la violence & la privation des secours, soit dans les besoins nécessaires, soit dans les dangers. Les hommes, pour se mettre à l'abri de ces inconvéniens, ont consenti donc à perdre un peu de leur égalité & liberté ; & le législateur a rempli son objet, lorsqu'en ôtant aux hommes le moins qu'il est possible d'égalité & de liberté, il leur procure le plus qu'il est possible de sécurité & de bonheur.
Le législateur doit donner, maintenir ou changer des lois constitutives ou civiles.
Les lois constitutives sont celles qui constituent l'espece du gouvernement. Le législateur, en donnant ces lois, aura égard à l'étendue de pays que possede la nation, à la nature de son sol, à la puissance des nations voisines, à leur génie, & au génie de sa nation.
Un petit état doit être républicain ; les citoyens y sont trop éclairés sur leurs intérêts : ces intérêts sont trop peu compliqués pour qu'ils veuillent laisser décider un monarque qui ne seroit pas plus éclairé qu'eux ; l'état entier pourroit prendre dans un moment la même impression qui seroit souvent contraire aux volontés du roi ; le peuple, qui ne peut constamment s'arrêter dans les bornes d'une juste liberté, seroit indépendant au moment où il voudroit l'être : cet éternel mécontentement attaché à la condition d'homme & d'homme qui obéit, ne s'y borneroit pas aux murmures, & il n'y auroit pas d'intervalle entre l'humeur & la résolution.
Le législateur verra que dans un pays fertile, & où la culture des terres occupe la plus grande partie des habitans, ils doivent être moins jaloux de leur liberté, parce qu'ils n'ont besoin que de tranquillité, & qu'ils n'ont ni la volonté ni le tems de s'occuper des détails de l'administration. D'ailleurs, comme dit le président de Montesquieu, quand la liberté n'est pas le seul bien, on est moins attentif à la défendre : par la même raison, des peuples qui habitent des rochers, des montagnes peu fertiles, sont moins disposés au gouvernement d'un seul ; leur liberté est leur seul bien ; & de plus, s'ils veulent, par l'industrie & le commerce, remplacer ce que leur refuse la nature, ils ont besoin d'une extrème liberté.
Le législateur donnera le gouvernement d'un seul aux états d'une certaine étendue : leurs différentes parties ont trop de peine à se réunir tout-à-coup pour y rendre les révolutions faciles : la promtitude des résolutions & de l'exécution, qui est le grand avantage du gouvernement monarchique, fait passer, quand il le faut & dans un moment, d'une province à l'autre, les ordres, les châtimens, les secours. Les différentes parties d'un grand état sont unies sous le gouvernement d'un seul ; & dans une grande république il se formeroit nécessairement des factions qui pourroient la déchirer & la détruire : d'ailleurs les grands états ont beaucoup de voisins, donnent de l'ombrage, sont exposés à des guerres fréquentes ; & c'est ici le triomphe du gouvernement monarchique ; c'est dans la guerre sur-tout qu'il a de l'avantage sur le gouvernement républicain ; il a pour lui le secret, l'union, la célérité, point d'opposition, point de lenteur. Les victoires des Romains ne prouvent rien contre moi ; ils ont soumis le monde ou barbare, ou divisé, ou amolli ; & lorsqu'ils ont eu des guerres qui mettoient la république en danger ; ils se hâtoient de créer un dictateur, magistrat plus absolu que nos rois. La Hollande, conduite pendant la paix par ses magistrats, a créé des stathouders dans ses guerres contre l'Espagne & contre la France.
Le législateur fait accorder les lois civiles aux lois constitutives : elles ne seront pas sur beaucoup de cas les mêmes dans une monarchie que dans une république, chez un peuple cultivateur & chez un peuple commerçant ; elles changeront selon les tems, les moeurs & les climats. Mais ces climats ont-ils autant d'influence sur les hommes que quelques auteurs l'ont prétendu, & influent-ils aussi peu sur nous que d'autres auteurs l'ont assuré ? Cette question mérite l'attention du législateur.
Partout les hommes sont susceptibles des mêmes passions, mais ils peuvent les recevoir par différentes causes & en différentes manieres ; ils peuvent recevoir les premieres impressions avec plus ou moins de sensibilité ; & si les climats ne mettent que peu de différence dans le genre des passions, ils peuvent en mettre beaucoup dans les sensations.
Les peuples du nord ne reçoivent pas comme les peuples du midi, des impressions vives, & dont les effets sont promts & rapides. La constitution robuste, la chaleur concentrée par le froid, le peu de substance des alimens font sentir beaucoup aux peuples du nord le besoin public de la faim. Dans quelques pays froids & humides, les esprits animaux sont engourdis, & il faut aux hommes des mouvemens violens pour leur faire sentir leur existance.
Les peuples du midi ont besoin d'une moindre quantité d'alimens, & la nature leur en fournit en abondance ; la chaleur du climat & la vivacité de l'imagination les épuisent & leur rend le travail pénible.
Il faut beaucoup de travail & d'industrie pour se vêtir & se loger de maniere à ne pas souffrir de la rigueur du froid ; & pour se garantir de la chaleur il ne faut que des arbres, un hamac & du repos.
Les peuples du nord doivent être occupés du soin de se procurer le nécessaire, & ceux du midi sentir le besoin de l'amusement. Le samoiede chasse, ouvre une caverne, coupe & transporte du bois pour entretenir du feu & des boissons chaudes ; il prépare des peaux pour se vêtir, tandis que le sauvage d'Afrique va tout nud, se desaltere dans une fontaine, cueille du fruit, & dort ou danse sous l'ombrage.
La vivacité des sens & de l'imagination des peuples du midi, leur rend plus nécessaires qu'aux peuples du nord les plaisirs physiques de l'amour ; mais, dit le président de Montesquieu, les femmes, chez les peuples du midi, perdant la beauté dans l'âge où commence la raison, ces peuples doivent faire moins entrer le moral dans l'amour, que les peuples du nord, où l'esprit & la raison accompagnent la beauté. Les Cafres, les peuples de la Guiane & du Brésil font travailler leurs femmes comme des bêtes, & les Germains les honoroient comme des divinités.
La vivacité de chaque impression, & le peu de besoin de retenir & de combiner leurs idées, doivent être cause que les peuples méridionaux auront peu de suite dans l'esprit & beaucoup d'inconséquences ; ils sont conduits par le moment ; ils oublient le tems, & sacrifient la vie à un seul jour. Le caraïbe pleure le soir du regret d'avoir vendu le matin son lit pour s'enivrer d'eau-de-vie.
On doit dans le nord, pour pourvoir à des besoins qui demandent plus de combinaisons d'idées, de persévérance & d'industrie, avoir dans l'esprit plus de suite, de regle, de raisonnement & de raison ; on doit avoir dans le midi des enthousiasmes subits, des emportemens fougueux, des terreurs paniques, des craintes & des espérances sans fondement.
Il faut chercher ces influences du climat chez des peuples encore sauvages, & dont les uns soient situés vers l'équateur & les autres vers le cercle polaire. Dans les climats tempérés, & parmi des peuples qui ne sont distans que de quelques degrés, les influences du climat sont moins sensibles.
Le législateur d'un peuple sauvage doit avoir beaucoup d'égard au climat, & rectifier ses effets par la législation, tant par rapport aux subsistances, aux commodités, que par rapport aux moeurs. Il n'y a point de climat, dit M. Hume, où le législateur ne puisse établir des moeurs fortes, pures, sublimes, foibles & barbares. Dans nos pays, depuis longtems policés, le législateur, sans perdre le climat de vûe, aura plus d'égard aux préjugés, aux opinions, aux moeurs établies ; & selon que ces moeurs, ces opinions, ces préjugés répondent à ses desseins ou leur sont opposés, il doit les combattre ou les fortifier par ses lois. Il faut chez les peuples d'Europe chercher les causes des préjugés, des usages, des moeurs & de leurs contrariétés, non seulement dans le gouvernement sous lequel ils vivent, mais aussi dans la diversité des gouvernemens sous lesquels ils ont vécu, & dont chacun a laissé sa trace. On trouve parmi nous des vestiges des anciens Celtes ; on y voit des usages qui nous viennent des Romains ; d'autres nous ont été apportés par les Germains, par les Anglois, par les Arabes, &c.
Pour que les hommes sentent le moins qu'il est possible qu'ils ont perdu les deux avantages de l'état de nature, l'égalité, l'indépendance ; le législateur, dans tous les climats, dans toutes les circonstances, dans tous les gouvernemens, doit se proposer de changer l'esprit de proprieté en esprit de communauté : les législations sont plus ou moins parfaites, selon qu'elles tendent plus ou moins à ce but ; & c'est à mesure qu'elles y parviennent le plus qu'elles procurent le plus de sécurité & de bonheur possibles. Chez un peuple où régne l'esprit de communauté, l'ordre du prince ou du magistrat ne paroît pas l'ordre de la patrie : chaque homme y devient, comme dit Metastaze, compagno delle legge e non seguace : l'ami & non l'esclave des lois. L'amour de la patrie est le seul objet de passion qui unisse les rivaux ; il éteint les divisions ; chaque citoyen ne voit dans un citoyen qu'un membre utile à l'état ; tous marchent ensemble & contens vers le bien commun ; l'amour de la patrie donne le plus noble de tous les courages : on se sacrifie à ce qu'on aime. L'amour de la patrie étend les vûes, parce qu'il les porte vers mille objets qui intéressent les autres : il éleve l'ame au-dessus des petits intérêts, il l'épure, parce qu'il lui rend moins nécessaire ce qu'elle ne pourroit obtenir sans injustice ; il lui donne l'enthousiasme de la vertu : un état animé de cet esprit ne menace pas les voisins d'invasion, & ils n'en ont rien à craindre. Nous venons de voir qu'un état ne peut s'étendre sans perdre de sa liberté, & qu'à mesure qu'il recule ses bornes, il faut qu'il cede une plus grande autorité à un plus petit nombre d'hommes, ou à un seul, jusqu'à ce qu'enfin devenu un grand empire, les lois, la gloire & le bonheur des peuples aillent se perdre dans le despotisme. Un état où regne l'amour de la patrie craint ce malheur, le plus grand de tous, reste en paix & y laisse les autres. Voyez les Suisses, ce peuple citoyen, respectés de l'Europe entiere, entourés de nations plus puissantes qu'eux : ils doivent leur tranquillité à l'estime & à la confiance de leurs voisins, qui connoissent leur amour pour la paix, pour la liberté, & pour la patrie. Si le peuple où regne cet esprit de communauté ne regrette point d'avoir soumis sa volonté à la volonté générale, voyez DROIT NATUREL ; s'il ne sent point le poids de la loi, il sent encore moins celui des impôts ; il paie peu, il paie avec joie. Le peuple heureux se multiplie, & l'extrême population devient une cause nouvelle de sécurité & de bonheur.
Dans la législation tout est lié, tout dépend l'un de l'autre, l'effet d'une bonne loi s'étend sur mille objets étrangers à cette loi : un bien procure un bien, l'effet réagit sur la cause, l'ordre général maintient toutes les parties, & chacune influe sur l'autre & sur l'ordre général. L'esprit de communauté, répandu dans le tout, fortifie, lie & vivifie le tout.
Dans les démocraties, les citoyens, par les lois constitutives, étant plus libres & plus egaux que dans les autres gouvernemens ; dans les démocraties, où l'état, par la part que le peuple prend aux affaires, est réellement la possession de chaque particulier, où la foiblesse de la patrie augmente le patriotisme, où les hommes dans une communauté de périls deviennent nécessaires les uns aux autres, & où la vertu de chacun d'eux se fortifie & jouit de la vertu de tous : dans les démocraties, dis-je, il faut moins d'art & moins de soin que dans les états où la puissance & l'administration sont entre les mains d'un petit nombre ou d'un seul.
Quand l'esprit de communauté n'est pas l'effet necessaire des lois constitutives, il doit l'être des formes, de quelques lois & de l'administration. Voyez en nous le germe de passions qui nous opposent à nos semblables, tantôt comme rivaux, tantôt comme ennemis ; voyez en nous le germe des passions qui nous unissent à la société : c'est au législateur à réprimer les unes, à exciter les autres ; c'est en excitant ces passions sociales qu'il disposera les citoyens à l'esprit de communauté.
Il peut par des lois qui imposent aux citoyens de se rendre des services mutuels, leur faire une habitude de l'humanité ; il peut par des lois faire de cette vertu un des ressorts principaux de son gouvernement. Je parle d'un possible, & je le dis possible, parce qu'il a été réel sous l'autre hémisphere. Les lois du Pérou tendoient à unir les citoyens par les chaînes de l'humanité ; & comme dans les autres législations elles défendent aux hommes de se faire du mal, au Pérou elles leur ordonnoient sans-cesse de se faire du bien. Ces lois en établissant (autant qu'il est possible hors de l'état de nature) la communauté des biens, affoiblissoient l'esprit de propriété, source de tous les vices. Les beaux jours, les jours de fête étoient au Pérou les jours où on cultivoit les champs de l'état, le champ du vieillard ou celui de l'orphelin : chaque citoyen travailloit pour la masse des citoyens ; il déposoit le fruit de son travail dans les magasins de l'état, & il recevoit pour récompense le fruit du travail des autres. Ce peuple n'avoit d'ennemis que les hommes capables du mal ; il attaquoit des peuples voisins pour leur ôter des usages barbares ; les Incas vouloient attirer toutes les nations à leurs moeurs aimables. En combattant les antropophages mêmes, ils évitoient de les détruire, & ils sembloient chercher moins la soumission que le bonheur des vaincus.
Le législateur peut établir un rapport de bienveillance de lui à son peuple, de son peuple à lui, & par-là étendre l'esprit de communauté. Le peuple aime le prince qui s'occupe de son bonheur ; le prince aime des hommes qui lui confient leur destinée ; il aime les témoins de ses vertus, les organes de sa gloire. La bienveillance fait de l'état une famille qui n'obéit qu'à l'autorité paternelle ; sans la superstition qui abrutissoit son siecle & rendoit ses peuples féroces, que n'auroit pas fait en France un prince comme Henri IV ! Dans tous les tems, dans toutes les monarchies, les princes habiles ont fait usage du ressort de la bienveillance ; le plus grand éloge qu'on puisse faire d'un roi est celui qu'un historien danois fait de Canut-le-Bon : il vécut avec ses peuples comme un pere avec ses enfans. L'amitié, la bienfaisance, la générosité, la reconnoissance seront nécessairement des vertus communes dans un gouvernement dont la bienveillance est un des principaux ressorts ; ces vertus ont composé les moeurs chinoises jusqu'au regne de Chi-T-Sou. Quand les empereurs de cet empire, trop vaste pour une monarchie réglée, ont commencé à y faire sentir la crainte, quand ils ont moins fait dépendre leur autorité de l'amour des peuples que de leurs soldats tartares, les moeurs chinoises ont cessé d'être pures, mais elles sont restées douces.
On ne peut imaginer quelle force, quelle activité, quel enthousiasme, quel courage peut répandre dans le peuple cet esprit de bienveillance, & combien il intéresse toute la nation à la communauté ; j'ai du plaisir à dire qu'en France on en a vu des exemples plus d'une fois : la bienveillance est le seul remede aux abus inévitables dans ces gouvernemens qui, par leurs constitutions, laissent le moins de liberté aux citoyens & le moins d'égalité entr'eux. Les lois constitutives & civiles inspireront moins la bienveillance que la conduite du législateur, & les formes avec lesquelles on annonce & on exécute ses volontés.
Le législateur excitera le sentiment de l'honneur, c'est-à-dire le desir de l'estime de soi-même & des autres, le desir d'être honoré, d'avoir des honneurs. C'est un ressort nécessaire dans tous les gouverne mens ; mais le législateur aura soin que ce sentiment soit comme à Sparte & à Rome, uni à l'esprit de communauté, & que le citoyen attaché à son propre honneur & à sa propre gloire, le soit, s'il se peut, davantage à l'honneur & à la gloire de sa patrie. Il y avoit à Rome un temple de l'honneur, mais on ne pouvoit y entrer qu'en passant par le temple de la vertu. Le sentiment de l'honneur séparé de l'amour de la patrie, peut rendre les citoyens capables de grands efforts pour elle, mais il ne les unit pas entr'eux, au contraire il multiplie pour eux les objets de jalousie : l'intérêt de l'état est quelquefois sacrifié à l'honneur d'un seul citoyen, & l'honneur les porte tous plus à se distinguer les uns des autres, qu'à concourir sous le joug des devoirs au maintien des lois & au bien général.
Le législateur doit-il faire usage de la religion comme d'un ressort principal dans la machine du gouvernement ?
Si cette religion est fausse, les lumieres en se répandant parmi les hommes feront connoître sa fausseté, non pas à la derniere classe du peuple, mais aux premiers ordres des citoyens, c'est-à-dire aux hommes destinés à conduire les autres, & qui leur doivent l'exemple du patriotisme & des vertus : or si la religion avoit été la source de leurs vertus, une fois désabusés de cette religion, on les verroit changer leurs moeurs, ils perdroient un frein & un motif, & ils seroient détrompés.
Si cette religion est la vraie, il peut s'y mêler de nouveaux dogmes, de nouvelles opinions : & cette nouvelle maniere de penser peut être opposée au gouvernement. Or si le peuple est accoutumé d'obéir par la force de la religion plus que par celle des lois, il suivra le torrent de ses opinions, & il renversera la constitution de l'état, ou il n'en suivra plus l'impulsion. Quels ravages n'ont pas fait en Vestphalie les Anabatistes ! Le carême des Abissins les affoiblissoit au point de les rendre incapables de soutenir les travaux de la guerre. Ne sont-ce pas les Puritains qui ont conduit le malheureux Charles I. sur l'échafaud ? Les Juifs n'osoient combattre le jour du sabat.
Si le législateur fait de la religion un ressort principal de l'état, il donne nécessairement trop de crédit aux prêtres qui prendront bientôt de l'ambition. Dans les pays où le législateur a pour ainsi dire amalgamé la religion avec le gouvernement, on a vu les prêtres devenus importans, favoriser le despotisme pour augmenter leur propre autorité, & cette autorité une fois établie, menacer le despotisme & lui disputer la servitude des peuples.
Enfin la religion seroit un ressort dont le législateur ne pourroit jamais prévoir tous les effets, & dont rien ne peut l'assurer qu'il seroit toujours le maître : cette raison suffit pour qu'il rende les lois principales soit constitutives, soit civiles, & leur exécution indépendante du culte & des dogmes religieux ; mais il doit respecter, aimer la religion, & la faire aimer & respecter.
Le législateur ne doit jamais oublier la disposition de la nature humaine à la superstition, il peut compter qu'il y en aura dans tous les tems & chez tous les peuples : elle se mêlera même toujours à la véritable religion. Les connoissances, les progrès de la raison sont les meilleurs remedes contre cette maladie de notre espece ; mais comme jusqu'à un certain point elle est incurable, elle mérite beaucoup d'indulgence.
La conduite des Chinois à cet égard me paroît excellente. Des philosophes sont ministres du prince, & les provinces sont couvertes de pagodes & de dieux : on n'use jamais de rigueur envers ceux qui les adorent ; mais lorsqu'un dieu n'a pas exaucé les voeux des peuples & qu'ils en sont mécontens au point de se permettre quelque doute sur sa divinité, les mandarins saisissent ce moment pour abolir une superstition, ils brisent le dieu & renversent le temple.
L'éducation des enfans sera pour le législateur un moyen efficace pour attacher les peuples à la patrie, pour leur inspirer l'esprit de communauté, l'humanité, la bienveillance, les vertus publiques, les vertus privées, l'amour de l'honnête, les passions utiles à l'état, enfin pour leur donner, pour leur conserver la sorte de caractere, de génie qui convient à la nation. Par-tout où le législateur a eu soin que l'éducation fût propre à inspirer à son peuple le caractere qu'il devoit avoir, ce caractere a eu de l'énergie & a duré long-tems. Dans l'espace de 500 ans il ne s'est presque pas fait de changement dans les moeurs étonnantes de Lacédémone. Chez les anciens Perses l'éducation leur faisoit aimer la monarchie & leurs lois ; c'est sur-tout à l'éducation que les Chinois doivent l'immutabilité de leurs moeurs ; les Romains furent long-tems à n'apprendre à leurs enfans que l'Agriculture, la science militaire & les lois de leur pays ; ils ne leur inspiroient que l'amour de la frugalité, de la gloire & de la patrie ; ils ne donnoient à leurs enfans que leurs connoissances & leurs passions. Il y a dans la patrie différens ordres, différentes classes ; il y a des vertus & des connoissances qui doivent être communes à tous les ordres, à toutes les classes ; il y a des vertus & des connoissances qui sont plus propres à certains états, & le législateur doit faire veiller à ces détails importans. C'est sur-tout aux princes & aux hommes qui doivent tenir un jour dans leurs mains la balance de nos destinées, que l'éducation doit apprendre à gouverner une nation de la maniere dont elle veut & dont elle doit l'être. En Suede le roi n'est pas le maître de l'éducation de son fils ; il n'y a pas long-tems qu'à l'assemblée des états de ce royaume un sénateur dit au gouverneur de l'héritier de la couronne : Conduisez le prince dans la cabane de l'indigence laborieuse : faites-lui voir de près les malheureux, & apprenez-lui que ce n'est pas pour servir aux caprices d'une douzaine de souverains que les peuples de l'Europe sont faits.
Quand les lois constitutives & civiles, les formes, l'éducation ont contribué à assurer la défense, la subsistance de l'état, la tranquillité des citoyens & les moeurs ; quand le peuple est attaché à la patrie, & a pris la sorte de caractere la plus propre au gouvernement sous lequel il doit vivre, il s'établit une maniere de penser qui se perpétue dans la nation ; tout ce qui tient à la constitution & aux moeurs paroît sacré ; l'esprit du peuple ne se permet pas d'éxaminer l'utilité d'une loi ou d'un usage : on n'y discute ni le plus ni le moins de nécessité des devoirs, on ne sait que les respecter & les suivre ; & si on raisonne sur leurs bornes, c'est moins pour les resserrer que pour les étendre : c'est alors que les citoyens ont des principes qui sont les regles de leur conduite, & le législateur ajoute à l'autorité que lui donnent les lois celle de l'opinion. Cette autorité de l'opinion entre dans tous les gouvernemens & les consolide ; c'est par elle que presque par-tout le grand nombre mal conduit ne murmure pas d'obéir au petit nombre : la force réelle est dans les sujets, mais l'opinion fait la force des maîtres, cela est vrai jusques dans les états despotiques. Si les empereurs de Rome & les sultans des Turcs ont regné par la crainte sur le plus grand nombre de leurs sujets, ils avoient pour s'en faire craindre des prétoriens & des janissaires sur lesquels ils regnoient par l'opinion : quelquefois elle n'est qu'une idée répandue que la famille régnante a un droit réel au trône : quelquefois elle tient à la religion, souvent à l'idée qu'on s'est faite de la grandeur de la puissance qui opprime ; la seule vraiement solide est celle qui est fondée sur le bonheur & l'approbation des citoyens.
Le pouvoir de l'opinion augmente encore par l'habitude, s'il n'est affoibli par des secousses imprévues, des révolutions subites, & de grandes fautes.
C'est par l'administration que le législateur conserve la puissance, le bonheur & le génie de son peuple ; & sans une bonne administration, les meilleures lois ne sauvent ni les états de leur décadence, ni les peuples de la corruption.
Comme il faut que les lois ôtent au citoyen le moins de liberté qu'il est possible, & laissent le plus qu'il est possible de l'égalité entr'eux ; dans les gouvernemens où les hommes sont le moins libres & le moins égaux, il faut que par l'administration le législateur leur fasse oublier ce qu'ils ont perdu des deux grands avantages de l'état de nature ; il faut qu'il consulte sans-cesse les desirs de la nation ; il faut qu'il expose aux yeux du public les détails de l'administration ; il faut qu'il lui rende compte de ses graces ; il doit même engager les peuples à s'occuper du gouvernement, à le discuter, à en suivre les opérations, & c'est un moyen de les attacher à la patrie. Il faut, dit un roi qui écrit, vit & regne en philosophe, que le législateur persuade au peuple que la loi seule peut tout, & que la fantaisie ne peut rien.
Le législateur disposera son peuple à l'humanité, par la bonté & les regards avec lesquels il traitera tout ce qui est homme, soit citoyen, soit étranger, en encourageant les inventions & les hommes utiles à la nature humaine ; par la pitié dont il donnera des preuves au malheureux ; par l'attention à éviter la guerre & les dépenses superflues ; enfin par l'estime qu'il accordera lui-même aux hommes connus par leur bonté.
La même conduite, qui contribue à répandre parmi son peuple le sentiment d'humanité, excite pour lui ce sentiment de bienveillance, qui est le lien de son peuple à lui ; quelquefois il excitera ce sentiment par des sacrifices éclatans de son intérêt personnel à l'intérêt de sa nation, en préférant, par exemple, pour les graces l'homme utile à la patrie à l'homme qui n'est utile qu'à lui. Un roi de la Chine ne trouvant point son fils digne de lui succéder, fit passer son sceptre à son ministre, & dit : J'aime mieux que mon fils soit mal & que mon peuple soit bien, que si mon fils étoit bien, & que mon peuple fût mal. A la Chine les édits des rois sont des exhortations d'un pere à ses ensans ; il faut que les édits instruisent, exhortent autant qu'ils commandent : c'étoit autrefois l'usage de nos rois, & ils ont perdu à le négliger. Le législateur ne sauroit donner à tous les ordres de l'état trop de preuves de sa bienveillance : un roi de Perse admettoit les laboureurs à sa table, & il leur disoit : Je suis un d'entre vous ; vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous ; vivons en freres.
C'est en distribuant justement & à-propos les honneurs, que le législateur animera le sentiment de l'honneur, & qu'il le dirigera vers le bien de l'état : quand les honneurs seront une récompense de la vertu, l'honneur portera aux actions vertueuses.
Le législateur tient dans ses mains deux rènes, avec lesquelles il peut conduire à son gré les passions, je veux dire les peines & les recompenses. Les peines ne doivent être imposées qu'au nom de la loi par les tribunaux ; mais le législateur doit se réserver le pouvoir de distribuer librement une partie des recompenses.
Dans un pays où la constitution de l'état intéresse les citoyens au gouvernement, où l'éducation & l'administration ont gravé dans les hommes les principes & les sentimens patriotiques & l'honneur, il suffit d'infliger au coupable les peines les plus légeres : c'est assez qu'elles indiquent que le citoyen puni a commis une faute ; les regards de ses concitoyens ajoûtent à son châtiment. Le législateur est le maître d'attacher les peines les plus graves aux vices les plus dangereux pour sa nation ; il peut faire considérer comme des peines des avantages réels, mais vers lesquels il est utile que les desirs de la nation ne se portent pas ; il peut même faire considérer aux hommes comme des peines véritables, ce qui dans d'autres pays pourroit servir de récompense. A Sparte, après certaines fautes il n'étoit plus permis à un citoyen de prêter sa femme. Chez les Péruviens, le citoyen auquel il auroit été défendu de travailler au champ du public, auroit été un homme très-malheureux ; sous ces législations sublimes, un homme se trouvoit puni quand on le ramenoit à son intérêt personnel & à l'esprit de propriété. Les nations sont avilies quand les supplices ou la privation des biens deviennent des châtimens ordinaires : c'est une preuve que le législateur est obligé de punir ce que la nation ne puniroit plus. Dans les républiques, la loi doit être douce, parce qu'on n'en dispense jamais. Dans les monarchies elle doit être plus sévere, parce que le législateur doit faire aimer sa clémence en pardonnant malgré la loi. Cependant chez les Perses, avant Cyrus, les lois étoient fort douces ; elles ne condamnoient à la mort ou à l'infamie que les citoyens qui avoient fait plus de mal que de bien.
Dans les pays où les peines peuvent être légeres, des récompenses médiocres suffisent à la vertu : elle est bien foible & bien rare quand il faut la payer. Les récompenses peuvent servir à changer l'esprit de propriété en esprit de communauté, 1°. lorsqu'elles sont accordées à des preuves de cette derniere sorte d'esprit ; 2°. en accoûtumant les citoyens à regarder comme des récompenses les nouvelles occasions qu'on leur donne de sacrifier l'intérêt personnel à l'intérêt de tous.
Le législateur peut donner un prix infini à sa bienveillance, en ne l'accordant qu'aux hommes qui ont bien servi l'état.
Si les rangs, les prééminences, les honneurs sont toujours le prix des services, & s'ils imposent le devoir d'en rendre de nouveaux, ils n'exciteront point l'envie de la multitude ; elle ne sentira point l'humiliation de l'inégalité des rangs ; le législateur lui donnera d'autres consolations sur cette inégalité des richesses, qui est un effet inévitable de la grandeur des états ; il faut qu'on ne puisse parvenir à l'extrème opulence que par une industrie qui enrichisse l'état, & jamais aux dépens du peuple ; il faut faire tomber les charges de la société sur les hommes riches qui jouissent des avantages de la société. Les impôts entre les mains d'un législateur qui administre bien, sont un moyen d'abolir certains abus, une industrie funeste, ou des vices ; ils peuvent être un moyen d'encourager le genre d'industrie le plus utile, d'exciter certains talens, certaines vertus.
Le législateur ne regardera pas comme une chose indifférente l'étiquette, les cérémonies ; il doit frapper la vûe, celui des sens qui agit le plus sur l'imagination. Les cérémonies doivent réveiller dans le peuple le sentiment pour la puissance du législateur, mais on doit aussi les lier avec l'idée de la vertu ; elles doivent rappeller le souvenir des belles actions, la mémoire des magistrats, des guerriers illustres, des bons citoyens. La plûpart des cérémonies, des étiquettes de nos gouvernemens modérés de l'Europe, ne conviendroient qu'aux despotes de l'Asie ; & beaucoup sont ridicules, parce qu'elles n'ont plus avec les moeurs & les usages les rapports qu'elles avoient au tems de leur institution ; elles étoient respectables, elles font rire.
Le législateur ne négligera pas les manieres : quand elles ne sont plus l'expression des moeurs, elles en sont le frein ; elles forcent les hommes à paroître ce qu'ils devroient être : & si elles ne remplacent qu'imparfaitement les moeurs, elles ont pourtant souvent les mêmes effets : c'est du lieu de la résidence du législateur ; c'est par ses exemples, par celui des hommes respectés, que les manieres se répandent dans le peuple.
Les jeux publics, les spectacles, les assemblées seront un des moyens dont le législateur se servira pour unir entr'eux les citoyens : les jeux des Grecs, les confrairies des Suisses, les coteries d'Angleterre, nos fêtes, nos spectacles répandent l'esprit de société qui contribue à l'esprit de patriotisme. Ces assemblées d'ailleurs accoûtument les hommes à sentir le prix des regards & du jugement de la multitude ; elles augmentent l'amour de la gloire & la crainte de la honte. Il ne se sépare de ces assemblées que le vice timide ou la prétention sans succès ; enfin quand elles n'auroient d'utilité que de multiplier nos plaisirs, elles mériteroient encore l'attention du législateur.
En se rapellant les objets & les principes de toute législation, il doit, en proportion de ce que les hommes ont perdu de leur liberté & de leur égalité, les dédommager par une jouissance tranquille de leurs biens, & une protection contre l'autorité qui les empêche de desirer un gouvernement moins absolu, où l'avantage de plus de liberté est presque toujours troublé par l'inquiétude de la perdre.
Si le législateur ne respecte ni ne consulte la volonté générale ; s'il fait sentir son pouvoir plus que celui de la loi ; s'il traite l'homme avec orgueil, le mérite avec indifférence, le malheureux avec dureté ; s'il sacrifie ses sujets à sa famille, les finances à ses fantaisies, la paix à sa gloire ; si sa faveur est accordée à l'homme qui sait plaire plus qu'à l'homme qui peut servir ; si les honneurs, si les places sont obtenues par l'intrigue ; si les impôts se multiplient, alors l'esprit de communauté disparoît ; l'impatience saisit le citoyen d'une république : la langueur s'empare du citoyen de la monarchie ; il cherche l'état, & ne voit plus que la proie d'un maître ; l'activité se ralentit ; l'homme prudent reste oisif, l'homme vertueux n'est que dupe ; le voile de l'opinion tombe ; les principes nationaux ne paroissent plus que des préjugés, & ils ne sont en effet que cela ; on se rapproche de la loi de la nature, parce que la législation en blesse les droits ; il n'y a plus de moeurs ; la nation perd son caractere ; le législateur est étonné d'être mal servi, il augmente les récompenses, mais celles qui flattoient la vertu ont perdu leur prix, qu'elles ne tenoient que de l'opinion ; aux passions nobles qui animoient autrefois les peuples, le législateur essaie de substituer la cupidité & la crainte, & il augmente encore dans la nation les vices & l'avilissement. Si dans sa perversité il conserve ces formules, ces expressions de bienveillance avec lesquelles leurs prédécesseurs annonçoient leurs volontés utiles ; s'il conserve le langage d'un pere avec la conduite d'un despote, il joue le rôle d'un charlatan méprisé d'abord, & bientôt imité ; il introduit dans la nation la fausseté & la perfidie, &, comme dit le Guarini, viso di carità mente d'invidia.
Quelquefois le législateur voit la constitution de l'état se dissoudre, & le génie des peuples s'éteindre, parce que la législation n'avoit qu'un objet, & que cet objet venant à changer, les moeurs d'abord, & bientôt les lois n'ont pû rester les mêmes. Lacédémone étoit instituée pour conserver la liberté au milieu d'une foule de petits états plus foibles qu'elle, parce qu'ils n'avoient pas ses moeurs ; mais il lui manquoit de pouvoir s'aggrandir sans se détruire. L'objet de la législation de la Chine étoit la tranquillité des citoyens par l'exercice des vertus douces : ce grand empire n'auroit pas été la proie de quelques hordes de tartares, si les législateurs y avoient animé & entretenu les vertus fortes, & si on y avoit autant pensé à élever l'ame qu'à la régler. L'objet de la législation de Rome étoit trop l'aggrandissement ; la paix étoit pour les Romains un état de trouble, de factions & d'anarchie ; ils se dévorerent quand ils n'eurent plus le monde à dompter. L'objet de la législation de Venise est trop de tenir le peuple dans l'esclavage ; on l'amollit ou l'avilit ; & la sagesse tant vantée de ce gouvernement, n'est que l'art de se maintenir sans puissance & sans vertus.
Souvent un législateur borné délie les ressorts du gouvernement & dérange ses principes, parce qu'il n'en voit pas assez l'ensemble, & qu'il donne tous ses soins à la partie qu'il voit seule, ou qui tient de plus près à son goût particulier, à son caractere.
Le conquérant avide de conquêtes négligera la Jurisprudence, le Commerce, les Arts. Un autre excite la nation au Commerce, & néglige la guerre. Un troisieme favorise trop les arts de luxe, & les arts utiles sont avilis, ainsi du reste. Il n'y a point de nation, du moins de grande nation, qui ne puisse être à la fois, sous un bon gouvernement, guerriere, commerçante, savante & polie. Je vais terminer cet article, déja trop long, par quelques réflexions sur l'état présent de l'Europe.
Le système d'équilibre, qui d'une multitude d'états ne forme qu'un seul corps, influe sur les résolutions de tous les législateurs. Les lois constitutives, les lois civiles, l'administration sont plus liées aujourd'hui avec le droit des gens, & même en sont plus dépendantes qu'elles ne l'étoient autrefois : il ne se passe plus rien dans un état qui n'intéresse tous les autres, & le législateur d'un état puissant influe sur la destinée de l'Europe entiere.
De cette nouvelle situation des hommes il résulte plusieurs conséquences.
Par exemple, il peut y avoir de petites monarchies & de grandes républiques. Dans les premieres, le gouvernement y sera maintenu par des associations, des alliances, & par le système général. Les petits princes d'Allemagne & d'Italie sont des monarques ; & si leurs peuples se lassoient de leur gouvernement, ils seroient réprimés par les souverains des grands états. Les dissentions, les partis inséparables des grandes républiques ne pourroient aujourd'hui les affoiblir au point de les exposer à être envahies. Personne n'a profité des guerres civiles de la Suisse & de la Pologne : plusieurs puissances se ligueront toujours contre celle qui voudra s'aggrandir. Si l'Espagne étoit une république, & qu'elle fût menacée par la France, elle seroit défendue par l'Angleterre, la Hollande, &c.
Il y a aujourd'hui en Europe une impossibilité morale de faire des conquêtes ; & de cette impossibilité il est jusqu'à présent résulté pour les peuples plus d'inconvéniens, peut-être, que d'avantages. Quelques législateurs se sont négligés sur la partie de l'administration qui donne de la force aux états ; & on a vû de grands royaumes sous un ciel favorable, languir sans richesses & sans puissances.
D'autres législateurs n'ont regardé les conquêtes que comme difficiles, & point comme impossibles, & leur ambition s'est occupée à multiplier les moyens de conquérir ; les uns ont donné à leurs états une forme purement militaire, & ne laissent presque à leurs sujets de métier à faire que celui de soldat ; d'autres entretiennent même en paix des armées de mercenaires, qui ruinent les finances & favorisent le despotisme ; des magistrats & quelques licteurs feroient obéir aux lois, & il faut des armées immenses pour faire servir un maître. C'est-là le principal objet de la plûpart de nos législateurs ; & pour le remplir ils se voyent obligés d'employer les tristes moyens des dettes & des impôts.
Quelques législateurs ont profité du progrès des lumieres qui depuis cinquante années se sont répandues rapidement d'un bout de l'Europe à l'autre ; elles ont éclairé sur les détails de l'administration, sur les moyens de favoriser la population, d'exciter l'industrie, de conserver les avantages de sa situation, & de s'en procurer de nouveaux. On peut croire que les lumieres conservées par l'Imprimerie, ne peuvent s'éteindre, & peuvent encore augmenter. Si quelque despote vouloit replonger sa nation dans les ténebres, il se trouvera des nations libres qui lui rendront le jour.
Dans les siecles éclairés, il est impossible de fonder une législation sur des erreurs ; la charlatanerie même & la mauvaise foi des ministres sont d'abord apperçues, & ne font qu'exciter l'indignation. Il est également difficile de répandre un fanatisme destructeur, tel que celui des disciples d'Odin & de Mahomet ; on ne feroit recevoir aujourd'hui chez aucun peuple de l'Europe des préjugés contraires au droit des gens & aux lois de la nature.
Tous les peuples ont aujourd'hui des idées assez justes de leurs voisins, & par conséquent ils ont moins que dans les tems d'ignorance l'enthousiasme de la patrie, il n'y a guere d'enthousiasme quand il y a beaucoup de lumieres ; il est presque toujours le mouvement d'une ame plus passionnée qu'instruite ; les peuples en comparant dans toutes les nations les lois aux lois, les talens aux talens, les moeurs aux moeurs, trouveront si peu de raison de se préférer à d'autres, que s'ils conservent pour la patrie cet amour, qui est le fruit de l'intérêt personnel, ils n'auront plus du moins cet enthousiasme qui est le fruit d'une estime exclusive.
On ne pourroit aujourd'hui par des suppositions, par des imputations, par des artifices politiques inspirer des haines nationales aussi vives qu'on en inspiroit autrefois ; les libelles que nos voisins publient contre nous ne font guere d'effet que sur une foible & vile partie des habitans d'une capitale qui renferme la derniere des populaces & le premier des peuples.
La religion de jour en jour plus éclairée, nous apprend qu'il ne faut point haïr ceux qui ne pensent pas comme nous ; on sait distinguer aujourd'hui l'esprit sublime de la religion, des suggestions de ses ministres ; nous avons vu de nos jours les puissances protestantes en guerre avec les puissances catholiques, & aucune ne réussit dans le dessein d'inspirer aux peuples ce zèle brutal & féroce qu'on avoit autrefois l'un contre l'autre, même pendant la paix, chez les peuples de différentes sectes.
Tous les hommes de tous les pays se sont devenus nécessaires pour l'échange des fruits de l'industrie & des productions de leur sol ; le commerce est pour les hommes un lien nouveau, chaque nation a intérêt aujourd'hui qu'une autre nation conserve ses richesses, son industrie, ses banques, son luxe & son agriculture ; la ruine de Leipsick, de Lisbonne & de Lima, a fait faire des banqueroutes sur toutes les places de l'Europe, & influé sur la fortune de plusieurs millions de citoyens.
Le commerce, comme les lumieres, diminue la férocité, mais aussi comme les lumieres ôtent l'enthousiasme d'estime, il ôte peut-être l'enthousiasme de vertu ; il éteint peu-à-peu l'esprit de désintéressement, qu'il remplace par celui de justice ; il adoucit les moeurs que les lumieres polissent ; mais en tournant moins les esprits au beau qu'à l'utile, au grand qu'au sage, il altere peut-être la force, la générosité & la noblesse des moeurs.
De l'esprit de commerce & de la connoissance que les hommes ont aujourd'hui des vrais intérêts de chaque nation, il s'ensuit que les législateurs doivent être moins occupés de défenses & de conquêtes qu'ils ne l'ont été autrefois ; il s'ensuit qu'ils doivent favoriser la culture des terres & des arts, la consommation & le produit de leurs productions, mais ils doivent veiller en même tems à ce que les moeurs polies ne s'affoiblissent point trop & à maintenir l'estime des vertus guerrieres.
Car il y aura toujours des guerres en Europe, on peut s'en fier là-dessus aux intérêts des ministres ; mais ces guerres qui étoient de nation à nation ne seront souvent que de législateur à législateur.
Ce qui doit encore embraser l'Europe c'est la différence des gouvernemens ; cette belle partie du monde est partagée en républiques & en monarchies : l'esprit de celles-ci est actif, & quoiqu'il ne soit pas de leur intérêt de s'étendre, elles peuvent entreprendre des conquêtes dans les momens où elles sont gouvernées par des hommes que l'intérêt de leur nation ne conduit pas ; l'esprit des républiques est pacifique, mais l'amour de la liberté, une crainte superstitieuse de la perdre, porteront souvent les états républicains à faire la guerre pour abaisser ou pour réprimer les états monarchiques ; cette situation de l'Europe entretiendra l'émulation des vertus fortes & guerrieres, cette diversité de sentimens & de moeurs qui naissent de différens gouvernemens, s'opposeront au progrès de cette mollesse, de cette douceur excessive des moeurs, effet du commerce, du luxe & des longues paix.
|
| LEGISLATION | S. f. (Gram. & Politiq.) l'art de donner des loix aux peuples. La meilleure législation est celle qui est la plus simple & la plus conforme à la nature, il ne s'agit pas de s'opposer aux passions des hommes ; mais au contraire de les encourager en les appliquant à l'intérêt public & particulier. Par ce moyen, on diminuera le nombre des crimes & des criminels, & l'on réduira les lois à un très-petit nombre. Voyez les articles LEGISLATEUR & LOIX.
|
| LEGISTE | S. m. (Gram.) se dit du maître & de l'écolier en Droit. L'arrivée des légistes au parlement, sous Philippe de Valois, causa de grands changemens ; ces gens pleins de formalités qu'ils avoient puisées dans le Droit, introduisirent la procédure, & par-là ils se rendirent maîtres des affaires les plus difficiles (Diction. de Trévoux).
|
| LÉGITIMATION | (Jurisprud.) est l'acte par lequel un bâtard est réputé enfant légitime & jouit des mêmes privileges.
Les enfans nés en légitime mariage ont toujours été distingués des bâtards, & ceux-ci au contraire ont toujours été regardés comme des personnes défavorables.
Chez les Hébreux, les bâtards n'héritoient point avec les enfans légitimes, ils n'étoient point admis dans l'église jusqu'à la dixieme génération ; & l'on ne voit point qu'il y eût aucun remede pour effacer le vice de leur naissance.
Les bâtards étoient pareillement incapables de succéder chez les Perses & les Grecs.
Pour ce qui est des Romains, dans tous les livres du digeste, il se trouve beaucoup de lois pour délivrer les esclaves de la servitude, & pour donner aux libertins ou affranchis la qualité d'ingénus ; c'est à quoi se rapportent le titre de jure aureorum annulorum, & celui de natalibus restituendis ; mais on n'y trouve aucune loi qui donne le moyen de légitimer les bâtards ni de les rendre habiles à succéder comme les enfans.
Il n'y avoit alors qu'un seul moyen de légitimer les bâtards & de les rendre habiles à succéder, c'étoit par la voie de l'adoption à l'égard des fils de famille, ce que l'on appelloit adrogation à l'égard d'un fils de famille ; un romain qui adoptoit ainsi un enfant, l'enveloppoit de son manteau, & l'on tient que c'est de-là qu'a été imitée la coutume qui s'observe parmi nous de mettre sous le poile les enfans nés avant le mariage.
L'empereur Anastase craignant que la facilité de légitimer ainsi ses bâtards, ne fût une voie ouverte à la licence, ordonna qu'à l'avenir cela n'auroit lieu que quand il n'y auroit point d'enfans légitimes vivans, nés avant l'adoption des bâtards.
Cette premiere forme de légitimation fut depuis abrogée par l'empereur Justinien, comme on le voit dans sa novelle 89.
Mais Constantin le grand & ses successeurs introduisirent plusieurs autres manieres de légitimer les bâtards.
On voit par la loi 1re, au code de naturalibus liberis, qui est de l'empereur Constantin, & par la loi 5 du même titre qu'il y avoit du tems de cet empereur trois autres formes de légitimation ; la loi 1re en indique deux.
L'une qui étoit faite proprio judicio, du pere naturel, c'est-à-dire, lorsque dans quelqu'acte public ou écrit de sa main, & muni de la signature de trois témoins dignes de foi, ou dans un testament ou dans quelqu'acte judiciaire, il traitoit son bâtard d'enfant légitime ou de son enfant simplement, sans ajouter la qualité d'enfant naturel, comme il est dit dans la novelle 117, cap. ij ; on supposoit dans ce cas qu'il y avoit eu un mariage valable, & l'on n'en exigeoit pas d'autre preuve. Cette légitimation donnoit aux enfans naturels tous les droits des enfans légitimes, il suffisoit même que le pere eût rendu ce témoignage à un de ses enfans naturels, pour légitimer aussi tous les autres enfans qu'il avoit eu de la même femme, le tout pourvu que ce fût une personne libre, & avec laquelle le pere auroit pu contracter mariage. Cette maniere de légitimer n'a point lieu parmi nous ; la déclaration du pere feroit bien une présomption pour l'état de l'enfant ; mais il faut d'autres preuves du mariage, ou que l'enfant soit en possession d'être reconnu pour légitime.
L'autre sorte de légitimation dont la même loi fait mention, est celle qui se fait per rescriptum principis, c'est-à-dire, par lettres du prince, comme cela se pratique encore parmi nous.
La loi 5 qui est de l'empereur Zenon, en renouvellant une constitution de l'empereur Constantin, ordonne que si un homme n'ayant point de femme légitime, ni d'enfans nés en légitime mariage, épouse sa concubine ingenue, dont il a eu des enfans avant le mariage, ces enfans seront légitimés par le mariage subséquent ; mais que ceux qui n'auroient point d'enfans de leur concubine, nés avant la publication de cette loi, ne jouiront pas du même privilege, leur étant libre de commencer par épouser leur concubine, & par ce moyen d'avoir des enfans légitimes.
Cette forme de légitimation ne devoit, comme on voit, avoir lieu qu'en faveur des enfans nés avant la publication de cette loi ; mais Justinien leur donna plus d'étendue par sa novelle 89, cap. ij. où il semble annoncer cette forme de légitimation par mariage subséquent, comme s'il en étoit l'auteur, quoique dans la vérité elle eût été introduite par l'empereur Constantin ; mais Justinien y fit plusieurs changemens, c'est pourquoi il regardoit cette forme comme étant de son invention.
Cette forme de légitimation est celle qu'il appelle per dotalia instrumenta, parce que dans ce cas le seul consentement n'étoit pas suffisant pour la validité du mariage ; il falloit qu'il y eût un contrat rédigé par écrit & des pactes dotaux.
Il ordonna donc que quand un homme épouseroit une femme libre ou affranchie qu'il pouvoit avoir pour concubine, soit qu'il eût déja des enfans légitimes, ou qu'il eût seulement des enfans naturels de cette femme, que ces enfans naturels deviendroient légitimes par le mariage subséquent.
La même chose a lieu parmi nous, & comme pour opérer cette légitimation, il faut que le pere naturel puisse contracter mariage avec la personne dont il a eu des enfans ; les bâtards adultérins & incestueux ne peuvent être légitimés par ce moyen, mais seulement par lettres du prince.
Néanmoins si un homme marié épousoit encore une femme, & que celle-ci fût dans la bonne foi, les enfans seroient légitimes, cap. ex tenore extra qui filii sint legitimi.
Il y avoit chez les Romains une cinquieme forme de légitimation ; c'étoit celle qui se fait per oblationem curiae ; c'est-à-dire lorsque le bâtard étoit aggrégé à l'ordre des décurions ou conseillers des villes, dont l'état devint si pénible, que pour les encourager on leur accorda divers privileges, du nombre desquels étoit celui-ci : ce privilege s'étendoit aussi aux filles naturelles qui épousoient des décurions. Cette maniere de légitimer fut introduite par Théodose le Grand, ainsi que le remarque Justinien dans sa novelle 89 ; elle n'est point en usage parmi nous.
La légitimation par mariage subséquent, a été admise par le Droit canon ; elle n'est pas de droit divin, n'ayant été admise que par le droit positif des décrétales, suivant un rescrit d'Alexandre III. de l'an 1181, au titre des décrétales, qui filii sint legitimi.
Cet usage n'a même pas été reçu dans toute l'Eglise ; Dumolin, Fleta, Selden & autres auteurs, assurent que la légitimation par mariage subséquent, n'a point d'effet en Angleterre par rapport aux successions, mais seulement pour la capacité d'être promu aux ordres sacrés.
Quelque dispense que la cour de Rome accorde pour les mariages entre ceux qui ont commis incestes ou adulteres, & quelque clause qui se trouve dans ces dispenses pour la légitimation des enfans nés de telles conjonctions, ces clauses de légitimation sont toujours regardées comme abusives ; elles sont contraires à la disposition du concile de Trente, & ne peuvent opérer qu'une simple dispense quoad spiritualia, à l'effet seulement de rendre ces enfans capables des ministeres de l'Eglise. Voyez les Mém. du clergé, tome V. pag. 858. & suiv.
Les empereurs voulant gratifier certaines familles, leur ont accordé la faculté de légitimer tous bâtards, & de les rendre capables de successions, en dérogeant aux lois de l'empire & à toutes les constitutions de l'empire comprises dans le corps des authentiques. Il y en a un exemple sous Louis de Baviere quatrieme du nom, lequel par des lettres données à Trente le 20 Janvier 1330, donna pouvoir à nobles hommes Tentalde, fils de Gauthier, Suard & à Maffée, fils d'Odaxes de Forêts de Bergame, & à leurs héritiers & successeurs en ligne masculine, de légitimer dans toute l'Italie toutes sortes de bâtards, même ceux descendus d'incestes ; ensorte qu'ils pussent être appellés aux successions, être institués héritiers & rendus capables de donation, nonobstant les lois contraires contenues aux authentiques.
Il y a dans l'empire un titre de comte palatin, qui n'a rien de commun avec celui des princes palatins du Rhin ; c'est une dignité dont l'empereur décore quelquefois des gens de Lettres. L'empereur leur donne ordinairement le pouvoir de faire des docteurs, de créer des notaires, de légitimer des bâtards ; & un auteur qui écrit sur les affaires d'Allemagne dit, que comme on ne respecte pas beaucoup ces comtes, on fait encore moins de cas de leurs productions, qui sont souvent vénales aussi-bien que la dignité même.
On voit dans les arrêts de Papon, qu'un de ces comtes nommé Jean Navar, chevalier & comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement de Toulouse, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende honorable, à demander pardon au roi pour les abus par lui commis en octroyant en France légitimation, notariats & autres choses, dont il avoit puissance du pape contre l'autorité du roi ; & que le tout fut déclaré nul & abusif.
En France on ne connoît que deux manieres de légitimer les bâtards, l'une de droit, qui est par mariage subséquent ; l'autre de grace, qui est par lettres du prince.
Le mariage subséquent efface le vice de la naissance, & met les bâtards au rang des enfans légitimes. Ceux qui sont ainsi légitimés jouissent des mêmes droits que s'ils étoient nés légitimes ; conséquemment ils succedent à tous leurs parens indistinctement, & sont considérés en toute occasion comme les autres enfans légitimes.
Le bâtard légitimé par mariage, jouit même du droit d'aînesse à l'exclusion des autres enfans qui sont nés constante matrimonio, depuis sa légitimation ; mais non pas à l'exclusion de ceux qui sont nés auparavant, parce qu'on ne peut enlever à ces derniers le droit qui leur est acquis.
La légitimation par mariage subséquent requiert deux conditions.
La premiere, que le pere & la mere fussent libres de se marier au tems de la conception de l'enfant, au tems de sa naissance, & dans le tems intermédiaire.
La seconde, que le mariage ait été célebré en face d'Eglise avec les formalités ordinaires.
La légitimation qui se fait par lettres du prince est un droit de souveraineté, ainsi qu'il est dit dans une instruction faite par Charles V. le 8 Mai 1372.
Nos rois ont cependant quelquefois permis à certaines personnes de légitimer les bâtards. Le roi Jean, par exemple, par des lettres du 26 Février 1061, permet à trois réformateurs généraux, qu'il envoyoit dans le bailliage de Mâcon, & dans les sénéchaussées de Toulouse, de Beaucaire & de Carcassonne, de donner des lettres de légitimation, soit avec finance, ou sans finance, comme ils jugeroient à propos.
De même Charles VI. en établissant le duc de Berri son frere pour son lieutenant dans le Languedoc par des lettres du 19 Novembre 1380, lui donna le pouvoir entr'autres choses, d'accorder des lettres de légitimation, & de faire payer finance aux légitimés.
Les lettres de légitimation portent qu'en tous actes en jugement & dehors, l'impétrant sera tenu, censé & réputé légitime ; qu'il jouira des mêmes franchises, honneurs, privileges & libertés, que les autres sujets du roi ; qu'il pourra tenir & posséder tous biens, meubles & immeubles qui lui appartiendront par dons ou acquêts, & qu'il pourra acquerir dans la suite ; recueillir toutes successions & acceptions, dons entre-vifs, à cause de mort ou autrement, pourvu toutefois quant aux successions, que ce soit du consentement de ses parens ; de maniere que ces lettres n'habilitent à succéder qu'aux parens qui ont consenti à leur enregistrement, & que la légitimation par lettres du prince, a bien moins d'effet que celle qui a lieu par mariage subséquent.
Les bâtards légitimés par lettres du prince acquierent le droit de porter le nom & les armes de leur pere ; ils sont seulement obligés de mettre dans leurs armes une barre, pour les distinguer des enfans légitimes.
On a quelquefois accordé des lettres à des bâtards adultérins, mais ces exemples sont rares.
Pour ce qui est de la légitimation, ou plutôt de la dispense, à l'effet de pouvoir être promu aux ordres sacrés & de pouvoir posséder des bénéfices, il faut se pourvoir en la jurisdiction ecclésiastique.
Sur la légitimation, Voyez ce qui est dit dans Henrys, tom. III. liv. VI. chap. V. quest. 27.
|
| LÉGITIME | legitima, seu portio lege debita, (Jurisprud.) est une portion assurée par la loi sur la part héréditaire que l'on auroit eu, sans les dispositions entre vifs ou testamentaires qui ont donné atteinte à cette part.
La loi n'accorde cette portion qu'à l'héritier présomptif, auquel le défunt étoit naturellement obligé de laisser la subsistance, & qui pourroit intenter la querelle d'inofficiosité.
Quelques auteurs, tels que le Brun en son traité des successions, attribuent l'origine de la légitime à la loi glicia ; nous ne savons pas précisément en quel tems cette loi fut faite, comme il sera dit ci-après au mot LOI, à l'article loi glicia. On voit seulement que le jurisconsulte Caïus, qui vivoit sous l'empire de Marc-Aurele, fit un commentaire sur cette loi ; mais il paroît que l'on a confondu la querelle d'inofficiosité avec légitime ; que la loi glicia n'introduisit que la querelle d'inofficiosité, & que le droit de légitime étoit déja établi.
Papinien dit que la légitime est quarta legitimae partis, ce qui nous indique l'origine de la légitime. Cujas avoue cependant en plusieurs endroits de ses observations, qu'il n'a pu la découvrir ; mais Janus Acosta, ad princ. institut. de inoff. testam. & d'après lui Antoine Schultingius, in Jurisprud. antejustinianaea, p. 381. prétendent avec assez de fondement que la légitime tire son origine de la loi falcidia, faite sous le triumvirat d'Auguste, laquelle permet à l'héritier de retenir le quart de l'hérédité, quelque disposition que le testateur ait pu faire au contraire.
Et en effet le jurisconsulte Paulus, liv. IV. recept. sentent. tit. 5. & Vulpien dans la loi 8. § 9 & 14. ff. de inoff. testam. disent positivement que la quarte falcidie est dûe aux héritiers qui pourroient intenter la plainte d'inofficiosité ; d'où il paroît qu'anciennement la légitime & la falcidie étoient la même chose. Voyez QUARTE FALCIDIE.
Mais on cessa de les confondre ensemble depuis que Justinien eut ordonné par ses novelles 18 & 92, que dorénavant la légitime seroit du tiers s'il y avoit quatre enfans ou moins, & de la moitié s'il y avoit cinq enfans ou davantage.
C'est de ces novelles qu'a été tirée l'authentique de triente & de semisse, qui dit que cette portion est un bienfait de la loi & non pas du pere.
La légitime a lieu quand il y a des donations entre vifs ou testamentaires si excessives, que l'héritier est obligé d'en demander la réduction, pour avoir la portion que la loi lui assure.
En pays coutumier, où l'institution n'a pas lieu, & où les testamens ne sont proprement que des codicilles, la querelle d'inofficiosité n'est ordinairement qu'une simple demande en légitime.
Celui qui est donataire ou légataire, & qui ne se trouve pas rempli de sa légitime, a l'action en supplément.
Le donataire contre lequel le légitimaire demande la réduction de la donation pour avoir sa légitime, a une exception pour retenir sur sa donation, autant qu'il lui seroit dû à lui-même pour sa légitime.
La légitime est un droit qui n'est ouvert qu'à la mort de celui sur les biens duquel elle est dûe ; un enfant ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, en demander une à son pere de son vivant, même sous prétexte que le pere auroit marié & doté, ou établi autrement quelques autres enfans.
Pour être légitimaire il faut être héritier, & n'avoir pas renoncé à la succession ; & en effet les lois romaines veulent que la légitime soit laissée non pas quocumque titulo, mais à titre d'institution. En pays coutumier, le légitimaire est saisi de plein droit & peut demander partage, & l'on traite avec lui de même qu'avec un héritier, comme il paroît par l'imputation qui se fait sur la légitime ; imputation qui est un véritable rapport par l'obligation de fournir des corps héréditaires pour la légitime, le jet des lots qui se pratique avec le légitimaire, & la garantie active & passive qui a lieu entre lui & les autres héritiers.
Cependant lorsque tous les biens de la succession ne suffisent pas pour payer les dettes, l'enfant qui veut avoir sa légitime, peut, sans se porter héritier, la demander au dernier donataire.
Le fils ainé prend non-seulement sa légitime naturelle, mais il la prend avec le préciput que la loi accorde aux aînés.
La légitime est quelquefois qualifiée de créance, ce qui s'entend selon le Droit naturel ; car selon le Droit civil, elle ne passe qu'après toutes les dettes, soit chirographaires ou hypothécaires ; elle a néanmoins cet avantage qu'elle se prend sur les immeubles qui ont été donnés, avant que les dettes fussent constatées, & sur les meubles que le défunt a donnés de son vivant, au lieu que les créanciers n'ont aucun droit fur ces biens.
Toute rénonciation à une succession soit échue ou future, lorsqu'elle est faite aliquo dato, exclud les enfans du renonçant de demander aucune part en la succession, même à titre de légitime.
Une rénonciation gratuite exclud pareillement les enfans du renonçant, de pouvoir demander une légitime, à moins que le renonçant ne fût fils unique, parce qu'en ce cas ses enfans viennent de leur chef, & non par représentation.
Une fille qui auroit renoncé par contrat de mariage, pourroit néanmoins revenir pour sa légitime, supposé qu'elle fût mineure lors de sa renonciation, qu'elle souffrît une lésion énorme, & qu'elle prît des lettres de rescision dans les dix ans de sa majorité.
Un fils majeur qui auroit accepté purement & simplement le legs à lui fait pour lui tenir lieu de légitime, ne seroit pas recevable à revenir pour sa légitime : on le juge pourtant autrement dans les parlemens de Droit écrit.
Nous ne voyons point de coutumes qui privent absolument les enfans de toute légitime ; les plus dures sont celles qui excluent de la succession les filles mariées, quand même elles n'auroient eu qu'un chapeau de roses en mariage, ou mariage avenant, lequel tient lieu de légitime.
Suivant le Droit romain, les enfans naturels n'ont point droit de légitime dans la succession de leur pere, quoiqu'ils soient appellés pour deux onces à sa succession, lorsqu'il ne laisse point de femme ni d'enfans légitimes.
A l'égard de la succession de la mere, le Droit romain y donne une légitime aux bâtards, quand même la mere seroit de condition illustre ; pourvû qu'elle n'ait point d'enfans légitimes ; mais les bâtards incestueux ou adultérins, ou qu'elle auroit eu pendant sa viduité lorsqu'elle est de condition illustre, n'ont point de légitime.
Le Droit françois ne distingue point & ne donne aucune légitime aux bâtards, mais simplement des alimens.
Néanmoins dans quelques coutumes singulieres, telles que S. Omer & Valenciennes, où les bâtards succedent à leur mere concurremment avec les enfans légitimes ; ils ont aussi droit de légitime.
Les enfans légitimés par mariage subséquent ont pareillement droit de légitime, quand même il y auroit des enfans d'un mariage intermédiaire entre leur naissance & leur légitimation, & ne peut même par le contrat de mariage subséquent qui opere cette légitimation, déroger au droit que les légitimés ont pour la légitime ; car cette dérogation à la légitime seroit elle-même un avantage sujet à la légitime.
Lorsque le pere a réduit son fils à un simple usufruit, dans le cas de la loi si furioso, les créanciers du fils peuvent demander la distraction de la légitime.
La loi fratres, au code de inoff. testam. donne aussi une légitime aux freres germains ou consanguins, lorsque le défunt avoit disposé de ses biens par testament au profit d'une personne infame d'une infamie de droit ; l'usage a même étendu cette querelle d'inofficiosité aux donations entre-vifs ; & dans les pays coutumiers l'infamie de droit est un moyen pour faire anéantir toute la disposition.
En pays de Droit écrit, & dans quelques coutumes, comme Bordeaux & Dax, les ascendans ont droit de légitime dans la succession de leurs enfans décédés sans postérité légitime.
La légitime des enfans par le droit du digeste, étoit la quatrieme partie de la succession ; mais par la novelle 18, d'où est tirée l'authentique novissima, les enfans ont le tiers lorsqu'ils ne sont que quatre ou un moindre nombre, & la moitié s'ils sont cinq ou plus ; la novelle 18 a reglé pareillement la légitime des ascendans au tiers.
Quelques coutumes ont réglé la légitime, conformément au droit écrit, comme Rheims & Melun.
D'autres, comme Paris, Orléans, Calais, & Chaunes, ont reglé la légitime à la moitié de ce que les enfans auroient eu si les pere & mere n'eussent pas disposé à leur préjudice.
D'autres enfin ne reglent rien sur la quotité de la légitime, & dans celle-ci on se conforme à la coutume de Paris, si ce n'est dans quelques coutumes voisines des pays de droit écrit, où l'on suit l'esprit du droit romain.
La légitime de droit qui est celle dont on parle ici, est différente de la légitime coutumiere qui n'est autre chose que ce que les coutumes réservent aux héritiers présomptifs, soit directs ou collatéraux.
La légitime doit être laissée librement, & ne peut être grévée d'aucune charge.
Pour fixer sa quotité, on fait une masse de toutes les donations & de tous les biens délaissés au tems du décès de celui de cujus.
On compte ensuite le nombre de ceux qui font part dans la supputation de la légitime.... Dans ce nombre ne sont point compris ceux qui ont renoncé à la succession tout-à-fait gratuitement ; mais on compte ceux qui n'ont renoncé qu'aliquo dato vel retento.
Pour le payement de la légitime on épuise d'abord les biens extans dans la succession, ensuite toutes les dispositions gratuites, en commençant par les dispositions testamentaires, & premierement les institutions d'héritier, & les legs universels, ensuite les legs particuliers.
Si ces objets ne suffisent pas, le légitimaire est en droit de se pourvoir contre les donataires entrevifs, en s'adressant d'abord aux derniers, & remontant de l'un à l'autre, suivant l'ordre des donations, jusqu'à ce que le légitimaire soit rempli ; bien entendu que chaque donataire est lui-même en droit de retenir sa légitime.
La dot, même celle qui a été fournie en deniers, est sujette au retranchement pour la légitime, dans le même ordre que les autres donations, soit que la légitime soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'après sa mort ; & quand il auroit joui de la dot pendant plus de 30 ans, ou même quand la fille dotée auroit renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en seroit excluse de droit, suivant la disposition des loix, coutumes, ou usages.
La légitime se regle eu égard au tems de la mort, tant par rapport aux biens que l'on doit faire rentrer dans la masse, que par rapport au nombre des personnes que l'on doit considérer pour fixer la quotité de la légitime.
On impute sur la légitime tout ce que le légitimaire a reçû à titre de libéralité de ceux sur les biens desquels il demande la légitime, tel que les donations entre-vifs, les prélegs, tout ce qui a été donné au légitimaire pour lui former un établissement, comme un office, un titre clérical, une bibliotheque, des frais & habits de noces, & généralement tout ce qui est sujet à rapport.
La légitime doit être fournie en corps héréditaires ; cependant le légitimaire ne peut pas demander que l'on morcelle les biens, s'ils ne peuvent pas se partager commodément.
Les fruits & intérêts de la légitime courent du jour de la mort.
L'action que le légitimaire a contre les héritiers & donataires, dure pendant 30 ans, à compter du décès de celui qui donne ouverture à la légitime ; car pendant sa vie elle n'est pas sujette à prescription, & ne peut être purgée par decret, attendu que le droit n'est pas encore ouvert.
Voyez les novelles 18, 101, 115, & 117, les traités de legitimâ, par Benavidius, Merlinus, Carnalhus, & celui de la Champagne ; Bouchel & la Peyrere, au mot légitime, & autres auteurs qui traitent des successions. (A)
LEGITIME des ascendans est celle que le droit romain donne aux pere, mere, & à leur défaut, à l'ayeul & ayeule, sur les biens de leurs enfans ou petits-enfans décédés sans postérité. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot LEGITIME. (A)
LEGITIME des collatéraux est celle que le droit donne aux freres germains ou consanguins, lorsque le défunt a disposé de ses biens par testament, au profit d'une personne infame. Voyez la loi fratres, au code de inoff. testam. (A)
LEGITIME COUTUMIERE, est la portion des propres ou autres biens que les coutumes réservent à l'héritier, nonobstant toutes dispositions testamentaires qui seroient faites : au contraire on l'appelle coutumiere, parce qu'elle est opposée à la légitime de droit ; c'est la même chose que ce que l'on appelle les réserves coutumieres. Voyez RESERVES. (A)
LEGITIME DE DROIT, est celle qui est établie par le Droit romain, à la différence des reserves coutumieres qu'on appelle légitime coutumiere.
LEGITIME DES FRERES. Voyez ci-devant LEGITIME DES COLLATERAUX.
LEGITIME DE GRACE, est celle dont la quotité dépend de l'arbitrage du juge, c'est-à-dire, celle que le juge accorde aux enfans sur les biens que leurs ancêtres ont substitués, & dont les pere & mere décédés sans autres biens, n'étoient que fidei-commissaires ; cette légitime a lieu sur les biens substitués au défaut de biens libres ; les petits-enfans ne la peuvent obtenir sur les biens de leur ayeul, que quand ils n'ont pas d'ailleurs d'établissement suffisant pour leur condition ; on la regle ordinairement à la moitié de la légitime de droit. Voyez la Peyrere, édition de 1717, let. L. p. 215. Albert, verbo LEGITIME, art. j. Voyez aussi Cambolas, & le journal du palais, à la date du 14 Mai 1672. (A)
LEGITIME DU MARI. Voyez DON MOBILE, CCESSIONSION, undè vir & uxor.
LEGITIME DE LA MERE. Voyez ci-devant LEGITIME DES ASCENDANS.
LEGITIME NATURELLE, est la même chose que la légitime de droit. Voyez ci-devant LEGITIME DE DROIT.
LEGITIME DU PERE. Voyez ci-devant LEGITIME DES ASCENDANS.
LEGITIME STATUAIRE, est celle qui est réglée par le statut ou la coutume de chaque province ; c'est la même chose que ce que l'on appelle légitime coutumiere, ou reserves coutumieres. (A)
LEGITIME, exquisitus, , (Pathologie) épithete que les anciens donnoient aux maladies dont les symptômes étoient conformes à la cause qui étoit censée les produire le plus constamment ; ils appelloient par exemple, une fievre tierce légitime, lorsque les symptômes qui l'accompagnoient annonçoient un caractere bilieux dans le sang, une pléthore, surabondance de bile ; lorsque le fébril étoit extrêmement vif, aigu, pénétrant, les vomissemens, diarrhées, rapports bilieux, la langue jaune, la chaleur forte, âcre, les maux de tête violens, les sueurs abondantes, les accès assez courts, l'apyrexie bien décidée, &c. Si les accès revenans tous les deux jours n'étoient pas suivis de ces symptômes, s'ils étoient longs & modérés, par exemple, ils l'appelloient alors fausse ou bâtarde, nothia, spuria, pensant qu'une autre cause conjointement à la bile, ou même sans elle, les avoit produites.
L'on explique aujourd'hui l'idée des anciens en d'autres paroles à l'ordinaire ; on donne le nom de légitime aux maladies dont tous les symptômes, surtout les principaux pathognomoniques, sont bien évidemment marqués. Ainsi une pleurésie sera censée légitime, si la fievre est violente, la douleur de côté très-aiguë, la difficulté de respirer très-grande, le pouls vîte, dur, & serré ; si ces symptômes manquent en nombre ou en intensité, la pleurésie est appellée fausse, .
On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont leur siége dans la partie où est le principal symptôme, & on l'a refusé à celles qui quoique excitant à-peu-près les mêmes phénomenes, étoient situées dans d'autres parties. La pleurésie nous fournit encore un exemple pour éclaircir ceci ; lorsque le siége de l'inflammation est dans la plevre ou les muscles intercostaux internes, elle est légitime ; si elle attaque les parties extérieures, elle est appellée bâtarde. Il y a comme on voit dans ces dénominations souvent beaucoup d'hypothétique & d'arbitraire.
Il n'est pas rare de voir dans des écrivains trop peu exacts & rigoureux ce nom confondu avec ceux de primaire, essentiel, idiopathique : quoique la distinction ne soit peut-être pas de grande importance, elle n'en est pas moins réelle. Article de M. MENURET.
|
| LÉGITIMER | v. act. (Jurisprud.) c'est faire un acte de légitimation, c'est donner à un bâtard l'état d'enfant légitime. Voyez ci-devant LEGITIMATION. (A)
|
| LEGO | ou LEGES, (Géogr. anc.) ancien peuple d'Asie qui habitoit vers le Caucase, entre l'Albanie & les Amazones, le long de la mer caspienne. Strabon, liv. II. p. 503, les met entre les peuples Scythes. (D.J.)
|
| LEGS | S. m. (Jurisprud.) est une libéralité faite par un testateur par testament ou codicille, & qui doit être délivrée après sa mort au légataire par l'héritier ab intestat, ou par l'héritier institué, s'il y en a un, ou par le légataire universel, lorsqu'il y en a un.
L'usage de faire des legs est probablement aussi ancien que celui des testamens. Dès que les hommes eurent inventé une maniere de regler leurs biens après leur mort, ils pratiquerent aussi l'usage des legs particuliers en faveur de leurs parens, amis, ou autres personnes auxquelles ils vouloient faire quelque libéralité, sans néanmoins leur donner la totalité de leurs biens.
Dans la Genese, liv. I. ch. xxv. v. 5. & 6, il est fait mention de legs particuliers fait par Abraham à ses enfans naturels : deditque Abraham cuncta quae possiderat Isaac, filiis autem concubinarum largitus est munera.
On trouve encore quelque chose de plus précis pour l'usage des legs dans le prophete Ezéchiel, ch. xlvj. v. 17. & 18. où en parlant du pouvoir que le prince avoit de disposer de ses biens, il prévoit le cas où il auroit fait un legs à un de ses serviteurs : si autem dederit legatum de hereditate suâ uni servorum suorum, erit illius usque ad annum remissionis, & revertetur ad principem ; hereditas autem ejus filius ejus erit, &c.
Ce même texte nous fait connoître que chez les Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étrangers, mais que les biens légués ne pouvoient être possédés par les légataires étrangers ou par leurs héritiers, que jusqu'à l'année du jubilé ; après quoi les biens devoient revenir aux héritiers des enfans du testateur. La liberté de disposer de ses biens par testament n'étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui avoient des enfans ne pouvoient disposer de leurs immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs enfans.
Ces usages furent transmis par les Hébreux aux Egyptiens, & de ceux-ci aux Grecs, dont les Romains emprunterent comme on sait une partie de leurs lois.
La fameuse loi des 12 tables qui fut dressée sur les mémoires que les députés des Romains avoient rapportés d'Athènes, parle de testament & de legs : pater-familias, uti legas, sit super familiâ pecuniâque suâ, ita jus esto.
L'usage des testamens & des legs s'introduisit aussi dans les Gaules ; & depuis que les Romains en eurent fait la conquête, il fut reglé en partie par les lois romaines, & en partie par les coutumes de chaque pays.
Il y avoit anciennement chez les Romains quatre sortes de legs, savoir per vindicationem, damnationem, sinendi modum & per praeceptionem : chacune de ces différentes especes de legs différoit des autres par la matiere, par la forme, & par l'effet.
Léguer per vindicationem, c'étoit quand le testateur donnoit directement au légataire, & en termes qui l'autorisoient à prendre lui-même la chose léguée, par exemple, do illi solidos centum, ou do, lego, capito, sumito, habeto : on appelloit ce legs per vindicationem, parce que le légataire étoit en droit de vendiquer la chose léguée contre toutes sortes de personnes, dès que l'héritier avoit accepté la succession.
Le legs per damnationem, se faisoit en ces termes, damno te heres illi dare solidos centum, ou heres meus damnas esto dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Ce legs produisoit contre l'héritier en faveur du légataire, une action in personam ex testamento.
On léguoit sinendi modo en disant, damno te heres ut illi permittas illam rem accipere, ou bien heres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere illam rem, sibique habere. Cette espece de legs produisoit aussi une action in personam ex testamento.
Le legs per praeceptionem, ne se pouvoit faire qu'aux héritiers qui étoient institués pour partie. C'étoit une espece de libation ou prélegs ; il se faisoit en ces termes : praecipuam ille ex parte heres rem illam accipito ; ou bien Lucius Titius illam rem praecipito : ce qui étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que par l'action appellée familiae erciscundae.
Dans la suite les empereurs Constantin, Constantius, & Constans, supprimerent toutes ces différentes formes de legs, & Justinien acheva de perfectionner cette jurisprudence, en ordonnant que tous les legs seroient de même nature, & qu'en quelques termes qu'ils fussent conçus, le légataire pourroit agir, soit par action personnelle ou réelle, soit par action hypothécaire.
On peut léguer en général toutes les choses dont on peut disposer par testament suivant la loi du lieu où elles sont situées, soit meubles meublans ou autres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, droits & actions, servitutes, &c. pourvû que ce soient des choses dans le commerce.
On peut même léguer la chose de l'héritier, parce que l'héritier en acceptant la succession, semble confondre son patrimoine avec celui du défunt, & se soumettre aux charges qui lui sont imposées.
Si le testateur legue sciemment la chose d'autrui, l'héritier est tenu de l'acheter pour la livrer au légataire, ou s'il ne peut pas l'avoir, de lui en payer la valeur ; mais s'il a légué la chose d'autrui croyant qu'elle lui appartenoit, le legs est caduc.
En général un legs peut être caduc par le défaut de capacité du testateur, par la qualité de la chose qui n'est pas disponible, ou par l'incapacité du légataire qui ne peut recevoir de libéralité.
Un legs peut être universel ou particulier, pur & simple ou conditionnel, ou fait pour avoir lieu dans un certain tems seulement.
Le legs fait sub modo, est celui qui est fait en vûe de quelque chose ; par exemple, je legue à Titius une somme pour se marier ou pour se mettre en charge.
Le legs fait pour cause est, par exemple, lorsque le testateur dit, je legue à un tel parce qu'il a bien geré mes affaires. Si la cause se trouve fausse, elle ne vicie pas le legs : il en est de même d'une fausse démonstration, soit du légataire, soit de la chose léguée, pourvû que la volonté du testateur soit constante.
Le droit d'accroissement n'a point lieu entre collégataires, s'ils ne sont conjoints que par les termes de la disposition, mais seulement s'ils sont conjoints par la chose & par les paroles, ou du-moins par la chose, c'est-à-dire lorsqu'une même chose est léguée à plusieurs.
Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-commis, lorsque le testateur prioit ou chargeoit son héritier de remettre telle chose au légataire ; ce qui revenoit à la formule des legs per damnationem ; mais Justinien rendit tous les legs semblables aux fideicommis particuliers.
Plusieurs personnes sont incapables de recevoir des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets civils, les corps & communautés non approuvées par le prince ; & même l'Eglise & les communautés approuvées, ne peuvent plus rien recevoir que conformément à l'édit du mois d'Août 1749.
Les bâtards adultérins & incestueux sont incapables de legs, excepté de simples alimens.
On ne pouvoit autrefois léguer à un posthume ; mais par le nouveau droit cela est permis, de même qu'on peut léguer en général à des enfans à naître.
Les legs peuvent être ôtés de plusieurs manieres ; savoir par la volonté expresse ou tacite du testateur, s'il révoque le legs ; s'il aliene sans nécessité la chose léguée, s'il la donne de son vivant à une autre personne, s'il survient des inimitiés capitales entre le testateur & le légataire.
Le fait du légataire peut aussi donner lieu d'annuller le legs, comme s'il s'en rend indigne, s'il cache le testament du défunt, s'il refuse la tutele dont le testateur l'a chargé par son testament, s'il accuse le testament d'être faux ou inofficieux.
En pays de droit écrit, l'héritier est en droit de retenir la quarte falcidie sur les legs, & la quarte trébellianique sur les fidei-commis.
En pays coutumier, il n'est permis de léguer qu'une certaine quotité de ses biens ; à Paris il est permis de léguer tous ses meubles & acquêts, & le quint de ses propres ; ailleurs cela est reglé différemment.
Dans la plûpart des coutumes, les qualités d'héritier & de légataire sont incompatibles ; ce qui s'entend sur les biens d'une même coutume ; mais on peut être héritier dans une coutume, & légataire dans une autre où l'on n'est pas habile à succéder.
Tous les legs sont sujets à délivrance, & les intérêts ne courent que du jour de la demande, à-moins que ce ne fût un legs fait à un enfant par ses pere & mere, pour lui tenir lieu de sa portion héréditaire ; auquel cas, les intérêts seroient dûs depuis le décès du testateur.
On peut imposer une peine à l'héritier pour l'obliger d'accomplir les legs ; d'ailleurs les légataires ont une action contre lui en vertu du testament.
Ils ont aussi une hypotheque sur tous les biens du défunt ; mais cette hypotheque n'a lieu que jusqu'à concurrence de la part & portion dont chaque héritier est chargé des legs.
Le légataire qui survit au testateur transmet à son héritier le droit de demander son legs, encore qu'il ne fût pas exigible, pourvû qu'il n'y ait pas lui-même renoncé, & que le legs ne soit pas absolument personnel au légataire.
Voyez au digeste, au code & aux institutes, les titres de legatis & fidei-commissis, l'auteur des lois civiles, & autres qui traitent des successions & testamens, dans lesquels il est aussi parlé des legs. (A)
|
| LEGUAN | S. m. (Hist. nat.) espece de crocodile de l'île de Java, que les habitans du pays écorchent pour le manger ; on dit que sa chair est fort délicate.
|
| LÉGUME | S. m. (Jardinage) on comprend sous ce mot toutes les plantes potageres à l'usage de la vie : ce mot est masculin.
LEGUME, (Chimie, Diete, & Mat. med.) ce mot se prend communément dans deux acceptions différentes. Il signifie premierement la même chose que herbe potagere, & il n'est presque d'usage dans ce sens qu'au pluriel, & pour désigner les herbes potageres en général. Secondement, il est donné à la semence des plantes appellées légumineuses, voyez PLANTE, soit en général, soit en particulier.
Les légumes ou herbes potageres ont peu de propriétés sensibles & diétetiques connues. La laitue, le persil, l'artichaut, &c. différent essentiellement entr'eux. Tout ce que nous avons à dire de toutes les différentes herbes potageres doit donc être cherché dans les articles particuliers. Voyez ces articles.
Les légumes ou sémences légumineuses, du-moins les légumes qu'on emploie ordinairement à titre d'aliment, ont entr'eux la plus grande analogie, soit par leur nature ou composition chimique, soit par leurs qualités diététiques, soit par leurs vertus medicinales fondamentales.
Ces légumes usuels sont les fêves appellées à Paris fêves de marais, les petites fêves ou haricots, les pois, les pois-chiches & les gesses. Il faut y ajouter le lupin, l'ers ou orobe, & la vesce, qui sont presqu'absolument relégués à l'usage pharmaceutique extérieur, mais qui ne different réellement, comme aliment, des légumes usuels que par le moindre agrément, ou si l'on veut le désagrément du goût, qui n'a pas empêché cependant que les paysans ne les aient mangés en tems de disette. Galien dit même que le lupin étoit une nourriture fort ordinaire des anciens Grecs ; mais toutes ces observations particulieres font la matiere des articles particuliers, voyez ces articles.
Les semences légumineuses sont du genre des substances farineuses, voyez FARINE & FARINEUX ; & la composition particuliere qui les spécifie, paroît dépendre de l'excès extrême du principe terreux surabondant qui établit dans la classe des corps muqueux le genre des corps farineux.
Les légumes ont été regardés dans tous les tems par les Medecins comme fournissant une nourriture abondante, mais grossiere & venteuse. Les modernes leur ont reproché de plus la qualité incrassante, & même éminemment incrassante, voyez INCRASSANT & NOURRISSANT. La qualité venteuse est la plus réelle de ces qualités nuisibles ; mais en général c'est un inconvenient de peu de conséquence pour les gens vraiment sains, que celui de quelques flatuosités, quoique c'en soit un assez grave pour les mélancholiques, & les femmes attaquées de passion hystérique, pour que cette espece d'aliment doive leur être défendu. Quant à la crainte chimérique d'épaissir les humeurs, d'en entretenir ou d'en augmenter l'épaississement par leur usage, & de procurer ou soutenir par-là des arrêts, des hérences, des obstructions ; & à la loi constante qui défend les légumes d'après cette spéculation dans toutes les maladies chroniques où l'épaississement des humeurs est soupçonné ou rédouté, ce sont-là des lieux communs théoriques. Il ne faut dans l'usage des légumes, comme dans celui de plusieurs autres alimens, peut-être de tous les alimens vrais & purs, tels que sont des légumes, avoir égard qu'à la maniere dont ils affectent les premieres voies, c'est-à-dire à leur digestion. Tout légume bien digéré est un aliment sain : or plus d'un sujet à humeurs censées épaisses, plein d'obstructions, &c. digere très-bien les légumes, donc ce sujet peut manger des légumes ; & quand même il seroit démontré, comme il est très-vraisemblable, que l'usage des légumes seroit incrassant & empâtant, comme celui des farines céréales, & qu'on connoîtroit des peuples entiers vivant de pois ou de fêves (le peuple des forçats n'est nourri sur nos galeres qu'avec des fêves, & il est gras, charnu, fort), comme on en connoît qui vivent de farines de maïs, & que les premiers fussent comme les derniers gras, lourds, &c. l'induction de cet effet incrassant à l'effet obstruant, n'est rien moins que démontré, sur-tout y ayant ici la très-grave différence d'un usage journalier, constant, à un usage passager, alterné par celui de tous les autres alimens accoutumés, &c.
Les légumes, du moins quelques-uns, les haricots, les fêves & les pois se mangent verds, ou bien mûrs & secs. Dans le premier état on les mange encore ou cruds ou cuits ; les légumes verds cruds sont en général une assez mauvaise chose ; mauvaise, dis-je, pour les estomacs malades, cela s'entend toujours, c'est pour les estomacs à qui les crudités ne conviennent point, une mauvaise espece de crudité. Les légumes verds cuits différent peu des légumes respectifs mangés secs & cuits ; ils sont même communément plus faciles à digérer. Les auteurs de diete disent qu'ils nourrissent moins ; mais qu'est-ce qu'un aliment plus ou moins nourrissant pour des hommes qui font leur repas d'un grand nombre d'alimens différens, & qui mangent toujours au-delà de leur besoin réel ? voyez NOURRISSANT. C'est aux légumes secs & mûrs que convient tout ce que nous avons dit jusqu'ici.
Les légumes se mangent, comme tout le monde sait, soit sous forme de potage, soit avec les viandes, entiers ou en purée : cette derniere préparation est utile en général. Les peaux qu'on rejette par-là sont au-moins inutiles, & peuvent même peser à certains estomacs. C'est à cette partie des légumes que les anciens medecins ont principalement attribué les qualités nuisibles qu'ils leur reprochoient, savoir d'être venteux, tormineux, resserrants, &c. D'ailleurs la discontinuité des parties du légume réduit en purée doit en rendre la digestion plus facile. Il a été dès long-tems observé que des légumes mangés entiers, & sur-tout les lentilles, étoient, quoique convenablement ramollis par la cuite, rendus tout entiers avec les gros excrémens.
On regarde assez généralement, comme une observation constante, comme un fait incontestable, que les légumes ne cuisent bien que dans les eaux communes les plus pures, les plus legeres ; & que les eaux appellées dures, crues, pesantes, voyez EAU DOUCE sous l'article EAU, Chimie, les durcissent, ou du-moins ne les ramollissent point, même par la plus longue cuite ou décoction. La propriété de bien cuire les légumes est même comptée parmi celles qui caractérisent les meilleures eaux : la raison de ce phenomene n'est point connue, il me semble qu'on n'en a pas même soupçonné une explication raisonnable ; mais peut-être aussi ce fait prétendu incontestable n'est-il au contraire qu'une croyance populaire.
Des quatre farines résolutives, trois sont tirées de semences légumineuses, savoir de la fêve, du lupin & de l'orobe. Voyez FARINES RESOLUTIVES & RESOLUTIF. (b)
|
| LÉGUMIE | ou POTAGER, s. m. (Jardinage) est un jardin destiné uniquement à élever des plantes potageres ou légumes. Voyez POTAGER.
|
| LÉGUMINEUSE | PLANTE, (Nomencl. Bot.) les plantes légumineuses sont celles dont le fruit, qui s'appelle gousse ou silique, est occupé par des semences. Voyez SILIQUE. (D.J.)
|
| LÉIBNITZIANISME | ou PHILOSOPHIE DE LÉIBNITZ, (Hist. de la Philosoph.) Les modernes ont quelques hommes, tels que Bayle, Descartes, Léibnitz & Newton, qu'ils peuvent opposer, & peut-être avec avantage, aux génies les plus étonnans de l'antiquité. S'il existoit au-dessus de nos têtes une espece d'êtres qui observât nos travaux, comme nous observons ceux des êtres qui rampent à nos piés, avec quelle surprise n'auroit-elle pas vu ces quatre merveilleux insectes ? combien de pages n'auroient-ils pas rempli dans leurs éphémérides naturelles ? Mais l'existence d'esprits intermédiaires entre l'homme & Dieu n'est pas assez constatée pour que nous n'osions pas supposer que l'immensité de l'intervalle est vuide, & que dans la grande chaîne, après le Créateur universel, c'est l'homme qui se présente ; & à la tête de l'espece humaine ou Socrate, ou Titus, ou Marc-Aurele, ou Pascal, ou Trajan, ou Confucius, ou Bayle, ou Descartes, ou Newton, ou Léibnitz.
Ce dernier naquit à Léipsic en Saxe le 23 Juin 1646 ; il fut nommé Godefroi-Guillaume. Frédéric son pere étoit professeur en Morale, & greffier de l'université, & Catherine Schmuck, sa mere, troisieme femme de Frédéric, fille d'un docteur & professeur en Droit. Paul Léibnitz, son grand oncle, avoit servi en Hongrie, & mérité en 1600 des titres de noblesse de l'empereur Rodolphe II.
Il perdit son pere à l'âge de six ans, & le sort de son éducation retomba sur sa mere, femme de mérite. Il se montra également propre à tous les genres d'études, & s'y porta avec la même ardeur & le même succès. Lorsqu'on revient sur soi & qu'on compare les petits talens qu'on a reçus, avec ceux d'un Léibnitz, on est tenté de jetter loin les livres, & d'aller mourir tranquille au fond de quelque recoin ignoré.
Son pere lui avoit laissé une assez ample collection de livres ; à peine le jeune Léibnitz sut-il un peu de grec & de latin, qu'il entreprit de les lire tous, Poëtes, Orateurs, Historiens, Jurisconsultes, Philosophes, Théologiens, Medecins. Bientôt il sentit le besoin de secours, & il en alla chercher. Il s'attacha particulierement à Jacques Thomasius ; personne n'avoit des connoissances plus profondes de la Littérature & de la Philosophie ancienne que Thomasius, cependant le disciple ne tarda pas à devenir plus habile que son maître. Thomasius avoua la supériorité de Léibnitz ; Léibnitz reconnut les obligations qu'il avoit à Thomasius. Ce fut souvent entr'eux un combat d'éloge, d'un côté, & de reconnoissance de l'autre.
Léibnitz apprit sous Thomasius à attacher un grand prix aux philosophes anciens, à la tête desquels il plaça Pythagore & Platon ; il eut du goût & du talent pour la Poésie : ses vers sont remplis de choses. Je conseille à nos jeunes auteurs de lire le poëme qu'il composa en 1676 sur la mort de Jean Frédéric de Brunswic, son protecteur ; ils y verront combien la Poésie, lorsqu'elle n'est pas un vain bruit, exige de connoissances préliminaires.
Il fut profond dans l'Histoire ; il connut les intérêts des princes. Jean Casimir, roi de Pologne, ayant abdiqué la couronne en 1668, Philippe Guillaume de Neubourg, comte Palatin, fut un des prétendans, & Léibnitz, caché sous le nom de George Ulicovius, prouva que la république ne pouvoit faire un meilleur choix ; il avoit alors vingt-deux ans, & son ouvrage fut attribué aux plus fameux jurisconsultes de son tems.
Quand on commença à traiter de la paix de Nimegue, il y eut des difficultés sur le cérémonial à l'égard des princes libres de l'empire qui n'étoient pas électeurs. On refusoit à leurs ministres des honneurs qu'on accordoit à ceux des princes d'Italie. Il écrivit en faveur des premiers l'ouvrage intitulé, Caesarini Furstenerii, de jure suprematûs ac legationis principum Germaniae. C'est un système où l'on voit un luthérien placer le pape à côté de l'empereur, comme chef temporel de tous les états chrétiens, du-moins en Occident. Le sujet est particulier, mais à chaque pas l'esprit de l'auteur prend son vol & s'éleve aux vûes générales.
Au milieu de ces occupations il se lioit avec tous les savans de l'Allemagne & de l'Europe ; il agitoit soit dans des theses, soit dans des lettres, des questions de Logique, de Métaphysique, de Morale, de Mathématique & de Théologie, & son nom s'inscrivoit dans la plûpart des académies.
Les princes de Brunswic le destinerent à écrire l'histoire de leur maison. Pour remplir dignement ce projet, il parcourut l'Allemagne & l'Italie, visitant les anciennes abbayes, fouillant dans les archives des villes, examinant les tombeaux & les autres antiquités, & recueillant tout ce qui pouvoit répandre de l'agrément & de la lumiere sur une matiere ingrate.
Ce fut en passant sur une petite barque seul, de Venise à Mesola, dans le Ferrarois, qu'un chapelet dont il avoit jugé à propos de se pourvoir à tout évenement dans un pays d'inquisition, lui sauva la vie. Il s'éleva une tempête furieuse : le pilote qui ne croyoit pas être entendu par un allemand, & qui le regardoit comme la cause du péril, proposa de le jetter en mer, en conservant néanmoins ses hardes & son argent, qui n'étoient pas hérétiques. Léibnitz sans se troubler tira son chapelet d'un air dévot, & cet artifice fit changer d'avis au pilote. Un philosophe ancien, c'étoit, je crois, Anaxagoras l'athée, échappa au même danger, en montrant au loin, à ceux qui méditoient d'appaiser les dieux en le précipitant dans les flots, des vaisseaux battus par la tempête, & où Anaxagoras n'étoit pas.
De retour de ses voyages à Hanovre en 1699, il publia une portion de la récolte qu'il avoit faite, car son avidité s'étoit jettée sur tout, en un volume in-fol. sous le titre de Code du droit des gens : c'est-là qu'il démontre que les actes publics de nation à nation sont les sources les plus certaines de l'Histoire, & que, quels que soient les petits ressorts honteux qui ont mis en mouvement ces grandes masses, c'est dans les traités qui ont précédé leurs émotions & accompagné leur repos momentané, qu'il faut découvrir leurs véritables intérêts. La préface du Codex juris gentium diplomaticus est un morceau de génie. L'ouvrage est une mer d'érudition : il parut en 1693.
Le premier volume Scriptorum Brunsvicensia illustrantium, ou la base de son histoire fut élevée en 1707, c'est-là qu'il juge, d'un jugement dont on n'a point appellé, de tous les matériaux qui devoient servir au reste de l'édifice.
On croyoit que des gouverneurs de villes de l'empire de Charlemagne étoient devenus, avec le tems, princes héréditaires ; Léibnitz prouve qu'ils l'avoient toujours été. On regardoit le x. & le xj. siecles comme les plus barbares du Christianisme ; Léibnitz rejette ce reproche sur le xiij. & le xjv. où des hommes pauvres par institut, avides de l'aisance par foiblesse humaine, inventoient des fables par nécessité. On le voit suivre l'enchaînement des évenemens, discerner les fils délicats qui les ont attirés les uns à la suite des autres, & poser les regles d'une espece de divination d'après laquelle l'état antérieur & l'état présent d'un peuple étant bien connus, on peut annoncer ce qu'il deviendra.
Deux autres volumes Scriptorum Brunsvicensia illustrantium parurent en 1710 & en 1711, le reste n'a point suivi. M. de Fontenelle a exposé le plan général de l'ouvrage dans son éloge de Léibnitz, an. de l'acad. des Scienc. 1716.
Dans le cours de ses recherches il prétendit avoir découvert la véritable origine des François, & il en publia une dissertation en 1716.
Léibnitz étoit grand jurisconsulte ; le Droit étoit & sera long-tems l'étude dominante de l'Allemagne ; il se présenta à l'âge de vingt ans aux examens du doctorat : sa jeunesse, qui auroit dû lui concilier la bienveillance de la femme du doyen de la faculté, excita, je ne sais comment, sa mauvaise humeur, & Léibnitz fut refusé ; mais l'applaudissement général & la même dignité qui lui fut offerte & conférée par les habitans de la ville d'Altorf, le vengerent bien de cette injustice. S'il est permis de juger du mérite du candidat par le choix du sujet de sa these, quelle idée ne se formera-t-on pas de Léibnitz ? il disputa des cas perplexes en Droit. Cette these fut imprimée dans la suite avec deux autres petits traités, l'un intitulé, Specimen Encyclopediae in jure, l'autre, Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure exhibitum in doctrinâ conditionum.
Ce mot Encyclopédie avoit été employé dans un sens plus général par Alstedius : celui-ci s'étoit proposé de rapprocher les différentes sciences, & de marquer les lignes de communication qu'elles ont entr'elles. Le projet en avoit plu à Léibnitz ; il s'étoit proposé de perfectionner l'ouvrage d'Alstedius ; il avoit appellé à son secours quelques savans : l'ouvrage alloit commencer, lorsque le chef de l'entreprise, distrait par les circonstances, fut entraîné à d'autres occupations, malheureusement pour nous qui lui avons succedé, & pour qui le même travail n'a été qu'une source de persécutions, d'insultes & de chagrins qui se renouvellent de jour en jour, qui ont commencé il y a plus de quinze ans, & qui ne finiront peut-être qu'avec notre vie.
A l'âge de vingt-deux ans il dédia à l'électeur de Mayence Jean Philippe de Schomborn, une nouvelle méthode d'enseigner & d'apprendre la Jurisprudence, avec un catalogue des choses à desirer dans la science du Droit. Il donna dans la même année son projet pour la réforme générale du corps du Droit. La tête de cet homme étoit ennemie du désordre, & il falloit que les matieres les plus embarrassées s'y arrangeassent en y entrant ; il réunissoit deux grandes qualités presqu'incompatibles, l'esprit d'invention & celui de méthode ; & l'étude la plus opiniâtre & la plus variée, en accumulant en lui les connoissances les plus disparates, n'avoit affoibli ni l'un ni l'autre : philosophe & mathématicien, tout ce que ces deux mots renferment, il l'étoit. Il alla d'Altorf à Nuremberg visiter des savans ; il s'insinua dans une société secrette d'alchimistes qui le prirent pour adepte sur une lettre farcie de termes obscurs qu'il leur adressa, qu'ils entendirent apparemment, mais qu'assurément Léibnitz n'entendoit pas. Ils le créerent leur secrétaire, & il s'instruisit beaucoup avec eux pendant qu'ils croyoient s'instruire avec lui.
En 1670, âgé de vingt-quatre ans, échappé du laboratoire de Nuremberg, il fit réimprimer le traité de Marius Nizolius de Bersello, de veris principiis & verâ ratione philosophandi contra pseudo-philosophos, avec une préface & des notes où il cherche à concilier l'aristotélisme avec la Philosophie moderne : c'est-là qu'il montre quelle distance il y a entre les disputes de mots & la science des choses, qu'il étale l'étude profonde qu'il avoit faite des anciens, & qu'il montre qu'une erreur surannée est quelquefois le germe d'une vérité nouvelle. Tel homme en effet s'est illustré & s'illustrera en disant blanc après un autre qui a dit noir. Il y a plus de mérite à penser à une chose qui n'avoit point encore été remuée, qu'à penser juste sur une chose dont on a déjà disputé : le dernier degré du mérite, la véritable marque du génie, c'est de trouver la vérité sur un sujet important & nouveau.
Il publia une lettre de Aristotele recentioribus reconciliabili, où il ose parler avantageusement d'Aristote dans un tems où les Cartésiens fouloient aux piés ce philosophe, qui doit être un jour vengé par les Newtoniens. Il prétendit qu'Aristote contenoit plus de vérités que Descartes, & il démontra que la philosophie de l'un & de l'autre étoit corpusculaire & méchanique.
En 1711 il adressa à l'académie des Sciences sa théorie du mouvement abstrait, & à la société royale de Londres, sa théorie du mouvement concret. Le premier traité est un système du mouvement en général ; le second en est une application aux phenomenes de la nature ; il admettoit dans l'un & l'autre du vuide ; il regardoit la matiere comme une simple étendue indifférente au mouvement & au repos, & il en étoit venu à croire que pour découvrir l'essence de la matiere, il falloit y concevoir une force particuliere qui ne peut gueres se rendre que par ces mots, mentem momentaneam, seu carentem recordatione, quia conatum simul suum & alienum contrarium non retineat ultro momentum, adeòque careat memoriâ, sensu actionum passionumque suarum, atque cogitatione.
Le voilà tout voisin de l'entéléchie d'Aristote, de son système des monades, de la sensibilité, propriété générale de la matiere, & de beaucoup d'autres idées qui nous occupent à-présent. Au lieu de mesurer le mouvement par le produit de la masse & de la vîtesse, il substituoit à l'un de ces élémens la force, ce qui donnoit pour mesure du mouvement le produit de la masse par le quarré de la vîtesse. Ce fut-là le principe sur lequel il établit une nouvelle dynamique ; il fut attaqué, il se défendit avec vigueur ; & la question n'a été, sinon decidée, du-moins bien éclaircie depuis, que par des hommes qui ont réuni la Métaphysique la plus subtile à la plus haute Géométrie. Voyez l'article FORCE.
Il avoit encore sur la Physique générale une idée particuliere, c'est que Dieu a fait avec la plus grande économie possible, ce qu'il y avoit de plus parfait & de meilleur : il est le fondateur de l'optimisme, ou de ce système qui semble faire de Dieu un automate dans ses decrets & dans ses actions, & ramener sous un autre nom & sous une forme spirituelle le fatum des anciens, ou cette nécessité aux choses d'être ce qu'elles sont.
Il est inutile de dire que Léibnitz étoit un mathématicien du premier ordre. Il a disputé à Newton l'invention du calcul différentiel. Voyez les articles de ce Diction. CALCUL DIFFERENTIEL & FLUXION. M. de Fontenelle, qui paroît toujours favorable à M. Léibnitz, prononce que Newton est certainement inventeur, & que sa gloire est en sûreté, mais qu'on ne peut être trop circonspect lorsqu'il s'agit d'intenter une accusation de vol & de plagiat contre un homme tel que Léibnitz : & M. de Fontenelle a raison.
Léibnitz étoit entierement neuf dans la haute Géométrie, en 1676, lorsqu'il connut à Paris M. Huyghens, qui étoit, après Galilée & Descartes, celui à qui cette science devoit le plus. Il lut le traité de horologio oscillatorio ; il médita les ouvrages de Pascal & de Grégoire de S. Vincent, & il imagina une méthode dont il retrouva dans la suite des traces profondes dans Grégori, Barrow & d'autres. C'est ce calcul par lequel il se glorifie d'avoir soumis à l'analyse des choses qui ne l'avoient jamais été.
Quoi qu'il en soit de cette histoire que Léibnitz a faite de ses découvertes à la sollicitation de Mrs Bernoulli, il est sûr que l'on apperçoit des infiniment petits de différens ordres dans son traité du mouvement abstrait, publié en 1671 ; que le calcul différentiel parut en 1684 ; que les principes mathématiques de Newton ne furent publiés qu'en 1687, & que celui-ci ne revendiqua point cette découverte. Mais Newton, depuis que ses amis eurent élevé la querelle, n'en demeura pas moins tranquille, comme Dieu au milieu de sa gloire.
Léibnitz avoit entrepris un grand ouvrage de la science de l'infini ; mais il n'a pas été fini.
De ses hautes spéculations il descendit souvent à des choses d'usage. Il proposa des machines pour l'épuisement des eaux, qui font abandonner quelquefois & interrompent toujours les travaux des mines.
Il employa une partie de son tems & de sa fortune à la construction d'une machine arithmétique, qui ne fut entierement achevée que dans les dernieres années de sa vie.
Nous avons montré jusqu'ici Léibnitz comme poëte, jurisconsulte & mathématicien ; nous l'allons considérer comme métaphysicien, ou comme homme remontant des cas particuliers à des lois générales. Tout le monde connoît son principe de la raison suffisante & de l'harmonie préétablie, son idée de la monade. Mais nous n'insisterons point ici là-dessus ; nous renvoyons aux différens articles de ce Dictionnaire, & à l'exposition abregée de la philosophie de Léibnitz, qui terminera celui-ci.
Il s'éleva en 1715 une dispute entre lui & le fameux M. Clarke sur l'espace, le tems, le vuide, les atomes, le naturel, le surnaturel, la liberté & autres sujets non moins importans qu'épineux.
Il en avoit eu une autre avec un disciple de Socin, appellé Wissoratius, en 1671, sur la Trinité ; car Léibnitz étoit encore théologien dans le sens strict de ce mot, & publia contre son adversaire un écrit intitulé Sacro-sancta Trinitas per nova inventa logicae defensa. C'est toujours le même esprit qui regne dans les ouvrages de Léibnitz. A l'occasion d'une question sur les mysteres, il propose des moyens de perfectionner la Logique, & il expose les défauts de celle qu'on suivoit. Il fut appellé aux conférences qui se tinrent vers le commencement de ce siecle sur le mariage d'un grand prince catholique & d'une princesse luthérienne. Il releva M. Burnet, évêque de Salisbury, sur les vûes peu exactes qu'il avoit eues dans son projet de réunion de l'église anglicane avec l'église luthérienne. Il défendit la tolérance des religions contre M. Pelisson. Il mit au jour la Théodicée en 1711 : c'est une réponse aux difficultés de Bayle sur l'origine du mal physique & du mal moral.
Nous devrions présentement avoir épuisé Léibnitz ; cependant il ne l'est pas encore. Il conçut le projet d'une langue philosophique qui mît en société toutes les nations : mais il ne l'exécuta point ; il remarqua seulement que des savans de son tems, qui avoient eu la même vûe que lui, perdoient leur tems, & ne frappoient pas au vrai but.
Après cette ébauche de la vie savante de Léibnitz, nous allons passer à quelques détails de sa vie particuliere.
Il étoit de la société secrette des alchimistes de Nuremberg, lorsque M. le baron de Boinebourg, ministre de l'électeur de Mayence, Jean-Philippe, rencontré par hasard dans une hôtellerie, reconnut son mérite, lui fit des offres, & l'attacha à son maître. En 1688 l'électeur de Mayence le fit conseiller de la chambre de révision de sa chancellerie. M. de Boinebourg avoit envoyé son fils à Paris ; il engagea Léibnitz à faire le voyage, & à veiller à ses affaires particulieres & à la conduite de son fils. M. de Boinebourg mourut en 1673, & Léibnitz passa en Angleterre, où peu de tems après il apprit la mort de l'électeur : cet évenement renversa les commencemens de sa fortune ; mais le duc de Brunswic Lunebourg s'empara de lui pendant qu'il étoit vacant, & le gratifia de la place de conseiller & d'une pension. Cependant il ne partit pas sur le champ pour l'Allemagne. Il revint à Paris, d'où il retourna en Angleterre ; & ce ne fut qu'en 1676 qu'il se rendit auprès du duc Jean Frederic, qu'il perdit au bout de trois ans. Le duc Ernest Auguste lui offrit sa protection, & le chargea de l'histoire de Brunswic : nous avons parlé de cet ouvrage & des voyages qu'il occasionna. Le duc Ernest le nomma en 1696 son conseiller-privé de justice : on ne croit pas en Allemagne qu'un philosophe soit incapable d'affaires. En 1699 l'académie des sciences de Paris le mit à la tête de ses associés étrangers. Il eût trouvé dans cette capitale un sort assez doux, mais il falloit changer de religion, & cette condition lui déplut. Il inspira à l'électeur de Brandebourg le dessein d'établir une académie à Berlin, & ce projet fut exécuté en 1700 d'après ses idées : il en fut nommé président perpétuel, & ce choix fut généralement applaudi.
En 1710 parut un volume de l'académie de Berlin, sous le titre de Miscellanea Berolinensia. Léibnitz s'y montra sous toutes ses formes, d'historien, d'antiquaire, d'étymologiste, de physicien, de mathématicien, & même d'orateur.
Il avoit les mêmes vûes sur les états de l'électeur de Saxe ; & il méditoit l'établissement d'une autre académie à Dresde, mais les troubles de la Pologne ne lui laisserent aucune espérance de succès.
En revanche le Czar, qui étoit allé à Torgau pour le mariage de son fils aîné & de Charlote-Christine, vit Léibnitz, le consulta sur le dessein où il étoit de tirer ses peuples de la barbarie, l'honora de présens, & lui conféra le titre de son conseiller-privé de justice, avec une pension considérable.
Mais toute prospérité humaine cesse ; le roi de Prusse mourut en 1713, & le goût militaire de son successeur détermina Léibnitz à chercher un nouvel asyle aux sciences. Il se tourna du côté de la cour impériale, & obtint la faveur du prince Eugène ; peut-être eût-il fondé une académie à Vienne, mais la peste survenue dans cette ville rendit inutiles tous ses mouvemens.
Il étoit à Vienne en 1714 lorsque la reine Anne mourut. L'électeur d'Hanovre lui succéda. Léibnitz se rendit à Hanovre, mais il n'y trouva pas le roi, & il n'étoit plus d'âge à le suivre. Cependant le roi d'Angleterre repassa en Allemagne, & Léibnitz eut la joie qu'il desiroit : depuis ce tems sa santé s'affoiblit toujours. Il étoit sujet à la goutte ; ce mal lui gagna les épaules, & une ptisane dont un jésuite d'Ingolstad lui avoit donné la recette, lui causa des convulsions & des douleurs excessives, dont il mourut le 14 Novembre 1716.
Dans cet état il méditoit encore. Un moment avant que d'expirer il demanda de l'encre & du papier : il écrivit ; mais ayant voulu lire ce qu'il avoit écrit, sa vûe s'obscurcit, & il cessa de vivre, âgé de 70 ans. Il ne se maria point ; il étoit d'une complexion forte ; il n'avoit point eu de maladies que quelques vertiges & la goutte. Il étoit sombre, & passoit souvent les nuits dans un fauteuil. Il étudioit des mois entiers de suite ; il faisoit des extraits de toutes ses lectures. Il aimoit à converser avec toute sorte de personnes, gens de cour, soldats, artisans, laboureurs. Il n'y a guere d'ignorans dont on ne puisse apprendre quelque chose. Il aimoit la société des femmes, & elles se plaisoient en la sienne. Il avoit une correspondance littéraire très-étendue. Il fournissoit des vûes aux savans ; il les animoit ; il leur applaudissoit ; il chérissoit autant la gloire des autres que la sienne. Il étoit colere, mais il revenoit promtement ; il s'indignoit d'abord de la contradiction, mais son second mouvement étoit plus tranquille. On l'accuse de n'avoir été qu'un grand & rigide observateur du droit naturel : ses pasteurs lui en ont fait des réprimandes publiques & inutiles. On dit qu'il aimoit l'argent ; il avoit amassé une somme considérable qu'il tenoit cachée. Ce trésor, après l'avoir tourmenté d'inquiétudes pendant sa vie, fut encore funeste à son héritiere ; cette femme, à l'aspect de cette richesse, fut si saisie de joie, qu'elle en mourut subitement.
Il ne nous reste plus qu'à exposer les principaux axiomes de la philosophie de Léibnitz. Ceux qui voudront connoître plus à fond la vie, les travaux & le caractere de cet homme extraordinaire, peuvent consulter les actes des savans, Kortholt, Eckard, Baringius, les mémoires de l'académie des sciences, l'éloge de Fontenelle, Fabricius, Feller, Grundmann, Gentzkennius, Reimann, Collins, Murat, Charles Gundelif-Ludovici. Outre Thomasius dont nous avons parlé, il avoit eu pour instituteur en Mathématiques Kunnius, & en Philosophie Scherzer & Rappolt. Ce fut Weigel qui lui fit naître l'idée de son arithmétique binaire, ou de cette méthode d'exprimer tout nombre avec les deux caracteres 1 & 0. Il revint sur la fin de sa vie au projet de l'Encyclopédie, qui l'avoit occupé étant jeune, & il espéroit encore l'exécuter de concert avec Wolf. Il fut chargé par M. de Montausier de l'édition de Martien-Capella, à l'usage du Dauphin : l'ouvrage étoit achevé lorsqu'on le lui vola. Il s'en manque beaucoup que nous ayons parlé de tous ses ouvrages. Il en a peu publié séparément ; la plus grande partie est dispersée dans les journaux & les recueils d'académies ; d'où l'on a tiré sa protogée, ouvrage qui n'est pas sans mérite, soit qu'on le considere par le fond des choses, soit qu'on n'ait égard qu'à l'élevation du discours.
I. Principes des méditations rationnelles de Léibnitz. Il disoit : la connoissance est ou claire ou obscure, & la connoissance claire est ou confuse ou distincte, & la connoissance distincte est ou adéquate ou inadéquate, ou intuitive ou symbolique.
Si la connoissance est en même tems adéquate & intuitive, elle est très-parfaite ; si une notion ne suffit pas à la connoissance de la chose représentée, elle est obscure, si elle suffit, elle est claire.
Si je ne puis énoncer séparément les caracteres nécessaires de distinction d'une chose à une autre, ma connoissance est confuse, quoique dans la nature la chose ait de ces caracteres, dans l'énumération exacte desquels elle se limiteroit & se résoudroit.
Ainsi les odeurs, les couleurs, les saveurs & d'autres idées relatives aux sens, nous sont assez clairement connues : la distinction que nous en faisons est juste ; mais la sensation est notre unique garant. Les caracteres qui distinguent ces choses ne sont pas énonciables. Cependant elles ont des causes : les idées en sont composées ; & il semble que s'il ne manquoit rien, soit à notre intelligence, soit à nos recherches, soit à nos idiomes, il y auroit une certaine collection de mots dans lesquels elles pourroient se résoudre & se rendre.
Si une chose a été suffisamment examinée ; si la collection des signes qui la distinguent de toute autre est complexe, la notion que nous en aurons sera distincte : c'est ainsi que nous connoissons certains objets communs à plusieurs sens, plusieurs affections de l'ame, tout ce dont nous pouvons former une définition verbale ; car qu'est-ce que cette définition, sinon une énumération suffisante des caracteres de la chose ?
Il y a cependant connoissance distincte d'une chose indéfinissable, toutes les fois que cette chose est primitive, qu'elle est elle-même son propre caractere, ou que s'entendant par elle-même, elle n'a rien d'antérieur ou de plus connu en quoi elle soit résoluble.
Dans les notions composées, s'il arrive, ou que la somme des caracteres ne se saisisse pas à la fois, ou qu'il y en ait quelques-uns qui échappent ou qui manquent, ou que la perception nette, générale ou particuliere des caracteres, soit momentanée & fugitive, la connoissance est distincte, mais inadéquate.
Si tous les caracteres de la chose sont permanens, bien rendus & bien saisis ensemble & séparément, c'est-à-dire que la résolution & l'analyse s'y fassent sans embarras & sans défaut, la connoissance est adéquate.
Nous ne pouvons pas toujours embrasser dans notre entendement la nature entiere d'une chose très-composée : alors nous nous servons de signes qui abregent ; mais nous avons, ou la conscience ou la mémoire que la résolution ou l'analyse entiere est possible, & s'exécutera quand nous le voudrons ; alors la connoissance est aveugle ou symbolique.
Nous ne pouvons pas saisir à la fois toutes les notions particulieres qui forment la connoissance complete d'une chose très-composée. C'est un fait. Lorsque la chose se peut, notre connoissance est intuitive autant qu'elle peut l'être. La connoissance d'une chose primitive & distincte est intuitive ; celle de la plûpart des choses composées est symbolique.
Les idées des choses que nous connoissons distinctement, ne nous sont présentes que par une opération intuitive de notre entendement.
Nous croyons à tort avoir des idées des choses, lorsqu'il y a quelques termes dont l'explication n'a point été faite, mais supposée.
Souvent nous n'avons qu'une notion telle quelle des mots, une mémoire foible d'en avoir connu autrefois la valeur, & nous nous en tenons à cette connoissance aveugle, sans nous embarrasser de suivre l'analyse des expressions aussi loin & aussi rigoureusement que nous le pourrions. C'est ainsi que nous échappe la contradiction enveloppée dans la notion d'une chose composée.
Qu'est-ce qu'une définition nominale ? Qu'est-ce qu'une définition réelle ? Une définition nominale, c'est l'énumération des caracteres qui distinguent une chose d'une autre. Une définition réelle, celle qui nous assure, par la comparaison & l'explication des caracteres, que la chose définie est possible. La définition réelle n'est donc pas arbitraire ; car tous les caracteres de la définition nominale ne sont pas toujours compatibles.
La science parfaite exige plus que des définitions nominales, à-moins qu'on ne sache d'ailleurs que la chose définie est possible.
La notion est vraie si la chose est possible ; fausse, s'il y a contradiction entre ses caracteres.
La possibilité de la chose est connue à priori ou à posteriori.
Elle est connue à priori lorsque nous résolvons sa notion en d'autres d'une possibilité avouée, & dont les caracteres n'impliquent aucune contradiction : il en est ainsi toutes les fois que la maniere dont une chose peut être produite nous est connue ; d'où il s'ensuit qu'entre toutes les définitions, les plus utiles ce sont celles qui se font par les causes.
La possibilité est connue à posteriori lorsque l'existance actuelle de la chose nous est constatée ; car ce qui est ou a été est possible.
Si l'on a une connoissance adéquate, l'on a aussi la connoissance à priori de la possibilité ; car en suivant l'analyse jusqu'à sa fin, si l'on ne rencontre aucune contradiction, il naît la démonstration de la possibilité.
Il est un principe dont il faut craindre l'abus ; c'est que l'on peut dire une chose, & qu'on dira vrai, si l'on affirme ce que l'on en apperçoit clairement & distinctement. Combien de choses obscures & confuses paroissent claires & distinctes à ceux qui se pressent de juger ! L'axiome dont il s'agit est donc superflu, si l'on n'a établi les regles de la vérité des idées, & les marques de la clarté & de la distinction, de l'obscurité & de la confusion.
Les regles que la Logique commune prescrit sur les caracteres des énonciations de la vérité, ne sont méprisables que pour ceux qui les ignorent, & qui n'ont ni le courage ni la sagacité nécessaires pour les apprendre : ne sont-ce pas les mêmes que celles des Géometres ? Les uns & les autres ne prescrivent-ils pas de n'admettre pour certain que ce qui est appuyé sur l'expérience ou la démonstration. Une démonstration est solide si elle garde les formes prescrites par la Logique. Il ne s'agit pas toujours de s'assujettir à la forme du syllogisme, mais il faut que tout raisonnement soit réductible à cette forme & qu'elle donne évidemment force à la conclusion.
Il ne faut donc rien passer des prémisses ; tout ce qu'elles renferment doit avoir été ou démontré, ou supposé : dans le cas de supposition, la conclusion est hypothétique.
On ne peut ni trop louer, ni s'assujettir trop sévérement à la regle de Pascal, qui veut qu'un terme soit défini pour peu qu'il soit obscur, & qu'une proposition soit prouvée pour peu qu'elle soit douteuse. Avec un peu d'attention sur les principes qui précedent, on verra comment ces deux conditions peuvent se remplir.
C'est une opinion fort ancienne que nous voyons tout en Dieu, & cette opinion bien entendue n'est pas à mépriser.
Quand nous verrions tout en Dieu, il ne seroit pas moins nécessaire à l'homme d'avoir des idées propres, ou des sensations, ou des mouvemens d'ame, ou des affections correspondantes à ce que nous appercevrions en Dieu. Notre ame subit autant de changemens successifs, qu'il s'y succede de pensées diverses. Les idées des choses auxquelles nous ne pensons pas actuellement, ne sont donc pas autrement dans notre ame que la figure d'Hercule dans un bloc de marbre informe.
Dieu n'a pas seulement l'idée actuelle de l'étendue absolue & infinie, mais l'idée de toute figure ou modification de cette étendue.
Qu'est-ce qui se passe en nous dans la sensation des couleurs & des odeurs ? Des mouvemens de fibres, des changemens de figures, mais si déliés qu'ils nous échappent. C'est par cette raison qu'on ne s'apperçoit pas que c'est là pourtant tout ce qui entre dans la perception composée de ces choses.
II. Métaphysique de Léibnitz, ou ce qu'il a pensé des élémens des choses. Qu'est-ce que la monade ? une substance simple. Les composés en sont formés. Je l'appelle simple, parce qu'elle n'a point de parties.
Puisqu'il y a des composés, il faut qu'il y ait des substances simples ; car qu'est-ce qu'un composé, sinon un aggrégat de simples ?
Où il n'y a point de parties, il n'y a ni étendue, ni figure ni divisibilité. Telle est la monade, l'atome réel de la nature, l'élément vrai des choses.
Il ne faut pas en craindre la dissolution. On ne conçoit aucune maniere dont une substance simple puisse périr naturellement. On ne conçoit aucune maniere dont une substance simple puisse naître naturellement. Car tout ce qui périt, périt par dissolution ; tout ce qui se forme, se forme par composition.
Les monades ne peuvent donc être ou cesser que dans un instant, par création ou par annihilation.
On ne peut expliquer comment il surviendroit en elles quelque altération naturelle : ce qui n'a point de parties, n'admet l'interception ni d'un accident, ni d'une substance.
Il faut cependant qu'elles ayent quelques qualités, sans quoi on ne les distingueroit pas du non être.
Il faut plus ; c'est qu'une monade différe d'une autre monade quelconque, car il n'y a pas dans la nature un seul être qui soit absolument égal & semblable à un autre, ensorte qu'il ne soit possible d'y reconnoître une différence interne & applicable à quelque chose d'interne. Il n'y a peut-être rien de moins raisonnable que ce principe pour ceux qui ne pensent que superficiellement, & rien de plus vrai pour les autres. Il n'est pas nouveau : c'étoit une des opinions des Stoïciens.
Tout être créé est sujet au changement. La monade est créée, chaque monade est donc dans une vicissitude continuelle.
Les changemens de la monade naturelle partent d'un principe interne, car aucune cause externe ne peut influer sur elle.
En général il n'y a point de force quelle qu'elle soit, qui ne soit un principe de changement.
Outre un principe de changement, il faut encore admettre dans ce qui change quelque forme, quelque modele qui spécifie & différencie. De-là, multitude dans le simple, nombre dans l'unité, car tout changement naturel se fait par degrés. Quelque chose change & quelque chose reste non changée. Donc dans la substance il y a pluralité d'affections, de qualités & de rapports, quoiqu'il y ait absence de parties.
Qu'est-ce qu'un état passager qui marque multitude & pluralité dans l'être simple & dans la substance une ? On n'en conçoit point d'autre que ce que nous appellons perception, chose très-distincte de ce que nous entendons par conscience, car il y a perception avant conscience. Ce principe est très-difficile à attaquer, & très-difficile à défendre. C'est selon Léibnitz, ce qui constitue la différence de la monade & de l'esprit, de l'être corporel & de l'être intellectuel.
L'action d'un principe interne, cause de mutation ou de passage d'une perception à une autre, est ce qu'on peut appeller appétit. L'appétit n'atteint pas toujours à la perception à laquelle il tend, mais il en approche, pour ainsi dire, & quelque légere que soit cette altération, il en naît des perceptions nouvelles.
Il ne faut point appliquer les causes méchaniques à ces perceptions, ni à leurs résultats ; parce qu'il n'y a ni mouvement, ni figure, ni parties agissantes & réagissantes. Ces perceptions & leurs changemens sont tout ce qu'il y a dans la substance simple. Elles constituent toutes les actions internes.
On peut, si l'on veut, donner le nom d'entéléchie à toutes les substances simples ou monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection propre, une suffisance essentielle, elles sont elles-mêmes les causes de leurs actions internes. Ce sont comme des automates incorporels : quelle différence y a-t-il entre ces êtres & la molécule sensible d'Hobbes ? Je ne l'entends pas. L'axiome suivant m'incline bien davantage à croire que c'est la même chose.
Si l'on veut appeller ame ce qui en général a perception & appétit, je ne m'oppose pas à ce qu'on regarde les substances simples ou les monades créées comme des ames. Cependant la perception étant où la connoissance n'est pas, il vaudroit mieux s'en tenir pour les substances simples qui n'ont que la perception aux mots de monades ou d'entéléchies, & pour les substances qui ont la perception & la mémoire ou conscience aux mots d'ame & d'esprit.
Dans la défaillance, dans la stupeur ou le sommeil profond, l'ame qui ne manque pas tout-à-fait de perception, ne differe pas d'une simple monade. L'état présent d'une substance simple procede naturellement de son état précédent, ainsi le présent est gros de l'avenir.
Lorsque nous sortons du sommeil, de la défaillance, de la stupeur, nous avons la conscience de nos perceptions ; il faut donc qu'il n'y ait eu aucune interruption absolue, qu'il y ait eu des perceptions immédiatement précédentes & contiguës, quoique nous n'en ayons pas la conscience. Car la perception est engendrée de la perception, comme le mouvement du mouvement : cet axiome fécond mérite le plus grand examen.
Il paroît que nous serions dans un état de stupeur parfaite, tant que nous ne distinguerions rien à nos perceptions. Or cet état est celui de la monade pure.
Il paroît encore que la nature en accordant aux animaux des organes qui rassemblent plusieurs rayons de lumiere, plusieurs ondulations de l'air, dont l'efficacité est une suite de leur union ou multitude, elle a mis en eux la cause de perceptions sublimes. Il faut raisonner de la même maniere de la saveur, des odeurs & du toucher. C'est par la mémoire que les perceptions sont liées dans les ames. La mémoire imite la raison, mais ce ne l'est pas.
Les animaux apperçoivent un objet, ils en sont frappés, ils s'attendent à une perception ou sensation semblable à celle qu'ils ont éprouvée antérieurement de la part de cet objet ; ils se meuvent, mais ils ne raisonnent pas ; ils ont la mémoire.
L'imagination forte qui nous frappe & nous meut, naît de la fréquence & de l'énergie des perceptions précédentes.
L'effet d'une seule impression forte équivaut quelquefois à l'effet habituel & réitéré d'une impression foible & durable.
Les hommes ont de commun avec les animaux le principe qui lie leurs perceptions. La mémoire est la même en eux. La mémoire est un medecin empyrique qui agit par expérience sans théorie.
C'est la connoissance des vérités nécessaires & éternelles qui distingue l'homme de la bête. C'est elle qui fait en nous la raison & la science, l'ame. C'est à la connoissance des vérités nécessaires & éternelles, & à leurs abstractions qu'il faut rapporter ces actes réfléchis qui nous donnent la conscience de nous.
Ces actes réfléchis sont la source la plus féconde de nos raisonnemens. C'est l'échelle par laquelle nous nous élevons à la pensée de l'être, de la substance simple ou complexe, de l'immatériel, de l'éternel, de Dieu. Nous concevons que ce qui est limité en nous existe en lui sans limites.
Nos raisonnemens ont deux grandes bases, l'une est le principe de contradiction, l'autre est le principe de raison suffisante.
Nous regardons comme faux tout ce qui implique contradiction, nous pensons que rien n'est sans une raison suffisante, pourquoi cela est ainsi & non autrement, quoique souvent cette raison ne nous soit pas connue. Ce principe n'est pas nouveau ; les anciens l'ont employé.
Si une vérité est nécessaire, on peut la résoudre dans ses élémens, & parvenir par analyse ou voie de décomposition à des idées primitives, où se consomme la démonstration.
Il y a des idées simples qui ne se définissent point. Il y a aussi des axiomes, des demandes, des principes primitifs qui ne se prouvent point. La preuve & la définition seroient identiques à l'énonciation.
On peut découvrir la raison suffisante dans les choses contingentes ou de fait. Elle est dans l'enchaînement universel : il y a une résolution ou analyse successive de causes ou de raisons particulieres, à d'autres raisons ou causes particulieres, & ainsi de suite.
Cependant toute cette suite ne nous menant que de contingence en contingence, & la derniere n'exigeant pas moins une analyse progressive que la premiere, on ne peut s'arrêter : pour arriver à la certitude, il faut tenir la raison suffisante ou derniere, fût-elle à l'infini.
Mais où est cette raison suffisante & derniere, sinon dans quelque substance nécessaire, source & principe de toutes mutations ?
Et quelle est cette substance, terme dernier de la serie, sinon Dieu ? Dieu est donc, & il suffit.
Cette substance une, suprême, universelle, nécessaire n'a rien hors d'elle qui n'en dépende. Elle est donc illimitée, elle contient donc toute réalité possible, elle est donc parfaite ; car qu'est-ce que la perfection, sinon l'illimité d'une grandeur réelle & positive ?
D'où il suit que la créature tient de Dieu sa perfection & les imperfections de sa nature, de son essence incapable de l'illimité. Voilà ce qui la distingue de Dieu.
Dieu est la source & des existences & des essences, & de ce qu'il y a de réel dans le possible. L'entendement divin est le sein des vérités essentielles. Sans Dieu, rien de réel ni dans le possible, ni dans l'existant, ni même dans le néant.
En effet s'il y a quelque réalité dans les essences, dans les existences, dans les possibilités, cette réalité est fondée dans quelque chose d'existant & de réel, & conséquemment dans la nécessité d'un être auquel il suffise d'être possible pour être existant. Ceci n'est que la démonstration de Descartes retournée.
Dieu est le seul être qui ait ce privilege d'être nécessairement, s'il est possible ; or rien ne montrant de la contradiction dans sa possibilité, son existence est donc démontrée à priori. Elle l'est encore à posteriori, car les contingens sont ; or ces contingens n'ont de raison suffisante & derniere que dans un être nécessaire, ou qui ait en lui-même la raison de son existence.
Il ne faut pas inférer de-là que les vérités éternelles qui ne se voyent pas sans Dieu, soient dépendantes de sa volonté & arbitraires.
Dieu est une unité ou substance simple, origine de toutes les monades créées, qui en sont émanées, pour ainsi dire, par des fulgurations continuelles. Nous nous sommes servis de ce mot fulguration, parce que nous n'en connoissons point d'autre qui lui réponde. Au reste, cette idée de Léibnitz est toute platonicienne, & pour la subtilité & pour la sublimité.
Il y a en Dieu, puissance, entendement & volonté ; puissance, qui est l'origine de tout ; entendement, où est le modele de tout ; volonté, par qui tout s'exécute pour le mieux.
Il y a aussi dans la monade les mêmes qualités correspondantes, perception & appétit ; mais perception limitée, appétit fini.
On dit que la créature agit hors d'elle-même, & souffre. Elle agit hors d'elle-même entant que parfaite, elle souffre entant qu'imparfaite.
La monade est active entant qu'elle a des perceptions distinctes, passive entant qu'elle a des perceptions confuses.
Une créature n'est plus ou moins parfaite qu'une autre, que par le principe qui la rend capable d'expliquer ce qui se passe dans elle & dans une autre ; c'est ainsi qu'elle agit sur celle-ci.
Mais dans les substances simples, l'influence d'une monade, par exemple, est purement idéale : elle n'a d'effet que par l'entremise de Dieu. Dans les idées de Dieu, l'action d'une monade se lie à l'action d'une autre, & il est la raison de l'action de toutes : c'est son entendement qui forme leurs dépendances mutuelles.
Ce qu'il y a d'actif & de passif dans les créatures, est réciproque. Dieu comparant deux substances simples, apperçoit dans l'une & l'autre la raison qui oblige l'une à l'autre. L'une est active sous un aspect, & passive sous un autre aspect ; active en ce qu'elle sert à rendre raison de ce qui arrive dans ce qui procede d'elle ; passive en ce qu'elle sert à rendre raison de ce qui arrive dans ce dont elle procede.
Cependant comme il y a une infinité de combinaisons & de mondes possibles dans les idées de Dieu, & que de ces mondes il n'en peut exister qu'un, il faut qu'il y ait une certaine raison suffisante de son choix ; or cette raison ne peut être que dans le différent degré de perfection, d'où il s'ensuit que le monde qui est, est le plus parfait. Dieu l'a choisi dans sa sagesse, connu dans sa bonté, produit dans la plénitude de sa puissance. Voilà comme Léibnitz en est venu à son système d'optimisme.
Par cette correspondance d'une chose créée à une autre, & de chacune à toutes, on conçoit qu'il y a dans chaque substance simple des rapports d'après lesquels, avec une intelligence proportionnée au tout, une monade étant donnée, l'univers entier le seroit. Une monade est donc une espece de miroir représentatif de tous les êtres & de tous les phénomenes. Cette idée que les petits esprits prendront pour une vision, est celle d'un homme de génie : pour le sentir, il n'y a qu'à la raprocher de son principe d'enchaînement & de son principe de dissimilitude.
Si l'on considere une ville sous différens points, on la voit différente ; c'est une multiplication d'optique. Ainsi la multitude des substances simples est si grande qu'on croiroit qu'il y a une infinité d'univers différens ; mais ce ne sont que des images sunographiques d'un seul considéré sous différens aspects de chaque monade. Voilà la source de la vérité, de l'ordre, de l'économie, & de la plus grande perfection possible, & cette hypothese est la seule qui réponde à la grandeur, à la sagesse & à la magnificence de Dieu.
Les choses ne peuvent donc être autrement qu'elles sont, Dieu ayant produit la monade pour le tout, le tout pour la monade qui le représente, non parfaitement, mais d'une maniere confuse, non pour elle, mais pour Dieu, sans quoi elle seroit elle-même Dieu.
La monade est limitée non dans ses rapports, mais dans sa connoissance. Toutes tendent à un même but infini. Toutes ont en elles des raisons suffisantes de cet infini, mais avec des bornes & des degrés différens de perceptions ; & ce que nous disons des simples, il faut l'entendre des composés.
Tout étant plein, tous les êtres liés, tout mouvement se transmet avec plus ou moins d'énergie à raison de la distance, tout être reçoit en lui l'impression de ce qui se passe par-tout, il en a la perception, & Dieu qui voit tout, peut lire en un seul être ce qui arrive en tous, ce qui y est arrivé & ce qui y arrivera, & il en seroit de même de la monade, si le loin des distances, des affoiblissemens ne s'exécutoit sur elle, & d'ailleurs elle est finie.
L'ame ne peut voir en elle que ce qui y est distinct ; elle ne peut donc être à toutes les perfections, parce qu'elles sont diverses & infinies.
Quoique l'ame ou toute monade créée soit représentative de l'univers, elle l'est bien mieux du corps auquel elle est attachée, & dont elle est l'entéléchie.
Or le corps, par sa connexion au tout, représentant le tout, l'ame par sa connexion au corps & au tout, le représente aussi.
Le corps & la monade, son entéléchie, constituent ce que nous appellons l'être vivant ; le corps & la monade, son ame, constitue l'animal.
Le corps d'un être, soit animal, soit vivant, est toujours organique ; car qu'est-ce que l'organisation ? un assemblage formant un tout relatif à un autre. D'où il s'ensuit que les parties sont toutes représentatives de l'universalité ; la monade par ses perceptions, le corps par sa forme & ses mouvemens, ou états divers.
Un corps organique d'un être vivant est une sorte de machine divine, surpassant infiniment tout automate artificiel. Qu'est-ce qui a pû empêcher le grand Ouvrier de produire ces machines ? la matiere n'est-elle pas divisible à l'infini, n'est-elle pas même actuellement divisée à l'infini ?
Or cette machine divine représentant le tout, n'a pû être autre qu'elle est.
Il y a donc, à parler à la rigueur, dans la plus petite portion de matiere, un monde de créatures vivantes, animales, entéléchies, ames, &c.
Il n'y a donc dans l'univers rien d'inutile, ni stérile, ni de mort, nul cahos, nulle confusion réelle.
Chaque corps a une entéléchie dominante, c'est l'ame dans l'animal ; mais ce corps a ses membres pleins d'autres êtres vivans, de plantes, d'animaux, &c. & chacun de ceux-ci a avec son ame dominante son entéléchie.
Tous les corps sont en vicissitudes, des parties s'en échappent continuellement, d'autres y entrent.
L'ame ne change point. Le corps change peu-à-peu ; il y a des métamorphoses, mais nulle métempsycose. Il n'y a point d'ames sans corps.
Conséquemment il n'y a ni génération, ni mort parfaite ; tout se réduit à des développemens & à des dépérissemens successifs.
Depuis qu'il est démontré que la putréfaction n'engendre aucun corps organique, il s'ensuit que le corps organique existoit à la conception, & que l'ame occupoit ce corps préexistant, & que l'animal étoit, & qu'il n'a fait que paroître sous une autre forme.
J'appellerois spermatiques, ces animaux qui parviennent par voie de conception à une grandeur considérable ; les autres, qui ne passent point sous des formes successives, naissant, croissant, sont multipliés & détruits.
Les grands animaux n'ont guere un autre sort ; ils ne font que se montrer sur la scene. Le nombre de ceux qui changent de théatre est petit.
Si naturellement un animal ne commence point, naturellement il ne finit point.
L'ame, miroir du monde indestructible, n'est point détruite. L'animal même perd ses enveloppes, & en prend d'autres ; mais à-travers ses métamorphoses, il reste toujours quelque chose de lui.
On déduit de ces principes l'union ou plutôt la convenance de l'ame & d'un corps organique. L'ame a ses lois qu'elle suit, & le corps les siennes. S'ils sont unis, c'est par la force de l'harmonie préétablie entre toutes les substances, dont il n'y a pas une seule qui ne soit représentative de l'univers.
Les ames agissent selon les lois des causes finales, par des appétits, par des moyens & par des fins ; les corps, selon les lois des causes efficientes ou motrices, & il y a, pour ainsi dire, deux regnes coordonnés entr'eux, l'un des causes efficientes, l'autre des causes finales.
Descartes a connu l'impossibilité que l'ame donnât quelque force ou mouvement aux corps, parce que la quantité de force reste toujours la même dans la nature, cependant il a cru que l'ame pouvoit changer la direction des corps. Ce fut une suite de l'ignorance où l'on étoit de son tems sur une loi de nature, qui veut que la même direction totale persévere dans la matiere. Avec cette connoissance de plus, & le pas qu'il avoit déja fait, il seroit infailliblement arrivé au système de l'harmonie préétablie ; selon ce système, le corps agissant, comme si par impossible il n'y avoit point d'ame, & les ames, comme si par impossible il n'y avoit point de corps, & tous les deux, comme s'ils influoient l'un sur l'autre. Il est incroyable comment deux lois méchaniques, géométriquement démontrées, l'une sur la somme du mouvement dans la nature, l'autre sur la direction des parties de la matiere, ont eu un effet sur le système de l'union de l'ame avec le corps. Je demanderois volontiers si ces spéculations physico-mathématiques & abstraites, appliquées aux choses intellectuelles, n'obscurcissent pas au lieu d'éclairer, & n'ébranlent pas plutôt la distinction des deux substances qu'elles n'en expliquent le commerce. D'ailleurs, qu'elle foule d'autres difficultés ne naissent pas de ce système Leibnitien, sur la nature & sur la grace, sur les droits de Dieu & sur les actions des hommes, sur la volonté, la liberté, le bien & le mal, les châtimens présens & à venir ! &c.
Dieu a créé l'ame dans le commencement, de maniere qu'elle se représente & produit en elle tout ce qui s'exécute dans le corps, & le corps, de maniere qu'il exécute tout ce que l'ame se représente & veut.
L'ame produit ses perceptions & ses appétits, le corps ses mouvemens, & l'action de l'une des substances conspire avec l'action de l'autre, en conséquence du concert que Dieu a ordonné entr'eux dans la formation du monde.
Une perception précédente est la cause d'une perception suivante dans l'ame. Un mouvement analogue à la perception premiere de l'ame, est la cause d'un mouvement second analogue à la seconde perception de l'ame. Il faut convenir qu'il est difficile d'appercevoir comment, au milieu de ce double changement la liberté de l'homme peut se conserver. Les Leibnitiens prétendent que cela n'y fait rien ; le croye qui pourra.
L'ame & l'animal ont la même origine que le monde, & ne finiront qu'avec lui. Les ames spermatiques des animaux raisonnables passent de l'état d'ame sensible à celui plus parfait d'ame raisonnable.
Les ames en général sont des miroirs de l'univers, des images représentatives des choses ; l'ame de l'homme est de plus un miroir représentatif, une image de son Créateur.
Tous les esprits ensemble forment la cité de Dieu, gouvernement le plus parfait de tous sous le monarque le plus parfait.
Cette cité, cette monarchie est le monde moral dans le monde naturel. Il y a aussi la même harmonie préétablie entre le regne physique de la nature & le regne moral de la grace, c'est-à-dire entre l'homme & Dieu, considéré, ou comme auteur de la grande machine, ou comme souverain de la cité des esprits.
Les choses, en conséquence de cette hypothèse, conduisent à la grace par les voies de la nature. Ce monde sera détruit & réparé par des moyens naturels, & la punition & le châtiment des esprits aura lieu sans que l'harmonie cesse. Ce dernier événement en sera le complément.
Le Dieu architecte de l'univers, satisfera au Dieu législateur, & les fautes seront punies & les vertus récompensées dans l'ordre de la justice & du méchanisme.
Nous n'avons donc rien de mieux à faire que de fuir le mal & de suivre le bien, convaincus que nous ne pourrions qu'approuver ce qui se passe dans le physique & dans le moral, s'il nous étoit donné d'embrasser le tout.
III. Principes de la théologie naturelle de Léibnitz. En quoi consiste la toute-puissance de Dieu, sinon dans ce que tout dépend de lui, & qu'il ne dépend de rien.
Dieu est indépendant & dans son existence & dans ses actions.
Dans son existence, parce qu'il est nécessaire & éternel.
Dans ses actions, naturellement & moralement ; naturellement, parce qu'il est libre ; moralement, parce qu'il n'a point de supérieur.
Tout dépend de Dieu, & les possibles & les existans.
Les possibles ont leur réalité dans son existence. S'il n'existoit pas, il n'y auroit rien de possible. Les possibles sont de toute éternité dans ses idées.
Les existans dépendent de Dieu, & dans leur existence & dans leurs actions ; dans leur existence, parce qu'il les a créées librement, & qu'il les conserve de même ; dans leurs actions, parce qu'il y concourt, & que le peu de bien qu'elles ont vient de lui.
Le concours de Dieu est ou ordinant ou spécial.
Dieu sait tout, connoît tout, & les possibles & les existans. Les existans dans ce monde, les possibles dans les mondes possibles.
La science des existans passés, présens & futurs, s'appelle science de vision. Elle ne differe point de la science de simple intelligence de ce monde, considéré seulement comme possible : si ce n'est qu'en même tems que Dieu le voit possible, il le voit aussi comme devant être créé.
La science de simple intelligence prise dans un sens plus strict, relativement aux vérités nécessaires & possibles, s'appelle science moyenne, relativement aux vérités possibles & contingentes ; & science de vision, relativement aux vérités contingentes & actuelles.
Si la connoissance du vrai constitue la sagesse, le desir du bien constitue la bonté. La perfection de l'entendement dépend de l'une, la perfection de la volonté dépend de l'autre.
La nature de la volonté suppose la liberté, & la liberté suppose la spontanéité & la délibération, conditions sous lesquelles il y a nécessité.
Il y a deux nécessités, la métaphysique qui implique l'impossibilité d'agir, la morale qui implique inconvénient à agir plutôt ainsi qu'autrement. Dieu n'a pû se tromper dans le choix. Sa liberté n'en est que plus parfaite. Il y avoit tant d'ordres possibles de choses, différens de celui qu'il a choisi. Louons sa sagesse & sa bonté, & n'en concluons rien contre sa liberté.
Ceux-là se trompent qui prétendent qu'il n'y a de possible que ce qui est.
La volonté est antécédente ou conséquente. Par l'antécédente, Dieu veut que tout soit bien, & qu'il n'y ait point de mal ; par la conséquente, qu'il y ait le bien qui est, & le mal qui est, parce que le tout ne pourroit être autrement.
La volonté antécédente n'a pas son plein effet ; la conséquente l'a.
La volonté de Dieu se divise encore en productive & en permissive. Il produit ses actes, il permet les nôtres.
Le bien & le mal peuvent être considérés sous trois points de vûe, le métaphysique, le physique & le moral. Le métaphysique est relatif à la perfection & à l'imperfection des choses non intelligentes ; le physique, aux commodités & aux incommodités des choses intelligentes ; le moral, à leurs actions vertueuses ou vicieuses.
Dans aucun de ces cas, le mal réel n'est l'objet de la volonté productive de Dieu ; dans le dernier, il l'est de sa volonté permissive. Le bien naît toujours, même quand il permet le mal.
La providence de Dieu se montre dans tous les effets de cet univers. Il n'a proprement prononcé qu'un decret, c'est que tout fût comme il est.
Le decret de Dieu est irrévocable, parce qu'il a tout vû avant que de le porter. Nos prieres & nos travaux sont entrés dans son plan, & son plan a été le meilleur possible.
Soumettons-nous donc aux événemens ; & quelque facheux qu'ils soient, n'accusons point son ouvrage ; servons-le, obéissons-lui, aimons-le, & mettons toute notre confiance dans sa bonté.
Son intelligence, jointe à sa bonté, constitue sa justice. Il y a des biens & des maux dans ce monde, & il y en aura dans l'autre ; mais quelque petit que soit le nombre des élus, la peine des malheureux ne sera point à comparer avec la récompense des bienheureux.
Il n'y a point d'objections prises du bien & du mal moral que les principes précédens ne résolvent.
Je ne pense pas qu'on puisse se dispenser de croire que les ames prééxistentes ayent été infectées dans notre premier pere.
La contagion que nous avons contractée, nous a cependant laissé comme les restes de notre origine céleste, la raison & la liberté ; la raison, que nous pouvons perfectionner ; la liberté, qui est exemte de nécessité & de coaction.
La futurition des choses, la préordination des événemens, la préscience de Dieu, ne touchent point à notre liberté.
IV. Exposition des principes que Léibnitz opposa à Clarke dans leur dispute. Dans les ouvrages de Dieu, la force se conserve toujours la même. Elle passe de la matiere à la matiere, selon les lois de la nature & l'ordre le meilleur préétabli.
Si Dieu produit un miracle, c'est une grace & non un effet de nature ; ce n'est point aux mathématiques, mais à la métaphysique qu'il faut recourir contre l'impiété.
Le principe de contradiction est le fondement de toute vérité mathématique ; c'est par celui de la raison suffisante, qu'on passe des mathématiques à la physique. Plus il y a de matiere dans l'univers, plus Dieu a pu exercer sa sagesse & sa puissance. Le vuide n'a aucune raison suffisante.
Si Dieu sait tout, ce n'est pas seulement par sa présence à tout, mais encore par son opération ; il conserve par la même action qu'il a produite, & les êtres, & tout ce qu'il y a en eux de perfection.
Dieu a tout prévû, & si les créatures ont un besoin continuel de son secours, ce n'est ni pour corriger ni pour améliorer l'univers.
Ceux qui prennent l'espace pour un être absolu, s'embarrassent dans de grandes difficultés ; ils admettent un être éternel, infini, qui n'est pas Dieu, car l'espace a des parties, & Dieu n'en a pas.
L'espace & le tems ne sont que des relations. L'espace est l'ordre des co-existences ; le tems, l'ordre des successions.
Ce qui est surnaturel surpasse les forces de toute créature ; c'est un miracle ; une volonté sans motif est une chimere, contraire à la nature de la volonté, & à la sagesse de Dieu.
L'ame n'a point d'action sur le corps ; ce sont deux êtres qui conspirent en conséquence des lois de l'harmonie préétablie.
Il n'y a que Dieu qui puisse ajoûter des forces à la nature, & c'est une action miraculeuse & surnaturelle.
Les images dont l'ame est affectée immédiatement, sont en elle ; mais elles sont coordonnées avec les actions du corps.
La présence de l'ame au corps n'est qu'imparfaite.
Celui qui croit que les forces actives & vives souffrent de la diminution dans l'univers, n'entend ni les loix primitives de la nature, ni la beauté de l'oeuvre divine.
Il y a des miracles, les uns que les anges peuvent opérer, d'autres qui sont dans la puissance de Dieu seul, comme anéantir ou créer.
Ce qui est nécessaire, l'est essentiellement, & ce qui est contingent doit son existence à un être meilleur, qui est la raison suffisante des choses.
Les motifs inclinent, mais ne forcent point. La conduite des contingens est infaillible, mais n'est pas nécessaire.
La volonté ne suit pas toûjours la décision de l'entendement ; on prend du tems pour un examen plus mûr.
La quantité n'est pas moins des choses relatives, que des choses absolues ; ainsi quoique le tems & l'espace soient des rapports, ils ne sont pas moins appréciables.
Il n'y a point de substance créée, absolument sans matiere. Les anges même y sont attachés.
L'espace & la matiere ne sont qu'un. Point d'espace où il n'y a point de matiere.
L'espace & la matiere ont entr'eux la même différence que le tems & le mouvement : quoique différens, ils ne sont jamais séparés.
La matiere n'est éternelle & nécessaire que dans la fausse supposition de la nécessité & de l'éternité de l'espace.
Le principe des indiscernables renverse l'hypothèse des atômes & des corps similaires.
On ne peut conclure de l'étendue à la durée.
Si l'univers se perfectionne ou se détériore, il a commencé.
L'univers peut avoir eu un commencement, & ne point avoir de fin. Quoi qu'il en soit, il y a des limites.
Le monde ne seroit pas soustrait à la toute-puissance de Dieu par son éternité. Il faut remonter à la monade, pour y trouver la cause de l'harmonie universelle. C'est par elle qu'on lie un état conséquent à un autre antécédent. Tout être qui suit des causes finales, est libre, quoiqu'il agisse de concert avec un être assujetti, sans connoissance, à des causes efficientes.
Si l'universalité des corps s'accroît d'une force nouvelle, c'est par miracle, car cet accroissement se fait dans un lieu, sans qu'il y ait diminution dans un autre. S'il n'y avoit point de créatures, il n'y auroit ni tems ni espace, & l'extrémité & l'immensité de Dieu cesseroient.
Celui qui niera le principe de la raison suffisante, sera réduit à l'absurde.
V. Principes du droit naturel, selon Léibnitz. Le droit est une sorte de puissance morale ; & l'obligation, une nécessité du même genre. On entend par moral ce qui auprès d'un homme de bien équivaut au naturel. L'homme de bien est celui qui aime tous ses semblables, autant que la raison le permet. La justice, ou cette vertu qui regle le sentiment, que les Grecs ont désignée sous le nom de philantropie, est la charité du sage. La charité est une bienveillance universelle ; & la bienveillance, une habitude d'aimer. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'un autre, ou faire de sa félicité une partie de la sienne. Si un objet est beau & sensible en même tems, on l'aime d'amour. Or comme il n'y a rien de si parfait que Dieu, rien de plus heureux, rien de plus puissant, rien d'aussi sage ; il n'y a pas d'amour supérieur à l'amour divin. Si nous sommes sages, c'est-à-dire, si nous aimons Dieu, nous participerons à son bonheur, & il fera le nôtre.
La sagesse n'est autre chose que la science du bonheur ; voilà la source du droit naturel, dont il y a trois degrés : droit strict dans la justice commutative ; équité, ou plus rigoureusement, charité dans la justice distributive, & piété ou probité dans la justice universelle. De-là naissent les préceptes de n'offenser personne, de rendre à chacun ce qui lui appartient, de bien vivre.
C'est un principe de droit strict, qu'il ne faut offenser personne, afin qu'on n'ait point d'action contre nous dans la cité, point de ressentiment hors de la cité, de-là naît la justice commutative.
Le degré supérieur au droit strict peut s'appeller équité, ou si l'on aime mieux, charité, vertu qui ne s'en tient pas à la rigueur du droit strict, mais en conséquence de laquelle on contracte des obligations qui empêchent ceux qui pourroient y être intéressés à exercer contre nous une action qui nous contraint.
Si le dernier degré est de n'offenser personne, un intermédiaire est de servir à tous, mais autant qu'il convient à chacun, & qu'ils en sont dignes ; car il n'est pas permis de favoriser tous ses semblables, ni tous également.
C'est-là ce qui constitue la justice distributive, & fonde le principe de droit qui ordonne de rendre à chacun ce qui lui est dû.
C'est ici qu'il faut rappeller les lois politiques : ces lois sont instituées dans la république pour le bonheur des sujets ; elles appuient ceux qui n'avoient que le droit, lorsqu'ils exigent des autres ce qu'il étoit juste qu'ils rendissent ; c'est à elles à peser le mérite : de-là naissent les privileges, les châtimens & les récompenses. Il s'ensuit que l'équité s'en tient dans les affaires au droit strict, & qu'elle ne perd de vûe l'égalité naturelle, que dans les cas où elle y est contrainte par la raison d'un plus grand bien ; ce qu'on appelle l'acception des personnes, peut avoir lieu dans la distribution des biens publics ou des nôtres, mais non dans l'échange des biens d'autrui.
Le premier dégré de droit ou de justice, c'est la probité ou la piété. Le droit strict garantit de la misere & du mal. Le degré supérieur au droit strict tend au bonheur, mais à ce bonheur qu'il nous est permis d'obtenir dans ce monde, sans porter nos regards au-delà ; mais si l'on se propose la démonstration universelle, que tout ce qui est honnête est utile, & que tout ce qui est deshonnête est nuisible, il faut monter à un principe plus élevé, l'immortalité de l'ame, & l'existence d'un Dieu créateur du monde, de maniere que nous soyons tous considérés comme vivans dans une cité très-parfaite, & sous un souverain si sage qu'il ne peut se tromper, si puissant que nous ne pouvons par quelque voie que ce soit, échapper à son autorité, si bon que le bonheur soit de lui obéir.
C'est par sa puissance & sa providence admise par les hommes, que ce qui n'est que droit devient fait, que personne n'est offensé ou blessé que par lui-même, qu'aucune bonne action n'existe sans récompense assurée, aucune mauvaise, sans un châtiment certain ; car rien n'est négligé dans cette république du monde, par le souverain universel.
Il y a sous ce point de vûe une justice universelle qui proscrit l'abus des choses qui nous appartiennent de droit naturel, qui nous retient la main dans le malheur, qui empêche un grand nombre d'actions mauvaises, & qui n'en commande pas un moindre nombre de bonnes ; c'est la soumission au grand monarque, à celui qui nous a fait, & à qui nous nous devons nous & le nôtre ; c'est la crainte de nuire à l'harmonie universelle.
C'est la même considération ou croyance qui fait la force du principe de droit, qu'il faut bien vivre, c'est-à-dire, honnêtement & pieusement.
Outre les lois éternelles du droit, de la raison, & de la nature, dont l'origine est divine, il en est de volontaires qui appartiennent aux moeurs, & qui ne sont que par l'autorité d'un supérieur.
Voilà l'origine du droit civil ; ce droit tient sa force de celui qui a le pouvoir en main dans la république, hors de la république de ceux qui ont le même pouvoir que lui ; c'est le consentement volontaire & tacite des peuples, qui fonde le droit des gens.
Ce droit n'est pas le même pour tous les peuples & pour tous les tems, du-moins cela n'est pas nécessaire.
La base du droit social est dans l'enceinte du droit de la nature.
Le droit des gens protege celui qui doit veiller à la liberté publique, qui n'est point soumis à la puissance d'un autre, qui peut lever des troupes, avoir des hommes en armes, & faire des traités, quoiqu'il soit lié à un supérieur par des obligations, qu'il doive foi & hommage, & qu'il ait voué l'obéissance : delà les notions de potentat, & de souverain.
La souveraineté n'exclut point une autorité supérieure à elle dans la république. Celui-là est souverain, qui jouit d'une puissance & d'une liberté telle qu'il en est autorisé à intervenir aux affaires des nations par ses armes, & à assister dans leurs traités.
Il en est de la puissance civile dans les républiques libres, comme dans la nature ; c'est ce qui a volonté.
Si les lois fondamentales n'ont pas pourvû dans la république à ce que ce qui a volonté jouisse de son droit, il y a vice.
Les actes sont des dispositions qui tiennent leur efficacité du droit, ou il faut les regarder comme des voies de fait.
Les actes qui tiennent leur efficacité du droit, sont ou judiciaires ou intrajudiciaires : ou un seul y intervient, ou plusieurs ; un seul, comme dans les testamens ; plusieurs, comme dans les conventions.
Voilà l'analyse succinte de la philosophie de Léibnitz : nous traiterons plus au long quelques-uns de ses points principaux, aux différens articles de ce Dictionnaire. Voyez OPTIMISME, RAISON SUFFISANTE, MONADES, INDISCERNABLE, HARMONIE PREETABLIE, &c.
Jamais homme peut-être n'a autant lû, autant étudié, plus médité, plus écrit que Leibnitz ; cependant il n'existe de lui aucun corps d'ouvrages ; il est surprenant que l'Allemagne à qui cet homme fait lui seul autant d'honneur que Platon, Aristote & Archimede en font ensemble à la Grece, n'ait pas encore recueilli ce qui est sorti de sa plume. Ce qu'il a composé sur le monde, sur Dieu, sur la nature, sur l'ame, comportoit l'éloquence la plus sublime. Si ces idées avoient été exposées avec le coloris de Platon, le philosophe de Leipsic ne le céderoit en rien au philosophe d'Athenes.
On s'est plaint, & avec quelque raison peut-être, que nous n'avions pas rendu à ce philosophe toute la justice qu'il méritoit. C'étoit ici le lieu de réparer cette faute si nous l'avons commise ; & nous le faisons avec joie. Nous n'avons jamais pensé à déprimer les grands hommes : nous sommes trop jaloux de l'honneur de l'espece humaine ; & puis nous aurions beau dire, leurs ouvrages transmis à la postérité déposeroient en leur faveur & contre nous ; on ne les verroit pas moins grands, & on nous trouveroit bien petits.
|
| LÉICESTER | Licestria, (Géog.) ville à marché d'Angleterre, capitale du Leicestershire. La qualité de comte de Leicester est plus ancienne que la conquête d'Angleterre par les Normands ; car il y a eu trois comtes de Leicester, savoir, Leofrike, Algar, & Edwin, du tems que les Saxons regnoient. La ville est riche, commerçante, bien peuplée, & dans une agréable situation, à 80 milles nord-ouest de Londres. Long. 16. 25. lat. 52. 35. (D.J.)
|
| LEICESTERSHIRE | (Géog.) province d'Angleterre dans l'intérieur du pays, au diocese de Lincoln. Elle a 96 milles de tour, contient environ 560 mille arpens, & 98 mille 700 maisons. C'est un pays de bon air, d'un terroir fertile en blé, en paturages, & abondant en charbon de terre ; la laine est la plus grande du royaume. Ses principales rivieres sont la Stoure, le Reck & le Swist : Leicester en est la capitale.
Joseph Hall, Sir Edouard Leigh, & Thomas Marschall, tous trois connus par leurs travaux étoient du comté de Leicester.
Le premier florissoit sur la fin du xvj siecle, & devint par son mérite évêque de Norwich. C'étoit un homme sage, plein d'esprit & de lumieres. Il prétendoit que le livre le plus utile, seroit, de paucis credendis ad salutem. Il dit dans un sermon qu'il prononça devant le synode de Dordrecht, qu'il y avoit deux sortes de Théologie ; l'une bonne & simple, qui faisoit le chrétien ; l'autre mauvaise, scholastique, & subtile qui faisoit le disputeur ; & qu'il comparoit cette derniere théologie à la quantité des Géometres, laquelle est divisible à l'infini. Plusieurs de ses écrits ont paru dans notre langue. Son traité contre les voyages, intitulé mundus alter & idem, est une peinture très-ingénieuse des moeurs de différentes nations.
On doit au chevalier Leigh une critique sacrée, hébraïque & grecque, qu'on estime encore.
Marschall justifia son érudition dans les langues septentrionales, par un grand ouvrage intitulé, Observationes in Evangelium gothicum, & anglo-saxonicum ; & comme citoyen, il légua tous ses livres & ses manuscrits à l'université d'Oxford.
|
| LEIFOURE | BEAUME DE, balsamum lectorense (Botan.) connu aussi à Paris sous le nom de baume de Condom, mais plus encore sous celui de Winsger. Voyez WINSGER.
|
| LEINE | ou LA LEYNE, (Géog.) riviere d'Allemagne. Elle a sa source à Heyligenstadt, passe à Gottingen, à Hannover, à Neustadt, & va se perdre dans l'Aller entre Zell & Ferden.
|
| LEINSTER | Lagenia, (Géogr.) province maritime, & la plus considérable de l'Irlande : on la nommoit anciennement Lagen ; les naturels du pays l'appellent Leighnigh, & les Gallois Lein. Sa longueur est d'environ 112 milles, & sa largeur de 70 milles ; elle peut avoir 360 milles de circuit, à compter ses tours & ses retours.
Ses principales rivieres sont le Barrow, le Shanon, la Boyne, le Leffy, la Nuer, la Slane & l'Inni.
Elle abonde en grains, en paturages, en bétail, en poissons & en oiseaux aquatiques ; elle nourrit aussi de très-bons chevaux.
Il y a dans cette province un archevêché, qui est celui de Dublin, & trois évêchés. Elle a seize villes qui ont des marchés publics, 47 villes de commerce, à-peu-près autant de villes ou bourgs qui ont droit d'envoyer leurs députés au parlement d'Irlande, une cinquantaine de châteaux fortifiés, & 929 paroisses. Dublin, capitale de l'Irlande, est la premiere de toutes les villes de Leinster.
Anciennement ce pays étoit partagé entre divers peuples ; savoir les Brigantes, qui occupoient Kilkenni, Catherlagh, Kings-County & Queens-County ; les Ménapiens, qui tenoient Wexford & les environs ; les Cauci, qui avoient Wicklow & ses dépendances ; les Blanii ou Elbanii, qui possédoient Dublin, Easth-Méath & West-Méath.
Ensuite par succession de tems, le pays fut partagé en deux royaumes, celui de Leinster & celui de Méath ; ce qui a duré jusqu'à Henri II. qui en fit la conquête. On le divise présentement en 11 comtés.
|
| LEIPSIC | on écrit aussi LEIPSICK, & LEIPSIG, Lipsia, (Géog.) riche & célebre ville d'Allemagne dans la Misnie, avec un château appellé Pleissembourg, & une fameuse université erigée sous l'électeur Frédéric, en 1409 : plusieurs souverains en ont éte les recteurs. Il se fait à Leipsic un grand commerce ; elle se gouverne par ses propres lois depuis 1263, & dépend de l'électeur de Saxe. Elle est remarquable par ses foires & par les batailles qui s'y donnerent en 1630 & 1642. Elle a souvent servi de théâtre à de grands événemens dans les guerres d'Allemagne. Elle est située dans une plaine & dans un terroir fertile, entre la Saale & la Mulde, au confluent de la Pleysse, de l'Elster & de la Barde, à 15 lieues S. O. de Wirtemberg ; 15 N. O. de Dresde ; 26 S. E. de Magdebourg ; 100 N. O. de Vienne. Long. suivant Rivinus, Cassini, Lieutaud & Desplaces, 29 d.51'. 30''. lat. 51 d.19'. 14''.
Il n'est peut-être point de ville en Allemagne qui ait donné la naissance à tant de gens de lettres que Leipsic : j'en trouve même plusieurs de célebres. Tels sont, indépendamment de M. Léibnitz, savant universel ; tels sont, dis-je, les Carpzove, les Ettmuller, les Fabricius, les Jungerman, les Mencken, les Thomasius ; car l'abondance m'oblige de m'arrêter à cette liste, sans que mon silence pour d'autres puisse porter atteinte aux éloges qu'ils méritent.
Les Carpzoves, se sont distingués par leurs ouvrages de Théologie, de Littérature ou de Jurisprudence. L'on convient généralement que Benoît Carpzovius mort en 1666, âgé de 72 ans, est le meilleur écrivain sur la pratique, les constitutions, les jugemens, les décisions criminelles & civiles de l'Allemagne.
Les Ettmuller pere & fils, ont brillé dans la Médecine. Les ouvrages du pere souvent réimprimés, forment sept volumes in-fol. de l'édition de Naples de 1728.
Entre les Fabricius, personne ne doute que Jean Albert ne soit un des plus laborieux, des plus érudits, des plus utiles littérateurs du xviij. siecle. Sa bibliotheque grecque en 14 vol. in-4 ° ; sa bibliotheque latine en 6 volumes ; ses mémoires d'Hambourg en 8 volumes in-8 ° ; son code apocryphe du vieux & du nouveau Testament en 6 volumes in-8 °. en sont de grandes & de bonnes preuves. Cet homme infatigable est mort en 1736, âgé de 68 ans.
Les Jungerman freres se sont attachés avec honneur, l'un à la Botanique, l'autre à la Littérature. Louis a donné entr'autres ouvrages, l'Hortus eistetensis. Le littérateur Godefroy a publié le premier les commentaires de Jules-César en grec. Cette édition faite à Francfort en 1606 in-4 °. est extrêmement recherchée des curieux : le même savant a mis au jour une traduction latine des pastorales de Longin, avec des notes.
Nous devons à MM. Mencken pere, fils, & petit-fils, le Journal de Leipsic, si connu sous le nom d'acta eruditorum ; ils n'ont point été discontinués ces actes des savans depuis 1683, & ils forment actuellement près de cent volumes in-4 °.
Entre les Thomasius, Christiern s'est illustré dans la Jurisprudence par son histoire du droit naturel ; par celle des disputes du sacerdoce & de l'empire, & par d'autres ouvrages écrits en latin ou en allemand.
Enfin Léibnitz seul auroit suffi pour donner du relief à Leipsic sa patrie. Ce fameux Léibnitz, dit M. de Voltaire " mourut en sage à Hanovre, le 14 Novembre 1716, à l'âge de 70 ans, adorant un dieu comme Newton, sans consulter les hommes. C'étoit peut-être le savant le plus universel de l'Europe ; historien infatigable dans ses recherches, jurisconsulte profond, éclairant l'étude du droit par la philosophie, toute étrange qu'elle paroit à cette étude ; métaphysicien assez délié, pour vouloir réconcilier la Théologie avec la Métaphysique ; poëte latin même, & de plus mathématicien assez bon pour disputer au grand Newton l'invention du calcul de l'infini, & pour faire douter quelque tems entre Newton & lui ". Voyez aussi sur ce beau génie l'éloge qu'en a fait M. de Fontenelle, Hist. de l'académie royale des Sciences, ann. 1716, & l'art. LEIBNITZIANISME. (D.J.)
|
| LEIPZIS | S. m. (Com.) sorte de serge qui se fabrique à Amiens ; à seize buzots, trente-deux parties, larges entre deux gardes de demi-aune de roi moins 1/12, & de longueur hors l'estille au métier ; les blanches de 22 aunes & 1/2 ; les mélées de 23 aunes, pour revenir à 20 aunes & 1/4, ou 20 aunes & 1/2 de roi appointées & apprêtées. Voyez Dictionnaire du Com.
|
| LEIRAC | (Géog.) petite ville de Guyenne en Agénois, proche d'Agen, & aujourd'hui démantelée ; elle étoit la patrie de Matthieu Larroque, un des habiles ministres des Protestans en France dans le dernier siecle. Il est connu par de bons ouvrages théologiques, sur-tout par une histoire de l'Eucharistie, dont on a fait plusieurs éditions. Il mourut à Rouen en 1684, âgé de 65 ans, & mérita pendant sa vie l'éloge qu'Eschyle donne à Amphiaraüs, non tam studens famâ esse, quam re, vir bonus, contra atque nunc.
|
| LÉIRIA | Leiria, (Géog.) ville de Portugal dans l'Estramadure, avec un château & un évêché suffragant de Lisbonne, érigé en 1554. Elle est à 11 lieues S. de Coimbre, 17 N. E. de Lisbonne, entre les torrens de Lis & de Linarez, à trois lieues de la mer. Long. 9. 45. lat. 39. 40.
Leiria est la patrie d'un des grands poëtes de Portugal, de Lobo Rodrigues Francesco. Il fleurissoit au commencement du dernier siecle, & se noya dans un esquif en revenant d'une maison de campagne. Sa piece intitulée Euphrosine, est la comédie favorite des Portugais. Toutes ses oeuvres ont été recueillies & imprimées à Lisbonne en 1721 in-fol.
|
| LEISNICK | (Géog.) petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe en Misnie, à 4 milles de Meissen, & à 5 de Leipsick sur la Mulde. Long. 30. lat. 51. 18.
|
| LEITH | ou LYTH, (Géog.) Durolitum selon quelques auteurs ; ville d'Ecosse, avec un port dans la province de Lothiane, sur le golfe de Forth près d'Edimbourg, dont elle est comme le port. Long. 14. 34. lat. 54. 50. (D.J.)
|
| LEITURGE | , (Antiquit. greq.) les leiturges chez les Atheniens, dit le savant Potter, étoient des personnes d'un rang & d'une fortune considérables, qui se trouvoient en conséquence obligés par leur tribu ou par toutes les tribus, de s'acquiter de quelque devoir important au bien de l'état, & même dans les occasions pressantes, de fournir à leurs propres frais certaines choses à la république. Voyez Potter, Archaeol. graec. l. I. c. 15.
|
| LELA | en langue turque signifie dame, (Herb. & Hist. mod.) ce nom se donne aux grandes dames dans l'Afrique ; & c'est assez le titre d'honneur qu'on y donne à la bienheureuse Vierge mere de Jesus-Christ, pour laquelle les Mahométans ont beaucoup de vénération, aussi-bien que pour son fils : c'est la remarque de Diégo de Torrez. Ils appellent, dit-il, parlant des Maures, Notre Seigneur Jesus-Christ, cidéna Ira, ou sidna Ica, c'est-à-dire Notre Seigneur Jesus : & la Sainte Vierge, lela Mariam, c'est-à-dire la dame Marie. Ricaud, de l'empire ottoman.
|
| LÉLEGES | LES, (Géog. anc.) ancien peuple d'Asie : Homere les surnomme belliqueux, & Strabon en parle beaucoup, l. XIII. p. 625. On recueille du discours de ce dernier, que les Léleges étoient un peuple vagabond, mêlé ensuite avec les Cariens, les Pisidiens & autres nations, & que la plus grande partie habitoit le long du golfe d'Adramyte, auprès des Ciliciens d'Homere.
Les Léleges sont encore dans Pausanias un ancien nom des Mégariens & des Lacédémoniens, qui eurent pour premier roi de la Laconie Lélex ; d'où vient que la Laconie en fut appellée Lélégie. (D.J.)
|
| LÉMAN | LE LAC, (Géog.) Lemanus lacus, lac situé entre la Savoie & le pays de Vaud, dépendant de la république de Berne. On le nomme communément le lac de Genève, & nous avons déja dit, je ne sais où, qu'il a porté le nom de lac de Lausanne, lacus Lauzanius.
La figure de ce lac approche un peu de celle d'un croissant, dont les deux cornes seroient émoussées, & dont l'une des mêmes cornes auroit une grande échancrure par-dedans. Il est vrai que nous en avons de bonnes cartes ; mais toutes ne représentent pas sa véritable figure ; ce lac s'étend bien plus contre le nord, & moins du côté de l'orient que plusieurs de ces cartes ne le marquent.
Il est situé entre le 24 degré 10', & le 25 de longitude, à compter cette longueur depuis l'isle de Fer, & entre le 46 degré 12', & le 46 degré 31' de latitude.
La longueur de ce lac depuis Genève jusqu'à Villeneuve, en passant par le pays de Vaud, est de 15 lieues de marine, dont il y en a 20 au degré ; & ces 15 lieues font 18 lieues trois quarts communes de France ; mais cette distance prise en ligne droite par dessus le Chablais, n'excede pas 12 lieues de marine.
La plus grande largeur de ce lac, à le prendre de Rolle jusqu'au voisinage de Thonon, est de trois à quatre lieues, ou plutôt à cause du biais qui se trouve entre ces deux endroits, sa plus grande largeur doit être seulement estimée environ sept milles toises de France de six piés de roi chacune, ce qui fait un peu plus de trois lieues communes du même royaume, mais ce lac se rétrécit beaucoup ensuite en venant vers Genève ; car depuis Rolle jusqu'à Genève, il n'est guere, que je sache, en aucun endroit plus large d'une lieue marine.
La surface du lac Léman est d'environ 26 lieues communes quarrées, dont chacune a 2282 toises & deux cinquiemes de côte.
La profondeur de ce lac est dans quelques endroits très-considérable, particulierement du côté de Savoie ; cependant on n'a point fait encore d'expériences suffisantes pour la justifier, & le fait en vaudroit la peine. Je prie les physiciens du pays de constater cette profondeur ; car nous ne pouvons faire aucun fonds sur des témoignages de pêcheurs mal-habiles ; témoignages d'autant plus suspects que les uns estiment la plus grande profondeur de ce lac, près de Melleria, à 200 brasses, tandis que d'autres la font monter au double. D'après leur même rapport, ce qu'ils appellent le petit lac de Genève, c'est-à-dire le lac qui s'étend depuis la ville de Nion jusqu'à celle de Genève, n'a nulle part plus de 40 brasses de profondeur ; encore un coup leurs assurances demandent une révision.
Il en est presque de même au sujet des trombes qu'on a observés quelquefois sur ce lac, par exemple en 1741 & 1742 ; les trombes dont nous parlons, sont des especes de vapeurs épaisses qui s'élevent de tems à autre sur le lac Léman, occupent en largeur des 15 à 20 toises, à peu près autant en hauteur, & se dissipent ensuite dans un instant, sans qu'on soit encore suffisamment éclairé sur leurs causes.
Un phénomène beaucoup moins rare que nous offre le lac Léman, est une espece de flux & reflux qu'on y remarque sous le nom vulgaire & ridicule de seiches ; cette espece de flux & reflux, qui se trouve d'une part près de l'embouchure du Rhône, ou bien à l'autre extrémité, près de l'embouchure de l'Arve, doit être vraisemblablement produit par la fonte des neiges, conformément au détail exact & savamment raisonné qu'en a fait M. Jallabert dans l'hist. de l'acad. des Scienc. ann. 1742.
Le lac Léman est en partie formé par le Rhône qui le traverse dans toute sa longueur, en sort à Genève, & y conserve seulement sa couleur jusqu'à une certaine distance : ce lac au contraire de plusieurs autres décroît en hiver, & croît en été quelquefois jusqu'à dix piés & davantage. Les neiges fondues des montagnes dans cette saison, grossissent de leurs eaux, les ruisseaux & rivieres qui entrent dans le lac, & par conséquent le lac lui-même. Il ne se gele presque jamais dans les plus grands froids, parce qu'il abonde en sources vives.
Mais si l'on joint à cet avantage sa belle situation, l'aspect admirable qu'il procure de maisons de plaisance, de villes, de bourgs & de villages, de champs cultivés, de côteaux, de vignobles & de campagnes fertiles, l'excellent poisson de plusieurs sortes qu'il fournit en abondance, sa profondeur, son étendue, la bonté du bassin sur lequel il roule des eaux pures, légeres & argentines, on ne pourra s'empêcher de le regarder pour un des plus beaux lacs de l'Europe, & de dire à sa gloire, avec le premier poëte de nos jours.
Que le chantre flateur du tyran des Romains,
L'auteur harmonieux des douces Géorgiques,
Ne vante plus ses lacs & leurs bords magnifiques,
Ces lacs que la nature a creusés de ses mains
Dans les campagnes italiques,
Le lac Léman est le premier....
.... C'est sur ces bords heureux,
Qu'habite des humains la déesse éternelle,
L'ame des grands travaux, l'objet des nobles voeux,
Que tout mortel embrasse, ou desire ou rappelle,
Qui vit dans tous les coeurs, & dont le nom sacré
Dans les cours des tyrans est tout bas adoré,
La liberté !....
(D.J.)
|
| LEMAN | ou LEMANUS, (Géog. anc.) riviere d'Angleterre ; c'est la Lyme, d'où prend son nom le port de Lyme, nommé par Antonin Lemanis portus, à 16 mille pas romains de Durovernum, qui est Cantorbery ; c'est encore de-là que tire son nom Lymchille, montagne voisine.
|
| LEMANNONIUS | LEMANNONIUS
|
| LEMBAIRE | S. m. (Art milit. antiq.) lembarius dans Vopiscus ; cet auteur donne le nom de lembaires aux soldats qui sous le regne d'Aurélien combattoient dans des bateaux qu'on armoit sur les rivieres. Voyez à ce sujet les notes de Saumaise, pag. 381. ad hist. August. script.
|
| LEMBERG | (Géog.) ou Lembourg par les Allemands, Luvow par les Polonois, en latin Leopolis, & en françois Léopol, est une ville de Pologne dans la petite Russie au palatinat de Lemberg, dont elle est la capitale. Voyez LEOPOL.
|
| LEMBRO | (Géog.) isle de l'Archipel sur la côte orientale de la presqu'isle de Romanie ; elle est d'environ 27 milles de circuit, avec un bourg de même nom, & un port. Elle est entre l'isle de Lamadrachi & celle de Ténédos. Voyez la carte de la méditerranée par Berthelot. Lembro est nommée par les anciens Imbros. Long. 43. 35. lat. 40. 25.
|
| LEMGOW | (Géog.) Lemgovia, petite ville d'Allemagne en Westphalie sur la riviere de Bège, au comté de la Lippe. Elle étoit autrefois impériale, mais présentement elle appartient au comté de la Lippe. Elle est à 4 milles S. O. de Minden. Longit. 26. 30. lat. 52. 8.
Koempfer (Engelbert), docteur en Médecine, naquit à Lemgow en 1651, & mourut en 1716. Il voyagea pendant dix ans dans les Indes orientales, à Siam & au Japon, & nous a donné l'histoire naturelle & civile, la plus vraie & la plus intéressante que nous ayons de ce dernier pays ; il l'avoit écrite en allemand, mais elle parut en françois en 1729 en 2 vol. in-folio, d'après la version angloise de Scheuchzer ; ses aménités exotiques, écrites en latin, sont pleines de choses curieuses, & mériteroient d'être traduites dans notre langue. (D.J.)
|
| LEMMA | S. f. (Botan.) plante aquatique traçante, qui ne vient que dans les eaux douces, mais avec le même succès sous toutes sortes de climats différens, chauds, froids, ou tempérés. La plûpart des Botanistes la nomment lemma ou lens lenticularis, quadrifolia, parce que ses feuilles sont au nombre de quatre, soutenues sur une même queue, ses racines ne sont que de petits filets garnis de fibrilles.
Cette plante porte des coques ovoïdes, qui ne sont pas simplement ses fruits, mais qui renferment aussi les fleurs. Chaque loge de la coque contient une fleur hermaphrodite, composée de quantité de petites étamines, qui répandent des grains sphériques de poussiere jaune, & de pistils ovoïdes posés de suite sur le même placenta.
On ne connoît qu'une espece de lemma, représentée & décrite plus scrupuleusement par M. de Jussieu, dans les Mém. de l'acad. des Scienc. ann. 1740. Cependant elle est d'assez peu d'importance, car elle n'a ni qualités, ni vertus en Medecine, ni d'usages à aucun égard. (D.J.)
|
| LEMME | S. m. en Mathématique, est une proposition préliminaire qu'on démontre pour préparer à une démonstration suivante, & qu'on place avant les théorèmes pour rendre la démonstration moins embarrassée, ou avant les problèmes, afin que la solution en devienne plus courte & plus aisée. Ainsi, lorsqu'il s'agit de prouver qu'une pyramide est le tiers d'un prisme ou d'un parallélépipede de même base & de même hauteur ; comme la démonstration ordinaire en est difficile, on peut commencer par ce lemme qui se prouve par la théorie des progressions ; savoir, que la somme de la suite des quarrés naturels 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, &c. est toujours le tiers du produit du dernier terme par le nombre des termes.
Ainsi un lemme est une proposition préparatoire, pour en prouver une autre qui appartient directement à la matiere qu'on traite ; car ce qui caractérise le lemme, c'est que la proposition qu'on y démontre n'a pas un rapport immédiat & direct au sujet qu'on traite actuellement ; par exemple, si pour démontrer une proposition de Méchanique, on a besoin d'une proposition de Géométrie qui ne soit pas assez connue pour qu'on la suppose, alors on met cette proposition de Géométrie en lemme, au-devant du théorème de Méchanique qu'on vouloit prouver. De même, si dans un traité de Géométrie on étoit arrivé à la théorie des solides, & que pour démontrer quelque proposition de cette théorie, on eût besoin d'une proposition particuliere sur quelque propriété des lignes ou des surfaces qui n'eût pas été démontrée auparavant, on mettroit cette proposition en lemme avant celle qu'on auroit à démontrer. (O)
|
| LEMNISCATE | S. f. (Géomet.) nom que les Géometres ont donné à une courbe qui a la forme d'un 8 de chiffre. Voyez fig. 41. de l'analyse.
Si on nomme A P, x, & P M = y, & qu'on prenne une ligne constante B C = a, la courbe qui aura pour équation ay = x , sera une lemniscate. Cette courbe sera du quatrieme degré, comme on le voit aisément en faisant évanouir le radical. Car on aura a2 yy = aaxx - x4 ; & d'ailleurs il est facile de voir que toute lemniscate est nécessairement du quatrieme degré au-moins, puisqu'une ligne droite qui passeroit par le point double A, couperoit cette courbe en quatre points, le point double étant censé équivalent à deux points. Voyez COURBE, voyez aussi POINT DOUBLE.
Il est facile de voir que la lemniscate est quarrable ; car son élément est y d x = x d x , dont l'intégrale est - + a3/3. Voyez INTEGRAL & QUADRATURE. Il peut y avoir plusieurs autres courbes en 8 de chiffre. Voyez, par exemple, ELLIPSE DE M. CASSINI : mais celle dont nous venons de parler est la plus simple. (O)
|
| LEMNISCEROS | S. m. (Géom.) quelques géometres ont donné ce nom à une courbe ou portion de courbe, dont on voit la figure, Pl. d'analyse, fig. 12, n°. 2. d'autres l'ont appellé noeud ou las d'amour. (O)
|
| LEMNISQUE | S. m. (Littérat.) en grec , en latin lemniscus, espece de couronne de fleurs entortillées de rubans de laine, dont les bouts assez longs pendoient & flottoient au gré des vents. Le lemnisque étoit une récompense honorable, que le préteur mettoit sur la tête de l'esclave gladiateur plusieurs fois victorieux, pour marque de sa bravoure & de son affranchissement. Voyez GLADIATEUR, tom. VII, pag. 696. (D.J.)
|
| LEMNOS | (Géog. anc.) île de la mer Egée, proche de Thrace, & à huit lieues du mont Athos.
On l'appella Dipolis, parce qu'elle n'avoit que deux villes, Myrene & Héphaestia ; sa capitale , est le nom grec de Vulcain, à qui l'île de Lemnos étoit consacrée. Aussi porte-t-elle le surnom de Vulcania chez les anciens, jam summis Vulcania surgit, Lemnos aquis, dit Valerius Flaccus, Argonaut. l. II. v. 78. Homere déclare que ce dieu chérit Lemnos par-dessus tous les pays du monde.
Quand Jupiter & Junon le précipiterent du ciel, à cause de sa laideur, il fut accueilli dans cette île, & même nourri par Eurynome, fille de l'Océan & de Thétis. En reconnoissance de ce bienfait, il y fixa son établissement avec ses cyclopes, pour y forger les foudres du maître de l'Olympe & les armes des héros. Cette fiction poétique tire son origine de deux causes ; 1°. du mont Mosycle qui vomit des flammes dans cette île ; & 2°. du préjugé reçu, que les Lemnéens étoient un des premiers peuples de la Grece qui s'appliquerent à forger le fer.
Mais quelle n'est point la longue durée des traditions fabuleuses ? Belon qui voyageoit dans ce pays-là en 1548, " nous assure qu'il n'y a petit habitant de l'île de Lemnos, qui ne raconte à sa façon toute l'histoire de Vulcain, comme si elle étoit arrivée de naguere ".
Philostrate écrivoit jadis que l'endroit où ce dieu tomba du ciel étoit remarquable par une espece de terre qui guérit Philoctete de la cruelle morsure d'un serpent. Les Poëtes ont peint à l'envi les peines que ce héros souffrit dans l'île de Lemnos, & Sophocle en a fait le sujet d'une de ses tragédies.
Les vertus de la terre lemnienne n'avoient point encore perdu de leur crédit dans le dernier siecle ; c'est la terre sigillée dont les anciens & les modernes ont tant chanté de merveilles. Busbecq en 1686, crut devoir envoyer sur les lieux un savant éclairé, pour savoir à quoi s'en tenir. Galien fit plus autrefois, il y alla lui-même en personne. Voyez donc TERRE LEMNIENNE ; car du-moins l'historique en est amusant, & s'il est trop long pour un extrait, voyez Belon, observat. liv. I. ch. xxij. xxiij. xxviij. & xxix. L'île qui la fournit, fit bien parler d'elle à d'autres égards.
Les sauterelles dont cette île étoit souvent ravagée, y donnerent lieu à une loi de police fort singuliere ; non-seulement chaque habitant fut taxé à en tuer un certain nombre, mais on y établit un culte en l'honneur de certains oiseaux qui venoient au-devant de ces insectes pour les exterminer. C'est Pline, lib. XI. cap. xxvij. qui nous l'apprend : voici son passage qui m'a paru très-curieux. In Cyrenaicâ regione, lex etiam est, ter anno debellandi eas (locustas), primò ova obterendo, deinde foetum, postremò adultas. Desertoris poena in eum qui cessaverit : & in Lemno insulâ certa mensura praefinita est, quam singuli enecatarum ad magistratus referant. Gracculos quoque ob id colunt, adverso volatu occurrente earum exitio. Les gracculi de Pline sont des especes de corneilles, que nous nommons choucas rouges. Voyez CHOUCAS ROUGE.
Mais les sauterelles firent bien moins de tort à l'île de Lemnos, que les deux massacres qui s'y commirent, si nous en croyons le récit des Poëtes & de quelques écrivains. Dans le premier massacre, fruit de la jalousie, de l'amour-propre, & de la vengeance, les Lemniennes piquées de l'abandon de leurs maris qui leur préféroient des esclaves qu'ils avoient amenées de Thrace, égorgerent tous les hommes de leurs îles en une seule nuit. La seule Hypsipyle eut la religion de conserver la vie au roi Thoas son pere, qu'elle prit soin de cacher secrettement. Le second massacre fit périr les enfans que les Pélasges retirés à Lemnos, avoient eu de leurs concubines athéniennes. De-là vint que toutes les actions atroces furent appellées des actions lemniennes, & qu'on entendoit par une main lemnienne, une main cruelle & barbare.
Vous trouverez dans Hérodote & dans Cornélius Népos, comment les Athéniens conquirent cette île sur les Pélasges, sous la conduite de Miltiade, & vous accorderez si vous pouvez le récit de ces deux historiens.
Apollodore, Hygin, & le scholiaste d'Apollonius, remarquent que Vénus n'avoit point de culte à Lemnos, & que la mauvaise odeur qui rendit les Lemniennes dégoutantes à leurs maris, fut un effet de la colere de cette déesse, irritée de voir que les femmes de cette île ne faisoient point fumer d'encens sur ses autels. Minerve avoit eu la préférence sur la reine de Cythere ; car les habitans de Lemnos possédoient la Minerve de Phidias, ce chef-d'oeuvre de l'art, auquel ce grand sculpteur mit son nom. Diane avoit aussi ses dévots ; mais Bacchus étoit particulierement honoré dans l'île de Lemnos. Comme elle étoit très fertile en vins, cette seule raison a pu la faire regarder pour être consacrée au fils de Jupiter & de Sémélé. Quintus Calaber la surnomme , la vineuse ; nos voyageurs assurent qu'elle mérite encore cette épithete.
Son labyrinthe est le troisieme des quatre, dont Pline a fait mention. Voyez le mot LABYRINTHE.
Si ce que Strabon avoit écrit de cette île, n'étoit pas perdu, nous aurions vraisemblablement plusieurs faits curieux à ajouter à cet article.
On sait les révolutions de cette île depuis la chûte de l'empire grec : il fallut la céder à Mahomet II. en 1478. Il est vrai que les Vénitiens s'en rendirent maîtres en 1656 ; mais les Turcs la reprirent sur eux l'année suivante, & n'en ont point été dépossédés depuis. Ils la nomment Limnis : les Grecs & les Chrétiens l'appellent Stalimene, nom corrompu de . Voyez STALIMENE.
Philostrate littérateur étoit de Lemnos ; il florissoit au commencement du troisieme siecle sous Caracalla & sous Géta. On a une bonne édition de ses oeuvres, Lipsiae, 1709. in-fol. (D.J.)
LEMNOS TERRE DE, (Hist. nat. Minéral.) espece de terre bolaire qui se trouve dans l'île de Lemnos fort vantée par les anciens. On en compte trois especes ; il y en a de blanche, de jaune, & de rouge : cette derniere est la plus usitée ; elle est d'un rouge pâle, unie, & douce au toucher ; ses parties sont assez liées ; elle ne se dissout pas promtement dans la bouche ; elle ne colore point les doigts, & ne s'écrase point trop aisément ; elle s'attache fortement à la langue ; on la lave pour la séparer du sable qui peut y être joint ; son goût est styptique & astringent. La terre de Lemnos blanche est de la même nature que la rouge, & n'en differe que par la couleur, & parce qu'elle ne fait point d'effervescence avec les acides, au lieu que le rouge y en fait un peu. La terre de Lemnos jaune a les mêmes propriétés que les deux précédentes, & n'en differe que par la couleur. Les anciens & plusieurs modernes ont attribué de très-grandes vertus à cette terre ; il est assez douteux qu'elles soient fondées. On les trouve dans l'île de Lemnos, l'une des îles de l'Archipel, & la terre de la meilleure espece ne se trouve que dans une seule ouverture ou puits, que l'on n'ouvre qu'une seule fois dans l'année avec beaucoup de cérémonies. Les habitans font commerce de ces terres, & on les contrefait assez souvent. Peut-être il y a lieu de croire que ceux qui en font usage ne s'en trouvent point plus mal. Voyez SIGILLEES (TERRES). (-)
|
| LEMOVICES | ou LIMOVICé, (Géog. anc.) ancien peuple de la Gaule aquitanique ; c'est aujourd'hui le Limousin, ou ce qui revient au même, les diocèses de Limoges & de Tulles ; ce dernier n'étant qu'un démembrement de l'autre. César en parle dans ses commentaires, de bello gallico, lib. VII. cap. lxxv. & il semble résulter de ce chapitre, qu'il y avoit deux peuples nommés Lemovices ; savoir les anciens habitans du Limousin, & un autre ancien peuple de la Gaule, vers la côte de Bretagne.
|
| LEMOVII | (Géog. anc.) ancien peuple de la Germanie, que Tacite, de morib. Germ. cap. xxviij. associe aux Rugiens. L'île de Rugen décide du lieu où étoient les Rugiens, dont elle conserve le nom ; mais il est difficile de découvrir les Lemovii. Cluvier conjecture que c'est le même peuple qui a été ensuite appellé les Hérules. (D.J.)
|
| LEMPE | S. f. (Commerce) sorte de perle qui se pêche dans quelques îles du Brésil.
|
| LEMPSTER | ou LIMSTER, (Géog.) petite ville à marché d'Angleterre en Herefordshire, avec titre de baronie : elle députe au parlement, & se distingue par son froment & par ses laines. Sa situation est près de la riviere de Lug, à 71 milles N. O. de Londres. Long. 14. 45. lat. 52. 16. (D.J.)
|
| LEMURES | S. m. (Hist. anc.) c'étoient dans le système des payens des génies malfaisans, ou les ames des morts inquiets qui revenoient tourmenter les vivans. On institua à Rome les Lemuries ou Lemurales, pour appaiser les Lemures ou pour les chasser. On croyoit que le meilleur moyen de les écarter des maisons étoit de leur jetter des fêves ou d'en brûler, parce que la fumée de ce légume rôti leur étoit insupportable. Apulée dit que dans l'ancienne langue latine, lemure signifioit l'ame de l'homme séparée du corps après sa mort ; ceux qui étoient bienfaisans à leur famille, ajoute-t-il, étoient appellés Lares familiares ; mais ceux qui pour les crimes qu'ils avoient commis pendant leur vie, étoient condamnés à errer continuellement sans trouver de repos, à épouvanter les bons & à faire du mal aux méchans, on les appelloit Larres ou Lemures.
Un commentateur d'Horace prétend que les Romains ont dit Lemures, pour Remures, & que ce dernier mot est formé du nom de Remus, qui fut tué par son frere Romulus, & dont l'ombre ou le spectre revenoit sur la terre pour tourmenter ce dernier. Mais on a déja vû que ce sentiment est contredit par Apulée, dont l'étymologie du mot Lemures est plus simple & plus vraisemblable. Voyez le Dictionnaire de Trévoux.
|
| LEMURIES | LEMURALIES, s. f. pl. (Hist. anc.) fête qu'on célébroit autrefois à Rome le 9 de Mai, pour appaiser les mânes des morts, ou en l'honneur des Lémures. Voyez LEMURE.
On attribue l'institution de cette fête à Romulus, qui pour se délivrer du fantôme de son frere Remus, qu'il avoit fait tuer, lequel se présentoit sans cesse à lui, ordonna une fête, qui du nom de Remus, s'appella Remuria, & ensuite Lémurie.
Dans les lémuries on offroit des sacrifices pendant trois nuits consécutives ; durant ce tems tous les temples des dieux étoient fermés, & on ne permettoit point les mariages. Il y avoit dans cette fête quantité de cérémonies, dont l'objet principal étoit d'exorciser les lémures, de prévenir leurs apparitions & les troubles qu'elles auroient pû causer aux vivans. Celui qui sacrifioit étoit nuds piés, & faisoit un signe ayant les doigts de la main joints au pouce, s'imaginant par-là empêcher que les lémures n'approchassent de lui. Ensuite il se lavoit les mains dans de l'eau de fontaine ; & prenant des fêves noires, il les mettoit dans sa bouche, puis les jettoit derriere lui en proférant ces paroles : Je me délivre par ces fêves moi & les miens ; conjuration qui étoit accompagnée d'un charivari de poëles & de vaisseaux d'airain, & de prieres aux lutins de se retirer & de laisser les vivans en paix.
|
| LÉNA | (Géog.) grand fleuve de la Sibérie, qui reçoit un grand nombre de rivieres considérables, & après avoir arrosé une étendue immense de pays, va se jetter dans la mer glaciale, à environ 120 lieues de la ville de Jakusk.
|
| LENCIC | ou LANZCHITZ, LANDCHUTZ, & par Delisle, LENCICZA, (Géog.) en latin moderne, Lencicia, ville de Pologne, capitale du palatinat de même nom, avec une forteresse sur un rocher. La noblesse de la province y tient sa diete. Elle est dans un marais, au bord de la riviere de Bsura, à 20 lieues S. E. de Gnesne, 32 O. de Warsovie, 55 N. O. de Cracovie. Long. 37. lat. 52. 12.
|
| LÉNÉEN | lenaeus, (Littérat.) surnom ordinaire de Bacchus, du mot grec , qui signifie un pressoir, ou plutôt la table d'un pressoir : de-là Bacchus a été nommé lénéen, c'est-à-dire, le dieu qui préside à la vendange. Mais Horace le désigne plus noblement, cingentem viridi tempora pampino, le dieu couronné de pampre verd. Les bacchantes furent semblablement nommées leneae, lénéennes ; les fêtes de Bacchus, lenaea, lénées ; & le mois dans lequel on les célébroit, lenaeon. Nous expliquerons tous ces mots.
|
| LÉNÉE | ou LÉNÉENNES, s. f. pl. (Littérat.) en latin lenaea, en grec ; fêtes qu'on célébroit tous les ans dans l'Attique en l'honneur de Bacchus, dans le cours du mois lénéon, en automne. Outre les cérémonies d'usage aux autres fêtes de ce dieu, celles-ci étoient remarquables, en ce que les poëtes y disputoient des prix, tant par des pieces composées pour faire rire, que par le combat de tétralogie, c'est-à-dire de quatre pieces dramatiques : de-là vient que dans les lénées on lui chantoit : " Bacchus, nous solemnisons vos fêtes, en vous présentant les dons des muses en nos vers éoliens ; vous en avez la premiere fleur, car nous n'employons point des chansons usées, mais des hymnes nouveaux & qui n'ont jamais été entendus ".
|
| LÉNÉON | lenaeon, (Littérat.) en grec , mois des anciens Ioniens, dans lequel on célébroit les fêtes de Bacchus en Grece. Quelques savans croyent que ce mois répondoit au posidéon des Athéniens ; d'autres le font répondre à leur mois anthoesterion : aussi, selon les uns, ce mois se rapporte à notre mois de Septembre, & selon d'autres, à notre mois d'Octobre : tout cela me prouve que dans les contradictions il faut conserver les noms grecs sur des choses de cette nature, sauf à faire les explications qu'on avisera bon être dans des notes particulieres. (D.J.)
|
| LÉNITIF | ÉLECTUAIRE, adj. (Pharmac. & Mat. medic.) D'après la pharmacopée de Paris, prenez orge entier, racine seche de polypode de chêne concassée, & raisins secs mondés de leurs pepins, de chacun deux onces ; jujubes, sebestes & prunes de damas noir, de chacun vingt ; tamarins deux onces ; feuilles récentes de scolopendre une once & demie, de mercuriale quatre onces, fleurs de violettes récentes cinq onces, ou à leur place semence de violettes une once, réglisse rapée ou concassée une once. Faites la décoction de ces drogues dans suffisante quantité d'eau commune, pour qu'il vous reste cinq livres de liqueur, dans laquelle vous ferez infuser séné mondé deux onces, semence de fenouil doux deux dragmes.
Prenez trois livres de cette colature ; jettez dedans deux livres & demie de sucre, & cuisez à consistance de syrop, dans lequel vous délayerez six onces de pulpe de pruneaux cuits avec une des deux livres restantes de colature, & passez ; autant de pulpe de tamarins préparée avec l'autre livre de colature, & autant de casse ; vous mêlerez exactement sené en poudre cinq onces, & semence d'anis en poudre deux dragmes.
Cet électuaire est un purgatif doux, c'est-à-dire agissant sans violence, assez efficace pourtant à la dose d'une once jusqu'à deux.
Toute la vertu de cette composition réside dans le séné, qui en est le seul ingrédient réellement purgatif : toutes les autres drogues ne servent qu'à en masquer le goût & à en corriger l'activité. Voyez CORRECTIF. Ce remede est peu en usage. (b)
|
| LÉNO | ou LENNOX, (Géog.) en latin Levinia, province de l'Ecosse méridionale, sur la côte occidentale ; elle est entre Mentheith au nord, & la riviere de Clyde au midi ; on la nomme aussi Dumbartonshire, le comté de Dumbarton, du nom de sa capitale. Peut-être qu'elle s'appelle Lénox par contraction pour Lévenox, de la riviere de Léven, qui sort du lac Lomond, & qui se jette dans la Clyde. Une partie de cette province est très-fertile en blé, & ses montagnes fournissent d'excellens pâturages. Lénox a donné le titre de comté, & ensuite de duc, à une branche de la famille des Stuards ; mais elle a plus fait encore en donnant la naissance au célebre Georges Buchanan. (D.J.)
|
| LEN | ou LENTICULA, (Hist. anc.) étoit chez les Romains le nom d'un poids qui faisoit la 208e. partie d'une dragme, & qui valoit un grain & demi. Voyez DRAGME & GRAIN.
|
| LENS | Lentium, (Géog.) petite ville de France en Artois, dont les fortifications ont été rasées. Il y a long-tems que cette ville porte le nom de Lens, car il se trouve dans les capitulaires de Charles le Chauve, selon M. de Valois, page 187 de sa notice gall. Cette ville fut cédée à la France par le traité des Pyrénées. Elle est sur le ruisseau de Sonchets, à 3 lieues d'Arras, 4 N. O. de Douay, 46 N. E. de Paris. Long. selon Cassini, 20 d 21' 37''. latit. 50 d 25'. 58''.
La gloire dont se couvrit M. le prince de Condé en 1648 dans la bataille de Lens contre les Espagnols, a été immortalisée par ces beaux vers de Despréaux.
C'est ainsi, grand Condé, qu'en ce combat célebre,
Où ton bras fit trembler le Rhin, l'Escaut & l'Ebre ;
Lorsqu'aux plaines de Lens nos bataillons poussés,
Furent presque à tes yeux ouverts & renversés ;
Ta valeur arrêtant les troupes fugitives,
Rallia d'un regard leurs cohortes craintives,
Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux,
Et força la victoire à te suivre avec eux. (D.J.)
|
| LENT | adj. (Gramm.) terme relatif au mouvement ; c'est l'opposé de vîte ou promt. On dit que plus les planetes sont éloignées, plus leur mouvement paroît lent ; que le lievre est vîte & la tortue lente ; que ce malade a une fievre lente ; que ce feu est lent ; qu'un homme a l'esprit lent, &c.
|
| LENTE | S. f. (Hist. nat.) c'est l'oeuf du pou, ou le pou même nouvellement produit. Voyez POU.
|
| LENTEMENT | adv. Ce mot, en Musique, répond à l'italien adagio, & marque un mouvement lent & posé. Nous n'avons même, dans la musique françoise, que son superlatif pour exprimer un mouvement encore plus tardif. (S)
|
| LENTER | v. act. en terme de chauderonnier, c'est proprement l'action de planer en premiere façon, & imprimer sur une piece des coups de marteau remarquables & par ordre.
|
| LENTIBULAIRE | S. f. (Botan.) plante aquatique, dont M. Vaillant a fait un genre, qu'il caractérise ainsi dans les mémoires de l'académie des Sciences, année 1719, pag. 21, où l'on trouvera sa figure.
La fleur est complete , monopétale, irréguliere & androgyne, renfermant l'ovaire qui devient une capsule, laquelle contient des semences entassées les unes sur les autres autour d'un placenta. Les feuilles sont laciniées, & les fleurs naissent à des tiges simples, dénuées de feuilles.
On connoît deux especes de ce genre de plante, lentibularia major, petiv. herb. brit. tab. 36, & lentibularia minor, ejusd. petiv.
Ces deux plantes se trouvent dans les prairies marécageuses, les fossés & les étangs. Elles ont été vûes & remarquées par Mrs Dent, Dodsworth & Lawson en Angleterre.
Le nom de lentibulaire a été donné à cette plante, parce que ses feuilles sont chargées de petites vessies assez semblables à la lentille. (D.J.)
|
| LENTICULAIRE | adj. (Diopt.) qui a la figure d'une lentille. On dit verre lenticulaire pour dire un verre en forme de lentille. Voyez LENTILLE. (O)
LENTICULAIRES, PIERRES (Hist. nat. Minér.) en latin lentes lapidei, lapides lenticulares, nummi lapidei, nummularii lapides, nummi diabolici, lapides numismales, &c. C'est ainsi qu'on nomme des pierres rondes & applatties, renflées par le milieu, en un mot qui ont la forme d'une lentille. Il y en a d'une petitesse imperceptible, & au-dessous de celle d'un grain de millet ; d'autres ont jusqu'à un pouce de diametre : c'est à ces dernieres que l'on a donné le nom de pierres numismales. On trouve ordinairement une grande quantité de ces pierres jointes ensemble ; elles sont liées les unes aux autres par la pierre qui les environne, qui est quelquefois d'une autre nature qu'elles ; cependant on en trouve aussi qui sont détachées & répandues dans du sable ou dans de la terre : celles de ces pierres qui sont calcaires étant mises au feu, se partagent suivant leur largeur, en deux parties égales ; on remarque une spirale sur leur surface intérieure, ou une ligne qui va en s'élargissant vers la circonférence ; le long de cette spirale on distingue de petites stries, qui forment des especes de petites cloisons ou de chambres. On trouve des pierres lenticulaires qui ne sont convexes que d'un côté & plattes par l'autre : elles ne doivent être regardées que comme des moitiés de ces pierres qui ont été séparées de l'autre moitié par quelque accident.
Les Naturalistes sont très-partagés sur la formation des pierres lenticulaires ; bien des gens se sont imaginé que c'étoient en effet des lentilles pétrifiées ; mais pour sentir le ridicule de cette opinion, on n'a qu'à faire attention à leur tissu intérieur garni d'une spirale, qui ne se remarque point dans les lentilles, qui d'ailleurs n'ont jamais un pouce de diametre.
Woodward pense que ce sont des os détachés qui se trouvent dans la tête de quelques poissons inconnus, & qui servent à l'organe de l'ouie ; d'autres ont cru que c'étoient des coquilles appellées opercules ou couvercles, de la nature de celles qu'on nomme umbilicus veneris : mais ce sentiment paroît aussi peu fondé que celui de Woodward.
M. Gesner regarde les pierres lenticulaires comme formées par de petites cornes d'ammon, de la nature de celles qui se trouvent à Rimini sur les bords de la mer Adriatique, que M. Plancus, dans son traité de conchis minus notis, appelle cornu hammonis littoris ariminensis minus vulgare, orbiculatum, striatum, umbiculo prominente, ex quo stria & loculamenta omnia prodeunt, & que M. Gualtieri, dans son index testarum, tab. XIX. figur. I H, appelle nautilus minimus, costâ acutissimâ marginatâ, umbilico utrinque prominente, à centro ad circumferentiam striatus, striis sinuosis inflexis, minutissimo granulatus, ex fusco fulvido colore splendens ; & que Breyn appelle nautilus orbiculatus striatus, umbilico prominente, exiguus. Cette coquille est d'une petitesse extrême ; on en trouve sur les côtes de la Sicile & près de Bergen en Norwege dans le sable. Quelques-uns ont cru que les pierres lenticulaires devoient leur formation à une coquille bivalve, par la propriété qu'elles ont de se partager en deux parties égales ; mais M. Gesner remarque que cela n'arrive qu'à celles qui sont calcaires, & qu'elles se partagent ainsi à cause du tuyau qui va le long du dos par où l'écaille est la plus foible. Voyez Gesner de petrificatorum differentiis & varia origine, §. XI, pag. 29. Selon ce sentiment, les cornes d'ammon & les pierres lenticulaires ont la même origine : au reste, les cornes d'ammon qui se trouvent dans le sable de Rimini sont si petites, qu'il en faut 130 pour peser un grain de froment ; elles ont cinq volutes, & l'on y compte environ 40 chambres ou cloisons ; leur couleur est blanche, ou de la couleur argentée de la nacre de perle. Voyez les ouvrages cités, & acta academiae electoralis Moguntinae scientiarum utilium qua Erfoediae est, tom. I. pag. 3 & suiv. & 118 & suiv.
On trouve des pierres lenticulaires en plusieurs endroits de l'Europe. En France il y en a beaucoup dans le voisinage de Soissons & de Villers-Coterêts ; ces dernieres ont 5 ou 6 lignes de diametre : on en rencontre aussi en Transilvanie, en Silésie, en Saxe, en Angleterre, &c.
On a donné différens noms à la pierre lenticulaire, suivant les différens aspects qu'elle présentoit : c'est ainsi qu'on l'a nommée salicites, lorsque quelquefois on l'a trouvée tranchée suivant son épaisseur, parce qu'alors elle est terminée en pointe par les deux bouts comme la fleur du saule ; dans ce même cas on l'a aussi nommée lapis frumentarius, lapis seminalis, lapis cumini. On l'a aussi désignée sous le nom de lapis vermicularis & de helicites, &c.
On trouve en Suede, dans le lac d'Asnen, une mine de fer, qui est en petites masses semblables à des lentilles ; on la nomme minera ferri lenticularis : ce lac est situé dans la province de Smaland ; il y a aussi des pyrites qui ont une forme lenticulaire.
Il ne faut point confondre les pierres lenticulaires, qui font l'objet de cet article, avec des pierres qui leur ressemblent assez au premier coup d'oeil, & qu'on nomme nummi Bratenburgici, qui ont une origine différente. Voy. l'art. NUMISMALES, PIERRES. (-)
LENTICULAIRE, (Chirurg.) instrument de Chirurgie. Voyez COUTEAU LENTICULAIRE.
|
| LENTILLAT | S. m. (Hist. natur. Icthyologie) on donne ce nom en Languedoc à un chien de mer, qui a sur le corps des taches blanches de la grandeur d'une lentille, & d'autres marques en forme d'étoiles, qui lui ont aussi fait donner le nom de chien de mer étoilé. Rondelet, hist. des poissons, liv. XIII.
|
| LENTILLE | lens, s. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur papilionacée ; il sort du calice un pistil qui devient dans la suite une silique courte, remplie de semences rondes, mais applatties, convexes sur chaque face, c'est-à-dire plus épaisses au centre que sur les bords. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LENTILLE, (Botan.) M. de Tournefort compte six especes de lentilles : nous allons décrire en peu de mots les principales de terre, petite & grande, & la lentille aquatique ou de marais.
La petite lentille, la lentille commune, lens arvensis minor, ou lens vulgaris, est une plante annuelle ; sa racine est menue, blanche, garnie de peu de fibres. Sa tige est assez grosse, eu égard au reste de la plante : elle est haute d'environ dix pouces, branchue dès la racine, velue, anguleuse, foible & couchée sur terre, à moins qu'elle ne trouve quelques plantes auxquelles elle puisse s'accrocher. Ses feuilles placées alternativement jettent de leurs aisselles des petits rameaux comme les autres plantes légumineuses : elles sont composées de cinq ou six paires de petites feuilles portées sur une côte qui se termine en une vrille ; chaque petite feuille est oblongue, étroite, velue, terminée en une pointe aiguë.
Il sort des aisselles des feuilles, des pédicules grêles, oblongs, qui portent deux ou trois fleurs légumineuses petites, blanchâtres, dont cependant le petale supérieur ou l'étendart est marqué intérieurement de petites lignes bleues. Il s'éleve du calice de la fleur un pistil qui se change en une gousse lisse, courte, large, plate, contenant deux ou trois graines ; ces graines sont fort grandes à proportion de cette petite plante ; elles sont orbiculaires, applaties, convexes des deux côtés, c'est-à-dire un peu plus épaisses vers le centre que sur les bords, dures, lisses, jaunâtres quand elles sont mûres, rougeâtres dans quelques especes, & noirâtres dans d'autres.
La grande lentille, lens major, lens arvensis major, est la plus belle à tous égards, & plus grande que la lentille commune. Sa tige est plus haute, ses feuilles sont plus grandes, ses fleurs sont plus blanches ; ses siliques & ses graines sont deux fois plus grosses que dans la précédente.
On seme beaucoup de l'une & de l'autre dans les champs, parce qu'il se fait une grande consommation de leurs graines. Elles sont une des principales nourritures du petit peuple dans les pays chauds catholiques & dans l'Archipel. Il est constant par les monumens des anciens, que l'on les estimoit beaucoup autrefois dans la Grece. Athénée dit que le sage assaisonnoit toujours bien ses lentilles ; mais on n'a jamais trop essayé d'en faire du pain, peut-être a-t-on pensé que leur sécheresse & leur friabilité n'y convenoient pas.
On trouve au reste plusieurs variétés dans les deux especes de lentilles que nous venons de décrire, tant pour la couleur des fleurs que des graines, mais ce ne sont que des variétés accidentelles.
La lentille de marais, lens ou lenticula palustris des Botanistes ne se plait que dans les eaux qui croupissent ; elle surnage au-dessus de l'eau comme une espece de mousse verte ; elle en couvre toute la superficie d'une multitude infinie de feuilles très-petites, noirâtres en-dessous, vertes en-dessus, luisantes, orbiculaires & de la forme des lentilles. Ces feuilles sont unies étroitement ensemble par des filamens blancs très-menus, & de chaque feuille par un filet ou racine par le moyen de laquelle la plante se nourrit. On trouve cette lentille dans les lacs, dans les fossés des villes, & dans les eaux dormantes. Elle fait les délices des canards, d'où vient que les Anglois l'appellent duck-meat. (D.J.)
LENTILLE, (Diete & Mat. med.) Les Medecins ont toujours regardé les lentilles comme le pire de tous les légumes. Riviere, qui a compilé la doctrine des anciens sur ce point, dit que les lentilles sont froides & seches, de difficile digestion ; qu'elles engendrent un suc mélancholique, causent des obstructions, affoiblissent la vûe, occasionnent des rêves tumultueux, nuisent à la tête, aux nerfs & aux poumons, resserrent le ventre, empêchent l'écoulement des regles & des urines : toutes ces mauvaises qualités dépendent, dit-il, de leur substance grossiere & astringente.
Les auteurs plus modernes n'ont pas dit à la vérité tant de mal des lentilles, mais ils se sont tous accordés à les regarder comme un assez mauvais aliment ; mais sur ceci, comme sur tant d'autres objets de diete, les observations & les occasions d'observer nous manquent. Il est peu de gens qui fassent long-tems leur principale nourriture de lentilles : or tous les vices que les Medecins leur ont attribué, s'ils étoient réels, ne pourroient dépendre que d'un long usage.
Il y a donc grande apparence que toutes ces prétentions sont purement rationelles & de tradition : l'usage rare & modéré des lentilles peut être regardé comme très-indifférent pour les sujets sains, dumoins n'en connoissons-nous point les bons effets ou le danger, encore moins les qualités spécifiques qui pourroient distinguer les lentilles des autres légumes, voyez LEGUMES.
La premiere décoction des lentilles est laxative selon Galien, & la seconde astringente ; la substance qui pourroit faire les vertus de ces décoctions, est fournie par l'écorce : on peut reprocher à cette écorce un vice plus réel ; elle est épaisse & dure, elle n'est point ramollie & ouverte dans l'estomac : ensorte que les lentilles qui ne sont point mâchées passent dans les excrémens presqu'absolument inaltérées, & par conséquent sans avoir fourni leur partie nutritive. C'est pour cela qu'il vaut mieux réduire les lentilles en purée que de les manger avec leur peau.
La décoction des lentilles passe pour un excellent remede dans la petite vérole & dans la rougeole : Riviere, que nous avons déja cité, fait l'éloge de ce remede, aussi bien que plusieurs autres auteurs qui ont emprunté cette pratique des Arabes ; plusieurs auteurs graves en ont au contraire condamné l'usage dans cette maladie. Geoffroy rapporte fort au long, dans sa matiere médicale, les diverses prétentions des uns & des autres ; mais cette querelle ne nous paroît pas assez grave pour nous en occuper plus long tems. Les lentilles ne sont plus aujourd'hui un remede ni dans la petite vérole, ni dans d'autres cas.
Au reste ce que nous venons de dire convient également aux grandes lentilles & aux petites lentilles rouges, appellées à Paris lentilles à la reine. (b)
LENTILLE de marais, (Mat. med.) cette plante n'est d'usage que pour l'extérieur : on croit qu'elle rafraîchit, qu'elle resout, qu'elle appaise les douleurs appliquée en cataplasme.
La lentille de marais passe pour faire rentrer la hernie des enfans.
On l'a recommandée encore contre la goutte & contre les douleurs de la tête, appliquée extérieurement sur cette partie.
La lentille d'eau est fort peu employée. (b)
LENTILLE d'eau, lenticula, (Botaniq.) genre de plante qui flotte sur les eaux stagnantes, & dont la fleur est monopétale & anomale. Quand elle commence à paroître, elle a un capuchon ; mais dans la suite elle se déploie & elle quitte son calice : alors elle a la forme d'une oreille ouverte. Cette fleur est stérile, elle sort par une petite ouverture que l'on voit à l'envers des feuilles : l'embryon sort aussi d'une semblable fente, & devient dans la suite un fruit membraneux, arrondi & dur qui renferme quatre, cinq ou six semences relevées en bosses, striées d'un côté & plates de l'autre, comme dans les ombelliferes. Micheli, nova plantarum genera.
LENTILLE D'EAU, la grande, lenticularia, (Bot.) genre de plante qui ressemble à la lentille d'eau ordinaire par sa nature & par sa figure. Jusqu'à-présent on n'a pu voir ses fleurs : les semences naissent abondamment dans les parois inférieurs des feuilles attachés irrégulierement à leur substance ; elles sont arrondies ou elliptiques. Nova plantarum genera, &c. par M. Micheli.
LENTILLES, (Med.) ce sont de petites taches roussâtres qui sont répandues çà & là sur la peau du visage & des mains, particulierement dans les personnes qui ont la peau délicate ; elles viennent surtout dans le tems chaud quand on s'expose au soleil & à l'air ; elles sont formées des vapeurs fuligineuses qui s'arrêtent & qui se coagulent dans la peau. Voyez le Traité des maladies de la peau, par Turner. On les appelle en latin lentigines, parce qu'elles ont la figure & la couleur des lentilles ; les François les appellent rousseurs & bran de Judas ; les Italiens, rossore & lentigine.
Les lentilles paroissent être formées des parties terrestres, huileuses & salines de la sueur, qui sont retenues dans la substance réticulaire de la peau : tandis que les parties aqueuses qui leur servoient de véhicule, s'évaporent par la chaleur du corps, ces parties plus grossieres s'amassent peu-à-peu, jusqu'à ce que les mailles de la peau en soient remplies.
Il y a continuellement quelques parties de sueur qui suintent de la cuticule ; & comme elles sont d'une nature visqueuse, elles retiennent la poussiere & tout ce qui voltige dans l'air : cette matiere visqueuse s'arrête sur la surface des lentilles, & plus on l'essuie, plus on la condense, ce qui la force de s'introduire dans les petites cavités des lentilles.
On trouve plus de lentilles autour du nez que partout ailleurs, & cela parce que la peau y étant plus tendue, les pores sont plus ouverts & plus propres à donner entrée à la poussiere.
Il suit de là qu'on ne peut guere trouver un remede sûr pour garantir des lentilles ; il peut y en avoir qui dissipent pour un tems la matiere déja amassée, mais les espaces vuides se remplissent derechef.
Le meilleur remede, selon M. Homberg, est le fiel de boeuf mêlé avec de l'alun : il faut que cet alun ait été précipité & exposé au soleil dans une phiole fermée pendant trois ou quatre mois ; il agit comme une lessive, en pénétrant les pores de la peau & dissolvant le coagulum des lentilles. Mém. de l'académ. des Scienc. année 1709, p. 472, &c.
LENTILLE, terme d'Optique, c'est un verre taillé en forme de lentille, épais dans le milieu, tranchant sur les bords ; il est convexe des deux côtés, quelquefois d'un seul, & plat de l'autre, ce qui s'appelle plan convexe. Le mot de lentille s'entend ordinairement des verres qui servent au microscope à liqueurs, & des objectifs des microscopes à trois verres. Le plus grand diametre des lentilles est de cinq à six lignes ; les verres qui passent ce diametre s'appellent verres lenticulaires. Il y a deux sortes de lentilles, les unes soufflées & les autres travaillées : on entend par lentilles soufflées de petits globules de verre fondus à la flamme d'une lampe ou d'une bougie, mais ces lentilles n'ont ni la clarté ni la distinction de celles qui sont travaillées, à cause de leur figure qui n'est presque jamais exacte, & de la fumée de la lampe ou bougie qui s'attache à leur surface dans le tems de la fusion. Les autres sont travaillées & polies au tour dans de petits bassins de cuivre. On a trouvé depuis peu le moyen de les travailler d'une telle petitesse, qu'il y en a qui n'ont que la troisieme & même la sixieme partie d'une ligne de diametre : ce sont celles qui grossissent le plus, & cette augmentation va jusqu'à plusieurs millions de fois plus que l'objet n'est en lui-même ; la poussiere qui est sur les aîles des papillons, & qui s'attache aux doigts quand on y touche, y paroît en forme de tulipes d'une grosseur surprenante. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de les faire plus petites ; la difficulté de les monter deviendroit insurmontable.
Maniere de tourner les lentilles. Après avoir mastiqué un petit morceau de cuivre au bout de l'arbre d'un tour à lunette, avec un foret d'acier applati & arrondi, on tourne le bassin du diametre de la lentille qu'on veut y travailler, Voyez BASSIN ; ensuite ayant choisi & taillé un petit morceau de glace blanche & bien nette, on le mastique du côté d'une de ses surfaces plates au bout d'un petit mandrin, avec de la cire d'Espagne noire, la rouge ne faisant pas si bien voir les défauts qui sont au verre que l'on travaille, & l'on use cette glace du côté qui n'est point mastiqué, en la tournant sur une meule avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait une figure presque convexe : on l'acheve au tour dans le bassin qui y est monté avec du grais fin & mouillé. Il faut prendre souvent de ce grais, jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que la lentille est bien ronde : lorsqu'elle est parvenue à ce point, on cesse d'en prendre, mais on continue de la tourner dans le bassin jusqu'à ce que le reste du sable qui y est resté soit devenu si fin qu'il l'ait presque polie. On s'apperçoit de cela lorsqu'après l'avoir essuyée, l'image de la fenêtre du lieu où l'on travaille se peint sur sa superficie ; si elle ne l'est pas, on la trempe dans l'eau sans prendre du sable, & on la tourne jusqu'à ce qu'elle soit assez polie. Il faut alors couvrir le bassin d'un linge plié en deux ou trois doubles, & avec de la potée d'étain ou du tripoli de Venise délayé dans l'eau, on acheve de la polir entierement : on connoît qu'elle est polie en regardant avec la loupe si les petites cavités que le sable a faites en l'usant sont effacées ; il faut alors la démastiquer & la mastiquer du côté qui est travaillé pour travailler l'autre de même que le premier, jusqu'à ce que les bords de la lentille soient tranchans & qu'elle soit parfaitement polie. Lorsqu'elle est entierement achevée, on se sert d'esprit-de-vin pour la laver & emporter ce qui peut y être resté de cire.
On pourroit ajouter une troisieme sorte de lentille, qui consiste en une goutte d'eau posée sur un petit trou fait à une piece de laiton que l'on applique au microscope ; cette goutte réunie en globe par la pression de l'air, fait le même effet qu'une lentille soufflée : ce sont les marchands de lunettes qui font & vendent ces lentilles. Voyez LUNETTIER.
M. Guinée a donné dans les Mémoires de l'académie des Sciences de 1704, une formule générale pour trouver le foyer d'une lentille, en supposant que la réfraction des rayons de l'air dans le verre soit comme 3 à 2. Voyez REFRACTION.
Il suppose l'objet placé à une distance quelconque y dans l'axe de la lentille. Il suppose ensuite un autre rayon qui partant du même objet tombe infiniment près de celui-là ; & il trouve facilement le point où ce rayon rompu par la réfraction de la premiere surface de la lentille, iroit rencontrer l'axe. Ensuite il regarde ce rayon rompu comme un rayon incident sur la seconde surface, & il trouve encore très-aisément le point où ce rayon rompu de nouveau par la premiere surface, iroit rencontrer l'axe ; & ce point est le foyer. Voyez FOYER.
Si on nomme a le rayon de la convexité tournée vers l'objet qu'on appelle la premiere convexité ; b, le rayon de la seconde convexité ; z la distance du foyer ouvert ; & qu'on néglige l'épaisseur de la lentille, on aura, suivant les formules de M. Guinée, z = .
Si l'objet est très-éloigné, de maniere que les rayons puissent être censés paralleles, on aura y = à l'infini ; & négligeant alors dans le dénominateur le terme 2 a b qui est nul par rapport aux autres, on aura z = = .
Si de plus dans cette supposition a étoit = b, c'est-à-dire que les deux verres de la lentille fussent de convexités égales, alors on auroit z = = a ; c'est-à-dire que dans une lentille formée de deux faces également convexes, le foyer des rayons paralleles qu'on appelle proprement le foyer de la lentille, est au centre de la premiere convexité. C'est à cet endroit qu'il faut appliquer un corps que l'on veut brûler au soleil, au moyen d'un verre ardent ; car un verre ardent n'est autre chose qu'une lentille.
Si les rayons tomboient divergens sur le verre, il faudroit faire y négative ; & alors on auroit z = = , qui est toujours positive.
Si dans le cas où les rayons tombent convergens, on a y < , alors a y + b y - 2 a b, est une quantité négative, & z est par conséquent négative, c'est-à-dire que les rayons, au lieu de se réunir audessous de la seconde convexité, se réuniroient audessous de la premiere ; & qu'au lieu de sortir convergens, ils sortiroient divergens.
Les rayons sortent donc divergens d'une lentille à deux verres, si l'objet est placé en-deçà du foyer de la premiere convexité. De plus, si y est = , c'est-à-dire si l'objet est placé au foyer même. Alors z = , c'est-à-dire que les rayons sortent paralleles. Delà on voit que si un objet est placé en-deçà du foyer d'une lentille ou d'un verre convexe, & assez proche de ce foyer, il rendra les rayons beaucoup moins divergens qu'ils ne le sont en partant de l'objet même : on trouvera en effet que z est alors beaucoup plus grand que y, si a y + b y - 2 a b est négative & fort petite. C'est pour cela que les verres de cette espece sont utiles aux presbytes. Voyez PRESBYTE.
Lorsque les deux faces de la lentille sont fort convexes ; c'est-à-dire que leur rayon est très-petit, la lentille reçoit alors le nom de loupe, & forme une espece de microscope. Voyez MICROSCOPE.
Les lentilles à deux surfaces convexes ont cette propriété, que si on place un objet assez près de la lentille, les rayons qui partent des deux extrémités de l'objet, & qui arrivent à l'oeil, y arriveront sous un angle beaucoup plus grand que s'ils ne passoient point par la lentille. Voilà pourquoi ces sortes de lentilles ont en général le pouvoir d'augmenter les objets & de les faire paroître plus grands. Voyez OPTIQUE, VISION, &c.
Dans les Mém. de 1704, que nous avons cités, M. Guinée donne la formule des foyers des lentilles, en supposant en général le rapport de la réfraction comme m à n, & en ayant égard, si l'on veut, à l'épaisseur de la lentille. On peut voir aussi la formule des lentilles, dans la recherche de la vérité du P. Malebranche, tome IV. à la fin. Voyez les conséquences de cette formule, aux mots MENISQUE, VERRE, &c. (O)
LENTILLE, (Horlogerie) signifie aussi parmi les Horlogers un corps pesant qui fait partie du pendule appliqué aux horloges. On l'a nommée ainsi à cause de sa forme. La lentille est adaptée au bas de la verge du pendule, & elle y est ordinairement soutenue par un écrou que l'on tourne à droite ou à gauche pour faire avancer ou retarder l'horloge. Voyez PENDULE en tant qu'appliqué aux horloges, pendules, & verge de pendule, voyez PENDULE à secondes, & nos Planches d'Horlogerie, & leur explication.
|
| LENTINI | Leontium, (Géog.) ancienne ville de Sicile dans la vallée de Noto ; elle fut fort endommagée par un tremblement de terre en 1693. Elle est sur la riviere de même nom à 5 milles de la mer, 10 S. O. de Catane, 20 N. O. de Syracuse. Long. 32. 50. lat. 37. 18. Voyez LEONTINI. (D.J.)
|
| LENTISQUE | S. m. lentiscus, (Hist. nat. Botan.) genre de plante qui differe du térébinthe en ce que les feuilles naissent par paires sur une côte qui n'est pas terminée par une seule feuille, comme la côte qui soutient les feuilles du térébinthe. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LENTISQUE, lentiscus, arbre de moyenne grandeur qui est toujours verd. Il croît naturellement dans les provinces méridionales de ce royaume, en Espagne, en Italie, dans la Grece, aux Indes, &c. Cet arbre prend de lui-même une tige assez droite ; il se garnit de beaucoup de branches, dont l'écorce est cendrée : sa feuille est composée de huit folioles, rangées par paires sur un filet commun qui n'est point terminé par une foliole unique, comme cela se trouve ordinairement dans les feuilles conjuguées. Le lentisque mâle donne ses fleurs au mois de Mai : elles viennent en grappes aux aisselles des feuilles, & leur couleur herbacée est relevée d'une teinte de pourpre. Les fruits viennent sur le lentisque femelle ; ce sont de petites baies qui deviennent noires en meurissant ; elles sont d'un goût acide, & elles renferment un noyau qui est petit, oblong, dur & noir. Cet arbre est délicat ; il lui faut un terrein sec & l'exposition la plus chaude, pour résister en plein air aux hivers ordinaires dans nos provinces septentrionales. Mais, à moins de grandes précautions, il arrivera quelquefois qu'il sera fort endommagé par les grands froids : cependant si l'arbre est dans sa force, il poussera de nouveaux rejettons. On peut le multiplier de graines ou de branches couchées. Il faut semer la graine dans des terrines au printems ; elle ne levera qu'à l'autre printems : l'année suivante, au mois d'Avril, il faudra transplanter les jeunes plants dans des petits pots, & au bout de trois ou quatre ans, on pourra les mettre en pleine terre : en supposant néanmoins qu'on aura eu soin de mettre pendant chaque hiver soit les terrines, soit les pots, à l'abri des gelées. Les branches couchées se font au printems ; il faut les marcotter & les arroser souvent : cependant elles ne feront de bonnes racines que pendant la seconde année, & on pourra les transplanter en plein air au mois d'Avril de la troisieme. Il faudra encore des précautions pour les garantir des gelées pendant les deux ou trois premiers hivers ; après quoi les soins ordinaires suffiront, avec l'attention pourtant de ne pas couper le bout des branches ; il vaudra mieux retrancher en entier celles que l'on voudra supprimer pour faire une tige à cet arbre. Il fait naturellement une tête réguliere, & il s'éleve à douze ou quatorze piés.
Au moyen des incisions que l'on fait au tronc & aux grosses branches du lentisque, il en découle une résine, que l'on appelle mastic, & que l'on emploie à plusieurs usages ; on s'en sert en Médecine, & on le fait entrer dans la composition de différens vernis. Les Turcs mâchent habituellement du mastic, pour fortifier leurs gencives, blanchir leurs dents, & avoir l'haleine agréable. On tire des fruits du lentisque, une huile qui est bonne à brûler, & qui entre dans quelques compositions de la Pharmacie. Le bois de cet arbre a aussi des propriétés, celle entr'autres de fortifier les gencives ; ce qui a fait imaginer d'en faire des curedents. Voici les différentes especes de cet arbre :
1°. Le lentisque ordinaire, ou lentisque de Montpellier. C'est principalement à cette espece qu'il faut appliquer tout ce qui précede.
2°. Le lentisque cultivé à larges feuilles, que les Grecs d'aujourd'hui distinguent par le nom de schinos.
3°. Le lentisque blanc cultivé, connu à Scio sous le nom de schinos-aspros.
4°. Le lentisque sauvage, appellé piscari par les mêmes Grecs.
5°. Le lentisque sauvage, que les Grecs nomment votomas.
6°. Le lentisque nain, on peut voir cette espece dans les jardins de Trianon.
Les cinq dernieres especes sont encore très-rares. C'est dans l'île de Scio qu'on les cultive pour en tirer le mastic ; on trouvera un plus ample détail à ce sujet dans le traité des arbres de M. Duhamel.
LENTISQUE, (Mat. med.) on recommande fort la vertu astringente, fortifiante & balsamique du bois de lentisque, dans les éphem. d'Allemagne, decad. 3. an. 9. & 10. Dioscoride avoit déja reconnu la premiere de ces vertus dans toutes les parties de cet arbre. La décoction de bois de lentisque a été célébrée sous le nom d'or potable végétal, comme une panacée singuliere pour guérir la goutte, les foiblesses d'estomac, appaiser les vomissemens opiniâtres, dissiper les vents, exciter les urines, chasser les calculs, affermir les dents chancelantes, & fortifier les gencives, &c.
Les Pharmacologistes comptent parmi les propriétés médicinales du bois de lentisque, la vertu des curedents qu'on en fait pour raffermir les gencives.
Il est dit dans la Pharmacopée de Paris qu'on fait une eau distillée du bois de lentisque, & une huile par infusion & par décoction avec ses baies : cette eau doit être aromatique & par conséquent médicamenteuse, & cette huile doit être chargée de parties balsamiques & résineuses, prises dans les baies employées à la préparer.
Cet arbre fournit encore une drogue simple à la médecine, savoir le mastic. Voyez MASTIC. (b)
|
| LENTZBOURG | (Géog.) petite ville de Suisse, capitale d'un bailliage de même nom, au canton de Berne, dans l'Argaw. Elle est dans une vaste plaine, à deux lieues d'Arau, au pié d'un mont fort élevé où est le château du baillif, qui étoit autrefois la résidence des comtes de Lentzbourg ; ce château est fort, & situé très-avantageusement ; on dit qu'il y a un puits taillé dans le roc, à la profondeur de 300 piés. Le bailliage de Lentzbourg est un des plus grands & des plus riches de la république de Berne : c'est dans ce bailliage que sont les bains de Schinzenach. Long. de la ville de Lentzbourg 25. 31. latit. 54. 25. (D.J.)
|
| LÉO | (Astr.) nom latin de la constellation du lion. Voyez LION.
LEO saint, (Géog.) Leonis fanum, petite mais forte ville d'Italie, dans l'état de l'église au duché d'Urbin, dans le pays de Montefeltro, avec un évêché dont l'évêque fait sa résidence à Penna de Billi. Elle est sur une montagne, à 3 lieues S. O. de San-Marino, 6 N. O. d'Urbin. Long. 30. Latit. 43. 57.
|
| LÉOCOCROTTE | S. m. (Hist. nat. fabul.) en latin leococrotta, leucocrotta, ou leocrocotta ; car on trouve ce mot écrit de toutes ces manieres différentes ; & il importeroit peu de rechercher avec Saumaise, Vossius & le P. Hardouin quelle est la leçon des meilleurs manuscrits pour un animal imaginaire d'Ethiopie ; Pline nous dit dans son histoire, liv. VIII. c. xx. que le léococrotte est fort léger à la course, qu'il est de la grosseur d'un âne sauvage, ayant la tête d'un taisson, la croupe du cerf, l'encolure, la queue, le poitrail du lion, le pié fourchu, la gueule fendue jusqu'aux oreilles, & formant un os continu, qui lui prend toute la mâchoire & qui est dénué de dents. Le même Pline, dans un des chapitres suivans, chap. xxx. prétend que ce monstre est né de l'accouplement d'une lionne & d'une hyene mâle ; que ses mâchoires coupent comme un rasoir ; & que, pour empêcher qu'en les frottant continuellement l'une contre l'autre, elles ne perdent leur taillant, il les retire en-dedans, comme dans un étui. Enfin le même historien ajoûte que le léococrotte contrefait la voix des hommes & des bêtes. C'en est assez pour conclure que cet animal est un de ceux dont l'existence est très-suspecte, ou, pour mieux dire, fabuleuse. Les Grecs n'en parlent point, mais ils parlent assez souvent du crocotte, animal bâtard, né d'une chienne & d'un loup ; & tout ce qu'ils en disent, sent également la fable.
|
| LÉOGANE | (Géog.) ville & plaine de l'Amérique, qui peut avoir 12 à 13 lieues de longueur de l'est à l'ouest, sur 2, 3 & 4 de large du nord au sud. Cette belle plaine commence aux montagnes du grand Goave, & finit à celles du cul-de-sac. C'est un pays uni, arrosé de rivieres, & qui fournit tout ce qu'on veut lui faire porter, cannes, cacao, indigo, rocou, tabac, toutes sortes de fruits, de pois & d'herbes potageres ; tous les environs sont forêts de cacaoyers ; cependant la chaleur y est extraordinaire, quoique cette plaine soit au 18e degré de latitude, c'est-à-dire 3 ou 4 degrés plus septentrionale que la Martinique & la Guadeloupe, mais c'est qu'elle est privée de vents alisés, à cause des hautes montagnes qui la couvrent. Aussi l'air y est mal sain, & les maladies épidémiques fréquentes. Ce pays est à la France depuis 1691, & il ne se peuple point.
|
| LÉON | Legio, (Géog.) ancienne ville de France dans la basse Bretagne, capitale du Léonois, avec un évêché suffragant de Tours. Un nommé Pol Aurélien, dans le vj. siecle, fut le fondateur & le premier évêque de cette ville, ce qui la fit appeller depuis saint Pol de Léon ; il établit le siege épiscopal des Osismiens, les plus célebres entre les Armoriques, on les appelle Osismii & Oximii : l'évêché de Léon occupe toute la longueur de la côte de la basse Bretagne, depuis la rade de Brest jusqu'à la riviere de Morlaix. La ville de Léon est près de la mer à 12 lieues N. E. de Brest, 119 S. O. de Paris. Long. 13 d. 39'. 39''. latit. 48 d. 40'. 56''.
LEON, (Géog.) province d'Espagne, avec titre de royaume, bornée N. par l'Asturie, O. par la Galice & le Portugal, S. & E. par la vieille Castille. Elle a environ 50 lieues de long, sur 40 de large. Le Duero la partage en deux parties presque égales. Elle abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie. Léon en est la capitale ; Astorga, Salamanque, Palencia, Zamora, & quelques autres villes y sont honorées du titre de cité.
LEON, (Géog.) ville d'Espagne, capitale du royaume du même nom. Elle fut bâtie par les Romains du tems de Galba, & appellée Legio septimana Germanica, à cause qu'on y mit une légion romaine de ce nom, & c'est de-là que le mot Léon s'est formé par corruption. Son évêché suffragant de Compostelle, mais exempt de sa jurisdiction, & des plus anciens d'Espagne, fut la résidence des rois jusqu'en 1029, que le royaume fut uni à celui de Castille par la mort de Vérémont III. Son église cathédrale surpasse en beauté toutes celles d'Espagne pour la structure.
C'est Pélage, prince des rois Goths d'Espagne, qui, après une grande victoire remportée sur les Maures, leur enleva la ville de Léon en 722, & y établit le siege d'un nouveau royaume. Cette ville est entre les deux sources de la riviere d'Ezla, à 20 lieues d'Oviedo, 25 N. O. de Valladolid, 38 N. O. de Burgos, 55 E. de Compostelle, 77 N. O. de Madrid. Long. 12. 22. latit. 42. 45.
LEON le nouveau royaume de, (Géog.) royaume de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle Espagne, mais royaume entierement dépeuplé, qui n'a en partage que quelques mines dont on tire peu de profit, des montagnes stériles, point de villes ni de colonies.
LEON de Nicaragua, (Géog.) ville de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle Espagne dans la province de Nicaragua. C'est la résidence du gouverneur de la province & le siege de l'évêque de Nicaragua. Les flibustiers anglois la pillerent en 1685 à la vue d'une armée espagnole qui n'osa les attaquer, quoique six fois plus forte. Elle est sur un grand lac, qui a flux & reflux comme la mer, à 12 lieues de la mer du sud. Long. 291. 26. lat. 12. 25.
|
| LÉONARD | LE NOBLE SAINT, (Géog.) Nobiliacum, ancienne petite ville de France dans le Limousin, avec une manufacture de papier, & une autre de drap. Elle est sur la Vienne, à 5 lieues N. E. de Limoges, 78 S. O. de Paris. Long. 19. 10. latit. 45. 50.
|
| LÉONICA | (Géog. anc.) ville de l'Espagne citérieure au pays des Hédétains, selon Ptolomée, l. II. c. vj. Les habitans sont nommés Leonicences, par Pline, l. III. c. 3. C'est présentement Alcanitz, sur la riviere de Guadalupa dans l'Aragon. (D.J.)
|
| LEONICERE | Leonicera, s. f. (Botan.) nom donné par le P. Plumier, M. Vaillant & autres Botanistes, à un genre de plante que Linnaeus appelle loranthus ; voici ses caracteres.
Il y a deux calices qui sont tous deux creux & non divisés. La fleur est monopétale, de figure exangulaire, découpée dans les bords en six segmens menus & presque égaux. Les étamines forment six filets pointus, les uns un peu plus grands que les autres, mais tous à peu près de la longueur de la fleur. Le germe du pistil est arrondi ; le style est de la grandeur des étamines. Le style du pistil est obtus. Le fruit est une baie sphéroïde avec une seule loge, qui contient six graines convexes d'un côté, & anguleuses de l'autre.
|
| LÉONIDÉES | S. f. pl. (Littér.) fêtes instituées en l'honneur de Léonidas, premier roi de Lacédémone, qui se fit tuer avec toute sa troupe, en défendant intrépidement le passage des Thermopiles, & s'immolant en quelque façon pour obéir à l'oracle ; mais ses peuples en reconnoissance, le mirent au nombre des dieux. On dit qu'en partant de Sparte, sa femme lui ayant demandé s'il n'avoit rien à lui recommander : " Rien, lui répondit-il, sinon de te remarier à quelque vaillant homme, afin d'avoir des enfans dignes de toi ". (D.J.)
|
| LEONIN | en Poésie, sorte de vers qui rime à chaque hémistiche ; le milieu du vers s'accordant toujours pour le son avec la fin. Voyez RIME & VERS.
Nous avons en vers de cette espece plusieurs hymnes, épigrammes & autres pieces de poésies anciennes ; par exemple, Muret a dit des poésies de Lorenzo Gambaca de Bresce :
Brixia vestrates quae condunt carmina vates
Non sunt nostrates tergere digna nattes.
Ceux qui suivent sont de l'école de Salerne, dont on a rédigé tous les axiomes sous la même forme.
Mensibus erratis ad solem ne sedeatis.
Ut vites poenam de potibus incipe coenam.
Mingere cum bombis res est saluberrima lumbis, &c.
On n'est pas d'accord sur l'origine du nom léonin donné à cette sorte de vers. Pasquier le fait venir d'un certain Léonius ou Léoninus, chanoine d'abord de S. Benoît & ensuite de S. Victor, qui fut un des plus déterminés rimeurs en latin qui eût été jusqu'alors, & dédia plusieurs de ses ouvrages au pape Alexandre III. D'autres veulent qu'on les ait ainsi appellés du pape Léon II. qu'ils regardent comme l'inventeur de la rime. D'autres enfin prétendent que nos bons ayeux dans leur simplicité les nommerent léonins du mot leo, lion, s'imaginant que comme cet animal passe les autres en courage & en force, les vers hérissés de rime avoient aussi je ne sais quoi de plus mâle & de plus nerveux que les autres. La premiere opinion est la plus probable, non que Léonius ait été l'inventeur de ces vers rimés, mais parce qu'il les mit extrêmement en vogue.
Fauchet prétend que la rime léonine est la même chose que ce que nous appellons rime riche, c'est-à-dire, qu'il ne donne ce nom qu'à la rime comprise dans deux syllabes de même orthographe, accentuation, ponctuation, que deux autres. Les vers léonins étoient fort admirés dans les siecles de barbarie, Bernard de Cluni fit un poëme de trois mille vers latins ainsi rimés, sur le mépris du monde ; mais à mesure que le bon goût a repris le dessus, on les a bannis de la poésie latine, où on les regarde comme un défaut.
|
| LEONINA-URBS | (Géog.) nom qu'on donna dans le cinquieme siecle, au faubourg de Rome, qui est de l'autre côté du Tibre, entre le Vatican & le château S. Ange, parce que le Pape saint Léon enferma ce lieu d'une muraille, pour le défendre contre les incursions des Barbares. Son nom vulgaire est Borgo. (D.J.)
|
| LEONOISES | S. f. pl. (Draperie) espece d'étoffe. Voyez l'article DRAPERIE, où nous avons expliqué sa fabrication & celle des autres étoffes en laine.
|
| LEONTAR | ou LEONDARIO, (Géog.) ville de la Morée dans la Zaconie, sur l'Alphée, au pié des monts. De Witt croit que c'est la fameuse Mégalopolis. Voyez MEGALOPOLIS.
|
| LEONTESERE | S. f. (Lithog. anc.) nom donné par les anciens à une espece d'agate, qu'ils ont célébrée pour sa beauté, & pour les vertus imaginaires qu'ils lui attribuoient, d'adoucir les bêtes féroces ; c'est au reste une des plus variées de toutes les agates des Indes orientales, & l'une des plus rares. Son fond est jaune, marqueté ou veiné d'un rouge de flamme, de blanc, de noir & de verd. Ces deux dernieres couleurs s'y trouvent ordinairement disposées en cercles concentriques, qui forme un seul ou plusieurs points ; mais quelquefois aussi l'assemblage des diverses couleurs, dont nous venons de parler, y est semé fort irrégulierement.
|
| LEONTINI | (Géogr.) ancienne ville de Sicile, selon Pomponius Mela, liv. II. ch. viij. & selon Pline, liv. III. ch. viij. mais Ptolomée, liv. III. ch. jv. l'appelle Léontium ; Polybe, dans un fragment du liv. VII. décrit amplement cette ville & ses campagnes ; Cicéron les nomme Campus Leontinus, & Pline les appelle Lestrigonii campi. La riviere Lissus couloit le long de la colline des champs Léontins. La ville subsiste encore, & se nomme Lentini, dont on peut voir l'article. Les anciens nommoient Leontinus sinus, la partie méridionale du golfe de Catane.
Il y a dans plusieurs cabinets d'antiquaires de fort belles médailles d'argent des anciens Léontins, avec différens types, entr'autres une tête de lion & quatre grains d'orge sur les bords de la médaille ; la tête du lion fait allusion au nom de cette ville, & les grains d'orge marquent la fertilité du pays : l'inscription est , & quelquefois avec une ancienne L phénicienne, telle que les Grecs la reçurent de Cadmus, . (D.J.)
|
| LEONTION | S. m. (Hist. nat.) nom donné par les anciens à une espece d'agate qui étoit de la couleur d'une peau de lion ; ils la nommoient aussi leontodora & leonina. Voyez Wallerius, Minéralogie.
|
| LEONTIQUES | S. m. pl. leontica, (Littérature) fêtes ou sacrifices de l'antiquité payenne qui se faisoient à l'honneur de Mithra, & qu'on appelloit autrement Mithriaques. Dans les mysteres de Mithra, dit Porphyre, on donnoit aux hommes le nom de lions, & aux femmes celui de hiènes. Dès le tems de Tertullien, on donnoit aussi le nom de lions aux initiés, leones Mithrae philosophantur. Enfin, dans les fêtes léontiques, les initiés & les ministres étoient déguisés sous la forme des différens animaux, dont ils portoient les noms ; & comme le lion passe pour le roi des animaux, ces mysteres en prirent le nom de léontiques.
Il y a dans Gruter, dans Reynesius, & autres Antiquaires, quelques inscriptions qui parlent des fêtes léontiques ; mais je réserve ces sortes de détails aux mots MITHRA ou MITHRIAQUES.
|
| LEONTOCEPHALE | , (Géog. anc.) ce mot signifie tête de lion. Appien appelle ainsi une forte place de Phrygie, où, selon Plutarque, Epixyes, satrape de Phrygie, se proposoit de faire assassiner Thémistocle à son passage. (D.J.)
|
| LEONTODONTOIDE | leontodontoïdes, s. f. (Bot.) genre de plante qui ne differe de la dent de lion, de la catanance, de l'hedypnoïs, qu'en ce que ses semences ne sont pas couronnées d'aigrettes ou de poils, & qu'elles sont renfermées dans un calice cylindrique, qui ne s'ouvre pas lorsqu'il est mûr, comme dans la dent-de-lion, mais il est plutôt un peu fermé comme dans l'hedypnoïs. Nova plantarum genera, &c. par M. Micheli.
|
| LEONTOPETALOIDE | S. f. (Botaniq.) genre de plante décrit par le docteur Amman, dans les actes de Petersbourg, vol. VIII. p. 209. En voici les caracteres.
La fleur est monopétale, faite en entonnoir, & découpée dans les bords en divers segmens. Elle est succédée par un fruit vésiculaire, qui renferme plusieurs graines de figure ovale.
Cette plante est originaire des Indes orientales. Sa racine est tubuleuse, grosse de deux pouces au milieu, grise en-dehors, blanche en-dedans, & ne jettant qu'un petit nombre de fibres. Il sort communément quatre tiges de chaque racine ; ces tiges s'élevent fort haut, & sont de la grosseur du doigt. Deux de ces tiges portent chacune ordinairement une grande feuille d'un beau verd, très-mince, & diversement dentelée. Les deux autres tiges portent chacune, dans des calices d'un joli verd, une touffe de fleurs larges, jaunes, monopétales, découpées en quelques parties aux extrémités. Chaque fleur est soutenue par un pédicule long d'un doigt. Il leur succede des fruits qui sont des vessies vertes, anguleuses, d'un pouce de diametre dans la partie la plus large, d'où elles s'amenuisent en pointe, de couleur pourpre. Les graines sont assez grosses, striées & de couleur de brique-pâle. (D.J.)
|
| LEONURUS | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbrisseau qui s'éleve peu, dont le bois grisâtre porte des feuilles longues, étroites, avec des fleurs rouges, formant des guirlandes très-serrées. Son calice est long, & contient plusieurs semences ; son casque est découpé, & plus long que la barbe, qui est divisée en trois parties. Cet arbrisseau croît de boutures & de marcottes ; sa délicatesse le fait serrer pendant l'hiver, & il contribue à la décoration de la serre.
|
| LEOPARD | S. m. leopardus, pardus, (Hist. nat.) animal quadrupede qui a beaucoup de rapport au tigre, tant par la forme du corps que par son naturel féroce. Le léopard a les mêmes couleurs que le tigre ; mais ces deux animaux ont des taches noires, qui dans l'un sont longues, maculae virgatae, & dans l'autre elles représentent une sorte d'anneau irrégulier, ou les contours d'une rose, maculae orbiculatae. Les Naturalistes donnent le nom de léopard à celui qui a des taches rondes ; mais il paroit que l'usage a prévalu au contraire, & qu'on le nomme vulgairement du nom de tigre. Il est dit dans le livre, intitulé le regne animal, p. 273. que la couleur du léopard est d'un blanc jaunâtre, avec des taches noires qui sont longues sous le ventre de l'animal & arrondies sur le dos, mais toutes séparées les unes des autres, & différentes des taches en forme de rose, dont il vient d'être fait mention.
LEOPARD, (Mat. med.) sa graisse passe pour un des meilleurs cosmétiques. Il est au moins certain que ce remede est digne d'occuper une place sur la toilette de nos dames ; car il est rare, & par conséquent très-cher, & que d'ailleurs il est peut-être beau de mettre la nature entiere à contribution, la marte & la civette du nord, & les monstres d'Afrique.
|
| LÉOPARDÉ | adj. en termes de Blason, se dit du lion passant.
Testu à Paris, d'or à trois lions léopardés de sable, l'un sur l'autre, celui du milieu contrepassant.
|
| LÉOPOL | Leopolis, (Géogr.) ville de Pologne, au palatinat de Russie, dont elle est la capitale. Les Allemands l'appellent Lemberg. Elle a un archevêché pauvre, & un chapitre du rite latin, mais c'est une des meilleures starosties de la province. Casimir II. ou le Grand, se rendit maître de Léopol en 1340, & son évêché fut honoré du titre d'archevêché l'an 1361 ; il n'y a dans toute la Pologne que cet archevêché & celui de Gnesne. La ville est située auprès de la riviere de Pietewa, à 36 lieues N. O. de Kaminieck, 64 S. E. de Cracovie, 80 S. E. de Warsovie. Long. 42. 49. latit. 49. 52.
|
| LEOPOLDSTADT | Leopoldistadium, (Géog.) petite, mais forte ville de la haute Hongrie, bâtie par l'empereur Leopold en 1665. Les mécontens de Hongrie l'assiegerent en 1707, mais le comte de Staremberg leur fit lever le siege. Elle est sur la Waag, à 18 lieues N. O. de Neuhausel, 22 N. E. de Presbourg, 40 N. O. de Bude, 34 N. E. de Vienne. Long. 36. 10. lat. 18. 45.
|
| LEOSTHENIUM | (Géog. anc.) golfe du bosphore de Thrace, selon Etienne le géographe. C'est peut-être le même qui est nommé Lasthenes par Denys de Byzance, & le même qui est appellé Casthenes par Pline, liv. IV. ch. xj. (D.J.)
|
| LÉPANTE | (Géogr. anc. & mod.) ville de Grece dans la Livadie propre, avec un port sur la côte septentrionale du golfe, qui prend d'elle le nom du golfe de Lépante. Voyez LEPANTE, golfe de.
Cette ville est appellée des Latins Naupactus, d'un mot grec qui signifie bâtir un vaisseau, soit que les Héraclides, ou les peuples de la Locride, comme le veulent d'autres auteurs, ayent construit leur premier navire dans cet endroit-là. Les Grecs modernes nomment Lépante Epactos, & les Turcs Einbachti.
Elle est située dans le pays de Livadia, sur le rivage, peu loin de l'ouverture du golfe de son nom, autour d'une montagne de figure conique, sur le sommet de laquelle est bâtie la forteresse, fermée de quatre rangs de grosses murailles séparées par de petits vallons entre deux, où les habitans ont leurs maisons.
Les anciens Grecs avoient à Naupacte quatre temples célebres, l'un consacré à Neptune, l'autre à Vénus, le troisieme à Esculape, & le quatrieme à Diane. Aujourd'hui que Naupacte a pris le nom de Einbachti, qu'elle est sous la domination du sultan, & gouvernée par un vaïvode, il y a sept mosquées, deux églises pour les Grecs méprisés par les Turcs, & trois synagogues de Juifs qui font le commerce du pays, consistant en apprêts de maroquins.
L'attaque de cette place étoit très-difficile avant l'usage du canon. En 1408, elle étoit soumise à l'empereur de Constantinople ; mais l'empereur Emanuel, craignant de ne pouvoir pas la conserver, prit le parti de la céder à la république de Venise, qui la munit de maniere à résister à une puissante armée. En effet, les Turcs s'y morfondirent en 1475, & furent obligés, au bout de quatre mois d'attaque, d'en lever honteusement le siége. Enfin, Bajazet fut plus heureux, la prit sur les Vénitiens en 1687, & le château de Romélie fut rasé en 1699, en exécution de la paix de Carlowitz.
Lépante est à 45 lieues N. O. d'Athènes, 140 S. O. de Constantinople. Long. 39. 48. lat. 38. 34.
LEPANTE, (Golfe de) Géog. ce golfe pris dans sa longueur du septentrion jusqu'au rivage de l'Achaïe, & au midi jusqu'à celui de la Morée, sépare ces deux grandes parties de la Grèce l'une de l'autre. Il a eu plusieurs noms que les auteurs lui ont donnés selon les différens tems & les occasions particulieres. Quelques anciens l'appelloient Criaesus, Strabon le nomme Mare Alcyonium, &c. Son nom le plus ordinaire étoit le golfe corinthien, corinthiacus sinus.
Ce golfe comprend quatre écueils dans son étendue, & reçoit les eaux de la mer ionienne par l'entrée qui est entre deux promontoires avancés du continent, & sur lesquels sont deux châteaux, qu'on nomme les Dardanelles. Toutes les marchandises qui sortent de ce golfe, comme les cuirs, les huiles, le tabac, le ris, l'orge, payent à l'émir trois pour cent ; & cet officier en rend six milles piastres par an au grand seigneur, mais son entrée n'est plus libre aux navires étrangers.
" Ce fut dans le golfe de Lépante, non loin de Corinthe, que Dom Juan d'Autriche & les Vénitiens remporterent sur les Turcs, le 5 Octobre 1571, une victoire navale, d'autant plus illustre, que c'étoit la premiere de cette espece. Jamais, depuis la bataille d'Actium, les mers de la Grece n'avoient vû ni des flottes si nombreuses, ni un combat si mémorable. Les galeres ottomanes étoient manoeuvrées par des esclaves chrétiens, qui tous servoient malgré eux contre leur pays. Le succès produisit la liberté à environ cinq mille esclaves chrétiens. Venise signala cette victoire par des fêtes qu'elle seule savoit donner. Zarlino composa les airs pour les réjouissances de cette victoire, & Constantinople fut dans la consternation.
Dom Juan, ce célebre bâtard de Charles V. comme vengeur de la Chrétienté, en devint le héros. Il mérita sur-tout cette idolatrie des peuples, lorsque deux ans après il prit Tunis à l'exemple de son pere, & fit comme lui un roi africain tributaire d'Espagne. Mais quel fut le fruit de la bataille de Lépante & de la conquête de Tunis ? Les Vénitiens ne gagnerent aucun terrein sur les Turcs, & l'amiral de Selim II. reprit sans peine le royaume de Tunis deux ans après, en 1574. Tous les chrétiens furent égorgés. Il sembloit que les Turcs eussent gagné la bataille de Lépante ". Extrait du chapitre de la bataille de Lépante dans M. de Voltaire, tom. III. (D.J.)
|
| LEPAS | S. m. (Conchyliol.) genre de coquillage univalve, ainsi nommé en grec, comme si l'on disoit l'écaille des rochers, parce qu'il est toujours adhérent aux rochers, ou à quelques autres corps durs ; & cette adhérence lui sert de seconde coquille, pour le préserver des injures du tems. Nous appellons ce coquillage en françois patelle ou oeil-de-bouc, voyez OEIL-DE-BOUC ou PATELLE ; mais il n'y auroit point de mal de lui conserver le nom de lépas, & dire un lépas épineux, un lépas finement cannelé, un lépas tacheté de blanc & de rouge, car toutes ces épithetes ne sonnent pas bien avec le mot oeil-de-bouc.
|
| LEPETHYMNU | ou LEPETHYMUS, (Géogr. anc.) montagne de l'île de Lesbos, que Philostrate met aux environs de Méthymne. Le nom moderne de cette montagne est Leptimo ou montagne de saint Théodore. (D.J.)
|
| LEPIDIUM | S. m. (Hist. nat. Botan.) genre de plante à fleur en croix, composée de quatre pétales ; il sort du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit en forme de lance, divisé en deux loges par une cloison qui soutient des panneaux de chaque côté, & rempli de semences oblongues. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LEPIDOCARPODENDRON | S. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante établi par Boerhaave, & qu'il caractérise ainsi.
Les feuilles sont entieres, & ordinairement rangées sans symmétrie. Son calice est composé d'un grand nombre de feuilles placées les unes sur les autres en écailles & par ordre successif. Lorsqu'il est mûr, il prend la forme d'un vaisseau écailleux, & se ferme ensuite. Ses fleurs en grand nombre, & composées d'une multitude de fleurons, remplissent le fond du calice. Elles sont à pétales, irrégulieres, capillacées & hermaphrodites. L'ovaire est placé au milieu de la fleur ; il est garni de tubes, plus ou moins longs, qui forment une capsule oblongue, & finissent en deux longs filamens. Sa graine est ornée d'un grand filet, qui porte une petite plume à sa sommité. Boerhaave compte douze especes de ce genre de plante. Son nom signifie arbre ou fruit écailleux, de , écaille, , fruit, & , arbre ; Linnaeus l'appelle leucadendron. (D.J.)
|
| LEPIDOID | ou LEPIDOEIDE, en Anatomie, est un nom que l'on donne à la suture écailleuse du crâne. Voyez SUTURE.
Ce mot est grec, , formé de , écaille, & de , forme, figure. Voyez ECAILLEUSE.
|
| LÉPIDOTES | S. f. (Hist. nat. Lithol.) nom donné par quelques auteurs anciens à une pierre qui ressembloit à des écailles de poisson. D'autres se sont servis de ce nom pour désigner en général les pierres qui sont comme composées d'écailles, telles que plusieurs pierres talqueuses. D'autres enfin ont entendu par-là des pierres chargées des empreintes de poisson, telles que celles qu'on trouve en Allemagne, dans le pays de Hesse, à Eisleben, &c.
|
| LEPONTII | (Géog. anc.) ancien peuple aux confins de l'Helvétie, de la Rhétie & de l'Italie, selon les différens auteurs qui en ont parlé, savoir César, liv. IV. Pline, liv. III. ch. xxjx. Ptolomée, liv. III. ch. j. & Strabon, liv. IV. p. 206. Il faut ici consulter M. Nicolas Sanson, qui a soigneusement & savamment examiné cette matiere. Il lui paroît, d'après ses recherches, que les Lépontiens occupoient les environs du Lac majeur, tirant vers les Alpes, ce qui comprend partie de l'état de Milan, & presque tous les bailliages que les Grisons tiennent en Italie, Bellinione, Lugano, Lucarno, &c. Leur situation se prouve encore par celle de leur capitale Oscela, qu'on appelle aujourd'hui Domo d'Ossela, & par l'une des principales vallées que ce peuple a occupées, nommée Val Leventina, comme qui diroit Lepontina, qui est à la source du Tésin.
|
| LEPORIE | Leporia, (Géogr.) c'est le nom qu'on donne à la partie de la Laponie qui appartient à la Russie. On la divise en maritime, ou mourmans-koy, où est Kéla, port de mer ; en Leporie Ters-koy, sur la mer Blanche, & en Leporie, Bella-Moresky, qui est au-dessus de la mer Blanche.
|
| LEPRE | S. f. (Méd.) cette maladie tire son nom des écailles dont tout le corps ou quelques-unes des parties de ceux qu'elle attaque sont recouvertes. Le mot grec est formé , qui signifient en françois écailles. On compte ordinairement deux especes principales de lepre ; savoir la lepre des Grecs, que les Arabes appelloient tantôt albaras nigra, & tantôt albaras alba, suivant qu'ils trouvoient plus ou moins d'intensité dans les symptomes : les Latins ont prétendu la désigner sous le nom d'impetigo ; l'autre espece est la lepre des Arabes, dont le nom grec est , éléphantiase. Voyez ce mot. Il paroît par les descriptions les plus exactes qui nous en restent, que ce n'est qu'une & même maladie ; que l'impetigo des Latins en est le commencement, le premier degré, l'état le plus doux, la lepre des Grecs, le second degré, & enfin la lepre des Arabes ou l'éléphantiase le plus haut & dernier période ; quant aux variétés qu'on observe dans les différens auteurs qui ont vu par eux-mêmes, il est clair qu'elles doivent plutôt être attribuées à la diversité de climats, de pays, de température, de sujet même, qu'à l'exactitude de ces écrivains.
La lepre commence à se manifester par l'éruption de pustules rouges plus ou moins abondantes, quelquefois solitaires, le plus souvent entassées les unes sur les autres dans différentes parties du corps, surtout aux bras & aux jambes ; à la base de ces premieres pustules naissent bientôt d'autres qui se multiplient & s'étendent extrêmement en forme de grappes ; leur surface devient en peu de tems rude, blanchâtre, écailleuse ; les écailles qu'on détache en se grattant sont tout-à-fait semblables, au rapport d'Avicenne, à celles des poissons : d'abord qu'on les a enlevés, on apperçoit un léger suintement d'une sanie ichoreuse qui occasionne un piquotement désagréable ou une démangeaison : il n'est point marqué dans les auteurs si la démangeaison est continuelle. A mesure que la maladie laissée à elle-même ou combattue par des remedes inefficaces fait des progrès, les pustules se répandent, occupent le membre entier, & ensuite les autres parties, & successivement tout le corps ; elles deviennent alors, suivant Celse, livides, noirâtres, ulcérées ; le corps ainsi couvert d'un ulcere universel, présente à l'oeil le spectacle le plus affreux & exhale une odeur insoutenable ; une maigreur excessive acheve de le défigurer ; le visage, les levres & les extrémités inférieures & supérieures s'enflent prodigieusement, souvent au point qu'on ne peut appercevoir qu'à peine les doigts enfoncés & cachés sous la tumeur : survient enfin une fievre lente qui consume en peu de tems le malade. Cette cruelle maladie étoit très-commune autrefois, sur-tout dans les pays chauds, dans la Syrie, l'Egypte, la Judée, à Alexandrie, &c. Willis assure que les habitans de la Cornouaille, province maritime d'Angleterre y étoient anciennement très-sujets. Les auteurs contemporains ont observé (cette observation est remarquable par rapport à la vérole) que la lepre n'attaquoit jamais les enfans avant l'âge de puberté ou d'adulte, ni les eunuques, suivant la remarque d'Archigene, & Aëtius rapporte que quelques personnes de son tems se faisoient châtrer pour s'en exempter. On croit que cette maladie n'existe plus à présent, du-moins il est certain qu'elle n'est plus connue sous le nom de lepre. Le docteur Town raconte qu'il y a dans la Nigritie une maladie qui lui est fort analogue, & qui attaque également les negres & les blancs d'abord qu'ils sont réduits au même régime, qu'ils éprouvent l'intempérie des saisons, & qu'ils font les mêmes travaux ; après que les malades ont resté quelque tems maigres, languissans, cachectiques, leurs jambes s'enflent, deviennent oedémateuses ; peu après les veines se distendent, il s'y forme des varices depuis le genou jusqu'à l'extrémité des orteils, la peau devient dure, inégale, raboteuse, se couvre d'écailles qui ne se dessechent point, mais qui s'augmentent de façon à grossir prodigieusement la jambe ; dans cet état toutes les fonctions se font à l'ordinaire comme en santé, & le malade est propre à tous les ouvrages qui ne demandent point d'exercice. Quels que soient les rapports de cette maladie avec la lepre, il est certain qu'elle en differe essentiellement, de même que quelques maladies cutanées dont on voit de tems en tems des exemples, & qui n'ont que quelque ressemblance extérieure avec la lepre sans en avoir la contagion, le caractere distinctif & spécial. Le tems auquel on a cessé d'observer la lepre, est à peu près l'époque de la premiere invasion de la vérole dans notre monde. Il y a, comme on voit, une espece de compensation, de façon que nous gagnons d'un côté ce que nous perdons de l'autre. On pourroit assurer qu'il y a à peu près toujours la même somme de maladie, lorsque quelqu'une cesse de paroître, nous lui en voyons ordinairement succéder une autre qu'on croit inobservée par les anciens : souvent ce n'est qu'un changement de forme ; cette vicissitude & cette succession de maladies a trop peu frappé les médecins observateurs. Les Arabes sont presque les derniers auteurs qui en parlent comme témoins oculaires, & d'après leur propre observation. Les symptomes par lesquels la vérole se manifesta dans les commencemens, avoit beaucoup de rapport à ceux de la lepre. Voyez VEROLE. Et c'est sur ce fondement que plusieurs auteurs ont établi l'antiquité de la vérole, prétendant qu'elle n'étoit autre chose que la lepre des anciens : d'autres tombant aussi vraisemblablement dans l'excès, ont pris le parti absolument contraire, & ont soutenu que la lepre & la vérole étoient deux maladies totalement différentes ; il y a tout lieu de penser que les uns & les autres ont trop généralisé leurs prétentions : les premiers n'ont pas assez pesé les différences qu'il y a dans les symptomes, les causes, la curation & la maniere dont la contagion se propage ; les seconds ont trop appuyé sur ces différences & sur d'autres encore plus frivoles ; ils n'ont pas fait attention que la lepre se communique de même que la vérole par le coït, qu'elle n'affecte point les âges qui n'y sont pas propres ; que lorsqu'elle se communique par cette voie, il survient aux parties génitales des accidens particuliers, tel que flux involontaire de semence, ardeur d'urine, pustules, ulceres à la verge, &c. comme Jean Gadderden & Avicenne l'ont exactement remarqué. On pourroit aussi leur faire observer que les maladies de cette espece qui ont une cause particuliere, spécifique, ne paroîtront pas toujours avec les mêmes symptomes ; qu'après qu'elles ont duré un certain tems, elles sont plus douces, plus modérées ; elles semblent affoiblies & comme usées par la propagation. On pourroit presque comparer ce qui arrive à ces maladies à ce qu'on observe sur un fil d'argent qu'on dore ; à mesure qu'on étend ce fil, on l'émincit & on diminue à proportion la quantité d'or qui se trouve dans chaque partie ; d'ailleurs il peut arriver dans ce virus diverses combinaisons ; il est susceptible de modification, de changement, &c. & ce ne seroit surement pas une opinion dénuée de vraisemblance, que de présumer que le virus vérolique n'est qu'une combinaison particuliere du virus lépreux, & que la vérole n'est qu'une lepre dégénérée, altérée, &c. Voyez VEROLE.
La lepre est une maladie particuliere de l'espece de celles qui sont entretenues par un vice spécial du sang ou de quelqu'humeur qu'on appelle virus ; elle ne dépend point, ou que très-peu, de l'action des causes ordinaires. Les anciens avoient fait consister le virus dans une surabondance particuliere d'humeur mélancholique ou de bile noire, différente de celle qui excitoit l'hyppocondriacité, la maladie noire, les fievres quartes, &c. pour nous nous ignorons absolument sa nature, sa maniere d'agir ; le méchanisme de l'éruption, qui en est la suite, n'est pas différent de celui des autres maladies éruptives. Voyez au mot PETITE VEROLE, GALE, &c. Tout ce que nous savons de certain, c'est que la lepre est une maladie contagieuse, & que les miasmes qui propagent la contagion, ne sont pas aussi fixes que ceux de la vérole. Avicenne prétend qu'ils sont assez volatils pour infecter l'air, & qu'ainsi la lepre se communique par la simple fréquentation ou voisinage des personnes infectées ; cette idée étoit universellement reçue, puisqu'on étoit obligé de séparer de la société & de renfermer ceux qui en étoient attaqués ; Moïse fit des lois pour ordonner cette séparation, & régler la maniere dont elle devoit se faire, & nous lisons dans les livres sacrés, que sa soeur étant attaquée de cette maladie, fut mise hors du camp pour prévenir les suites funestes de la contagion ; on a bâti dans plusieurs pays des hôpitaux, appellés de S. Lazare, dont la fondation étoit de donner à ces malheureux des secours qui leur étoient refusés par des parens ou domestiques justement allarmés pour leur propre santé. Cette maladie ou la disposition à cette maladie se transmet héréditairement des parens aux enfans ; elle se communique par le coït, & par le simple coucher ; Scultetus raconte que plusieurs personnes ont contracté cette maladie pour avoir mangé de la chair de lépreux. Le même auteur assure que l'usage de la chair humaine même saine, produit le même effet. Porta, man. chirurg. observ. 100. L'on craignoit aussi beaucoup autrefois, pour la même raison, la viande de cochon, & l'usage immodéré du poisson ; & c'est dans le dessein de prévenir les ravages que fait cette affreuse maladie, que le prudent législateur des Juifs leur défendit ces mets. Ces lois s'exécutent, sur-tout à l'égard du cochon, encore aujourd'hui très-rigoureusement chez les malheureux restes de cette nation. Quelques auteurs assurent que des excès fréquens en liqueurs ardentes, aromatiques, en vins sur-tout aigres, en viandes épicées, endurcies par le sel & la fumée, sur-tout dans les pays chauds, disposoient beaucoup à cette maladie ; c'est à un pareil régime que Willis attribue la lepre commune aux Cornouailliens ; mais ces causes ne sont pas constatées, & même si l'on veut parcourir les nations chez lesquelles la lepre étoit comme endémique, il sera facile d'y observer que ce genre de vie, qu'on regarde comme cause de la lepre, n'y étoit point suivi, ou moins que chez d'autres peuples qui en étoient exempts ; il y en a qui ont avancé que le coït avec une femme dans le tems qu'elle a ses régles, étoit une des causes les plus ordinaires de la lepre ; il n'est personne qui ne sente le ridicule & le faux de cette assertion. On a aussi quelquefois, comme il arrive dans les choses fort obscures, eu recours pour trouver les causes de cette maladie, aux conjonctions particulieres des astres, & à la vengeance immédiate des dieux : à l'ignorance, la superstition, ou même la politique peuvent faire recourir à de semblables causes.
Dans les tems & les pays où la lepre étoit très-commune, il n'étoit pas possible de s'y méprendre, l'habitude suffisoit pour la faire distinguer des autres maladies cutanées avec lesquelles elle pouvoit avoir quelque ressemblance ; si elle paroissoit de nos jours, quelqu'inaccoutumés que nous soyons à la voir, les descriptions détaillées que nous en avons, mais plus que tout un génie contagieux épidémique, pourroient aisément nous la faire reconnoître ; d'ailleurs il n'y auroit pas grand risque à la confondre avec les autres maladies cutanées ; la vérole peut aussi, dans certains cas, en imposer pour la lepre. J'ai vu une jeune femme dont toutes les parties du corps étoient couvertes de pustules écailleuses assez larges, semblables à celles qui paroissent dans la lepre ; pendant l'usage des frictions mercurielles que je lui fis administrer, tous les autres symptomes vénériens se dissiperent, ces pustules s'applanirent par la chûte de grosses écailles, & la peau revint ensuite, moyennant quelques bains, dans son état naturel. Je suis très-persuadé que dans pareil cas une erreur dans le diagnostic ne peut avoir aucune suite funeste.
Malgré l'appareil effrayant que présente la lepre, on a observé qu'elle étoit rarement mortelle, & qu'elle n'étoit accompagnée d'aucun danger pressant. On a vu des lépreux vivre pendant plusieurs années, sans autre incommodité ou plutôt n'ayant que le désagrément d'avoir la peau ainsi défigurée. Lorsque la lepre ne fait que commencer, qu'elle est encore dans le premier degré que nous avons appellé avec les Latins impetigo, on peut se flatter de la guérir ; les remedes que les anciens employoient réussissoient ordinairement. Dans le second degré, ou la lepre des Grecs, on ne guérissoit que rarement & à la longue, & la guérison étoit le plus souvent très-imparfaite ; pour la lepre des Arabes ou l'éléphantiase, los remedes qu'un succès heureux & constant faisoit regarder comme plus appropriés à cette maladie dans les commencemens, ne produisoient dans ces derniers tems aucun effet, pas même le moindre changement en bien, toutes les tentatives étoient infructueuses ; c'est pourquoi Celse conseille dans ce cas de ne point fatiguer le malade par des remedes dont l'inutilité est si constatée.
Dans la curation de la lepre, les anciens avoient principalement égard à l'humeur mélancolique qu'ils regardoient comme la cause de cette maladie ; cette idée n'est point tout-à-fait sans fondement, elle est sur-tout très-inutilement appliquable au traitement des autres maladies cutanées ; en conséquence ils se servoient beaucoup des mélanagogues, des hépatiques fondans, de l'aloës, de l'ellébore, de la coloquinte, de l'extrait de fumeterre, &c. ils joignoient à ces remedes plus particuliers l'usage d'une quantité d'autres remedes généraux dont on a encore augmenté le catalogue dans les derniers tems ; les purgatifs, la saignée, le petit-lait à haute dose, les eaux acidules, les sucs d'herbes, les décoctions sudorifiques, les martiaux & le mercure sont ceux qu'on employoit le plus fréquemment ; sans doute on en avoit observé de meilleurs effets ; parmi les sudorifiques, on a beaucoup vanté les vipères : Aretée, Galien, Aëtius, Avicenne, Rhazès, assurent que dans la lépre même confirmée, c'est un remede très-efficace ; ils ne promettent de son usage rien moins qu'un renouvellement total de la constitution du corps ; la connoissance de leurs vertus est dûe, suivant Galien, au hazard ; cet auteur raconte que quelques personnes touchées de compassion envers un misérable lépreux, & se croyant dans l'impossibilité de le guérir, résolurent de mettre fin à ses souffrances en l'empoisonnant ; pour cet effet, ils lui donnerent de l'eau dans laquelle on avoit laissé long-tems une vipere ; l'effet ne répondit point à leur attente, & le remede loin de précipiter la mort opéra une parfaite guérison, fides sit penès auctorem. Il s'en faut bien que la chair de vipères mangée, ou mise en décoction, produise des effets aussi sensibles. Voyez VIPERE. La maniere dont Solenander les employoit ne paroît pas, toute singuliere qu'elle est, leur donner plus d'efficacité ; cet Auteur prenoit deux ou trois viperes, ou à leur défaut, des serpens, qu'il coupoit tous vivans par morceaux, & les mêloit ensuite avec de l'orge ; il faisoit bouillir le tout jusqu'à ce que l'orge s'ouvrît, alors il s'en servoit pour nourrir des jeunes poulets ; ne leur donnant aucune autre nourriture ; après quelques jours les plumes tomboient aux poulets, & dès qu'elles étoient revenues, il les tuoit & en faisoit manger la chair & prendre le bouillon aux malades ; il assure que par cette méthode, il a très-souvent guéri des lépreux. Les sels volatils qu'on retire de la vipere, ou de la corne de cerf, paroissent mériter à plus juste titre tous ces éloges ; leur action est incontestable, très forte, & vraisemblablement avantageuse, dans le cas dont il s'agit. Quelqu'indiqués que paroissent les mercuriaux dans cette maladie, les expériences que Willis en a fait ne sont point en leur faveur ; il les a employés dans deux cas où ils n'ont operé qu'un effet passager, ils n'ont fait qu'adoucir & pallier pour un tems les symptômes qui ont recommencé après de nouveau & même avec plus de force. Toutes les applications extérieures doivent, à mon avis, être bannies de la pratique dans cette maladie ; si elles ne sont qu'adoucissantes, elles ne peuvent faire aucun bien, elles sont exactement inutiles ; pour peu qu'elles soient actives elles exigent beaucoup de circonspection dans leur usage, qui peut dans bien des cas être dangereux & qui n'est jamais exactement curatif. Les bains simples, ou composés avec des eaux minerales sulphureuses, telles que celles de Barreges, de Bannieres, &c. sont les remedes les plus appropriés, soit pour operer la guérison, soit pour la rendre parfaite, en donnant à la peau sa couleur & sa souplesse naturelle ; ces mêmes eaux prises intérieurement ne peuvent aussi qu'être très-avantageuses. Il ne faut cependant pas dissimuler que l'effet de tous ces remedes n'est pas constant, encore moins universel ; nous avons déjà remarqué que la lepre confirmée résistoit opiniâtrement à toutes sortes de remedes, ce qui dépend probablement moins d'une incurabilité absolue, que du défaut d'un véritable spécifique. (M)
|
| LEPRIUM | autrement LEPREUM, LEPREON, LEPREUS, (Géogr. anc.) ancienne ville du Péloponnèse dans l'Elide, assez près des confins de l'Arcadie. Niger croit que le nom moderne est Chaiapa. (D.J.)
|
| LÉPROSERIE | S. f. (Hist.) MALADRERIE, mais ce terme ne se soutient plus que dans le style du palais, dans les actes & dans les titres, pour signifier une maladrerie en général. En effet, il ne s'appliquoit autrefois qu'aux seuls hôpitaux, destinés pour les lépreux. Matthieu Paris comptoit dix-neuf mille de ces hôpitaux dans la chrétienté, & cela pouvoit bien être, puisque Louis VIII. dans son testament fait en 1225, légue cent sols, qui reviennent à environ 84 livres d'aujourd'hui, à chacune des deux mille léproseries de son royaume.
La maladie pour laquelle on fit bâtir ce nombre prodigieux d'hôpitaux, a toujours eu, comme la peste, son siege principal en Egypte, d'où elle passa chez les Juifs, qui tirerent des Egyptiens les mêmes pratiques pour s'en préserver ; mais nous n'avons pas eu l'avantage d'en être instruits.
Il paroît que Moïse ne prescrit point de remedes naturels pour guérir la lepre, il renvoie les malades entre les mains des prêtres ; & d'ailleurs il caracterise assez bien la maladie, mais non pas avec l'exactitude d'Arétée parmi les Grecs, liv. IV. chap. xiij. & de Celse parmi les Romains, liv. III. chap. xxv.
Prosper Alpin remarque que dans son tems, c'est-à-dire, sur la fin du seizieme siecle, la lepre étoit encore commune en Egypte. Nos voyageurs modernes, & en particulier Maundrell, disent qu'en Orient & dans la Palestine, ce mal attaque principalement les jambes, qui deviennent enflées, écailleuses & ulcéreuses.
Le D. Townes a observé qu'une pareille lépre regne parmi les esclaves en Nigritie ; l'enflure de leurs jambes, & les écailles qui les couvrent vont toujours en augmentant ; & quoique cette écorce écailleuse paroisse dure & insensible, cependant pour peu qu'on en effleure sur la surface avec la lancette, le sang en sort librement. On a tenté jusqu'à ce jour sans succès la cure de ce mal éléphantiatique.
L'histoire raconte que les soldats de Pompée revenant de Syrie, rapporterent pour la premiere fois en Italie, une maladie assez semblable à la lépre même. Aucun reglement fait alors pour en arrêter les progrès, n'est parvenu jusqu'à nous ; mais il y a beaucoup d'apparence qu'on fit des reglemens utiles, puisque ce mal fut suspendu jusqu'au tems des Lombards.
Rotharis qui les gouvernoit avec tant de gloire au milieu du septieme siecle, ayant été instruit de l'étendue & des ravages de cette maladie, trouva le moyen le plus propre d'y couper court. Il ne se contenta pas de reléguer les malades dans un endroit particulier, il ordonna de plus, que tout lépreux chassé de sa maison, ne pourroit disposer de ses biens, parce que du moment qu'il avoit été mis hors de sa maison, il étoit censé mort. C'est ainsi que pour empêcher toute communication avec les lépreux, sa loi les rendit incapables des effets civils.
Je pense avec M. de Montesquieu, que ce mal reprit naissance pour la seconde fois en Italie, par les conquêtes des empereurs Grecs, dans les armées desquels il y avoit des milices de la Palestine & de l'Egypte. Quoi qu'il en soit, les progrès en furent arrêtés jusqu'au tems malheureux des croisades, qui répandirent la lepre, non pas dans un seul coin de l'Europe, mais dans tous les pays qui la composent, & pour lors, on établit par-tout des léproseries.
Ainsi les chrétiens après avoir élevé de nouveaux royaumes de courte durée, dépeuplé le monde, ravagé la terre, commis tant de crimes, de grandes & d'infâmes actions, ne rapporterent enfin que la lepre pour fruit de leurs entreprises. Cette cruelle maladie dura long-tems par son étendue dans le corps du petit peuple, par le manque de connoissance dans la maniere de la traiter, par le peu d'usage du linge, & par la pauvreté des pays, ou pour mieux dire leur extrême misere, car les léproseries manquoient de tout ; & ces cliquettes ou barrils qu'on faisoit porter aux lépreux pour les distinguer, n'étoient pas un remede pour les guérir. (D.J.)
|
| LEPSIS | S. f. , sumptio, en Musique, est une des parties de l'ancienne mélopée, par laquelle le compositeur discerne s'il doit placer son chant dans le systême des sons bas, qu'ils appellent hypatoïdes ; dans celui des sons aigus, qu'ils appellent nétoïdes ; ou dans celui des sons moyens, qu'ils appellent mésoïdes. Voyez MELOPEE. (S)
|
| LEPTIS | (Géog. anc.) les anciens distinguent deux leptis ; l'une qu'ils nomment la grande, magna ; & l'autre la petite, parva ou minor.
Leptis magna, la grande Leptis, étoit une ville & colonie romaine en Afrique, dans la contrée nommée Syrtique, & l'une des trois qui donnerent le nom de Tripolis à cette contrée.
Leptis, en qualité de colonie romaine, est nommée sur les médailles, COL. VIC. JUL. LEP. Colonia, Victrix, Julia, Leptis, c'est-à-dire Leptis, colonie victorieuse Julienne. Cette ville devint épiscopale, & son évêque est désigné le premier entre les évêques de la province Tripolitaine.
Leptis parva ou Leptis minor, la petite Leptis étoit une ville d'Afrique, dans la Byzacène. La table de Peutinger dit, Lepte minus. Il ne faut pas croire, pour ces noms de parva, minor ou minus, que ce fût une petite ville ; elle ne s'appelloit ainsi, que par rapport à l'autre Leptis, & pour les distinguer ; car du reste, c'étoit une belle & grande ville, liberum oppidum, ville libre, dit Pline, liv. V. chap. iv. Libera civitas, & immunis, ville libre & franche, dit Hirtius, ch. vij. César y mit six cohortes en garnison. Elle étoit aussi épiscopale, & la notice d'Afrique, nomme évêque dans la Byzacène, Fortunatianus, Leptiminensis.
La grande Leptis est nommée Lépide par Marmol, Lepeda par Baudrand, Lesida par le sieur Lucas. La petite Leptis est appellée Lepté par Corneille, & Télepté par M. l'Abbé Fleuri, & par Dupin. (D.J.)
|
| LEPTUM | S. m. (Monn. anc.) petite monnoie des anciens Romains, qui valoit selon les uns, la huitieme partie d'une obole, & qui selon d'autres, étoit une drachme de cuivre ou d'argent. (D.J.)
|
| LEQUIOS | ou LIQUIOS, ou RIUKU, (Géog.) ce sont plusieurs îles de l'Océan oriental, au nombre de six principales ; ce petit Archipel coupe obliquement le 145 dégré de long. vers le 26 ou 27 de lat. au sud-ouest de Saxuma, province du Japon, dont elles dépendent, un roi de Saxuma en ayant fait la conquête vers l'an 1610.
Le langage du pays est une espece de chinois corrompu, parce que dans la derniere révolution de la Chine, plusieurs des habitans de ce vaste empire se refugierent dans ces îles, où ils s'appliquerent au négoce. Depuis que le commerce du Japon est fermé aux étrangers, les insulaires Lequios ne sont reçûs que dans un port de la province de Saxuma, pour le débit de quelques marchandises, jusqu'à la concurrence de 23 caisses d'argent par an ; mais ils ne sont ni moins habiles, ni moins heureux que les Chinois, à faire la contrebande. Voyez les détails dans Koempfer, & le P. Charlevoix, Hist. du Japon. (D.J.)
|
| LÉRICE | (Gram.) en latin erix, ou ericis portus, bourg ou petite ville d'Italie, avec une espece de port sur la côte orientale du golfe de la Spécia, dans l'état de Gènes, à 5 milles de la Spécia, & à 40 de Porto-fino. Long. 27. 30. lat. 44. 5.
|
| LÉRIDA | (Géog.) ancienne & forte ville d'Espagne, dans la Catalogne, avec un évêché considérable suffragant de Tarragone, une université, & un bon château. Il s'y tint un concile en 528. Jacques I. roi d'Aragon, s'en empara sur les Maures, en 1238. Le grand Condé fut obligé d'en lever le siege dans le dernier siecle. Les Catalans la prirent en 1705. Elle est proche la riviere de Segre, dans un terroir fertile, à 6 lieues sud-ouest de Balaguer, 16 nord-ouest de Tarragone, 30 nord-ouest de Barcelone, 76 nord-est de Madrid.
Les Anciens ont connu Lérida, sous le nom d'Ilerda, dont le nom moderne n'est qu'une espece d'anagramme ; elle se rendit célebre dans l'antiquité, par son commerce, & par la victoire que Jules-César y remporta sur les lieutenans du grand Pompée. Long. 18. 10. lat. 41. 31. (D.J.)
|
| LÉRINS | (LES ISLES DE) Lerinae insulae, Géog. nom de deux petites îles de la mer Méditerranée, sur la côte de Provence, à 2 lieues d'Antibes.
Celle des deux îles qui est le plus près de la côte, a une lieue & demie de long, sur une demi-lieue de large ; elle s'appelle l'île sainte Marguerite, & est la Lero ou Lerone des anciens. Elle a une sorte de forteresse, avec une garnison d'invalides, pour y garder les prisonniers d'état.
L'autre île est nommée des anciens Lerina, Lerinum, Lerinus. Tacite, l. I. de ses Annales, rapporte qu'Auguste y avoit relegué Agrippa son neveu. On l'appelle aujourd'hui l'île saint Honorat, parce que ce saint en 410 la choisit pour sa retraite, & y fonda le monastere de Lerins, qui suit la regle de saint Benoît. L'île saint Honorat est du côté de l'ouest, plus basse & plus petite que l'île sainte Marguerite.
|
| LERJEONS | S. m. pl. (Pêche) terme de pêche usité dans le ressort de l'amirauté de Bourdeaux : ce sont des especes de tramaux ou filets tramaillés. Voyez TRAMAUX.
|
| LERME | (Géog.) petite ville d'Espagne, dans la vieille Castille, érigée en duché par Philippe III. en 1599, en faveur de son favori & premier ministre le duc de Lerme, qui devint cardinal après la mort de sa femme, & qui y bâtit le château de Lerme. La ville est sur la petite riviere d'Arlanzon, à 6 lieues de Burgos, & à 12 de Valladolid. Long. 14. 15. lat. 51. 36.
|
| LERNE | (Géog. anc. Mythol. & Litt.) marais du Péloponnèse, au royaume d'Argos.
Il est célebre dans les tems fabuleux, par le meurtre des fils d'Aegyptus ; car ce fut-là, dit Pausanias, l. II. c. xxiv. que les filles de Danaüs, leurs fiancées, les égorgerent, & leurs corps y furent inhumés, mais leurs têtes furent portées à Argos, & l'on y montroit leur sépulture, sur le chemin de la citadelle.
Lerne n'est pas moins célebre dans les écrits des Poëtes, par cette hydre à sept têtes, dont Hercule triompha ; ce qui signifie, nous disent les Mythologistes, autant de sources qui se perdoient dans ce marais, & qu'Hercule détourna pour le dessécher.
Quoi qu'il en soit, ce lieu étoit réputé mal-sain, & les assassinats qu'on y avoit commis, obligerent plusieurs fois de le purifier. Ce sont ces purifications, qui suivant Strabon, donnerent naissance à une expression proverbiale, , Lerne de maux, expression, ajoute ce géographe, que les modernes interprêtes des proverbes, comme Zénobius, Diogénianius, & autres, ont prétendu expliquer, en supposant qu'on voituroit à Lerne tous les immondices d'Argos.
Le marais de Lerne s'écouloit dans une petite riviere qui entrant dans la Laconie, portoit ses eaux dans la mer, & au nord de son embouchure.
Entre la riviere de Lerne & les confins d'Argos, étoit une petite ville du même nom Lerna, que le marais & la riviere. C'est du moins de cette maniere, que M. Delisle, dans sa belle carte de l'ancienne Grece, concilie les divers auteurs qui parlent de Lerne les uns comme ville, d'autres comme riviere, & d'autres enfin comme un marais infect & mal-sain. M. l'abbé Fourmont en 1729, n'a vû ni ville, ni riviere, ni marais, mais une simple fontaine qu'on nomme Lerne, & qui est à 200 pas de la mer.
|
| LERNECA | (Géog.) ancienne ville de Chypre, qui a dû être autrefois considérable, à en juger par ses ruines. Elles forment encore un village de ce nom, sur la côte méridionale de l'île de Chypre ; ce village a une bonne rade, & un petit fort pour sa défense. (D.J.)
|
| LERNÉES | (Littérat.) fêtes ou mysteres qu'on célébroit à Lerna, petite ville près d'Argos, en l'honneur de Bacchus & de Cérès. La déesse y avoit un bois sacré, tout en platanes, & au milieu du bois étoit sa statue de marbre qui la représentoit assise ; Bacchus y avoit aussi sa statue ; mais quant aux sacrifices nocturnes qui s'y font tous les ans à l'honneur de ce dieu, dit Pausanias, il ne m'est pas permis de les divulguer. (D.J.)
|
| LÉROS | (Géog. anc.) le nom moderne est Léro, île d'Asie, dans la mer Egée, l'Archipel, l'une des sporades, sur la côte de Cane ; c'étoit une des colonies des Milésiens ; ses habitans avoient assez mauvaise réputation du côté de la probité, si nous en jugeons par une épigramme de Phocydide, qui se trouve dans l'anthologie ; mais au lieu de l'original que peu de lecteurs entendroient, j'y substituerai la traduction qu'en a faite M. Chevreau dans ses Oeuvres mêlées, p. 369.
Ceux de Léros ne valent rien,
Hors Patrocle pourtant qui malgré sa naissance
A passé jusqu'ici pour un homme de bien ;
Mais quand avec Patrocle on a fait connoissance,
Encore s'apperçoit-on qu'il tient du Lérien.
Long. de Léro 44. 40. lat. 37. (D.J.)
|
| LEROT | S. m. (Hist. nat. quadrup.) mus avellanarum major, Raï, synop. anim. quadr. rat dormeur un peu plus petit que le loir ; il en differe principalement en ce qu'il n'a de longs poils qu'au bout de la queue. Ses yeux sont entourés d'une bande noire qui s'étend en avant jusqu'à la moustache, & en arriere jusqu'au-delà de l'oreille, en passant par-dessus l'oeil. La face supérieure du corps est de couleur fauve, mêlée de cendré brun, & de brun noirâtre ; la face inférieure a une couleur blanche, avec des teintes jaunâtres & cendrées. Le lerot est plus commun que le loir ; on l'appelle aussi rat blanc ; il se trouve dans les jardins, & quelquefois dans les maisons ; il se niche dans des trous de murailles, près des arbres en espalier, dont il mange les fruits ; il grimpe aussi sur les arbres élevés, tels que les poiriers, les abricotiers, les pruniers, & lorsque les fruits lui manquent, il mange des amandes, des noisettes, des noix, &c. & même des graines légumineuses ; ce rat transporte des provisions dans des trous en terre, dans des creux d'arbres, ou dans des fentes de vieux murs, qu'il garnit de mousse, d'herbe, & de feuilles. Il reste engourdi & pelotonné durant le froid. Il s'accouple au printems ; la femelle met bas en été cinq ou six petits à chaque portée. Le lerot a une aussi mauvaise odeur que le rat domestique : aussi sa chair n'est pas mangeable. On trouve des lerots dans tous les climats tempérés de l'Europe, & même en Pologne, en Prusse, &c. Hist. nat. génér. & part. tom. VIII. Voyez RAT DORMEUR & QUADRUPEDE.
|
| LESBOS | (Géog. anc.) île de la mer Egée, sur la côte de l'Asie mineure, & plus particulierement de l'Aeolie. Strabon lui donne 137 milles & demi de tour, & Pline, selon la pensée d'Isidore, 168 milles.
Elle tenoit le septieme rang entre les plus grandes îles de la mer Méditerranée. Les Grecs sous la conduite de Graüs, arriere-petit-fils d'Oreste, fils d'Agamemnon, y établirent une colonie qui devint si puissante, qu'elle & la ville de Cumes passerent pour la métropole de toutes les colonies greques qui composoient l'Aeolide, & qui étoient environ au nombre de trente. Pausanias prétend que Penthilus fils d'Oreste, fut celui qui s'empara de l'île de Lesbos.
Elle avoit eu plusieurs noms ; Pline en rapporte six, & néanmoins il ne dit rien de celui d'Issa, que Strabon n'a pas oublié. Ce mot d'Issa lui venoit d'Issus fils de Macarée : le nom de Macaria lui venoit de Macarée pere d'Issus, & petit-fils de Jupiter, qui y avoit sa résidence. Avant Macarée, cette île portoit le nom de Pelasgia, parce qu'elle avoit été peuplée par les Pélasges, ses plus anciens habitans. On sait que son nom de Lesbos lui vint de Lesbus, petit-fils d'Aeole, gendre & successeur de Macarée.
Cette île eut jusqu'à neuf villes considérables ; mais au tems de Strabon & de Pline, à peine en restoit-il quatre, Méthymne, Erèse, Pyrrha, & Mytilène, d'où s'est formé le nom moderne de Lesbos qui est Metelin. Voyez METELIN, TILENELENE.
Thucydide, l. III. nous apprend que les Lesbiens abandonnerent le parti des Athéniens, pendant la guerre du Péloponnèse, & qu'ils en furent châtiés rigoureusement. Peu s'en fallut que la sentence qui condamnoit à mort tous les mâles de Mytilène audessus de l'âge de puberté, ne fût mise à exécution. Par bonheur, le contr'ordre des Athéniens arriva, lorsqu'on se préparoit à cet horrible massacre.
Lesbos étoit fameuse par les personnes illustres qu'elle avoit produites, par la fertilité de son terroir, par ses bons vins, par ses marbres, & par beaucoup d'autres choses.
Plutarque nous assure que les Lesbiens étoient les plus grands musiciens de la Grece. Le fameux Arion, dont l'avanture sur mer fit tant de bruit, étoit de Méthymne. Terpandre qui remporta quatre fois de suite le prix aux jeux Pythiques, qui calma la sédition de Lacédémone par ses chants mélodieux, accompagnés des sons de la cithare, en un mot le même Terpandre qui mit le premier sept cordes sur la lyre, étoit lesbien, dit la chronique de Paros. C'est ce qui donna lieu à la fable de publier qu'on avoit entendu parler dans cette île la tête d'Orphée, après qu'on l'eut tranchée en Thrace, comme l'explique ingénieusement Eustathe, dans ses notes sur Denys d'Alexandrie.
Pittacus l'un des sept sages, le poëte Alcée, qui vivoit dans la 44e Olympiade, l'aimable Sapho, le rhétoricien Diophanes, l'historien Théophane, étoient natifs de Mytilene. La ville d'Erese fut la patrie de Théophraste & de Phanias, disciples d'Aristote : le poëte Leschez, à qui l'on attribue la petite Iliade, naquit à Pyrrha. Strabon ajoute aux illustres Lesbiens que nous avons nommés, Hellanicus l'historien, & Callias qui fit des notes intéressantes sur les poésies d'Alcée & de Sapho.
Si l'île de Lesbos produisoit des gens célebres, elle n'étoit pas moins fertile en tout ce qui peut être nécessaire ou agréable à la vie, & son sol n'a point changé de nature. Ses vins n'ont rien perdu de leur premiere réputation : Strabon, Horace, Elien, Athénée, les trouveroient aussi bons aujourd'hui que de leur tems. Aristote à l'agonie, prononça en faveur du vin de Lesbos : il s'agissoit de laisser un successeur du Lycée, qui soutînt la gloire de l'école péripatéticienne. Ménédeme de Rhodes, & Théophraste de Lesbos, étoient les concurrens. Aristote, selon le récit d'Aulugelle, liv. XIII. cap. v. se fit apporter du vin de ces deux îles, & après en avoir goûté avec attention, il s'écria devant ses disciples : " je trouve ces deux vins excellens, mais celui de Lesbos est bien plus agréable " ; voulant donner à connoître par cette tournure, que Théophraste l'emportoit autant sur son compétiteur, que le vin de Lesbos sur celui de Rhodes.
Tristan donne le type d'une médaille de Géta, qui suivant Spartien, aimoit beaucoup le bon vin ; le revers représente une Fortune, tenant de la main droite le gouvernail d'un vaisseau, & de l'autre une corne d'abondance, d'où parmi plusieurs fruits, sort une grappe de raisin. Enfin, Pline releve le vin de cette île par l'autorité d'Erasistrate, l'un des plus grands medecins de l'antiquité. Le même auteur parle du jaspe de Lesbos & de ses hauts pins, qui donnent de la poix noire, & des planches pour la construction des vaisseaux.
Voilà quelques-uns des beaux endroits par où l'on peut vanter cette île & ses citoyens. D'un autre côté, leurs moeurs étoient si corrompues, que l'on faisoit une grande injure à quelqu'un, de lui reprocher de vivre à la maniere des Lesbiens. Dans Goltzius, il y a une médaille qui ne fait pas beaucoup d'honneur aux dames de cette île. M. Tournefort, dont j'emprunte ces détails, ajoute qu'il devoit rendre la justice aux Lesbiennes de son tems, qu'elles étoient moins coquettes que les femmes de Milo & de l'Argentiere ; que leur habit & leur coëffure étoient plus modestes ; mais que les unes découvroient trop leur gorge, tandis que les autres donnant dans un excès différent, n'en laissoient voir que la rondeur au-travers d'un linge. (D.J.)
LESBOS, MARBRE DE, (Hist. nat.) marbre d'un bleu clair fort estimé des anciens, dont ils ornoient leurs édifices publics & formoient des vases ; il se tiroit de l'île de Lesbos dans l'Archipel.
|
| LESCAR | ou LASCAR, (Géog.) en latin moderne Lascura, ville de France, dans le Béarn, avec un évêché suffragant d'Ausch. M. de Marca croit qu'elle fut bâtie vers l'an 1000, des ruines de Beneharnum, que détruisirent les Normands l'an 845 ; d'autres savans prétendent que Lescar fut fondée par Guillaume Sanche, duc de Gascogne, l'an 980 dans un lieu couvert d'un bois épais, où il n'y avoit nul vestige de bâtiment. On la nomma Lescourre, à cause des tournans de quelques ruisseaux qu'on appelloit dans la langue des Gascons, lescourre, ou escourre ; par la suite des tems, on a corrompu le mot Lescourre en Lescar.
Le même Guillaume Sanche, souverain du pays, établit dans sa nouvelle ville l'évêché de Lescar, qui vaut aujourd'hui 13 à 14 mille livres de rente ; son évêque jouit de beaux priviléges, comme de présider aux états de Béarn, & d'être premier conseiller au parlement de Pau.
Les anciens titres nomment cet évêque Lascurrensis, & la ville de Lescar, Lascurris.
La ville de Lescar est située sur une colline, à une lieue N. O. de Pau. Long. 17. 5. lat. 43. 16.
|
| LESCHÉ | S. m. (Littérat.) le lesché étoit un endroit particulier dans chaque ville de la Grece, où l'on se rendoit pour converser ; mais on donnoit le nom de lesché par excellence, aux salles publiques de Lacédémone, dans lesquelles on s'assembloit pour les affaires de l'état. C'étoit ici où le pere portoit lui-même son enfant nouveau né, & où les plus anciens de chaque tribu qui y étoient assemblés, le visitoient ; s'ils le trouvoient bien formé, fort, & vigoureux, ils ordonnoient qu'il fût nourri, & lui assignoient une des neuf mille portions pour son héritage ; si au contraire ils le trouvoient mal-fait, délicat, & foible, ils l'envoyoient aux apothêtes, c'est-à-dire, dans le lieu où l'on exposoit les enfans ; Lycurgue l'avoit ainsi prescrit, & Aristote lui-même approuve cette loi de Lycurgue. (D.J.)
|
| LESCHE LA | (Géog.) M. Delisle écrit la Lesse, riviere des Pays-bas, qui a sa source au duché de Luxembourg, & se jette dans la Meuse, un peu audessous de Dinant. (D.J.)
|
| LESCHÉNORE | (Littérature) c'est un des surnoms que les Grecs donnerent à Apollon, comme au dieu protecteur des sciences & des lieux où on s'assembloit pour en discourir. On voit par-là, que l'épithete de Leschénore tiroit son origine de lesché, qui étoit en Grece une promenade, un portique, une salle, où l'on se rendoit pour converser sur différens sujets. Voyez LESCHE.
|
| LESCHERNUVIS | S. m. (terme de relation) c'est, selon nos voyageurs, le nom qu'on donne en Perse au tribunal où l'on reçoit & où l'on examine les placets & requêtes de ceux qui demandent quelque chose au sophi, soit payement de dette ou d'appointement, soit récompense, ou quelque nouveau bienfait.
|
| LESCHEZ LE | (Géog.) petite riviere de France en Gascogne, qui a sa source en Bigorre, & se jette dans l'Adour, à l'entrée de l'Armagnac.
|
| LESÉ | (Jurisprud.) c'est celui qui souffre quelque lésion. Voyez ci-après LESION. (A)
|
| LESE-MAJESTÉ | CRIME DE, (Droit politique) c'est selon Ulpien, un attentat formel contre l'empire, ou contre la vie de l'empereur. Puis donc que cet attentat tend directement à dissoudre l'empire ou le gouvernement, & à détruire toute obligation des lois civiles, il est de la derniere importance d'en fixer la nature, comme a fait l'auteur de l'esprit des lois dans plusieurs chapitres de son douzieme livre. Plus le crime est horrible, plus il est essentiel de n'en point donner le nom à une action qui ne l'est pas. Ainsi déclarer les faux-monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté, c'est confondre les idées des choses. Etendre ce crime au duel, à des conspirations contre un ministre d'état, un général d'armée, un gouverneur de province, ou bien à des rébellions de communautés, à des réceptions de lettres d'un prince avec lequel on est en guerre, faute d'avoir déclaré ses lettres, c'est encore abuser des termes. Enfin, c'est diminuer l'horreur du crime de lese-majesté, que de porter ce nom sur d'autres crimes. Voilà pourquoi je pense que les distinctions de crimes de lese-majesté au premier, au second, au troisieme chef, ne forment qu'un langage barbare que nous avons emprunté des Romains. Quand la loi Julie eut établi bien des crimes de lese-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes ; mais nous ne devons pas être dans ce cas-là.
Qu'on examine le caractere des législateurs qui ont étendu le crime de lese-majesté à tant de choses différentes, & l'on verra que c'étoient des usurpateurs ou des tyrans, comme Auguste & Tibere, ou comme Gratian, Valentinien, Arcadius, Honorius, des princes chancelans sur le trône, esclaves dans leurs palais, enfans dans le conseil, étrangers aux armées, & qui ne garderent l'empire, que parce qu'ils le donnerent tous les jours. L'un fit la loi de poursuivre comme sacrilége, quiconque douteroit du mérite de celui qu'il avoit choisi pour quelque emploi. Un autre déclara que ceux qui attentent contre les ministres & les officiers du prince, sont criminels de lese majesté ; & ce qui est encore plus honteux, c'est sur cette loi que s'appuyoit le rapporteur de M. de Cinq-Mars, pour satisfaire la vengeance du cardinal de Richelieu.
La loi Julie déclaroit coupable de lese-majesté, celui qui fondroit des statues de l'empereur qui avoient été reprouvées ; celui qui vendroit des statues de l'empereur qui n'avoient pas été consacrées ; & celui qui commettroit quelque action semblable ; ce qui rendoit ce crime aussi arbitraire, que si on l'établissoit par des allégories, des métaphores, ou des conséquences.
Il y avoit dans la république de Rome une loi de majestate, contre ceux qui commettroient quelque attentat contre le peuple romain. Tibere se saisit de cette loi, & l'appliqua non pas au cas pour lequel elle avoit été faite, mais à tout ce qui put servir sa haine ou ses défiances. Ce n'étoient pas seulement les actions qui tomboient dans le cas de cette loi, mais des paroles indiscrettes, des signes, des songes, le silence même. Il n'y eut plus de liberté dans les festins, de confiance dans les parentés, de fidélité dans les esclaves. La dissimulation & la tristesse sombre de Tibere se communiquant par-tout, l'amitié fut regardée comme un écueil, l'ingénuité comme une imprudence, & la vertu comme une affectation qui pouvoit rappeller dans l'esprit des peuples, le bonheur des tems précédens.
Les songes mis au rang des crimes de lese-majesté, est une idée qui fait frémir. Un certain Marsyas, dit Plutarque, raconte avoir songé qu'il coupoit la gorge à Denys ; le tyran le sut, & le fit mourir, prétendant qu'il n'y auroit pas songé la nuit, s'il n'y avoit pas pensé le jour ; mais quand il y auroit pensé, il faut pour établir un crime, que la pensée soit jointe à quelque action.
Les paroles indiscrettes, peu respectueuses, devinrent la matiere de ce crime ; mais il y a tant de différence entre l'indiscrétion, les termes peu mesurés, & la malice ; & il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guere commettre les paroles à une peine capitale, à-moins qu'elle ne déclare expressément celles qu'elle y soumet. La plûpart du tems les paroles ne signifient quelque chose, que par le ton dont on les dit ; souvent en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens, parce que ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses. Comment donc peut-on sans tyrannie, en faire un crime de lese-majesté ?
Dans le manifeste de la feue czarine, donné en 1740, contre la famille d'Olgourouki, un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient du rapport à la personne de l'impératrice. Un autre pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l'empire, & offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses. S'il est encore des pays où cette loi regne, la liberté, je dirai mieux, son ombre même, ne s'y trouve pas plus qu'en Russie. Des paroles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles accompagnent une action criminelle, qu'elles y sont jointes, ou qu'elles la suivent. On renverse tour, si l'on fait des paroles un crime capital.
Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles ; mais lorsqu'ils ne préparent pas au crime de lese-majesté, on en fait plutôt dans la monarchie un sujet de police, que de crime. Ils peuvent ces écrits, dit M. de Montesquieu, amuser la malignité générale, consoler les mécontens, diminuer l'envie contre les places, donner au peuple la patience de souffrir, & le faire rire de ses souffrances. Si quelque trait va contre le monarque, ce qui est rare, il est si haut que le trait n'arrive point jusques à lui : quelque décemvir en peut être effleuré, mais ce n'est pas un grand malheur pour l'état.
Je ne prétends point diminuer par ces réflexions, l'indignation que méritent ceux qui par des paroles ou des écrits, chercheroient à flétrir la gloire de leur prince ; mais une punition correctionnelle est sans doute plus convenable que toute autre. César se montra fort sage, en dédaignant de se vanger de ceux qui avoient publié des libelles diffamatoires très-violens contre sa personne ; c'est Suétone qui porte ce jugement : si quae dicerentur adversùs se, inhibere maluit quàm vindicare, Aulique Cecinnae criminosissimo libro, &. Pitholaï carminibus, laceratam existimationem suam, civili animo tulit. Trajan ne voulut jamais permettre que l'on fît la moindre recherche contre ceux qui avoient malicieusement inventé des impostures contre son honneur & sa conduite : quasi contentus esset magnitudine suâ, quâ nulli magis caruerunt, quàm qui sibi majestatem vindicarent, dit si bien Pline le jeune. Voyez le mot LIBELLE.
Rien ne fut plus fatal à la liberté romaine, que la loi d'Auguste, qui fit regarder certains écrits comme objets du crime de lese-majesté. Cremutius Cordus en fut accusé, parce que dans ses annales, il avoit appellé Cassius le dernier des Romains. Mais ce seroit être vraiment criminel, j'ai pensé dire vraiment coupable du crime de lese-majesté, que de corrompre le pouvoir du prince, jusqu'à lui faire changer de nature, parce que ce seroit lui ôter tout ensemble son bonheur, sa tranquillité, sa sûreté, l'affection, & l'obéissance de ses sujets.
Je finis par un trait bien singulier de notre histoire ; Montgomeri pris les armes à la main dans Domfront, fut condamné à la mort en 1574, comme criminel de lese-majesté. On sait que quinze ans auparavant il avoit eu le malheur de tuer Henri II. dans un tournois, & cet ancien accident le conduisit sur l'échafaud ; car pour le crime de lese majesté dont on l'accusoit par sa prise d'armes, il ne pouvoit en être recherché, en vertu de plusieurs édits, & sur-tout depuis la derniere amnistie ; mais la régente vouloit sa mort à quelque prix que ce fût, & l'on lui accorda cette satisfaction. Exemple mémorable, dit de Thou, pour nous apprendre que dans les coups qui attaquent les têtes couronnées, le hasard seul est criminel, lors même que la volonté est la plus innocente. (D.J.)
LESE-MAJESTE, (Jurisprud.) Il y a crime de lese-majesté divine & lese-majesté humaine.
Le crime de lese-majesté divine est une offense commise directement contre Dieu, telles que l'apostasie, l'hérésie, sortilege, simonie, sacrilege & blasphème.
Ce crime est certainement des plus détestables, aussi est-il puni griévement, & même quelquefois de mort, ce qui dépend des circonstances. Quelques-uns ont pensé que ce n'étoit pas un crime public, & conséquemment que les juges de seigneurs en pouvoient connoître ; mais le bien de l'état demandant que le culte divin ne soit point troublé, on doit regarder ce crime de lese-majesté divine comme un cas royal.
Le crime de lese-majesté humaine est une offense commise contre un roi ou autre souverain : ce crime est aussi très-grave, attendu que les souverains sont les images de Dieu sur terre, & que toute puissance vient de Dieu.
En Angleterre on appelle crime de haute trahison ce que nous appellons crime de lese-majesté humaine.
On distingue, par rapport au crime de lese-majesté humaine, plusieurs chefs ou degrés différens qui rendent le crime plus ou moins grave.
Le premier chef, qui est le plus grave, est la conspiration ou conjuration formée contre l'état ou contre la personne du souverain pour le faire mourir, soit par le fer ou par le feu, par le poison ou autrement.
Le deuxieme chef est lorsque quelqu'un a composé & semé des libelles & placards diffamatoires contre l'honneur du roi, ou pour exciter le peuple à sédition ou rebellion.
La fabrication de fausse monnoie, le duel, l'infraction des saufs-conduits donnés par le prince à l'ennemi, à ses ambassadeurs ou otages, sont aussi considérés des crimes de lese-majesté.
Quelques auteurs distinguent trois ou quatre chefs du crime de lese majesté, d'autres jusqu'à huit chefs, qui sont autant de cas différens où la majesté du prince est offensée ; mais en fait de crime de lese-majesté proprement dit, on ne distingue que deux chefs, ainsi qu'on vient de l'expliquer.
Toutes sortes de personnes sont reçues pour accusateurs en fait de ce crime, & il peut être dénoncé & poursuivi par toutes sortes de personnes, quand même elles seroient notées d'infamie : le fils même peut accuser son pere & le pere accuser son fils.
On admet aussi pour la preuve de ce crime le témoignage de toutes sortes de personnes, même ceux qui seroient ennemis déclarés de l'accusé ; mais dans ce cas on n'a égard à leurs dépositions qu'autant que la raison & la justice le permettent : la confession ou déclaration d'un accusé est suffisante dans cette matiere pour emporter condamnation.
Tous ceux qui ont trempé dans le crime de lese-majesté sont punis ; & même ceux qui en ayant connoissance ne l'ont pas revélé, sont également coupables du crime de lese-majesté.
Celui qui ose attenter sur la personne du roi est traité de parricide, parce que les rois sont considérés comme les peres communs de leurs peuples.
Le seul dessein d'attenter quelque chose contre l'état ou contre le prince, est puni de mort lorsqu'il y en a preuve.
On tient communément que la connoissance du crime de lese-majesté au premier chef appartient au parlement, les autres chefs sont seulement réputés cas royaux.
Le crime de lese-majesté au premier chef est puni de la mort la plus rigoureuse, qui est d'être tiré & démembré à quatre chevaux.
L'arrêt du 29 Septembre 1595, rendu contre Jean Chastel, qui avoit blessé Henri IV. d'un coup de couteau au visage, le déclara atteint & convaincu du crime de lese-majesté divine & humaine au premier chef, pour le très-méchant & très-cruel parricide attenté sur la personne du roi. Il fut condamné à faire amende honorable & de dire à genoux que malheureusement & proditoirement il avoit attenté cet inhumain & très-abominable parricide, & blessé le roi d'un couteau en la face, & par de fausses & damnables instructions, il avoit dit être permis de tuer les rois ; & que le roi Henri IV. lors regnant, n'étoit point en l'église jusqu'à ce qu'il eût l'approbation du pape. De là on le conduisit en un tombereau en la place de Greve, où il fut tenaillé aux bras & aux cuisses, & sa main droite tenant le couteau dont il s'étoit efforcé de commettre ce parricide, coupée, & après son corps tiré & démembré avec quatre chevaux & ses membres & corps jettés au feu & consommés en cendres, & les cendres jettées au vent ; ses biens acquis & confisqués au roi. Avant l'exécution il fut appliqué à la question ordinaire & extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices. La cour fit aussi défenses à toutes personnes de proférer en aucun lieu de semblables propos, lesquels elle déclara scandaleux, séditieux, contraires à la parole de Dieu, & condamnés comme hérétiques par les saints decrets.
La maison de Jean Chastel, qui étoit devant la porte des Barnabites, fut rasée ; & dans la place où elle étoit on éleva une pyramide avec des inscriptions : elle fut abattue en 1606.
L'arrêt rendu le 27 Mars 1610 contre Ravaillac, pour le parricide par lui commis en la personne du roi Henri IV. fut donné les grand'chambre, tournelle & chambre de l'édit assemblées. La peine à laquelle Jean Chastel avoit été condamné fut encore aggravée contre Ravaillac, parce que celui-ci avoit fait mourir le roi. Il fut ordonné que sa main droite seroit brûlée de feu de soufre, & que sur les endroits où il seroit tenaillé il seroit jetté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix-resine bouillante, de la cire & soufre fondus ensemble ; il fut aussi ordonné que la maison où il étoit né seroit démolie, le propriétaire préalablement indemnisé, sans que sur le fonds il pût être à l'avenir construit aucun autre bâtiment ; & que dans quinzaine après la publication de l'arrêt à son de trompe & cri public en la ville d'Angoulême (lieu de sa naissance), son pere & sa mere vuideroient le royaume, avec défenses d'y jamais revenir, à peine d'être pendus & étranglés sans autre forme ni figure de procès. Enfin il fut défendu à ses freres & soeurs, oncles & autres de porter ci-après le nom de Ravaillac, & il leur fut enjoint de le changer sous les mêmes peines ; & au substitut du procureur général du roi de faire publier & exécuter ledit arrêt, à peine de s'en prendre à lui.
La confiscation pour crime de lese-majesté au premier chef appartient au roi seul privativement à tous seigneurs hauts-justiciers ; le roi prend ces biens comme premier créancier privilégié à l'exclusion de tous autres créanciers ; il les prend même sans être tenu d'aucunes charges ou hypotheques, ni même des substitutions.
Touchant le crime de lese-majesté, voyez Julius Clarus, lib. V. sententiar. §. laesae majestatis crimen. Chopin, traité du domaine, liv. I. ch. vij. & sur Paris, liv. III. n. 25. Lebret, traité de la souver. liv. IV. ch. v. Papon, liv. XXII. tit. 1. Dupuy, traité des droits du roi, p. 141.
Voyez aussi la déclaration de François I. du mois d'Août 1539 ; l'édit de Charles IX. du mois de Décembre 1563, art. 13 ; celui d'Henri III. du mois de Janvier 1560, art. 6 ; l'ordonnance criminelle de 1670, tit. j. art. 11. (A)
|
| LÉSER | LE, (Géog.) en latin Lesura exilis, Ausone dit Lescura ; petite riviere d'Allemagne dans l'électorat de Trèves : elle a sa source aux confins de l'Eisfel, & se rend dans la Moselle à deux petites lieues au-dessus de Traerbach. (D.J.)
|
| LÉSION | S. f. (Jurisprud.) est le préjudice ou la perte que l'on souffre par le fait d'autrui, ou par quelqu'acte que l'on a passé inconsidérément, ou par force ou dol.
Un mineur lésé par trop de facilité ou par le dol de celui avec lequel il a contracté, peut être restitué à cause de la lésion, si légere qu'elle soit. La lésion d'affection suffit même seule lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble appartenant à un mineur, c'est-à-dire qu'il suffit que cet immeuble ait été vendu sans formalités & sans nécessité pour que le mineur puisse demander la nullité de la vente, quand même elle n'auroit pas été faite à vil prix.
Il n'en est pas de même à l'égard des majeurs, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à revenir contre toutes sortes d'engagemens ; ainsi elle ne fait pas un moyen suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme au-dessous de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d'offices & de droits successifs, les échanges d'héritage contre un héritage, contre les transactions ; ce qui a lieu quand même la lésion seroit d'outre moitié du juste prix, ce que l'on appelle une lésion enorme.
Cependant lorsque la lésion est très-énorme, & ce que l'on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois dans ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.
On appelle lésion du tout au tout celle par laquelle une des parties contractantes perd tout ce qu'elle devoit retirer de son bien ou de ses droits.
La lésion d'outre moitié du juste prix est un moyen de restitution contre la vente d'un immeuble entre majeurs, liv. II. cod. de rescind. vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen : l'acheteur n'est jamais écouté à se plaindre de la lésion, à moins que l'on n'ait usé de dol pour le surprendre.
Dans les partages entre co-héritiers majeurs, la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la restitution : on entend par lésion du tiers au quart, qu'il faut que celui qui se prétend lésé soit en perte d'une portion qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir, il n'est pas nécessaire qu'il s'en faille d'un tiers entier, mais il faut que la lésion soit de plus d'un quart : par exemple, s'il devoit revenir à l'héritier 12000 livres pour sa part, & qu'il n'ait eu que 8500 livres, la lésion n'est pas d'un tiers, lequel feroit 4000 livres, mais elle est de plus d'un quart, puisque le quart ne seroit que 3000 liv. & qu'elle se trouve de 3500 livres ; ainsi, dans ce cas, elle est du tiers au quart.
Voyez au digeste le titre de minoribus, & au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les mots CRAINTE, DOL, FORCE, MINEUR, OBLIGATION, RESCISION, RESTITUTION EN ENTIER. (A)
|
| LESNOW | Lesnovia, (Géog.) petite place de Pologne dans la Volhinie, à 15 milles de Lucko ; elle est remarquable par la victoire que Jean Casimir, roi de Pologne, y remporta en 1651 sur l'armée réunie des Cosaques & des Tartares ; elle fut incendiée & saccagée en 1656 par Charles Gustave, roi de Suede. Long. 43. 55. lat. 50. 45. (D.J.)
|
| LESQUEMIN | (Géog.) île & port de l'Amérique en Canada sur le fleuve S. Laurent, près de Tadousac : l'île est peu de chose, & le port mal sûr n'est fréquenté que par quelques Basques qui y viennent à la pêche de la baleine. Long. 309. lat. 48. 25.
|
| LESQUI | ou LESGI, (Géog.) peuple tartare du Daghestan. Voyez LAZE. (D.J.)
|
| LESSE | voyez LAISSE.
|
| LESSINA | (Géog.) ou, comme écrit M. Spon, LEPSINA, nom moderne de l'ancienne Eleusis, à 12 milles d'Athènes. Cette ville, autrefois si célebre par sa fête à l'honneur de Cérès, n'offre à-présent que des décombres. Les corsaires chrétiens, beaucoup plus inhumains que les Turcs, l'ont si maltraitée, que les habitans ont généralement déserté, & qu'on n'y voit plus que des ruines. Le temple de Cérès & de Proserpine se réduisent à un amas informe de colonnes, de frises & de corniches de marbre toutes brisées ; l'enceinte du lieu peut avoir deux milles de tour ; une partie étoit proche de la mer, & une partie sur la colline, au pié de laquelle étoit le temple. La rade peut servir de port, étant à couvert par l'île de Coulomis, qui est l'ancienne Salamine : la plaine voisine a sept ou huit milles d'étendue, quatre de large, & est labourée. Le Waivode du pays dit en 1729 à M. l'abbé Fourmont, qu'il étoit bien fâché que ses esclaves eussent détruit tout récemment à Lessina plus de 350 marbres inscrits, mais qu'il y feroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont indiqueroit. Notre voyageur ayant profité de cette honnêteté, il rassembla quelques nouveaux marbres précieux, entr'autres de ces inscriptions écrites de la droite à la gauche, que l'on connoît sous le nom de boustrophédon. Cette maniere d'écrire étoit en usage chez les Grecs long-tems avant la guerre de Troie, & elle a duré plusieurs siecles après Homere.
|
| LESSINES | (Géog.) petite ville des Pays-Bas dans le Hainault, sur la Deure, à 2 lieues N. d'Ath, 6 N. O. de Mons, 5 S. O. de Bruxelles. Long. 21. 28. lat. 51. 41. (D.J.)
|
| LESSIVE | S. f. (Chimie) C'est ainsi qu'on appelle une dissolution saline qui a été préparée par le moyen de la lixiviation. Voyez LIXIVIATION.
On a coutume de spécifier les différentes lessives par les noms des matieres qui ont été lessivées : c'est ainsi qu'on dit lessive de soude, lessive de potasse, pour désigner une eau qui a été appliquée à la soude ou à la potasse pour en retirer le sel. (b)
* LESSIVE du linge, (Art méchan.) c'est la maniere de le décrasser quand il est sale. Pour cet effet on a un grand cuvier percé au bas latéralement d'un trou qu'on bouche d'un bouchon de paille. On met le linge sale dans ce cuvier ; on le couvre d'un gros drap qui déborde par-dessus le cuvier. On charge ce linge ou drap d'une grande quantité de cendres de bois neuf & non flotté. Cependant on a fait chauffer de l'eau dont on arrose les cendres, sur lesquelles on rejette les bords du drap, & l'on couvre le cuvier d'un couvercle de natte ; cette eau chaude met en dissolution le sel du bois contenu dans les cendres : ce sel dissout, se sépare des cendres, passe à-travers le drap avec l'eau, va impregner le linge sale qui est dessous : la dissolution ou l'eau de lessive tombe au fond du cuvier, & sort par le bouchon de paille qu'on a mis au trou latéral du cuvier, d'où elle est reçue dans un autre cuvier plus petit placé au-dessous du premier. On reverse cette dissolution sur les cendres, on les arrose de nouvelle eau chaude, & l'on fait ensorte que tout le sel contenu dans les cendres soit dissous & déposé sur le linge. Quand on a épuisé les cendres de sel par l'eau chaude, quand on a fait repasser la lessive ou sa dissolution sur le linge sale, on enleve le drap avec les cendres, on tire le linge du cuvier, on le lave & on le bat dans l'eau claire, en le frottant de savon. Quand il est blanc & bien décrassé, on le lave & relave dans de l'eau claire seulement, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucun vestige ni d'eau de lessive, ni d'eau de savon, ni de crasse. On l'étend sur des cordes pour le faire sécher : sec, on le détire & on le plie, puis on le serre dans des armoires à linge. La raison de cette opération est assez simple ; la saleté du linge est une graisse ; le sel des cendres s'y unit un peu, & forme avec elle une espece de savon. Ce premier savon, formé dans le cuvier, s'unit facilement avec celui dont on frotte le linge au sortir du cuvier : ils se dissolvent ensemble ; en se dissolvant l'eau les emporte avec la crasse. D'ailleurs toute cendre n'est pas bonne pour la lessive : celles du bois flotté ne contiennent presque point de sel ; il a été dissous dans le flottage, & toute eau n'est pas également bonne pour la lessive ; les eaux séléniteuses, par exemple, sont mauvaises ; la sélénite venant à se dissoudre, son acide s'unit au sel du savon, & l'huile du savon reste seule & surnage à l'eau en petits flocons.
LESSIVE des aiguilles, terme d'Aiguillier, qui signifie laver les aiguilles dans de l'eau de savon après qu'elles sont polies, afin d'en enlever la crasse ou cambouis qui s'y étoit attaché pendant le poliment. Voyez AIGUILLE.
LESSIVE, (Jardinage) on appelle de ce nom l'eau qui sort de la lessive du linge ; cette eau est pleine de sels, dont elle s'est chargée en passant sur les cendres de la lessive, & elle dépose ses sels dans les terres où elle se mêle. On peut s'en servir pour arroser celles qu'on prépare pour les orangers, citronniers, ou pour mouiller une planche où l'on a semé des plantes qui demandent une terre substantielle.
LESSIVE d'Imprimerie, est la même que celle dont on s'est servi pour lessiver le linge ; mais pour la rendre plus douce & plus onctueuse, on y fait fondre une suffisante quantité de drogue, que l'on nomme aussi potasse. C'est dans cette lessive, qui dans le bon usage doit être chaude, pour ménager l'oeil de la lettre, qu'on lave les formes avec la brosse, de façon qu'il ne doit rester aucun vestige d'encre sur la lettre, sur les garnitures ni sur le chassis. Voyez nos Planches d'Imprimerie.
|
| LEST | S. m. (Marine) on donne ce nom à des choses pesantes, telles que des pierres, des cailloux, du sable, &c. qu'on met au fond de cale du vaisseau pour le faire enfoncer dans l'eau & lui procurer une assiette solide. Le lest sert principalement de contrepoids aux vergues & aux mâts, qui étant élevés hors du vaisseau, lui feroient faire capot au moindre roulis, & même à la moindre impression du vent.
La quantité de lest qu'il convient de mettre dans un vaisseau ne dépend pas seulement de la grandeur du vaisseau, mais encore de la forme de sa carene ; car plus cette carene est aiguë, moins elle exige de lest, parce qu'elle enfonce d'autant plus aisément dans l'eau : cela fait voir qu'on ne peut pas déterminer avec exactitude la quantité de lest qu'il faut à un vaisseau : la chose devient encore plus difficile quand on y fait entrer toute la mâture. L'expérience fait connoître, en lestant un vaisseau, de la façon qu'il se comporte le mieux à la mer, & s'il faut augmenter ou diminuer son lest. Il y a des bâtimens auxquels il faut pour le lest environ la moitié de leur charge, d'autres le tiers, & quelques-uns le quart : cela dépend de leur construction. On peut voir les reglemens qu'il faut observer pour le lest dans l'ordonnance de 1681, liv. IV. tit. IV. Voyez DELESTAGE.
Bon lest, c'est le lest de petits cailloux, qu'on arrange aisément : c'est ordinairement celui des vaisseaux de guerre ; le fond de cale en est plus propre, & il n'embarrasse pas les pompes, comme fait quelquefois le lest de terre ou de sable.
Gros lest, composé de très-grosses pierres, ou de quartiers de canons brisés. Ce lest n'est pas avantageux pour l'arrimage, & est difficile à remuer dans le besoin.
Vieux lest, c'est celui qui a déja fait un voyage ou une campagne. Il est fait défenses à tous capitaines & maîtres de navires de jetter leur vieux lest dans les ports, canaux, bassins & rades, à peine de 500 liv. d'amende, &c. Voyez DELESTAGE.
Lest lavé, c'est le lest qu'on lave après qu'il a déja servi pour s'en servir de nouveau : ordinairement on met du lest neuf une fois en deux années. (Z)
|
| LESTAGE | S. m. (Marine) c'est l'embarquement du lest dans le navire. Il y a des bateaux & des gabares qui servent pour le lestage. Il est défendu aux maîtres & patrons de ces gabares ou bateaux lesteurs de travailler au lestage ou délestage pendant la nuit.
|
| LESTE | adj. (Gramm.) il se dit d'un vêtement qui charge peu le corps, & qui donne à l'homme un air de légereté ; d'une troupe qui n'est point embarrassée dans sa marche par des bagages qui la rallentiroient ; quelquefois des personnes en qui l'on remarque la souplesse des membres, & l'activité des mouvemens que demandent les exercices du corps. Il a aujourd'hui une autre acception dans cette langue honnête que les gens du monde se sont faite pour désigner sans rougir, & par conséquent s'encourager à commettre sans remords des actions malhonnêtes. Un homme leste dans ce dernier sens, c'est un homme qui a acquis le droit de commettre une bassesse par le malheureux talent qu'il a d'en plaisanter : il nous fait rire d'un forfait qui devroit nous indigner. Un homme leste est encore celui qui sait saisir l'occasion, ou de faire sa cour, ou d'augmenter sa considération, ou d'ajouter à sa fortune. L'homme leste n'est pas moins adroit à esquiver à une chose dangereuse qu'à ses suites. On a le ton leste quand on possede sa langue au point qu'on fait entendre aux autres tout ce qu'on veut sans les offenser ou les faire rougir.
|
| LESTER | v. act. (Marine) c'est mettre des cailloux, du sable ou autres choses pesantes au fond d'un vaisseau, pour le faire enfoncer dans l'eau & se tenir droit de façon qu'il porte bien ses voiles. On dit embarquer & décharger du lest, aussi-bien que lester & délester. (Z)
|
| LESTRIGONS | S. m. (Géog. anc.) en latin Laestrigones, en grec ; peuple que les anciens ont placé diversement. Homere les met en Italie, aux environs de la ville de Lamus, ainsi nommée parce que Lamus, roi des Lestrigons & fils de Neptune, l'avoit bâtie : ses états étoient assez étendus. Antiphatés, qui y regnoit lorsqu' Ulysse eut le malheur d'y aborder, étoit un homme cruel, qui auroit mangé, dit Ovide, tous les députés de ce héros s'ils ne se fussent sauvés après avoir vu le triste sort de l'un d'eux. De-là vint que ce monstre a servi d'exemple pour désigner la barbarie & l'inhospitalité : Quis non Antiphatem Laestrigona devovet ? Delà vint encore que tous les Lestrigons passerent pour autant de mangeurs d'hommes. Il semble que Pline ajoutoit foi à cette tradition populaire, quand il dit, lib. VII. cap. ij. Esse Scytharum genera quae corporibus humanis vescerentur indicavimus ; id ipsum incredibile fortasse, ni cogitemus in medio orbe terrarum, Siciliâ & Italiâ, fuisse gentes hujus monstri, Cyclopes & Laestrigonas.
Ce dont nous ne pouvons pas douter, c'est que la ville de Lamus n'ait pris dans la suite le nom de Formies : Cicéron, Horace & Pline le disent tous trois positivement. Ajoutez à leurs témoignages celui de Silius Italicus, qui en deux endroits du l. VII. appelle la ville de Formies en Campanie, Lestrygoniae rupes.
D'autres auteurs placent les Lestrigons avec les Cyclopes, dans le territoire de Leontium en Sicile, & aux environs du mont Ethna. Lycophron nous assure que les Lestrigons sont les mêmes que le peuple de Sicile, nommé Léontins.
Cependant remarquons ici que les Historiens n'ont adopté qu'avec défiance la tradition des Poëtes. Les noms de Lestrigons & de Léontins ne sont peut-être qu'un même nom ; du moins Bochart prouve que lestrigon est un mot phénicien, lequel signifie un lion qui dévore. Ce nom a vraisemblablement été rendu par celui de léontin, qui désigne la même chose, & marque les moeurs féroces & léonines de ces peuples barbares : apparemment qu'une partie des Lestrigons quitta la Sicile pour s'établir sur les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que Lamus, qui bâtit Formies, ne fût un lestrigon ; son nom seul le témoigne ; car Lamus, laham en phénicien, signifie dévorer : de-là même a été tiré le nom des Lamies, ces spectres imaginaires de la fable ; sur lesquels voyez LAMIES.
|
| LESTWITHIEL | (Géog.) ville à marché d'Angleterre, dans la province de Cornouaille, sur le Fowey, à 188 milles O. de Londres. Elle députe au parlement. Speed écrit Lesttethiel, Cambden Lishtyel dans sa carte, & Lost-Uthiel dans sa table. Ce nom, selon lui, signifie une colline élevée, parce que ce bourg à marché, situé maintenant dans la plaine, étoit autrefois sur la colline où est aujourd'hui Lestormiu. Il étoit alors habité par les Dammoniens. Long. 12. 58. lat. 50. 24. (D.J.)
|
| LETECH | S. m. (Hist. anc.) mesure hébraïque, qui étoit la moitié du chomer, & par consequent de 149 pintes, demi-septier, un poisson & un peu plus. On ne trouve cette mesure que dans Osée, ch. iij. . 2. letech hordeorum, que les Septante traduisent par Nebel, & la vulgate par dimidium cori. Voyez NEBEL & CORE, dictionn. de la Bible.
|
| LETH | LETHE ou LATH, s. m. (Antiq. Anglo-Saxon.) nom d'une mesure ou portion de terre dans les anciennes divisions de l'Angleterre. Le roi Alfred, selon l'opinion de quelques auteurs, partagea le royaume en comtés, comme il l'est encore. Il divisa les comtés en hundreds ou tilhings. L'hundred étoit une portion de pays où il y avoit cent officiers (nous dirions des centeniers) pour maintenir le bon ordre. Ils étoient appellés fidejussores pacis, répondans de la paix ; & le leth contenoit trois ou quatre hundreds.
Le leth étoit aussi la jurisdiction d'un vicomte, où le seigneur tenoit des especes d'assises, tous les ans une fois dans chaque village, aux environs de la saint Michel. (D.J.)
LETH, (Commerce) qu'on écrit & qu'on prononce aussi lecht, lest ou last, suivant les différens idiomes des peuples qui se servent de ce terme. En France on dit leth.
Le leth signifie differentes choses ; tantôt il exprime la charge entiere d'un navire, c'est-à-dire la quantité de tonneaux de mer qu'il peut porter ; quelquefois il signifie une certaine pesanteur de telle ou telle espece de marchandise ; & d'autrefois il se prend pour une certaine sorte de mesure de grains plus ou moins forte, suivant les divers lieux où elle est en usage.
En Hollande, Angleterre, Flandres, Allemagne, Danemarck, Suede, Pologne, & dans tout le nord, les navires s'estiment ou mesurent par leur port ou charge sur le pié de tant de leths, le leth pesant quatre mille livres, ou deux tonneaux de France de deux mille livres chacun ; ainsi lorsqu'on dit qu'un vaisseau est de trois cent leths, cela doit s'entendre qu'il peut porter six cent tonneaux ou douze cent mille livres pesant.
Lorsqu'il s'agit du fret d'un vaisseau, voici par estimation ce qui passe ordinairement pour un leth, soit par rapport au poids, soit par rapport au volume de la marchandise : savoir, cinq pieces d'eau-de-vie, deux tonneaux de vin, cinq pieces de prunes, douze barrils de pois, treize barrils de goudron, quatre mille livres de ris, de fer ou de cuivre, trois mille six cent livres d'amandes, sept quartaux ou barriques d'huile de poisson, quatre pieces ou bottes d'huile d'olive, deux mille livres de laine.
En Hollande, le leth, qui est une certaine mesure ou quantité de grains, est semblable à 38 boisseaux mesure de Bordeaux, qui reviennent à 19 septiers de Paris, chaque boisseau de Bordeaux pesant environ 120 livres poids de marc ; ainsi le leth de grains en Hollande doit approcher du poids de 4560 liv.
Le leth ou last d'Amsterdam est de 27 muddes, le mudde de 4 scheppels, le scheppel de 4 vierdevats, & le vierdevat de 4 kops. Voyez les noms & la quantité de toutes ces mesures sous leur titre particulier.
Le last de froment pese ordinairement 4600 à 4800 livres, celui de seigle 4000 à 4200, & le last d'orge 3200 à 3400 livres.
Le last est aussi la mesure des grains dans presque toutes les autres villes & principaux lieux de commerce des Provinces-unies, mais avec quelque diversité, soit de continence, soit de diminution : on peut voir ces différences exprimées fort au long & avec la derniere précision dans le dictionnaire de commerce.
En Pologne, le leth fait 40 boisseaux de Bordeaux, ou 20 septiers de Paris ; ensorte que sur ce pié, le leth de Pologne peut peser 4800 livres.
En Suede & en Moscovie on parle par grand & petit leth ; le grand leth est de 12 barrils ou petits tonneaux, & le petit leth est de 6 de ces barrils.
A Dantzik, le leth ou charge de lin est de 2040 l. le leth de houblon de 3830 livres ; le leth de miel ou de farine est de 12 barrils, & celui de sel est de 18.
Le leth de hareng salé blanc ou sor, celui de maquereau, de cabillaud ou morue verte, est de 12 barrils ou caques.
Le last ou leth d'Angleterre ou de Londres est de 10 barriques ou quarteaux 1/4, le quarteau de 8 boisseaux ou gallons, le gallon de 4 picotins ; le gallon pese depuis 56 jusqu'à 60 livres : 10 gallons ou boisseaux de Londres font un last d'Amsterdam.
Le last en Ecosse & en Irlande est de 10 quarteaux 1/4, ou 38 boisseaux, & le boisseau fait 18 gallons.
Le last de Dantzik est égal au last d'Amsterdam : on compte ordinairement qu'il pese 16 schippons, de 340 livres chacun pour le blé ; ce qui fait 5440 pour le last, poids de Dantzik, & seulement 15 schippons pour le seigle, qui ne font que 5100 liv. Voyez SCHIPPON.
Le last de Riga est de 46 loopens, qui font le last d'Amsterdam. Voyez LOOPEN. Celui de Copenhague est de 42 tonnes, ou de 80 scheppels, & même jusqu'à 96, suivant la quantité & la nature des blés. Voyez LOOPEN & SCHEPPEL.
Le last de Suede & de Stockholm est de 23 tonnes ; celui de Hambourg de 90 scheppels, dont les 95 scheppels font le last d'Amsterdam. Le last de Lubeck est de 95 scheppels, dont 96 font le last d'Amsterdam.
Les 50 fanegas de Seville & de Cadix font le last d'Amsterdam. Voyez FANEGAS.
Les 216 alquiers, ou les 4 muids de Lisbonne font le last d'Amsterdam. Voyez ALQUIER.
Vingt-cinq mines de Gènes font un last d'Amsterdam ; 40 sacs de Livourne font aussi le last d'Amsterdam ; les deux sacs font une charge de Marseille, qui pese 296 livres. Voyez MINE & CHARGE.
Quant aux mesures de France, il est aisé de les évaluer avec le last d'Amsterdam, par ce que nous avons dit ci-dessus des boisseaux de Bordeaux & des septiers de Paris comparés avec cette mesure hollandoise. Dictionn. de Commerce & Chambers. (G)
|
| LÉTHARGIE | S. f. (Médec.) tire son nom des mots grecs signifie oubli, & est un composé d', travail, laborieux, & de la particule privative . On appelle de ce nom un homme qui mene une vie tranquille & oisive ; ainsi léthargie suivant l'étymologie, signifieroit un oubli paresseux. Les anciens & les modernes attachent différentes idées à ce nom. Les anciens appelloient léthargiques ceux qui ensevelis dans un profond sommeil, étoient pâles, décolorés, boursoufflés, avoient les parties sous les yeux élevées, les mains tremblantes, le pouls lent, & la respiration difficile. Hippocrate, coac. praenot. n°. 34. cap. iij. Caelius Aurelianus, de morb. acut. lib. II. cap. j. On donne aujourd'hui le nom de léthargie à une espece d'affection soporeuse composée, dans laquelle on observe un délire qu'on nomme oublieux, & une petite fievre assez semblable aux fievres hectiques. Le sommeil dans cette maladie, n'est pas si profond que dans l'apoplexie & le carus. Les malades un peu agités, tiraillés, excités par des cris, s'éveillent, répondent à ce qu'on leur demande, comme on dit, à bâtons rompus ; si quelque besoin naturel leur fait demander les vaisseaux nécessaires, ils les refusent lorsqu'on les leur présente, ou dès qu'ils les ont entre les mains, ils en oublient l'usage & leurs propres nécessités, & s'assoupissent aussi-tôt ; leur pouls est vîte, fréquent, mais inégal, petit, & serré. Cette maladie est assez rare ; c'est dans l'hyver des saisons & de l'âge principalement, suivant Hippocrate, qu'on l'observe ; elle attaque les personnes affoiblies par l'âge, par les maladies, par les remedes, &c. les personnes cacochymes, sur-tout lorsque dans ces sujets quelque cause augmente la force de la circulation, & la détermine à la tête ; elle est quelquefois symptome des fievres putrides, malignes, pestilentielles, de l'hémitritée ; d'autres fois elle est occasionnée par des doses trop fortes d'opium, par des excès de vin ; elle est une suite de l'ivresse, &c. il est constant qu'il y a dans le cerveau quelque vice, quelque dérangement qui détermine les symptomes de cette maladie ; mais quel est-il ? A dire le vrai, on l'ignore ; l'aetiologie des maladies du cerveau est encore ensevelie dans les plus profondes ténebres ; nous n'avons jusqu'ici aucune théorie tant soit peu satisfaisante, de toutes ces affections. Les anciens attribuoient la léthargie à une congestion de lymphes ou de sérosités épaisses & putréfiées dans le cerveau. Les modernes assurent un relâchement joint à une stagnation légerement inflammatoire de sang dans le cerveau. Les observations anatomiques faites sur les cadavres des personnes qui sont mortes victimes de cette maladie, sont contraires à ces opinions, & font voir que ces causes sont particulieres, mais du tout point générales. Forestus a effectivement observé une fois dans un enfant mort de léthargie, les lobes droits du cerveau & du cervelet corrompus & abscédes, lib. X. cap. xj. On a vû aussi des tumeurs skhirrheuses placées dans le crane, produire cette maladie. Etienne Blancard en rapporte une observation : " une léthargie survient à un violent mal de tête ; quelques remedes la dissipent, la douleur de tête reparoît avec plus de violence ; peu de tems après le malade tombe apoplectique, & meurt ; on trouve la dure-mere toute remplie de tumeurs skhirrheuses ". Cette observation fait encore voir que toutes les maladies soporeuses dépendent à-peu-près des mêmes causes.
On lit dans les Observations singulieres de Chifflet, observ. x. p. 8. un cas fort curieux qui prouve évidemment qu'il y a des léthargies sympathiques, qui ne dépendent d'aucune cause agissante immédiatement sur le cerveau : " une jeune fille est attaquée de léthargie ; elle succombe après 48 heures, à la force de la maladie ; le cerveau ouvert ne présente aucune trace d'inflammation, aucune sérosité épanchée ; il est ou paroît être dans l'état le plus naturel ; on ne trouve dans tout le corps aucune altération, excepté une inflammation assez considérable, à une portion d'intestins, dans la cavité duquel il y avoit douze vers assez longs ". Quoiqu'on ignore absolument quel est le dérangement du cerveau qui constitue la léthargie, il y a tout lieu de croire que dans cette maladie, comme dans les autres affections soporeuses, les fibres du cerveau & les nerfs sont relâchés ; le sommeil profond semble indiquer cet état-là ; l'oubli en est aussi un signe & un effet ; il est à présumer que pour la mémoire il faut une tension & une mobilité dans les fibres du cerveau. Voyez DELIRE, APOPLEXIE, AFFECTION SOPOREUSE.
Le délire obscur, oublieux, la petite fievre essentielle à la léthargie, suffisent pour différencier cette maladie d'avec les autres affections soporeuses, & le sommeil profond la distingue des non-soporeuses avec qui elle a quelque rapport, comme frenésie, délire, &c.
La léthargie est une maladie aiguë, très-dangereuse, qui se termine ordinairement en moins de sept jours, par la mort du malade ; les urines pâles, limpides, le tremblement en augmentent le danger. Si le malade est assez heureux pour atteindre le septieme jour, il est hors d'affaire. Lorsqu'elle est la suite & l'effet d'une chûte, d'une blessure, de l'ivresse, des narcotiques, elle est moins dangereuse, & il y a espérance si les remedes employés apportent quelque relâche dans les symptomes : alors, suivant l'observation d'Hippocrate, coac. praenot. n°. 35. cap. iij. les malades se plaignent d'une douleur au col, & d'un bruit dans les oreilles.
Les remedes qui conviennent dans cette maladie, sont les mêmes qui réussissent dans l'apoplexie, les autres maladies soporeuses, savoir les émétiques, sur-tout lorsqu'elle a été occasionnée par un excès de vin, & par les narcotiques, les cathartiques, les lavemens irritans, les potions cordiales, les huiles essentielles éthérées, les élixirs spiritueux, les sels volatils, les vésicatoires, les ventouses, les sternutatoires, les sialagogues ou salivans, les saignées sont rarement indiquées ; la prétendue inflammation du cerveau ne sauroit être une raison suffisante pour les conseiller : tels sont les remedes généraux : chaque auteur en propose ensuite de particuliers spécifiques, mais le remede le plus généralement conseillé, est le castor qu'on regarde comme éminemment anti-narcotique ; on l'ordonne de toutes les façons, mêlé avec les purgatifs, pris en potion, ajouté au vinaigre pour être attiré par le nez. Borellus assure avoir guéri une léthargie avec la scammonée & le castor : on vante après le castor, beaucoup la rhue, le serpolet, le pouliot, & l'origan. Tous les acides appliqués à l'extérieur, ou pris intérieurement, passent assez communément pour très-efficaces dans la léthargie. L'esprit de vitriol céphalique, c'est-à-dire, tiré du vitriol qui a été auparavant arrosé des essences céphaliques, est très-célebre ; il est pénétrant, volatil, de même que le vinaigre vitriolé bénit. Quelques observations nous apprennent les heureux effets de l'immersion subite des léthargiques dans de l'eau bien froide. Il vaut mieux, dit Celse, essayer un remede douteux, qu'aucun. Art. de M. MENURET.
|
| LÉTHÉ | (Mythol.) fleuve d'oubli, en grec , en latin laetheus fluvius ou Lethes au génitif, en sousentendant fleuve de, un des quatre fleuves des enfers.
Les poëtes ont ingénieusement imaginé qu'il y avoit dans les enfers une riviere de ce nom, & que tous les morts en buvoient un trait, qui leur faisoit oublier le passé, les joies & les chagrins, les plaisirs & les peines qu'on avoit ressentis pendant tout le cours de la vie, longa potant oblivia vitae, dit Virgile. Il ne s'agissoit plus que d'indiquer entre les rivieres du monde qui s'appelloient léthé, celle qui pouvoit être le fleuve des enfers. Les uns le placerent en Grece, & d'autres en Lybie. Voyez LETHAEUS, fluvius, (Géog.)
Pline nous apprend aussi que les anciens nommoient Lethes, fleuve d'oubli, un fleuve d'Espagne, sur lequel ils avoient fait beaucoup de contes ; ce fleuve est vraisemblablement la Lima, riviere de Portugal, qui serpente entre le Minho & le Duero. Enfin Lucain, phars. l. IX. prend le Lethes ou lethon, riviere d'Afrique, pour être le vrai fleuve d'oubli ; ce fleuve après avoir coulé sous terre pendant quelques milles, ressortoit près de la ville de Bérénice, & se jettoit dans la Méditerranée, proche le cap oriental des Syrtes.
Le mot , au génitif , veut dire oubli, & voilà l'origine du fleuve d'oubli des enfers. (D.J.)
|
| LETHOEUS | fluvius, (Geog. anc.) ce nom chez les anciens est donné 1°. à une riviere de l'Asie-mineure, qui passoit encore plus près de la ville de Magnésie que le Méandre ; 2°. à une riviere de Macédoine, proche de laquelle on disoit qu'Esculape étoit né ; 3°. à une riviere de l'île de Crete, qui, selon Strabon, traversoit Gortyne ; 4°. à une riviere que le même Strabon l. XIV. p. 647. place chez les Libyens occidentaux. (D.J.)
|
| LÉTRIM | (Géog.) contrée montagneuse d'Irlande, dans la province de Connaught, au nord-est de cette province. Elle a 40 milles de longueur, sur 18 de largeur, abonde en excellens pâturages, & est divisée en cinq baronies. La capitale de ce comté porte le nom de Létrim, située à 75 milles de Dublin. Long. 9. 35. lat. 54. 3.
|
| LETTER-HAUT | S. m. (Com.) espece de bois rougeâtre tirant sur le violet qu'on nomme aussi bois de la Chine ; il nous vient par les Hollandois.
|
| LETTERE | Letterum ou Letteranum, (Géogr.) petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la principauté citérieure, avec un évêché suffragant d'Amalfi. Elle est assise sur le dos du mont Lactarius, à 5 lieues nord ouest de Salerne, 8 sud-est de Naples. Long, 32. 5. lat. 40. 52. (D.J.)
|
| LETTRES | S. f. (Gramm.) on appelle ainsi les caracteres représentatifs des élémens de la voix. Ce mot nous vient du latin littera, dont les étymologistes assignent bien des origines différentes.
Priscien, lib. I. de litterâ, le fait venir par syncope de legitera, eo quòd legendi iter praebeat, ce qui me semble prouver que ce grammairien n'étoit pas difficile à contenter. Il ajoute ensuite que d'autres tirent ce mot de litura, quòd plerùmque in ceratis tabulis antiqui scribere solebant, & posteà delere ; mais si littera vient de litura, je doute fort que ce soit par cette raison, & qu'on ait tiré la dénomination des lettres de la possibilité qu'il y a de les effacer : il auroit été, me semble, bien plus raisonnable en ce cas de prendre litura dans le sens d'onction, & d'en tirer litera, de même que le mot grec correspondant est dérivé de je peins, parce que l'écriture est en effet l'art de peindre la parole. Cependant il resteroit encore contre cette étymologie une difficulté réelle, & qui mérite attention : la premiere syllabe de litura est breve, au lieu que litera a la premiere longue, & s'écrit même communément littera.
Jul. Scaliger, de caus. l. L. cap. iv. croit que ces caracteres furent appellés originairement lineaturae, & qu'insensiblement l'usage a réduit ce mot à litterae, parce qu'ils sont composés en effet de petites lignes. Quoique la quantité des premieres syllabes ne réclame point contre cette origine, j'y apperçois encore quelque chose de si arbitraire, que je ne la crois pas propre à réunir tous les suffrages.
D'après Hesychius, Vossius dans son étymologicon l. L. verbo LITERA, dérive ce mot de l'adjectif grec tenuis, exilis, parce que les lettres sont en effet des traits minces & déliés ; c'est la raison qu'il en allegue ; & M. le président de Brosses juge cette étymologie préférable à toutes les autres, persuadé que quand les lettres commencerent à être d'usage pour remplir l'écriture symbolique, dont les caracteres étoient nécessairement étendus, compliqués, & embarrassans, on dut être frappé sur-tout de la simplicité & de la grande réduction des nouveaux caracteres, ce qui put donner lieu à leur nomination. Qu'il me soit permis d'observer que l'origine des lettres latines qui viennent incontestablement des lettres grecques, & par elles des phéniciennes, prouve qu'elles n'ont pas dû être désignées en Italie par une dénomination qui tînt à la premiere impression de l'invention de l'alphabet ; ce n'étoit plus là une nouveauté qui dût paroître prodigieuse, puisque d'autres peuples en avoient l'usage. Que ne dit-on plutôt que les lettres sont les images des parties les plus petites de la voix, & que c'est pour cela que le nom latin a été tiré du grec , ensorte que litterae est pour notae litterae, ou notae elementares, notae partium vocis tenuissimarum ?
Que chacun pense au reste comme il lui plaira, sur l'étymologie de ce mot : ce qu'il importe le plus ici de faire connoître, c'est l'usage & la véritable nature des lettres considérées en général ; car ce qui appartient à chacune en particulier, est traité amplement dans les différens articles qui les concernent.
Les diverses nations qui couvrent la terre, ne different pas seulement les unes des autres, par la figure & par le tempérament, mais encore par l'organisation intérieure, qui doit nécessairement se ressentir de l'influence du climat, & de l'impression des habitudes nationales. Or il doit résulter de cette différence d'organisation, une différence considérable dans les sons & articulations dont les peuples font usage. De-là vient qu'il nous est difficile, pour ne pas dire impossible, de prononcer l'articulation que les Allemands représentent par ch, qu'eux-mêmes ont peine à prononcer notre u qu'ils confondent avec notre ou ; que les Chinois ne connoissent pas notre articulation r, &c. Les élémens de la voix usités dans une langue, ne sont donc pas toûjours les mêmes que ceux d'une autre ; & dans ce cas les mêmes lettres ne peuvent pas y servir, du moins de la même maniere ; c'est pourquoi il est impossible de faire connoître à quelqu'un par écrit, la prononciation exacte d'une langue étrangere, sur-tout s'il est question d'un son ou d'une articulation inusitée dans la langue de celui à qui l'on parle.
Il n'est pas plus possible d'imaginer un corps de lettres élémentaires qui soient communes à toutes les nations ; & les caracteres chinois ne sont connus des peuples voisins, que parce qu'ils ne sont pas les types des élémens de la voix, mais les symboles immédiats des choses & des idées : aussi les mêmes caracteres sont-ils lû diversement par les différens peuples qui en font usage ; parce que chacun d'eux exprime selon le génie de sa langue, les différentes idées dont il a les symboles sous les yeux. Voyez ECRITURE CHINOISE.
Chaque langue doit donc avoir son corps propre de lettres élémentaires ; & il seroit à souhaiter que chaque alphabet comprît précisément autant de lettres qu'il y a d'élémens de la voix usités dans la langue ; que le même élément ne fut pas représenté par divers caracteres ; & que le même caractere ne fût pas chargé de diverses représentations. Mais il n'est aucune langue qui jouisse de cet avantage ; & il faut prendre le parti de se conformer sur ce point à toutes les bisarreries de l'usage, dont l'empire après tout est aussi raisonnable & aussi nécessaire sur l'écriture que sur la parole, puisque les lettres n'ont & ne peuvent avoir qu'une signification conventionnelle, & que cette convention ne peut avoir d'autre titre que l'usage le plus reçu. Voyez ORTHOGRAPHE.
Comme nous distinguons dans la voix deux sortes d'élémens, les sons & les articulations ; nous devons pareillement distinguer deux sortes de lettres, les voyelles pour représenter les sons, & les consonnes pour représenter les articulations. Voyez CONSONNE, SON, (Gramm.) VOYELLE, H, & HIATUS. Cette premiere distinction devoit être, ce semble, le premier principe de l'ordre qu'il falloit suivre dans la table des lettres ; les voyelles auroient dû être placées les premieres, & les consonnes ensuite. La considération des différentes ouvertures de la bouche, auroit pu aider la fixation de l'ordre des voyelles entr'elles : on auroit pu classifier les consonnes par la nature de l'organe dont l'impression est la plus sensible dans leur production, & régler ensuite l'ordre des classes entr'elles, & celui des consonnes dans chaque classe par des vûes d'analogie. D'autres causes ont produit par-tout un autre arrangement, car rien ne se fait sans cause : mais celles qui ont produit l'ordre alphabétique tel que nous l'avons, n'étoient peut-être par rapport à nous qu'une suite de hasards, auxquels on peut opposer ce que la raison paroît insinuer, sinon pour réformer l'usage, du moins pour l'éclairer. M. du Marsais désiroit que l'on proposât un nouvel alphabet adapté à nos usages présens, (Voyez ALPHABET), débarrassé des inutilités, des contradictions & des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons, & enrichi des caracteres qui y manquent. Qu'il me soit permis de poser ici les principes qui peuvent servir de fondement à ce système.
Notre langue me paroit avoir admis huit sons fondamentaux qu'on auroit pu caractériser par autant de lettres, & dont les autres sons usités sont dérivés par de légeres variations : les voici écrits selon notre orthographe actuelle, avec des exemples où ils sont sensibles.
Il me semble que j'ai arrangé ces sons à-peu-près selon l'analogie des dispositions de la bouche lors de leur production. A est à la tête, parce qu'il paroît être le plus naturel, puisque c'est le premier ou du moins le plus fréquent dans la bouche des enfans : je ne citerai point en faveur de cette primauté le verset 8 du ch. j. de l'Apocalypse, pour en conclure, comme Wachter dans les prolégomenes de son Glossaire germanique, sect. 11. §. 32, qu'elle est de droit divin ; mais je remarquerai que l'ouverture de la bouche nécessaire à la production de l'a, est de toutes la plus aisée & celle qui laisse le cours le plus libre à l'air intérieur. Le canal semble se retrécir de plus en plus pour les autres. La langue s'éleve & se porte en avant pour ê ; un peu plus pour é ; les mâchoires se rapprochent pour i ; les levres font la même chose pour eu ; elles se serrent davantage & se portent en avant pour o ; encore plus pour u ; mais pour le son ou, elles se serrent & s'avancent plus que pour aucun autre.
J'ai dit que les autres sons usités dans notre langue dérivent de ceux-là par de legeres variations : ces variations peuvent dépendre ou du canal par où se fait l'émission de l'air, ou de la durée de cette émission.
L'air peut sortir entierement par l'ouverture ordinaire de la bouche, & dans ce cas on peut dire que le son est oral ; il peut aussi sortir partie par la bouche & partie par le nez, & alors on peut dire que le son est nasal. Le premier de ces deux états est naturel, & par conséquent il ne faudroit pour le peindre, que la voyelle même destinée à la représentation du son : le second état est, pour ainsi dire, violent, mais il ne faudroit pas pour cela une autre voyelle ; la même suffiroit, pourvu qu'on la surmontât d'une espece d'accent, de celui, par exemple, que nous appellons aujourd'hui circonflexe, & qui ne serviroit plus à autre chose, vû la distinction des caracteres que l'on propose ici. Or, il n'y a que quatre de nos huit sons fondamentaux, dont chacun puisse être ou oral, ou nasal ; ce sont le premier, le troisieme, le cinquiéme & le sixieme. C'est ce que nous entendons dans les monosyllabes, ban, pain, jeun, bon. Cette remarque peut indiquer comment il faudroit disposer les voyelles dans le nouvel alphabet : celles qui sont constantes, ou dont l'émission se fait toujours par la bouche, feroient une classe ; celles qui sont variables, ou qui peuvent être tantôt orales & tantôt nasales, feroient une autre classe : la voyelle a assure la prééminence à la classe des variables ; & ce qui précede fixe assez l'ordre dans chacune des deux classes.
Par rapport à la durée de l'émission, un son peut être bref ou long ; & ces différences, quand même on voudroit les indiquer, comme il conviendroit en effet, n'augmenteroient pas davantage le nombre de nos voyelles : tout le monde connoît les notes grammaticales qui indiquent la briéveté ou la longueur. Voyez BREVE.
Si nous voulons maintenant fixer le nombre & l'ordre des articulations usitées dans notre langue, afin de construire la table des consonnes qui pourroient entrer dans un nouvel alphabet ; il faut considérer les articulations dans leur cause & dans leur nature.
Considérées dans leur cause, elles sont ou labiales ou linguales, ou gutturales, selon qu'elles paroissent dépendre plus particulierement du mouvement ou des levres, ou de la langue, ou de la trachée-artere que le peuple appelle gosier : & cet ordre même me paroît le plus raisonnable, parce que les articulations labiales sont les plus faciles, & les premieres en effet qui entrent dans le langage des enfans, auquel on ne donne le nom de balbutie, que par une onomatopée fondée sur cela même ; d'ailleurs l'articulation gutturale suppose un effort que toutes les autres n'exigent point, ce qui lui assigne naturellement le dernier rang : au surplus cet ordre caractérise à merveille la succession des parties organiques ; les levres sont extérieures, la langue est en dedans, & la trachée-artere beaucoup plus intérieure.
Les articulations linguales se soudivisent assez communement en quatre especes, que l'on nomme dentales, sifflantes, liquides & mouillées : Voyez LINGUALE. Cette division a son utilité, & je ne trouverois pas hors de propos qu'on la suivît pour régler l'ordre des articulations linguales entr'elles, avec l'attention de mettre toujours les premieres dans chaque classe, celles dont la production est la plus facile. Ce discernement tient à un principe certain ; les plus difficiles s'operent toujours plus près du fond de la bouche ; les plus aisées se rapprochent davantage de l'extérieur.
Les articulations considérées dans leur nature, sont constantes ou variables, selon que le degré de force, dans la partie organique qui les produit, est ou n'est pas susceptible d'augmentation ou de diminution ; par conséquent, les articulations variables sont foibles ou fortes, selon qu'elles supposent moins de force ou plus de force dans le mouvement organique qui en est le principe. D'où il suit que dans l'ordre alphabétique, il ne faut pas séparer la foible de la forte, puisque c'est la même au fond ; & que la foible doit préceder la forte, par la raison du plus de facilité. Voici dans une espece de tableau le système & l'ordre des articulations, tel que je viens de l'exposer ; & vis-à-vis, une suite de mots où l'on remarque l'articulation dont il est question, représentée selon notre orthographe actuelle.
Système figuré des articulations.
Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans notre langue, ce qui exige dans notre alphabet dix-neuf consonnes : ainsi en y ajoutant les huit voyelles dont on a vû ci-devant la nécessité, le nouvel alphabet ne seroit que de vingt-sept lettres. C'est assez, non-seulement pour ne pas surcharger la multitude de trop de caracteres, mais encore pour exprimer toutes les modifications essentielles de notre langue, au moyen des accents que l'on y ajouteroit, comme je l'ai déja dit.
Me permettra-t-on encore une remarque qui peut paroître minutieuse, mais qui me semble pourtant raisonnable ? C'est que je crois qu'il pourroit y avoir quelque utilité à donner aux lettres d'une même classe une forme analogue, & distinguée de la forme commune aux lettres d'une autre classe : par exemple, à n'avoir que des voyelles sans queue, & formées de traits arrondis, comme a, e, o, 8 ; c, s, 3, a : à former les consonnes de traits droits ; les cinq labiales, par exemple, sans queue, comme n, m, u, m, z : toutes les linguales avec queue ; les dentales par en haut, les sifflantes par en bas ; les foibles en deux traits, les fortes en trois ; les liquides & les mouillées, d'une queue droite & d'un trait rond, la queue en haut pour les premieres, & en bas pour les autres : notre gutturale, comme la plus difficile pourroit avoir une figure plus irréguliere, comme le k, le x ou le &. Je sens très-bien qu'il n'y a aucun fonds à faire sur une pareille innovation ; mais je ne pense pas qu'il faille pour cela en dédaigner le projet, ne pût-il que servir à montrer comment on envisage en général & en détail un objet qu'on a intérêt de connoître. L'art d'analyser, qui est peut-être le seul art de faire usage de la raison est aussi difficile que nécessaire ; & l'on ne doit rien mépriser de ce qui peut servir à la perfectionner.
Il est évident, par la définition que j'ai donnée des lettres, qu'il y a une grande différence entre ces caracteres & les élémens de la voix dont ils sont les signes : hoc interest, dit Priscien, inter elementa & litteras, quod elementa propriè dicuntur ipsae pronunciationes ; notae autem earum litterae, lib. I. de litterâ. Il semble que les Grecs aient fait aussi attention à cette différence, puisqu'ils avoient deux mots différens pour ces deux objets, , élémens & , peintures, quoique l'auteur de la méthode grecque de P. R. les présente comme synonymes ; mais il est bien plus naturel de croire que dans l'origine le premier de ces mots exprimoit en effet les élémens de la voix, indépendamment de leur représentation, & que le second en exprimoit les signes représentatifs ou de peinture. Il est cependant arrivé par le laps de tems, que sous le nom du signe on a compris indistinctement & le signe & la chose signifiée. Priscien, ibid. remarque cet abus : abusivè tamen & elementa pro litteris & litterae pro elementis vocantur. Cet usage contraire à la premiere institution, est venu, sans doute de ce que, pour désigner tel ou tel élément de la voix, on s'est contenté de l'indiquer par la lettre qui en étoit le signe, afin d'éviter les circonlocutions toujours superflues & très-sujettes à l'équivoque dans la matiere dont il est question. Ainsi, au lieu d'écrire & de dire, par exemple, l'articulation foible produite par la réunion des deux levres, on a dit & écrit le b, & ainsi des autres. Au reste, cette confusion d'idées n'a pas de grands inconvéniens, si même on peut dire qu'elle en ait. Tout le monde entend très-bien que le mot lettres, dans la bouche d'un maître d'écriture, s'entend des signes représentatifs des élémens de la voix ; que dans celle d'un fondeur ou d'un imprimeur il signifie les petites pieces de métal qui portent les empreintes de ces signes pour les transmettre sur le papier au moyen d'une encre ; & que dans celle d'un grammairien il indique tantôt les signes & tantôt les élémens mêmes de la voix, selon que les circonstances designent qu'il s'agit ou d'orthologie ou d'orthographe. Je ne m'écarterai donc pas du langage ordinaire dans ce qui me reste à dire sur l'attraction & la permutation des lettres : on verra assez que je ne veux parler que des élémens de la voix prononcée, dont les lettres écrites suivent assez communément le sort, parce qu'elles sont les dépositaires de la parole. Hic enim usus est litterarum, ut custodiant voces, & velut depositum reddant legentibus. Quintil. inst. orat. I. jv.
Nous avons vu qu'il y a entre les lettres d'une même classe une sorte d'affinité & d'analogie qui laissent souvent entr'elles assez peu de différence : c'est cette affinité qui est le premier fondement & la seule cause raisonnable de ce que l'on appelle l'attraction & la permutation des lettres.
L'attraction est une opération par laquelle l'usage introduit dans un mot une lettre qui n'y étoit point originairement, mais que l'homogénéité d'une autre lettre préexistante semble seule y avoir attirée. C'est ainsi que les verbes latins ambio, ambigo, composés de l'ancienne particule am, équivalente à circùm, & des verbes eo & ago, ont reçu la consonne labiale b, attirée par la consonne m, également labiale : c'est la même chose dans comburo, composé de cùm & d'uro. Notre verbe françois trembler, dérivé de tremere, & nombre, dérivé de numerus, présentent le même méchanisme.
La permutation est une opération par laquelle dans la formation d'un mot tiré d'un autre mot pris dans la même langue ou dans une langue étrangere, on remplace une lettre par une autre. Ainsi du mot grec , les Latins ont fait pes en changeant en e, & les Allemands ont fait fuss, en changeant en f, car leur u répond à l' des Grecs quant à la prononciation.
Je l'ai déja dit, & la saine philosophie le dit aussi, rien ne se fait sans cause ; & il est très-important dans les recherches étymologiques de bien connoître les fondemens & les causes de ces deux sortes de changemens de lettres, sans quoi il est difficile de débrouiller la génération & les différentes métamorphoses des mots. Or le grand principe qui autorise ou l'attraction ou la permutation des lettres, c'est, comme je l'ai déja insinué, leur homogénéité.
Ainsi, 1°. toutes les voyelles sont commuables entr'elles pour cette raison d'affinité, qui est si grande à l'égard des voyelles, que M. le président des Brosses regarde toutes les voyelles comme une seule, variée seulement selon les différences de l'état du tuyau par où sort la voix, & qui, à cause de sa flexibilité, peut être conduit par dégradation insensible depuis son plus large diametre & sa plus grande longueur, jusqu'à son état le plus resserré & le plus raccourci. C'est ainsi que nous voyons l'a de capio changé en e dans particeps, en i dans participare ; & en u dans aucupium ; que l'a du grec est changé en e dans le latin pello, cet e changé en u dans le supin pulsum, que nous conservons dans impulsion, & que nous changeons en ou dans pousser ; que l'i du grec est changé en a dans le latin ala, & en ê, que nous écrivons ai, dans le françois aile, &c. Il seroit superflu d'accumuler ici un plus grand nombre d'exemples : on n'a qu'à ouvrir les Dictionnaires étymologiques de Vossius pour le latin, Ménage pour le françois ; de Wachter pour l'allemand, &c. & lire sur-tout le traité de Vossius de litterarum permutatione : on en trouvera de toutes les especes.
2°. Par la même raison les consonnes labiales sont commuables entr'elles, voyez LABIALES, & l'une peut aisément attirer l'autre, comme on l'a vu dans la définition que j'ai donnée de l'attraction.
3°. Il en est de même de toutes les consonnes linguales, mais dans un degré de facilité proportionné à celui de l'affinité qui est entr'elles ; les dentales se changent ou s'allient plus aisément avec les dentales, les sifflantes avec les sifflantes, &c. & par la même raison dans chacune de ces classes, & dans toute autre où la remarque peut avoir lieu, la foible & la forte ont le plus de disposition à se mettre l'une pour l'autre, ou l'une avec l'autre. Voyez les exemples à l'article LINGUALE.
4°. Il arrive encore assez souvent que des consonnes, sans aucuns degrés prochains d'affinité, ne laissent pas de se mettre les unes pour les autres dans les dérivations des mots, sur le seul fondement d'affinité qui résulte de leur nature commune ; dans ce cas néanmoins la permutation est déterminée par une cause prochaine, quoiqu'accidentelle ; communément c'est que dans la langue qui emprunte, l'organe joint à la prononciation de la lettre changée l'inflexion d'une autre partie organique, & c'est la partie organique de la lettre substituée. Comment avons-nous substitué c à la lettre t, une sifflante à une dentale, dans notre mot place venu de platea ? c'est que nous sommes accoutumés à prononcer le t en sifflant comme s dans plusieurs mots, comme action, ambitieux, patient, martial, &c. que d'autre part nous prononçons de même la lettre c devant e, i, ou devant les autres voyelles quand elle est cédillée : or l'axiome dit quae sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se ; donc le c & le t peuvent se prendre l'un pour l'autre dans le système usuel de notre langue : l'une & l'autre avec s peuvent aussi être commuables. D'autres vûes autorisées par l'usage contre les principes naturels de la prononciation, donneront ailleurs d'autres permutations éloignées des lois générales.
Pour ce qui concerne l'histoire des lettres & la génération des alphabets qui ont eu cours ou qui sont aujourd'hui en usage, on peut consulter le ch. xx. du liv. I. de la seconde partie de la Géographie sacrée de Bochart ; le livre du P. Herman Hugo, jésuite, de ratione scribendi apud veteres ; Vossius de arte Grammaticâ, ch. ix. & x. Baudelot de Daireval, de l'utilité des voyages & de l'avantage que la recherche des antiquités procure aux Savans ; les oeuvres de dom Bernard de Montfaucon ; l'art de vérifier les dates des faits historiques, par des religieux Bénédictins de la congrégation de S. Maur ; le livre IV. de l'introduction à l'histoire des Juifs de Prideaux, par M. Shuckford ; nos Pl. d'Alph. anc. & mod. plus riches qu'aucun de ces ouvrages. (B. E. R. M.)
LETTRES, (Imprimerie) Les Imprimeurs nomment ainsi, & sans acception de corps ou de grandeur, chaque piece mobile & séparée dont sont assortis les différens caracteres en usage dans l'Imprimerie, mais ils en distinguent de quatre sortes dans chaque corps de caracteres, qui sont les capitales, petites capitales, ou majuscules & minuscules, les lettres du bas de casse & lettres doubles, tels que le si, le fi, le double ssi & le double ffi, & quelqu'autres. Il y a outre ces corps & grandeurs un nombre de lettres pour l'impression des affiches & placards, que l'on nomme, à cause de leur grandeur & de leur usage, grosses & moyennes : elles sont de fonte ou de bois ; ces corps n'ont ni petites capitales ni lettres du bas de casse. Voyez nos Pl. d'Imprimerie.
LETTRE CAPITALE, (Ecrit. Imprim.) grande lettre, lettre majuscule. Les anciens manuscrits grecs & latins sont entierement écrits en lettres capitales ; & lors de la naissance de l'Imprimerie, on mit au jour quelques livres, tout en capitales. Nous avons un Homere, une Anthologie grecque, un Appollonius imprimés de cette façon : on en doit l'idée à Jean Lascaris, surnommé Rhyndacène, mais on lui doit bien mieux, c'est d'avoir le premier apporté en Occident la plûpart des plus beaux manuscrits grecs que l'on y connoisse. Il finit ses jours à Rome en 1535. (D.J.)
LETTRE GRISE, (Imprimerie) Les Imprimeurs appellent ainsi des lettres entourées d'ornemens de gravure, soit en bois, soit en taille-douce ; elles sont d'usage pour commencer la matiere d'un ouvrage aux pages où il y a une vignette en bois. Voyez VIGNETTE, Voyez TABLE DES CARACTERES.
LETTRE TREMBLEE, (Ecrivain) est dans l'écriture un caractere qui, quoique sorti d'une main libre & sûre, imite le tremblé naturel, parce que ses traits ont la même attitude que s'ils partoient d'un style foible.
Voyez tom. II. 2. part. aux Planches de notre Ecriture moderne.
LETTRES GRECQUES, (Gramm. orig. des langues,) , caracteres de l'écriture des anciens grecs.
Joseph Scaliger, suivi par Walton, Bochart, & plusieurs autres savans, a tâché de prouver dans ses notes sur la chronique d'Eusebe, que les caracteres grecs tiroient leur origine des lettres phéniciennes ou hébraïques.
Le chevalier Marsham, dans son Canon chronicus aegyptiacus, ouvrage excellent par la méthode, la clarté, la briéveté & l'érudition dont il est rempli, rejette le sentiment de Scaliger, & prétend que Cadmus égyptien de naissance, ne porta pas de Phénicie en Grece les lettres phéniciennes, mais les caracteres épistoliques des Egyptiens, dont Theut ou Thoot, un des hermès des Grecs, étoit l'inventeur, & que de plus les Hébreux mêmes ont tiré leurs lettres des Egyptiens, ainsi que diverses autres choses.
Cette hypothèse a le désavantage de n'être pas étayée par des témoignages positifs de l'antiquité, & par la vûe des caracteres épistoliques des Egyptiens que nous n'avons plus, au lieu que les caracteres phéniciens ou hébraïques ont passé jusqu'à nous.
Aussi les partisans de Scaliger appuient beaucoup en faveur de son opinion, sur la ressemblance de forme entre les anciennes lettres grecques & les caracteres phéniciens ; mais malheureusement cette similitude n'est pas concluante, parce qu'elle est trop foible, trop legere, parce qu'elle ne se rencontre que dans quelques lettres des deux alphabets, & parce qu'enfin Rudbeck ne prouve pas mal que les lettres runiques ont encore plus d'affinité avec les lettres grecques, par le nombre, par l'ordre & par la valeur que les lettres phéniciennes.
Il se pourroit donc bien que les sectateurs de Scaliger & de Marsham fussent également dans l'erreur, & que les Grecs, avant l'arrivée de Cadmus, qui leur fit connoître les caracteres phéniciens ou égyptiens, il n'importe, eussent déja leur propre écriture, leur propre alphabet, composé de seize lettres, & qu'ils enrichirent cet alphabet qu'ils possédoient de quelques autres lettres de celui de Cadmus.
Après tout, quand on examine sans prévention combien le système de l'écriture grecque est différent de celui de l'écriture phénicienne, on a bien de la peine à se persuader qu'il en émane.
1°. Les Grecs exprimoient toutes les voyelles par des caracteres séparés, & les Phéniciens ne les exprimoient point du tout ; 2°. les Grecs n'eurent que seize lettres jusqu'au siége de Troie ; & les Phéniciens en ont toujours eu vingt-deux ; 3°. les Phéniciens écrivoient de droite à gauche, & les Grecs au contraire de gauche à droite. S'ils s'en sont écartés quelques fois, ç'a été par bisarrerie & pour s'accommoder à la forme des monumens sur lesquels on gravoit les inscriptions, ou même sur les monumens élevés par des phéniciens, ou pour des phéniciens de la colonie de Cadmus. Les Thébains eux-mêmes sont revenus à la méthode commune de disposer les caracteres grecs de la gauche à la droite, qui étoit la méthode ordinaire & universelle de la nation.
Ces différences, dont il seroit superflu de rapporter la preuve, étant une fois posées, est-il vraisemblable que les Grecs eussent fait de si grands changemens à l'écriture phénicienne, s'ils n'eussent pas déja été accoutumés à une autre maniere d'écrire, & à un autre alphabet auquel apparemment ils ajouterent les caracteres phéniciens de Cadmus ? Ils retournerent ceux-ci de la gauche à la droite, donnerent à quelques-uns la force de voyelles, parce qu'ils en avoient dans leur écriture, & rejetterent absolument ceux qui exprimoient des sons dont ils ne se servoient point. (D.J.)
LETTRES les, (Encyclopédie) ce mot désigne en général les lumieres que procurent l'étude, & en particulier celle des belles-lettres ou de la littérature. Dans ce dernier sens, on distingue les gens de lettres, qui cultivent seulement l'érudition variée & pleine d'aménités, de ceux qui s'attachent aux sciences abstraites, & à celles d'une utilité plus sensible. Mais on ne peut les acquérir à un degré éminent sans la connoissance des lettres, il en résulte que les lettres & les sciences proprement dites, ont entr'elles l'enchaînement, les liaisons, & les rapports les plus étroits ; c'est dans l'Encyclopédie qu'il importe de le démontrer, & je n'en veux pour preuve que l'exemple des siecles d'Athenes & de Rome.
Si nous les rappellons à notre mémoire, nous verrons que chez les Grecs l'étude des lettres embellissoit celle des sciences, & que l'étude des sciences donnoit aux lettres un nouvel éclat. La Grece a dû tout son lustre à cet assemblage heureux ; c'est par-là qu'elle joignit au mérite le plus solide, la plus brillante réputation. Les lettres & les sciences y marcherent toujours d'un pas égal, & se servirent mutuellement d'appui. Quoique les muses présidassent les unes à la Poésie & à l'Histoire, les autres à la Dialectique, à la Géométrie & à l'Astronomie, on les regardoit comme des soeurs inséparables, qui ne formoient qu'un seul choeur. Homere & Hésiode les invoquent toutes dans leurs poëmes, & Pythagore leur sacrifia, sans les séparer, un hécatombe philosophique en reconnoissance de la découverte qu'il fit de l'égalité du quarré de l'hypothénuse dans le triangle-rectangle, avec les quarrés des deux autres côtés.
Sous Auguste, les lettres fleurirent avec les sciences & marcherent le front. Rome, déja maîtresse d'Athenes, par la force de ses armes, vint à concourir avec elle pour un avantage plus flatteur, celui d'une érudition agréable & d'une science profonde.
Dans le dernier siecle, si glorieux à la France à cet égard, l'intelligence des langues savantes & l'étude de la nôtre furent les premiers fruits de la culture de l'esprit. Pendant que l'éloquence de la chaire & celle du barreau brilloient avec tant d'éclat ; que la Poésie étaloit tous ses charmes ; que l'Histoire se faisoit lire avec avidité dans ses sources, & dans des traductions élégantes ; que l'antiquité sembloit nous dévoiler ses trésors ; qu'un examen judicieux portoit par-tout le flambeau de la critique : la Philosophie réformoit les idées, la physique s'ouvroit de nouvelles routes pleines de lumieres, les Mathématiques s'élevoient à la perfection ; enfin les lettres & les sciences s'enrichissoient mutuellement par l'intimité de leur commerce.
Ces exemples des siecles brillans prouvent que les sciences ne sauroient subsister dans un pays que les lettres n'y soient cultivées. Sans elles une nation seroit hors d'état de goûter les sciences, & de travailler à les acquérir. Aucun particulier ne peut profiter des lumieres des autres & s'entretenir avec les Ecrivains de tous les pays & de tous les tems, s'il n'est savant dans les lettres par lui-même, ou du moins, si des gens de lettres ne lui servent d'interpretes. Faute d'un tel secours, le voile qui cache les sciences, devient impénétrable.
Disons encore que les principes des sciences seroient trop rebutans, si les lettres ne leur prétoient des charmes. Elles embellissent tous les sujets qu'elles touchent : les vérités dans leurs mains deviennent plus sensibles par leurs tours ingénieux, par les images riantes, & par les fictions même sous lesquelles elles les offrent à l'esprit. Elles répandent des fleurs sur les matieres les plus abstraites, & savent les rendre intéressantes. Personne n'ignore avec quels succès les sages de la Grece & de Rome employerent les ornemens de l'éloquence dans leurs écrits philosophiques.
Les scholastiques, au lieu de marcher sur les traces de ces grands maîtres, n'ont conduit personne à la science de la sagesse, ou à la connoissance de la nature. Leurs ouvrages sont un jargon également inintelligible, méprisé de tout le monde.
Mais si les lettres servent de clé aux sciences, les sciences de leur côté concourent à la perfection des lettres. Elles ne feroient que bégayer dans une nation où les connoissances sublimes n'auroient aucun accès. Pour les rendre florissantes, il faut que l'esprit philosophique, & par conséquent les sciences qui le produisent, se rencontrent dans l'homme de lettres, ou du moins dans le corps de la nation. Voyez GENS de LETTRES.
La Grammaire, l'Eloquence, la Poésie, l'Histoire, la Critique, en un mot, toutes les parties de la Littérature seroient extrêmement défectueuses, si les sciences ne les reformoient & ne les perfectionnoient : elles sont sur-tout nécessaires aux ouvrages didactiques en matiere de rhétorique, de poétique & d'histoire. Pour y réussir, il faut être philosophe autant qu'homme de lettres. Aussi, dans l'ancienne Grece, l'érudition polie & le profond savoir faisoient le partage des génies du premier ordre. Empédocle, Epicharme, Parménide, Archelaüs sont célebres parmi les Poëtes, comme parmi les philosophes. Socrate cultivoit également la philosophie, l'éloquence & la poésie. Xénophon son disciple sut allier dans sa personne l'orateur, l'historien & le savant, avec l'homme d'état, l'homme de guerre & l'homme du monde. Au seul nom de Platon, toute l'élévation des sciences & toute l'aménité des lettres se présente à l'esprit. Aristote, ce génie universel, porta la lumiere & dans tous les genres de littérature, & dans toutes les parties des sciences. Pline, Lucien, & les autres écrivains font l'éloge d'Eratosthene, & en parlent comme d'un homme qui avoit réuni avec le plus de gloire, les lettres & les sciences.
Lucrece, parmi les Romains, employa les muses latines à chanter les matieres philosophiques. Varron, le plus savant de son pays, partageoit son loisir entre la Philosophie, l'Histoire, l'étude des antiquités, les recherches de la Grammaire & les délassemens de la Poésie. Brutus étoit philosophe, orateur, & possédoit à fond la jurisprudence. Cicéron, qui porte jusqu'au prodige l'union de l'Eloquence & de la Philosophie, déclaroit lui-même que s'il avoit un rang parmi les orateurs de son siecle, il en étoit plus redevable aux promenades de l'académie, qu'aux écoles des rhéteurs. Tant il est vrai, que la multitude des talens est nécessaire pour la perfection de chaque talent particulier, & que les lettres & les sciences ne peuvent souffrir de divorce.
Enfin si l'homme attaché aux sciences & l'homme de lettres ont des liaisons intimes par des intérêts communs & des besoins mutuels, ils se conviennent encore par la ressemblance de leurs occupations, par la supériorité des lumieres, par la noblesse des vûes, & par leur genre de vie, honnête, tranquille & retiré.
J'ose donc dire sans préjugé en faveur des lettres & des sciences, que ce sont elles qui font fleurir une nation, & qui répandent dans le coeur des hommes les regles de la droite raison, & les semences de douceur, de vertu & d'humanité si nécessaires au bonheur de la société.
Je conclus avec Raoul de Presles, dans son vieux langage du xiv. siecle, que " Ociosité, sans lettres & sans science est sépulture d'homme vif ". Cependant le goût des lettres, je suis bien éloigné de dire la passion des lettres, tombe tous les jours davantage dans ce pays, & c'est un malheur dont nous tâcherons de dévoiler les causes au mot LITTERATURE.
LETTRE, EPITRE, MISSIVE, (Littérat.) les lettres des Grecs & des Romains avoient, comme les nôtres, leurs formules : voici celles que les Grecs mettoient au commencement de leurs missives.
Philippe, roi de Macédoine, à tout magistrat, salut, & pour indiquer le terme en grec, . Les mots , dont ils se servoient, & qui signifioient joie, prospérité, santé, étoient des especes de formules affectées au style épistolaire, & particulierement à la décoration du frontispice de chaque lettre.
Ces sortes de formules ne signifioient pas plus en elles-mêmes, que signifient celles de nos lettres modernes ; c'étoient de vains complimens d'étiquettes. Lorsqu'on écrivoit à quelqu'un, on lui souhaitoit au moins en apparence la santé par , la prospérité par , la joie & la satisfaction par .
Comme on mettoit à la tête des lettres, , on mettoit à la fin, , & quand on adressoit sa lettre à plusieurs, , portez-vous bien, soyez heureux, ce qui équivaloit (mais plus sensément) à notre formule, votre très-humble serviteur.
S'il s'agissoit de donner des exemples de leurs lettres, je vous citerois d'abord celle de Philippe à Aristote, au sujet de la naissance d'Alexandre.
" Vous savez que j'ai un fils ; je rends graces aux dieux, non pas tant de me l'avoir donné, que de me l'avoir donné du vivant d'Aristote. J'ai lieu de me promettre que vous formerez en lui un successeur digne de nous, & un roi digne de la Macédoine ". Aristote ne remplit pas mal les espérances de Philippe. Voici la lettre que son éleve devenu maître du monde, lui écrivit sur les débris du trône de Cyrus.
" J'apprends que tu publies tes écrits acromatiques. Quelle supériorité me reste-t-il maintenant sur les autres hommes ? Les hautes sciences que tu m'as enseignées, vont devenir communes ; & tu n'ignores pas cependant que j'aime encore mieux surpasser les hommes par la science des choses sublimes, que par la puissance. Adieu ".
Les Romains ne firent qu'imiter les formules des Grecs dans leurs lettres ; elles finissoient de même par le mot vale, portez-vous bien ; elles commençoient semblablement par le nom de celui qui les écrivoit, & par celui de la personne à qui elles étoient adressées. On observoit seulement lorsqu'on écrivoit à une personne d'un rang supérieur, comme à un consul ou à un empereur, de mettre d'abord le nom du consul ou de l'empereur.
Quand un consul ou empereur écrivoit, il mettoit toujours son nom avant celui de la personne à qui il écrivoit. Les lettres des empereurs, pour les affaires d'importance, étoient cachetées d'un double cachet.
Les successeurs d'Auguste ne se contenterent pas de souffrir qu'on leur donnât le titre de seigneurs, dans les lettres qu'on leur adressoit, mais ils agréerent qu'on joignit à leur nom les épithetes magnifiques de très-grand, très-auguste, très-débonnaire, invincible & sacré. Dans le corps de la lettre, on employoit les termes de votre clémence, votre piété, & autres semblables. Par cette nouvelle introduction de formules inouies jusqu'alors, il arriva que le ton noble épistolaire des Romains sous la république ne connut plus sous les empereurs d'autre style, que celui de la bassesse & de la flatterie.
LETTRES DES SCIENCES, (Littérat.) l'usage d'écrire des lettres, des épîtres, des billets, des missives, des dépêches, est aussi ancien que l'écriture ; car on ne peut pas douter que dès que les hommes eurent trouvé cet art, ils n'en ayent profité pour communiquer leurs pensées à des personnes éloignées. Nous voyons dans l'Iliade, liv. VI. v. 69, Bellerophon porter une lettre de Proëtus à Jobatès. Il seroit ridicule de répondre que c'étoit un codicille, c'est-à-dire de simples feuilles de bois couvertes de cire, & écrites avec une plume de métal, car quand on écrivoit des codicilles, on écrivoit sans doute des lettres, & même ce codicille en seroit une essentiellement, si la définition que donne Cicéron d'une épître est juste, quand il dit que son usage est de marquer à la personne à qui elle est adressée, des choses qu'il ignore.
Nous n'avons de vraiment bonnes lettres que celles de ce même Cicéron & d'autres grands hommes de son tems, qu'on a recueillies avec les siennes, & les lettres de Pline ; comme les premieres sur-tout sont admirables & même uniques, j'espere qu'on me permettra de m'y arrêter quelques momens.
Il n'est point d'écrits qui fassent tant de plaisir que les lettres des grands hommes ; elles touchent le coeur du lecteur, en déployant celui de l'écrivain. Les lettres des beaux génies, des savans profonds, des hommes d'état sont toutes estimées dans leur genre différent ; mais il n'y eut jamais de collection dans tous les genres égale à celle de Cicéron, soit qu'on considere la pureté du style, l'importance des matieres, ou l'éminence des personnes qui y sont intéressées.
Nous avons près de mille lettres de Cicéron qui subsistent encore, & qu'il fit après l'âge de quarante ans ; cependant ce grand nombre ne fait qu'une petite partie, non seulement de celles qu'il écrivit, mais même de celles qui furent publiées après sa mort par son secrétaire Tyro. Il y en a plusieurs volumes qui se sont perdus ; nous n'avons plus le premier volume des lettres de ce grand homme à Lucinius Calvus ; le premier volume de celles qu'il adressa à Q. Axius ; le second volume de ses lettres à son fils ; un autre second volume de ses lettres à Cornelius Nepos ; le troisieme livre de celles qu'il écrivit à Jules-César, à Octave, à Pansa ; un huitieme volume de semblables lettres à Brutus ; & un neuvieme à A. Hirtius.
Mais ce qui rend les lettres de Cicéron très-précieuses, c'est qu'il ne les destina jamais à être publiques, & qu'il n'en garda jamais de copies. Ainsi nous y trouvons l'homme au naturel, sans déguisement & sans affectation : nous voyons qu'il parle à Atticus avec la même franchise, qu'il se parloit à lui-même, & qu'il n'entre dans aucune affaire sans l'avoir auparavant consulté.
D'ailleurs, les lettres de Cicéron contiennent les matériaux les plus authentiques de l'histoire de son siecle, & dévoilent les motifs de tous les grands événemens qui s'y passerent, & dans lesquels il joua lui-même un si beau rôle.
Dans ses lettres familieres, il ne court point après l'élégance ou le choix des termes ; il prend le premier qui se présente, & qui est d'usage dans la conversation ; son enjouement est aisé, naturel, & coule du sujet ; il se permet un joli badinage, & même quelquefois des jeux de mots : cependant dans le reproche qu'il fait à Antoine, d'avoir montré une de ses lettres, il a raison de lui dire : " Vous n'ignoriez pas qu'il y a des choses bonnes dans notre société, qui rendues publiques, ne sont que folles ou ridicules ".
Dans ses lettres de complimens, & quelques-unes sont adressées aux plus grands hommes qui vécurent jamais, son desir de plaire y est exprimé de la maniere la plus conforme à la nature & à la raison, avec toute la délicatesse du sentiment & de la diction ; mais sans aucun de ces titres pompeux, de ces épithetes fastueuses que nos usages modernes donnent aux grands, & qu'ils ont marqués au coin de la politesse, tandis qu'ils ne présentent que des restes de barbarisme, fruit de la servitude & de la décadence du goût.
Dans ses lettres politiques, toutes ses maximes sont tirées de la profonde connoissance des hommes, & des affaires. Il frappe toujours au but, prévoit le danger, & annonce les événemens : Quae nunc usu veniunt, cecinit ut vates, dit Cornelius Nepos.
Dans ses lettres de recommandation, c'est la bienfaisance, c'est le coeur, c'est la chaleur du sentiment qui parle. Voyez LETTRE de recommandation.
Enfin, les lettres qui composent le recueil donné sous le nom de Cicéron, me paroissent d'un prix infini en ce point particulier, que ce sont les seuls monumens qui subsistent de Rome libre. Elles soupirent les dernieres paroles de la liberté mourante. La plus grande partie de ces lettres ont paru, si l'on peut parler ainsi, au moment que la république étoit dans la crise de sa ruine, & qu'il falloit enflammer tout l'amour qui restoit encore dans le coeur des vertueux & courageux citoyens pour la défense de leur patrie.
Les avantages de cette conjoncture sauteront aux yeux de ceux qui compareront ces lettres avec celles d'un des plus honnêtes hommes & des plus beaux génies qui se montrerent sous le regne des empereurs. On voit bien que j'entends les lettres de Pline ; elles méritent certainement nos regards & nos éloges, parce qu'elles viennent d'une ame vraiment noble, épurée par tous les agrémens possibles de l'esprit, du savoir & du goût. Cependant, on apperçoit dans le charmant auteur des lettres dont nous parlons, je ne sais quelle stérilité dans les faits, & quelle réserve dans les pensées, qui décelent la crainte d'un maître. Tous les détails du disciple de Quintilien, & toutes ses réflexions, ne portent que sur la vie privée. Sa politique n'a rien de vraiment intéressant ; elle ne développe point le ressort des grandes affaires, ni les motifs des conseils, ni ceux des événemens publics.
Pline a obtenu les mêmes charges que Cicéron ; il s'est fait une gloire de l'imiter à cet égard, comme dans ses études : Laetaris, écrit-il à un de ses amis, laetaris quòd honoribus ejus insistam, quem emulari in studiis cupio. Epist. 4. 8. Néanmoins, s'il tâcha de suivre l'orateur romain dans ses études & dans ses emplois ; toutes les dignités dont il fut après lui revêtu, n'étoient que des dignités de nom. Elles lui furent conférées par le pouvoir impérial, & il les remplit conformément aux vues de ce pouvoir. En vain je trouve Pline décoré de ces vieux titres de consul & de proconsul, je vois qu'il leur manque l'homme d'état, le magistrat suprème. Dans le commandement de province, où Cicéron gouvernoit toutes choses avec une autorité sans bornes, où des rois venoient recevoir ses ordres, Pline n'ose pas réparer des bains, punir un esclave fugitif, établir un corps d'artisans nécessaire, jusqu'à-ce qu'il en ait informé l'empereur : Tu domine, lui demande-t-il, despice, an instituendum putes collegium Fabrorum : mais Lépide, mais Antoine, mais Pompée, mais César, mais Octave craignent & respectent Cicéron ; ils le ménagent, ils le courtisent, ils cherchent sans succès à le gagner, & à le détacher du parti de Cassius, de Brutus & de Caton. Quelle distance à cet égard entre l'auteur des Philippiques & l'écrivain du panégyrique de Trajan ! (D.J.)
LETTRES SOCRATIQUES, (Littérat.) c'est ainsi qu'on nomme chez les Littérateurs le recueil de diverses lettres au nombre de trente-cinq, que Léo Allatius fit imprimer à Paris, l'an 1637, en grec, avec une version latine & des notes, sous le nom de Socrate & de ses disciples. Les sept premieres lettres sont attribuées à ce philosophe même ; les autres à Antisthène, Aristippe, Xénophon, Platon, &c. Elles furent reçues avec applaudissement, & elles le méritent à plusieurs égards ; cependant on a depuis considéré ce recueil avec plus d'attention qu'on ne le fit quand il vit le jour ; & M. Fabricius s'est attaché à prouver que ces lettres sont des pieces supposées & qu'elles sont l'ouvrage de quelques sophistes plus modernes que les philosophes dont elles portent le nom ; c'est ce qu'il tache d'établir, tant par les caracteres du style, que par le silence des anciens. Le célébre Pearson avoit déjà dans ses Vindic. Ignatii, part. II. pag. 12. donné plusieurs raisons tirées de la chronologie, pour justifier que ces lettres ne peuvent être de Socrate & des autres philosophes auxquels on les donne ; enfin c'est aujourd'hui le sentiment général de la plûpart des savans. Il est vrai que M. Stanley semble avoir eu dessein de réhabiliter l'authenticité de ces lettres dans la vie des philosophes, auxquels Léo Allatius les attribue ; mais le soin qu'a pris l'illustre anglois dont nous venons de parler, n'a pu faire pancher la balance en sa faveur.
Cependant quels que soient les auteurs des lettres socratiques, on les lit avec plaisir, parce qu'elles sont bien écrites, ingénieuses & intéressantes ; mais comme il est vraisemblable que la plûpart des lecteurs ne les connoissent guere, j'en vais transcrire deux pour exemple. La premiere est celle qu'Aristippe, fondateur de la secte cyrénaïque, écrit à Antisthène, fondateur de la secte des cyniques, à qui la maniere de vivre d'Aristippe déplaisoit. Elle est dans le style ironique d'un bout à l'autre, comme vous le verrez.
Aristippe à Antisthène.
" Aristippe est malheureux au-delà de ce que l'on peut s'imaginer ; & cela peut-il être autrement ? Réduit à vivre avec un tyran, à avoir une table délicate, à être vêtu magnifiquement, à se parfumer des parfums les plus exquis ? Ce qu'il y a d'affligeant, c'est que personne ne veut me délivrer de la cruauté de ce tyran, qui ne me retient pas sur le pié d'un homme grossier & ignorant, mais comme un disciple de Socrate, parfaitement instruit de ses principes ; ce tyran me fournit abondamment tout ce dont j'ai besoin, ne craignant le jugement ni des dieux ni des hommes ; & pour mettre le comble à mes infortunes, il m'a fait présent de trois belles filles Siciliennes, & de beaucoup de vaisselle d'argent.
Ce qu'il y a de fâcheux encore, c'est que j'ignore quand il finira de pareils traitemens. C'est donc bien fait à vous d'avoir pitié de la misere de vos prochains ; & pour vous en témoigner ma reconnoissance, je me réjouis avec vous du rare bonheur dont vous jouissez, & j'y prends toute la part possible. Conservez pour l'hiver prochain les figues & la farine de Crete que vous avez : cela vaut bien mieux que toutes les richesses du monde. Lavez-vous & vous désaltérez à la fontaine d'Ennéacrune ; portez hiver & été le même habit, & qu'il soit mal-propre, comme il convient à un homme qui vit dans la libre république d'Athènes.
Pour moi en venant dans un pays gouverné par un monarque, je prévoyois bien que je serois exposé à une partie des maux que vous me dépeignez dans votre lettre ; & à présent les Syracusains, les Agrigentins, les Géléens, & en général tous les Siciliens ont pitié de moi, en m'admirant. Pour me punir d'avoir eu la folie de me jetter inconsidérément dans ce malheur, je souhaite d'être accablé toujours de ces mêmes maux, puisqu'étant en âge de raison, & instruit des maximes de la sagesse, je n'ai pu me résoudre à souffrir la faim & la soif, à mépriser la gloire, & à porter une longue barbe.
Je vous enverrai provision de pois, après que vous aurez fait l'Hercule devant les enfans ; parce qu'on dit que vous ne vous faites pas de peine d'en parler dans vos discours & dans vos écrits. Mais, si quelqu'un se mêloit de parler de pois devant Denys, je crois que ce seroit pécher contre les lois de la tyrannie. Du reste, je vous permets d'aller vous entretenir avec Simon le corroyeur, parce que je sais que vous n'estimez personne plus sage que lui : pour moi qui dépends des autres, il ne m'est pas trop permis de vivre en intimité, ni de converser familierement avec des artisans de ce mérite. "
La seconde lettre d'Aristippe, qui est adressée à Arete sa fille, est d'un tout autre ton. Il l'écrivit peu avant que de mourir selon Léon Allatius ; c'est la trente-septieme de son recueil. La voici :
" Télée m'a remis votre lettre, par laquelle vous me sollicitez de faire diligence pour me rendre à Cyrène, parce que vos affaires ne vont pas bien avec les magistrats, & que la grande modestie de votre mari, & la vie retirée qu'il a toujours menée, le rendent moins propre à avoir soin de ses affaires domestiques. Aussi-tôt que j'ai eu obtenu mon congé de Denys, je me suis mis en voyage pour arriver auprès de vous ; mais je suis tombé malade à Lipara, où les amis de Sonicus prennent de moi tous les soins possibles, avec toute l'amitié qu'on peut desirer quand on est près du tombeau.
Quant à ce que vous me demandez, quels égards vous devez à mes affranchis, qui déclarent qu'ils n'abandonneront jamais Aristippe tant qu'il leur restera des forces, mais qu'ils le serviront toujours aussi-bien que vous ; vous pouvez avoir une entiere confiance en eux, car ils ont appris de moi à n'être pas faux. Par rapport à ce qui vous regarde personnellement, je vous conseille de vous mettre bien avec vos magistrats, & cet avis vous sera utile, si vous ne desirez pas trop ; vous ne vivrez jamais plus contente, que quand vous mépriserez le superflu ; car ils ne seront pas assez injustes pour vous laisser dans la nécessité.
Il vous reste deux vergers, qui peuvent vous fournir abondamment de quoi vivre ; & le bien que vous avez en Bernice vous suffiroit, quand vous n'auriez pas d'autre revenu. Ce n'est pas que je vous conseille de négliger les petites choses ; je veux seulement qu'elles ne vous causent ni inquiétude ni tourment d'esprit, qui ne servent de rien, même pour les grands objets. En cas qu'il arrive qu'après ma mort vous souhaitiez de savoir mes sentimens sur l'éducation du jeune Aristippe, rendez-vous à Athènes, & estimez principalement Xantippe & Myrto, qui m'ont souvent prié de vous amener à la célébration des mysteres d'Eléusis ; tandis que vous vivrez agréablement avec elles, laissez les magistrats donner un libre cours à leurs injustices, si vous ne pouvez les en empêcher par votre bonne conduite avec eux. Après tout, ils ne peuvent vous faire tort par rapport à votre fin naturelle.
Tâchez de vous conduire avec Xantippe & Myrto comme je faisois autrefois avec Socrate : conformez-vous à leurs manieres ; l'orgueil seroit mal placé là. Si Tyroclès, fils de Socrate, qui a demeuré avec moi à Mégare, vient à Cyrène, ayez soin de lui, & le traitez comme s'il étoit votre fils. Si vous ne voulez pas alaiter votre fille, à cause de l'embarras que cela vous causeroit, faites venir la fille d'Euboïs, à qui vous avez donné à ma considération le nom de ma mere, & que moi-même j'ai souvent appellée mon amie.
Prenez soin sur-tout du jeune Aristippe pour qu'il soit digne de nous, & de la Philosophie que je lui laisse en héritage réel ; car le reste de ses biens est exposé aux injustices des magistrats de Cyrène. Vous ne me dites pas du-moins que personne ait entrepris de vous enlever à la Philosophie. Réjouissez-vous, ma chere fille, dans la possession de ce trésor, & procurez-en la jouissance à votre fils, que je souhaiterois qu'il fût déja le mien ; mais étant privé de cette consolation, je meurs dans l'assurance que vous le conduirez sur les pas des gens de bien. Adieu ; ne vous affligez pas à cause de moi. " (D.J.)
LETTRES DES MODERNES, (genre epistol.) nos lettres modernes, bien différentes de celles dont nous venons de parler, peuvent avoir à leur louange le style simple, libre, familier, vif & naturel ; mais elles ne contiennent que de petits faits, de petites nouvelles, & ne peignent que le jargon d'un tems & d'un siecle où la fausse politesse a mis le mensonge par-tout : ce ne sont que frivoles complimens de gens qui veulent se tromper, & qui ne se trompent point : c'est un remplissage d'idées futiles de société, que nous appellons devoirs. Nos lettres roulent rarement sur de grands intérêts, sur de véritables sentimens, sur des épanchemens de confiance d'amis, qui ne se déguisent rien, & qui cherchent à se tout dire ; enfin elles ont presque toutes une espece de monotonie, qui commence & qui finit de même.
Ce n'est pas parmi nous qu'il faut agiter la question de Plutarque, si la lecture d'une lettre peut être différée : ce délai fut fatal à César & à Archias, tyran de Thèbes ; mais nous ne manions point d'assez grandes affaires pour que nous ne puissions remettre sans péril l'ouverture de nos paquets au lendemain.
Quant à nos lettres de correspondance dans les pays étrangers, elles ne regardent presque que des affaires de Commerce ; & cependant en tems de guerre, les ministres qui ont l'intendance des postes, prennent le soin de les décacheter & de les lire avant nous. Les Athéniens, dans de semblables conjonctures, respecterent les lettres que Philippe écrivoit à Olympie ; mais nos politiques ne seroient pas si délicats : les états, disent-ils avec le duc d'Albe, ne se gouvernent point par des scrupules.
Au reste, on peut voir au mot EPISTOLAIRE, un jugement sur quelques recueils de lettres de nos écrivains célebres ; j'ajouterai seulement qu'on en a publié sous le nom d'Abailard & d'Héloïse, & sous celui d'une religieuse portugaise, qui sont de vives peintures de l'amour. Nous avons encore assez bien réussi dans un nouveau genre de lettres, moitié vers, moitié prose : telle est la lettre dans laquelle Chapelle fait un récit de son voyage de Montpellier, & celle du comte de Pléneuf de celui de Danemarck : telles sont quelques lettres d'Hamilton, de Pavillon, de la Fare, de Chaulieu, & sur-tout celles de M. de Voltaire au roi de Prusse.
LETTRE DE RECOMMANDATION, (style épist.) c'est le coeur, c'est l'intérêt que nous prenons à quelqu'un, qui dicte ces sortes de lettres ; & c'est ici que Cicéron est encore admirable : si ses autres lettres montrent son esprit & ses talens, celles-ci peignent sa bienfaisance & sa probité. Il parle, il sollicite pour ses amis avec cette chaleur & cette force d'expression dont il étoit si bien le maître, & il apporte toujours quelque raison décisive, ou qui lui est personnelle dans l'affaire & dans le sujet qu'il recommande, au point que finalement son honneur est intéressé dans le succès de la chose qu'il requiert avec tant de vivacité.
Je ne connois dans Horace qu'une seule lettre de recommandation ; c'est celle qu'il écrit à Tibere en 731, pour placer Septimius auprès de lui dans un voyage que ce jeune prince alloit faire à la tête d'une armée pour visiter les provinces d'Orient.
La recommandation eut son effet ; Septimius fut agréé de Tibere, qui lui donna beaucoup de part dans sa bienveillance, & le fit ensuite connoître d'Auguste, dont il gagna bien-tôt l'affection. Une douzaine de lignes d'Horace porterent son ami aussi loin que celui-ci pouvoit porter ses espérances : aussi est-il difficile d'écrire en si peu de mots une lettre de recommandation, où le zele & la retenue se trouvent alliés avec un plus sage tempérament ; le lecteur en jugera : voici cette lettre.
" Septimius est apparemment le seul informé de la part que je puis avoir à votre estime, quand il me conjure, ou plutôt quand il me force d'oser vous écrire, pour vous le recommander comme un homme digne d'entrer dans la maison d'un prince qui ne veut auprès de lui que d'honnêtes gens. Quand il se persuade que vous m'honorez d'une étroite familiarité, il faut qu'il ait de mon crédit une plus haute idée que je n'en ai moi-même. Je lui ai allégué bien des raisons pour me dispenser de remplir ses desirs ; mais enfin j'ai appréhendé qu'il n'imaginât que la retenue avoit moins de part à mes excuses que la dissimulation & l'intérêt. J'ai donc mieux aimé faire une faute, en prenant une liberté qu'on n'accorde qu'aux courtisans les plus assidus, que de m'attirer le reproche honteux d'avoir manqué aux devoirs de l'amitié. Si vous ne trouvez pas mauvais que j'aye pris cette hardiesse, par déférence aux ordres d'un ami, je vous supplie de recevoir Septimius auprès de vous, & de croire qu'il a toutes les belles qualités qui peuvent lui faire mériter cet honneur ". Epist. jx. l. I.
Je tiens pour des divinités tutélaires ces hommes bien nés, qui s'occupent du soin de procurer la fortune & le bonheur de leurs amis. Il est impossible, au récit de leurs services généreux, de ne pas sentir un plaisir secret, qui s'empare de nos coeurs hors même que nous n'y avons pas le moindre intérêt. On éprouvera sans doute cette sorte d'émotion à la lecture de la lettre suivante, où Pline le jeune recommande un de ses amis à Maxime de la maniere du monde la plus pressante & la plus honnête. L'on voudroit même, après l'avoir lue, que cet aimable écrivain nous eût appris la réussite de sa recommandation, comme nous avons sû le succès de celle d'Horace : voici cette lettre en françois ; c'est la seconde du troisieme livre.
Pline à Maxime. " Je crois être en droit de vous demander pour mes amis ce que je vous offrirois pour les vôtres si j'étois à votre place. Arrianus Maturius tient le premier rang parmi les Altinates. Quand je parle de rangs, je ne les regle pas sur les biens de la fortune dont il est comblé, mais sur la pureté des moeurs, sur la justice, sur l'intégrité, sur la prudence. Ses conseils dirigent mes affaires, & son goût préside à mes études ; il a toute la droiture, toute la sincérité, toute l'intelligence qui se peut desirer. Il m'aime autant que vous m'aimez vous-même, & je ne puis rien dire de plus. Il ne connoît point l'ambition ; il s'est tenu dans l'ordre des chevaliers, quoiqu'aisément il eût pû monter aux plus grandes dignités. Je voudrois de toute mon ame le tirer de l'obscurité où le laisse sa modestie, ayant la plus forte passion de l'élever à quelque poste éminent sans qu'il y pense, sans qu'il le sache, & peut-être même sans qu'il y consente ; mais je veux un poste qui lui fasse beaucoup d'honneur, & lui donne peu d'embarras. C'est une faveur que je vous demande avec vivacité, à la premiere occasion qui s'en présentera : lui & moi nous en aurons une parfaite reconnoissance ; car quoiqu'il ne cherche point ces sortes de graces, il les recevra comme s'il les avoit ambitionnées. Adieu ".
Si quelqu'un connoît de meilleurs modeles de lettres de recommandation dans nos écrits modernes, il peut les ajoûter à cet article.
LETTRE GEMINEE, (Art numismat.) les lettres géminées dans les inscriptions & les médailles, marquent toujours deux personnes : c'est ainsi qu'on y trouve COSS. pour les deux consuls, IMPP. pour deux empereurs, AUGG. pour deux Augustes, & ainsi de toute autre médaille ou inscription. Quand il y avoit trois personnes de même rang, on triploit les lettres en cette sorte, IMPPP. AUGGG. & les monétaires avoient sur ce sujet des formules invariables. (D.J.)
LETTRES, (Jurisprud.) ce terme, usité dans le droit & dans la pratique de la chancellerie & du palais, a plusieurs significations différentes ; il signifie souvent un acte rédigé par écrit au châtelet de Paris & dans plusieurs autres tribunaux. On dit donner lettres à une partie d'une déclaration faite par son adversaire ; c'est-à-dire lui en donner acte ; ou, pour parler plus clairement, c'est lui donner un écrit authentique, qui constate ce que l'autre partie a dit ou fait.
Quelquefois lettres signifie un contrat.
LETTRES D'ABREVIATION D'ASSISES, sont des lettres de chancellerie usitées pour la province d'Anjou, qui dispensent le seigneur de faire continuer ses assises dans sa terre, & lui permettent de les faire tenir dans la ville la plus prochaine par emprunt de territoire. La forme de ces lettres se trouve dans le style de la chancellerie par de Pimont. (A)
LETTRES D'ABOLITION, sont des lettres de chancellerie scellées du grand sceau, par lesquelles le roi, par la plénitude de sa puissance, abolit le crime commis par l'impétrant ; sa majesté déclare être bien informée du fait dont il s'agit, sans même qu'il soit énoncé dans les lettres qu'elle entend que le crime soit entierement aboli & éteint, & elle en accorde le pardon, de quelque maniere que le fait soit arrivé, sans que l'impétrant puisse être inquiété à ce sujet.
Lorsque ces lettres sont obtenues avant le jugement, elles lient les mains au juge, & elles effacent le crime de maniere qu'il ne reste aucune note d'infamie, ainsi que l'enseigne Julius Clarus, lib. sentent. tractatu de injuriâ ; au lieu que si elles ne sont obtenues qu'après le jugement, elles ne lavent point l'infamie : c'est en ce sens que l'on dit ordinairement quos princeps absolvit, notat.
L'ordonnance de 1670 porte que les lettres d'abolition seront entérinées si elles sont conformes aux charges.
L'effet de ces sortes de lettres est plus étendu que celui des lettres de rémission ; en ce que celles-ci contiennent toujours la clause, s'il est ainsi qu'il est exposé, au lieu que par les lettres d'abolition, le roi pardonne le crime de quelque maniere qu'il soit arrivé.
Il y a des lettres d'abolition générales qui s'accordent à une province entiere, à une ville, à un corps & à une communauté, & d'autres particulieres qui ne s'accordent qu'à une seule personne.
On ne doit point accorder de lettres d'abolition ni de rémission pour les duels ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs qu'à leurs complices, ni à ceux qui ont procuré l'évasion des prisonniers détenus pour crime, ni pour rapt de violence, ni à ceux qui ont excédé quelque officier de justice dans ses fonctions.
L'impétrant n'est pas recevable à présenter ses lettres d'abolition qu'il ne soit prisonnier & écroué pendant l'instruction, & jusqu'au jugement définitif ; il doit les présenter comme les autres lettres de grace à l'audience, nue tête & à genoux, & affirmer qu'elles contiennent vérité. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. xvj. (A)
LETTRES D'ACQUITPATENT. Voyez ACQUITPATENT.
LETTRES D'AFFRANCHISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, pour des causes particulieres, affranchit & exempte les habitans d'une ville, bourg ou village des tailles, ou autres impositions & contributions auxquelles ils étoient naturellement sujets. (A)
LETTRES D'AMORTISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, moyennant une certaine finance, accorde à des gens de main morte la permission d'acquérir, ou conserver & posséder des héritages sans qu'ils soient obligés d'en vuider leurs mains, les gens de main morte ne pouvant posseder aucuns héritages sans ces lettres. Voyez AMORTISSEMENT & MAIN-MORTE. (A)
LETTRES D'AMNISTIE, sont des lettres patentes qui contiennent un pardon général accordé par le roi à des peuples qui ont exercé des actes d'hostilité, ou qui se sont révoltés. (A)
LETTRES D'AMPLIATION DE REMISSION, sont des lettres de chancellerie que l'on accorde à celui qui a déja obtenu des lettres de remission pour un crime, lorsque dans ces premieres il a omis quelque circonstance qui pourroit causer la nullité des premieres lettres. Par les lettres d'ampliation on rappelle ce qui avoit été omis, & le roi ordonne que les premieres lettres ayent leur effet, nonobstant les circonstances qui avoient été oubliées. (A)
LETTRES D'ANNOBLISSEMENT, ou LETTRES DE NOBLESSE, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi, de sa grace spéciale, annoblit un roturier & toute sa postérité, à l'effet de jouir par l'impétrant & ses descendans, des droits, priviléges, exemptions & prérogatives des nobles.
Ces sortes de lettres sont expédiées par un secrétaire d'état, & scellées de cire verte.
Elles doivent être registrées au parlement, à la chambre des comptes & à la cour des aides. Voyez NOBLESSE. (A)
LETTRES D'ANTICIPATION, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d'ajourner ou anticiper l'appellant sur son appel. Voyez ANTICIPATION & ANTICIPER. (A)
LETTRES D'APPEL, qu'on appelle plus communément relief d'appel, sont des lettres de petit sceau, portant mandement au premier huissier ou sergent sur ce requis, d'ajourner à certain & compétent jour en la cour un tel, pour procéder sur l'appel que l'impétrant a interjetté ou qu'il interjette par lesdites lettres, de la sentence rendue avec celui qu'il fait ajourner pour procéder sur son appel. Voyez APPEL & RELIEF D'APPEL. (A)
LETTRES APOSTOLIQUES sont les lettres des papes ; on les appelle plus communément depuis plusieurs siecles, rescrits, bulles, brefs. Voyez BREFS, BULLES, DECRETALES, RESCRITS. (A)
LETTRES D'APPEL COMME D'ABUS, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d'assigner au parlement sur un appel comme d'abus. Elles doivent être libellées & contenir sommairement les moyens d'abus, avec le nom des trois avocats qui ont donné leur consultation pour interjetter cet appel, & la consultation doit être attachée aux lettres. Voyez ABUS & APPEL COMME D'ABUS. (A)
LETTRES POUR ARTICULER FAITS NOUVEAUX. Avant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevoit point de faits nouveaux, soit d'un appellant en cause d'appel, ou en premiere instance, sans lettres royaux, comme en fait de rescision & restitution en entier ; mais par l'art. XXVI. du tit. xj. de l'ordonnance de 1667, il est dit qu'il ne sera expédié à l'avenir aucunes lettres pour articuler nouveaux faits, mais que les faits seront posés par une simple requête, qui sera signifiée & jointe au procès, sauf au défendeur à y répondre par une autre requête. (A)
LETTRES D'ASSIETTE, sont des lettres de chancellerie, qui ordonnent aux trésoriers de France d'asseoir & imposer sur chaque habitant la part qu'il doit supporter d'une somme qui est dûe par la communauté. On leve de cette maniere les dépenses faites pour la communauté, pour des réparations & autres dépenses publiques, & les condamnations de dépens, dommages & intérêts obtenues contre une communauté d'habitans.
Les commissaires départis par le roi dans les provinces, peuvent, en vertu de leur ordonnance seule, faire l'assiette des sommes qui n'excedent pas 150 liv. mais au-dessus de cette somme, il faut des lettres de chancellerie, ou un arrêt du conseil pour faire l'assiette. (A)
LETTRES D'ATTACHE sont des lettres qui sont jointes & attachées à d'autres pour les faire mettre à exécution. Ces lettres sont de plusieurs sortes.
Il y en a qui émanent du Roi, telles que les lettres d'attache que l'on obtient en grande chancellerie pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume des bulles du pape, ou quelque ordonnance d'un chef d'ordre établi dans le royaume, sans quoi ces lettres n'auroient point d'effets.
On comprend aussi quelquefois sous les termes généraux de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui s'obtiennent, soit en la grande ou en la petite chancellerie, pour pouvoir mettre à exécution un jugement dans l'étendue d'une autre jurisdiction que celle où il a été rendu.
Les commissions que les cours & autres tribunaux font expédier sous leur sceau pour l'exécution de quelques ordonnances ou arrêts, ou autres jugemens, sont aussi considérées comme des lettres d'attache.
Enfin, on regarde encore comme des lettres d'attache les ordonnances que donne un gouverneur de province, ou à son défaut le lieutenant de roi, ou le commandant pour faire mettre à exécution les ordres du Roi qui lui sont présentés. (A)
LETTRES D'ATTRIBUTION sont des lettres patentes du grand sceau, qui attribuent à un tribunal la connoissance de certaines contestations qui, sans ces lettres, auroient dû être portées devant d'autres juges.
On appelle aussi lettres d'attribution de jurisdiction des lettres du petit sceau, qui s'obtiennent par un poursuivant criées, lorsqu'il y a des héritages saisis réellement, situés en différentes jurisdictions du ressort d'un même parlement. Ces lettres, dont l'objet est d'éviter à frais, s'accordent après que les criées des biens saisis ont été vérifiées par les juges des lieux. Elles autorisent le juge du lieu où la plus grande partie des héritages est située, à procéder à la vente & adjudication par decret de la totalité des biens saisis. Voyez CRIEES, DECRET, SAISIE REELLE. (A)
LETTRES AVOCATOIRES sont une ordonnance par laquelle le souverain d'un état rappelle les naturels du pays de chez l'étranger où ils servent. Voyez le traité du droit de la nature par Puffendorf, tome III. liv. VIII. ch. xj. p. 437. (A)
LETTRES DE BACCALAUREAT sont des lettres expédiées par le greffier d'une des facultés d'une université, qui attestent que celui auquel ces lettres ont été accordées, après avoir soutenu les actes probatoires nécessaires, a été décoré du grade de bachelier dans cette faculté. Voy. BACHELIER, DOCTEUR, LICENTIE, LETTRES DE LICENCE. (A)
LETTRES DE BENEFICE D'AGE ou D'EMANCIPATION, sont des lettres du petit sceau que l'on accorde à un mineur qui demande à être émancipé, elles sont adressées au juge ordinaire du domicile, auquel elles enjoignent de permettre à l'impétrant de jouir de ses meubles & du revenu de ses immeubles.
Ces lettres n'ont point d'effet qu'elles ne soient entérinées par le juge, lequel ne procede à cet entérinement que sur un avis des parens & amis du mineur, au cas qu'ils estiment le mineur capable de gouverner ses biens.
On n'accorde guere ces lettres qu'à des mineurs qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on en accorde quelquefois plus tôt, cela dépend des circonstances & de la capacité du mineur. Voyez EMANCIPATION. (A)
LETTRES DE BENEFICE D'INVENTAIRE, sont des lettres du petit sceau par lesquelles le roi permet à un héritier présomptif de se porter héritier par bénéfice d'inventaire, à l'effet de ne point confondre ses créances, & de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'il amende de la succession.
Ces lettres se peuvent obtenir en tout tems, même jusqu'à l'expiration des trente années depuis l'ouverture de la succession, pourvû qu'on n'ait point fait acte d'héritier pur & simple ; & si c'est un collatéral, il faut qu'il n'y ait point d'autre héritier.
En pays de droit écrit, il n'est pas besoin de lettres pour jouir du bénéfice d'inventaire. Voyez BENEFICE D'INVENTAIRE, HERITIER EENEFICIAIRE & INVENTAIRE. (A)
LETTRES DE BOURGEOISIE ; c'étoit un acte dressé par le juge royal ou seigneurial par lequel un particulier non noble, non clerc & non bâtard, qui vouloit jouir des privileges accordés aux personnes libres & de franche condition, étoit reconnu pour bourgeois du roi ou d'un autre seigneur, selon qu'il s'adressoit pour cet effet à l'un ou à l'autre.
L'ordonnance de Philippe le Bel donné au parlement, de la pentecôte 1287, touchant les bourgeoisies, explique ainsi la forme d'obtenir les lettres de bourgeoisie. Quand aucun vouloit entrer en aucune bourgeoisie, il devoit aller au lieu dont il requiéroit être bourgeois, & devoit venir au prevôt du lieu ou à son lieutenant ou au maire des lieux qui reçoivent des bourgeois sans prevôt, & dire à cet officier : " Sire, je vous requiere la bourgeoisie de cette ville, & suis appareillé de faire ce que je dois ". Alors le prevôt ou le maire ou leur lieutenant, en la présence de deux ou de trois bourgeois de la ville, du nom desquels les lettres devoient faire mention, recevoit sureté de l'entrée de la bourgeoisie, & que le (récipiendaire) feroit ou acheteroit, pour raison de la bourgeoisie, une maison dans l'an & jour de la valeur de 60 sols parisis au moins. Cela fait & registré, le prevôt ou le maire donnoit à l'impétrant un sergent pour aller avec lui par devers le seigneur sous lequel il étoit départi, ou devant son lieutenant, pour lui faire savoir que l'impétrant étoit entré en bourgeoisie de telle ville à tel jour & en tel an, ainsi qu'il étoit contenu dans les lettres de bourgeoisie. (A)
LETTRES DE CACHET, appellées aussi autrefois lettres closes ou clauses, lettres du petit cachet ou du petit signet du roi, sont des lettres émanées du souverain, signées de lui, & contresignées d'un secrétaire d'état, écrites sur simple papier, & pliées de maniere qu'on ne peut les lire sans rompre le cachet dont elles sont fermées ; à la différence des lettres appellées lettres patentes qui sont toutes ouvertes, n'ayant qu'un seul repli au-dessous de l'écriture, qui n'empêche point de lire ce qu'elles contiennent.
On n'appelle pas lettres de cachet toutes les lettres missives que le prince écrit selon les occasions, mais seulement celles qui contiennent quelque ordre, commandement ou avis de la part du prince.
La lettre commence par le nom de celui ou ceux auxquels elle s'adresse, par exemple : Monsieur *** (ensuite sont le nom & les qualités) je vous fais cette lettre pour vous dire que ma volonté est que vous fassiez telle chose dans tel tems, si n'y faites faute. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte & digne garde.
La suscription de la lettre est à celui ou ceux à qui ou auxquels la lettre est adressée.
Ces sortes de lettres sont portées à leur destination par quelque officier de police, ou même par quelque personne qualifiée, selon les personnes auxquelles la lettre s'adresse.
Celui qui est chargé de remettre la lettre fait une espece de procès-verbal de l'exécution de sa commission, en tête duquel la lettre est transcrite ; & au bas, il fait donner à celui qui l'a reçûe une reconnoissance comme elle lui a été remise ; ou s'il ne trouve personne, il fait mention des perquisitions qu'il a faites.
L'objet des lettres de cachet est souvent d'envoyer quelqu'un en exil, ou pour le faire enlever & constituer prisonnier, ou pour enjoindre à certains corps politiques de s'assembler & de faire quelque chose, ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer sur certaine matiere. Ces sortes de lettres ont aussi souvent pour objet l'ordre qui doit être regardé dans certaines cérémonies, comme pour le te Deum, processions solemnelles, &c.
Le plus ancien exemple que l'on trouve des lettres de cachet, entant qu'on les emploie pour exiler quelqu'un, est l'ordre qui fut donné par Thierry ou par Brunehaut contre S. Colomban pour le faire sortir de son monastere de Luxeuil, & l'exiler dans un autre lieu pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, quoadusque regalis sententia quod voluisset decerneret. Le saint y fut conduit de force, ne voulant pas y déférer autrement ; mais aussi-tôt que les gardes furent retirés, il revint à son monastere : sur quoi il y eut de nouveaux ordres adressés au comte juge du lieu.
Nos rois sont depuis fort long-tems dans l'usage de se servir de différens sceaux ou cachets selon les lettres qu'ils veulent sceller.
On tient communément que Louis le jeune fut le premier qui, outre le grand sceau royal dont on scelloit dès-lors toutes les lettres patentes, eut un autre scel plus petit, appellé scel du secret, dont il scelloit certaines lettres particulieres qui n'étoient point publiques, comme les lettres patentes. Les lettres scellées de ce scel secret, étoient appellées lettres closes ou encloses dudit scel : il est parlé de ces lettres closes dans des lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean son pere, du 10 Avril 1357. Ce scel secret étoit porté par le grand chambellan, & l'on s'en servoit en l'absence du grand sceau pour sceller les lettres patentes.
Il y eut même un tems où l'on ne devoit apposer le grand sceau à aucunes lettres patentes qu'elles n'eussent été envoyées au chancelier étant closes de ce scel secret, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318. Ce scel secret s'apposoit aussi au revers du grand scel, d'où il fut appellé contre scel, & de-là est venu l'usage des contre-sceaux que l'on appose présentement à la gauche du grand scel ; mais Charles V. dont on a déja parlé, étant régent du royaume, fit le 14 Mai 1358 une ordonnance portant entr'autres choses, que plusieurs lettres patentes avoient été au tems passé scellées du scel secret, sans qu'elles eussent été vûes ni examinées en la chancellerie, il ordonna en conséquence que dorênavant nulles lettres patentes ne seroient scellées pour quelconque cause de ce scel secret, mais seulement les lettres closes. Voyez ordonnances royaux, tome, &c. Ce même prince, étant encore régent du royaume, fit une autre ordonnance le 27 Janvier 1359, portant que l'on ne scelleroit nulles lettres ou cédules ouvertes du scel secret, à moins que ce ne fussent des lettres très-hatives touchant Monsieur ou Nous, & en l'absence du grand scel & du scel du châtelet & non autrement, ni en autre cas ; & que si quelques-unes étoient scellées autrement, l'on n'y obéiroit pas.
Le roi Jean donna, le 3 Novembre 1361, des lettres ou mandement pour faire exécuter les ordonnances qui avoient fixé le prix des monnoies. Lettres scellées du grand scel du roi furent envoyées à tous les baillifs & sénéchaux, dans une boîte scellée du contre-scel du châtelet de Paris, avec des lettres closes du 6 du même mois, scellées du scel secret du roi, par lesquelles il leur étoit ordonné de n'ouvrir la boîte que le 15 Novembre, & de ne publier que ce jour-là les lettres qu'ils y trouveroient. La forme de ces lettres closes étoit telle :
De par le Roi.... bailli de.... nous vous envoyons certaines lettres ouvertes scellées de notre grand scel, encloses en une boîte scellée du contre scel de la prevôté de Paris : si vous mandons que le contenu d'icelles vous fassiez tenir & garder plus diligemment que vous n'avez fait au tems passé, & bien vous gardez que icelle boîte ne soit ouverte, & que lesdites lettres vous ne véez jusqu'au quinzieme jour de ce présent mois de Novembre, auquel jour nous voulons que le contenu d'icelles vous fassiez crier & publier par tout votre bailliage & ressort d'icelui, & non avant. Si gardez si cher comme vous doutez encourre en notre indignation que de ce faire n'ait aucun défaut. Donné à Paris le 6 Novembre 1361. Ainsi signé Collors.
Il y avoit pourtant dès-lors outre le scel secret un autre cachet ou petit cachet du roi, qui est celui dont ces sortes de lettres sont présentement fermées ; c'est pourquoi on les a appellées lettres de cachet ou de petit cachet. Ce cachet du roi étoit autrefois appellé le petit signet : le roi le portoit sur soi, à la différence du scel secret, qui étoit porté par un des chambellans. Le roi appliquoit quelquefois ce petit signet aux lettres patentes, pour faire connoître qu'elles étoient scellées de sa volonté. C'est ce que l'on voit dans des lettres de Philippe VI. du 16 Juin 1349, adressées à la chambre des comptes, à la fin desquelles il est dit : & ce voulons être tenu & gardé.... sans rien faire au contraire pour quelconques prieres que ce soit, ne par lettres se notre petit signet que nous portons n'y étoit plaqué & apparent. On trouve dans les ordonnances de la troisieme race deux lettres closes ou de cachet, du 19 Juillet 1367, l'une adressée au parlement, l'autre aux avocat & procureur général du roi pour l'exécution de lettres patentes du même mois. Ces lettres de cachet qui sont visées dans d'autres lettres patentes du 27 du même mois, sont dites signées de la propre main du roi, sub signeto annuli nostri secreto. Ainsi le petit signet ou cachet, ou petit cachet du roi, étoit alors l'anneau qu'il portoit à son doigt.
L'ordonnance de Charles V. du dernier Février 1378, porte que le roi aura un signet pour mettre ès- lettres, sans lequel nul denier du domaine ne sera payé.
Il est aussi ordonné que les assignations d'arrérages, dons, transports, aliénations, changemens de terre, ventes & compositions de ventes à tems, à vie, à héritage ou à volonté, seront signées de ce signet, & autrement n'auront point d'effet.
Que les gages des gens des comptes seront renouvellés par chacun an par mandement & lettres du roi, signées de ce signet, & ainsi seront payés & non autrement.
Les lettres que le roi adresse à ses cours concernant l'administration de la justice, sont toûjours des lettres patentes & non des lettres closes ou de cachet, parce que ce qui a rapport à la justice, doit être public & connu de tous, & doit porter la marque la plus authentique & la plus solemnelle de l'autorité du roi.
Du Tillet, en son recueil des ord. des rois de France, part. I. p. 416. parle d'une ordonnance de Philippe-le-Long, alors régent du royaume, faite à S. Germain-en-Laie au mois de Juin 1316. (cette ordonnance ne se trouve pourtant pas dans le recueil de celles de la troisieme race) après avoir rapporté ce qui est dit par cette ordonnance sur l'ordre que l'on devoit observer pour l'expédition, signature, & sceau des lettres de justice : il dit que " de cette ordonnance est tirée la maxime reçue, qu'en fait de justice on n'a regard à lettres missives, & que le grand scel du roi y est nécessaire non sans grande raison ; car les chanceliers de France & maîtres des requêtes sont institués à la suite du roi, pour avoir le premier oeil à la justice de laquelle le roi est débiteur ; & l'autre oeil est aux officiers ordonnés par les provinces pour l'administration de ladite justice mêmement souveraine, & faut pour en acquiter la conscience du roi & des officiers de ladite justice, tant près la personne dudit roi, que par ses provinces, qu'ils y apportent tous une volonté conforme à l'intégrité de ladite justice, sans contention d'autorité, ne passion particuliere qui engendrent injustice, provoquent & attirent l'ire de Dieu sur l'universel. Ladite ordonnance, ajoute du Tillet, étoit sainte ; & par icelle les rois ont montré la crainte qu'ils avoient qu'aucune injustice se fît en leur royaume, y mettant l'ordre susdit pour se garder de surprise en cet endroit, qui est leur principale charge ".
Il y a même plusieurs ordonnances qui ont expressément défendu à tous juges d'avoir aucun égard aux lettres closes ou de cachet qui seroient accordées sur le fait de la justice.
La premiere est l'ordonnance d'O léans, art. 3.
La seconde est l'ordonnance de Blois, art. 281.
La troisieme est l'ordonnance de Moulins, qui est encore plus générale & plus précise sur ce sujet ; sur quoi on peut voir dans Néron les remarques tirées de M. Pardoux du Prat, savoir que pour le fait de la justice, les lettres doivent absolument être patentes, & que l'on ne doit avoir en cela aucun égard aux lettres closes. Voyez aussi Theveneau, liv. III. tit. 15. article 2.
On trouve néanmoins quelques lettres de cachet registrées au parlement ; mais il s'agissoit de lettres qui ne contenoient que des ordres particuliers & non de nouveaux réglemens. On peut mettre dans cette classe celle d'Henri II. du 3 Décembre 1551, qui fut registrée au parlement le lendemain, & dont il est fait mention dans le traité de la police, tome I. livre I. chap. ij. page 133. col. premiere. Le roi dit dans cette lettre, qu'ayant fait examiner en son conseil les ordonnances sur le fait de la police, il n'avoit rien trouvé à y ajouter ; il mande au parlement d'y tenir la main, &c.
La déclaration du roi, du 24 Février 1673, porte que les ordonnances, édits, déclarations, & lettres-patentes, concernant les affaires publiques, soit de justice ou de finances, émanées de la seule autorité & propre mouvement du roi, sans parties qui seront envoyées à son procureur général avec ses lettres de cachet portant ses ordres pour l'enregistrement, seront présentées par le procureur général en l'assemblée des chambres avec lesdites lettres de cachet.
Lorsqu'un homme est détenu prisonnier en vertu d'une lettre de cachet, on ne reçoit point les recommandations que ses créanciers voudroient faire, & il ne peut être retenu en prison en vertu de telles recommandations. (A)
LETTRES CANONIQUES, étoient la même chose que les lettres commendatices ou pacifiques. Voyez ci après ces deux articles. (A)
LETTRES DE CESSION, sont celles qu'un débiteur obtient en chancellerie pour être reçu à faire cession & abandonnement de biens à ses créanciers ; & par ce moyen se mettre à couvert de leurs poursuites. Voyez ABANDONNEMENT, BENEFICE DE CESSION, CESSION. (A)
LETTRES DE CHANCELLERIE, qu'on appelle aussi lettres royaux, sont toutes les lettres émanées du souverain, & qui s'expédient en la chancellerie en France : il y en a de plusieurs sortes ; les unes qui s'expédient en la grande chancellerie de France, & que l'on appelle par cette raison lettres de grande chancellerie, ou lettres du grand sceau ; les autres qu'on appelle lettres de petite chancellerie, ou du petit sceau, lesquelles s'expédient dans les chancelleries établies près les cours ou près des présidiaux.
Toutes les lettres de grande ou de petite chancellerie, sont de justice ou de grace. Elles sont réputées surannées un an après la date de leur expédition. Voyez SURANNATION. (A)
LETTRE DE CHANGE, est une espece de mandement qu'un banquier, marchand ou négociant donne à quelqu'un pour faire payer dans une autre ville à celui qui sera porteur de ce mandement la somme qui y est exprimée.
Pour former une lettre de change, il faut que trois choses concourent.
1°. Que le change soit réel & effectif, c'est-à-dire, que la lettre soit tirée d'une place pour être payée dans une autre. Ainsi une lettre tirée de Paris sur Paris, n'est qu'un mandement ordinaire & non une véritable lettre de change.
2°. Il faut que le tireur, c'est-à-dire celui qui donne cette lettre, ait une somme pareille à celle qu'il reçoit entre les mains de la personne sur laquelle il tire ce mandement, ou bien qu'il le tire sur son crédit ; autrement ce ne seroit qu'un simple mandement ou rescription.
3°. Il faut que la lettre de change soit faite dans la forme prescrite par l'article premier, du tit. V. de l'ordonnance du mois de Mars 1673, qu'elle porte valeur reçue soit en deniers, marchandises, ou autres effets. C'est ce qui distingue les lettres de change des billets de change qui ne sont point pour valeur fournie en deniers, marchandises, ou autres effets, mais pour lettres de change fournies ou à fournir.
La forme la plus ordinaire d'une lettre de change est telle.
" A Paris, ce premier Janvier 1756.
Monsieur,
A vue il vous plaira payer par cette premiere de change à M. Siméon ou à son ordre, la somme de deux mille livres, valeur reçue comptant dudit sieur, ou d'un autre dont on exprime le nom, & mettez à compte, comme par l'avis, &c. "
Le contrat qui se forme par ces lettres entre les différentes personnes qui y ont part, n'a pas été connu des anciens ; car ce qui est dit au digeste de eo quod certo loco dari oportet, & dans plusieurs lois au sujet de ceux que l'on appelloit numularii, argentarii, & trapesitae, n'a point de rapport avec le change de place en place par lettres, tel qu'il se pratique présentement.
Les anciens ne connoissoient d'autre change que celui d'une monnoie contre une autre ; ils ignoroient l'usage de changer de l'argent contre des lettres.
On est fort incertain du tems où cette maniere de commercer a commencé, aussi-bien que de ceux qui en ont été les inventeurs.
Quelques auteurs, tel que Giovan Villani, en son histoire universelle, & Savary dans son parfait négociant, attribuent l'invention des lettres de change aux Juifs qui furent bannis du royaume.
Sous le regne de Dagobert I. en 640, sous Philippe Auguste, en 1181, & sous Philippe le Long, en 1316, ils tiennent que ces Juifs s'étant retirés en Lombardie, pour y toucher l'argent qu'ils avoient déposé en sortant de France entre les mains de leurs amis, ils se servirent de l'entremise des voyageurs & marchands étrangers qui venoient en France, auxquels ils donnerent des lettres en style concis, à l'effet de toucher ces deniers.
Cette opinion est refutée par de la Serra, tant parce qu'elle laisse dans l'incertitude de savoir si l'usage des lettres de change a été inventé dès l'an 640, ou seulement en 1316, ce qui fait une différence de plus de 600 ans, qu'à cause que le bannissement des Juifs étant la punition de leurs rapines & de leurs malversations, leur ayant attiré la haine publique, cet auteur ne présume pas que quelqu'un voulût se charger de leur argent en dépôt, les assister & avoir commerce avec eux, au préjudice des défenses portées par les ordonnances.
Il est cependant difficile de penser que les Juifs n'ayent pas pris des mesures pour recupérer en Lombardie la valeur de leurs biens ; ce qui ne se pouvoit faire que par le moyen des lettres de change. Ainsi il y a assez d'apparence qu'ils en furent les premiers inventeurs.
Les Italiens Lombards qui commerçoient en France, ayant trouvé cette invention propre à couvrir leurs usures, introduisirent aussi en France l'usage des lettres de change.
De Rubys, en son histoire de la ville de Lyon, page 289, attribue cette invention aux Florentins spécialement, lesquels, dit-il, ayant été chassés de leur pays par les Gibelins, se retirerent en France, où ils commencerent, selon lui, le commerce des lettres de change, pour tirer de leur pays, soit le principal, soit le revenu de leurs biens. Cette opinion est même celle qui paroît la plus probable à de la Serra, auteur du traité des lettres de change.
Il est à croire que cet usage commença dans la ville de Lyon, qui est la ville de commerce la plus proche de l'Italie : & en effet, la place où les marchands s'assemblent dans cette ville pour y faire leurs négociations de lettres de change, & autres semblables, s'appelle encore la place du change.
Les Gibelins chassés d'Italie par la faction des Guelphes, s'étant retirés à Amsterdam, se servirent aussi de la voie des lettres de change pour retirer les effets qu'ils avoient en Italie ; ils établirent donc à Amsterdam le commerce des lettres de change, qu'ils appellerent polizza di cambio. Ce furent eux pareillement qui inventerent le rechange, quand les lettres qui leur étoient fournies revenoient à protêt, prenant ce droit par forme de dommages & intérêts. La place des marchands à Amsterdam, est encore appellée aujourd'hui la place Lombarde, à cause que les Gibelins s'assembloient en ce lieu pour y exercer le change : les négocians d'Amsterdam répandirent dans toute l'Europe le commerce des lettres de change par le moyen de leurs correspondans, & particulierement en France.
Ainsi les Juifs retirés en Lombardie, ont probablement inventé l'usage des lettres de change, & les Italiens & négocians d'Amsterdam en ont établi l'usage en France.
Ce qui est de certain, c'est que les Italiens & particulierement les Génois & les Florentins étoient dans l'habitude, dès le commencement du xiij. siecle, de commercer en France, & de fréquenter les foires de Champagne & de Lyon, tellement que Philippe le bel fit en 1294 une convention avec le capitaine & les corps de ces marchands & changeurs italiens, contenant que de toutes les marchandises qu'ils acheteroient & vendroient dans les foires & ailleurs, il seroit payé au roi un denier par le vendeur & un par l'acheteur ; & que pour chaque livre de petits tournois, à quoi monteroient les contrats de change qu'ils feroient dans les foires de Champagne & de Brie, & dans les villes de Paris & de Nismes, ils payeroient une pite. Cette convention fut confirmée par les rois Louis Hutin, Philippe de Valois, Charles V. & Charles VI.
On voit aussi que dès le commencement du xiv. siecle il s'étoit introduit dans le royaume beaucoup de florins, qui étoient la monnoie de Florence ; ce qui provenoit, sans doute, du commerce que les florentins & autres italiens faisoient dans le royaume.
Mais comme il n'étoit pas facile aux florentins & autres italiens de transporter de l'argent en France pour payer les marchandises qu'ils y achetoient, ni aux françois d'en envoyer en Italie pour payer les marchandises qu'ils tiroient d'Italie, ce fut ce qui donna lieu aux florentins, & autres italiens d'inventer les lettres de change, par le moyen desquelles on fit tenir de l'argent d'un lieu dans un autre sans le transporter.
Les anciennes ordonnances font bien quelque mention de lettres de change, mais elles n'entendent par là que les lettres que le roi accordoit à certaines personnes pour tenir publiquement le change des monnoies ; & dans les lettres-patentes de Philippe de Valois, du 6 Août 1349, concernant les privileges des foires de Brie & de Champagne, ce qui est dit des lettres passées dans ces foires ne doit s'entendre que des obligations & contrats qui étoient passés sous le scel de ces foires, soit pour prêt d'argent, soit pour vente de marchandises, mais on n'y trouve rien qui dénote qu'il fût question de lettres tirées de place en place, qui est ce qui caractérise essentiellement les lettres de change.
La plus ancienne ordonnance que j'aie trouvé où il soit véritablement parlé de ces sortes de lettres, c'est l'édit du roi Louis XI. du mois de Mars 1462, portant confirmation des foires de Lyon. L'article 7 ordonne que comme dans les foires les marchands ont accoutumé user de changes, arriere-changes & intérêts, toutes personnes, de quelqu'état, nation ou condition qu'ils soient, puissent donner, prendre & remettre leur argent par lettres de change, en quelque pays que ce soit, touchant le fait de marchandise, excepté la nation d'Angleterre, &c.
L'article suivant ajoute que si à l'occasion de quelques lettres touchant les changes faits ès foires de Lyon pour payer & rendre argent autre part ou des lettres qui seroient faites ailleurs pour rendre de l'argent auxdites foires de Lyon, lequel argent ne seroit pas payé selon lesdites lettres, en faisant aucune protestation ainsi qu'ont accoutumé de faire les marchands fréquentant les foires, tant dans le royaume qu'ailleurs, qu'en ce cas ceux qui seront tenus de payer ledit argent tant pour le principal que pour les dommages & intérêts, y seront contraints, tant à cause des changes, arriere-changes, qu'autrement, ainsi qu'on a coutume de faire ès foires de Pezenas, Montignac, Bourges, Genève, & autres foires du royaume.
On voit par ces dispositions que les lettres de change tirées de place en place étoient déja en usage, nonseulement à Lyon, mais aussi dans les autres foires & ailleurs.
La jurisdiction consulaire de Toulouse, établie en 1549, celle de Paris établie en 1563, & les autres qui ont été ensuite établies dans plusieurs autres villes du royaume, ont entr'autres choses pour objet de connoître du fait des lettres de change entre marchands.
L'ordonnance de 1673 pour le Commerce, est la premiere qui ait établi des regles fixes & invariables pour l'usage des lettres de change ; c'est ce qui fait l'objet du titre V, intitulé des lettres & billets de change & des promesses d'en fournir ; & du titre 6, des intérêts du change & rechange.
L'usage des lettres de change n'a d'abord été introduit que parmi les marchands, banquiers & négocians, pour la facilité du Commerce qu'ils font, soit avec les provinces, soit dans les pays étrangers. Il a été ensuite étendu aux receveurs des tailles, receveurs généraux des finances, fermiers du roi, traitans, & autres gens d'affaire & de finance, à cause du rapport qu'il y a entr'eux & les marchands & négocians pour retirer des provinces les deniers de leur recette, au lieu de les faire voiturer ; & comme ces sortes de personnes négocient leur argent & leurs lettres de change, ils deviennent à cet égard justiciables de la jurisdiction consulaire.
Les personnes d'une autre profession qui tirent, endossent ou acceptent des lettres de change, deviennent pareillement justiciables de la jurisdiction consulaire, & même soumis à la contrainte par corps ; c'est pourquoi il ne convient point à ceux qui ont des bienséances à garder dans leur état, de tirer, endosser ou accepter des lettres de change ; mais toutes sortes de personnes peuvent sans aucun inconvénient être porteurs d'une lettre de change tirée à leur profit.
Les ecclésiastiques ne peuvent se mêler du commerce des lettres de change : les lettres qu'ils adressent à leurs fermiers ou receveurs ne sont que de simples rescriptions ou mandemens qui n'emportent point de contrainte par corps, quoique ces mandemens aient été négociés.
Il se forme, par le moyen d'une lettre de change un contrat entre le tireur & celui qui donne la valeur ; le tireur s'oblige de faire payer le montant de la lettre de change.
Il entre même dans ce contrat jusqu'à quatre personnes ou du-moins trois, savoir celui qui en fournit la valeur, le tireur, celui sur qui la lettre de change est tirée & qui doit l'acquittement, & celui à qui elle est payable ; mais ces deux derniers ne contractent aucune obligation envers le tireur, & n'entrent dans le contrat que pour l'exécution, quoique suivant les cas ils puissent avoir des actions pour l'exécution de la convention.
Le contrat qui se forme par le moyen d'une lettre de change n'est point un prêt, c'est un contrat du droit des gens & de bonne foi, un contrat nommé contrat de change : c'est une espece d'achat & vente de même que les cessions & transports, car celui qui tire la lettre de change, vend, cede & transporte la créance qu'il a sur celui qui la doit payer.
Ce contrat est parfait par le seul consentement, comme l'achat & la vente ; tellement que lorsqu'on traite d'un change pour quelque payement ou foire dont l'échéance est éloignée, il peut arriver que l'on ne délivre pas pour lors la lettre de change ; mais pour la preuve de la convention, il faut qu'il y ait un billet portant promesse de fournir la lettre de change, ce billet est ce que l'on appelle billet de change, lequel, comme l'on voit, est totalement différent de la lettre même ; & si la valeur de la lettre de change n'a pas non plus été fournie, le billet de change doit être fait double, afin de pouvoir prouver respectivement le consentement.
Les termes ou échanges des payemens des lettres de change, sont de cinq sortes.
La premiere est des lettres payables à vûe ou à volonté : celles-ci doivent être payées aussi-tôt qu'elles sont présentées.
La seconde est des lettres payables à tant de jours de vûe : en ce cas le délai ne commence à courir que du jour que la lettre a été présentée.
La troisieme est des lettres payables à tant de jours d'un tel mois, & alors l'échéance est déterminée par la lettre même.
La quatrieme est à une ou plusieurs usances, qui est un terme déterminé par l'usage du lieu où la lettre de change doit être payée, & qui commence à courir ou du jour de la date de la lettre de change ou du jour de l'acceptation, il est plus long ou plus court, suivant l'usage de chaque place. En France les usances sont fixées à trente jours par l'ordonnance du Commerce, titre V, ce qui a toujours lieu, encore que les mois ayent plus ou moins de trente jours ; mais dans les places étrangeres il y a beaucoup de diversité. A Londres, par exemple, l'usance des lettres de France est du mois de la date ; en Espagne deux mois ; à Venise, Gènes & Livourne trois mois, & ainsi des autres pays : on peut voir à ce sujet le parfait négociant de Savary.
La cinquieme espece de terme pour les lettres de change est en payemens ou aux foires, ce qui n'a lieu que pour les places où il y a des foires établies, comme à Lyon, Francfort & autres endroits, & ce tems est déterminé par les réglemens & statuts de ces foires.
Les lettres de change doivent contenir sommairement le nom de ceux auxquels le contenu doit en être payé, le tems du payement, le nom de celui qui en a donné la valeur, & expliquer si cette valeur a été fournie en deniers, marchandises ou autres effets.
Toutes lettres de change doivent être acceptées par écrit purement & simplement ; les acceptations verbales & celles qui se faisoient en ces termes, vû sans accepter, ou accepté pour répondre à tems, & toutes autres acceptations sous conditions, ont été abrogées par l'ordonnance du Commerce, & passent présentement pour des refus, en conséquence desquels on peut faire protester les lettres.
En cas de protest d'une lettre de change, elle peut être acquittée par tout autre que celui sur qui elle a été tirée, & au moyen du payement il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation ni ordre.
Les porteurs de lettres de change qui ont été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, sont tenus, suivant l'ordonnance, de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance ; mais la déclaration du 10 Mai 1686 a reglé que les dix jours accordés par le protêt des lettres & billets de change ne seront comptés que du lendemain de l'échéance des lettres & billets, sans que le jour de l'échéance y puisse être compris, mais seulement celui du protêt, des dimanches & des fêtes mêmes solemnelles qui y seront compris.
La ville de Lyon a sur cette matiere un réglement particulier du 2 Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a point dérogé.
Après le protêt, celui qui a accepté la lettre peut être poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur.
Les porteurs peuvent aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui ont tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles aient été acceptées, même les effets de ceux sur lesquels elles ont été tirées, en cas qu'ils les ayent acceptées.
Ceux qui ont tiré ou endossé des lettres doivent être poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues & audelà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemens, pour les personnes domiciliées dans le royaume ; & hors d'icelui, les délais sont de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandres ou Hollande ; de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne & les Cantons Suisses ; quatre mois pour l'Espagne, six pour le Portugal, la Suede & le Danemark.
Faute par les porteurs des lettres de change d'avoir fait leurs diligences dans ces délais, ils sont non-recevables dans toute action en garantie contre les tireurs & endosseurs.
En cas de dégénération, les tireurs & endosseurs sont tenus de prouver que ceux sur qui elles étoient tirées leur étoient redevables ou avoient provision au tems qu'elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.
Si depuis le tems reglé pour les protêts les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises, par compte, compensation ou autrement, ils sont aussi tenus de la garantie.
Si la lettre de change, payable à un tel particulier, se trouve adhirée, le payement peut en être fait en vertu d'une seconde lettre sans donner caution, en faisant mention que c'est une seconde lettre, & que la premiere ou autre précédente demeurera nulle. Un arrêt de réglement du 30 Août 1714, décide qu'en ce cas celui qui est porteur de la lettre de change doit s'adresser au dernier endosseur de la lettre adhirée pour en avoir une autre de la même valeur & qualité que la premiere, & que le dernier endosseur, sur la réquisition qui lui en sera faite par écrit, doit prêter ses offres auprès du précédent endosseur, & ainsi en remontant d'un endosseur à un autre jusqu'au tireur, &c.
Si la lettre adhirée est payable au porteur ou à ordre, le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge & en donnant caution.
Au bout de trois ans, les cautions sont déchargées lorsqu'il n'y a point de poursuites.
Les lettres ou billets de change sont réputés acquités après cinq ans de cessation de demande & poursuite, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou derniere poursuite, en affirmant néanmoins, par ceux que l'on prétend en être débiteurs, qu'ils ne sont plus redevables.
Les deux fins de non-recevoir dont on vient de parler ont lieu même contre les mineurs & les absens.
Les signatures au dos des lettres de change ne servent que d'endossement & non d'ordre, s'il n'est daté & ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement.
Les lettres de change endossées dans la forme qui vient d'être dite, appartiennent à celui du nom duquel l'ordre est rempli, sans qu'il ait besoin de transport ni signification.
Au cas que l'endossement ne soit pas dans la forme qui vient d'être expliquée, les lettres sont réputées appartenir à celui qui les a endossées, & peuvent être saisies par ses créanciers, & compensées par ses débiteurs.
Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.
Ceux qui ont mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le Commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs & accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval.
Voyez Scace, De commercis cambiorum ; Dupuy de la Serra en son traité de l'art des lettres de change ; Clarac, en son traité de l'usance du négoce ; le parfait négociant de Savary ; Bornier sur le titre 5. de l'ordonnance du Commerce.
Voyez aussi les mots ACCEPTATION, BILLET DE CHANGE A ORDRE, AU PORTEUR, CHANGE, ENDOSSEMENT, PROTEST, RECHANGE. (A)
LETTRES DE CHARTRE, ou en forme de CHARTRE, sont des lettres de grande chancellerie, qui ordonnent quelque chose pour toûjours. Voyez au mot CHARTRE (lettre de).
LETTRES CLOSES, c'est ainsi que l'on appelloit anciennement ce que nous nommons aujourd'hui lettre de cachet. Voyez LETTRE DE CACHET.
LETTRES EN COMMANDEMENT, sont des lettres de faveur expédiées en grande chancellerie, qui sont contre-signées par un secretaire d'état ; elles sont de deux sortes, les unes, que le secretaire d'état de la province donne toutes signées, & que l'on scelle ensuite ; d'autres qui sont du ressort ou du chancelier ou du garde des sceaux, & qui sont scellées avant d'être signées par le secretaire d'état. (A)
LETTRES COMMENDATICES, litterae commendatitiae, c'est ainsi que dans la pratique de cour d'église, on appelle les lettres de recommandation qu'un supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un, adressantes aux évêques voisins, ou autres supérieurs ecclésiastiques. Les réguliers ne peuvent donner des lettres commendatices ni testimoniales, à des séculiers ni même à des réguliers qui ne sont pas de leur ordre. Mémoires du clergé, tom. 6. p. 1177. (A)
LETTRES DE COMMISSION, sont une commission que l'on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu'un à comparoître dans une cour souveraine, en conséquence de quelque instance qui y est pendante entre d'autres parties, ou pour constituer nouveau procureur, ou reprendre une instance ou procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire contre des héritiers.
On entend aussi par lettres de commission, un pareatis, ou le mandement qui est donné à un juge royal de faire procéder à l'exécution de quelque arrêt, à la fin duquel mandement il est enjoint au premier huissier ou sergent, de mettre à exécution cet arrêt.
LETTRES DE COMMITTIMUS, sont celles que le roi accorde à ses commensaux & autres privilégiés, en vertu desquelles ils peuvent faire renvoyer toutes leurs causes civiles, possessoires & mixtes, devant le juge de leur privilege.
Ces lettres s'obtiennent au grand sceau ou au petit sceau, selon le droit du privilégié. Voyez COMMITTIMUS.
LETTRES COMMUNICATOIRES, étoient la même chose que les lettres commendatices. Voyez LETTRES COMMENDATICES, TTRES PACIFIQUESQUES.
LETTRES DE COMMUTATION DE PEINE, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi commue la peine à laquelle l'accusé étoit condamné, en une autre peine plus douce, comme lorsque la peine de mort est commuée en un bannissement, ou en un certain tems de prison. Voyez l'ordonnance de 1660, tit. XVI. art. 5.
LETTRES DE COMPENSATION, étoient des lettres de chancellerie que l'on obtenoit autrefois dans les pays coutumiers, pour pouvoir opposer la compensation ; présentement il n'est plus d'usage d'en prendre. Voyez COMPENSATION.
LETTRES DE COMPULSOIRE, sont des lettres de chancellerie que l'on obtient pour contraindre le dépositaire d'une piece, de la représenter à l'effet d'en tirer une expédition, ou de faire collation d'une expédition ou copie à l'original. Voyez COMPULSOIRE.
LETTRES DE CONFIRMATION, sont celles par lesquelles le roi confirme l'impétrant dans la jouissance de quelque droit ou privilege qui lui avoit été accordé précédemment.
LETTRES DE CONFORTEMAIN. Voyez CONFORTEMAIN.
LETTRES DE CREANCE, sont des lettres émanées du souverain ou de quelque autre personne constituée en dignité, portant que l'on peut ajouter foi à ce que dira celui qui est muni de ces lettres. Les ambassadeurs plénipotentiaires, envoyés, & autres ministres qui vont dans une cour étrangere, ne partent point sans avoir des lettres de créance ; & la premiere chose qu'ils font lorsqu'on leur donne audience, est de présenter leurs lettres de créance.
On entend aussi quelquefois par lettre de créance, la même chose que par lettre de crédit. Voyez au mot CREANCE, lettre de créance.
LETTRE DE CREDIT. Voyez au mot CREDIT, (Jurisp.) à l'art. LETTRE DE CREDIT.
LETTRES POUR CUMULER LE PETITOIRE AVEC LE POSSESSOIRE. C'étoient des lettres que l'on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler le pétitoire, quoiqu'on ne fût poursuivi qu'au possessoire ; mais l'usage de ces lettres fut défendu par l'ordonnance de Charles VII. en 1453, art. 8. par celle de Louis XII. en 1507, art. 41. François I. en 1535, chap. jx. art. 1. Cette défense a été renouvellée par l'ordonnance de 1667, tit. 18. art. 5.
LETTRES DE DEBITIS. Voyez DEBITIS.
LETTRES DE DECLARATION, ou EN FORME DE DECLARATION, sont des lettres patentes du grand sceau, signées en commandement, par lesquelles le roi explique ses intentions sur l'interprétation de quelque ordonnance ou édit.
On appelle aussi lettres de déclaration : celles que le roi donne à des regnicoles qui ayant été longtems absens, étoient réputés avoir abdiqué leur patrie, & néanmoins sont revenus en France ; ils n'ont pas besoin de lettres de naturalité, parce qu'ils ne sont pas étrangers ; mais il leur faut des lettres de déclaration, pour purger le vice de leur longue absence. On appelle de même lettres de déclaration, celles par lesquelles quelqu'un qui est déja noble, est déclaré tel par le roi, pour prévenir les difficultés qu'on auroit pû lui faire. Ce sont proprement des lettres de confirmation de noblesse. Voyez DECLARATION, ÉDIT, & ci-après LETTRES-PATENTES & ORDONNANCE.
LETTRES DE DENICATION, sont des especes de lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent en Angleterre, à l'effet seulement de posséder des bénéfices. Voyez Basnage, sur l'art. 235. de la coutume de Normandie.
LETTRES DE DEPRECATION, sont des lettres par lesquelles quelqu'un, en vertu d'un privilege particulier, présente un accusé au prince, à l'effet d'obtenir de lui des lettres de grace, s'il y échet.
Ce terme paroît emprunté des Romains, chez lesquels la déprécation étoit la supplication qu'une personne accusée d'homicide involontaire faisoit au sénat, lequel avoit en ce cas le pouvoir d'accorder à l'accusé sa grace.
L'édit du mois de Novembre 1753, qui a réglé l'étendue du privilege dont les évêques d'Orléans jouissent à leur avenement, de faire grace à certains criminels, a réglé que dans les cas où ce privilege peut avoir lieu, l'évêque donnera au criminel des lettres d'intercession & de déprécation, sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grace.
LETTRES DE DESERTION, sont des lettres de chancellerie, que l'intimé obtient à l'effet d'assigner l'appellant, pour voir déclarer son appel desert, faute par lui de l'avoir relevé dans le tems de l'ordonnance. Voyez APPEL, DESERTION ILLICO, LIEF D'APPELPPEL.
LETTRES DE DIACONAT, sont l'acte par lequel un évêque confere à un sous-diacre l'ordre du diaconat. Voyez DIACONAT & DIACRE.
LETTRES DE DISPENSE, sont celles par lesquelles l'impétrant est déchargé de satisfaire à quelque chose que la regle exige.
Le roi accorde en chancellerie des dispenses d'âges, de tems d'étude, & autres semblables.
Le pape, les archevêques & évêques en accordent pour le spirituel, comme des dispenses de ban, de parenté pour les mariages, d'interstice pour les ordres, &c. Voyez DISPENSE.
LETTRES DE DOCTEUR, ou DE DOCTORAT, sont des lettres accordées dans quelque faculté d'une université, qui conferent à un licencié le grade de docteur. Voyez DOCTEUR.
LETTRES DE DON GRATUIT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi permet aux états d'une province de faire don d'une somme au gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à qui Sa Majesté permet de l'accepter. Les ordonnances défendent de faire, ni de recevoir ces sortes de dons, sans la permission du prince.
LETTRES ECCLESIASTIQUES, étoient la même chose que les lettres canoniques ou pacifiques. Voyez ces différens articles. (A)
LETTRES D'ECOLIER JURE sont la même chose que lettres de scholarité. Voyez ECOLIER JURE, GARDE-GARDIENNE, TTRES DE SCHOLARITERITE & SCHOLARITE. (A)
LETTRES D'EMANCIPATION ou DE BENEFICE D'AGE. Voyez ci-devant LETTRES DE BENEFICE D'AGE.
LETTRES POUR ESTER A DROIT, sont des lettres de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui étant in reatu, ont laissé écouler les cinq années sans se présenter & purger leur contumace. Le roi par le bénéfice de ces lettres les releve du tems qui s'est passé, & les reçoit à ester à droit & à se purger des cas à eux imposés, quoiqu'il y ait plus de cinq ans passés, tout ainsi qu'ils auroient pu faire avant le jugement de contumace, à la charge de se mettre en état dans trois mois du jour de l'obtention, lors de la présentation des lettres, de refonder les frais de contumace, de consigner les amendes & les sommes si aucunes ont été adjugées aux parties civiles, & à la charge que foi sera ajoûtée aux témoins recollés & décédés, ou morts civilement pendant la contumace.
Le roi dispense quelquefois par les lettres de consigner les amendes, soit à cause de la pauvreté de l'impétrant, ou par quelqu'autre considération.
On obtient quelquefois des lettres de cette espece même dans les cinq années de la contumace, à l'effet d'être reçu à ester à droit, sans consigner les amendes adjugées au roi. (A)
LETTRES D'ETAT, sont des lettres de grande chancellerie contresignées d'un sécrétaire d'état, que le roi accorde aux ambassadeurs, aux officiers de guerre & autres personnes qui sont absentes pour le service de l'état, par lesquelles le roi ordonne de surseoir toutes les poursuites qui pourroient être faites en justice contr'eux, en matiere civile, durant le tems porté par ces lettres.
Quelques-uns ont prétendu trouver l'origine des lettres d'état jusque dans la loi des 12 tables, art. 40. & 41. où il est dit : Si judex vel alter ex litigatoribus morbo sontico impediatur, judicii dies diffusus esto.
Ulpien dans la loi 2. §. 3. ff. si quis caution. dit que toute sorte de maladies ou d'infirmités qui empêche l'une des parties de poursuivre, arrête aussi le cours des poursuites contre cette même partie.
Mais ce qui est dit à ce sujet, soit dans cette loi ou dans celle des 12 tables, fait proprement la matiere des délais & surséances que le juge peut accorder selon le mérite du procès, l'excuse des parties ou autres causes légitimes.
Ce que dit Tite-Live, liv. II. de son histoire romaine, a plus de rapport aux lettres d'etat. Il parle d'un édit de Pub. Servilius & d'Appius Claudius consuls : ne quis militis donec in castris esset bona possideret aut venderet.
Le jurisconsulte Callistrate en parle aussi fort clairement en la loi 36, au digeste de judiciis. Ex justis causis, dit-il, & certis personis sustinendae sunt cognitiones, veluti si instrumenta litis apud eos esse dicantur qui reipublicae causâ absunt.
Ce même privilege est établi par la 140e regle de droit : absentia ejus qui reipublicae causâ abest, neque ei, neque alii damnosa esse debet.
Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état sont appellées lettres de surséance ; il en est parlé dans celles de Philippe le Bel en 1316, sur le fait des aides, art. 8 ; de Philippe VI. en 1358 ; du roi Jean, en 1364 ; de Charles VII. en 1453, articles 55, 56 & 57.
Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice, il falloit que l'absent ne fût pas salarié de son absence, autrement elle étoit regardée comme affectée, comme il fut jugé au parlement de Paris en 1391, contre le baillif d'Auxerre, étant en Bourgogne pour une enquête, en une cause concernant le roi, sur les deniers duquel il étoit payé chaque jour.
L'ordonnance de 1669, tit. des lettres d'état, veut qu'on n'en accorde qu'aux personnes employées aux affaires importantes pour le service du roi ; ce qui s'applique à tous les officiers actuellement employés à quelque expédition militaire. Pour obtenir des lettres d'état, il faut qu'ils rapportent un certificat du secrétaire d'état ayant le département de la guerre, de leur service actuel, à peine de nullité.
Autrefois les lieutenans du roi dans les armées royales avoient le pouvoir d'accorder de ces sortes de lettres, mais elles furent rejettées par un arrêt du parlement de l'an 1393, & depuis ce droit a été reservé au roi seul.
Ces sortes de lettres ne s'accordent ordinairement que pour six mois, à compter du jour de l'impétration, & ne peuvent être renouvellées que quinze jours avant l'expiration des précédentes ; & il faut que ce soit pour de justes considérations qui soient exprimées dans les lettres.
Quand les lettres sont débattues d'obreption ou de subreption, les parties doivent se retirer par devant le roi pour leur être pourvû ; les juges ne peuvent passer outre à l'instruction & jugement des procès, au préjudice de la signification des lettres.
Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers de faire saisir réellement les immeubles de leur débiteur, & de faire registrer la saisie ; mais on ne peut procéder au bail judiciaire ; & si les lettres ont été signifiées depuis le bail, les criées peuvent être continuées jusqu'au congé d'adjuger inclusivement. Les opposans au decret ne peuvent se servir de telles lettres pour arrêter la poursuite, ni le bail ou l'adjudication.
Les opposans à une saisie mobiliaire, ne peuvent pas non plus s'en servir pour retarder la vente des meubles saisis.
Les lettres d'état n'ont point d'effet dans les affaires où le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles ; ce qui comprend le faux tant principal qu'incident.
Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en servir que dans les affaires où il a personnellement intérêt, sans que ses pere & mere ou autres parens, ni ses coobligés, cautions & certificateurs, puissent s'aider de ces mêmes lettres.
Néanmoins les femmes, quoique séparées de biens, peuvent se servir des lettres d'état de leurs maris dans les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres personnes que leurs maris.
Les tuteurs honoraires & onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir pour eux des lettres qu'ils ont obtenues pour ceux qui sont sous leur tutele & curatelle.
Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il soit passé outre au jugement d'un procès ou instance, lorsque les juges ont commencé à opiner avant la signification des lettres.
On ne peut à la faveur des lettres d'état se dispenser de payer le prix d'une charge, ni pour le prix d'un bien adjugé par justice, ni pour se dispenser de consigner ou de rembourser l'acquéreur en matiere de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte, ni pour arrêter un partage.
Elles n'ont pas lieu non plus en matiere de restitution de dot, payement de douaire & conventions matrimoniales, payement de légitime, alimens, médicamens, loyers de maison, gages de domestiques, journées d'artisans, reliquats de compte de tutele, dépôt nécessaire, & maniement de deniers publics, lettres & billets de change, exécution de sociétés de commerce, caution judiciaire, frais funéraires, arrérages de rentes seigneuriales & foncieres, & redevances de baux emphitéotiques.
Ceux qui interviennent dans un procès, ne peuvent faire signifier des lettres d'état pour arrêter le jugement, que leur intervention n'ait été reçue ; & s'ils interviennent comme donataires ou cessionnaires, autrement que par contrat de mariage ou partage de famille, ils ne peuvent faire signifier de lettres que six mois après, à compter du jour que la donation aura été insinuée, ou que le transport aura été signifié, & si le titre de créance est sous seing privé, ils ne pourront se servir de lettres d'état qu'un an après que le titre aura été produit & reconnu en justice.
Les lettres d'état ne peuvent être opposées à l'hôtel-Dieu, ni à l'hôpital général, & à celui des enfans trouvés de Paris. Voyez la déclaration du 23 Mars 1680, celle du 23 Décembre 1702.
Le roi a quelquefois accordé une surséance générale à tous les officiers qui avoient servi dans les dernieres guerres, par la déclaration du premier Février 1698, & leur accorda trois ans.
Cette surséance fut prorogée pendant une année par une autre déclaration du 15 Février 1701.
Il y eut encore une surséance de trois ans accordée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)
LETTRES D'ETAT ou de CONTRE-ETAT, étoient des lettres de provision, c'est-à-dire provisoires, que les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant le jugement, qui maintenoient ou chargeoient l'état des choses contestées ; les jugemens définitifs faisoient toujours mention de ces lettres. (A)
LETTRES D'EVOCATION, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi, pour des considérations particulieres, évoque à soi une affaire pendante devant quelque juge, & en attribue la connoissance à son conseil, ou la renvoye devant un autre tribunal. Voyez EVOCATION. (A)
LETTRES D'EXEAT, Voyez EXEAT.
LETTRES EXECUTOIRES, ce terme est quelquefois employé pour signifier des lettres apostoliques dont les papes usoient pour la collation des bénéfices, comme il sera expliqué ci-après à l'article LETTRES MONITOIRES. (A)
Lettres exécutoires, en Normandie & dans quelques autres Coutumes, signifient des titres authentiques, tels que contrats & obligations, sentences, arrêts & jugemens qui sont en forme exécutoire, & deviennent par ce moyen des titres parés, quod paratam habent executionem : Voy. les art. 546, 560 & 561 de la Coutume de Normandie. (A)
LETTRES EN FERME. On appelle ainsi dans le Cambresis, le double des actes authentiques qui est déposé dans l'hôtel-de-ville ; il en est parlé dans la coutume de Cambray, tit. 5. art. 5. Comme dans ce pays il n'y a point de garde-notes publics & en titre d'office, ainsi que le remarque M. Pinault sur l'article que l'on vient de citer, on y a suppléé en établissant dans chaque hôtel-de-ville une chambre où chacun a la liberté de mettre un double authentique des lettres ou actes qu'il a passés devant notaire, & comme cette chambre est appellée ferme, quasi firmitas, sureté, assurance ; les actes qui s'y conservent sont appellés lettres en ferme, pour que le double des lettres qu'on met dans ce dépôt ne puisse être changé, & qu'on puisse être certain de l'identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui doit écrire les deux doubles fait d'abord au milieu d'une grande peau de parchemin de gros caracteres, il coupe ensuite la peau & les caracteres par le milieu, & sur chaque partie de la peau, où il y a la moitié des caracteres coupés, il transcrit le contrat, selon l'intention des parties ; on dépose un des doubles à l'hôtel-de-ville, & l'on donne l'autre à celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau ainsi coupée en deux, est ce que l'on appelle charta partita, d'où est venu le mot de charte partie, usité sur mer. V. AMANS, ARCHES D'AMANS, CHARTE PARTIE, & l'art. 47. des coutumes de Mons. (A)
LETTRES EN FORME DE REQUESTE CIVILE. Voy. LETTRES DE REQUESTE CIVILE, & au mot REQUESTE CIVILE. (A)
LETTRES FORMEES dans la coutume d'Anjou, art. 471 & 509. & dans celle de Tours, art. 369. sont les actes authentiques qui sont en forme exécutoire.
On appelle requête de lettre formée, lorsque le juge rend son ordonnance sur requête, portant mandement au sergent de saisir les biens du débiteur & de les mettre en la main de justice, s'il ne paye, ce qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui appert d'un acte authentique & exécutoire, que la coutume appelle lettre formée. Voy. Dupineau sur l'art. 471. de la coutume d'Anjou. (A)
On entendoit aussi autrefois par lettres formées des lettres de recommandation, qu'un évêque donnoit à un clerc pour un autre évêque, on les appelloit formées, formatae, à cause de toutes les figures d'abréviation dont elles étoient remplies. Voyez l'histoire de Verdun, p. 144. (A)
LETTRES DE FRANCE. On appelloit autrefois ainsi en style de chancellerie, les lettres qui s'expedioient pour les provinces de l'ancien patrimoine de la couronne, à la différence de celles qui s'expedioient pour la Champagne ou pour le royaume de Navarre, que l'on appelloit lettres de Champagne, lettres de Navarre. (A)
LETTRES DE GARDE-GARDIENNE, sont des lettres du grand sceau, que le Roi accorde à des abbayes & autres églises, universités, colleges & communautés, par lesquelles il les prend sous sa protection speciale, & leur assigne des juges devant lesquels toutes leurs causes sont commises. Voyez CONSERVATEUR & GARDE-GARDIENNE. (A)
LETTRES DE GRACE, sont des lettres de chancellerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice, ni d'équité, tellement qu'il peut les refuser quand il le juge à propos ; telles sont en général les lettres de don & autres qui contiennent quelque libéralité ou quelque dispense ; telles que les lettres de bénéfice d'âge & d'inventaire, les lettres de terriers, de committimus, les séparations de biens en la coutume d'Auvergne, les attributions de jurisdiction pour criées ; les validations & autorisations de criées en la coutume de Vitry, les abréviations d'assises en la coutume d'Anjou ; les lettres de subrogation au lieu & place en la coutume de Normandie, lettres de main souveraine, les lettres de permission de vendre du bien substitué au pays d'Artois ; autres lettres de permission pour autoriser une veuve à vendre du bien propre à ses enfans dans la même province, & les lettres de permission de produire qu'on obtient pour le même pays, les rémissions & pardons ; les lettres d'assietes ; les lettres de naturalité, de légitimation, de noblesse, de réhabilitation, &c.
Ces lettres sont opposées à celles qu'on appelle lettres de justice : Voyez ci-après LETTRES DE JUSTICE. (A)
Lettres de grace en matiere criminelle, est un nom commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, telles que les lettres d'abolition, de rémission & pardon, par lesquelles le roi décharge un accusé de toutes poursuites que l'on auroit pû faire contre lui, & lui remet la peine que méritoit son crime.
On comprend quelquefois aussi sous ce terme de lettres de grace les lettres pour ester à droit, celles de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, de réhabilitation & révision de procès.
Comme ces lettres ont chacune leurs regles particulieres, on renvoye le lecteur à ce qui est dit sur chacune de ces lettres en son lieu & au mot GRACE. (A)
Lettres de grace. On donnoit aussi autrefois ce nom à certaines lettres par lesquelles on fondoit remise de l'argent qui étoit dû au roi ; lorsque ces lettres étoient données par des lieutenans du roi, elles devoient être confirmées par lui & passées à la chambre des comptes, ainsi qu'il est dit dans des lettres du roi Jean du 2 Octobre 1354. Charles V. étant régent du royaume fit une ordonnance le 19 Mars 1359, portant défenses aux présidens du parlement commis pour rendre la justice, le parlement non séant, d'obéir à ces lettres, lorsqu'elles seroient contre le bien de la justice, quand elles auroient été accordées par le régent même ou par le connétable, les maréchaux de France, le maître des arbalétriers, ou par des capitaines ; cette défense ne concernoit pas seulement les lettres de don, mais aussi celles de rémission & pardon. (A)
LETTRES D'HONORAIRE, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi accorde les honneurs & privileges de vétéran à quelque magistrat.
Celles que l'on accorde à d'autres officiers inférieurs, s'appellent simplement lettres de vétérance.
On ne les accorde ordinairement qu'au bout de vingt années de service, à moins que le roi par des considérations particulieres ne dispense l'officier d'une partie de ce tems.
Elles sont nécessaires pour jouir des honneurs & privileges, & doivent être registrées.
On n'en donne point au chef de compagnies, parce qu'ils ne peuvent après leur démission, conserver la même place.
Ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraire n'ont point de part aux émolumens ; cependant en 1513, la chambre des comptes en enregistrant celles d'un auditeur, ordonna qu'il jouiroit de ses gages ordinaires pendant deux ans, en se rendant sujet au service comme les autres & à la résidence, & sans tirer à conséquence, & on lui fit prêter un nouveau serment contre lequel les auditeurs protesterent.
On trouve un exemple de lettres d'honoraire, accordées à une personne décedée ; sçavoir, celles qui furent accordées le 18 Septembre 1671 pour feu messire Charles de la Vieuville, surintendant des finances. Voyez Tessereau, histoire de la chancellerie, & les mémoires de la chambre des comptes. (A)
LETTRES D'HYPOTHEQUE ; c'est un écrit, contrat ou jugement, portant reconnoissance de l'hypotheque ou droit réel qu'un créancier ou bailleur de fond a sur un bien possedé par celui qui donne cette reconnoissance. On demande à chaque nouveau détenteur de nouvelles lettres d'hypotheque. (A)
LETTRES D'INNOCENCE ou de PARDON. On les appelle plus communément de ce dernier nom. Voyez ci-après LETTRES DE PARDON. (A)
LETTRES D'INTERCESSION. Voyez ci-devant LETTRES DE DEPRECATION.
LETTRES DE JUSSION, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonne à ses cours de procéder à l'enregistrement de quelque ordonnance, édit ou déclaration que les cours n'ont pas crû devoir enregistrer sans faire auparavant de très-humbles remontrances au roi.
Lorsque le roi ne juge pas à propos d'y déferer, il donne des lettres de jussion sur lesquelles les cours font encore quelquefois de très-humbles représentations ; & si le roi n'y defere pas, il donne de secondes lettres de jussion sur lesquelles les cours ordonnent encore quelquefois d'itératives représentations.
Il y a eu dans certaines occasions jusqu'à quatre lettres de jussion données successivement pour le même enregistrement, comme il arriva par rapport à l'édit du mois de Juin 1635, portant création de plusieurs officiers en la cour des monnoies.
Lorsque les cours enregistrent en conséquence de lettres de jussion, elles ajoutent ordinairement dans leur arrêt d'enregistrement du très-exprès commandement de S. M.
Il est parlé de jussion dans deux novelles de Justinien : l'une est la novelle 125 qui porte pour titre, ut judices non expectent sacras jussiones sed quas videntur eis decernant ; l'autre est la 113 qui porte ne ex divinis jussionibus à principe impetratis sed antiquis legibus lites dirimantur ; mais le terme de jussion n'est pas pris dans ces endroits dans le même sens que nous entendons les lettres de jussion ; ces novelles ne veulent dire autre chose, sinon que les juges ne doivent point attendre des ordres particuliers du prince pour juger ; mais qu'ils doivent juger selon les anciennes loix, & ce qui leur paroîtra juste. Voyez PARLEMENT & REMONTRANCES. (A)
LETTRES DE JUSTICE, sont des lettres de chancellerie qui sont fondées sur le droit commun, ou qui portent mandement de rendre la justice, & que le roi accorde moins par faveur que pour subvenir au besoin de ses sujets, suivant la justice & l'équité. Tels sont les reliefs d'appel simple ou comme d'abus, les anticipations, désertions, compulsoires, debitis, commission pour assigner, les paréatis sur sentence ou arrêt, les rescisions, les requêtes civiles & autres semblables, &c. (A)
Ces sortes de lettres sont ainsi appellées par opposition à celles qu'on nomme lettres de grace. Voyez ci-devant LETTRES DE GRACE. (A)
LETTRES DE LEGITIMATION, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi légitime un bâtard, & veut que dans tous les actes il soit réputé légitime, & jouisse de tous les privileges accordés à ses autres sujets nés en légitime mariage. Voyez ci-devant LEGITIMATION. (A)
LETTRES DE LICENCE, sont des lettres expédiées par le greffier d'une des facultés d'une université, qui attestent qu'un tel, bachelier de cette faculté, après avoir soutenu les actes nécessaires, a été décoré du titre de licencié. Voyez BACHELIER, DOCTEUR & LICENCIE. (A)
LETTRES LOMBARDES : on donnoit ce nom anciennement aux lettres de chancellerie qui s'expédioient en faveur des Lombards, Italiens & autres étrangers qui vouloient trafiquer ou tenir banque en France ; on comprenoit même sous ce terme de lettres lombardes, toutes celles qui s'expédioient pour tous changeurs, banquiers, revendeurs & usuriers, que l'on appelloit tous Lombards, de quelque nation qu'ils fussent ; on les taxoit au double des autres en haine des usures que commettoient les Lombards. (A)
LETTRE LUE, en Normandie signifie un contrat de vente ou de fieffe à rente rachetable qui a été lecturé, c'est-à-dire publié en la forme prescrite par l'article 455 de la coutume. Voyez CLAMEUR A DROIT DE LETTRE LUE, & LECTURE. (A)
LETTRES DE MAJORITE, on appelle ainsi dans quelques provinces, & notamment en Bourbonnois, les lettres d'émancipation, ce qui vient de ce que l'émancipation donne au mineur la même capacité que la loi donne à celui qui est majeur de majorité coutumiere. (A)
LETTRES DE MAIN SOUVERAINE, sont des lettres qui s'obtiennent en la petite chancellerie par un vassal, lorsqu'il y a combat de fief entre deux seigneurs pour la mouvance, à l'effet de se faire recevoir en foi par main souveraine, & d'avoir main levée de la saisie féodale. Voyez FOI & HOMMAGE & RECEPTION EN FOI PAR MAIN SOUVERAINE. (A)
LETTRE DE MAITRE ES ARTS, sont des lettres accordées à quelqu'un par une université pour pouvoir enseigner la Grammaire, la Rhétorique, la Philosophie & autres Arts libéraux. Voyez MAITRE ES ARTS. (A)
LETTRES DE MAITRISE, sont des lettres de privilege que le roi accorde à quelques marchands ou artisans pour les autoriser à exercer un certain commerce ou métier, sans qu'ils aient fait leur apprentissage & chef-d'oeuvre, ni été reçus maîtres par les autres maîtres du même commerce ou métier.
Les communautés donnent aussi des lettres de maîtrise à ceux qui ont passé par les épreuves nécessaires. Voyez MAITRE & MAITRISE. (A)
LETTRES DE MAITRISE, (Police) on nomme ainsi, dans ce royaume, des actes en forme que les maîtres & gardes, & maîtres jurés délivrent à ceux qu'ils ont admis à la maîtrise, après examen, chef-d'oeuvre ou expérience qu'ils ont fait ; c'est en vertu de ces lettres qu'ils ont droit de tenir magasin, ouvrir boutique, exercer le négoce ou métier, soit du corps, soit de la communauté dans laquelle ils ont été reçus ; mais on ne leur expédie ces lettres qu'après qu'ils ont prêté serment & payé les droits de confrairie.
Exposons ici les réflexions d'un auteur moderne, à qui l'Encyclopédie doit beaucoup, & qui a joint à de grandes connoissances du commerce & des finances, les vues désintéressées d'un bon citoyen.
Il est parlé dans les anciens capitulaires de chef-d'oeuvre d'ouvriers, mais nulle part de lettres de maîtrise ; la raison ne favorise en aucune maniere l'idée d'obliger les artisans, de prendre de telles lettres, & de payer tant au roi qu'aux communautés, un droit de réception. Le monarque n'est pas fait pour accepter en tribut le fruit du labeur d'un malheureux artisan, ni pour vouloir astreindre ses sujets à un seul genre d'industrie, lorsqu'ils sont en état d'en professer plusieurs. L'origine des communautés est dûe vraisemblablement au soutien que les particuliers industrieux chercherent contre la violence des autres. Les rois prirent ces communautés sous leur protection, & leur accorderent des privileges. Dans les villes où l'on eut besoin d'établir certains métiers, l'entrée en fut accordée libéralement, en faisant épreuve, & en payant seulement une légere rétribution pour les frais communs.
Henri III. voulant combattre le parti de la ligue, & étant trompé par ce même parti, ordonna le premier en 1581, que tous négocians, marchands, artisans, gens de métier, résidens dans les bourgs & villes du royaume, seroient établis en corps, maîtrise & jurande, sans qu'aucun pût s'en dispenser. Les motifs d'ordre & de regle, ne furent point oubliés dans cet édit ; mais un second qui suivit en 1583, dévoilà le mystere. Le roi déclara que la permission de travailler étoit un droit royal & domanial ; en conséquence, il prescrivit les sommes qui seroient payées par les aspirans, tant au domaine qu'aux jurés & communautés.
Pour dédommager les artisans de cette nouvelle taxe, on leur accorda la permission de limiter leur nombre, c'est-à-dire d'exercer des monopoles. Enfin, l'on vendit des lettres de maîtrise, sans que les titulaires fussent tenus à faire épreuve ni apprentissage ; il falloit de l'argent pour les mignons.
Cependant le peuple en corps ne cessa de reclamer la liberté de l'industrie. Nous vous supplions, Sire, dit le tiers-état dans ses placets, " que toutes maîtrises de métiers soient à jamais éteintes ; que les exercices desdits métiers soient laissés libres à vos pauvres sujets, sous visite de leurs ouvrages & marchandises par experts & prud'hommes, qui à ce seront commis par les juges de la police : nous vous supplions, Sire, que tous édits d'Arts & Métiers, accordés en faveur d'entrées, mariages, naissances ou d'autres causes, soient révoqués ; que les marchands & artisans ne payent rien pour leur réception, levement de boutique, salaire, droits de confrairie, & ne fassent banquets ou autres frais quelconques à ce sujet, dont la dépense ne tend qu'à la ruine de l'état, &c. "
Malgré ces humbles & justes supplications, il continua toujours d'être défendu de travailler à ceux qui n'avoient point d'argent pour en acheter la permission, ou que les communautés ne vouloient pas recevoir, pour s'épargner de nouveaux concurrens.
M. le duc de Sully modéra bien certains abus éclatans des lettres de maîtrise ; mais il confirma l'invention, n'appercevant que de l'ordre dans un établissement dont les gênes & les contraintes, si nuisibles au bien politique, sautent aux yeux.
Sous Louis XIV. on continua de créer de nouvelles places de maîtres dans chaque communauté, & ces créations devinrent si communes, qu'il en fut accordé quelques-unes en pur don, indépendamment de celles qu'on vendit par brigue.
Tout cela cependant ne présente que d'onéreuses taxes sur l'industrie & sur le commerce. De-là sont venues les permissions accordées aux communautés d'emprunter, de lever sur les récipiendaires & les marchandises, les sommes nécessaires pour rembourser ou payer les intérêts.
Les seuls inconvéniens qui sont émanés de ces permissions d'emprunter, méritent la réforme du gouvernement. Il est telle communauté à Paris, qui doit quatre à cinq cent mille livres, dont la rente est une charge sur le public, & une occasion de rapines ; car chaque communauté endettée obtient la permission de lever un droit, dont le produit excédant la rente, tourne au profit des gardes. Ces sortes d'abus regnent également dans les provinces, excepté que les emprunts & les droits n'y sont pas si considérables, mais la proportion est la même ; ne doutons point que la multiplicité des débiteurs ne soit une des causes qui tiennent l'argent cher en France au milieu de la paix.
Ce qui doit paroître encore plus extraordinaire, c'est qu'une partie de ces sommes ait été & soit journellement consommée en procès & en frais de justice. Les communautés de Paris, grace aux lettres de maîtrise, dépensent annuellement près d'un million de cette maniere ; c'est un fait avéré par leur registre. A ne compter dans le royaume que vingt mille corps de jurande ou de communautés d'artisans, & dans chacun une dette de cinq mille livres, l'un portant l'autre ; si l'on faisoit ce dépouillement, on trouveroit beaucoup au-delà ; ce sont cent millions de dettes, dont l'intérêt à cinq pour cent se leve sur les marchandises consommées, tant au-dedans qu'au dehors ; c'est donc une imposition réelle dont l'état ne profite point.
Si l'on daigne approfondir ce sujet, comme on le fera sans doute un jour, on trouvera que la plûpart des autres statuts de M. Colbert, concernant les lettres de maîtrise & les corps de métiers, favorisent les monopoles au lieu de les extirper, détruisent la concurrence, & fomentent la discorde & les procès entre les classes du peuple, dont il est le plus important de réunir les affections du côté du travail, & de ménager le tems & la bourse.
Enfin, l'on y trouvera des bisarreries, dont les raisons sont inconcevables. Pourquoi, par exemple, un teinturier en fil n'a-t-il pas la permission de teindre ses étoffes ? Pourquoi est-il défendu aux teinturiers d'avoir plus de deux apprentifs ? Pourquoi leurs veuves sont-elles dépouillées de ce droit ? Pourquoi les chapeliers sont-ils privés en même tems de faire le commerce de la bonnetterie ? La liste des pourquoi seroit grande, si je voulois la continuer ; on ne peut donner à ces sortes de questions d'autre réponse, sinon que les statuts le réglent ainsi ; mais d'autres statuts plus éclairés réformeroient ceux des tems d'ignorance, & feroient fleurir l'industrie. (D.J.)
LETTRES DE MARQUE ou DE REPRESAILLES, sont des lettres qu'on souverain accorde pour reprendre sur les ennemis l'équivalent de ce qu'ils ont pris à ses sujets, & dont le souverain ennemi n'a pas voulu faire justice ; elles sont appellées lettres de marques ou plutôt de marche, quasi jus concessum in alterius principis marchas seu limites transeundi sibique jus faciendi.
Il fut ordonné en 1443, que ces sortes de lettres ne seroient accordées qu'à ceux à qui le prince étranger auroit refusé la justice par trois fois ; c'est principalement pour les prises sur mer que ces sortes de lettres s'accordent. Voyez REPRESAILLES. (A)
LETTRES DE MER, sont des lettres patentes qu'on obtient pour naviguer sur mer. (A)
LETTRE MISSIVE, on appelle ainsi les lettres privées que l'on envoye d'un lieu dans un autre, soit par le courier ou par voie d'ami, ou que l'on fait porter à quelqu'un dans le même lieu par une autre personne.
On ne doit point abuser de ces sortes de lettres pour rendre public ce qui a été écrit confidemment ; il est sur-tout odieux de les remettre à un tiers qui peut en abuser ; c'est un abus de confiance.
Une reconnoissance d'une dette faite par une lettre missive, est valable ; il en seroit autrement s'il s'agissoit d'un acte qui de sa nature dût être synallagmatique, & conséquemment fait double, à moins qu'il ne soit passé par-devant notaire.
L'ordonnance des testamens déclare nulles les dispositions faites par des lettres missives. Voyez Cicéron D. Philipp. 2. & le Journal des audiences, au 9 Mars 1645. (A)
LETTRES DE MIXTION : la coutume de Normandie, art. 4, appelle ainsi les lettres de chancellerie, que l'on appelle communément lettres d'attribution de jurisdiction pour criées, lesquelles s'accordent quand il y a des héritages saisis réellement en différentes jurisdictions du ressort d'un même parlement, pour attribuer au juge, dans le ressort duquel est la plus grande partie des héritages, le droit de procéder à l'adjudication du total après que les criées ont été certifiées par les juges des lieux. La coutume de Normandie, en parlant du bailli ou de son lieutenant, dit qu'il a aussi la connoissance des lettres de mixtion, quand les terres contentieuses sont assises en deux vicomtés royales, en cas que l'une soit dans le ressort d'un haut justicier : on obtient aussi des lettres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de vendre par decret les biens roturiers situés en diverses sergenteries ou en une ou plusieurs hautes justices de la vicomté. Voyez les art. 4 & 8 de la coutume. (A)
LETTRES MONITOIRES ou MONITORIALES, étoient des lettres par lesquelles le pape prioit autrefois les ordinaires de ne pas conférer certains bénéfices ; ils envoyerent ensuite des lettres préceptoriales, pour les obliger sous quelque peine à obéir ; & comme les lettres ne suffisoient pas pour rendre la collation des ordinaires nulle, ils renvoyoient des lettres exécutoires non seulement pour punir la coutumace de l'ordinaire, mais encore pour annuller sa collation.
LETTRES DE NATURALITE, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonne qu'un étranger sera réputé naturel, sujet & régnicole, à l'effet de jouir de tous les droits, privileges, franchises & libertés dont jouissent les vrais originaires françois, & qu'il soit capable d'aspirer à tous les honneurs civils. Voyez NATURALITE.
LETTRES DE NOBLESSE sont la même chose que les lettres d'annoblissement. Voyez ci-devant LETTRES D'ANNOBLISSEMENT.
LETTRES PACIFIQUES, on appelloit ainsi autrefois des lettres que les évêques ou les chorévêques donnoient aux prêtres qui étoient obligés de faire quelques voyages : c'étoient proprement des lettres de recommandation, ou, comme ou dit aujourd'hui, des lettres testimoniales, par lesquelles on attestoit que celui auquel on les donnoit, étoit catholique & uni avec le chef de l'Eglise ; on les nommoit aussi lettres canoniques, lettres communicatoires, lettres ecclésiastiques, & lettres formées. La vie du pape Sixte I. tirée du pontificat du pape Damase, dit que ce fut ce saint pontife qui établit l'usage de ces lettres. Voyez les remarques de Dinius sur cette vie, tome I. des conciles, édit. du P. Labbé, p. 553 & 554.
Le concile d'Antioche de l'an 341 défend de recevoir aucun étranger, s'il n'a des lettres pacifiques ; il défend aussi aux prêtres de la campagne d'en donner ni d'autres lettres canoniques, sinon aux évêques voisins, mais il permet aux évêques de donner des lettres pacifiques. Voyez LETTRES COMMENDATICES, LETTRES FORMEES & LETTRES TESTIMONIALES.
LETTRES DE PARDON, sont une espece de lettres de grace que l'on obtient en chancellerie dans les cas où il n'échet pas peine de mort naturelle ou civile, ni aucune autre peine corporelle, & qui néanmoins ne peuvent être excusés.
Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les Romains appelloient purgation, laquelle s'obtenoit de l'autorité des magistrats & juges inférieurs.
On les intitule à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & on les date du jour de l'expédition, & elles sont scellées en cire jaune, au lieu que celles de remission se datent du mois seulement, & sont scellées en cire verte & intitulées à tous présens & à venir, parce qu'elles sont ad perpetuam rei memoriam. Voyez GRACE, LETTRES D'ABOLITION & de GRACE, & ci-après LETTRES DE REMISSION, & au mot REMISSION.
LETTRES DE PAREATIS sont des lettres du grand ou du petit sceau, qui ont pour objet de faire mettre un jugement à exécution. Voyez PAREATIS.
LETTRES PATENTES sont des lettres émanées du roi, scellées du grand sceau & contresignées par un secrétaire d'état.
On les appelle patentes, parce qu'elles sont toutes ouvertes, n'ayant qu'un simple repli au bas, lequel n'empêche pas de lire ce qui est contenu dans ces lettres, à la différence des lettres closes ou de cachet, que l'on peut lire sans les ouvrir.
On comprend en général sous le terme de lettres patentes toutes les lettres scellées du grand sceau, telles que les ordonnances, édits & déclarations, qui forment des lois générales ; mais on entend plus ordinairement par le terme de lettres patentes celles qui sont données à une province, ville ou communauté, ou à quelque particulier, à l'effet de leur accorder quelque grace, privilege ou autre droit.
Ces sortes de lettres n'étoient désignées anciennement que sous le terme de lettres royaux ; ce qui peut venir de ce qu'alors l'usage des lettres closes ou de cachet étoit plus rare, & aussi de ce qu'il n'y avoit point alors de petites chancelleries.
Présentement le terme des lettres royaux comprend toutes sortes de lettres, soit de grandes ou de petites chancelleries ; toutes lettres de chancellerie en général sont des lettres royaux, mais toutes ne sont pas des lettres patentes ; car quoique les lettres qu'on expédie dans les petites chancelleries soient ouvertes, de même que celles du grand sceau, il n'est pas d'usage de les appeller lettres patentes.
On appelloit anciennement charte ce que nous appellons présentement lettres patentes, & les premieres lettres qui soient ainsi qualifiées dans la table des ordonnances par Blanchard, sont des lettres de l'an 993, portant confirmation de l'abbaye de saint Pierre de Bourgueil, données à Paris la huitieme année du regne de Hugues & de Robert, rois de France.
Mais le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans les ordonnances même de la dénomination de lettres patentes & de la distinction de ces sortes de lettres d'avec les lettres closes ou de cachet, est dans des lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean, datées le 10 Avril 1357, par lesquelles il défend de payer aucune des dettes du roi, nonobstant quelconques lettres patentes ou closes de monsieur, de nous, des lieutenans de monsieur & de nous, &c.
Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai 1358, défendit de sceller aucunes lettres patentes du scel secret du roi, mais seulement les lettres closes à moins que ce ne fût en cas de nécessité.
Ainsi lorsque nos rois commencerent à user de différens sceaux ou cachets, le grand sceau fut réservé pour les lettres patentes, & l'on ne se servit du scel secret qui depuis est appellé contrescel, qu'au défaut du grand sceau, & même en l'absence de celui-ci au défaut du scel de châtelet ; c'est ce que nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359, donnée par Charles V. alors régent du royaume, dans laquelle on peut aussi remarquer que les lettres patentes étoient aussi appellées cédules ouvertes ; il ordonne en effet que l'on ne scellera nulles lettres ou cédules ouvertes de notre scel secret, si ce ne sont lettres très-hâtives touchant monsieur ou nous, & en l'absence du grand scel & du scel du châtelet, non autrement, ni en autre cas, & que si aucunes sont autrement scellées, l'on n'y obéira pas.
Les lettres patentes commencent par ces mots : " A tous présens & à venir, parce qu'elles sont ad perpetuam rei memoriam ; elles sont signées du roi, & en commandement par un secrétaire d'état ; elles sont scellées du grand sceau de cire verte.
Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles n'ayent été enregistrées au parlement ; voyez ce qui a été dit ci-devant au mot ENREGISTREMENT.
Celles qui sont accordées à des corps ou particuliers sont susceptibles d'opposition, lorsqu'elles préjudicient à un tiers. Voyez ci-devant LETTRE DE CACHET.
LETTRES DE LA PENITENCERIE DE ROME, sont celles qu'on obtient du tribunal de la pénitencerie, dans le cas où l'on doit s'adresser à ce tribunal pour des dispenses sur les empêchemens de mariage, pour des absolutions de censures, &c.
LETTRES PERPETUELLES, la coûtume de Bourbonnois, art. 78. appelle ainsi les testamens, contrats de mariage, constitutions de rente fonciere, ventes, donations, échanges, & autres actes translatifs de propriété, & qui sont faits pour avoir lieu à perpétuité, à la différence des obligations, quittances, baux & autres actes semblables, dont l'effet n'est nécessaire que pour un certain tems, & desquels par cette raison on ne garde souvent point de minute.
LETTRES PRECEPTORIALES, ce mot est expliqué ci-devant à l'article LETTRES MONITOIRES.
LETTRES DE PRETRISE sont l'acte par lequel un évêque confere à un diacre l'ordre de prêtrise. Voyez PRETRE & PRETRISE.
LETTRES DE PRIVILEGE sont des lettres patentes du grand sceau, qui accordent à l'impétrant quelque droit, comme de faire imprimer un ouvrage, d'établir un coche, une manufacture, &c. Voyez PRIVILEGE.
LETTRES DE RAPPEL DE BAN, appellées en droit remeatus, comme on voit à la loi Relegati ff. de poenis, sont parmi nous des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle & décharge celui qui avoit été condamné au bannissement à tems ou perpétuel, du bannissement perpétuel, ou pour le tems qui restoit à écouler, & remet & restitue l'impétrant en sa bonne renommée & en ses biens qui ne sont pas d'ailleurs confisqués ; à la charge par lui de satisfaire aux autres condamnations portées par le jugement. Ces lettres doivent être entérinées par les juges à qui l'adresse en est faite, sans examiner si elles sont conformes aux charges & informations, sauf à faire des remontrances, suivant l'article 7 du tit. 16 de l'Ordonnance de 1670.
LETTRES DE RAPPEL DES GALERES sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi rappelle & décharge des galeres celui qui y est, ou de la peine des galeres, à laquelle il avoit été condamné, s'il n'y est pas effectivement, & le remet & restitue en sa bonne renommée. Ces lettres sont sujettes aux mêmes regles que celles de rappel de ban. Voyez ci-devant LETTRES DE RAPPEL DE BAN.
LETTRES DE RATIFICATION sont des lettres du grand sceau que l'acquéreur d'un contrat de rente constitué sur le domaine du roi, sur les tailles, sur les aydes & gabelles, & sur le clergé, obtient à l'effet de purger les hypotéques qui pourroient procéder du chef de son vendeur. Voyez ci-devant CONSERVATEUR DES HYPOTEQUES & RATIFICATION.
LETTRES DE RECOMMANDATION sont des lettres missives, ou lettres écrites par un particulier à un autre en faveur d'un tiers, par lesquelles celui qui écrit recommande à l'autre celui dont il lui parle, prie de lui faire plaisir & de lui rendre service : ces sortes de lettres ne produisent aucune obligation de la part de celui qui les a écrites, quand même il assûreroit que celui dont il parle est homme d'honneur & de probité, qu'il est bon & solvable, ou en état de s'acquiter d'un tel emploi ; il en seroit autrement, si celui qui écrit ces lettres marquoit qu'il répond des faits de celui qu'il recommande, & des sommes qu'on pourroit lui confier. Alors ce n'est plus une simple recommandation, mais un cautionnement. Voyez Papon, liv. X. ch. iv. n°. 12. & Bouvot, tome I. part. II. verbo lettres de recommandation. Maynard, liv. VIII. ch. 29. Leprêtre, cent. IV. ch. xlij. Bouchel, en sa Bibliotheque, verbo preuves. Boniface, tome II. liv. IV. tit. 2. Voyez RECOMMANDATION.
LETTRES EN REGLEMENT DE JUGES sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi regle en laquelle de deux jurisdictions l'on doit procéder, lorsqu'il y a conflit entre deux cours, ou autres jurisdictions inférieures indépendantes l'une de l'autre. Voyez CONFLIT & REGLEMENT DE JUGES.
LETTRES DE REHABILITATION DU CONDAMNE, s'obtiennent en la grande chancellerie, pour remettre le condamné en sa bonne renommée, & biens non d'ailleurs confisqués. Voyez l'Ordonnance de 1670. tit. 16. art. 5. & REHABILITATION.
On obtient aussi des lettres de réhabilitation de noblesse. Voyez NOBLESSE.
Enfin il y a des lettres de réhabilitation de cession, que l'on accorde à celui qui a fait cession, lorsqu'il a entierement payé ses créanciers, ou qu'il s'est accordé avec eux : ces lettres le rétablissent en sa bonne renommée. Voyez CESSION.
LETTRES DE RELIEF DE LAPS DE TEMS, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles l'impétrant est relevé du tems qu'il a laissé écouler à son préjudice, à l'effet de pouvoir obtenir des lettres de requête civile, quoique le délai prescrit par l'ordonnance soit écoulé. Voyez RELIEF DE LAPS DE TEMS. (A)
LETTRES DE REMISSION, sont des lettres de grace qui s'obtiennent au grand ou au petit sceau pour les homicides involontaires, ou commis dans la nécessité d'une légitime défense : c'est ce que l'on appelloit chez les Romains déprécation. Voyez ci-devant LETTRES DE DEPRECATION, LETTRES D'ABOLITION, LETTRES DE GRACE, LETTRES DE PARDON, & au mot REMISSION. (A)
LETTRES DE REPI, que l'on devroit écrire respi, étant ainsi appellées à respirando, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles un débiteur obtient surséance ou délai de payer ses créanciers. Voy. REPI. (A)
LETTRES DE REPRESAILLES. Voyez LETTRES DE MARQUE.
LETTRES DE REPRISE, sont une commission que l'on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu'un en reprise d'une cause, instance ou procès. Voyez REPRISE. (A)
LETTRES DE REQUETE CIVILE, ou comme il est dit dans les ordonnances, en forme de requête civile, sont des lettres du petit sceau, tendantes à faire rétracter quelque arrêt ou jugement en dernier ressort, ou contre un jugement présidial au premier chef de l'édit, au cas que quelqu'une des ouvertures ou moyens de requête civile exprimées dans ces lettres se trouve vérifiée. Voyez REQUETE CIVILE. (A)
LETTRES DE RESCISION, sont des lettres de chancellerie que l'on obtient ordinairement au petit sceau pour se faire relever de quelque acte que l'on a passé à son préjudice, & auquel on a été induit, soit par force ou par dol, ou qui cause une lésion considérable à celui qui obtient ces lettres.
On en accorde aux majeurs aussi-bien qu'aux mineurs : elles doivent être obtenues dans les dix ans, à compter de l'acte ou du jour de la majorité, si l'acte a été passé par un mineur. Voyez LESION, MINEUR, RESCISION & RESTITUTION EN ENTIER. (A)
LETTRES DE RETABLISSEMENT, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi rétablit un office, une rente, ou autre chose qui avoit été supprimée, ou remet une personne dans le même état qu'elle étoit avant ces lettres : elles operent à l'égard des personnes qui n'étoient pas integri statûs, le même effet que les lettres de réhabilitation.
On obtient aussi des lettres de rétablissement pour avoir la permission de rétablir une justice, un poteau ou pilori, des fourches patibulaires, une maison rasée pour crime. (A)
LETTRES DE REVISION, sont des lettres que l'on obtient en grande chancellerie dans les matieres criminelles, lorsque celui qui a été jugé par arrêt ou autre jugement en dernier ressort, prétend qu'il a été injustement condamné ; ces lettres autorisent les juges auxquels elles sont adressées, à revoir de nouveau le procès : on les adresse ordinairement à la même chambre, à moins qu'il n'y ait quelque raison pour en user autrement. Voyez REVISION. (A)
LETTRES ROGATOIRES sont la même chose que commission rogatoire : on se sert même ordinairement du terme de commission. Voyez COMMISSION ROGATOIRE. (A)
LETTRES ROYAUX se dit, en style de chancellerie, pour exprimer toutes sortes de lettres émanées du roi, & scellées du grand ou du petit sceau.
Ces lettres sont toujours intitulées du nom du roi ; & lorsqu'elles sont destinées pour le Dauphiné ou pour la Provence, on ajoûte, après ses qualités de roi de France & de Navarre, celles de dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois, ou bien comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes.
L'adresse de ces sortes de lettres ne se fait jamais qu'aux juges royaux, ou à des huissiers ou sergens royaux ; desorte que quand il est nécessaire d'avoir des lettres royaux en quelque procès pendant devant un juge non royal, le roi adresse ses lettres, non pas au juge, mais au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, auquel il mande de faire commandement au juge de faire telle chose s'il lui appert, &c.
Ces sortes de lettres ne sont jamais censées être accordées au préjudice des droits du roi ni de ceux d'un tiers ; c'est pourquoi la clause, sauf le droit du roi & celui d'autrui, y est toujours sous-entendue.
La minute de ces lettres est en papier, mais l'expédition se fait en parchemin ; il faut qu'elle soit lisible, sans ratures ni interlignes, renvois ni apostilles.
Les lettres de grande chancellerie sont signées en cette forme : par le roi en son conseil ; si c'est pour le Dauphiné, on met par le roi dauphin ; si c'est pour la Provence, on met par le roi, comte de Provence. Celles du petit sceau sont signées par le conseil.
Toutes les lettres royaux sont de grace ou de justice. Voyez LETTRES DE GRACE & LETTRES DE JUSTICE. (A)
LETTRES DE SANG, ou LETTRES DE GRACE EN MATIERE CRIMINELLE : il en est parlé dans le sciendum de la chancellerie & dans l'ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du 27 Janvier 1359, art. xxij. (A)
LETTRES DE SANTE sont des certificats délivrés par les officiers de ville ou par le juge du lieu, que l'on donne à ceux qui voyagent sur terre ou sur mer lorsque la peste est en quelque pays, pour montrer qu'ils ne viennent pas des lieux qui en sont infectés. (A)
LETTRES DU GRAND SCEAU, sont des lettres qui s'expédient en la grande chancellerie, & qui sont scellées du grand sceau du roi.
L'avantage que ces sortes de lettres ont sur celles qui ne sont expédiées qu'au petit sceau, est qu'elles sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume sans visa ni pareatis ; au lieu que celles du petit sceau ne peuvent s'exécuter que dans le ressort de la petite chancellerie où elles ont été obtenues, à moins que l'on n'obtienne un pareatis du juge en la jurisdiction duquel on veut s'en servir, lorsqu'elle est hors le ressort de la chancellerie dont les lettres sont émanées.
Il y a des lettres que l'on peut obtenir indifféremment au grand ou au petit sceau ; mais il y en a d'autres qui ne peuvent être expédiées qu'au grand sceau, en présence de M. le garde des sceaux qui y préside.
Telles sont les lettres de rémission, d'annoblissement, de légitimation, de naturalité, de réhabilitation, amortissemens, priviléges, évocations, exemptions, dons & autres semblables.
Ces sortes de lettres ne peuvent être expédiées que par les secrétaires du roi servant près la grande chancellerie. Voyez ci-après LETTRES DU PETIT SCEAU. (A)
LETTRES DU PETIT SCEAU, sont celles qui s'expédient dans les petites chancelleries établies près les cours & présidiaux, & qui sont scellées du petit sceau, à la différence des lettres de grande chancellerie, qui sont scellées du grand sceau.
Telles sont les émancipations ou bénéfice d'âge, les lettres de bénéfice d'inventaire, lettres de terriers, d'attribution de jurisdiction pour criées, les committimus au petit sceau, les lettres de main-souveraine, les lettres d'assiette, les reliefs d'appel simple ou comme d'abus, les anticipations, désertions, compulsoires, rescisions, requêtes civiles & autres, dont la plûpart ne concernent que l'instruction & la procédure.
Quelques-unes de ces lettres ne peuvent être dressées que par les secrétaires du roi ; d'autres peuvent l'être aussi par les référendaires concurremment avec eux.
Ces lettres ne sont exécutoires que dans le ressort de la chancellerie où elles ont été obtenues.
On obtient quelquefois au grand sceau des lettres que l'on auroit pu aussi obtenir au petit sceau : on le fait alors pour qu'elles puissent être exécutées dans tout le royaume sans visa ni pareatis. Voyez ci-devant LETTRES DU GRAND SCEAU. (A)
LETTRES DE SCHOLARITE, sont des lettres testimoniales ou attestations qu'un tel est écolier juré de l'université qui lui a accordé ces lettres. Voyez GARDE GARDIENNE & SCHOLARITE. (A)
LETTRES DE SEPARATION, sont des lettres du petit sceau que l'on obtient dans les provinces d'Auvergne, Artois, Saint-Omer & quelques autres pays, pour autoriser la femme à former sa demande en séparation de biens. (A)
LETTRES SIMPLES, en style de chancellerie, sont celles qui payent le simple droit, lequel est moindre que celui qui est dû pour les lettres appellées doubles.
On met dans la classe des lettres simples tous arrêts, tant du conseil que des cours souveraines, qui portent seulement assigné & défenses de poursuites, pareatis sur lesdits arrêts & sentences, relief d'adresse, surannation & autres lettres, selon que les droits en sont reglés en connoissance de cause.
Les lettres simples civiles sont ordinaires ou extraordinaires ; les premieres sont celles dont on parle d'abord ; on appelle simples, civiles, extraordinaires les reglemens de juges & toutes autres commissions pour assigner au conseil. En matiere criminelle, il y a de même deux sortes de lettres simples, les unes ordinaires & les autres extraordinaires.
LETTRES DE SOUFFRANCE sont la même chose que les lettres de main-souveraine : elles sont plus connues sous ce dernier nom. Voyez ci-devant LETTRES DE MAIN-SOUVERAINE. (A)
LETTRES DE SOUDIACONAT, sont l'acte par lequel un évêque confere à un clerc l'ordre de soudiacre. Voyez DIACONAT & SOUDIACONAT. (A)
LETTRES DE SUBROGATION, sont des lettres du petit sceau usitées pour la province de Normandie ; elles s'accordent au créancier lorsque son débiteur est absent depuis long-tems, & qu'il a laissé des héritages vacans & abandonnés par ses héritiers présomptifs. Lorsque ces héritages ne peuvent supporter les frais d'un decret, le créancier est recevable à prendre des lettres portant subrogation à son profit au lieu & place de l'absent, pour jouir par lui de ces héritages & autres biens de son débiteur, à la charge néanmoins par lui de rendre bon & fidele compte des jouissances au débiteur au cas qu'il revienne. L'adresse de ces lettres se fait au juge royal dans la jurisdiction duquel les biens sont situés. (A)
LETTRES DE SURANNATION s'obtiennent en grande ou petite chancellerie, selon que les lettres auxquelles elles doivent être adaptées sont émanées de l'une ou de l'autre. L'objet de ces lettres est d'en valider de précédentes, nonobstant qu'elles soient surannées ; car toutes lettres de chancellerie ne sont valables que pour un an. Les lettres de surannation s'attachent sur les anciennes. (A)
LETTRES DE SURSEANCE signifient souvent la même chose que les lettres d'état ; cependant par lettres de surséance on peut entendre plus particulierement une surséance générale que l'on accorde en certain cas à tous les officiers, à la différence des lettres d'état, qui se donnent à chaque particulier séparément.
Le premier exemple que l'on trouve de ces surséances générales est sous Charles VI. en 1383. Ce prince, averti de l'arrivée des Anglois en Flandres, assembla promtement sa noblesse ; elle se rendit à ses ordres au nombre de 16000 hommes d'armes, & lui demanda en grace, que tant qu'elle seroit occupée au service, on ne pût faire contr'elle aucunes procédures de justice ; ce que Charles VI. lui accorda. Daniel, Hist. de France, tom. II. p. 768. Voyez ci-devant LETTRES D'ETAT, & ci-après LETTRES DE REPI, & au mot REPI. (A)
LETTRES DE TERRIER, sont une commission générale qui s'obtient en chancellerie par les seigneurs qui ont de grands territoires & beaucoup de redevances seigneuriales, pour faire appeller pardevant un ou deux notaires à ce commis, tous les débiteurs de ces redevances, afin de les reconnoître, exhiber leurs titres, payer les arrérages qui sont dûs, & passer des déclarations en forme authentique. Voyez TERRIER. (A)
LETTRES TESTIMONIALES, en cour d'église sont celles qu'un supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un de ceux qui lui sont subordonnés ; telles sont les lettres que l'évêque donne à des clercs pour attester qu'ils ont reçu la tonsure, les quatre mineurs ou les ordres sacrés ; telles sont aussi les lettres qu'un supérieur régulier donne à quelqu'un de ses religieux pour attester ses bonne vie & moeurs, ou le congé qu'on lui a donné, &c.
Les lettres de scholarité sont aussi des lettres testimoniales. Voyez SCHOLARITE, & ci-devant LETTRES COMMENDATICES. (A)
LETTRES DE VALIDATION DE CRIEES ; il est d'usage dans les coûtumes de Vitry, Château-neuf & quelques autres, avant de certifier les criées, d'obtenir en la petite chancellerie des lettres de validation ou autorisation de criées, dont l'objet est de couvrir les défauts qui pourroient se trouver dans la signification des criées, en ce qu'elles n'auroient pas été toutes signifiées en parlant à la personne du saisi, comme l'exigent ces coûtumes. Ces lettres s'adressent au juge du siége où les criées sont pendantes. (A)
LETTRES DE VETERANCE sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi conserve à un ancien officier de sa maison ou de justice qui a servi 20 ans, les mêmes honneurs & priviléges que s'il possédoit encore son office. Voyez VETERANCE. (A)
LETTRES DE VICARIAT GENERAL sont de trois sortes ; savoir, celles que les évêques donnent à quelques ecclésiastiques pour exercer en leur nom & à leur décharge la jurisdiction volontaire dans leur diocèse. Voyez GRANDS VICAIRES.
On appelle de même celles qu'un évêque donne à un conseiller-clerc du parlement pour instruire, conjointement avec l'official, le procès à un ecclésiastique accusé de cas privilégié. Voyez CAS PRIVILEGIE & DELIT COMMUN.
Enfin on appelle encore lettres de vicariat général celles qu'un curé donne à son vicaire. Voyez VICAIRE. (A)
LETTRE DE VOITURE est une lettre ouverte que l'on adresse à celui auquel on envoie, par des rouliers & autres voituriers, quelques marchandises sujettes aux droits du roi ; elle contient le nom du voiturier, la qualité & la quantité des marchandises, leur destination, & l'adresse de celui auquel elles sont destinées, & est signée de celui qui fait l'envoi.
L'ordonnance des aides veut que les lettres de voiture que l'on donne pour conduire du vin, soient passées devant notaire. Voyez le titre V. article 2. & 3. & le Dictionnaire des aides, au mot lettres de voiture. (A)
LETTRE A USANCES ou A UNE, DEUX OU TROIS USANCES, est une lettre de change qui n'est payable qu'au bout d'un, deux ou trois mois ; car en style de change, une usance signifie le délai d'un mois composé de trente jours, encore que le mois fût plus ou moins long. Voyez l'ordonnance du commerce, titre V. article v. & ci-devant LETTRES DE CHANGE. (A)
LETTRE A VUE est une lettre de change qui est payable aussi-tôt qu'elle est présentée à celui sur lequel elle est tirée, à la différence de celles qui ne sont exigibles qu'après un certain délai. Quand les lettres sont payables à tant de jours de vûe, le délai ne court que du jour que la lettre a été présentée. Voyez LETTRE DE CHANGE. (A)
LETTRES, s. f. (Gramm.) on comprend sous ce nom tous les caracteres qui composent l'alphabet des différentes nations. L'écriture est l'art de former ces caracteres, de les assembler, & d'en composer des mots tracés d'une maniere claire, nette, exacte, distincte, élégante & facile ; ce qui s'exécute, communément sur le papier avec une plume & de l'encre. Voyez les articles PAPIER, PLUME & ENCRE.
L'écriture étoit une invention trop heureuse pour n'être pas regardée dans son commencement avec la plus grande surprise. Tous les peuples qui en ont successivement eu la connoissance, n'ont pû s'empêcher de l'admirer, & ont senti que de cet art simple en lui-même les hommes retireroient toujours de grands avantages. Jaloux d'en paroitre les inventeurs, les Egyptiens & les Phéniciens s'en sont longtems disputé la gloire ; ce qui met encore aujourd'hui en question à laquelle de ces deux nations on doit véritablement l'attribuer.
L'Europe ignora les caracteres de l'écriture jusques vers l'an du monde 2620, que Cadmus passant de Phénicie en Grece pour faire la conquête de la Boeotie, en donna la connoissance aux Grecs ; & 200 ans après, les Latins la reçurent d'Evandre, à qui Latinus leur roi donna pour récompense une grande étendue de terre qu'il partagea avec les Arcadiens qui l'avoient accompagné.
L'écriture étoit devenue trop utile à toutes les nations policées pour éprouver le sort de plusieurs autres découvertes qui se sont entiérement perdues. Depuis sa naissance jusqu'au tems d'Auguste, il paroit qu'elle a fait l'étude de plusieurs savans qui, par les corrections qu'ils y ont faites, l'ont portée à ce degré de perfection où on la voit sous cet empereur. On ne peut disconvenir que l'écriture n'ait dégénéré par la suite de la beauté de sa formation ; & qu'elle ne soit retombée dans la grossiereté de son origine, lorsque les Barbares, répandus dans toute l'Europe comme un torrent, vinrent fondre sur l'empire romain, & porterent aux Arts les coups les plus terribles. Mais, toute défectueuse qu'elle étoit, on la recherchoit, & ceux qui la possédoient, étoient regardés comme des savans du premier ordre. A la renaissance des Sciences & des Arts, l'écriture fut, pour ainsi dire, la premiere à laquelle on s'appliqua le plus, comme à un art utile, & qui conduisoit à l'intelligence des autres. Comme on fit un principe de le rendre simple, on retrancha peu-à-peu les traits inutiles qui l'embarrassoient ; & en suivant toujours cette méthode, on est enfin parvenu à lui donner cette forme gracieuse dont le travail n'est point difficile. N'est-il pas singulier que l'écriture si nécessaire à l'homme dans tous les états, qu'il ne peut l'ignorer sans s'avilir aux yeux des autres, à qui nous sommes redevables de tant de connoissances qui ont formé notre esprit & policé nos moeurs : n'est-il pas, dis-je, singulier qu'un art d'une si grande conséquence soit regardé aujourd'hui avec autant d'indifférence qu'il étoit recherché avec ardeur, quand il n'étoit qu'à peine dégrossi & privé des graces que le bon goût lui a fait acquérir ? L'histoire nous fournit cent exemples du cas que les empereurs & les rois faisoient de cet art, & de la protection qu'ils lui accordoient. Entr'autres, Suétone nous rapporte dans la vie d'Auguste, que cet empereur enseignoit à écrire à ses petits-fils. Constantin le Grand chérissoit la belle écriture au point qu'il recommanda à Eusebe de Palestine, que les livres ne fussent écrits que par d'excellens ouvriers, comme il ne devoient être composés que par de bons auteurs. Pierre Messie en ses leçons, liv. III. chap. j. Charlemagne s'exerçoit à former le grand caractere romain. Hist. littéraire de la France. Selon la nouvelle diplomatique, tome II. p. 437. Charles V. & Charles VII. rois de France, écrivoient avec élégance & mieux qu'aucun maître de leur tems. Nous avons eu deux ministres, célebres par leur mérite, MM. Colbert & Desmarets, qui écrivoient avec la plus grande propreté. Le premier sur-tout aimoit & se connoissoit à cet art. Il suffisoit de lui présenter des pieces élégamment écrites pour obtenir des emplois. Ce siecle, où les belles mains étoient récompensées, a disparu trop tôt ; celui auquel nous vivons, n'offre que rarement à la plume de si heureux avantages. Un trait arrivé presque de nos jours à Rome, & attesté par M. l'abbé Molardini, secrétaire du saint-office della propaganda fide, fera connoître que l'écriture trouve encore des admirateurs, & qu'elle peut conduire aux dignités les plus éminentes ; il a assuré qu'un cardinal de la création de Clément XII. dût en partie son élévation à l'adresse qu'il avoit de bien écrire. Ce fait, tout véritable qu'il soit, paroitra extraordinaire & même douteux à beaucoup de personnes, mais les Italiens pensent autrement que nous sur l'écriture ; un habile écrivain parmi eux est autant estimé qu'un fameux peintre ; il est décoré du titre de virtuoso, & l'art jouit de la prérogative d'être libre.
S'il est indispensable de savoir écrire avec art & avec méthode, il est aussi honteux de ne le pas savoir ou de le savoir mal. Sans entrer ici dans les détails, & faire sentir les malheurs que cette ignorance occasionne, je ne m'arrêterai qu'à quelques faits. Quintilien, instit. orat. liv. I. chap. j. se plaint que de son tems on négligeoit cet art, non pas jusqu'à dédaigner d'apprendre à écrire, mais jusqu'à ne point se soucier de le faire avec élégance & promtitude. L'empereur Carin est blâmé par Vopisque d'avoir porté le dégoût pour l'écriture jusqu'à se décharger sur un secrétaire du soin de contrefaire sa signature. Egnate, liv. I. rapporte que l'empereur Licinius fut méprisé, parce qu'il ignoroit les lettres, & qu'il ne pouvoit placer son nom au bas de ses ordonnances. J'ai appris d'un homme très-connu par de savans ouvrages, & dont je tairai le nom, un trait singulier de M. le maréchal de Villars. Dans une de ses campagnes, ce héros conçut un projet qu'il écrivit de sa main. Voulant l'envoyer à la cour, il chargea un secrétaire de le transcrire ; mais il étoit si mal écrit que ce secrétaire ne put le déchiffrer, & eut recours dans cet embarras au maréchal, qui ne pouvant lui-même lire ce que sa main avoit tracé, dit, que l'on avoit tort de faire négliger l'écriture aux jeunes seigneurs, laquelle étoit si nécessaire à un homme de guerre, qui en avoit besoin pour le secret, & pour que ses ordres étant bien lus, pussent être aussi exécutés ponctuellement. Ce trait prouve bien la nécessité de savoir écrire proprement. L'écriture est une ressource toujours avantageuse, & l'on peut dire qu'elle fait souvent sortir un homme de la sphere commune pour l'élever par degrés à un état plus heureux, où souvent il n'arriveroit pas s'il ne possédoit ce talent. Un jeune gentilhomme, étant à l'armée, sollicitoit à la cour une place très-avantageuse dans une ville frontiere. Il étoit sur le point de l'obtenir, lorsqu'il envoya au ministre un mémoire qui étant mal écrit & mal conçu, fit voir une ignorance qui n'est pas pardonnable dans un homme de condition, & que le poste qu'il désiroit ne supportoit point ; aussi n'en fut-il point pourvû.
On voit par cet exemple que l'art d'écrire est aussi nécessaire aux grands qu'aux petits. Un roi, un prince, un ministre, un magistrat, un officier, peuvent se dispenser de savoir peindre, jouer d'un instrument, mais ils ne peuvent assez ignorer l'écriture pour ne la pas former au moins dans un goût simple & facile à lire. Ce n'est pas, me dira-t-on, qu'on refuse de leur donner des maîtres dans leur bas âge, il est vrai, mais a-t-on fait un bon choix ? Il arrive tous les jours que des gens inconnus & d'une foible capacité sont admis pour instruire d'un art dont ils n'ont eux-mêmes qu'une legere teinture, & sur-tout de celui d'écrire, qui a le caractere unique d'être utile jusqu'au dernier instant de la vie. Dans tel genre de talens que ce soit, un bon maître doit être recherché, considéré & récompensé. Par son habileté & son expérience, on apprend dans le beau, dans le naturel, & d'une maniere qui ne se corrompt point, & qui se soutient toujours, parce que son enseignement est établi sur des principes certains & vrais. Je ne puis mieux donner pour imitation que ce qui a été observé aux éducations de deux princes vivans pour le bonheur des hommes. Ce sont M. le duc d'Orléans & M. le prince de Condé. Tous deux écrivent avec goût & avec grace ; tous deux ont appris de maîtres titrés, écrivains habiles, & qui avoient donné des preuves de leur supériorité. Ce qui s'est exécuté dans l'établissement de l'école royale militaire, assure encore mon sentiment. On a fait choix pour l'écriture de maîtres connus, approuvés, & connoissant à fond leur art ; ce qui prouve que M. Paris du Verney, à qui rien n'échappe, le regarde comme une des parties essentielles de l'éducation de la jeune noblesse qu'on y éleve. On peut dire, à la louange de ce grand homme, que les talens sont bien reçus chez lui, & que l'écriture y tient une place honorable. Le siecle de Colbert renaîtroit assurément, s'il étoit à portée, comme ce ministre, de favoriser les bons écrivains.
Je me suis un peu étendu sur l'art d'écrire, parce que j'ai cru qu'il étoit nécessaire de faire sentir combien on avoit tort de le négliger. Une fois persuadé de cette vérité, on doit encore être certain que l'écriture ne s'apprend que par des principes. Personne, je crois, ne met en doute qu'il n'est point d'art qui n'en soit pourvu, & il seroit absurde de soutenir que l'écriture en est exemte. Si elle étoit naturelle à l'homme, c'est-à-dire, qu'il pût écrire avec grace & proprement dès qu'il en auroit la volonté & sans l'avoir apprise, alors je conviendrois que cet art seroit le seul qui ne fût pas fondé sur les regles. Mais on sait que les arts ne s'apprennent point sans le secours des maîtres & sans les principes. Comme il faut tous ces secours, moins à la vérité pour des seigneurs, qui n'ont besoin que d'une écriture simple & réguliere, & plus pour ceux qui veulent approfondir l'art, il est clair que dans l'un & l'autre cas, on doit être enseigné par de bons maîtres & par les principes. Mais il ne faut pas que ces principes soient confus & multipliés ; ils doivent être au contraire simples, naturels & démontrés si sensiblement, qu'on puisse soi-même connoître les défauts de son caractere, lorsqu'il n'est pas tracé dans la forme que le maître a peint à l'imagination. Tous les arts, dit avec raison M. de Voltaire, sont accablés par un nombre prodigieux de regles, dont la plûpart sont inutiles ou fausses. En effet, la multiplicité des regles & l'obscurité dont l'artiste enveloppe ses démonstrations, rebutent souvent l'éleve, qui ne peut les éclaircir par son peu d'intelligence ou de volonté.
Je n'irai pas plus loin sur la nécessité des principes dans les arts, je passe à l'origine des écritures qui sont en usage en France & à leurs caracteres distinctifs.
Trois écritures sont en usage ; la françoise ou la ronde, l'italienne ou la batarde, la coulée ou de permission.
La ronde tire son origine des caracteres gothiques modernes qui prirent naissance dans le douzieme siecle. On l'appelle françoise, parce qu'elle est la seule écriture qui soit particulierement affectée à cette nation si connue pour la perfection qu'elle communique aux arts. Voilà pour sa naissance, voyons son caractere propre.
La ronde est une écriture pleine, frappante & majestueuse. La difformité la déguise entierement. Elle veut une composition abondante ; ce n'est pas qu'elle ne flatte dans la simplicité, mais quand elle produit des effets mâles & recherchés, & qu'il y a une union intime entr'eux, elle acquiert beaucoup plus de valeur. Elle exige la perfection dans sa forme, la justesse dans ses majeures, le goût & la rectitude dans le choix & l'arrangement de ses caracteres, la délicatesse dans le toucher & la grace dans l'ensemble. Elle admet les passes & autres mouvemens, tantôt simples & tantôt compliqués, mais elle les veut conçus avec jugement, exécutés avec une vive modération & proportionnés à sa grandeur. Elle demande encore dans l'accessoire, qui sont les cadeaux & les lettres capitales, de la variété, de la hardiesse & du piquant. Cette écriture est la plus convenable à la langue françoise, qui est féconde en parties courbes.
L'italienne ou la bâtarde tire son origine des caracteres des anciens romains. Elle a le surnom de bâtarde, lequel vient, suivant les uns, de ce qu'elle n'est point en France l'écriture nationale ; & suivant les autres, de sa pente de droite à gauche. Cette pente n'a commencé à paroître dans cette écriture, qu'après les ravages que firent en Italie les Goths ou les Lombards.
L'essentiel de cette écriture consiste dans la simplicité & la précision. Elle ne veut que peu d'ornemens dans sa composition ; encore les exige-t-elle naturels & de facile imitation. Elle rejette tout ce qui sent l'extraordinaire & le surprenant. Elle a dans son caractere uni bien des difficultés à rassembler pour la peindre dans sa perfection. Il lui faut nécessairement pour flatter les yeux, une position de plume soutenue, une pente juste, des majeures simples & correctes, des liaisons délicates, de la légereté dans les rondeurs, du tendre & du moëlleux dans le toucher. Son accessoire a pour fondement le rare & le simple. Rien de mieux que les caracteres de cette écriture pour exécuter la langue latine, qui est extrêmement abondante en parties droites ou jambages.
La coulée ou l'écriture de permission dérive également des deux écritures dont je viens de parler : on l'appelle de permission, parce que chacun en l'écrivant y ajoûte beaucoup de son imagination. L'origine de cette écriture est du commencement de ce siecle.
Cette écriture la plus usitée de toutes, tient comme le milieu entre les deux autres. Elle n'a ni la force & la magnificence de la premiere, ni la simplicité de la seconde. Elle approche de toutes les deux, mais sans leur ressembler ; elle reçoit dans sa composition toutes sortes de mouvemens & de variétés. Son essence est de paroître plus promte & plus animée que les autres écritures. Elle demande dans son exécution de la facilité ; dans son expédition, de la vîtesse ; dans sa pente, de la régularité ; dans ses liaisons, de la finesse ; dans ses majeures, du feu & du principe ; & dans son toucher, un frappant qui donne du relief avec de la douceur. Son accessoire ne doit être ni trop chargé, ni trop uni. Cette écriture si ordinaire à tous les états, n'est nullement propre à écrire le latin.
Après cette idée des écritures, qui est suffisante pour faire sentir que le caprice n'en doit diriger aucune, il est à propos de dire un mot sur l'esprit qui a fait composer les Planches qui les concernent. L'auteur fixé à 15, n'a pu s'étendre autant qu'il l'auroit desiré ; néanmoins voulant rendre son ouvrage utile, & à la portée de toutes les personnes, il ne s'est point écarté du simple & du naturel. En rassemblant le tout à peu de démonstrations & de mots, il a rejetté tous les principes introduits par la nouveauté, & consacrés par un faux goût. Toute simple que soit l'écriture, elle est déja assez difficile par elle-même, sans encore chercher à l'embarrasser par des proportions superflues multipliées, & à la démontrer avec des termes peu connus, & qui chargent la mémoire sans aucun fruit.
On terminera cet article par la composition des différentes encres, & par un moyen de révivifier l'écriture effacée, lorsque cela est possible.
Les trois principales drogues qui servent à la composition des encres, sont la noix de galle, la couperose verte & la gomme arabique.
La noix de galle est bonne lorsqu'elle est menue, très-velue, ferme ou bien pleine en-dedans, & qu'elle n'est point poudreuse.
La bonne couperose se connoît quand elle est de couleur céleste, tant dans l'intérieur que dans l'extérieur.
La gomme arabique est bonne, lorsqu'elle est claire & qu'elle se brise facilement.
Encres à l'usage des maîtres Ecrivains. Il faut prendre quatre onces de noix de galle les plus noires, épineuses & non trouées, & les concasser seulement. Un morceau de bois d'inde, gros comme une moyenne plume, & long comme le petit doigt, que l'on réduit en petits morceaux ; un morceau d'écorce de figuier, de la grosseur de quatre doigts. On mettra ces trois choses dans un coquemar de terre neuf, avec deux pintes d'eau du ciel ou de riviere, mesure de Paris : on fera bouillir le tout jusqu'à diminution de moitié, en observant que la liqueur ne se répande pas en bouillant.
Ensuite on prendra quatre onces de vitriol romain que l'on fera calciner, & une demi-livre ou plus de gomme arabique. On mettra le vitriol calciné dans un linge, & on l'attachera en mode de poupée. On mettra la gomme dans un plat de terre neuf. On posera dans le même plat la poupée où sera le vitriol ; puis quand l'encre sera diminuée comme on vient de l'expliquer, on mettra un linge blanc sur le plat dans lequel sera la gomme & la poupée de vitriol, & on passera l'encre toute bouillante par ce linge, laquelle tombera dans le plat qui sera pour cet effet sur un réchaud de feu, prenant garde pourtant qu'elle ne bouille pas dans ce plat, car alors l'encre ne vaudroit rien. On remuera l'encre en cet état avec un bâton de figuier assez fort pour empêcher la gomme de s'attacher au fond du plat, & cela de tems en tems. On pressera la poupée de vitriol avec le bâton, & on essayera cette encre de moment en moment, pour lui donner le degré de noir que l'on voudra, & jusqu'à ce que la gomme soit fondue.
On peut recommencer une seconde fois sur les mêmes drogues, en y ajoûtant pareille quantité d'eau, de bois d'inde & d'écorce de figuier ; la seconde se trouve quelquefois la meilleure.
Cette encre qui est très-belle, donne à l'écriture beaucoup de brillant & de délicatesse.
Autre. Une once de gomme arabique bien concassée, deux onces de noix de galle triée & aussi-bien concassée ; trois ou quatre petits morceaux de bois d'inde, & gros comme une noix de sucre candi.
Il faut dans un pot de terre vernissé, contenant cinq demi-setiers, faire infuser dans une pinte de biere rouge ou blanche, les quatre drogues ci-dessus pendant trois quarts d'heure auprès d'un feu bien chaud sans bouillir ; ensuite on y mettra une demi-once de couperose verte, que l'on laissera encore au feu pendant une demi-heure, toujours sans bouillir. Lorsque l'encre est faite, il faut la passer & la mettre à la cave pour la mieux conserver : cette encre est très-belle & très-luisante.
Encre grise. L'encre grise se fait de la même maniere & avec les mêmes drogues que la précédente, à l'exception de la couperose verte que l'on ne met point. On ne la doit laisser au feu qu'une bonne heure sans bouillir : on passe cette encre, & on la met à la cave ainsi que l'autre.
L'encre grise se mêle dans le cornet avec l'encre noire ; on met moitié de l'une & moitié de l'autre. Si la noire cependant étoit trop foncée ou trop épaisse, il faudroit augmenter la dose de l'encre grise pour la rendre plus légere & plus coulante.
Encre pour le parchemin. Toutes sortes d'encres ne conviennent point pour écrire sur le parchemin ; la luisante devient jaune ; la légere boit, & la trop gommée s'écaille : en voici une qui est exempte de ces inconvéniens.
Prenez un quarteron & demi de noix de galle de la plus noire, & un quarteron & demi de gomme arabique, demi-livre de couperose d'Hongrie, & faites piler le tout dans un mortier, puis vous mettrez le tout ensemble dans une cruche de terre avec trois pintes d'eau de pluie ou de vin blanc, mesure de Paris. Il faut avoir soin pendant trois ou quatre jours de la remuer souvent avec un petit bâton sans la faire bouillir ; elle sera bien blanche en écrivant, & d'un noir suffisant vingt-quatre heures après.
Encre de communication. On appelle ainsi une encre qui sert pour les écritures que l'on veut faire graver. Elle se détache du papier, & se fixe sur la cire blanche que le graveur a mise sur la planche.
Cette encre est composée de poudre à canon, à volonté, réduite en poudre très-fine, avec une même quantité du plus beau noir d'impression ; à ces deux choses on ajoûte un peu de vitriol romain : le tout se met dans un petit vase avec de l'eau. Il faut avoir le soin lorsque l'on fait usage de cette liqueur, de remuer beaucoup à chaque lettre le vase dans lequel elle se trouve. Si cette encre devenoit trop épaisse, il faudroit y mettre de l'eau, & si au contraire elle étoit trop foible, on la laisseroit reposer, pour en ôter après un peu d'eau.
Encre rouge. Il faut avoir quatre onces de bois de brésil, un sol d'alun de rome, un sol ou six liards de gomme arabique, & deux sols de sucre candi. On fera d'abord bouillir les quatre onces de bois de brésil dans une pinte d'eau pendant un bon quart-d'heure, puis on y ajoûtera le reste des drogues que l'on laissera bouillir encore un quart-d'heure.
Cette encre se conserve long-tems ; & plus elle est vieille, & plus elle est rouge.
Encre blanche pour écrire sur le papier noir. Il y a deux sortes d'encres blanches. La premiere consiste à mettre dans l'eau gommée, une suffisante quantité de blanc de plomb pulvérisé, de maniere que la liqueur ne soit ni trop épaisse ni trop fluide ; la seconde est plus composée, & elle vaut mieux : la voici.
Prenez coquilles d'oeufs frais bien lavées & bien blanchies ; ôtez la petite peau qui est en dedans de la coque, & broyez-les sur le marbre bien nettoyé avec de l'eau claire ; mettez-les ensuite dans un vase bien net, & laissez les reposer jusqu'à ce que la poudre soit descendue au fond. Vuidez ensuite légérement l'eau qui reste dessus, & faites sécher la poudre au soleil ; & lorsqu'elle sera bien seche vous la serrerez proprement. Quand vous en voudrez faire usage, prenez de la gomme ammoniaque, de celle qui est en larmes & en morceaux ronds ou ovales, blancs dans leur intérieur, & jaunâtres au-dehors, très-bien lavée, & émondée de la peau jaune qui la couvre. Mettez-la ensuite détremper l'espace d'une nuit dans du vinaigre distillé, que vous trouverez le lendemain de la plus grande blancheur ; vous passerez le tout ensuite à-travers un linge bien propre, & vous y mêlerez de la poudre de coquilles d'oeufs. Cette encre est si blanche qu'elle peut se voir sur le papier.
Moyen de révivifier l'encre effacée. Prenez un demi-poisson d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle (plus ces noix seront petites, meilleures elles seront) ; concassez-les, reduisez-les en une poudre menue ; mettez cette poudre dans l'esprit-de-vin. Prenez votre parchemin ou papier, exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit-de-vin échauffé. Ayez un petit pinceau, ou du coton ; trempez-le dans le mélange de noix de galle & d'esprit-de-vin, & passez-le sur l'écriture : l'écriture effacée reparoîtra, s'il est possible qu'elle reparoisse. Article de M. PAILLASSON, expert écrivain-juré.
|
| LETTRÉS | Litradas, (Littérat.) nom que les Chinois donnent à ceux qui savent lire & écrire leur langue. Voyez CHINOIS.
Il n'y a que les lettrés qui puissent être élevés à la qualité de mandarins. Voyez MANDARINS. Lettrés est aussi dans le même pays le nom d'une secte qu'on distingue par ses sentimens sur la religion, la Philosophie, la politique. Elle est principalement composée de gens de lettres du pays, qui lui donnent le nom de jukiao, c'est-à-dire les savans ou gens de lettres.
Elle s'est élevée l'an 1400 de J. C. lorsque l'empereur, pour réveiller la passion de son peuple pour les Sciences, dont le goût avoit été entierement émoussé par les dernieres guerres civiles, & pour exciter l'émulation parmi les mandarins, choisit quarante-deux des plus habiles docteurs, qu'il chargea de composer un corps de doctrine conforme à celle des anciens, pour servir desormais de regle du savoir, & de marque pour reconnoître les gens de lettres. Les savans préposés à cet ouvrage, s'y appliquerent avec beaucoup d'attention ; mais quelques personnes s'imaginerent qu'ils donnerent la torture à la doctrine des anciens pour la faire accorder avec la leur, plutôt qu'ils ne formerent leurs sentimens sur le modele des anciens. Ils parlent de la divinité comme si ce n'étoit rien de plus qu'une pure nature, ou bien le pouvoir & la vertu naturelle qui produit, arrange & conserve toutes les parties de l'univers. C'est, disent-ils, un pur & parfait principe, sans commencement ni fin ; c'est la source de toutes choses, l'espérance de tout être, & ce qui se détermine soi-même à être ce qu'il est. Ils font de Dieu l'ame du monde ; il est, selon leurs principes, répandu dans toute la matiere, & il y produit tous les changemens qui lui arrivent. En un mot, il n'est pas aisé de décider s'ils réduisent l'idée de Dieu à celle de la nature, ou s'ils élevent plutôt l'idée de la nature à celle de Dieu : car ils attribuent à la nature une infinité de ces choses que nous attribuons à Dieu.
Cette doctrine introduisit à la Chine une espece d'athéïsme raffiné, à la place de l'idolatrie qui y avoit régné auparavant. Comme l'ouvrage avoit été composé par tant de personnes réputées savantes & versées en tant de parties, que l'empereur lui-même lui avoit donné son approbation, le corps de doctrine fut reçu du peuple non seulement sans contradiction, mais même avec applaudissement. Plusieurs le goûterent, parce qu'il leur paroissoit détruire toutes les religions ; d'autres en furent satisfaits, parce que la grande liberté de penser qu'il leur laissoit en matiere de religion, ne leur pouvoit pas donner beaucoup d'inquiétude. C'est ainsi que se forma la secte des lettres, qui est composée de ceux des Chinois qui soutiennent les sentimens que nous venons de rapporter, & qui y adherent. La cour, les mandarins, les gens de qualité, les riches, &c. adoptent presque généralement cette façon de penser ; mais une grande partie du menu peuple est encore attachée au culte des idoles.
Les lettrés tolerent sans peine les Mahométans, parce que ceux-ci adorent comme eux le roi des cieux & l'auteur de la nature ; mais ils ont une parfaite aversion pour toutes les sectes idolâtres qui se trouvent dans leur nation. Ils résolurent même une fois de les extirper, mais le desordre que cette entreprise auroit produit dans l'empire les empêcha ; ils se contentent maintenant de les condamner en général comme autant d'hérétiques, & renouvellent solemnellement tous les ans à Pékin cette condamnation.
|
| LETTRINE | terme d'Imprimeur ; les lettrines sont des lettres dont l'on accompagne un mot qui est expliqué à la marge, ou en note au bas de la page. Ces sortes de lettres se mettent ordinairement en italique & entre deux parenthèses, & se répetent ainsi au commencement de l'explication ou interprétation à laquelle on renvoie.
|
| LETUS | (Géog. anc.) montagne d'Italie dans la Ligurie, selon Tite-Live & Valere-Maxime ; Léandre prétend que c'est aujourd'hui l'Alpi del peregrino. (D.J.)
|
| LE | ou LÛ, (Jurisprud.) lû & publié. Voyez ENREGISTREMENT, & au mot LECTURE. (A)
|
| LEUBEN | (Géog.) petite ville d'Allemagne, dans la Styrie, au cercle d'Autriche, capitale d'un grand comté, & appartenant à présent à la maison d'Autriche ; elle est sur la Muer, près de Gosz, fameuse abbaye de religieuses qui font preuve de noblesse.
|
| LEUCA | (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie, au pays des Salentins, voisine du promontoire japygien ; c'est présentement sancta Maria de Leuca, dans la terre d'Otrante. (D.J.)
|
| LEUCACHATE | S. f. (Hist. nat.) les anciens donnoient ce nom à une espece d'agate, qui suivant cette dénomination devoit être blanche, ou dumoins dans laquelle on remarquoit des taches ou des veines blanches.
|
| LEUCADE ISLE | (Géog. anc.) en latin Leucadia, dans Tite-Live, Leucas dans Florus & Ovide, & par les Grecs modernes Leucada ; île célebre située dans la mer Ionienne, sur la côte de l'Acarnanie, à l'entrée septentrionale du détroit qui sépare l'île de Céphalonie de la terre-ferme.
On place communément l'île Leucade vers le 38 degré de latitude, & le 47 de longitude. Son circuit est de cinquante mille pas ; elle a au nord le fameux promontoire d'Actium, & au midi l'île de Céphalonie.
Elle étoit jointe originairement à la terre-ferme ; Homere l'a désignée par ces mots, rivage d'Epire, , en donnant le nom d'Epire à tout le continent, qui est vis-à-vis des îles d'Ithaque & de Céphalonie : ce poëte y met trois villes, Neritum, Crocylée, & Agylipe.
On lit dans Pline, qu'elle a été séparée de la terre-ferme par un coup de mer ; il est le seul de cette opinion, & il adopte dans un autre endroit le sentiment général des historiens & des géographes, qui conviennent tous qu'une colonie de corinthiens, envoyée par Cypsélus & Gargasus, tyrans de Corinthe, vint s'établir sur la côte de l'Acarnanie, & coupa l'isthme qui joignoit le territoire de Leucade au continent. Ils transporterent sur le bord du canal qu'ils creuserent, la petite ville de Néricum ou Néritum, qui étoit à l'autre bout de l'île sur le bord de la mer, & donnerent à cette nouvelle ville, le nom de Leucade, qui depuis long-tems étoit celui de la petite contrée, & qui lui fut conservé lorsqu'on en fit une île.
Quoique cette île ait toûjours été séparée de la terre-ferme depuis que les Corinthiens s'en emparerent, plusieurs écrivains ont continué de lui donner le nom de presqu'île, parce que le canal qui la sépare du continent est étroit, & qu'il n'a jamais été fort profond.
Nous recueillons d'un passage de Tite-Live, que Leucade étoit encore réellement une presqu'île l'an de Rome 557 ; & M. Dodwel conjecture qu'on n'en fit une île, que lorsque les Romains ôterent Leucade de la jurisdiction de l'Acarnanie ; c'est-à-dire l'an de Rome 587, selon Varron ; cette conjecture est très-vraisemblable. De-là vient que tous les écrivains qui ont vécu depuis ce tems-là, l'appellent une île. Ovide en en parlant dit :
Leucada continuam veteres habuêre coloni,
Nunc freta circumeunt.
On la nomme aujourd'hui Sainte-Maure. Voyez SAINTE-MAURE.
LEUCADE, Leucas en latin, (Géog. anc.) par la plûpart des auteurs, excepté Florus, ville ancienne de la presqu'île, ou île Leucade. Elle devint très-florissante, & fut la capitale de l'Acarnanie, le chef-lieu du pays, & celui de l'assemblée générale des habitans. Auprès de cette île étoit le cap ou le promontoire dit de Leucade, d'où les amans malheureux se précipitoient dans la mer, & sur le haut duquel étoit bâti le temple d'Apollon Leucadien. Voyez donc LEUCADE promontoire de, Géog. hist. & Littérature. (D.J.)
LEUCADE, Promontoire de, (Géog. anc. Hist. & Littér.) en latin juga Leucatae, mons Leucatae, promontoire d'Acarnanie, auprès de la ville de Leucade. Détachons en partie ce que nous en dirons, d'un discours de M. Hardion, inséré dans le recueil des Mém. de Littér. tom. X.
Le promontoire de Leucade étoit à l'une des extrémités de l'île, vis-à-vis de Céphalonie ; on l'appelloit Leucade, Leucate, ou mont Leucadien, du mot , qui signifie blanc, à cause de la blancheur de ses roches. Ce nom devint celui du pays, & ensuite de la ville de Leucade.
Suivant le témoignage de l'auteur de l'Acméonide, cité par Strabon, Leucadius fils d'Icarius, & frere de Pénélope, ayant eu dans le partage des biens de son pere, le territoire du cap de Leucade, donna son nom à ce petit domaine. D'autres tirent le nom de Leucade de Leucas Zacynthien, l'un des compagnons d'Ulysse, & prétendent que ce fut lui qui y bâtit le temple d'Apollon. D'autres enfin estiment que le cap Leucate devoit sa dénomination à l'avanture d'un jeune enfant appellé Leucatée, qui s'élança du haut de cette montagne dans la mer, pour se dérober aux poursuites d'Apollon.
Quoi qu'il en soit, le promontoire de Leucade étoit terminé par une pointe qui s'avançoit au-dessus de la mer, & qui se perdoit dans les nues. Les écrivains qui en ont parlé, n'en ont point marqué la hauteur précise ; ils se sont contentés de dire qu'elle étoit constamment environnée de brouillards dans les jours mêmes les plus sereins.
Le temple d'Apollon dont je viens de faire mention, étoit bâti sur le sommet du promontoire, & comme on l'appercevoit de loin, ceux qui navigeoient dans la mer Ionienne, ne manquoient guere de le reconnoître, pour s'assurer de leur route, si nous en croyons le rapport de Virgile, Aenéid. liv. III. v. 274.
Mox & Leucatae nimbosa cacumina montis,
Et formidatus nautis aperitur Apollo.
Cependant ce n'est pas le seul temple du fils de Jupiter & de Latone, qui rendit célebre la montagne de Leucate ; ce sont les précipitations du haut de cette roche éclatante, qui l'ont immortalisée.
Il falloit, suivant une ancienne coutume, que tous les ans, au jour de la fête du dieu de Leucade, l'on précipitât du haut de cette montagne quelque criminel condamné à mort. C'étoit un sacrifice expiatoire, que les Leucadiens offroient à Apollon pour détourner les fléaux qui pouvoient les menacer. Il est vrai qu'en même tems on attachoit au coupable des aîles d'oiseaux, & même des oiseaux vivans, pour le soutenir en l'air, & rendre sa chute moins rude. On rangeoit au bas du précipice, de petites chaloupes, pour tirer promtement le criminel hors de la mer. Si on pouvoit ensuite le rappeller à la vie, on le bannissoit à perpétuité, & on le conduisoit hors du pays.
Voilà ce qu'on faisoit par l'autorité publique, & pour le bien de la patrie ; mais il y eut des particuliers qui de leur propre mouvement, & dans l'espérance de guérir des fureurs de l'amour, se précipiterent eux-mêmes du haut de cette roche. De-là vint que ce promontoire fut appellé le saut des amoureux, , saltus quo finiri amores, creditum est.
On ne manque pas d'exemples d'amans malheureux, qui dans le desespoir d'aimer sans être aimés, n'ont envisagé que la mort, pour se délivrer de leurs peines, & ont pris les chemins les plus courts, pour se la procurer. L'exécution de si noirs projets, n'écoute ni réflexion ni raisonnement. Il n'en est pas de même du saut de Leucade, qui consistoit à se précipiter du haut de cette montagne dans la mer, pour obtenir la guérison des tourmens de l'amour.
Ce saut étoit regardé comme un remede souverain, auquel on recouroit sans renoncer au plaisir & à l'espérance de vivre. On se rendoit de sang froid à Leucade, des pays les plus éloignés ; on se disposoit par des sacrifices & par des offrandes, à cette épreuve ; on s'y engageoit par un acte de religion, & par une invocation à Apollon, qui faisoit partie du voeu même ; enfin, on étoit persuadé qu'avec l'assistance du dieu dont on imploroit la protection avant que d'entreprendre ce redoutable saut, & par l'attention des personnes placées au bas du précipice, pour en recevoir tous les secours possibles à l'instant de la chute, on recouvreroit en cessant d'aimer, la tranquillité qu'on avoit perdue.
Cette étrange recette fut accréditée par la conduite de Jupiter, qui n'avoit trouvé, disoit-on, d'autre remede dans sa passion pour Junon, que de descendre du ciel, & s'asseoir sur la roche leucadienne. Vénus elle-même, ajoutoient les poëtes, éprouvant après la mort de son cher Adonis, que les feux dont elle brûloit, devenoient chaque jour encore plus insupportables, recourut à la science d'Apollon, comme au dieu de la Medecine, pour obtenir du soulagement à ses maux ; il fut touché de son triste état, lui promit sa guérison, & la mena généreusement sur le promontoire de Leucade, d'où il lui conseilla de se jetter dans la mer. Elle obéit, & fut toute surprise au sortir de l'onde, de se trouver heureuse & tranquille.
On ignore cependant quel mortel osa le premier suivre l'exemple des dieux. Sapho nous assure dans la lettre où l'aimable Ovide lui servoit de secrétaire, que ce fut Deucalion, trop sensible aux charmes de l'indifférente Pyrrha. L'histoire parle de deux poëtes qui l'imiterent ; l'un nommé Nicostrate, fit le saut sans aucun accident, & fut guéri de sa passion pour la cruelle Tettigigée ; l'autre appellé Charinus, se cassa la cuisse, & mourut quelques heures après.
Nous ne savons pas mieux si ce fut la fille de Ptéréla, éperduement amoureuse de Céphale ; Calycé, atteinte du même mal pour un jeune homme qui s'appelloit Evathlus ; ou l'infortunée Sapho, qui tenta la premiere le terrible saut de Leucate, pour se délivrer des cruels tourmens dont Phaon étoit l'objet ; mais nous savons que toutes périrent victimes de leur aveugle confiance dans le remede des prêtres d'Apollon.
On doit être cependant moins étonné des égaremens où l'amour jetta les trois femmes que nous venons de nommer, que de ceux où tomba depuis une illustre héroïne, qui ayant partagé sa vie entre les soins d'un état, & les pénibles exercices de la guerre, ne put avec de pareilles armes, garantir son coeur des excès d'une folle passion, je veux parler d'Artémise, fille de Lygdamis, & reine de Carie.
Cette princesse dont on vante l'élévation des sentimens, la grandeur de courage, & les ressources de l'esprit dans les plus grands dangers, sécha d'amour pour un jeune homme de la ville d'Abydos, nommé Dardanus. Les prieres & les promesses furent vainement employées : Dardanus ne voulut rien écouter ; Artémise guidée par la rage & le désespoir, entra dans sa chambre, & lui creva les yeux. Bien-tôt une action si barbare lui fit horreur à elle-même, & pour lors ses feux se rallumerent avec plus de violence que jamais ; accablée de tant de malheurs, elle crut ne pouvoir trouver de ressource que dans le remede d'Apollon Leucadien ; mais ce remede trancha le fil de ses jours, & elle fut enterrée dans l'île Leucade.
Il paroît par les exemples tirés des annales historiques, que le saut du promontoire a été fatal à toutes les femmes qui s'y sont exposées, & qu'il n'y eut qu'un petit nombre d'hommes vigoureux qui le soutinrent heureusement.
Il est même très-vraisemblable que sans les liens d'un voeu redoutable que les amans contractoient sur les autels d'Apollon, avant que de subir l'épreuve du saut, tous auroient changé de résolution à la vûe du précipice, puisqu'il y en eut qui malgré cet engagement solemnel, firent céder dans ces momens d'effroi, le respect pour les dieux, à la crainte plus forte d'une mort presque assurée ; témoin ce lacédémonien qui s'étant avancé au bord du précipice, retourna sur ses pas, & répondit à ceux qui lui reprochoient son irreligion : " J'ignorois que mon voeu avoit besoin d'un autre voeu bien plus fort, pour m'engager à me précipiter ".
Enfin, les hommes éclairés par l'expérience, ne songerent plus à risquer une si rude épreuve, que les femmes avoient depuis long-tems pour toûjours abandonnée. Alors les ministres du temple d'Apollon, ne trouvant aucun moyen de remettre en crédit leur remede contre l'amour, établirent selon les apparences, qu'on pourroit se racheter du saut, en jettant une somme d'argent dans la mer, de l'endroit où l'on se précipitoit auparavant. Du-moins cette conjecture est fondée sur ce qu'un historien rapporte, qu'on tira de la mer dans un filet, une cassette pleine d'or, avec un jeune homme nommé Nérée, dont on sauva la vie. (D.J.)
|
| LEUCATE | (Géog.) petite ville de France dans le bas Languedoc. Elle n'est remarquable que par le siege qu'elle soutint en 1637 contre l'armée espagnole qui y fut défaite. Les fortifications ont été démolies sous Louis XIV. Elle est auprès de l'étang de même nom, à 7 lieues S. de Narbonne, 6 N. E. de Perpignan, 168 S. E. de Paris. Long. 20. 44. lat. 43. 40. (D.J.)
|
| LEUCÉ | ou ACHILLÉE, en latin Achillea, Achillis insula, (Géog. anc.) île du Pont-Euxin, assez près de l'embouchure du Borysthène. Pline assure qu'elle étoit fameuse, à cause du tombeau d'Achille. Il nous apprend qu'on l'appelloit aussi l'île des Bienheureux, & l'île des Héros. Ce dernier nom lui fut donné, selon Eustathe, parce qu'on croyoit que l'ame d'Achille & celles des autres héros, y erroient dans le creux des montagnes. Scylax en parle comme d'une île déserte. Son nom moderne est Ficonisi, suivant la plûpart des géographes ; cependant ils ne sont pas plus d'accord que les anciens, sur sa position ; car les uns la placent avec Pline & Pomponius Méla, à l'opposite du Boristhène, & les autres avec Pausanias, vers l'embouchure du Danube. (D.J.)
LEUCE, s. f. (Chirurg.) espece de pustule, symptome de la lepre ; c'est une tache blanche qui pénetre jusqu'à la chair ; il en découle de la sanie lorsqu'on la pique. Ce mot est grec, , alba, blanche. (Y)
|
| LEUCHTENBERG | LANDGRAVIAT DE, (Géog.) petit canton d'Allemagne, dans le Nordgow, au palatinat de Baviere, dans lequel il est enclavé. Il n'a qu'une seule ville, savoir Pfreimt, & prend son nom du bourg & château situé sur une montagne, à un mille de la riviere de Nab, 15 N. E. de Ratisbonne, 20 N. E. de Nuremberg. Long. 30. 10. lat. 49. 36. (D.J.)
|
| LEUCI | (Géog. anc.) ancien peuple de la Gaule dont César, Strabon, Lucain, Tacite, Pline & Ptolémée font mention. La notice des provinces, des cités de la Gaule, met les Leuciens dans la premiere Belgique, & cette notice, ainsi que Ptolémée, nomme leur ville capitale Tullum. Il suit de là que le diocèse de Toul, l'un des plus grands qu'il y ait en France, répond au peuple Leuci des anciens. (D.J.)
|
| LEUCO | S. m. (Hist. nat. Bot.) espece de graine d'Afrique semblable au millet, qui, moulue, donne une farine dont les habitans des royaumes de Congo & d'Angola font du pain qu'ils préferent à celui du froment. Cette graine croît aussi en Egypte sur les bords du Nil.
|
| LEUCO-SYRIE | LA, Leuco-suria, (Géog. mod.) contrée d'Asie dans la Cappadoce ; dont elle faisoit partie, vers l'embouchure du Thermodon, qu'on appelle aujourd'hui Pormon, & qui se jette dans la mer Noire. Les Cappadociens furent nommés leuco-syriens, ou Syriens-blancs, parce qu'ils étoient plus septentrionaux & moins basanés que les autres Syriens. (D.J.)
|
| LEUCOCRYSOS | S. m. (Hist. nat.) nom d'une pierre dont Pline & les anciens semblent s'être servi pour désigner par ce nom l'hyacinthe d'un jaune clair.
|
| LEUCOGÉE | S. f. (Hist. nat.) nom employé par quelques naturalistes pour désigner une craie ou la terre blanche qu'on nomme moroclitus.
|
| LEUCOIU | ou PERCENEIGE, (Jardinage) Voyez PERCENEIGE.
|
| LEUCOLITHE | (Hist. nat.) nom donné par les auteurs grecs à une espece de pyrite blanche qu'ils calcinoient & regardoient comme un grand remede contre les maladies des yeux.
|
| LEUCOMA | S. m. (Antiq. grec.) , registre public de la ville d'Athènes, dans lequel on écrivoit le nom de tous les citoyens, d'abord qu'ils avoient atteint l'âge prescrit, pour être admis à l'héritage paternel ; cet âge étoit celui de vingt ans. Potter, archaeol. graec. lib. I. cap. xiij. tom. I. p. 79. (D.J.)
LEUCOMA, s. m. en Chirurgie, est une petite tache blanche sur la cornée de l'oeil, appellée en latin albugo, & en françois taye. Le mot grec vient de , blanc.
Il ne faut pas confondre le leucoma qui est causé par une humeur amassée dans la cornée, avec les cicatrices qui sont la suite d'une plaie ou d'un ulcere dans cette membrane, comme il arrive quelquefois dans la petite vérole. On trouvera les caracteres distinctifs de ces deux affections, & les remedes qui conviennent pour la guérison du leucoma, au mot ALBUGO. (Y)
|
| LEUCONOTUS | S. m. (Littér.) ; nom d'un vent chez les anciens ; nous pouvons le nommer en françois le vent du midi, car Végece le place au point que nous appellons le sud-sud est, à vingt-deux degrés & demi du sud. Les Grecs l'ont nommé , & les Latins albus, parce qu'il est ordinairement serein en Italie comme en Grece. (D.J.)
|
| LEUCOPETRA | (Géog. anc.) promontoire d'Italie au pays des Brutiens, dans le territoire de Rhégio, selon Strabon, Ptolémée & Cicéron, liv. XVI. ép. 7. Ce cap est présentement nommé Capo del armi. (D.J.)
|
| LEUCOPHLEGMATIE | S. f. (Médecine) ; espece d'hydropisie qui a son siége dans le tissu cellulaire qui meut toutes les parties du corps. La blancheur extraordinaire qu'on observe dans les parties infiltrées, a fait soupçonner à Hippocrate qu'elle étoit produite par une humeur blanchâtre, & lui a fait donner le nom de leucophlegmatie, qui chez les Grecs vient de , qui signifie phlegme blanc : elle est générale ou particuliere. Dans le premier cas, tout le corps est bouffi, oedémateux ; dans quelque partie que l'on enfonce le doigt, l'impression reste gravée pendant quelque tems, & ne s'efface qu'avec peine : le plus souvent cette humeur ne s'observe que dans les jambes & les cuisses. Lorsque la leucophlegmatie commence, les parties les plus lâches, & celles dans lesquelles la circulation est la plus lente, sont les premieres attaquées. Ainsi d'abord le dessous des yeux & les environs des chevilles se gonflent, peu-à-peu l'enflure gagne les jambes, les cuisses, se répand dans les bourses, dans la verge, qui grossit & se contourne singulierement : bientôt après tout le reste du corps se trouve infiltré, ou les eaux s'accumulent dans quelque cavité, comme le ventre, la poitrine, &c. Alors l'ascite ou l'hydropisie de poitrine se complique avec la leucophlegmatie : la respiration devient plus difficile, le pouls se concentre, devient petit, serré, inégal : de tems en tems il se developpe, se dilate, devient supérieur, nasal. J'ai observé que les hémorrhagies du nez étoient fréquentes dans cette maladie, l'excrétion des urines diminuée ; elles sont en petite quantité, rougeâtres, & déposent un sédiment briqueté : la soif & la toux surviennent.
Les causes qui produisent la leucophlegmatie sont les mêmes que celles de l'hydropisie (voyez ce mot), les obstructions dans les visceres, les fievres intermittentes mal traitées, trop tôt arrêtées, la suppression du flux menstruel, hémorrhoïdal, &c ; celles qui occasionnent le plus souvent l'espece d'hydropisie dont il est ici question, sont les cachéxies, les éruptions galeuses, dartreuses, repercutées : l'arrêt de la transpiration, la lenteur de la circulation, la rapidité, l'atonie, la langueur du mouvement putréfactif du sang y disposent beaucoup. Les observations anatomiques nous font voir, dans presque tous ceux qui sont morts à la suite de cette maladie, des concrétions polypeuses dans le coeur, l'aorte : des vices dans le foie, la rate, & autres visceres du bas ventre, la pâleur du foie, l'inertie de la bile, sont ceux qu'on observe le plus souvent. Pour se former une idée de la façon dont cette extravasation de sérosité peut avoir lieu, il n'y a qu'à faire attention à une expérience ingénieuse faite par Lower. Ce célebre anatomiste lia dans un chien vivant la veine cave inférieure, il recousut après cela les tégumens ; quelques heures après tout le bas-ventre, toutes les parties inférieures étoient vuides de sérosité qui avoit transsudé à-travers les pores des vaisseaux par ce vice, que les Pathologistes appellent diapedese. Il tenta la même expérience sur la souclaviere, qui fut suivie d'un effet semblable dans les parties supérieures. La communication qui est entre le tissu cellulaire de toutes les différentes parties, explique fort simplement la facilité avec laquelle la leucophlegmatie se répand d'une partie à l'autre.
On trouve dans bien des auteurs la leucophlegmatie confondue avec l'anasarque : ces deux maladies ont effectivement les mêmes symptomes, elles sont caractérisées l'une & l'autre par une bouffissure générale ou particuliere. Les écrivains plus exacts pensent que dans l'anasarque l'épanchement des eaux est plus profond, que son siege est dans l'enveloppe même des muscles, , autour des chairs, comme le porte son nom. Aretée prétend en outre que la sérosité infiltrée dans l'anasarque est putride, sanieuse, & qu'elle suppose une altération considérable dans les visceres qui servent à la sanguification, ce qui fait qu'alors la couleur de la peau est plus changée, qu'elle est d'un verd noirâtre ; au lieu que dans la leucophlegmatie la peau est luisante & très-blanche. Caelius Aurelianus établit la même différence.
De toutes les hydropisies, celle-ci, qui est la moins dangereuse, est la plus facile à guerir ; elle est très-rebelle lorsqu'elle succede à quelque maladie chronique, & qu'elle est entretenue par un vice dans les visceres du bas-ventre, sur-tout dans un vieillard ; mais lorsqu'elle est le produit d'une maladie aiguë, d'une fievre intermittente, de la suppression de quelqu'écoulement, &c. elle se dissipe assez surement ; celle qui survient aux jambes, aux cuisses dans les femmes enceintes, se guérit d'elle-même par l'accouchement. Il arrive aussi quelquefois, à la suite des maladies aiguës pendant la convalescence, une leucophlegmatie particuliere aux jambes : j'ai toujours observé que ce symptome étoit d'un très-bon augure, & que le rétablissement, dès qu'il paroissoit, étoit plus solide & plus promt. Tout ce qu'on a à craindre dans cette maladie, c'est qu'elle ne se termine en ascite. A la leucophlegmatie, dit Hippocrate, survient ordinairement l'hydropisie ascite, Aph. 7, lib. VII. On peut enfin regler le prognostic sur l'abondance des urines, l'état du pouls, la fréquence de la toux, la gêne de la respiration, la diminution des forces, &c. On doit très-bien augurer d'un cours de ventre ; il procure, dit Hippocrate, Aphor. 29, lib. VII. la solution de la leucophlegmatie.
Je consultois, il y a quelque tems, pour une jeune & aimable dame qui avoit les jambes & les cuisses prodigieusement bouffies, à cause d'un cancer à la matrice ; lorsque l'enflure étoit parvenue à un certain point, il survenoit une petite fievre & un dévoiement qui dissipoit la bouffissure ; mais la diarrhée arrêtée, les jambes s'infiltroient de nouveau, & peu de tems après la fievre & le cours de ventre revenoient & produisoient le même effet. Elle a vécu pendant plus d'un an dans cette alternative de leucophlegmatie, de fievre & de dévoiement ; enfin elle a succombé à la violence de sa maladie.
L'on a dans cette maladie les mêmes indications à remplir & les mêmes remedes pour en venir à bout, que dans l'hydropisie (Voyez ce mot). Si nous en croyons Hippocrate, Alexandre de Tralles, Paul d'Egine, & quelqu'autres praticiens fameux, la saignée est quelquefois nécessaire dans la guérison de la leucophlegmatie, quoique cependant elle paroisse au premier coup d'oeil déplacée. Les violens purgatifs, hydragogues, drastiques, peuvent être employés avec moins de risque & d'inconvénient ici que dans l'ascite : on doit terminer leur usage par les stomachiques amers, & sur-tout par les martiaux ; les sudorifiques peuvent avoir lieu dans certains cas où la repercussion des éruptions cutanées a causé la maladie. Lorsqu'on doit en accuser la gale rentrée, il n'y a point de secours plus assuré que de faire reprendre la gale. Si l'enflure étoit trop considérable, si les tégumens étoient trop distendus, on pourroit évacuer les eaux par des scarifications ou les vésicatoires ; mais il faut user de circonspection dans l'usage de ce remede, parce qu'on risque d'amener la gangrene. On doit éviter avec plus d'attention les astringens répercussifs, trop forts pour dissiper l'enflure des piés. L'ascite ou l'hydropisie de poitrine suit d'ordinaire une pratique si peu judicieuse ; il est plus à-propos alors d'appliquer des cendres chaudes, du son ou autres choses semblables. (M)
|
| LEUCOPHRINE | (Mytholog.) surnom que les Magnésiens donnoient à Diane, & qui est pris, soit de Leucophrys, ville d'Asie en Phrygie, sur les bords du Méandre, selon Xénophon, soit de Leucophois, ancien nom de l'île de Ténédos, où Diane avoit un temple célebre. Ce fut sur le modele de ce dernier temple que les Magnésiens consacrerent à cette divinité celui qu'ils éleverent en son honneur, avec une statue qui la représentoit à plusieurs mamelles, & couronnée par deux victoires. (D.J.)
|
| LEUCOPHTALMUS | S. m. (Hist. nat.) espece d'onyx dans laquelle on trouvoit la ressemblance d'un oeil humain entouré d'un cercle blanc.
|
| LEUCOPHYLE | S. m. (Botan. fabul.) en grec , plante fabuleuse qui venoit dans le Phase, riviere de la Colchide. Plutarque en parle dans son traité des fleuves. Les anciens lui attribuoient une vertu admirable, celle d'empêcher les femmes de tomber dans l'adultere ; mais on ne trouvoit cette plante qu'au point du jour, vers le commencement du printems, lorsqu'on célébroit les mysteres d'Hécate, & alors il la falloit cueillir avec de certaines précautions. Les maris jaloux, après l'avoir cueillie, la jettoient autour de leur lit, afin de le conserver à l'abri de toute tache. C'est ce que Plutarque dit élégamment en grec, & que Pontus de Tyard traduit ainsi dans son vieux gaulois.
Car quiconque au printems en son lit cachera
Cette plante cueillie en Phasis, trouvera
Que jamais sa Vénus ne sera dérobée.
Un usage pareil se pratiquoit chez les Athéniens durant la fête des thesmophories ; mais l'herbe du Phasis avoit des propriétés bien autrement considérables que l'agnus castus des Athéniens, puisque sa vertu ne se bornoit pas à la durée d'une fête, & qu'elle calmoit pour toujours l'inquiétude des maris jaloux. (D.J.)
|
| LEUCOSIE | Leucosia, (Géog. anc.) petite île de la mer Tyrrhène, sur la côte occidentale d'Italie. On a quelque lieu de croire que c'est la même île nommée par Méla Leucothoé, & Leucasie par les autres géographes : ce n'est aujourd'hui qu'un écueil au continent, nommé le cap de la Licosa. (D.J.)
|
| LEUCOSTICTOS | S. m. (Hist. nat.) Pline donne ce nom à une espece de porphyre, parce qu'il est rempli de taches blanches.
|
| LEUCOTHOÉ | (Mythol. & Littérat.) c'est la même qu'Ino, nourrice de Bacchus, qui, fuyant la fureur d'Athamas son mari, roi d'Orchomène, se précipita dans la mer ; mais les dieux touchés de son sort lui donnerent le nom de Leucothoé, après l'avoir admise au rang des divinités marines. Les Romains l'appellerent Matula, voyez ce mot. Elle avoit un autel dans le temple de Neptune à Corinthe. On sait la sage réponse que fit le philosophe Xénophane aux Eléates, qui lui demandoient s'ils feroient bien de continuer à Leucothoé leurs sacrifices, accompagnés de pleurs & de lamentations : il leur répondit que s'ils la tenoient pour déesse il étoit inutile de la tant pleurer ; & que s'ils croyoient qu'elle eût été du nombre des mortelles, ils se pouvoient passer de lui sacrifier. (D.J.)
|
| LEUCTRE | Leuctrum, (Géog. anc.) petite ville du Péloponnèse dans la Laconie, sur le golfe Messéniaque, assez près du cap Taenare. Le P. Hardouin avertit de ne pas confondre Leuctrum, que Pline nomme aussi Leuctra, avec Leuctres de Béotie, cette ville fameuse par la bataille qu'Epaminondas, général de Thebes, y gagna sur les Lacédemoniens 371 ans avant J. C. Les Spartiates perdirent dans cette action, avec leur roi Cléombrote, toute l'élite de leurs troupes, & depuis ce coup mortel ils ne donnerent qu'à peine quelque signe de vie.
Il faut encore distinguer la ville de Leuctre en Laconie de la ville de Leuctre, Leuctrum, en Arcadie : cette derniere fut abandonnée par ses habitans, qui allerent peupler Mégalopolis. (D.J.)
|
| LEUDE | (Jurisprud.) voyez ci-devant LANDE.
|
| LEUGAIRE | LEUGAIRE
Tout le monde sait l'usage où les Romains étoient de placer de mille en mille pas le long de leurs routes, des colonnes de pierre, sur lesquelles ils marquoient la distance des différens lieux à la ville où chaque route commençoit.
Mais 1°. les colonnes itinéraires découvertes dans les Gaules & dans le voisinage au de-là du Rhin, ont une singularité qu'on ne voit point sur celles d'aucun autre pays ; c'est que les distances y sont quelquefois marquées par le nombre des lieues, leugis, & non par celui des milles.
2°. Ces sortes de colonnes ne se rencontrent que dans la partie des Gaules, nommée par les Romains comata ou chevelue, & dont César fit la conquête ; dans tout le reste, on ne voit que des colonnes milliaires.
3°. Quelquefois dans le même canton, & sous le même empereur, la distance d'une station à l'autre étoit exprimée à la romaine & à la gauloise, c'est-à-dire en milles ou en lieues, non pas à-la-fois sur une même colonne, mais sur des colonnes différentes.
4°. Le mot leuga ou leonga, est originairement gaulois ; il vient du mot celtique leong ou leak, une pierre ; d'où l'on doit inférer que l'usage de diviser les chemins en lieues, & de marquer chaque division par une pierre, étoit vraisemblablement connu des Gaulois avant que les Romains les eussent soumis à leur empire. (D.J.)
|
| LEUH | (Hist. mod.) c'est ainsi que les Mahométans nomment le livre dans lequel, suivant les fictions de l'alcoran, toutes les actions des hommes sont écrites par le doigt des anges.
|
| LEUK | ou LEUCK, (Géog.) gros bourg de Suisse, presqu'au milieu du Vallais, remarquable par la force de sa situation, par l'assemblée fréquente des députés du pays avec ceux de l'évêque pour y délibérer sur les affaires communes, & par les bains de Leuk qui sont à deux lieues. Ce sont des eaux minérales chaudes, sans odeur, & dont on a trouvé cinq sources ; long. 25. 30. lat. 46. 12. (D.J.)
|
| LEURRE | S. m. terme de Fauconnerie ; c'est une figure garnie de bec, d'ongles & d'aîles, accompagnée d'un morceau de cuir rouge, qui ressemble un peu au faucon ; les Fauconniers l'attachent à une lesse par le moyen d'un crochet de corne, & s'en servent pour reclamer les oiseaux de proie ; on y attache de quoi le paître, c'est ce qu'on appelle acharner le leurre, parce que c'est un morceau de chair qu'on y met & qu'on nomme quelquefois rappel.
On dit aussi duire un oiseau au leurre, leurrer un oiseau, c'est le faire revenir sur le poing en lui montrant le leurre.
On dit leurrer bec au vent ou contre vent, à l'égard de l'autour & de l'épervier. V. nos Pl. de Chasses.
|
| LEUSE | (Géog.) Lutosa ; petite ville des pays-bas Autrichiens, dans le Hainaut, à 2 lieues d'Ath, 3 de Condé, 5 de Mons, sur un petit ruisseau. Le prince de Waldeck y fut battu par le maréchal de Luxembourg en 1691. Long. 21. 18. lat. 50. 34. (D.J.)
|
| LEUTKIRCH | (Géog.) ville libre & impériale d'Allemagne, en Souabe, dans l'Algow, sur le torrent d'Eschach, à six milles N. E. de Lindau, quatre O. de Kempten, trois S. O. de Memmingen. Long. 27. 45. lat. 47. 44.
Jean Faber de l'ordre de S. Dominique, & qui fit tant d'écrits contre les Luthériens au commencement du xvj. siecle, étoit de Leutkirch. Ses principaux ouvrages polémiques, forment 3 vol. in-folio. Celui qu'il intitula Malleus Haereticorum, le marteau des hérétiques, lui en valut le surnom. Il soutint Zuingle, tant qu'il ne prêcha que contre les indulgences ; mais il fulmina contre ses dogmes & ceux de Luther. Dans la célebre conférence qu'il eut à Zurich en 1526, où on lui alléguoit l'évangile comme regle de la foi, il répondit : " Qu'on auroit bien pu vivre en paix, quand il n'y auroit point eu d'évangile ". Cette vivacité qui lui échappa dans la dispute, ne lui fit point de tort auprès de l'empereur Ferdinand, qui le nomma son confesseur, & lui donna pour récompense de ses travaux l'évêché de Vienne. Erasme en ayant appris la nouvelle, dit que Luther, malgré sa pauvreté, trouvoit encore le moyen d'enrichir ses ennemis. Jean Faber mourut à Vienne en 1541, âgé de 63 ans. (D.J.)
|
| LEUTMÉRITZ | Litomerium, (Géog.) ville de Bohème, capitale du cercle de même nom, avec un évêché suffragant de Prague, érigé en 1655. Elle est sur l'Elbe, à 8 milles N. O. de Prague, & à 10 S. E. de Dresde. Long. 31. 50. lat. 50. 34. (D.J.)
|
| LEVACI | (Géog. anc.) ancien peuple de la Gaule, entre les Eliens & les Nerviens, selon César, de bell. gall. lib. V. cap. xxxix. Nicolas Samson conjecture que le pays de la Loeuvre, entre la Flandres & l'Artois, ou le pays de Vaes en Flandres, répond au nom de ce peuple. (D.J.)
|
| LEVAGE | S. m. (Jurisprud.) qui est aussi appellé petite coutume, c'est-à-dire une même prestation ou redevance dûe, suivant la coutume & l'usage, est une espece de layde qui appartient au seigneur justicier pour les denrées qui ont séjourné huit jours en son fief, & y ont été vendues & transportées en autre main, & mises hors de ce fief ; il est dû par l'acheteur, & le seigneur prend aussi ce droit sur les biens de ses sujets qui vont demeurer hors son fief : ce droit ne doit point excéder cinq sols. Voyez la coutume d'Anjou, art. 9, 10, & 30. & celle du Maine, art. 10, 11, & 35. (A)
|
| LEVAIN | S. m. (Chimie) voyez FERMENT, Chimie.
LEVAIN, (Boulanger) est un morceau de pâte de la fournée précédente qu'on laisse aigrir pour le délayer ensuite avec la pâte qu'on fait le lendemain, la soutenir & la faire lever. On fait quelquefois aigrir le levain avec du sel & de la levûre de biere, quand il y a trop peu de tems jusqu'à la prochaine fournée, pour qu'il puisse s'aigrir naturellement.
|
| LEVANA | S. f. (Mythol.) divinité tutélaire des enfans ; elle présidoit à l'action de celui qui levoit un enfant de terre : car quand un enfant étoit né, la sage-femme le mettoit par terre, & il falloit que le pere ou quelqu'un de sa part, le levât de terre, & le prit entre ses bras, sans quoi il passoit pour illégitime. La déesse Levana avoit ses autels à Rome, où on lui offroit des sacrifices. Voyez Dempster, Paral. ad Rosin. antiq. lib. II. cap. xix. (D.J.)
|
| LEVANT LE | L'ORIENT, s. m. (Gramm.) ces deux mots sont quelquefois synonymes en Géographie, comme le sont le couchant & l'occident ; mais on ne les emploie pas toûjours indifféremment. Lorsqu'il s'agit de commerce & de navigation, on appelle le Levant toutes les côtes d'Asie, le long de la Méditerranée, & même toute la Turquie asiatique ; c'est pourquoi toutes les échelles depuis Alexandrie en Egypte, jusqu'à la mer Noire, & même la plûpart des îles de l'Archipel, sont comprises dans ce qu'on nomme le Levant. Nous disons alors voyage du Levant, marchandises du Levant, &c. & non pas voyage d'Orient, marchandises d'Orient, à l'égard de ces lieux-là. Cela est si bien établi, que par Orient, on entend la Perse, les Indes, Siam, le Tonquin, la Chine, le Japon, &c. Ainsi le Levant est la partie occidentale de l'Asie, & l'Orient est tout ce qui est au-delà de l'Euphrate. Enfin, quand il n'est pas question de commerce & de navigation, & qu'il s'agit d'empire & d'histoire ancienne, on doit toûjours dire l'Orient, l'empire d'Orient, l'église d'Orient. Les anciens auteurs ecclésiastiques, par une licence de leur profession, entendent souvent par l'Orient, le patriarchat d'Antioche, qu'ils regardoient comme la capitale de l'Orient. (D.J.)
LEVANT, (Astronomie) est la même chose que l'orient. Ainsi on dit le soleil est au levant, pour dire qu'il est à l'orient. Voyez ORIENT, EST, &c.
Il est aussi adjectif dans ce sens, le soleil levant. Voyez LEVER.
LEVANT, en Géographie, signifie les pays situés à notre orient.
Ce mot se restreint généralement à la Méditerranée, ou plutôt aux pays qui sont situés à l'orient de cette mer par rapport à nous. De-là le commerce que nous y faisons est nommé commerce du levant : on dit aussi vent du levant, en parlant de celui qui souffle au sortir du détroit de Gibraltar. Chambers. (O)
LEVANT & COUCHANT, (Jurisprud.) en matiere de justice & de corvées, on ne considere comme sujets du seigneur que ceux qui sont levans & couchans dans l'étendue de la seigneurie. (A)
|
| LEVE | S. f. (Jeu de mail) est une espece de cuillere dont le manche est à la hauteur de la main, qui sert à lever & jetter sur la passe une petite boule d'acier faite exprès.
|
| LEVÉ | (Gramm.) participe du verbe lever. Voyez LEVER.
LEVEE, s. m. en Musique, c'est le tems de la mesure où on leve la main ou le pié. C'est un tems qui suit & précede le frappé. Les tems levés sont le second à deux tems, & le troisieme à trois & à quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mesure à quatre tems, levent le second & le quatrieme. Voyez ARSIS. (S)
LEVE, en terme de Blason, se dit des ours en pié. Orly en Savoie, ou Orlier, d'or, à l'ours levé en pié de sable.
|
| LEVÉE | subst. fem. (Hydr.) voyez JETTEE. La nécessité de faire des levées ou digues aux rivieres peut venir de plusieurs causes : 1°. si les rivieres sont tortueuses, les eaux rongent les bords & les percent, après quoi elles se répandent dans les campagnes. 2°. Les rives peuvent être foibles, comme celles que les fleuves se sont faites eux-mêmes par la déposition des sables. 3°. Les fleuves qui coulent sur du gravier fort gros, sont sujets dans leurs crues à en faire de grands amas, qui détournent ensuite leur cours. Eloge de M. Guglielmini, Hist. acad. 1710. Voyez FLEUVE & DIGUE.
LEVEE, (Politiq.) il se dit d'un impôt. Exemples : la misere des peuples a rendu la levée des impôts difficile.
LEVEE, (Jurisprud.) est un acte qui s'applique à divers objets.
On dit la levée des défenses ou d'une opposition, la levée des scellés. Voyez DEFENSES, OPPOSITION, SCELLES, & ci-après LEVER. (A)
LEVEE, (Marine) il y a de la levée, c'est-à-dire que le mouvement de la mer la fait s'élever, & qu'elle n'est pas tout-à-fait calme & unie.
LEVEE des troupes, (Art milit.) ces mots expriment l'action d'enroller des hommes au service des troupes, soit pour en former des corps nouveaux, soit pour recruter les anciens.
Cette opération aussi importante que délicate ne devroit être confiée qu'à des officiers d'une expérience & d'un zele éprouvés ; puisque du premier choix des soldats dépendent la destinée des empires, la gloire des souverains, la réputation & la fortune des armes. Elle a des principes généraux avoués de toutes les nations, & des regles particulieres à chaque pays. Voici celles qui sont propres à la France.
La levée des troupes y est ou volontaire, ou forcée. La premiere se fait par engagement pour les troupes réglées ; la seconde, par le sort pour le service de la milice : l'une & l'autre ont leurs principes & leurs procédés particuliers. Nous essayerons de les faire connoître en suivant l'esprit & la lettre des ordonnances & réglemens militaires, & les décisions des ministres.
Troupes réglées. Il est défendu à tous sujets du roi de faire, ordonner ou favoriser aucunes levées de gens de guerre dans le royaume, sans exprès commandement de sa majesté, à peine d'être punis comme rebelles & criminels de lese-majesté au premier chef ; & à tous soldats sous pareille peine de s'enrôler avec eux.
Au moyen du traitement que le roi accorde aux capitaines de ses troupes, ils sont obligés d'entretenir leurs compagnies complete s, en engageant des hommes de bonne volonté pour y servir.
L'engagement est un acte par lequel un sujet capable s'engage au service militaire d'une maniere si étroite qu'il ne peut le quitter sous peine de mort, sans un congé absolu, expédié dans la forme prescrite par les ordonnances. Un engagement peut être verbal ou par écrit ; il doit toujours être volontaire. Les ordonnances militaires de France en ont fixé le prix à trente livres, l'âge à seize ans, & le terme à six.
Le prix réglé à trente livres, les cavaliers, dragons ou soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu'ils n'ayent restitué ce qu'ils auroient reçu au-delà de cette somme, ou qu'ils n'ayent servi trois années de guerre au-delà du tems de leur engagement, ou rempli consécutivement deux engagemens de six ans chacun dans la même compagnie.
L'âge fixé à seize ans, les engagemens contractés au dessous de cet âge sont nuls, & les engagés en ce cas ne peuvent être forcés de les remplir, ni punis de mort pour le crime de désertion.
Enfin le terme à six ans, il ne doit pas en être formé pour un moindre tems, à peine de nullité des engagemens, & de cassation contre l'officier qui les auroit reçu ; & les cavaliers, dragons & soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu'après avoir porté les armes & fait réellement service pendant six années entieres du jour de leur arrivée à la troupe, sans égard aux absences qu'ils pourroient avoir faites pour leurs affaires particulieres.
Ceux qui sont admis aux places de brigadiers dans la cavalerie & les dragons, & à celles de sergent, caporal, anspessade & grenadier dans l'infanterie, doivent servir dans ces places trois ans au-delà du terme de leurs engagemens. Ces trois années ne sont comptées pour ceux qui passent successivement à plusieurs hautes-payes, que du jour qu'ils reçoivent la derniere. Il leur est libre de renoncer à ces emplois & aux hautes-payes, pour se conserver le droit d'obtenir leurs congés à l'expiration de leurs engagemens.
La taille nécessaire pour ceux qui prennent parti dans les troupes réglées n'est pas déterminée par les ordonnances ; elle l'est à cinq piés pour les miliciens. Chez les Romains, l'âge militaire étoit à dix-sept ans. Végece conseilloit de comprendre dans les levées ceux qui entrent en âge de puberté, doués d'ailleurs d'une complexion robuste & des autres indices extérieurs qui décelent un sujet d'espérance. " Ne vaut-il pas mieux, dit cet auteur, qu'un soldat tout formé se plaigne de n'avoir pas encore la force de combattre, que de le voir désolé de n'être plus en état de le faire " ?
La taille militaire dans la primitive Rome étoit de cinq piés dix pouces romains au moins, c'est-à-dire d'environ cinq piés quatre pouces de roi. Le témoignage de quelques anciens ajoute même à cette hauteur, dont sans doute on fut ensuite souvent obligé de se relâcher. Quoi qu'il en soit de ces tems éloignés, les circonstances & le besoin rendent aujourd'hui les officiers plus ou moins délicats sur cet article ; ils doivent l'être toujours beaucoup dans le choix des sujets propres aux exercices & fonctions militaires, sur la connoissance des lieux de leur naissance & de leur conduite. Ces précautions sont très-importantes pour le service & l'ordre public. Le ministere porte son attention sur tous ces objets ; en faisant faire exactement, par les maréchaussées, la vérification des signalemens de tous les hommes de recrue des troupes du roi, & renvoyer aux frais des capitaines ceux qui ne sont pas propres au service.
C'est une maxime généralement reçue, confirmée par l'expérience, que la puissance militaire consiste moins dans le nombre que dans la qualité des troupes. On ne peut donc porter trop d'attention & de scrupule dans le choix des sujets destinés à devenir les défenseurs de la patrie. Une physionomie fiere, l'oeil vif, la tête élevée, la poitrine & les épaules larges, la jambe & le bras nerveux, une taille dégagée, sont les signes corporels, qui pour l'ordinaire, annoncent dans l'ame des vertus guerrieres. Un officier d'expérience, attentif sur ces qualités, se trompera rarement dans son choix. Il y ajoutera, s'il est possible, le mérite de la naissance & des moeurs, & préférera la jeunesse de la campagne à celle des villes. La premiere nourrie dans la soumission, la sobriété & la peine, supporte plus constamment les fatigues de la guerre & le joug de la discipline : la seconde élevée dans la molesse & la dissipation, joint peut-être à plus d'intelligence une valeur égale, mais elle succombe plutôt aux travaux d'une campagne pénible, ou aux fatigues d'une marche difficile : elle porte d'ailleurs trop souvent dans un corps un esprit de licence & de sédition, contre lequel la discipline est forcée d'employer des correctifs violens, dont l'exemple même rendu trop fréquent n'est pas exemt de danger.
Différentes qualités militaires distinguent aussi les nations. Le soldat allemand est plus robuste, l'espagnol plus sobre, l'anglois plus farouche, le françois plus impétueux : la constance est le caractere du premier, la patience du second, l'orgueil du troisieme, l'honneur du quatrieme. Nous disons l'honneur, & nous ne disons pas trop ; il n'importe qu'il ait sa source dans l'éducation guerriere du soldat françois, ou qu'il soit emprunté de l'exemple de l'officier, il existe & domine dans le coeur du soldat, il l'agite, l'éleve & produit les meilleurs effets. Ce sentiment est uni dans nos soldats aux qualités naturelles les plus heureuses, & nous osons assûrer qu'il nous reste peu de pas à faire pour les rendre supérieurs à tous ceux des autres nations, graces aux soins continuels du ministere pour la perfection de la discipline, aux talens de nos officiers majors, & au goût des études militaires qui se répand dans l'ordre des officiers en général.
Après le choix & l'enrôlement des soldats à Rome, on leur imprimoit des marques ineffaçables sur la main, ils prêtoient serment & juroient de faire de bon coeur tout ce qu'on leur commanderoit, de ne jamais déserter & de sacrifier leur vie pour la défense de l'empire. On demande avec raison pourquoi les modernes ont négligé ou aboli ces anciennes pratiques de police militaire, dont les signes permanens & l'appareil religieux imprimoient au guerrier la crainte de faillir & le respect. Elles seroient peut-être le préservatif le plus puissant contre ces mouvemens inquiets & irrésistibles qui sollicitent, & trop souvent déterminent le soldat à la désertion, malgré la terreur du châtiment capital dont son crime est menacé.
Les propositions d'engagemens qui présentent des conditions évidemment excessives & illusoires, ne peuvent être regardées comme sérieuses, ni opérer d'engagemens valables : mais en ce cas, les badinages sur ce qui regarde le service militaire, ne doivent pas rester impunis.
Les engagemens ne mettent point à couvert des decrets judiciaires ; il est même défendu d'enrôler des sujets prévenus de la justice, des libertins, & même ceux qui ont déja servi, s'ils ne sont porteurs de congés absolus d'un mois de date au moins.
Quoique le terme des engagemens soit fixé à six ans, le roi trouve bon néanmoins que les soldats congédiés par droit d'ancienneté puissent être enrôlés pour un moindre tems, soit dans la même compagnie, soit dans une autre du même corps, pourvu que ce soit pour une année au moins ; sa Majesté permet aussi aux régimens étrangers à son service de recevoir des engagemens de trois ans.
Un soldat enrôlé avec un capitaine ne peut être réclamé par un autre capitaine, auquel il se seroit adressé précédemment : l'usage est contraire dans le seul régiment des gardes françoises.
Les capitaines peuvent enrôler les fils de gentilshommes & d'officiers militaires ; mais il est d'usage de leur accorder leurs congés absolus, lorsqu'ils sont demandés. Cette pratique s'observe aussi en faveur des étudians dans les universités du royaume, en dédommageant les capitaines.
Il est défendu à tous officiers d'enrôler les matelots classés, & les habitans des îles de Ré & d'Oleron. Pareilles défenses sont faites, sous peine de cassation, d'engager les miliciens, & aux miliciens de s'engager sous peine des galeres perpétuelles.
Les soldats de l'hôtel royal des Invalides ne peuvent être enrôlés qu'avec permission du secrétaire d'état de la guerre.
Les ordonnances défendent aux capitaines françois d'enrôler des soldats nés sous une domination étrangere, à l'exception de ceux de la partie de la Lorraine située à la gauche de la riviere de Sare, & de ceux de la Savoie & du comtat Venaissin ; & par réciprocité, il est défendu aux capitaines des régimens étrangers au service du roi de recevoir dans leurs compagnies aucuns sujets françois, même de la partie de la province de Lorraine, située sur la gauche de la Sare : en conséquence tout sujet du roi engagé dans un corps étranger au service de sa majesté peut être reclamé par un capitaine françois, en payant trente livres de dédommagement au capitaine étranger ; & réciproquement tout sujet étranger servant dans un régiment françois, par un capitaine étranger, en payant pareil dédommagement au capitaine françois, pour servir respectivement dans leurs compagnies pendant six ans, à compter du jour qu'ils y passent, sans égard au tems pour lequel ils seroient engagés ou auroient servi dans les premieres compagnies ; l'intention de sa majesté étant que, pour raison de ces six années de service, il leur soit payé par les capitaines quinze livres en entrant dans la compagnie, & pareille somme trois années après. Hors ces cas, on ne peut obliger un soldat à servir dans un corps autre que celui pour lequel il s'est engagé.
Il est défendu aux capitaines d'enrôler aucun cavalier, dragon ou soldat des compagnies avec lesquelles ils sont en garnison, quoique porteur d'un congé absolu ; à peine aux capitaines de cassation, & de perdre le prix des engagemens, & aux engagés de continuer à servir dans les compagnies qu'ils auroient quittées.
Les Alsaciens peuvent, par le droit de leur naissance, servir également dans les régimens françois & allemands au service du Roi.
Les sujets de l'état d'Avignon & du comtat Venaissin, qui s'enrôlent dans les troupes de sa Majesté, ont trois jours pour se rétracter de leurs engagemens, en restituant l'argent qu'ils ont reçu, & payant en outre trente livres d'indemnité au capitaine ; & si étant engagés, ils désertent & entrent dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent répéter que l'habit, les armes & l'engagement qu'ils ont emportés.
Les capitaines étant autorisés, en vertu de leur état & commission, à faire des recrues, peuvent en charger des officiers subalternes ou des sergens, en leur donnant des pouvoirs par écrit : la nécessité, qui malheureusement fait étendre ces pouvoirs aux cavaliers, dragons & soldats, ouvre la porte à toutes sortes d'excès, de faussetés, de manoeuvres criminelles, toutes également contraires aux droits des citoyens qu'elles violent, & à la dignité du service qu'elles dégradent. Le malheur est encore, & nous souffrons d'être forcés de le dire, que ces pratiques odieuses couvertes du voile imposant du service du roi, trouvent communément un appui coupable & secret parmi les officiers même, en qui l'intérêt étouffe quelquefois le sentiment de la justice ; ensorte que ces pratiques demeurent souvent impunies, malgré les cris de l'opprimé, le zele des ministres, & toute la protection qu'ils accordent aux lois.
La connoissance & le jugement des contestations pour raison d'engagemens militaires, appartient aux intendans des provinces du royaume. C'est à eux qu'est spécialement confié, par cette attribution, le soin important & glorieux de défendre la liberté des sujets, contre les artifices & les violences des gens de guerre, sur le fait des engagemens ; & l'on auroit bien lieu de gémir, que dans un gouvernement aussi juste que celui sous lequel nous avons le bonheur de vivre, ces magistrats, par leur vigilance & l'autorité dont ils sont dépositaires, ne pussent enfin parvenir à détruire des abus aussi condamnables.
Nous espérons qu'on nous pardonnera d'avoir osé élever ici une foible voix dans la cause de l'humanité.
Milices. Elles souffrent beaucoup, sans doute, des moyens forcés qu'on est obligé d'employer pour recruter & entretenir les corps des milices ; mais ces moyens sont nécessaires : le législateur doit seulement s'occuper du soin d'en tempérer la rigueur, par tous les adoucissemens possibles, & de les faire tourner au profit de la société.
Les milices font la puissance naturelle des états ; elles en étoient même autrefois toute la force : mais depuis que les souverains ont à leur solde des corps de troupes toujours subsistans, le principal est devenu l'accessoire.
Le corps des milices de France est entretenu en paix comme en guerre, plus ou moins nombreux, suivant les conjonctures & les besoins, & forme, en tout tems, un des plus fermes appuis de notre monarchie environnée de nations puissantes, jalouses & toujours armées.
Le roi pour concilier l'intérêt de son service avec l'économie intérieure des provinces, par rapport à la culture des terres, ordonne en tems de paix, la séparation des bataillons de milice, lesquels en ce cas ne sont assemblés qu'une fois par an pour passer en revue, & être exercés pendant quelques jours.
C'est ainsi que sans nuire aux travaux champêtres, on prépare ces corps à une discipline plus parfaite ; & qu'on y cultive, dans le loisir de la paix, les qualités militaires qui doivent opérer leur utilité pendant la guerre.
Les intendans des provinces sont chargés de faire la levée des augmentations & des remplacemens qui y sont ordonnés ; ils fixent par des états de répartition le nombre d'hommes que chaque paroisse doit fournir relativement à sa force, & procedent à la levée, chacun dans leurs départemens, soit par eux-mêmes, soit par leurs subdélégués. Cette levée se fait, comme nous l'avons déja dit, par voie de tirage au sort entre les sujets miliciables ; il en faut au moins quatre pour tirer un milicien.
Les garçons sujets à la milice, de l'âge de seize ans au moins, de quarante au plus, & les jeunes gens mariés au-dessous de l'âge de vingt ans, de la taille de cinq piés au moins, sains, robustes, & en état de bien servir, doivent, sous peine d'être déclarés fuyards, se présenter au jour indiqué par devant le commissaire chargé de la levée, à l'effet de tirer au sort pour les communautés de leur résidence actuelle ; ils en subissent deux chacun : le premier regle les rangs par ordre numérique, le second décide ceux qui doivent servir.
Dans les paroisses où il ne se trouve pas dans la classe des garçons & celle des mariés au-dessous de vingt ans, le nombre de quatre miliciables pour chacun des miliciens demandés, on a recours aux hommes mariés au-dessus de l'âge de vingt ans & au-dessous de quarante. Ils tirent d'abord au sort pour fournir entr'eux les hommes nécessaires à joindre aux autres classes & compléter le nombre de quatre miliciables pour chaque milicien, & ceux que le sort a choisis, tirent ensuite concurremment avec les garçons & les jeunes mariés. Ceux des miliciables, garçons ou mariés, auxquels le sort est échu, sont sur le champ enregistrés & signalés dans le procès-verbal, & dès ce moment acquis au service de la milice. L'intérêt de la population sembleroit exiger que l'on n'y assujettit pas les hommes mariés ; aussi quelques intendans pénétrés de la nécessité de protéger les mariages, s'élevant au-dessus de la loi, préférent de tirer un milicien entre deux ou trois garçons, à l'inconvénient de faire tirer les hommes mariés ; d'autres les en dispensent à l'âge de trente ans ; mais ne seroit-il pas plus avantageux de les en dispenser tout-à-fait, & en même tems d'assujettir de nouveau au sort, les soldats des milices congédiés, qui après un intervalle d'années déterminé, depuis leur premier service, se trouveroient encore célibataires au-dessous de l'âge de quarante ans ? Cette nouvelle ressource mettroit en état d'accorder l'exemption absolue de milice aux hommes mariés, sans opérer un vuide sensible dans le nombre des sujets miliciables. Nous hasardons cette idée sur l'exemple à-peu-près semblable de ce qui se pratique dans le service des milices gardes-côtes du royaume.
Tout sujet miliciable convaincu d'avoir usé d'artifices pour se soustraire au sort dans le tirage, est censé milicien de droit, & comme tel condamné de servir à la décharge de sa paroisse, ou de celui auquel le sort est échu.
Le tems du service de la milice étoit de six années pendant la derniere guerre ; il a été réduit à cinq depuis la paix. Les soldats de milice reçoivent exactement leurs congés absolus à l'expiration de ce terme, à moins que les circonstances n'obligent à en suspendre la délivrance. Ce sont les intendans qui les expédient, & il est défendu aux officiers d'en donner aucun à peine d'être cassés. Voyez LICENCIEMENT.
Le service volontaire rendu dans les troupes réglées, ne dispense pas de celui de la milice.
Il ne doit y être admis aucun passager ni vagabond.
Il est défendu à tout milicien d'en substituer un autre à sa place, hors un frere qui se présente pour son frere, à peine contre le milicien de six mois de prison & de dix années de service au-delà du tems qu'il se trouvera avoir servi, de trois années de galeres contre l'homme substitué, & de cinq cent livres d'amende contre les paroisses qui auroient toléré la substitution. Cette disposition rigoureuse est ordonnée pour favoriser le travail des recrues des troupes réglées ; on s'en écarte dans quelques provinces par une facilité peut-être louable dans son motif, mais très-contraire par son effet au véritable intérêt du service.
Les fuyards de la milice, ceux qui se sont soustraits au tirage par des engagemens simulés, ou qui après avoir joint un régiment, restent plus de six mois dans la province, sont condamnés à dix années de service de milice.
Il est libre à un milicien qui a arrêté & fait constituer un fuyard en son lieu & place, de prendre parti dans les troupes réglées.
Les fuyards constitués n'ont pas le droit d'en faire constituer d'autres en leur place. V. FUYARD.
Les miliciens qui manquent aux assemblées indiquées de leurs bataillons, doivent être contraints d'y servir pendant dix années au-delà du terme de leur engagement.
Ceux qui désertent des quartiers d'assemblée, ou qui s'enrôlent dans d'autres troupes, sont condamnés aux galeres perpétuelles.
Il est défendu de donner retraite à aucun garçon sujet à la milice, à peine de cinq cent livres d'amende ; de faire ou tolérer aucune contribution ou cotisation en faveur des miliciens sous la même peine ; & aux miliciens de faire d'attroupement ou exaction sous prétexte du service de la milice, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Les soldats de milice sont assujettis comme ceux des autres troupes, aux peines portées par les ordonnances touchant les crimes & délits militaires.
Si dans une communauté où il faut plusieurs miliciens, deux freres ayant pere ou mere se trouvent dans le cas de tirer, & que l'un deux tombe au sort, l'autre en est exempté pour cette fois. S'il s'en trouve trois, & que les deux premiers soient faits miliciens, le troisieme est tiré du rang, & ainsi à proportion dans les autres cas, de maniere qu'il reste aux peres ou meres au-moins un de plusieurs enfans sujets à la milice.
Sont exempts du service de milice, les officiers de justice & de finance & leurs enfans ; les employés aux recettes & fermes du roi ; les médecins, chirurgiens & apoticaires ; les avocats, procureurs, notaires & huissiers ; les étudians dans les universités & les colléges depuis un an au moins ; les commerçans & maîtres de métiers dans les villes où il y a maîtrise ; les sujets des pays étrangers domiciliés dans le royaume ; les maîtres des postes aux lettres & aux chevaux, & pour ceux-ci un postillon par quatre chevaux ; les laboureurs faisant valoir au-moins une charrue, & un fils ou domestique à leur choix, s'ils en font valoir deux ; les valets servant à la personne des ecclésiastiques, des officiers, gentilshommes & autres.
On se plaint depuis long tems de voir jouir de cette exemption, les valets aux personnes ; à la faveur d'un tel privilege, cette classe oisive & trop nombreuse enleve continuellement & sans retour, au travail de la terre & aux arts utiles, ce qu'il y a de mieux constitué dans la jeunesse des campagnes, pour remplir les antichambres des grands & des riches. Tout bon citoyen espere du zele patriotique des ministres, une loi restrictive sur cet abus.
Il seroit trop long de détailler ici les autres classes qui jouissent de l'exemption de la milice, nous nous bornons à celle-ci, & renvoyons aux ordonnances pour le surplus.
Mais avant de terminer cet article, qu'il nous soit permis de jetter un regard sur l'ordre des laboureurs, cette portion précieuse des sujets qui mérite tant de considération & qui en a si peu : elle paroit avoir été trop négligée dans la dispensation des priviléges relatifs au service de la milice. Dans une de nos plus belles provinces, où l'agriculture languissoit par le malheur des tems, on lui a rendu sa premiere activité en augmentant, à cet égard, les priviléges de l'agriculteur.
Il a été reglé que les laboureurs qui feroient valoir une charrue, soit en propre, soit à ferme, & entretiendront au moins quatre chevaux toute l'année, quelle que soit leur cotte à la taille, outre l'exemption personnelle, en feront jouir un de leurs fils au-dessus de l'âge de seize ans, servant à leur labourage, ou à ce défaut un domestique.
Que ceux qui feront valoir plusieurs charrues en propre ou à ferme, ou entretiendront aussi toute l'année quatre chevaux par chacune, outre le privilege personnel, auront encore celui d'exempter par chacune charrue, soit un fils au-dessus de l'âge de seize ans servant à leur labourage, soit au défaut un domestique à leur choix.
Et en même tems que les maîtres de métiers où il y a maîtrise approuvée, qui ne seront pas mariés & n'auront pas l'âge de trente ans, seront sujets à la milice ; mais que ceux au-dessus de cet âge, qui exerceront publiquement leur profession à boutique ouverte dans les villes, en seront exempts.
Sur l'heureuse expérience de ces dispositions salutaires, ne seroit-il pas possible d'étendre leur influence aux autres provinces du royaume ? On ne peut sans gémir y voir l'état pénible & nécessaire du modeste laboureur, dans l'avilissement & l'oubli, tandis que des corps d'artisans bas ou frivoles y jouissent de prérogatives utiles & flatteuses, sous prétexte de chefs-d'oeuvres & de réceptions aux maîtrises.
C'est à la sagesse du ministere à établir la balance des priviléges & des encouragemens, à les dispenser aux uns & aux autres, & à déterminer jusqu'à quel degré ceux-ci doivent être subordonnés à celui-là, pour le plus grand avantage de la société.
Nous aurions desiré pouvoir resserrer les bornes de cet article trop étendu sans doute ; mais la nature du sujet ne nous l'a pas permis ; d'ailleurs nous avons tâché d'y suppléer à ce qui nous a paru manquer aux mots ENGAGEMENT & ENROLEMENT déja imprimés. Cet article est de M. DURIVAL, cadet.
LEVEE, (Chirurgie) il se dit de l'appareil. Ainsi assister à la levée de l'appareil, c'est être présent lorsqu'on le sépare de la blessure ou de la plaie.
LEVEE, (Agriculture) Il se dit de l'action de receuillir les grains sur la terre ; il se dit aussi de la récolte.
LEVEE, (Comm. d'étoffes) il se dit de la quantité d'étoffe qu'on prend sur la piece entiere, selon l'usage qu'on en veut faire.
LEVEES, voyez l'article MANUFACTURE EN LAINE.
LEVEE, ARC DE, (Horlogerie) c'est la partie de l'échappement par laquelle la force motrice est transmise sur le régulateur.
Si le régulateur est un pendule, il faut qu'il soit mis en mouvement avec la main : car la force motrice sur l'arc de levée seroit insuffisante pour le tirer du repos ; donc la force motrice ne doit agir sur cet arc, que pour entretenir le mouvement sur le régulateur.
Si le régulateur est un balancier avec son spiral, la force motrice sur l'arc de levée doit être suffisante pour le tirer du repos & lui faire parcourir entierement cet arc ; & dans ce cas elle communique donc le mouvement sur ce régulateur.
L'étendue de l'arc de levée est d'autant plus grande, que le levier qui est sur l'axe du régulateur est plus court, que le rayon de la roue est plus grand, & qu'elle est moins nombrée.
L'arc de levée ne varie point par le plus ou le moins de force motrice qu'il peut recevoir ; mais seulement dans le tems employé à parcourir : car plus cette force est grande, moins il emploie de tems.
Dans les pendules, il faut d'autant plus de force motrice que la lentille est plus pesante, la verge plus courte, les oscillations plus promtes, & que l'arc de levée est plus grand, & réciproquement.
Dans les montres, il faut d'autant plus de force motrice que le spiral est plus fort ; que les mouvemens du balancier sont plus petits, soit par sa grandeur, soit par sa masse ; que ses vibrations sont plus promtes ; & que l'arc de levée est plus grand, & réciproquement.
Par l'usage l'on donne dans les pendules d'autant moins d'arc de levée, que les oscillations sont plus lentes.
Au contraire dans les montres l'on donne d'autant moins de levée, que les vibrations sont plus promtes.
Déterminer exactement dans les pendules & dans les montres la force précise qui doit être employée sur l'arc de levée, pour communiquer aux unes, ou entretenir dans les autres le mouvement sur le régulateur, est un problème digne des plus grands Géometres. Mais ne craignons point de l'avouer, si notre théorie est en défaut, l'expérience y suppléera.
Si je dis que la théorie est en défaut, je ne veux pas dire qu'elle est impossible, mais seulement infiniment difficile, parce qu'elle tient à une bonne théorie de l'élasticité qui est encore à trouver ; & la question de déterminer la force précise qu'il faut sur l'arc de levée, en fournit une autre encore plus difficile. En effet, pourquoi les vibrations d'un balancier sont-elles accélérées par l'élasticité appliquée ? N'est-ce pas un obstacle de plus à surmonter pour la roue de rencontre ? Le balancier ne résiste-t-il pas au mouvement par sa grandeur & par sa masse, & le ressort spiral par sa roideur ? Comment donc se fait-il que cette derniere resistance diminue la premiere, & en accélere d'autant plus le mouvement, que cette roideur est plus grande ? Cependant, si l'on vient à augmenter la roideur du ressort spiral, soit en le rendant plus court, ou en en plaçant un autre plus fort, l'on arrivera facilement au terme où cette roideur sera si grande, qu'elle ne pourra pas être bandée par la force motrice transmise sur la roue de rencontre ; & alors le balancier restera en repos. De même si au lieu d'augmenter la roideur du spiral, l'on diminue la masse du balancier, les vibrations seront aussi accélérées ; & elles le seront d'autant plus, que les mouvemens du balancier seront réduits. Il sera même très-facile de parvenir au terme où elle seront tellement accélérées, que la force motrice ne sera plus suffisante pour le tirer du repos, & lui donner le mouvement ; & cela par la même raison qu'il l'a fait ci-dessus, en augmentant la roideur du ressort spiral.
L'on voit donc par l'union de l'élasticité à la masse ou pesanteur, que l'une augmente comme l'autre diminue & réciproquement.
Je n'entrerai pas dans les conjectures que je pourrois tirer de ce que je viens d'avancer, je dirai seulement que j'ai plusieurs fois réfléchi qu'on pouvoit tirer plus d'avantages que l'on ne fait de la force élastique. Par exemple, ne pourroit-on pas faire des leviers élastiques, pour remuer les blocs de pierre plus aisément qu'on ne le fait par des leviers inflexibles ? Les marteaux qui dans les grosses forges seroient soutenus par des leviers élastiques, n'augmenteroient-ils pas la force des coups ?
Mais pour revenir à notre question de mesurer la force précise & nécessaire pour entretenir le mouvement dans les pendules ; voici l'opération qu'il y a à faire.
La pendule étant toute montée & en repos, il faut faire décrire avec la main à son pendule l'arc de levée, ensuite l'abandonner avec délicatesse à la seule force motrice qui, si les arcs n'augmentent point, sera insuffisante pour l'entretenir en mouvement. Dans ce cas la pendule s'arrêtant bientôt, il faut augmenter la force motrice, ou diminuer le poids de la lentille, jusqu'à ce que la seule force motrice devienne capable de faire décrire au pendule des arcs doubles de l'arc de levée. Cet arc d'augmentation, nommé arc de supplément, ne sert qu'à exprimer une force surabondante, pour suppléer aux pertes de force qui peuvent survenir, tant du moteur que de la résistance, que la coagulation des huiles occasionne dans tout le rouage. Voyez ARC DE SUPPLEMENT.
Dans les montres ordinaires, pour trouver ou mesurer la force précise qui est nécessaire pour communiquer le mouvement au régulateur, il faut (la montre étant marchante & réglée) retenir le balancier très-légérement, & laisser agir la force motrice, jusqu'à ce que le balancier ait décrit l'arc de levée. Si elle arrête sur la fin de la levée, c'est ce qu'on appelle arrêter au doigt. Dans ce cas la puissance motrice étant trop foible, ou la resistance du régulateur étant trop grande, il faut donc augmenter l'une ou diminuer l'autre, en mettant un ressort plus fort, ou en affoiblissant le ressort spiral, & diminuant les mouvemens du balancier.
Il faut continuer cette opération jusqu'à ce que le balancier décrive un arc d'augmentation ; appellé aussi arc de supplément.
Mais comme cet arc de supplément n'augmente point en proportion de la force motrice, il suit que ce régulateur acheve plus promtement sa vibration ; ensorte qu'elle fait avancer la montre. Il faut donc continuer cette opération au point de la faire avancer d'une demie, pour prévenir l'arrêt du doigt qui peut arriver par la suite ; parce que j'estime que dans les montres ordinaires, la force motrice transmise sur le régulateur peut bientôt perdre une demie de sa puissance, soit par le ressort moteur, soit par la résistance que la coagulation de l'huile apporte dans les rouages. Il faut ensuite relâcher le ressort spiral ou l'affoiblir, pour faire retarder la montre, d'autant qu'on la fait avancer.
Il est à remarquer qu'il faut d'autant plus de force motrice surabondante dans les montres, qu'elles sont composées pour en exiger beaucoup : par exemple, celles dont les vibrations sont promtes, celles qui sont faites pour aller long-tems sans être remontées ; enfin celles dont les effets sont compliqués.
Si par ce qui précede l'on voit que dans les montres il faut beaucoup plus de force motrice surabondante à l'arc de levée pour leur continuer le mouvement que dans les pendules, cela vient de ce que les cas défavorables sont infiniment plus grands dans les montres, qui par-là sont aussi moins régulieres.
Plus il y aura dans les pendules & les montres d'uniformité dans la communication de la force motrice, plus les arcs de supplément seront égaux entr'eux ; & par conséquent plus elles seront régulieres.
L'on terminera cet article en disant, que l'art de l'horloger consiste d'un côté à rendre la force motrice la plus constante, & de l'autre à n'en point abuser en l'employant surabondamment ; car par-là on altéreroit l'isocronisme des oscillations ou vibrations sur les régulateurs.
Je me sers de l'arc de levée pour marquer le centre d'échappement en cette sorte. Ayant fait une marque sur le bord du balancier ; par exemple prenant la cheville de renversement pour point fixe, je fais décrire l'arc de levée à droite & à gauche, & je marque sur la platine ou sur le coq les termes de ces deux arcs qui n'en font plus qu'un, lesquels je divise en deux parties égales, & je marque le point de division sur la platine ; & lorsque je mets le balancier avec son spiral, je le retire ou le lâche jusqu'à ce que la cheville ou la marque faite au balancier se repose sur le point de division que j'ai marqué sur la platine : alors mon balancier est dans son échappement beaucoup plus parfaitement qu'on ne le pourroit faire en tâtonnant par la roue de champ, comme on le faisoit avant moi. Art. de M. Romilly, horl.
LEVEE, (Lingere) c'est une bande de toile qu'on sépare de la piece pour en faire un ouvrage, ou qu'on sépare d'un ouvrage quand il y en a plus qu'il ne faut.
LEVEE, (Méchan.) se dit aussi dans quelques machines, de ce qu'on appelle camme dans d'autres. Ce sont des éminences pratiquées sur un arbre qui tourne ; il y en a d'autres pratiquées à des pieces debout. Celle de l'arbre venant à rencontrer celles-ci, font relever la piece, s'échappent, & la laissent retomber : c'est le méchanisme des bocards.
LEVEE, (Maréchall.) en termes de courses de bague, se dit de l'action de celui qui court la bague lorsqu'il vient à lever la lance dans sa course pour l'enfiler.
LEVEE, terme de moulin à papier ; ce sont des morceaux de bois plats enfoncés de distance en distance dans l'arbre de la roue du moulin, & qui donnant le mouvement aux maillets qu'ils enlevent, les laissent retomber après, ce qui réduit les chiffons en bouillie. Voyez les Planches de Papeterie.
LEVEE, terme de riviere ; élévation formée aux deux extrémités d'un bateau, où elles forment un siege. Le batelier est assis sur une des levées, quelques-uns laissent les passans sur l'autre.
LEVEE, (Rubanerie) s'entend de toute portion de chaînes que les lisses ou lisettes font lever tantôt en grande quantité, tantôt en moindre, suivant le passage du patron. C'est toujours à travers cette levée que la navette passe la trame qu'elle contient, laquelle trame se trouve arrêtée, lorsque cette levée ayant fait son office lui fait place. On entend assez que cette levée est opérée par les marches, qui faisant toujours lever quelque portion que ce soit de la chaîne, pour donner passage à la navette, donne lieu à la fabrique de l'ouvrage.
LEVEE, terme de Tisserand, qui signifie la quantité d'ouvrage qu'un ouvrier peut faire sans être obligé de rouler sur l'ensuple de devant l'ouvrage qui est déja fait. Voyez TOILE.
LEVEE, (Jeu de cartes) Une carte est supérieure à une autre, à quelque jeu de carte que ce soit ; c'est-à-dire, que celui qui joue la supérieure, l'emporte de son côté. Toutes les cartes inférieures qui sont jouées sur la sienne, & la collection de ces cartes s'appelle une levée. Il y a autant de levées à chaque coup qu'on a de cartes en main ; & selon les conditions du jeu, il faut un certain nombre de levées pour gagner la partie.
|
| LEVENDI | S. m. (Hist. mod.) nom donné par les Turcs à leurs forces maritimes ; ils y admettent les Grecs & les Chrétiens sans distinction, ce qu'ils ne font point dans leurs troupes de terre, où ils ne reçoivent que des Mahométans.
|
| LEVENT | ou LEVANTI, s. m. (terme de relation) soldat turc de galere qu'on rencontre en assez grand nombre dans Constantinople. Comme ces gens-là ne sont que de la canaille qui court sur le monde le coutelas à la main, le gouverneur de la ville a permis de se défendre contr'eux, & l'on les met à la raison à coups d'épée & de pistolets. On a encore un moyen plus sage d'éviter leurs insultes, c'est de se faire escorter par des janissaires, qui ne demandent pas mieux, & pour lors on peut se promener dans Constantinople en toute sureté. (D.J.)
|
| LEVER | v. act. (Gramm.) terme relatif au mouvement de bas en haut. Voyez quelques-unes de ces acceptions, au simple & au figuré, aux articles LEVE, LEVEE, & ceux qui suivent.
LEVER, v. act. (Géom.) on dit, dans la Géométrie-pratique, lever un plan ; c'est prendre avec un instrument la grandeur des angles, qui déterminent la longueur & la disposition des lignes par lesquelles est terminé le terrein dont on se proposoit de lever le plan. Voyez PLANCHETTE, DEMI-CERCLE, GRAPHOMETRE, &c.
Lever un plan & faire un plan sont deux opérations très-distinctes. On leve un plan, en travaillant sur le terrein, c'est-à-dire, en prenant des angles & en mesurant des lignes, dont on écrit les dimensions dans un registre, afin de s'en ressouvenir, pour faire le plan ; ce qui consiste à tracer en petit sur du papier, du carton ou toute autre matiere semblable, les angles & les lignes déterminés sur le terrein dont on a levé le plan, de maniere que la figure tracée sur la carte, ou décrite sur le papier, soit tout-à-fait semblable à celle du terrein, & possede en petit, quant à ses dimensions, tout ce que l'autre contient en grand. Voyez PLAN, CARTE, &c. (E)
LEVER, s. f. terme d'Astronomie, c'est la premiere apparition du soleil, d'une étoile ou d'un autre astre sur l'horison, lorsqu'il ne fait que de sortir de l'hémisphere opposé à celui que le spectateur habite. Voyez HORISON, &c. voyez aussi AMPLITUDE.
La réfraction des rayons dans l'atmosphere avance le lever des corps célestes, c'est-à-dire, fait qu'ils paroissent sur l'horison, lorsqu'ils sont encore réellement dessous. Voyez REFRACTION.
Il y a pour les Poëtes trois sortes de levers des étoiles. Le lever cosmique, lorsqu'une étoile se leve avec le soleil. Voyez COSMIQUE.
Le lever acronyque, lorsqu'une étoile s'éleve en même tems que le soleil se couche. Voyez ACRONYQUE.
Le lever héliaque, solaire ou apparent. C'est celui d'une étoile qui paroît sortir des rayons du soleil proche l'horison, & cesse d'être cachée par l'éclat de cet astre, ce qui arrive environ 20 jours après la conjonction de l'étoile avec le soleil, le nombre de jours étant plus ou moins grand, selon la grandeur de l'étoile, la distance, &c. Voyez HELIAQUE.
Hésiode a remarqué, il y a long-tems, que Sirius étoit caché par le soleil l'espace de 40 jours, c'est-à-dire, 20 jours avant son lever cosmique, & 20 après. Quelques nations d'Amérique, entr'autres les sauvages de l'île de Cayenne, reglent leur année civile par le cours de Sirius, & la commencent au lever héliaque de cette étoile. Voyez CANICULE, CANICULAIRE & SIRIUS.
Pour trouver par le moyen du globe le lever, &c. d'une étoile ou du soleil, voyez GLOBE. Chambers. (O)
LEVER UN SIEGE, (Art milit.) c'est décamper de devant une place assiégée, & abandonner l'opération du siege lorsqu'il n'y a nulle apparence de pouvoir réduire la place.
On peut lever un siége par différentes raisons, comme par exemple lorsqu'il vient au secours une armée trop considérable pour qu'on puisse lui résister ; lorsque le siége a été commencé dans l'arriere saison, & que le mauvais tems & les maladies ne permettent pas d'avoir assez de monde pour résister à la garnison ; lorsqu'on manque de vivres & de munitions ; que l'ennemi a intercepté les convois qui venoient aux assiégeans, ou qu'il s'est emparé de leurs principaux magasins. Dans ces circonstances, on se trouve dans la triste nécessité d'abandonner le siége, c'est-à-dire de le lever.
Si l'on craint d'être incommodé par la garnison dans la retraite, on lui en cache le dessein.
On fait retirer de bonne heure les canons & les mortiers des batteries. On a soin de faire ramasser les outils & de les faire serrer. On fait partir l'attirail de l'artillerie & le bagage à l'entrée de la nuit, les tranchées & les places d'armes étant encore garnies de soldats qui font feu pour tromper l'ennemi.
Lorsque l'artillerie & le bagage se trouvent assez éloignés de la place pour n'en avoir rien à craindre, les troupes se mettent à la suite, en laissant des feux dans le camp de la même maniere que s'il étoit occupé par l'armée. On fait escorter le tout par de la cavalerie ou par de l'infanterie, suivant la nature du pays que l'on a à traverser.
Si l'on est obligé de se retirer avec précipitation, & qu'on ne puisse pas emporter avec soi toutes les munitions & tout ce qui concerne l'artillerie, on brûle & l'on gâte tout ce qui pourroit servir à l'ennemi.
Lorsque l'armée ne craint pas les attaques de la garnison, elle fait partir de jour tous ses bagages & son artillerie, & elle se met à la suite en ordre de bataille, prête à tomber sur la garnison, si elle sort de la place pour harceler l'armée dans sa retraite.
Quoiqu'on ne doive abandonner un siége que lorsqu'il est impossible de le continuer sans s'exposer à être battu, ou avoir son armée détruite par les maladies & par les intempéries de la saison, il est à propos néanmoins, dès qu'on s'apperçoit de la nécessité de le lever, de faire partir de bonne heure la grosse artillerie & les bagages qui pourroient retarder la marche de l'armée. On les envoie dans les lieux de sureté des environs, on se retire ensuite en bon ordre ; & si la garnison entreprend de harceler l'armée dans sa retraite, on repousse avec vigueur les différentes attaques qu'elle peut faire à l'arriere-garde.
Comme la levée d'un siége a ordinairement quelque chose d'humiliant, ce seroit bien réparer sa gloire, dit M. le marquis de Santacrux, en levant le siége d'une place, d'en secourir une autre prête à tomber au pouvoir de l'ennemi : mais il est rare de trouver des occasions de cette espece. Il y en a quelques autres où l'on peut abandonner un siége sans compromettre l'honneur du général. Par exemple, si l'on assiege une place dans l'intention d'attirer l'ennemi qui est éloigné, & qui fait la guerre avec trop de succès d'un côté ; si l'on parvient à l'obliger de les interrompre pour venir au secours de la place, la levée du siege, loin d'avoir rien d'humiliant, est au contraire une preuve de la réussite du projet qu'on avoit eu d'éloigner l'ennemi pour quelque tems d'un pays ou d'une province où il étoit difficile de résister à toutes ses forces. Cette espece de ruse peut donner le loisir de se fortifier contre lui, & faciliter les moyens de s'opposer à ses progrès.
Lorsqu'on est obligé de lever le siége d'une place, on détruit non-seulement ce qu'on ne peut emporter qui pourroit servir à l'ennemi ; mais l'on doit encore ravager une bonne partie du pays, afin, dit M. le marquis de Santacrux, que la désolation des peuples étouffe les voix de ceux qui voudroient chanter des triomphes. Il nous paroît que cette dévastation seroit bien foiblement justifiée par ce motif ; le véritable doit être de se dédommager, autant qu'il est possible, de la dépense du siége ; d'obliger l'ennemi de ravitailler le pays, & d'empêcher qu'il n'en tire aucun secours pour ses subsistances. (q)
LEVER (Jurisprud.) a différentes significations.
Quelquefois il signifie ôter un empêchement, comme lever des défenses, lever une opposition.
Lever des scellés, c'est ôter juridiquement les sceaux qui avoient été apposés sur quelque chose. Voyez SCELLE.
Lever un acte, c'est s'en faire délivrer une expédition.
Lever la main, c'est lorsqu'on éleve la main pour donner la solemnité ordinaire à une affirmation que l'on fait. Voyez AFFIRMATION.
Lever une charge aux parties casuelles, c'est acheter une charge qui étoit tombée aux parties casuelles. Voyez OFFICE & PARTIES CASUELLES.
Lever un corps mort, quand on parle d'officiers de justice, signifie faire le procès-verbal de l'état auquel on a trouvé un cadavre, & le faire transporter dans quelqu'autre endroit ; quand on parle d'un corps levé par un curé, vicaire, ou autre ecclésiastique faisant fonction curiale, signifie faire enlever le corps d'un défunt pour lui donner la sépulture. (A)
LEVER L'ANCRE. (Marine) Voyez ANCRE.
Lever l'ancre avec la chaloupe, c'est lorsqu'on envoie la chaloupe qui tire l'ancre par son orin, & qui la porte à bord.
Lever l'ancre d'affourché avec le navire, c'est lorsqu'on file du cable de la grosse ancre qui est mouillée, & que l'on vire sur l'ancre d'affourché jusqu'à ce qu'elle soit à bord.
Lever une amarre ou une manoeuvre, c'est démarer cette amarre ou cette manoeuvre. On dit leve l'amarre pour changer de bord, mais on ne dit pas leve l'écoute.
Lever le lof, c'est démarer le couet qui tient le point de la voile, & peser sur le cargue point.
Leve le lof de la grande voile ; c'est de cette sorte qu'on fait le commandement pour lever le grand lof. On dit leve le lof de misene, leve, lorsqu'on commande pour la voile nommée misene.
Lever la fourrure du cable, c'est ôter de dessus le cable la garniture de toile ou de corde qu'on y avoit mise pour sa conservation.
Lever les terres, c'est observer à quel air de vent les terres vous restent, & représenter sur le papier comment elles paroissent situées dans un certain point de vûe.
LEVER, en termes de Finances, c'est faire le recouvrement des droits dûs par les particuliers.
LEVER (Com.) de l'étoffe, du drap, de la serge, c'est acheter chez un marchand ces sortes de marchandises à l'aune, ou les faire couper à la piece. On dit en ce sens, je m'en vais lever tant d'aunes de drap ou de velours pour me faire un habit.
Lever boutique, c'est louer une boutique, & la remplir d'un assortiment de marchandises pour en faire négoce, & la tenir ouverte aux marchands qui se présentent pour acheter. Diction. de commerce.
LEVER, en terme de Blondier, c'est l'action de diviser les écales d'un tiers ; ce qui se fait à la main, & est d'autant moins difficile que ces écales sont distinguées visiblement les unes des autres. Voyez ECALES : on dit, lever les écales, & découper les centaines.
LEVER, faire la pâte, en terme de Boulangerie, c'est faire revenir la pâte dans des bannes, en toile. Voy. COUCHER LA PASTE.
LEVER, (Jardinage) on dit qu'une graine leve, quand elle commence à sortir de terre.
On dit encore, lever un arbre en motte ; opération qui demande des ouvriers adroits, mais admirable pour jouir en peu de tems d'un beau jardin.
Après avoir choisi un arbre dans la pepiniere, on le fera déchausser tout autour, avant les gelées, pour former une motte, à moins que la terre ne soit assez forte pour se soutenir d'elle-même. Si cette motte étoit grosse de trois ou quatre piés de tour, on la renfermeroit dans des claies ou manequins faits exprès pour la maintenir dans le transport ; on rafraîchit seulement les longues racines, c'est-à-dire, que l'on coupe leur extrémité, & on les étend dans le trou préparé en les garnissant de terre à l'ordinaire.
La maniere de planter & d'aligner ces arbres est toujours la même, il faut seulement observer de les arroser souvent & de les soutenir avec des perches contre les grands vents qui en empêcheroient la reprise.
LEVER LA LETTRE, terme d'Imprimeur, usité pour désigner l'action du compositeur lorsqu'il prend dans la casse les lettres les unes après les autres, qu'il les arrange dans le composteur pour en former des lignes, dont le nombre répété fait des pages, puis des formes. Voyez l'art. IMPRIMERIE.
LEVER, en Manege, est une des trois actions des jambes d'un cheval ; les deux autres sont l'arrêt & l'allure. Voyez AIR, &c.
Le lever des jambes du cheval pour les cabrioles, les courbettes, &c. est regardé comme bon, quand il le fait hardiment & à l'aise, sans croiser les jambes, sans porter les piés trop en-dehors ou en-dedans, & cependant en étendant les jambes suffisamment.
Il faut lever le devant à un cheval après l'arrêt formé. Voyez ARRET.
Lorsque le cheval est délibéré au terre-à-terre, on lui apprend à lever haut, en l'obligeant de plier les jambes le plus qu'il est possible, pour donner à son air une meilleure grace ; & quand il est bien délibéré à se lever haut du devant, on le fait attacher entre deux piliers pour lui apprendre à lever le derriere, & à ruer des deux jambes à-la-fois.
LEVER LE SEMPLE, (Manufacture en soie) c'est remonter les lacs & les gavassines d'un semple pour travailler l'étoffe.
LEVER, en terme de Vannerie, c'est plier les lattes du fond à une certaine distance pour faire le bord de la piece qu'on travaille.
|
| LEVERPOOL | ou LIVERPOOL, en latin Liserpalus, (Géog.) petite ville d'Angleterre, dans le comté de Lancastre, à 18 milles de Chester, 150 N. O. de Londres, & à l'embouchure du Mersey, dans la mer d'Irlande, où elle a un grand port ; elle a droit de députer au parlement. Long. 13. 30. & selon Strect, 14. 56. 15. lat. 53. 16. & selon Strect, 53. 22. (D.J.)
|
| LEVEURS | S. m. terme de Papeterie : c'est ainsi qu'on appelle les ouvriers qui levent les feuilles de papier de-dessus les feutres pour les placer sur le drapant, qui est une machine faite comme un chevalet de peintre, sur les chevilles de laquelle on met une planche ; c'est sur cette planche qu'on arrange les feuilles de papier les unes sur les autres. Voyez PAPIER, & les Planches de Papeterie.
|
| LEVI | ou LEVé, (Géog. anc.) & par Polybe, l. II. c. xvij. , Laoi, ancien peuple d'Italie, dans la Ligurie, proche les Insubriens, le long du Pô. Pline dit : les Leves & les Marigues bâtirent Ticinum (Pavie) près du Pô ; ainsi les Leves étoient aux environs de Pavie, & occupoient le Pavesan. (D.J.)
|
| LEVIATHAN | S. m. (Hist. nat.) nom que les Hébreux ont donné aux animaux cétacés, tels que les baleines.
LEVIATHAN, (Théol.) est le nom de la baleine dont il est parlé dans Job, chap. xlj. Les rabbins ont écrit de plaisantes choses de ce leviathan : ils disent que ce grand animal fur créé dès le commencement du monde, au cinquieme jour avec la femelle, que Dieu châtra le mâle, & qu'il tua la femelle, & qu'il la sala pour la conserver jusqu'à la venue du messie, qu'on régalera d'un grand festin où l'on servira cette baleine ou leviathan. Ce sont-là les fables des talmudistes touchant le leviathan, dont il est aussi fait mention dans les chapitres du rabbin Eliezer, & dans plusieurs autres auteurs juifs. Les plus sages néanmoins d'entr'eux, qui voyent bien que cette histoire du leviathan, n'est qu'une pure fiction, tâchent de l'expliquer comme une allégorie, & disent que les anciens docteurs ont voulu marquer le diable par cet animal leviathan. Il est certain que la plûpart des contes qui sont dans le talmud, & dans les anciens livres des Juifs, n'ont aucun sens, si on ne les prend allégoriquement. Samuel Bochart a montré dans son hierozoïcon, que leviathan est le nom hébreu du crocodile, pag. 2. l. IV. c. xvj. xvij. & xviij. Buxtorf, synagog. jud. & dictionn.
|
| LEVIER | S. m. en Méchanique, est une verge inflexible, soutenue sur un seul point ou appui, & dont on se sert pour élever des poids, laquelle est presque dépourvue de pesanteur, ou au-moins n'en a qu'une qu'on peut négliger. Ce mot vient du verbe lever, qui vient lui-même du latin elevare.
Le levier est la premiere des machines simples, comme étant en effet la plus simple de toutes, & on s'en sert principalement pour élever des poids à de petites hauteurs. Voyez MACHINE & FORCES MOUVANTES.
Il y a dans un levier trois choses à considérer, le poids qu'il faut élever ou soutenir, comme O, (Pl. de Méchanique, fig. 1.), la puissance par le moyen de laquelle on doit l'élever ou le soutenir comme B, & l'appui D, sur lequel le levier est soutenu, ou plutôt sur lequel il se meut circulairement, cet appui restant toûjours fixe.
Il y a des leviers de trois especes ; car l'appui C, est quelquefois placé entre le poids A & la puissance B, comme dans la figure premiere, & c'est ce qu'on nomme levier de la premiere espece ; quelquefois le poids A est situé entre l'appui C & la puissance B, ce qu'on appelle levier de la seconde espece, comme dans la fig. 2. & quelquefois enfin la puissance B est appliquée entre le poids A, & l'appui C, comme dans la fig. 3. ce qui fait le levier de la troisieme espece.
La force du levier a pour fondement ce principe ou théorème, que l'espace ou l'arc décrit par chaque point d'un levier, & par conséquent la vîtesse de chaque point est comme la distance de ce point à l'appui ; d'où il s'ensuit que l'action d'une puissance & la résistance du poids augmentent à proportion de leur distance de l'appui.
Et il s'ensuit encore qu'une puissance pourra soutenir un poids lorsque la distance de l'appui au point de levier où elle est appliquée, sera à la distance du même appui au point où le poids est appliqué, comme le poids est à la puissance, & que pour peu qu'on augmente cette puissance, on élevera ce poids. Voyez la démonstration de tout cela au mot PUISSANCE MECHANIQUE, & plus au long encore au mot BALANCE, machine qui a beaucoup d'analogie avec le levier, puisque le levier n'est autre chose qu'une espece de balance ou de peson pour élever des poids, comme la balance est elle-même une espece de levier.
La force & l'action du levier se réduisent facilement à des propositions suivantes.
1°. Si la puissance appliquée à un levier de quelque espece que ce soit, soutient un poids, la puissance doit être au poids en raison réciproque de leurs distances de l'appui.
2°. Etant donné le poids attaché à un levier de la premiere ou seconde espece, A B, fig. premiere, la distance C V, du poids à l'appui, & la distance A, C, de la puissance au même appui, il est facile de trouver la puissance qui soutiendra le poids. En effet, supposons le levier sans pesanteur, & que le poids soit suspendu en V, si l'on fait comme A C est à C V, le poids V du levier est à un quatrieme terme, on aura la puissance qu'il faut appliquer en A, pour soutenir le poids donné V.
3°. Si une puissance appliquée à un levier de quelque espece que ce soit, enleve un poids, l'espace parcouru par la puissance dans ce mouvement est à celui que le poids parcourt en même tems, comme le poids est à la puissance qui seroit capable de le soutenir ; d'où il s'ensuit que le gain qu'on fait du côté de la force est toûjours accompagné d'une perte du côté du tems & réciproquement. Car plus la puissance est petite, plus il faut qu'elle parcoure un grand espace pour en faire parcourir un fort petit au poids.
De ce que la puissance est toûjours au poids comme la distance du poids au point d'appui est à la distance de la puissance au même point d'appui, il s'ensuit que la puissance est plus grande ou plus petite, ou égale au poids, selon que la distance du poids à l'appui est plus grande ou plus petite, ou égale à celle de la puissance. De-là on conclura, 1°. que dans le levier de la premiere espece, la puissance peut être ou plus grande ou plus petite, ou égale au poids ; 2°. que dans le levier de la seconde espece, la puissance est toûjours plus petite que le poids ; 3°. qu'elle est toûjours plus grande dans le levier de la troisieme espece ; & qu'ainsi cette derniere espece de levier, bien loin d'aider la puissance quant à sa force absolue, ne fait au contraire que lui nuire. Cependant cette derniere espece est celle que la nature a employée le plus fréquemment dans le corps humain. Par exemple, quand nous soutenons un poids attaché au bout de la main, ce poids doit être considéré comme fixé à un bras de levier dont le point d'appui est dans le coude, & dont par conséquent la longueur est égale à l'avant-bras. Or ce même poids est soutenu en cet état par l'action des muscles dont la direction est fort oblique à ce bras de levier, & dont par conséquent la distance au point d'appui est beaucoup plus petite que celle du poids. Ainsi l'effort des muscles doit être beaucoup plus grand que le poids. Pour rendre raison de cette structure, on remarquera que plus la puissance appliquée à un levier est proche du point d'appui, moins elle a de chemin à faire pour en faire parcourir un très-grand au poids. Or l'espace à parcourir par la puissance, étoit ce que la nature avoit le plus à ménager dans la structure de notre corps. C'est pour cette raison qu'elle a fait la direction des muscles fort peu distante du point d'appui ; mais elle a dû aussi les faire plus forts en même proportion.
Quand deux puissances agissent parallelement aux extrémités d'un levier, & que le point d'appui est entre deux, la charge du point d'appui sera égale à la somme des deux puissances, de maniere que si l'une des puissances est, par exemple, de 100 livres, & l'autre de 200, la charge du point d'appui sera de 300. Car en ce cas les deux puissances agissent dans le même sens ; mais si le levier est de la seconde ou troisieme espece, & que par conséquent le point d'appui ne soit pas entre les deux puissances, alors la charge de l'appui sera égale à l'excès de la plus grande puissance sur la plus petite ; car alors les puissances agissent en sens contraire.
Si les puissances ne sont pas paralleles, alors il faut les prolonger jusqu'à ce qu'elles concourent, & trouver par le principe & la composition des forces (voyez COMPOSITION) la puissance qui résulte de leur concours.
Cette puissance, à cause de l'équilibre supposé, doit avoir une direction qui passe par le point d'appui, & la charge du point d'appui sera évidemment égale à cette puissance. Voyez APPUI.
Au reste, nous avons déjà remarqué au mot BALANCE, & c'est une chose digne de remarque, que les propriétés du levier sont plus difficiles à démontrer rigoureusement lorsque les puissances sont paralleles, que lorsqu'elles ne le sont pas. Tout se réduit à démontrer que, si deux puissances égales sont appliquées aux extrémités d'un levier, & qu'on place au point du milieu du levier une puissance qui leur fasse équilibre, cette puissance sera égale à la somme des deux autres. Cela paroît n'avoir pas besoin de démonstration ; cependant la chose n'est pas évidente par elle-même, puisque les puissances qui se font équilibre dans le levier, ne sont pas directement opposées les unes aux autres ; & on pourroit croire confusément, que plus les bras du levier sont longs, tout le reste étant égal, moins la troisieme puissance doit être grande pour soutenir les deux autres, parce qu'elles lui sont pour ainsi dire, moins directement opposées. Cependant il est certain par la théorie de la balance (voyez BALANCE), que cette troisieme puissance est toujours égale à la somme des deux autres ; mais la démonstration qu'on en donne, quoique vraie & juste est indirecte.
Il ne sera peut-être pas inutile d'expliquer ici un paradoxe de méchanique, par lequel on embarrasse ordinairement les commençans, au sujet de la propriété du levier. Voici en quoi consiste ce paradoxe : on attache à une regle A B, fig. 3. n°. 2. Méchan. deux autres regles F C, E D, par le moyen de deux clous B & A, & les regles F C, E D, sont mobiles autour de ces clous ; on attache de même aux extrémités de ces dernieres regles deux autres regles F E, C D, aussi mobiles autour des points C D ; ensorte que le rectangle F C D E, puisse prendre telle figure & telle situation qu'on voudra, comme f c d e, les points A & B, demeurant toûjours fixes. Au milieu de la regle F E, & de la regle C D, on plante vis-à-vis l'un de l'autre deux bâtons H G O, I N P, perpendiculaires & fixément attachés à la regle. Cela posé, en quelque endroit des bâtons qu'on attache les poids égaux H I, ils sont toûjours en équilibre, même lorsqu'ils ne sont pas également éloignés du point d'appui A ou B. Que devient donc, dit-on, cette regle générale, que des puissances égales appliquées à un levier, doivent être également distantes du point d'appui ?
On rendra aisément raison de ce paradoxe, si on fait attention à la maniere dont les poids H I agissent l'un sur l'autre. Pour le voir bien nettement, on décomposera les efforts des poids H I, (fig. 3. n. 3.) chacun en deux, dont l'un pour le poids H, soit dans la direction f H, & l'autre dans la direction H e ; & dont l'un pour le poids I, soit dans la direction C I, & l'autre dans la direction I D. Or l'effort C I se décompose en deux efforts C n & C Q ; & de même l'effort I D se décompose en deux efforts D n & D O. Donc la verge C D est tirée suivant C D par une force = C n + n D ; & l'on trouvera de même que la verge f e est tirée suivant f e par une force = f e. Donc puisque B C = B f, & C D = & parallele à f e, les deux efforts suivans C D & f e se font équilibre. Maintenant on décomposera de même l'effort suivant C Q en deux, l'un dans la direction de B C, lequel effort sera détruit par le point fixe & immobile B, l'autre suivant C D ; & on décomposera ensuite l'effort qui agit au point D, suivant C D en deux autres, l'un dans la direction D A, qui sera détruit par le point fixe A, & l'autre dans la direction D C ; & on trouvera facilement que cet effort est égal & contraire à l'effort qui résulte de l'effort C Q suivant C D. Ainsi ces deux efforts se détruiront : on en dira de même du point H ; ainsi il y aura équilibre.
Nous croyons devoir avertir que l'invention de ce paradoxe méchanique est dû à M. de Roberval, membre de l'ancienne académie des Sciences, & connu par plusieurs ouvrages mathématiques, dont la plupart ont été imprimés après sa mort. Le docteur Desaguiliers, membre de la société royale, mort depuis peu d'années, a parlé assez au long de ce même paradoxe dans ses leçons de Physique expérimentale, imprimées en anglois & in-4°. mais il n'a point cité M. de Roberval, que peut-être il ne connoissoit pas pour en être l'auteur.
Au reste il est indifférent (& cela suit évidemment de la démonstration précédente), que les points N G, (fig. 3. n. 2.) soient placés ou non au milieu des regles C D, F E. On peut placer les regles P I, H O, par-tout ailleurs en C D, F E, & la démonstration aura toujours lieu. Je dois avertir que l'équilibre dans la balance de Roberval (car c'est ainsi qu'on appelle cette machine), est assez mal démontré dans la plupart des ouvrages qui en ont parlé ; & je ne sais même s'il se trouve dans aucun ouvrage une démonstration aussi rigoureuse que celle que nous venons d'en donner.
J'ai dit plus haut que tout se réduisoit à démontrer que dans la balance à bras égaux, la charge est égale à la somme des deux poids. En effet, cette proposition une fois démontrée, on n'a qu'à substituer un appui fixe à l'un des deux poids, & au centre de la balance une puissance égale à leur somme, & on aura un levier, où l'une des puissances sera 1 & l'autre 2, & dans lequel les distances au point d'appui, seront comme 1 & 2. Voilà donc l'équilibre démontré dans le cas où les puissances sont dans la raison de 2 à 1 ; & on pourra de même le démontrer dans le cas où elles seront dans tout autre rapport : nous en disons assez pour mettre sur la voie de la démonstration les lecteurs intelligens. Ainsi toutes les lois de l'équilibre se déduiront toujours de la loi de l'équilibre dans le cas le plus simple. V. ÉQUILIBRE. (O)
LEVIER, dans l'art de bâtir, est une piece de bois de brin qui, par le secours d'un coin nommé orgueil, qui est posé dessous le bout qui touche à terre, aide à lever avec peu d'hommes une grosse pierre. Lorsqu'on pese sur le levier, on dit faire une pesée ; & lorsqu'on l'abat avec des cordages à cause de sa trop grande longueur & de la grandeur du fardeau, on dit faire un abatage ; ce qui s'est pratiqué avec beaucoup d'art & d'intelligence, pour enlever & poser les deux cimaises du grand fronton du Louvre. Voyez les notes de M. Perrault sur Vitruve, l. X. c. xviij.
LEVIER, (Charpente) est un gros bâton qui sert aux Charpentiers à remuer les pieces de bois, & à faire tourner le treuil des engins, &c. Sa longueur n'est point déterminée ; ceux des Charpentiers sont ordinairement de quatre à cinq piés. Voyez nos Pl. de Charpente & leur explic.
LEVIER, outil d'Horlogerie, qui sert à égaler la fusée au ressort. Voyez nos Pl. d'Horlogerie.
Il est composé d'une verge ou branche A B, un peu longue, d'une espece de pince E, dans laquelle il y a un trou quarré, qui sert à le faire tenir sur le quarré de la fusée, & d'un poids P, porté sur une autre petite verge V, qui a une piece percée quarrément, pour pouvoir s'ajuster & glisser sur la verge A B, qui doit être quarrée au-moins vers le bout. Les deux vis V S, serrent la pince de la maniere suivante. La vis marquée S, n'entre point dans la partie A de la mâchoire A a a ; son bout pose seulement dessus, & elle est vissée dans la partie E S ; de façon que lorsqu'on la tourne elle fait bercer cette mâchoire, & fait approcher le bout E de G. L'autre vis V passe au-travers la mâchoire E F, & se visse dans l'autre A G. Au moyen de cet ajustement on serre d'abord le quarré, que l'on met dans la pince, par la vis V ; ensuite on tourne l'autre S, afin que les extrémités E & G des deux mâchoires, pincent bien le quarré. Quand il n'y a que la seule vis V, la pince est sujette à bâiller par le bout ; ce qui fait que le levier saute de dessus le quarré de la fusée, d'où il arrive souvent que l'on casse le ressort & la chaîne.
Pour s'en servir, on met le barillet avec le ressort & la fusée dans la cage, & on ajuste la chaîne dessus, comme si on vouloit faire aller la montre ; notez qu'on n'y met aucune des autres pieces du mouvement. Ensuite on ajuste la pince E du levier sur le quarré de la fusée, & on l'y fait bien tenir au moyen des deux petites vis V S ; desorte qu'alors le levier est fixement adapté à ce quarré. Tout étant ainsi préparé, on se sert du levier comme d'une clef ; & faisant comme si l'on vouloit remonter la montre, on le tourne jusqu'à ce que la chaîne soit parvenue au haut de la fusée. Ce qui, comme nous l'avons dit à l'article FUSEE, bande le ressort d'autant de tours précisément, que la chaîne enveloppoit de fois le barillet. Cette opération faite, on lâche le levier, & on voit si lorsqu'il est horisontal, l'action du ressort sur la fusée fait équilibre avec le poids P, qui est à son extrémité.
Si elle l'emporte, on éloigne le poids de la pince E ; si au contraire c'est le levier, on l'approche de cette pince : car il est clair que par l'un ou par l'autre de ces mouvemens, on augmente ou l'on diminue la force du poids. Ces deux forces étant une fois en équilibre, on examine ensuite si cet équilibre a lieu dans tous les points de la fusée, depuis son sommet jusqu'à sa base. Si cela arrive, la fusée est égalée parfaitement, & transmettra au rouage une force toujours égale, malgré les inégalités de celle du ressort. Si au contraire cet équilibre n'a pas lieu, & que le ressort ait le moins de force vers sa base, quelquefois en le bandant un peu, on parvient à cet équilibre. Enfin, lorsque le ressort tire beaucoup plus fort par une partie de la fusée que par les autres, on la diminue ; & en variant ainsi la bande du ressort, & diminuant des parties de la fusée où le ressort tire trop fort, on parvient à égaler parfaitement la fusée au ressort. Voyez EGALER, RESSORT, FUSEE, BANDE, BARILLET, VIS SANS FIN, &c.
On voit facilement que la longueur de la verge ou branche A B, ne sert qu'à diminuer le poids, en conservant toujours le même mouvement, ce qui se fait pour diminuer le frottement du poids P sur les pivots de la fusée, & pour approcher davantage de l'état où elle se trouve lorsque la montre marche.
Cet outil autrefois n'avoit point de petite verge V, de façon que le poids P glissoit sur la grande A B ; mais M. le Roy ayant remarqué que cela augmentoit considérablement le frottement sur le pivot, auquel étoit attaché le levier, imagina cette petite verge, au moyen de laquelle en éloignant plus ou moins le poids P de la verge A B, on parvient à faire passer le centre de gravité de toute cette machine entre les deux pivots, ce qui distribue le frottement également sur l'un & sur l'autre.
LEVIER, (Jardin) est un bâton long de 3 à 4 piés, qui sert à pousser les terres sous les racines pour les garnir & empêcher qu'il ne se forme des caves.
|
| LÉVIGATION | S. f. (Pharmacie) l'action de réduire en poudre sur le porphyre. Voyez PORPHYRISER.
|
| LÉVIN | le lac de, Levinus lacus, (Géog.) lac de l'écosse méridionale, dans la province de Tife. Ce lac est remarquable par son île, où est un vieux château dans lequel la reine Marie d'Ecosse fut confinée. Il se décharge dans le golfe de Forth, par la riviere de même nom. (D.J.)
|
| LÉVITE | S. m. (Théol.) prêtre ou sacrificateur hébreu, ainsi nommé parce qu'il étoit de la tribu de Lévi.
Ce mot vient du grec , dont la racine est le nom de Lévi, chef de la tribu de ce nom, dont étoient les prêtres de l'ancienne loi. Ce nom fut donné à ce patriarche par sa mere Lia, du verbe hébreu lavah, qui signifie être lié, être uni, parce que Lia espéra que la naissance de ce fils lui attacheroit son mari Jacob.
Les Lévites étoient chez les Juifs un ordre inférieur aux prêtres, & répondoient à-peu-près à nos diacres. Voyez PRETRES & DIACRES.
Ils n'avoient point de terres en propre, mais ils vivoient des offrandes que l'on faisoit à Dieu. Ils étoient répandus dans toutes les tribus, qui chacune avoient donné quelques-unes de leurs villes aux Lévites, avec quelques campagnes aux environs pour faire paître leurs troupeaux.
Par le dénombrement que Salomon fit des Lévites, depuis l'âge de 20 ans, il en trouva trente-huit mille capables de servir. Il en destina vingt-quatre mille au ministere journalier sous les prêtres, six mille pour être juges inférieurs dans les villes, & décider les choses qui touchoient la religion, & qui n'étoient pas de grande conséquence ; quatre mille pour être portiers & avoir soin des richesses du temple, & le reste pour faire l'office de chantres. Voyez TEMPLE, TABERNACLE, &c. Diction. de Trévoux.
LEVITIQUE, s. m. (Théol.) ; c'est le troisieme des cinq livres de Moyse. Il est appellé le lévitique, parce qu'il y est traité principalement des cérémonies & de la maniere dont Dieu vouloit que son peuple le servît par le ministere des sacrificateurs & des Lévites.
LEVITIQUES, s. f. pl. (Hist. eccles.) branche des Gnostiques & des Nicolaïtes. Ils parurent dans les premiers siecles de l'Eglise. S. Epiphane les nomme.
|
| LEVONTINA | VALLEE, (Géog.) les Allemands disent Levinerthal ; vallée de Suisse, dans laquelle on descend du mont S. Gothard, lorsqu'on prend la route d'Italie. Ses habitans dépendent en partie de l'évêché de Milan pour le spirituel, & du canton d'Uri pour le temporel, en conséquence du traité de Lucerne conclu en 1466. (D.J.)
|
| LEVRAUT | S. m. (Chass.) c'est le petit d'un liévre : les meilleurs levrauts sont ceux qui naissent en Janvier ; pour s'assurer de la jeunesse d'un levraut de trois quarts, ou qui est parvenu à sa grandeur naturelle, il faut lui prendre les oreilles & les écarter l'une de l'autre ; si la peau se relâche, c'est signe qu'il est jeune & tendre ; mais si elle tient ferme, c'est signe qu'il est dur & que ce n'est pas un levraut, mais un lievre.
|
| LÉVRES | S. f. (Anat.), sont le bord ou la partie extérieure de la bouche ; ou cette extrémité musculeuse qui ferme & ouvre la bouche, tant supérieurement, qu'inférieurement. Voyez BOUCHE.
Les levres, outre les tégumens communs, sont composées de deux parties ; l'une est ferme, qui est dure & musculeuse ; l'autre intérieure, qui est molle, spongieuse & glanduleuse, & couverte d'une membrane fine, dont le devant & la portion la plus éminente est rouge, & se nomme en latin prolabia. Les auteurs se contentent ordinairement d'appeller spongieuse la partie intérieure des levres ; mais réellement elle est glanduleuse, comme on voit par les tumeurs scrophuleuses & carcinomateuses auxquelles elle est sujette. Les muscles dont la partie extérieure est composée, sont ou communs aux levres avec d'autres parties, ou sont propres. Les communs sont la troisieme paire des muscles du nez, le peaucier, & le buccinateur.
Les muscles propres des levres sont au nombre de douze paires, six incisifs, deux canins, quatre zygomatiques, deux rieurs, deux triangulaires, deux buccinateurs & un impair, le quarré de la lévre inférieure ; voyez-en la description à leur article.
Les arteres qui portent le sang aux levres sont des branches des carotides, & les veines vont se décharger dans les jugulaires externes. Les nerfs viennent de la cinquieme, de la septieme & de la huitieme paire de la moëlle allongée. Les lévres ont beaucoup de part à l'action de la parole, & servent beaucoup pour prendre la nourriture, &c.
LEVRES, ou grandes LEVRES, sont aussi les deux extrémités des parties naturelles de la femme, entre lesquelles est la fente ou vulve. On les nomme en latin, labia pudendi. Ce sont des corps mous & oblongs, d'une substance particuliere, & qu'on ne trouve dans aucune autre partie du corps.
On se sert aussi fort souvent du mot levre dans la description des os.
LEVRES, sont aussi les deux bords d'une plaie.
Voilà donc tout ce que l'anatomie sait de la structure de cette partie du visage, appellée les levres, qui après les yeux, a le plus d'expression. Les passions influent puissamment sur les levres ; la voix les anime, leur couleur vermeille y fixe les regards de l'amour. Secundus les nomme suaviorum delubra ; illa rosas spirant, ajoute-t-il, en parlant de celles de sa maîtresse, & tous les amans tiennent le même langage. Mais on peut dire avec plus de vérité, que chaque mot, chaque articulation, chaque son, produisent des mouvemens différens sur les levres ; on a vû des sourds en connoître si bien les différences & les nuances successives, qu'ils entendoient parfaitement ce qu'on disoit, en voyant comment on le disoit. C'est pour cela, que les Anatomistes ont tâché d'expliquer le méchanisme de tous ces mouvemens si variés, en disséquant à leur fantaisie, les muscles de cet organe. Mais premierement, leur travail n'aboutit qu'à des généralités fort incertaines. Le muscle buccinateur, disent-ils, applique les joues aux dents molaires ; l'orbiculaire ride, retrécit, ferme la bouche ; le grand & le petit incisif, dilatent les narines, & relevent la levre supérieure tout à la-fois ; les triangulaires & les canins rapprochent les coins de la bouche, &c. cependant tous ces usages sont d'autant moins sûrs, que le défaut & la varieté des jeux qu'on trouve dans ces muscles par la dissection, ne causent dans les vivans ni d'obstacle aux mouvemens de leurs levres, ni de différence d'avec les autres hommes. Ajoutez, que tous les muscles qui vont à la commissure des levres, forment dans cet endroit un tel entrelacement, qu'on ne sauroit le démêler, quelque habile qu'on soit dans l'art de disséquer. Enfin, la multiplication de tous ces muscles a été portée si loin, qu'il faut l'attribuer, ou à l'embarras de les séparer, ou à l'ouvrage du scalpel, plutôt qu'à celui de la nature.
Remarquons sur-tout ici, que les levres offrent à la méditation, une structure aussi curieuse que peu connue. Couvertes de peau & d'un tissu graisseux en dehors, elles sont tapissées d'une membrane glanduleuse en dedans ; elles paroissent de plus avoir un tissu spongieux, qui se gonfle & se dégonfle dans certaines occasions, indépendamment de l'action musculaire de leurs portions charnues. Le tissu qui forme le bout rouge des levres est encore plus singulier ; il ne ressemble en rien au tissu de la peau voisine ; son épaisseur est un amas de mamelons veloutés, longuets, très-fins, & très-étroitement collés ensemble ; ce tissu est couvert d'une peau subtile, qui paroît une continuation réciproque de l'épiderme, & de la pellicule qui s'étend sur la membrane glanduleuse de la cavité de la bouche. Ce tissu est d'une extrême sensibilité, comme le prouve l'attouchement le plus léger de la barbe d'un épi d'orge. Cette sensibilité devient fort incommode, quand la levre est tant soit-peu dépouillée de sa pellicule épidermique. Enfin, la membrane interne de la levre supérieure forme une petite bride mitoyenne au-dessus des premieres dents incisives ; on n'en connoît point l'usage ; Ruysch avoit une tête d'enfant injectée, où cette bride étoit double.
Les levres reçoivent leurs nerfs de la cinquieme paire de la moëlle allongée, & de la portion dure du petit nerf sympathique, dont les ramifications sont dispersées amplement sur toutes ces parties, sans qu'il soit possible d'en suivre le cours. En un mot, toute la structure des levres est fort étonnante. (D.J.)
LEVRES, plaies des (Chirurg.) les plaies des levres peuvent être faites avec des instrumens ou tranchans, ou émoussés.
Dans les plaies faites par des instrumens tranchans, les maîtres de l'art conseillent, soit que ces plaies soient longitudinales ou transversales, d'en faciliter la réunion avec des emplâtres agglutinatifs, & lorsque les plaies sont un peu considérables, de les saupoudrer avec quelque poudre consolidante, telle que celle de sarcocolle ou autre préparée avec la racine de consoude, la gomme adraganthe, & la gomme arabique. Si la plaie est si grande, qu'elle rende tous ces moyens inutiles, il faut nécessairement en procurer la réunion avec une suture.
Dans les plaies des levres, occasionnées par des corps émoussés, par une chûte, ou par des armes à feu ; la premiere chose qu'on doit faire, est de préparer la plaie à la suppuration, par quelque onguent digestif ; il faut ensuite la déterger & finalement en réunir les levres, par un emplâtre agglutinatif, ou par la suture, comme on la pratique pour le bec-de-lievre.
Dans toutes plaies des levres, on évitera de parler, & on n'usera que d'alimens qui ne demandent point de mastication. (D.J.)
LEVRE, s. f. (Botan.) M. de Tournefort a introduit en Botanique ce mot de levre, pour exprimer les découpures recourbées ou relevées des fleurs en gueule ; car on peut dire que ces découpures sont en quelque maniere un prolongement des mâchoires de ces sortes de gueules ; aussi les Botanistes ont donné à ces fleurs en général, le nom de fleurs labiées. Voyez FLEURS LABIEES, à l'article, FLEURS des Plantes, Botan. Syst. (D.J.)
LEVRES, (Conchyl.) en latin, orae ; ce sont les bords de la bouche d'une coquille. (D.J.)
LEVRE, en Architecture. Voyez CAMPANE.
LEVRE de Cheval (Maréch.) ; c'est la peau qui regne sur les bords de la bouche & qui environne les mâchoires. On dit qu'un cheval s'arme de la levre, ou se défend de ses levres, quand il les a si grosses, qu'elles couvrent les barres, en ôtent le sentiment, & rendent l'appui du mors sourd & pesant. Voyez BARRE.
Toute embouchure dont le canon est beaucoup plus large auprès des banquets, qu'à l'endroit de l'appui, empêche un cheval de s'armer des levres. Voyez CANON, EMBOUCHURE, BANQUET.
|
| LEVRIERS | S. f. (Chasse), sont chiens à hautes jambes, qui chassent de vîtesse à l'oeil & non par l'odorat ; ils ont la tête & la taille déliée, & fort longue : il y en a de plusieurs especes ; les plus nobles sont pour le lievre, & les meilleurs viennent de France, d'Angleterre & de Turquie ; ils sont très-vifs. Il y a des levriers à lievres, des levriers à loups, & tous les plus grands sont pour courre le loup, le sanglier, le renard & toutes les grosses bêtes ; ils viennent d'Irlande & d'Ecosse, & on les appelle levriers d'attaque, les petits levriers sont pour courre les lapins.
On appelle aussi levriers des levrons d'Angleterre qui chassent aux lapins : on appelle levriers harpés, ceux qui ont les devants & les côtés fort ovales, & peu de ventre.
Les levriers gigotés sont ceux qui ont les gigots courts & gros, & les os éloignés.
On les dit levriers nobles, quand ils ont la tête petite & longue, l'encolure longue & déliée, & le rable large & bien fait.
On nomme levriers ouvrés, ceux qui ont le palais noir.
On parle aux levriers en criant, oh levriers ; & quand ils chassent le renard, hare, hare.
|
| LEVROUX | (Géog.) en latin, Leprosum, ou Lebrosum ; ville de France, dans le Berry, élection d'Issoudun. Il est justifié que c'est une ville ancienne, par des vestiges de la grandeur romaine que l'on y remarque encore, tels que la place des arènes, & l'amphithéatre. D'ailleurs, on y a trouvé des médailles & des monnoies romaines. Au commencement du dernier siecle, on y découvrit une lame de cuivre, sur laquelle étoit cette inscription : Flavia Cuba, Firmiani filia, Colozzo Deo Marti suo, hoc signum fecit Augusto ; tout cela paroît prouver que les Romains ont autrefois habité ce lieu : Levroux, est au pied d'un côteau, à 5 lieues d'Issoudun, & à 15 de Bourges. M. de Valois croit que ce lieu fut ainsi nommé, à cause de la multitude de lépreux qu'il y avoit, ou peut-être à cause que c'étoit un endroit où on les recevoit dans des hôpitaux. Long. 19. 15. lat. 47. 2. (D.J.)
|
| LEVURE | S. f. (Brasserie) écume qu'on tire de la biere, lorsqu'elle fermente dans la cuve. Voyez DRECHE, BRASSER, &c.
On s'en sert comme de levain ou de ferment en faisant le pain, à cause qu'elle fait renfler la pâte en très-peu de tems, & qu'elle rend le pain plus léger & plus délicat. Lorsqu'on en emploie trop, le pain est amer. Voyez BOULANGERIE.
L'usage de la levure dans le pain est nouveau parmi nous, & il n'y a pas plus de 80 ans qu'il s'est introduit, d'abord par l'avarice des boulangers, & ce n'étoit en premier lieu que furtivement qu'ils l'employoient ; mais Pline assure que cet usage étoit connu des anciens Gaulois.
La faculté de Médecine par un decret du 24 Mars 1688, a déclaré que l'usage de la levure étoit nuisible à la santé ; mais elle n'a cependant pu empêcher qu'on ne s'en servît. Voyez BIERE, BRASSERIE, &c.
|
| LÉWARDE | Leowardia, (Géog.) belle, riche & grande ville des Pays-bas, dans la république des Provinces-unies ; elle est capitale de l'Ostergoo, du Westergoo & de Sevenwolden, la résidence du Stadhouder de la province, & le lieu du conseil souverain & de la chancellerie de toute la Frise. Les bâtimens tant publics que particuliers, sont beaux & propres. Elle est partagée par divers canaux, qui facilitent son commerce. Elle est située sur trois rivieres, à 11 lieues O. de Groningue, 24 N. de Déventer, 26 N. E. d'Amsterdam. Long. 23. 17. lat. 53. 12.
|
| LEWE | ou LEUW, LEUWE, (Géog.) petite ville de Brabant, dans les marais que fait la riviere de Jette, à 4 lieues de Louvain, 2 de Tillemont, 1 de S. Tron. Ses écluses la rendent très-forte. Long. 22. 45. lat. 50. 50.
|
| LEWENTZ | (Géog.) Leuca en latin moderne, ville de la haute Hongrie, au comté & sur la riviere de Gran, dans le gouvernement de Neuhausel, à 5 milles de cette ville, 9 N. E. de Gran. Long. 36. 58. lat. 48. 15.
|
| LEWES | Lesva, (Géog.) ville à marché d'Angleterre, dans le Sussex, sur une éminence. Elle est connue par la bataille qui s'y donna en 1264, sous Henri III. Elle envoie deux députés au parlement, & est à 4 milles de la mer, à 40 de Londres, & presque à mi chemin entre Chichester & la Rye. Long. 17. 40. latit. 50. 55. (D.J.)
|
| LEXIARQUE | S. m. (Antiq. grecq.) en grec , officier ou magistrat d'Athenes, employé principalement à tenir registre de l'âge & des qualités de l'esprit & du coeur de tous les citoyens qui pouvoient avoir droit de suffrage dans les assemblées.
M. Potter dans ses Archoeol. greques, liv. I. ch. xvj. dit que les lexiarques étoient au nombre de six en chef, assistés de trente autres personnes sous leurs ordres.
Ils enregistroient tous les citoyens capables de voter dans une des quatre tribus de la république. On tiroit ensuite de chacune de ces tribus un certain nombre de sujets pour former les prytanes de l'année, & travailler dans les différens bureaux où on les distribuoit, selon les matieres dont la discussion leur étoit renvoyée.
Comme l'on ne recevoit point dans l'assemblée les citoyens qui par le manque d'âge n'étoient pas encore enregistrés, aussi forçoit-on les autres de s'y trouver, & même à une certaine heure fixe.
Les lexiarques en sous-ordre, avec une corde teinte d'écarlate qu'ils tenoient tendue, les poussoient vers le lieu de l'assemblée ; & quiconque paroissoit avec quelque grain de cette teinture, portoit, pour ainsi dire, des livrées de paresse, qu'il payoit d'une amende, au lieu que l'on récompensoit de trois oboles l'exactitude & la diligence.
Tous les citoyens écrits dans le registre dont les lexiarques en chef étoient dépositaires, avoient voix délibérative dès l'âge de vingt ans, à moins qu'un défaut personnel ne leur donnât l'exclusion.
Ainsi l'on n'admettoit point aux voix les mauvais fils, les poltrons déclarés, les brutaux qui dans la débauche s'étoient emportés jusqu'à oublier leur sexe, les prodigues & les débiteurs du fisc.
Les femmes jusqu'au tems de Cécrops, avoient eu droit de suffrage ; elles le perdirent, dit-on, pour avoir favorisé Minerve dans le jugement du procès qu'elle eut avec Neptune, à qui nommeroit la ville d'Athenes.
Le mot lexiarque vient de , héritage, patrimoine, & , commander, parce que ces magistrats avoient la jurisdiction sur les sujets qui devoient decider des affaires, du bien & du patrimoine de la république. (D.J.)
|
| LEXICOGRAPHIE | S. f. (Gramm.) la Grammaire se divise en deux parties générales, dont la premiere traite de la parole, c'est l'Orthologie ; la seconde traite de l'écriture, & c'est l'Orthographe. Celle-ci se partage en deux branches, que l'on peut nommer Lexicographie & Logographie.
La Lexicographie est la partie de l'Orthographe qui prescrit les regles convenables pour représenter le matériel des mots, avec les caracteres autorisés par l'usage de chaque langue. On peut voir à l'article GRAMMAIRE, l'étymologie de ce mot, l'objet & la division détaillée de cette partie, & sa liaison avec les autres branches du système de toute la Grammaire ; & à l'article ORTHOGRAPHE, les principes qui en sont le fondement. (B. E. R. M.)
|
| LEXICOLOGIE | S. f. (Gramm.) l'Orthologie, premiere partie de la Grammaire, selon le système adopté dans l'Encyclopédie, se soudivise en deux branches générales, qui sont la Lexicologie & la Syntaxe. La Lexicologie a pour objet la connoissance des mots considérés hors de l'élocution, & elle en considere le matériel, la valeur & l'étymologie. Voyez à l'article GRAMMAIRE, tout ce qui concerne cette partie de la science grammaticale. (B. E. R. M.)
|
| LEYDE | Lugdunum Batavorum, (Géog.) ville des Provinces-unies, capitale du Rhinland ; elle est grande, riche, agréable, & la plus peuplée des Provinces-unies, après Amsterdam. C'est aussi une des six premieres villes de la Hollande, ayant 45 bourgs ou villages qui dépendent de son territoire ; mais son académie ou son université, fondée en 1565 par le prince d'Orange & les états de la province, est ce qui contribue le plus à son illustration.
On convient assez généralement du nom latin de Leyde : les Géographes la reconnoissent pour le Lugdunum Batavorum, dont Ptolémée fait une mention honorable, & que l'Itinéraire d'Antonin appelle Lugdunum ad Rhenum caput Germanorum. A l'égard de ses anciens noms du pays, Alting vous en instruira.
Il n'est pas aussi facile de décider du tems de sa fondation, quoiqu'il soit prouvé qu'elle est plus ancienne qu'Harlem, fondée en 406 par Lémus fils de Dibbald, roi des Frisons ; elle est même plus ancienne que Dort, puisque nous avons vu qu'elle étoit déja fameuse du tems de Ptolémée qui vivoit sous Antonin Pie, fondateur de Dort. Enfin, dans l'année 1090, on la regardoit pour une seigneurie considérable, & les comtes de Hollande lui donnerent des seigneurs héréditaires avec le titre de Burggraves.
Mais pour passer à des siecles moins reculés, ses citoyens se comblerent de gloire dans le siege que les Espagnols firent de leur ville en 1572, & qu'ils renouvellerent l'année suivante. Cette défense est un des plus grands témoignages historiques de ce que peut sur les hommes l'amour de la liberté. Les habitans de Leyde, souffrirent alors tout ce qu'il est possible d'imaginer de plus cruel. La famine & la peste les réduisirent à l'extrémité, sans leur faire perdre courage. Ils manderent leur triste état au prince d'Orange par le moyen des pigeons, pratique ordinaire en Asie, & peu connue des Européens ; ensuite, ils firent la même chose que les Hollandois mirent en usage en 1672, lorsque Louis XIV. étoit aux portes d'Amsterdam, ils percerent les digues ; les eaux de l'Issel, de la Meuse & de l'Océan, inonderent les campagnes, & une flotte de deux cent bateaux apporta du secours dans leur ville par-dessus les ouvrages des Espagnols. Vainement ceux-ci entreprirent de saigner cette vaste inondation, ils n'y purent réussir, & Leyde célebre encore aujourd'hui tous les ans, le jour de sa délivrance. La monnoie de papier qu'elle fabriqua avec la légende admirable qui peignoit les sentimens qui l'animoient, libertatis ergò, fut toute échangée pour de l'argent quand la ville se trouva libre.
Elle est très-avantageusement située sur le Rhin, dans une plaine, au milieu des autres villes de la Hollande, à une lieue de la mer, 3 de Delft, 6 S. E. de Harlem, 7 O. d'Utrecht, 8 S. O. d'Amsterdam, 6 N. O. de Rotterdam, & 9 de Dort. Long. suivant Zumbac, 22 d. 8'. 48''. lat. 52 d. 12'.
L'académie de Leyde est la premiere de l'Europe. Il semble que tous les hommes célebres dans la république des lettres, s'y sont rendus pour la faire fleurir, depuis son établissement jusqu'à nos jours. Jean Douza, Joseph Scaliger, Saumaise, Adrien Junius, Pierre Forest, Rember Dodonée, François Rapheleng, Jean Cocceius, François Gomar, Paul Merula, Charles Clusius, Conrard Vorstius, Philippe Cluvier, Jacques Arminius, Jacques Golius, Daniel Heinsius, Dominique Baudius, Paul Herman, Gerard Noodt, Schultens, Burmann, Vitriarius, s'Gravesande & Boerhaave, dont les grands éleves sont devenus les médecins des nations ; je ne dois pas oublier de joindre à cette liste incomplete , les Gronovius & les Vossius nés dans l'académie.
Les Gronovius nous ont donné tous les auteurs classiques, cum notis variorum ; mais nous devons à Jacques, mort en 1716 âgé de 71 ans, un nombre étonnant d'autres ouvrages, dont vous trouverez le catalogue dans les Mém. du P. Niceron tit. II. Je me contenterai de citer le Trésor des antiquités grecques, Lugd. Bat. 1697. en 13. vol. in-folio. Les meilleures éditions des anciens Géographes, Scylax, Agathamer, Palmerius, Manéthon, Etienne de Byzance, Pomponius Méla, Arrien, & la belle édition de Marcellin, Lugd. Bat. 1693. in-fol. & celle d'Hérodote, Lugd. Bat. 1715. in-folio. sont le fruit des veilles de cet illustre littérateur.
(Gérard Jean) Vossius, doit appartenir à Leyde, quoique né dans le Palatinat, parce que son pere l'emmena en Hollande, n'ayant que six mois, & qu'il y mourut en 1649 âgé de 72 ans. On connoît ses ouvrages latins sur l'origine de l'idolâtrie, les sciences mathématiques, les arts populaires, l'histoire du pélagianisme ; les historiens grecs & latins, les poëtes grecs & latins, le recueil étymologique de la langue latine, &c. On les a rassemblés à Amsterdam en 6 vol. in-folio. Il laissa cinq fils, Denis, François, Gérard, Matthieu, & Isaac, qui entre eux & leur pere ont rempli le xvij. siecle de leurs ouvrages. C'est à Isaac que M. Colbert écrivit en 1663 : " Monsieur, quoique le roi ne soit pas votre souverain, il veut néanmoins être votre bienfaiteur, & m'a commandé de vous envoyer la lettre de change ci-jointe, comme une marque de son estime, & un gage de sa protection. Chacun sait que vous suivez l'exemple du fameux Vossius votre pere, & qu'ayant reçu de lui un nom qu'il a rendu illustre par ses écrits, vous en conservez la gloire par les vôtres, &c. " Isaac Vossius mourut à Windsor en 1688, à 71 ans.
Pour ce qui est de Jean Douza (Jan Vander Does) que j'ai mis à la tête des hommes qui nés dans le sein de Leyde, ont fait fleurir cette ville ; il faut ajouter ici que son nom lui est doublement cher, nonseulement comme celui d'un aimable poëte & d'un savant, qu'on nommoit pour son érudition le Varron de la Hollande ; mais sur-tout celui d'un grand capitaine, au génie duquel elle fut redevable de sa liberté. Le prince d'Orange lui confia la défense de cette place, dans le fameux siege des Espagnols dont j'ai parlé, & que Requésens commandoit. Vander Doës, ne trompa point l'opinion favorable qu'on avoit de lui, il défendit constamment sa patrie avec la même valeur & la même sagesse. Doué d'un sang froid admirable, au milieu des plus grands dangers, il soutenoit le courage de ses compatriotes, & répondoit en vers au bas des lettres que le général espagnol lui adressoit pour se rendre, tout ce que l'esprit pouvoit dicter d'ingénieux, & de propre à tromper son ennemi. Il mourut comblé de gloire en 1597 à l'âge de 52 ans. (D.J.)
|
| LEYTE | LA, (Géog.) riviere d'Allemagne : elle a sa source aux confins de la Styrie & de la basse-Autriche, & finit par arriver à Owar, où elle se joint à une branche du Danube, qui forme le Schut.
|
| LEZ | LE, ou LETZ, (Géogr.) en latin Ledus ; petite riviere du Languedoc ; elle a sa source dans les Cévennes, coule près de Montpellier, & va se jetter dans la mer par l'étang de Tau, autrement dit l'étang du Pérotz. Voyez Hadrien de Valois, not. galliae, p. 263 & 267. (D.J.)
|
| LEZARD | S. m. (Hist. nat. Icthiolog.) poisson de mer qui a été ainsi nommé, parce qu'il a une belle couleur verte, & qu'il ressemble au lézard de terre par la forme du corps & de la bouche ; il a la tête grosse, la bouche ouverte, & les dents pointuës ; il devient long d'une coudée. Rondelet, hist. des poissons, liv. XV. Voyez POISSON.
LEZARD ECAILLEUX, lacertus indicus squamosus. Bot. animal quadrupede qui a trois ou quatre piés de longueur, & même jusqu'à six piés, selon Seba. Il a la tête oblongue & la bouche petite ; la langue est très-longue & cylindrique : l'animal la fait sortir au-dehors pour attirer dans sa bouche les insectes dont il se nourrit. Il n'a point de dents : on ne distingue pas le cou ; la queue est à-peu-près aussi longue que le corps : les doigts sont au nombre de cinq à chaque pié ; ils ont chacun un grand ongle. Le dessous & les côtés de la tête, le dessous du corps & la face interne des jambes, sont couverts d'une peau molle parsemée de quelques poils. Les autres parties sont revêtues de grandes écailles arrondies, striées & rousses ; il y a par-dessous quelques gros poils de même couleur : les écailles de la tête sont moins grandes que les autres. Cet animal se pelotonne en appliquant sa tête & sa queue contre son ventre : on le trouve au Brésil & dans les îles de Ceylan, Java & Formose. Voyez le regne animal par M. Brisson, qui donne au lezard écailleux le nom de pholidote, & qui fait mention d'une seconde espece sous le nom de pholidote à longue queue. Lacertus squamosus peregrinus, Rau : celui-ci n'a que quatre doigts à chaque piés, &c.
LEZARD d'Amérique, (Hist. nat.) Les îles de l'Amérique sont remplies d'une prodigieuse quantité de lézards de toutes les sortes. Le plus gros de ces reptiles, qu'on nomme à cet effet gros lézard, se tient dans les bois aux environs des rivieres & des sources d'eau vive ; on en rencontre qui ont près de cinq piés de longueur depuis le bout du nez jusqu'à l'extrémité de la queue. Toutes les parties de l'animal sont couvertes d'une peau rude, écailleuse, de couleur verte, marquée de petites taches brunes : son corps est porté sur quatre fortes pattes armées chacunes de cinq griffes. Sa tête est moyennement grosse ; il a la gueule fendue, les yeux gros & perçans, mais le regard farouche & colere ; il porte le long de l'épine du dos, depuis le col jusqu'à la naissance de la queue, une membrane mince, seche, élevée d'environ un pouce, & découpée en plusieurs pointes à-peu-près comme les dents d'une scie. Sous la gorge est une autre membrane plus déliée, un peu jaunâtre & comme chiffonnée : c'est une espece de poche qui s'enfle & s'étend lorsque l'animal se met en colere. Sa queue est forte, souple, trainante, diminuant d'une façon uniforme jusqu'à son extrémité comme un fouet de baleine ; elle est fort agile, & cause une sensation très-douloureuse à ceux qui en sont frappés.
La morsure du lézard n'est point venimeuse ; on doit cependant l'éviter, car l'animal est opiniâtre & ne quitte point qu'il n'ait emporté la piece ; il a la vie dure & résiste aux coups de bâton. Les femelles sont plus petites que les mâles ; la couleur verte de leur peau est beaucoup plus belle, & paroît comme surdorée. Après qu'elles ont été fécondées, on leur trouve dans le corps un assez bon nombre d'oeufs gros comme ceux de pigeons, un peu plus allongés & d'égale grosseur par les deux bouts ; ils ont la coque blanche, unie & molle, n'ayant pas plus de consistance qu'un parchemin humide : ces oeufs sont totalement remplis de jaune, sans aucun blanc ; ils ne durcissent jamais, quelque cuisson qu'on leur donne ; ils deviennent un peu pâteux, & n'en sont pas moins bons : on s'en sert souvent pour lier les sauces que l'on fait à la chair du lézard, qui peut aussi s'accommoder en fricassée de poulets. Cette chair est blanche, délicate & d'un assez bon goût ; on prétend qu'elle subtilise le sang par un long usage, & l'on croit avoir remarqué que ceux qui s'en nourrissent n'engraissent jamais.
Petit lézard des îles. Il s'en trouve de plusieurs sortes que l'on nomme en général anolis, pour les distinguer de la grande espece dont on vient de parler.
Le gros anoli que les Negres appellent aussi arado, fréquente les bois & les jardins ; sa longueur totale est d'environ un pié & demi ; sa queue traine à terre, ainsi que celle de tous les lézards ; il a les pattes de devant plus hautes & moins écartées que celles de derriere ; la peau qui lui couvre le dos est grise, rayée de brun & d'ardoise, & celle de dessous le ventre est toute blanche. Cet animal a beaucoup d'agilité : il se nourrit d'herbes, de fruits & d'insectes.
Anoli de terre. Celui-ci est beaucoup plus petit que le précédent ; il n'excede guere la longueur de six à sept pouces. Sa peau est brune, rayée de jaune le long des flancs ; & parsemée de très-petites écailles luisantes. On le prendroit pour un petit serpent, tant ses pattes sont petites & si peu apparentes qu'on ne les apperçoit que de fort près. Il se montre peu, & se tient presque toujours sous terre ou dans des souches d'arbres pourris.
Gobe-mouche. Cette espece est encore plus petite, mais très-jolie & moins farouche que les autres. Son agilité est extrême : elle a la peau ou d'un verd gai, ou d'un gris cendré, varié de marques blanches & brunes. On en voit une grande quantité dans les jardins & même dans les appartemens, s'occuper à faire la chasse aux mouches & aux autres insectes.
Roquets. Ils ont quelquefois huit à neuf pouces de longueur, leur couleur est grise, mouchetée de brun & de noir ; mais ce qui les distingue le plus des autres lézards, c'est qu'ils ont la queue un peu recourbée en-dessus, au lieu de l'avoir droite & trainante.
Maboya ou mabouya. C'est le plus vilain de tous les lézards : aussi les Caraibes ont-ils cru devoir lui imposer le nom qu'ils donnent au démon ou mauvais esprit. Le mot mabouya est aussi employé par ces sauvages pour exprimer toutes les choses qu'ils ont en horreur.
Le reptile dont il est question n'a guere plus de sept à huit pouces de longueur ; il est stupide, pesant, applati & comme collé sur les corps qu'il touche. Sa tête paroit écrasée, ayant deux gros yeux ronds sortant en-dehors d'une façon difforme. Il a les pattes grosses, courtes, très-écartées, & armées de griffes toujours ouvertes. Sa peau est flasque, jaunâtre & couverte de taches livides, hideuses à voir. Le maboya se gîte dans les plantations de bananiers, dans les souches d'arbres pourris, sous les pierres & dans les charpentes des maisons. Il jette par intervalle un vilain cri semblable au bruit d'une petite cresselle qui seroit agitée par secousses. On craint sa morsure ; & l'on prétend que s'il s'applique sur la chair il y cause une sensation brûlante, mais je n'ai jamais vû personne qui en ait ressenti l'effet. (M. le Romain.)
LEZARD, (Mat. med.) Le lézard appliqué extérieurement passe pour faire sortir les corps étrangers hors des plaies, & pour attirer le venin des morsures ou piquures des animaux venéneux. L'onguent fait avec sa chair, est regardé comme un remede contre l'alopécie ; mais ces prétentions ne sont pas moins frivoles que la plûpart de celles qu'on trouve dans tant d'auteurs de medecine, sur les vertus medicinales des animaux.
On fait entrer la fiente de lézard séchée dans les poudres composées pour les taies des yeux.
LEZARDE, s. f. (Archit.) terme de bâtiment. On appelle ainsi les crevasses qui se font dans les murs de maçonnerie par vétusté ou malfaçon. Latin, fissurae.
|
| LEZE | voyez ci-devant LESE.
|
| LEZÉ | voyez ci-devant LESE.
|
| LEZINE | S. f. (Morale) c'est l'avarice qui, pour l'intérêt le plus leger, blesse les bienséances, les usages, & brave le ridicule. C'est un trait de lézine dans un ancien officier général fort riche, que de se loger dans une chambre éclairée par une des lanternes de la rue, afin de pouvoir se coucher sans allumer une chandelle. Ce qui n'est qu'avarice dans un bourgeois est lézine dans un homme de qualité.
La cupidité est l'avarice en grand ; elle veut envahir, elle blesse visiblement l'ordre général : l'avarice veut acquérir & craint de dépenser ; elle blesse la justice : la lézine a de petits objets, soit d'épargne, soit de profit ; elle est ridicule. Il est bien extraordinaire qu'un aussi grand homme que mylord Marlboroug ait eu la cupidité la plus insatiable, l'avarice la plus sordide, & la lézine la plus ridicule.
|
| LEZION | voyez ci-devant LESION.
|
| LI | LY, LIS, LYS, s. m. (Mesure chinoise) comme vous voudrez l'écrire, est la plus petite mesure itinéraire des Chinois. Le P. Maffée dit que le li comprend l'espace où la voix de l'homme peut porter dans une plainé quand l'air est tranquille & serein ; mais les confreres du P. Maffée ont apprécié le li avec une toute autre précision.
Le P. Martini trouve dans un degré 90 mille pas chinois ; & comme 350 de ces pas font le li, il conclut qu'il faut 250 de ces lis pour un degré : desorte que selon lui 25 lis font six milles italiques ; car de même que six milles italiques multipliés par dix, font 60 pour le degré, de même 25 lis, multipliés par dix, sont 250.
Le P. Gouye remarque qu'il en est des lis chinois comme de nos lieues françoises, qui ne sont pas de même grandeur par-tout. Le P. Noel confirme cette observation, en disant que dans certains endroits 15 lis & dans d'autres 12, répondent à une heure de chemin ; c'est pourquoi, continue ce jésuite, j'ai cru pouvoir donner 12 lis chinois à une lieue de Flandre. Cette idée du P. Noel s'accorde avec ce que dit le P. Verbiest dans sa cosmographie chinoise, qu'un degré de latitude sur la terre est de 250 lis.
Or je raisonne ainsi sur tout cela ; puisque 250 lis chinois font un degré de latitude, & que suivant les observations de l'académie des Sciences le degré est de 57 mille 60 toises, il résulte que chaque li est de 208 toises & de six vingt cinquiemes de toise, & que par conséquent la lieue médiocre, la françoise, qui est de 2282 toises du châtelet de Paris, fait environ dix lis chinois. (D.J.)
|
| LI-P | ou LI-POU, (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine la cour supérieure ou le grand tribunal, composé des premiers magistrats qui sont au-dessus de tous les mandarins & ministres de l'empire chinois. On pourroit les nommer assez justement les inquisiteurs de l'état, vu que ce tribunal est chargé de veiller sur la conduite de tous les officiers & magistrats des provinces, d'examiner leurs bonnes ou mauvaises qualités, de recevoir les plaintes des peuples, & d'en rendre compte à l'empereur, auprès de qui ce conseil réside ; c'est de ses rapports & de ses décisions que dépend l'avancement des officiers à des postes plus éminens, ou leur degradation, lorsqu'ils ont commis des fautes qui la méritent ; le tout sous le bon plaisir de l'empereur qui doit ratifier les décisions du tribunal.
Les Chinois donnent encore le nom de li-pu à un autre tribunal chargé des affaires de la religion. Voyez RITES, tribunal des.
|
| LIAGE | S. m. (Jurisprud.) droit qui se leve au profit de certains seigneurs, non pas sur le vin même, comme l'ont cru quelques auteurs, mais sur les lies des vins vendus en broche dans l'étendue de leur seigneurie.
Le grand bouteiller de France jouissoit de ce droit, & en conséquence prenoit la moitié des lies de tous les vins que l'on vendoit à broche en plusieurs celliers assis en la ville de Paris. Mais plusieurs personnes se prétendoient exemptes de ce droit, entr'autres le chapitre de Paris pour ses sujets ; il avoit toute jurisdiction pour cet objet, suivant les preuves qui en sont rapportées par M. de Lauriere en son glossaire, au mot liage. Depuis la suppression de l'office de grand bouteiller, on ne connoît plus à Paris ce droit de liage.
Il est fait mention de ce droit au livre ancien qui enseigne la maniere de procéder en cour laie, & dans les ordonnances de la prevôté & échevinage de Paris, & dans deux arrêts du seigneur de Noyers, du 7 Avril 1347. (A)
LIAGE, fil de, (Manufacture en soie) il se dit du fil qui lie la dorure ou la soie.
LIAGE, lisse de, c'est celle qui fait baisser les fils qui lient la dorure & la soie.
|
| LIAIS | PIERRE DE, (Hist. anc.) c'est ainsi qu'on nomme en France une espece de pierre à chaux, compacte, dont le grain est plus fin que celui de la pierre à bâtir ordinaire ; elle est fort dure, & sonnante sous le marteau quand on la travaille. Elle peut se scier en lames assez minces, sans pour cela se casser. Comme on peut la rendre assez unie, on en fait des chambranles de cheminées & d'autres ouvrages propres. C'est la pierre la plus estimée, on l'emploie sur-tout dans la fondation des édifices, parce que la pierre tendre ne vaudroit rien pour cet usage. Les Mâçons & ouvriers l'appellent par corruption pierre de liere. (-)
LIAIS, (Draperie) voyez l'article MANUFACTURE EN LAINE.
LIAIS, chez les Tisserands, se dit des longues tringles de bois qui soutiennent les lisses ; de l'assemblage des liais & des lisses résulte ce qu'on appelle des lames.
|
| LIAISON | S. f. (Gram.) c'est l'union de plusieurs choses entr'elles, qualité en conséquence de laquelle elles forment ou peuvent être regardées comme formant un tout. Ce mot se prend au physique & au moral. On dit la liaison des idées, la liaison des êtres de la nature, la liaison d'un homme avec un autre, la liaison des caracteres de l'écriture, &c. Voyez les articles suivans.
LIAISON, (Métaphysiq.) principe nécessaire pour l'intelligence du monde considéré sous son point de vûe le plus général, c'est-à-dire entant qu'il est un être composé & modifiable. Cette liaison consiste en ce que chaque être qui entre dans la composition de l'univers, a la raison suffisante de sa co-existence ou de sa succession dans d'autres êtres. Empruntons un exemple dans la structure du corps humain. C'est un assemblage de plusieurs organes différens les uns des autres & co-existens. Ces organes sont liés entre eux. Si l'on vous demande en quoi consiste leur liaison, & que vous vous proposiez de l'expliquer d'une maniere intelligible, vous déduisez de leur structure la maniere dont ils peuvent s'adapter les uns aux autres, & par-là vous rendez raison de la possibilité de leur co-existence. Si l'on va plus loin, & que l'on vous requiere de dire comment ces organes, entant qu'organes, & relativement à leurs fonctions, sont liés ensemble, vous pouvez encore satisfaire à cette question. Le gosier, par exemple, & l'estomac sont deux organes du corps humain. Si vous ne les considérez que comme des êtres composés, & par rapport à leur matiere, vous pouvez montrer comment l'un s'ajuste commodément à l'autre, en vertu de leur structure : mais si vous les prenez sur le pié d'organes du corps humain, de parties d'un corps humain, de parties d'un corps vivant, dont l'une sert au passage des alimens, & l'autre à leur digestion, ces deux fonctions expliquent distinctement la raison de la co-existence de ces deux organes.
De ce que chaque être a la raison suffisante de sa co-existence ou de sa succession des autres êtres, il s'ensuit qu'il y a une enchaînure universelle de toutes choses, la premiere étant liée à la troisieme par la seconde, & ainsi de suite sans interruption. Rien de plus commun en effet que ces sortes de liaisons. Des planches sont attachées l'une à l'autre par des clous qui les séparent, de maniere qu'elles ne se touchent point. La colle est une espece d'amas de petites chevilles, qui s'insérant de part & d'autre dans les pores du bois, forme un corps mitoyen qui sépare & lie en même tems les deux autres. Dans une chaîne, le premier anneau tient au dernier par le moyen de tous les autres. Le gosier tient aux intestins par l'estomac. C'est-là l'image du monde entier. Toutes ses parties sont dans une liaison qui ne souffre aucun vuide, aucune solution ; chaque chose étant liée à toutes celles qui lui sont contiguës, par celles-ci à celles qui suivent immédiatement, & de même jusqu'aux dernieres bornes de l'univers. Sans cela on ne pourroit rendre raison de rien ; le monde ne seroit plus un tout, il consisteroit en pieces éparses & indépendantes, dont il ne résulteroit aucun système, aucune harmonie.
La liaison la plus intime est celle de la cause avec l'effet ; car elle produit la dépendance d'existence ; mais il y en a encore plusieurs autres, comme celles de la fin avec le moyen, de l'attribut avec le sujet, de l'essence avec ses propriétés, du signe avec la chose signifiée, &c. sur quoi il faut remarquer que la liaison de la fin avec les moyens suppose nécessairement une intelligence qui préside à l'arrangement, & qui lie tout à la fois l'effet avec la cause qui le produit, & avec sa propre intention. Dans une montre, par exemple, le mouvement de l'aiguille est lié d'une double maniere ; savoir, avec la structure même de la montre, & avec l'intention de l'ouvrier.
L'univers entier est rempli de ces liaisons finales, qui annoncent la souveraine intelligence de son auteur. Le soleil éleve les vapeurs de la mer, le vent les chasse au-dessus des terres, elles tombent en pluie, & pourquoi ? Pour humecter la terre, & faire germer les semences qu'elle renferme. On n'a qu'à lire Derham, le Spectacle de la nature, pour voir combien les fins des choses sont sensibles dans la nature.
Il n'y a que les êtres finis qui puissent être assujettis à une semblable liaison ; & l'assemblage actuel des êtres finis, liés de cette maniere entr'eux, forme ce qu'on appelle le monde, dans lequel il est aisé d'observer que toutes les choses, tant simultanées que successives, sont indissolublement unies. Cela se prouve également des grands corps, comme ceux qui composent le système planétaire, & des moindres qui font partie de notre globe. Le soleil & la terre sont deux grands corps simultanés dans ce monde visible. Si vous voulez expliquer le changement des saisons sur la terre & leurs successions régulieres, vous ne la trouverez que dans le mouvement oblique du soleil parcourant l'écliptique ; car, si vous supposiez que cet astre suive la route de l'équateur, il en résulteroit une égalité perpétuelle de saisons. Otez tout-à-fait le soleil, voilà la terre livrée à un engourdissement perpétuel, les eaux changées en glace, les plantes, les animaux, les hommes détruits sans retour, plus de générations, plus de corruptions, un vrai cahos. Le soleil renferme par conséquent la raison des changemens que la terre subit. Il en est de même des autres planetes relativement à leur constitution & à leur distance du soleil. Les petits corps coexistans sont dans le même cas. Pour qu'une semence germe, il faut qu'elle soit mise en terre, arrosée par la pluie, échauffée par le soleil, exposée à l'action de l'air ; sans le secours de ces causes, la végétation ne réussira point. Donc la raison de l'accroissement de la plante est dans la terre, dans la pluie, dans le soleil, dans l'air ; donc elle est liée avec toutes ces choses.
Cet assemblage d'êtres liés entr'eux de cette maniere n'est pas une simple suite ou serie d'un seul ordre de choses ; c'est une combinaison d'une infinité de series mêlées & entrelacées ensemble ; car, pour ne pas sortir de l'enceinte de notre terre, n'y trouve-t-on pas une foule innombrable de choses contingentes, soit que nous regardions à la composition des substances, soit que nous observions leurs modifications. Il y a plus, une seule serie de choses contingentes se subdivise manifestement en plusieurs autres. Le genre humain est une serie qui dérive d'une tige commune, mais qui en a formé d'autres sans nombre. On peut en dire autant des animaux & même des végétaux. Ceux-ci dans chacune de leurs especes constituent de pareilles series. Les plantes naissent les unes des autres, soit de semence, soit par la séparation des tiges, soit par toute autre voie. Personne ne sauroit donc méconnoître la multiplicité des series, tant dans le regne animal que dans le végétal. Les autres êtres successifs, par exemple, les météores les plus bisarres & les plus irréguliers forment également des series de choses contingentes, quoique ce ne soit pas suivant cette uniformité d'espece qui regne dans les series organisées. Si de la composition des substances nous passons à leur modification, la même vérité s'y confirme. Considérez un morceau de la surface extérieure de la terre exposée à un air libre, vous la verrez alternativement chaude, froide, humide, seche, dure, molle ; ces changemens se succedent sans interruption, durent autant que la suite des siecles, & coexistent aux générations des hommes, des animaux & des plantes. Le corps d'un homme pendant toute la durée de sa vie n'est-il pas le théatre perpétuel d'une suite de scenes qui varient à chaque instant ? car à chaque instant il se fait déperdition & réparation de substance. De la terre, si nous nous élevons aux corps célestes, nous serons en droit de raisonner de la même maniere. Les observations des astronomes ne nous permettent pas de douter que toutes les planetes ne soient des corps semblables à la terre, & ne doivent être compris sous une espece commune. Les mêmes observations découvrent sur la surface de ces planetes des générations & des corruptions continuelles. En vertu donc de l'argument tiré de l'analogie, on peut conclure qu'il y a dans toutes les planetes plusieurs series contingentes, tant de substances composées que de modifications. Le soleil, corps lumineux par lui-même, & qui compose avec les étoiles fixes une espece particuliere de grands corps du monde, est également sujet à divers changemens dans sa surface. Il doit donc y avoir dans cet astre & dans les étoiles fixes une serie d'états contingens. C'est ainsi que de toute la nature sort en quelque sorte une voix qui annonce la multiplicité & l'enchaînure des series contingentes. Les difficultés qu'on pourroit former contre ce principe, sont faciles à lever. En remontant, dit-on, jusqu'au principe des généalogies, jusqu'aux premiers parens, on rencontre la même personne placée dans plusieurs series différentes. Plusieurs personnes actuellement vivantes ont un auteur commun, qui se trouve par conséquent dans la généalogie de chacun. Mais cela ne nuit pas plus à la multiplicité des series, que ne nuit à un arbre la réunion de plusieurs petites branches en une seule plus considérable, & celle des principales branches au tronc. Au contraire c'est de-là que tire sa force l'enchaînure universelle des choses. On objecte encore que la mort d'un fils unique sans postérité rompt & termine tout d'un coup une serie de contingens, qui avoit duré depuis l'origine du monde. Mais si la serie ne se continue pas dans l'espece humaine, néanmoins la matiere, dont ce dernier individu étoit composé, n'étant point anéantie par sa mort, subit des changemens également perpétuels, quoique dans d'autres series. Et d'ailleurs aucune serie depuis l'origine des choses n'est venue à manquer, aucune espece de celles qui ont été créées ne s'est éteinte. Pour acquérir une idée complete de cette matiere, il faut lire toute la premiere section de la Cosmologie de M. Wolf.
LIAISON, est en Musique un trait recourbé, dont on couvre les notes qui doivent être liées ensemble.
Dans le plein-chant, on appelle aussi liaison une suite de plusieurs notes passées sur la même syllabe, parce qu'en effet elles sont ordinairement attachées ou liées ensemble.
Quelques-uns nomment encore quelquefois liaison ce qu'on appelle plus proprement syncope. Voyez SYNCOPE.
Liaison harmonique est le prolongement ou la continuation d'un ou plusieurs sons d'un accord sur celui qui le suit ; desorte que ces sons entrent dans l'harmonie de tous deux. Bien lier l'harmonie, est une des grandes regles de la composition, & celle à laquelle on doit avoir le plus d'égard dans la marche de la basse fondamentale. Voyez BASSE & FONDAMENTAL. Il n'y a qu'un seul mouvement permis sur lequel elle ne puisse se pratiquer : c'est lorsque cette basse monte diatoniquement sur un accord parfait : aussi de tels passages ne doivent-ils être employés que sobrement, seulement pour rompre une cadence, ou pour sauver une septieme diminuée. On se permet aussi quelquefois deux accords parfaits de suite, la basse descendant diatoniquement, mais c'est une grande licence qui ne sauroit se tolérer qu'à la faveur du renversement.
La liaison harmonique n'est pas toujours exprimée dans les parties ; car, quand on a la liberté de choisir entre les sons d'un accord, on ne prend pas toujours ceux qui la forment ; mais elle doit au moins se sous-entendre. Quand cela ne se peut, c'est, hors le cas dont je viens de parler, une preuve assûrée que l'harmonie est mauvaise.
Liaison, dans nos anciennes musiques. Voyez LIGATURE. (S)
LIAISON, (Architecture) Mâçonnerie en liaison. Voyez MAÇONNERIE.
Liaison en Architecture, est une maniere d'arranger & de lier les pierres & les briques par enchaînement les unes avec les autres, de maniere qu'une pierre ou une brique recouvre le joint des deux qui sont au-dessous.
Vitruve nomme les liaisons de pierres ou de briques alterna coagmenta.
Liaisons de joint, s'entend du mortier ou du plâtre détrempé, dont on fiche & jointoye les pierres.
Liaison à sec, celle dont les pierres sont posées sans mortier, leurs lits étant polis & frottés au grais, comme ont été construits plusieurs bâtimens antiques faits des plus grandes pierres.
On se sert aussi de ce terme dans la décoration, tant extérieure qu'intérieure, pour exprimer l'accord que doivent avoir les parties les unes avec les autres, de maniere qu'elles paroissent être unies ensemble & ne faire qu'un tout harmonieux, ce qui ne peut arriver qu'en évitant l'union des contraires.
LIAISON, dans la coupe des pierres, est un arrangement des joints, qu'il est essentiel d'observer pour la solidité. A B, fig. 17. représente les joints de lit aussi-bien que les lignes qui lui sont paralleles, a a, b b, c c, & les joints de tête. Poser les pierres en liaison, c'est faire ensorte que les joints de tête de différentes assises qui sont contiguës, ne soient pas vis-à-vis les uns des autres. Comme, par exemple, les joints a a, b b, ne doivent point être vis-à-vis les uns des autres. Ceux d'une troisieme assise pouvoient être vis-à-vis des premiers, comme les joints c c vis-à-vis des joints a a : les joints e e vis-à-vis des joints c c laissant toujours une assise entre deux, & c'est une régularité qu'on affecte quelquefois. Lorsque les joints de deux assises contiguës sont vis-à-vis les uns des autres, les pierres sont alors posées en déliaison. On ne peut pas mieux comparer ce qu'on appelle liaison dans la coupe des pierres, qu'à une page d'un livre : les lignes représentent les assises ou joints de lit, & chaque mot une pierre, les séparations des mots les joints de tête. On voit clairement que les intervalles des mots dans différentes lignes ne sont pas vis-à-vis les uns des autres. Ce seroit même un défaut, s'ils s'y rencontroient trop fréquemment, cela feroit des rayures blanches du haut en bas des pages, qu'on appelle en terme d'Imprimerie, chemin de saint Jacques. (D)
LIAISON, terme de Cuisinier, est une certaine quantité de farine, de jaunes d'oeufs, & autres matieres semblables qu'on met dans les sauces pour les épaissir.
LIAISON, (Ecriture) signifie aussi dans l'écriture le produit de l'angle gauche de la plume, une ligne fort délicate, qui enchaîne les caracteres les uns avec les autres.
Il y en a de deux sortes ; les liaisons de lettres, les liaisons de mots : les premieres se trouvent au haut ou au bas des lettres qui ne sont pas intrinséquement un seul corps, mais deux, comme en a, m, n, &c. & les joignent pour n'en faire qu'un extrinséquement : les secondes se trouvent à la fin des finales, & sont une suite de cette finale pour servir de chaîne au mot suivant.
|
| LIAISONNER | (Mâçonnerie) c'est arranger les pierres, ensorte que les joints des unes portent sur le milieu des autres. C'est aussi remplir de mortier ou de plâtre leurs joints, pendant qu'elles sont sur leurs cales.
|
| LIAL-FAIL | S. m. (Hist. anc.) C'est ainsi que les anciens Irlandois nommoient une pierre fameuse qui servoit au couronnement de leurs rois ; ils prétendoient que cette pierre, qui dans la langue du pays signifie pierre fatale, poussoit des gémissemens quand les rois étoient assis dessus lors de leur couronnement. On dit qu'il y avoit une prophétie qui annonçoit que par-tout où cette pierre seroit conservée, il y auroit un prince de la race des Scots sur le trône au x. siecle. Elle fut enlevée de force par Edouard I. roi d'Angleterre, de l'abbaye de Scône, où elle avoit été conservée avec vénération ; & ce monarque la fit placer dans le fauteuil qui sert au couronnement des rois d'Angleterre, dans l'abbaye de Westminster, où l'on prétend qu'elle est encore. Voyez Histoire d'Irlande par Mac-Geogegan.
|
| LIANNE | S. f. (Botan.) on donne ce nom à un grand nombre de différentes plantes, qui croissent naturellement dans presque toute l'Amérique, & principalement aux Antilles : plusieurs de ces plantes sont rameuses, bien garnies de feuilles, & couvrent la terre & les rochers ; d'autres ; comme le lierre d'Europe, serpentent & s'attachent à tout ce qu'elles rencontrent ; on en voit beaucoup d'aussi grosses que le bras, rondes, droites, couvertes d'une peau brune, fort unie, sans noeuds ni feuilles, s'élever jusqu'à la cime des plus grands arbres, d'où, après avoir enlacé les branches & n'étant plus soutenue, leur propre poids les fait incliner vers la terre, où elles reprennent racine & produisent de nouveaux jets qui cherchent à s'appuyer sur quelque arbre voisin, ou remontent en serpentant autour de la maîtresse lianne, ce qui ressemble à des cables de moyenne grosseur : l'usage que l'on fait de cette lianne lui a donné le nom de lianne à cordes. On l'appelle encore lianne jaune, à cause d'un suc de cette couleur qui en découle lorsqu'elle a été coupée.
Les autres liannes, dont l'usage est le plus connu, sont,
1. Lianne brûlante. C'est une espece de lierre qu'on employe tout verd dans la composition de la lessive, qui sert à la fabrication des sucres.
2. Lianne à concombre. Celle-ci porte un fruit gros comme un citron de moyenne grosseur, ayant la forme d'un sphéroïde très-peu allongé ; la pellicule qui le couvre est lisse, d'un verd pâle & parsemée de petites pointes peu aiguës, l'intérieur de ce fruit est tout-à-fait semblable à celui des concombres ordinaires ; on l'emploie aux mêmes usages.
3. Lianne à crocs de chiens. Cette lianne produit beaucoup de branches tortueuses, souples & fortes, garnies de beaucoup d'épines très-aiguës, assez grandes & recourbées comme les griffes d'un chat ; son bois sert à faire des cerceaux pour les barriques où l'on met le sucre. Il ne faut pas la confondre avec la lianne à barriques, que l'on emploie aussi à faire des cerceaux, mais dont l'usage n'est pas si bon.
4. Lianne à eau. Elle croit abondamment dans les bois & dans les montagnes ; sa propriété la plus connue est de servir à désaltérer ceux qui fréquentent les lieux écartés des ruisseaux & des sources ; lorsqu'ils sont pressés de la soif, ils coupent cette lianne par le pié, &, après avoir fait une médiocre ouverture à la partie qui est restée suspendue aux rochers ou aux arbres, ils reçoivent par le bout d'en bas la valeur d'une chopine & plus d'une belle eau fraîche, limpide, sans aucun goût ni qualité malfaisante.
5. Lianne grise. Cette espece est un peu noueuse, mais très-liante ; sa grosseur approche de celle du petit doigt : on l'emploie au lieu d'osier pour faire des paniers, des claies & autres ouvrages utiles à la campagne.
6. Miby. Lianne de la petite espece très-menue, fort souple, servant à faire des liens & des petits paniers peu durables.
7. Lianne à patate. Ce n'est autre chose que la tige des patates, qui rampe à terre & s'étend beaucoup ; on en nourrit les cochons.
8. Lianne à persil. Le bois de cette lianne est de couleur rougeâtre ; il est dur, solide, & cependant assez liant ; on en fait des bâtons qui ne rompent point.
9. Lianne à sang. Cette lianne étant coupée, donne quelques gouttes d'une liqueur visqueuse, rouge comme du sang de boeuf ; teignant les linges & les étoffes blanches, mais cette couleur s'efface à la lessive ; on pourroit peut-être la fixer.
10. Lianne à savon. Ainsi nommée par l'effet qu'elle produit, étant écrasée & frottée dans de l'eau claire ; on lui attribue une qualité purgative.
11. Lianne à serpent. Cette lianne est employée dans les remedes contre la morsure du serpent, on exprime le suc de la tige & des feuilles, & après l'avoir mêlé avec les deux tiers de taffia ou d'eau-de-vie, on fait boire le tout au patient, & le marc s'applique sur la morsure, cela réussit quelquefois.
Cette plante dont les propriétés ne sont pas bien connues, paroît avoir une qualité narcotique ; elle exhale une odeur forte, désagréable & assoupissante.
Le nombre des autres liannes est si considérable, qu'il faudroit un volume entier pour les décrire toutes exactement.
LIANNE, (pomme de) s. f. Botan. La pomme de lianne est le fruit d'une plante d'Amérique nommée par quelques auteurs grenadille, ou fleur de la passion. Cette plante s'étend beaucoup, & s'éleve contre tout ce qu'elle rencontre ; elle est bien garnie de feuilles d'un assez beau verd ; & dans la saison elle porte une parfaitement belle fleur en campanille ou clochette d'un pouce & demi à deux pouces de diametre, sur autant de hauteur, au fond de laquelle sont le pistil & les étamines que l'imagination a fait ressembler aux instrumens de la passion.
Cette fleur en clochette n'est pas composée de plusieurs pétales, ni même d'une seule, ainsi que le sont les fleurs en entonnoir ; mais toute sa circonférence est formée par un grand nombre de filets assez gros, veloutés, & d'une belle couleur bleue depuis leur extrémité jusqu'environ les deux tiers de leur longueur, le reste étant marqueté de blanc & de pourpre, jusqu'à la partie qui joint le pistil, autour duquel ces filets prennent naissance, & représentent intérieurement un soleil rayonnant, varié de diverses couleurs. La position naturelle de cette fleur est toujours pendante, & differe beaucoup de la figure défectueuse qu'en ont donné les RR. PP. Dutertre & Labat, dans laquelle ils renversent les filets en-dehors, pour montrer le pistil à découvert ; c'est tout le contraire, puisqu' ainsi qu'on l'a déja dit, la fleur ressemble à une campanille ou clochette dont le pistil peut être regardé comme le battant.
Au bout de deux ou trois jours cette fleur se séche, & le pistil en croissant se change en un fruit verd, plus gros qu'un oeuf de poule ; la peau de ce fruit acquiert en murissant une belle couleur d'abricot ; elle est fort épaisse, coriace, souple, unie, un peu veloutée, & belle à voir ; elle renferme intérieurement une multitude de petites graines plates, presque noires, nageantes dans une liqueur épaissie en consistance de gelée claire, un peu aigrelette, sucrée, parfumée, & d'un goût très-agréable ; on la croit raffraîchissante. Pour manger ce fruit, communément on fait avec le couteau un trou à l'une de ses extrémités, au moyen de quoi on en suce la substance, en pressant un peu la peau qui cede sous les doigts comme une bourse de cuir.
Quelques voyageurs ont confondu la pomme de lianne avec la grenadille ou barbadine ; celle-ci est trois ou quatre fois plus grosse ; sa peau est de l'épaisseur du petit doigt, extrêmement lisse, & d'un jaune verdâtre très-pâle, comme celle d'un concombre à moitié mûr. La substance intérieure de ce fruit est un peu moins liquide, & plus parfumée que celle de la pomme de lianne ; ces deux plantes s'emploient à former de très-jolis berceaux qu'on appelle tonelles dans le pays. Art. de M. le Romain.
LIANNE, (Géog.) petite riviere de France, en Picardie ; elle tire sa source des frontieres de l'Artois, & se jette dans la Manche, au-dessous de Boulogne. (D.J.)
|
| LIANT | adj. (Gram.) Il se dit au physique & au moral. Au physique, il désigne une souplesse molle, une élasticité douce & uniforme dans toute la continuité du corps ; c'est en ce sens qu'un ressort est liant. Le tissu de l'osier est liant. Au moral il se dit d'un caractere doux, affable, complaisant, & qui invite à former une liaison.
|
| LIARD | S. m. (Monnoie) teruncius, petite monnoie de billon, qui vaut trois deniers, & fait la quatrieme partie d'un sol. Louis XI. en fit fabriquer qui eurent en Guyenne le nom de hardi. On en fabriqua en 1658 de cuivre pur, qu'on appella doubles, parce qu'ils ne valoient que deux deniers ; ils ont été remis à trois deniers au commencement de ce siecle, & ont repris leur premier nom de liard.
On ignore l'origine de ce mot ; les uns prétendent qu'il est venu par corruption de li-hardi, petite monnoie des princes anglois, derniers ducs d'Aquitaine ; d'autres tirent ce mot de Guignes Liard, natif de Crémieu, qui inventa, disent-ils, cette monnoie en 1430 ; d'autres enfin prétendent qu'elle fut ainsi nommée par opposition aux blancs, ly-blancs, & qu'étant les premieres pieces qu'on eût vû de billon, on les appella ly-ards, c'est-à-dire les noirs. (D.J.)
|
| LIASSE | S. f. (Jurisprud.) se dit de plusieurs pieces & procédures enfilées & attachées ensemble par le moyen d'un lacet ou d'un tiret.
Lorsqu'il y a plusieurs liasses de papiers dans un inventaire, on les cotte ordinairement par premiere, seconde, troisieme, &c. afin de les distinguer & de les reconnoître. (A)
|
| LIBAGES | S. m. pl. en Architecture. Ce sont des quartiers de pierres dures & rustiques, de quatre ou cinq à la voie, qu'on emploie brutes dans les fondations, pour servir comme de plate-forme pour asseoir dessus la maçonnerie de moilon ou de pierre de taille.
|
| LIBAN | LE, Libanus, (Géog.) montagne célebre d'Asie, aux confins de la Palestine & de la Syrie. Nous ne nous arrêterons point à ce que les anciens géographes disent du Liban & de l'anti-Liban, parce que nos modernes en ont beaucoup mieux connu la situation & l'étendue.
Ils appellent le Liban les plus hautes montagnes de la Syrie ; c'est une chaîne de montagnes qui courent le long du rivage de la mer Méditerranée, du midi au septentrion. Son commencement est vers la ville de Tripoli, & vers le cap rouge ; sa fin est au-delà de Damas, joignant d'autres montagnes de l'Arabie déserte. Cette étendue du couchant à l'orient, est environ sous le 35 degré de latitude.
L'anti-Liban, ainsi nommé à cause de sa situation opposée à celle du Liban, est une autre suite de montagnes qui s'élevent auprès des ruines de Sidon, & vont se terminer à d'autres montagnes du pays des Arabes, vers la Trachonitide, sous le 34 degré.
Chacune de ces montagnes est d'environ cent lieues de circuit, sur une longueur de 35 à 40 lieues, ce qui est facile à comprendre, si on fait réflexion qu'elles occupent un espace fort vaste, en trois provinces qu'on appelloit autrefois la Syrie propre, la Coelé-Syrie, & la Phénicie, avec une partie de la Palestine.
De cette façon, le Liban & l'anti-Liban pris ensemble, ont à leur midi la Palestine, du côté du nord l'Arménie mineure ; la Mésopotamie ou le Diarbeck, avec partie de l'Arabie déserte sont à leur orient, & la mer de Syrie du côté du couchant.
Ces deux hautes montagnes sont séparées l'une de l'autre, par une distance assez égale par-tout ; & cette distance forme un petit pays fertile, auquel on donnoit autrefois le nom de Coelé-Syrie, ou Syrie creuse ; c'est une profonde vallée, presque renfermée de toutes parts. Voyez de plus grands détails dans Relandi Palaestina, les voyages de Maundrell, dans le voyage de Syrie & du mont Liban, par la Roque. Lucien parle d'un temple consacré à Vénus sur le mont Liban, & qu'il avoit été voir. L'empereur Constantin le fit démolir.
Dom Calmet croit que le nom de Liban vient du mot hébreu leban ou laban, qui veut dire blanc, parce que cette chaîne de montagnes est couverte de neige. (D.J.)
|
| LIBANOCHROS | S. m. (Hist. nat.) pierre qui suivant Pline ressembloit par sa couleur à des grains d'encens ou à du miel.
|
| LIBANOMANCIE | S. f. (Divin.) divination qui se faisoit par le moyen de l'encens.
Ce mot est composé du grec , encens, & , divination.
Dion Cassius, l. XLI. de l'hist. august. parlant de l'oracle de Nymphée, proche d'Apollonie, décrit ainsi les cérémonies usitées dans la libanomancie. On prend, dit-il, de l'encens, & après avoir fait des prieres relatives aux choses qu'on demande, on jette cet encens dans le feu, afin que sa fumée porte ces prieres jusqu'aux dieux. Si ce qu'on souhaite doit arriver, l'encens s'allume sur le champ, quand même il seroit tombé hors du feu, le feu semble l'aller chercher pour le consumer ; mais si les voeux qu'on a formés ne doivent pas être remplis, ou l'encens ne tombe pas dans le feu, ou le feu s'en éloigne, & ne le consume pas. Cet oracle, ajoute-t-il, prédit tout, excepté ce qui regarde la mort & le mariage. Il n'y avoit que ces deux articles sur lesquels il ne fut pas permis de le consulter.
|
| LIBANOVA | (Géog.) bourg de Grece dans la Macédoine, & dans la province de Jamboli, sur la côte du golfe de Contessa, au pié du Monte-Santo. Le bourg est pauvre & dépeuplé ; mais c'est le reste de Stagyre, la patrie d'Aristote, & cela me suffiroit pour en parler. (D.J.)
|
| LIBATION | S. f. (Littér. gréq. & rom.) en grec , Hom. en latin libatio, libamen, libamentum, d'où l'on voit que le mot françois est latin ; mais nous n'avons point de terme pour le verbe libare, qui signifioit quelquefois sacrifier ; de-là vient que Virgile dit l. VII. de l'Aenéide, nunc pateras libate Jovi ; car les libations accompagnoient toujours les sacrifices. Ainsi pour lors les libations étoient une cérémonie d'usage, où le prêtre épanchoit sur l'autel quelque liqueur en l'honneur de la divinité à laquelle on sacrifioit.
Mais les Grecs & les Romains employoient aussi les libations sans sacrifices, dans plusieurs conjonctures très-fréquentes, comme dans les négociations, dans les traités, dans les mariages, dans les funérailles ; lorsqu'ils entreprenoient un voyage par terre ou par mer ; quelquefois en se couchant, en se levant ; enfin très-souvent au commencement & à la fin des repas ; alors les intimes amis ou les parens se réunissoient pour faire ensemble leurs libations. C'est pour cela qu'Eschine a cru ne pouvoir pas indiquer plus malicieusement l'union étroite de Démosthene & de Céphisodote, qu'en disant qu'ils faisoient en commun leurs libations aux dieux.
Les libations des repas étoient de deux sortes ; l'une consistoit à séparer quelque morceau des viandes, & à le brûler en l'honneur des dieux ; dans ce cas, libare n'est autre chose que excerpere ; l'autre sorte de libation, qui étoit la libation proprement dite, consistoit à répandre quelque liqueur, comme de l'eau, du vin, du lait, de l'huile, du miel, sur le foyer ou dans le feu, en l'honneur de certains dieux, par exemple, en l'honneur des Lares qui avoient un soin particulier de la maison ; en l'honneur du Génie, dieu tutélaire de chaque personne ; & en l'honneur de Mercure, qui présidoit aux heureuses avantures. Plaute appelle assez plaisamment les dieux qu'on fêtoit ainsi, les dieux des plats, dii patellarii.
En effet on leur présentoit toujours quelque chose d'exquis, soit en viandes, soit en liqueurs. Horace peint spirituellement l'avarice d'Avidienus, en disant qu'il ne faisoit des libations de son vin, que lorsqu'il commençoit à se gâter.
Ac nisi mutatum parcit defundere vinum.
On n'osoit offrir aux dieux que de l'excellent vin, & même toujours pur, excepté à quelques divinités à qui, pour des raisons particulieres, on jugeoit àpropos de le couper avec de l'eau. On en usoit ainsi à l'égard de Bacchus, peut-être pour abattre ses fumées, & vis-à-vis de Mercure, parce que ce dieu étoit en commerce avec les vivans & les morts.
Toutes les autres divinités vouloient qu'on leur servît du vin pur ; aussi dans le Plutus d'Aristophane, un des dieux privilégiés se plaint amérement qu'on le triche, & que dans les coupes qu'on lui présente, il y a moitié vin & moitié eau. Les maîtres, & quelquefois les valets, faisoient ces tours de pages.
Dans les occasions solemnelles on ne se contentoit pas de remplir la coupe des libations de vin pur, on la couronnoit d'une couronne de fleurs ; c'est pour cela que Virgile en parlant d'Anchise qui se préparoit à faire une libation d'apparat, n'oublie pas de dire :
Magnum cratera coronâ
Induit, implevitque mero.
Avant que de faire les libations, on se lavoit les mains, & l'on récitoit certaines prieres. Ces prieres étoient une partie essentielle de la cérémonie des mariages & des festins des noces.
Outre l'eau & le vin, le miel s'offroit quelquefois aux dieux ; & les Grecs le mêloient avec de l'eau pour leurs libations, en l'honneur du soleil, de la lune, & des nymphes.
Mais des libations fort fréquentes, auxquelles on ne manquoit guere dans les campagnes, étoient celles des premiers fruits de l'année, d'où vient qu'Ovide dit :
Et quodcunque mihi pomum novus educat annus,
Libatum agricolae ponitur antè deos.
Ces fruits étoient présentés dans des petits plats qu'on nommoit patellae. Ciceron remarque qu'il y avoit des gens peu scrupuleux, qui mangeoient eux-mêmes les fruits réservés en libations pour les dieux : atque reperiemus asotos non ità religiosos, ut edant de patella, quae diis libata sunt.
Enfin les Grecs & les Romains faisoient des libations sur les tombeaux, dans la cérémonie des funérailles. Virgile nous en fournit un exemple dans son troisieme livre de l'Enéide.
Solemnes tùm forte dapes, & tristia dona
Libabat cineri Andromache, manesque vocabat
Hectoreum ad tumulum.
Anacréon n'approuve point ces libations sépulcrales. A quoi bon, dit-il, répandre des essences sur mon tombeau ? Pourquoi y faire des sacrifices inutiles ? Parfume-moi pendant que je suis en vie ; mets des couronnes de roses sur ma tête....
Quelques empereurs romains partagerent les libations avec les dieux. Après la bataille d'Actium, le sénat ordonna les libations pour Auguste, dans les festins publics, ainsi que dans les repas particuliers ; & pour complete r la flatterie, ce même sénat ordonna l'année suivante, que dans les hymnes sacrés le nom d'Auguste seroit joint à celui des dieux. Mais en vain desira-t-il cette espece de déification, pour ne se trouver tous les matins à son réveil, que le foible, tremblant, & malheureux Octave. (D.J.)
|
| LIBATTE | ou CHILONGI, (Géogr. historique) terme usité dans quelques provinces d'Ethiopie, pour signifier un amas de maisons, de cases, ou plutôt de basses chaumieres construites de branchages, enduites de terre grasse, & couvertes de chaume. Elles sont environnées d'une haie de grosses épines, laquelle haie est très-épaisse, pour empêcher les animaux carnassiers de la franchir ou de la forcer. Il n'y a dans chaque case qu'une porte, que l'on a soin de fermer avec des faisceaux de grosses épines : car sans toutes ces précautions les bêtes dévoreroient les habitans. Ces amas de cabanes sont faits en maniere de camp, & tracés par les officiers du prince, qui en ont le commandement & l'inspection. Voyez-en les détails dans les relations de l'Ethiopie. Tout ce qui en résulte, c'est que ces misérables, comparés aux autres peuples, ne présentent que la pauvreté, l'horreur & le brigandage. (D.J.)
|
| LIBATTO | S. m. (Hist. mod.) c'est le nom que les habitans du royaume d'Angola donnent à des especes de hameaux ou de petits villages qui ne sont que des assemblages de cabanes chétives bâties de bois & de terre grasse, & entourées d'une haie fort épaisse & assez haute pour garantir les habitans des bêtes féroces, dont le pays abonde. Il n'y a qu'une seule porte à cette haie, que l'on a grand soin de fermer la nuit, sans quoi les habitans couroient risque d'être dévorés.
|
| LIBAU | Liba, (Géog.) place de Curlande, avec un port sur la mer Baltique & aux frontieres de la Samogitie. Cette place appartient au duc de Curlande, & est à 18 milles germaniques N. O. de Mémel, 25 O. de Mittau, 16 S. O. de Goldingen. Long. 39. 2. lat. 56. 27.
|
| LIBBI | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbre des Indes orientales qui ressemble beaucoup à un palmier ; il croît sur le bord des rivieres : les pauvres gens en tirent de quoi faire une espece de pain semblable à celui que fournit le sagou. La substance qui fournit ce pain est une moëlle blanche, semblable à celle du sureau ; elle est environnée de l'écorce & du bois de l'arbre, qui sont durs quoique très-menus. On fend le tronc pour en tirer cette moëlle : on la bat avec un pilon de bois dans une cuve ou dans un mortier : on la met ensuite dans un linge que l'on tient audessus d'une cuve : on verse de l'eau par-dessus, en observant de remuer pour que la partie la plus déliée de cette substance se filtre avec l'eau au-travers du linge ; cette eau, après avoir séjourné dans la cuve, y dépose une fécule épaisse dont on fait un pain d'assez bon goût. On en fait encore, comme avec le sagou, une espece de dragées séches, propres à être transportées ; on prétend que, mangées avec du lait d'amandes, elles sont un remede spécifique contre les diarrhées.
|
| LIBELLATIQUES | S. m. pl. (Théolog.) Dans la persécution de Decius, il y eut des chrétiens qui, pour n'être point obligés de renier la foi & de sacrifier aux dieux en public, selon les édits de l'empereur, alloient trouver les magistrats, renonçoient à la foi en particulier, & obtenoient d'eux, par grace ou à force d'argent, des certificats par lesquels on leur donnoit acte de leur obéissance aux ordres de l'empereur, & on défendoit de les inquiéter davantage sur le fait de la religion.
Ces certificats se nommoient en latin libelli, libelles, d'où l'on fit les noms de libellatiques.
Les centuriateurs prétendent cependant que l'on appelloit libellatiques ceux qui donnoient de l'argent aux magistrats pour n'être point inquiétés sur la religion, & n'être point obligés de renoncer au Christianisme.
Les libellatiques, selon M. Tillemont, étoient ceux qui, sachant qu'il étoit défendu de sacrifier, ou alloient trouver les magistrats, ou y envoyoient seulement, & leur témoignoient qu'ils étoient chretiens, qu'il ne leur étoit pas permis de sacrifier ni d'approcher des autels du diable ; qu'ils les prioient de recevoir d'eux de l'argent, & de les exempter de faire ce qui leur étoit défendu. Ils recevoient ensuite du magistrat ou lui donnoient un billet qui portoit qu'ils avoient renoncé à J. C. & qu'ils avoient sacrifié aux idoles, quoiqu'ils n'en eussent rien fait, & ces billets se lisoient publiquement.
Ce crime, quoique caché, ne laissoit pas que d'être très-grave. Aussi l'église d'Afrique ne recevoit à la communion ceux qui y étoient tombés, qu'après une longue pénitence : la rigueur des satisfactions qu'elle exigeoit, engagea les libellatiques à s'adresser aux confesseurs & aux martyrs qui étoient en prison ou qui alloient à la mort, pour obtenir par leur intercession la relaxation des peines canoniques qui leur restoient à subir, ce qui s'appelloit demander la paix. L'abus qu'on fit de ces dons de la paix causa un schisme dans l'église de Carthage du tems de S. Cyprien, ce saint docteur s'étant élevé avec autant de force que d'éloquence contre cette facilité à remettre de telles prévarications, comme on le peut voir dans ses épitres 31. 52. & 68, & dans son livre de lapsis. L'onzieme canon du concile de Nicée regarde en partie les libellatiques.
|
| LIBELLE | S. m. libellus, (Jurisprud.) signifie différentes choses.
Libelle de divorce, libellus repudii, est l'acte par lequel un mari notifie à sa femme qu'il entend la répudier. Voyez DIVORCE, REPUDIATION & SEPARATION.
Libelle d'un exploit ou d'une demande est ce qui explique l'objet de l'ajournement ; quelquefois ce libelle est un acte séparé qui est en tête de l'exploit ; quelquefois le libelle de l'exploit est inséré dans l'exploit même, cela dépend du style de l'huissier & de l'usage du pays, car au fond cela revient au même.
Libelle diffamatoire est un livre, écrit, ou chanson, soit imprimé ou manuscrit, fait & répandu dans le public exprès pour attaquer l'honneur & la réputation de quelqu'un.
Il est également défendu, & sous les mêmes peines, de composer, écrire, imprimer & de répandre des libelles diffamatoires.
L'injure résultante de ces sortes de libelles est beaucoup plus grave que les injures verbales, soit parce qu'elle est ordinairement plus méditée, soit parce qu'elle se perpétue bien davantage : une telle injure qui attaque l'honneur est plus sensible à un homme de bien que quelques excès commis en sa personne.
La peine de ce crime dépend des circonstances & de la qualité des personnes. Quand la diffamation est accompagnée de calomnie, l'auteur est puni de peine afflictive, quelquefois même de mort.
Voyez l'édit de Janvier 1561, article 13 ; l'édit de Moulins, article 77 ; & celui de 1571, article 10. Voyez l'article suivant. (A)
LIBELLE, (Gouvern. politiq.) écrit satyrique, injurieux contre la probité, l'honneur & la réputation de quelqu'un. La composition & la publication de pareils écrits méritent l'opprobre des sages ; mais laissant aux libelles toute leur flétrissure en morale, il s'agit ici de les considérer en politique.
Les libelles sont inconnus dans les états despotiques de l'Orient, où l'abattement d'un côté, & l'ignorance de l'autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d'en faire. D'ailleurs, comme il n'y a point d'imprimeries, il n'y a point par conséquent de publication de libelles ; mais aussi il n'y a ni liberté, ni propriété, ni arts, ni sciences : l'état des peuples de ces tristes contrées n'est pas au-dessus de celui des bêtes, & leur condition est pire. En général, tout pays où il n'est pas permis de penser & d'écrire ses pensées, doit nécessairement tomber dans la stupidité, la superstition & la barbarie.
Les libelles se trouvent séverement punis dans le gouvernement aristocratique, parce que les magistrats s'y voyent de petits souverains qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures. Voilà pourquoi les décemvirs, qui formoient une aristocratie, décernerent une punition capitale contre les auteurs de libelles.
Dans la démocratie, il ne convient pas de sévir contre les libelles, par les raisons qui les punissent criminellement dans les gouvernemens absolus & aristocratiques.
Dans les monarchies éclairées les libelles sont moins regardés comme un crime que comme un objet de police. Les Anglois abandonnent les libelles à leur destinée, & les regardent comme un inconvénient d'un gouvernement libre qu'il n'est pas dans la nature des choses humaines d'éviter. Ils croient qu'il faut laisser aller, non la licence effrénée de la satyre, mais la liberté des discours & des écrits, comme des gages de la liberté civile & politique d'un état, parce qu'il est moins dangereux que quelques gens d'honneur soient mal-à-propos diffamés, que si l'on n'osoit éclairer son pays sur la conduite des gens puissans en autorité. Le pouvoir a de si grandes ressources pour jetter l'effroi & la servitude dans les ames, il a tant de pente à s'accroître injustement, qu'on doit beaucoup plus craindre l'adulation qui le suit, que la hardiesse de démasquer ses allures. Quand les gouverneurs d'un état ne donnent aucun sujet réel à la censure de leur conduite, ils n'ont rien à redouter de la calomnie & du mensonge. Libres de tout reproche, ils marchent avec confiance, & n'appréhendent point de rendre compte de leur administration : les traits de la satyre passent sur leurs têtes & tombent à leurs piés. Les honnêtes gens embrassent le parti de la vertu, & punissent la calomnie par le mépris.
Les libelles sont encore moins redoutables, par rapport aux opinions spéculatives. La vérité a un ascendant si victorieux sur l'erreur ! elle n'a qu'à se montrer pour s'attirer l'estime & l'admiration. Nous la voyons tous les jours briser les chaînes de la fraude & de la tyrannie, ou percer au-travers des nuages de la superstition & de l'ignorance. Que ne produiroit-elle point si l'on ouvroit toutes les barrieres qu'on oppose à ses pas !
On auroit tort de conclure de l'abus d'une chose à la nécessité de sa destruction. Les peuples ont souffert de grands maux de leurs rois & de leurs magistrats ; faut-il pour cette raison abolir la royauté & les magistratures ? Tout bien est d'ordinaire accompagné de quelque inconvénient, & n'en peut être séparé. Il s'agit de considérer qui doit l'emporter, & déterminer notre choix en faveur du plus grand avantage.
Enfin, disent ces mêmes politiques, toutes les méthodes employées jusqu'à ce jour, pour prévenir ou proscrire les libelles dans les gouvernemens monarchiques, ont été sans succès ; soit avant, soit surtout depuis que l'Imprimerie est répandue dans toute l'Europe. Les libelles odieux & justement défendus, ne sont, par la punition de leurs auteurs, que plus recherchés & plus multipliés. Sous l'empire de Néron un nommé Fabricius Véjento ayant été convaincu de quantité de libelles contre les sénateurs & le clergé de Rome, fut banni d'Italie, & ses écrits satyriques condamnés au feu : on les rechercha, dit Tacite, on les lut avec la derniere avidité tant qu'il y eut du péril à le faire ; mais dès qu'il fut permis de les avoir, personne ne s'en soucia plus. Le latin est au-dessus de ma traduction : Convictum Vejetonem, Italiâ depulit. Nero, libros exuri jussit, conquisitos, lectitatosque, donec cum periculo parabantur ; mox licentia habendi, oblivionem attulit. Annal. liv. XIV. ch. l.
Néron, tout Néron qu'il étoit, empêcha de poursuivre criminellement les écrivains des satyres contre sa personne, & laissa seulement subsister l'ordonnance du sénat, qui condamnoit au bannissement & à la confiscation des biens le préteur Antistius, dont les libelles étoient les plus sanglans. Henri IV. eh quel aimable prince ! se contenta de lasser le duc de Mayenne à la promenade, pour peine de tous les libelles diffamatoires qu'il avoit semés contre lui pendant le cours de la ligue ; & quand il vit que le duc de Mayenne suoit un peu pour le suivre : " Allons, dit-il, mon cousin nous reposer présentement, voilà toute la vengeance que j'en voulois ".
Un auteur françois très-moderne, qui est bien éloigné de prendre le parti des libelles & qui les condamne séverement, n'a pu cependant s'empêcher de réfléchir que certaines flatteries peuvent être encore plus dangereuses & par conséquent plus criminelles aux yeux d'un prince ami de la gloire, que des libelles faits contre lui. Une flatterie, dit-il, peut à son insçu détourner un bon prince du chemin de la vertu, lorsqu'un libelle peut quelquefois y ramener un tyran : c'est souvent par la bouche de la licence que les plaintes des opprimés s'élevent jusqu'au trône qui les ignore.
A dieu ne plaise que je prétende que les hommes puissent insolemment répandre la satyre & la calomnie sur leurs supérieurs ou leurs égaux ! La religion, la morale, les droits de la vérité, la nécessité de la subordination, l'ordre, la paix & le repos de la société concourent ensemble à détester cette audace ; mais je ne voudrois pas, dans un état policé, réprimer la licence par des moyens qui détruiroient inévitablement toute liberté. On peut punir les abus par des lois sages, qui dans leur prudente exécution réuniront la justice avec le plus grand bonheur de la société & la conservation du gouvernement. (D.J.)
|
| LIBELLÉ | adj. (Jurisprud.) signifie qui est motivé & appuyé. L'ordonnance de 1667 veut que l'ajournement soit libellé, & contienne sommairement les moyens de la demande, titre 2. article j. (A)
|
| LIBELLI | S. m. pl. (anc. Jurisprud. rom.) les libelli étoient à Rome les informations dans lesquelles les accusateurs écrivoient le nom & les crimes de l'accusé ; ils donnoient ensuite ces informations au juge ou au préteur, qui les obligeoit de les signer avant que de les recevoir. (D.J.)
|
| LIBENTINA | S. f. (Litter.) déesse du plaisir. De libendo, dit Varron, se sont faits les noms libido, libidinosus, Libentina, & autres. Plaute appelle cette déesse Lubentia quand il dit, Asin. act. II. sc. 2. v. 2. uti ego illos Lubentiores faciam, quam Lubentia est. C'est Vénus libentine selon Lambin, la déesse de la joie. (D.J.)
|
| LIBER | (Mythol.) c'est-à-dire libre, surnom qu'on donnoit à Bacchus, ou parce qu'il procura la liberté aux villes de la Béotie, ou plutôt parce qu'étant le dieu du vin, il délivre l'esprit de tout souci, & fait qu'on parle librement ; on lui joignoit souvent le mot pater, comme qui diroit le pere de la joie & de la liberté.
Quelques payens s'étoient imaginés que les Juifs adoroient aussi leur dieu liber, parce que les prêtres hébreux jouoient des instrumens de musique, de la flûte & du tambour dans les cérémonies judaïques, & qu'ils possédoient dans leur temple une vigne d'or ; mais Tacite n'adopte point ce sentiment ; car, dit-il, Bacchus aime les fêtes où regne la bonne chere & la gaieté, au lieu que celles des Juifs sont absurdes & sordides. Quippe liber festos, laetosque ritus instituit, Judaeorum mos absurdus, sordidusque. (D.J.)
LIBER, (Littér.) nom latin qu'on a donné aux pellicules prises d'entre l'écorce & le tronc de certains arbres, dont on se servoit dans plusieurs pays pour écrire : on nommoit pareillement les pellicules d'arbres employées à cet usage, corticea charta. Il n'en faut pas confondre la matiere avec celle du papier d'Egypte. Comme les charges du papier d'Egypte n'abordoient que sur les côtes de la mer Méditerranée, les pays éloignés de cette mer en pouvoient souvent manquer ; & alors entre les diverses substances qu'ils essayerent pour y suppléer, on compte les pellicules d'arbres, le liber dont nous venons de parler, d'où est venu le nom de livre. (D.J.)
|
| LIBERA | (Mythol.) Il y avoit une déesse Libera que Cicéron, dans son livre de la nature des dieux, fait fille de Jupiter & de Cérès. Ovide dans ses fastes dit que le nom de libera fut donné par Bacchus à Ariadne, qu'il consola de l'infidélité de Thésée. Il y a des médailles & des monumens consacrés à Liber & à Libera tout ensemble : Libera y est représentée couronnée de feuilles de vignes, de même que Bacchus. Les médailles consulaires de la famille Cassia, nous offrent les portraits de Liber & de Libera comme ils sont nommés dans les anciennes inscriptions, c'est-à-dire, selon plusieurs antiquaires, de Bacchus mâle & de Bacchus femelle. (D.J.)
|
| LIBÉRALES | liberalia, s. f. pl. (Littér.) fêtes qu'on célébroit à Rome en l'honneur de Bacchus le 17 de Mars, à l'imitation des dionisiaques d'Athènes. Voyez DIONISYSIENNES.
Ovide dit dans ses Tristes qu'il a souvent assisté aux fêtes libérales. Varron ne dérive pas le nom de cette fête de Liber, Bacchus, mais du mot liber, considéré comme adjectif, qui veut dire libre, parce que les prêtres de Bacchus se trouvoient libres de leurs fonctions & dégagés de tous soins au tems des libérales. C'étoit des femmes qui faisoient les cérémonies & les sacrifices de la fête : on les voyoit couronnées de lierre à la porte du temple, ayant devant elles un foyer & des liqueurs composées avec du miel, & invitant les passans à en acheter pour en faire des libations à Bacchus en les jettant dans le feu. On mangeoit en public ce jour-là, & la joie libre régnoit dans toute la ville. (D.J.)
|
| LIBERALITÉ | S. f. (Morale) c'est une disposition à faire part aux hommes de ses propres biens ; elle doit, comme toutes les qualités qui ont leur source dans la bienveillance, la pitié, & le desir des louanges, &c. être subordonnée à la justice pour devenir une vertu. La libéralité ne peut être exercée que par les particuliers, parce qu'ils ont des biens qui leur sont propres ; elle est injuste & dangereuse dans les souverains. Le roi de Prusse n'étant encore que prince royal, avoit récompensé libéralement une actrice célebre ; il la récompensa beaucoup moins lorsqu'il fut roi, & il dit à cette occasion ces paroles remarquables : autrefois je donnois mon argent, & je donne aujourd'hui celui de mes sujets.
La libéralité, comme on voit, est donc une vertu qui consiste à donner à propos, sans intérêt, ni trop, ni trop peu.
La libéralité est une qualité moins admirable que la générosité ; parce que celle-ci ne se borne point aux objets pécuniaires, & qu'elle est en toutes choses une élévation de l'ame, dans la façon de penser & d'agir : c'est la d'Aristote, qui fait pour les autres par le plaisir d'obliger, beaucoup audelà de ce qu'ils peuvent attendre de nous. Mais le mérite éminent de la générosité, ne détruit point le cas qu'on doit faire de la libéralité, qui est toujours une vertu des plus estimables, quand elle n'est pas le fruit de la vanité de donner, de l'ostentation, de la politique, & de la simple décence de son état. Le vice nommé avarice dans l'idée commune, est précisément l'opposé de cette vertu.
Je définis la libéralité avec l'évêque de Peterborough, une vertu qui s'exerce en faisant part gratuitement aux autres, de ce qui nous appartient. Cette vertu a pour principe la justice de l'action, & pour but la plus excellente fin : car, quoique les donations soient libres, elles doivent être faites de maniere, que ce que l'on donne de son bien ou de sa peine, serve à maintenir les parties d'une grande fin ; c'est-à-dire la sûreté, le bonheur, & l'avantage des sociétés.
Mais comme il est impossible de fournir aux dépenses que demande l'exercice de la libéralité, sans un attachement honnête à acquérir du bien, & à conserver celui qu'on a acquis, ce soin est prescrit par des maximes qui se tirent de la même fin dont nous venons de faire l'éloge. Ainsi la libéralité qui désigne principalement l'acte de donner & de dépenser comme il convient, renferme une volonté d'acquérir, & de conserver, selon les principes que dictent la raison & la vertu.
La volonté d'acquérir s'appelle prévoyance, & elle est opposée d'un côté à la rapacité, de l'autre, à une imprudente négligence de pourvoir sagement à l'avenir. La volonté de conserver, est ce que l'on nomme frugalité, économie, épargne entendue, qui tient un juste milieu entre la sordide mesquinerie & la prodigalité. Il est certain que ces deux choses, la prévoyance & la frugalité, facilitent la pratique de la libéralité, l'aident & la soutiennent. Soyez vigilant & économe dans les dépenses journalieres ; vous pourrez être libéral dans toutes les occasions nécessaires. Voilà pourquoi l'on voit très-peu régner cette vertu dans les pays de luxe : on n'y donne qu'à soi, rien aux autres, & l'on finit par être ruiné.
La libéralité a divers noms, selon la diversité des objets envers lesquels on doit l'exercer ; car si l'on est libéral pour des choses qui sont d'une très-grande utilité publique, cette vertu est une noble magnificence, , dit Aristote, à quoi est opposée d'un côté la profusion des ambitieux, & de l'autre la vilenie des ames basses. Si l'on est libéral envers les malheureux, c'est une compassion pratique ; & quand on assiste les pauvres, c'est l'aumône. La libéralité exercée envers les étrangers, s'appelle hospitalité, sur-tout si on les reçoit dans sa maison. En tout cela la juste mesure de la bénéficence, dépend de ce qui contribue le plus aux diverses parties de la grande fin ; savoir aux secours réciproques, au commerce entre les divers états ; au bien des sociétés particulieres, autant qu'on peut le procurer, sans préjudice des sociétés supérieures.
Il ne faut pas confondre la libéralité avec la prodigalité, quoiqu'elles paroissent avoir ensemble un grand rapport ; l'une est une vertu, & l'autre un excès vicieux. La prodigalité consiste à répandre sans choix, sans discernement, sans égard à toutes les circonstances ; cet homme prodigue, qu'on appelle d'ordinaire généreux, trouvera bientôt qu'il a sacrifié en vaines dépenses, à des sots, des fripons, des flateurs, & même à des malheureux volontaires, tous les moyens d'assister à l'avenir d'honnêtes gens. S'il est beau de donner, quel soin ne doit on pas prendre de se conserver en situation de faire toute sa vie des actes de libéralité ?
Mais je ne tiens point compte à Crassus de ses libéralités immenses, employées même en choses honnêtes, parce qu'il en avoit acquis le moyen par des voies criminelles. Les largesses estimables sont celles qui viennent de la pureté des moeurs, & qui sont les suites & les compagnes d'une vie vertueuse.
La libéralité bien appliquée, est absolument nécessaire aux princes pour l'avancement du bonheur public. " A le prendre exactement, dit Montagne, un roi en tant que roi, n'a rien proprement sien ; il se doit soi-même à autrui. Le prince ayant à donner, ou pour mieux dire à payer, & rendre à tant de gens selon qu'ils ont desservi, il en doit être loyal dispensateur. Mais si la libéralité d'un prince est sans discrétion & sans mesure, je l'aime mieux avare. L'immodérée largesse est un moyen foible à lui acquérir bienveillance, car elle rebute plus de gens qu'elle n'en pratique ; & si elle est employée sans respect de mérite, fait vergogne à qui la reçoit, & se reçoit sans grace. Les sujets d'un prince excessif en don, se rendent excessifs en demandes ; ils se taillent non à la raison, mais à l'exemple. Qui a sa pensée à prendre, ne l'a plus à ce qu'il a prins ".
Enfin, comme les rois ont particulierement reservé la libéralité dans leur charge, ce n'est pas assez que leurs bienfaits roulent sur la récompense de la vertu, il faut qu'en même tems leur dispensation ne blesse point l'équité. Satisbarzane officier chéri d'Artaxerxes, voulant profiter de ses bontés, lui demanda pour gratification une chose qui n'étoit pas juste. Ce prince comprit que la demande pouvoit s'évaluer à trente mille dariques ; il se les fit apporter, & les lui donna en disant : " Satisbarzane, prenez cette somme ; en vous la donnant je ne serai pas plus pauvre, au lieu que si je faisois ce que vous me demandez, je serois plus injuste ".
J'ai quelquefois pensé que la libéralité étoit une de ces qualités, dont les germes se manifestent dès la plus tendre enfance. Le persan Sadi rapporte dans son rosaire du plus libéral & du plus généreux des princes indiens, qu'on augura dans tout le pays qu'il seroit tel un jour, lorsqu'on vit qu'il ne vouloit pas teter sa mere, qu'elle n'allaitât en même tems un autre enfant de sa seconde mamelle. (D.J.)
LIBERALITE, (Littérat.) vertu personnifiée sur les médailles romaines, & représentée d'ordinaire en dame romaine, vêtue d'une longue robe. On ne manqua pas de la faire paroître sur les médailles des empereurs, tantôt répandant la corne d'abondance, tantôt la tenant d'une main, & montrant de l'autre une tablette marquée de plusieurs nombres, pour désigner sous ce voile la quantité d'argent, de grain ou de vin, que l'empereur donnoit au peuple. Dans d'autres médailles, l'action du prince qui fait ces sortes de largesses, est nuement représentée. Ce sont là les médailles qu'on appelle liberalitas par excellence ; mais cet empereur quelquefois libéral par crainte, par politique ou par ostentation, n'avoit-il pas tout pris & tout usurpé lui-même ? (D.J.)
|
| LIBÉRATION | S. f. (Jurisprud.) est la décharge d'une dette, d'une poursuite, d'une servitude, ou de quelqu'autre charge ou droit. (A)
|
| LIBERATOR | (Littérat.) Jupiter se trouve quelquefois appellé de ce nom dans les Poëtes. On le donnoit toujours à ce dieu, lorsqu'on l'avoit invoqué dans quelque danger, dont on croyoit être sorti par sa protection. (D.J.)
|
| LIBERIES | S. f. pl. Liberia, (Littérat.) fête des Romains, qui tomboit le 16 des calendes d'Avril, c'est-à-dire le 17 de Mars. C'étoit le jour auquel les enfans quittoient la robe de l'enfance, & prenoient celle qu'on appelloit toga libera, la toge libre. Voyez Dempster, paral. ad Rosini antiquit. lib. V. cap. 32. (D.J.)
|
| LIBERTÉ | S. f. (Morale) La liberté réside dans le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il veut, conformément à sa propre détermination. On ne sauroit dire que dans un sens fort impropre, que cette faculté ait lieu dans les jugemens que nous portons sur les vérités, par rapport à celles qui sont évidentes ; elles entraînent notre consentement, & ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend de nous, c'est d'y appliquer notre esprit ou de l'en éloigner. Mais dès que l'évidence diminue, la liberté rentre dans ses droits, qui varient & se reglent sur les degrés de clarté ou d'obscurité : les biens & les maux en sont les principaux objets. Elle ne s'étend pas pourtant sur les notions générales du bien & du mal. La nature nous a faits de maniere, que nous ne saurions nous porter que vers le bien, & qu'avoir horreur du mal envisagé en général ; mais dès qu'il s'agit du détail, notre liberté a un vaste champ, & peut nous déterminer de bien des côtés différens, suivant les circonstances & les motifs. On se sert d'un grand nombre de preuves, pour montrer que la liberté est une prérogative réelle de l'homme ; mais elles ne sont pas toutes également fortes. M. Turretin en rapporte douze : en voici la liste. 1°. Notre propre sentiment qui nous fournit la conviction de la liberté. 2°. Sans liberté, les hommes seroient de purs automates, qui suivroient l'impulsion des causes, comme une montre s'assujettit aux mouvemens dont l'horloger l'a rendue susceptible. 3°. Les idées de vertu & de vice, de louange & de blâme qui nous sont naturelles, ne signifieroient rien. 4°. Un bienfait ne seroit pas plus digne de reconnoissance que le feu qui nous échauffe. 5°. Tout devient nécessaire ou impossible. Ce qui n'est pas arrivé ne pourroit arriver. Ainsi tous les projets sont inutiles ; toutes les regles de la prudence sont fausses, puisque dans toutes choses la fin & les moyens sont également nécessairement déterminés. 6°. D'où viennent les remords de la conscience, & qu'ai-je à me reprocher si j'ai fait ce que je ne pouvois éviter de faire ? 7°. Qu'est-ce qu'un poëte, un historien, un conquérant, un sage législateur ? Ce sont des gens qui ne pouvoient agir autrement qu'ils ont fait. 8°. Pourquoi punir les criminels, & récompenser les gens de bien ? Les plus grands scélérats sont des victimes innocentes qu'on immole, s'il n'y a point de liberté. 9°. A qui attribuer la cause du péché, qu'à Dieu ? Que devient la Religion avec tous ses devoirs ? 10°. A qui Dieu donne-t-il des lois, fait-il des promesses & des menaces, prépare-t-il des peines & des récompenses ? à de pures machines incapables de choix ? 11°. S'il n'y a point de liberté, d'où en avons-nous l'idée ? Il est étrange que des causes nécessaires nous ayent conduit à douter de leur propre nécessité. 12°. Enfin les fatalistes ne sauroient se formaliser de quoi que ce soit qu'on leur dit, & de ce qu'on leur fait.
Pour traiter ce sujet avec précision, il faut donner une idée des principaux systèmes qui le concernent. Le premier système sur la liberté, est celui de la fatalité. Ceux qui l'admettent, n'attribuent pas nos actions à nos idées, dans lesquelles seules réside la persuasion, mais à une cause méchanique, laquelle entraîne avec soi la détermination de la volonté ; de maniere que nous n'agissons pas, parce que nous le voulons, mais que nous voulons, parce que nous agissons. C'est là la vraie distinction entre la liberté & la fatalité. C'est précisément celle que les Stoïciens reconnoissoient autrefois, & que les Mahométans admettent encore de nos jours. Les Stoïciens pensoient donc que tout arrive par une aveugle fatalité ; que les événemens se succedent les uns aux autres, sans que rien puisse changer l'étroite chaîne qu'ils forment entr'eux ; enfin que l'homme n'est point libre. La liberté, disoient-ils, est une chimere d'autant plus flateuse, que l'amour-propre s'y prête tout entier. Elle consiste en un point assez délicat, en ce qu'on se rend témoignage à soi-même de ses actions, & qu'on ignore les motifs qui les ont fait faire : il arrive de-là, que méconnoissant ces motifs, & ne pouvant rassembler les circonstances qui l'ont déterminé à agir d'une certaine maniere, chaque homme se félicite de ses actions, & se les attribue.
Le fatum des Turcs vient de l'opinion où ils sont que tout est abreuvé des influences célestes, & qu'elles reglent la disposition future des événemens.
Les Esséniens avoient une idée si haute & si décisive de la providence, qu'ils croyoient que tout arrive par une fatalité inévitable, & suivant l'ordre que cette providence a établi, & qui ne change jamais. Point de choix dans leur système, point de liberté. Tous les événemens forment une chaîne étroite & inaltérable : ôtez un seul de ces événemens, la chaîne est rompue, & toute l'économie de l'univers est troublée. Une chose qu'il faut ici remarquer, c'est que la doctrine qui détruit la liberté, porte naturellement à la volupté ; & qui ne consulte que son goût, son amour-propre & ses penchans, trouve assez de raisons pour la suivre & pour l'approuver : cependant les moeurs des Esséniens & des Stoïciens ne se ressentoient point du désordre de leur esprit.
Spinosa, Hobbes & plusieurs autres ont admis de nos jours une semblable fatalité.
Spinosa a répandu cette erreur dans plusieurs endroits de ses ouvrages ; l'exemple qu'il allegue pour éclaircir la matiere de la liberté, suffira pour nous en convaincre. " Concevez, dit-il, qu'une pierre, pendant qu'elle continue à se mouvoir, pense & sache qu'elle s'efforce de continuer autant qu'elle peut son mouvement ; cette pierre par cela même qu'elle a le sentiment de l'effort qu'elle fait pour se mouvoir, & qu'elle n'est nullement indifférente entre le mouvement & le repos, croira qu'elle est très-libre, & qu'elle persévere à se mouvoir uniquement parce qu'elle le veut. Et voilà quelle est cette liberté tant vantée, & qui consiste seulement dans le sentiment que les hommes ont de leurs appétits, & dans l'ignorance des causes de leurs déterminations ". Spinosa ne dépouille pas seulement les créatures de la liberté, il assujettit encore son Dieu à une brute & fatale necessité : c'est le grand fondement de son système. De ce principe il s'ensuit qu'il est impossible qu'aucune chose qui n'existe pas actuellement, ait pû exister, & que tout ce qui existe, existe si nécessairement qu'il ne sauroit n'être pas ; & enfin qu'il n'y a pas jusqu'aux manieres d'être, & aux circonstances de l'existence des choses, qui n'ayent dû être à tous égards précisément ce qu'elles sont aujourd'hui. Spinosa admet en termes exprès ces conséquences, & il ne fait pas difficulté d'avouer qu'elles sont des suites naturelles de ses principes.
On peut réduire tous les argumens dont Spinosa & ses sectateurs se sont servis pour soutenir cette absurde hypothèse, à ces deux. Ils disent 1°. que puisque tout effet présuppose une cause, & que, de la même maniere que tout mouvement qui arrive dans un corps lui est causé par l'impulsion d'un autre corps, & le mouvement de ce second par l'impulsion d'un troisieme ; & ainsi chaque volition, & chaque détermination de la volonté de l'homme, doit nécessairement être produite par quelque cause extérieure, & celle-ci par une troisieme ; d'où ils concluent que la liberté de la volonté n'est qu'une chimere. Ils disent en second lieu que la pensée avec tous ses modes, ne sont que des qualités de la matiere ; & par conséquent qu'il n'y a point de liberté de volonté, puisqu'il est évident que la matiere n'a pas en elle-même le pouvoir de commencer le mouvement, ou de se donner à elle-même la moindre détermination.
En troisieme lieu, ils ajoûtent que ce que nous sommes dans l'instant qui va suivre, dépend si nécessairement de ce que nous sommes dans l'instant présent, qu'il est métaphysiquement impossible que nous soyons autres. Car, continuent-ils, supposons une femme qui soit entraînée par sa passion à se jetter tout-à-l'heure entre les bras de son amant ; si nous imaginons cent mille femmes entierement semblables à la premiere, d'âge, de tempérament, d'éducation, d'organisation, d'idées, telles en un mot, qu'il n'y ait aucune différence assignable entr'elles & la premiere : on les voit toutes également soumises à la passion dominante, & précipitées entre les bras de leurs amans, sans qu'on puisse concevoir aucune raison pour laquelle l'une ne feroit pas ce que toutes les autres feront. Nous ne faisons rien qu'on puisse appeller bien ou mal, sans motif. Or il n'y a aucun motif qui dépende de nous, soit eu égard à sa production, soit eu égard à son énergie. Prétendre qu'il y a dans l'ame une activité qui lui est propre ; c'est dire une chose inintelligible, & qui ne résout rien. Car il faudra toujours une cause indépendante de l'ame qui détermine cette activité à une chose plutôt qu'à une autre ; & pour reprendre la premiere partie du raisonnement, ce que nous sommes dans l'instant qui va suivre, dépend donc absolument de ce que nous sommes dans l'instant présent ; ce que nous sommes dans l'instant présent, dépend donc de ce que nous étions dans l'instant précédent ; & ainsi de suite, en remontant jusqu'au premier instant de notre existence, s'il y en a un. Notre vie n'est donc qu'un enchaînement d'instans d'existences & d'actions nécessaires ; notre volonté, un acquiescement à être ce que nous sommes nécessairement dans chacun de ces instans, & notre liberté une chimère ; ou il n'y a rien de démontré en aucun genre ou cela l'est. Mais ce qui confirme sur-tout ce système, c'est le moment de la délibération, le cas de l'irrésolution. Qu'est-ce que nous faisons dans l'irrésolution ? nous oscillons entre deux ou plusieurs motifs, qui nous tirent alternativement en sens contraire. Notre entendement est alors comme créateur & spectateur de la nécessité de nos balancemens. Supprimez tous les motifs qui nous agitent, alors inertie & repos nécessaires. Supposez un seul & unique motif ; alors une action nécessaire. Supposez deux ou plusieurs motifs conspirans, même nécessité, & plus de vîtesse dans l'action. Supposez deux ou plusieurs motifs opposés & à-peu-près de forces égales, alors oscillations, oscillations semblables à celles des bras d'une balance mise en mouvement, & durables jusqu'à ce que le motif le plus puissant fixe la situation de la balance & de l'ame. Et comment se pourroit-il faire que le motif le plus foible fût le motif déterminant ? Ce seroit dire qu'il est en même tems le plus foible & le plus fort. Il n'y a de différence entre l'homme automate qui agit dans le sommeil, & l'homme intelligent qui agit & qui veille, sinon que l'entendement est plus présent à la chose ; quant à la nécessité, elle est la même. Mais, leur dit-on, qu'est-ce que ce sentiment intérieur de notre liberté ? l'illusion d'un enfant qui ne réfléchit sur rien. L'homme n'est donc pas différent d'un automate ? Nullement différent d'un automate qui sent ; c'est une machine plus composée ? Il n'y a donc plus de vicieux & de vertueux ? non, si vous le voulez ; mais il y a des êtres heureux ou malheureux, bienfaisans & malfaisans. Et les récompenses & les châtimens ? Il faut bannir ces mots de la Morale ; on ne récompense point, mais on encourage à bien faire ; on ne châtie point, mais on étouffe, on effraye ? Et les lois, & les bons exemples, & les exhortations, à quoi servent-elles ? Elles sont d'autant plus utiles, qu'elles ont nécessairement leurs effets. Mais, pourquoi distinguez vous par votre indignation & par votre colere, l'homme qui vous offense, de la tuile qui vous blesse ? c'est que je suis déraisonnable, & qu'alors je ressemble au chien qui mord la pierre qui l'a frappé. Mais cette idée de liberté que nous avons, d'où vient-elle ? De la même source qu'une infinité d'autres idées fausses que nous avons ? En un mot, concluent-ils, ne vous effarouchez pas à contre-tems. Ce système qui vous paroît si dangereux, ne l'est point ; il ne change rien au bon ordre de la société. Les choses qui corrompent les hommes seront toujours à supprimer ; les choses qui les améliorent, seront toujours à multiplier & à fortifier. C'est une dispute de gens oisifs, qui ne mérite point la moindre animadversion de la part du législateur. Seulement notre système de la nécessité assure à toute cause bonne, ou conforme à l'ordre établi, son bon effet ; à toute cause mauvaise ou contraire à l'ordre établi, son mauvais effet ; & en nous prêchant l'indulgence & la commisération pour ceux qui sont malheureusement nés, nous empêche d'être si vains de ne pas leur ressembler ; c'est un bonheur qui n'a dépendu de nous en aucune façon.
En quatrieme lieu, ils demandent si l'homme est un être simple tout spirituel, ou tout corporel, ou un être composé. Dans les deux premiers cas, ils n'ont pas de peine à prouver la nécessité de ses actions ; & si on leur répond que c'est un être composé de deux principes, l'un matériel & l'autre immatériel, voici comment ils raisonnent. Ou le principe spirituel est toujours dépendant du principe immatériel, ou toujours indépendant. S'il en est toujours dépendant, nécessité aussi absolue que si l'être étoit un, simple & tout matériel, ce qui est vrai. Mais si on leur soutient qu'il en est quelquefois dépendant, & quelquefois indépendant ; si on leur dit que les pensées de ceux qui ont la fievre chaude & des fous ne sont pas libres, au lieu qu'elles le sont dans ceux qui sont sains : ils répondent qu'il n'y a ni uniformité ni liaison dans notre système, & que nous rendons les deux principes indépendans, selon le besoin que nous avons de cette supposition pour nous défendre, & non selon la vérité de la chose. Si un fou n'est pas libre, un sage ne l'est pas davantage ; & soutenir le contraire, c'est prétendre qu'un poids de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids de six. Mais si un poids de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids de six, il ne le sera pas non plus par un poids de mille ; car alors il résiste à un poids de six livres par un principe indépendant de sa pesanteur ; & ce principe, quel qu'il soit, n'aura pas plus de proportion avec un poids de mille livres qu'avec un poids de six livres, parce qu'il saut alors qu'il soit d'une nature différente de celle des poids.
Voilà certainement les argumens les plus forts qu'on puisse faire contre notre sentiment. Pour en montrer la vanité, je leur opposerai les trois propositions suivantes : La premiere est qu'il est faux que tout effet soit le produit de quelque cause externe ; qu'au contraire il faut de toute nécessité reconnoître un commencement d'action, c'est-à-dire un pouvoir d'agir indépendamment d'aucune action précédente, & que ce pouvoir peut être & est effectivement dans l'homme. Ma seconde proposition est que la pensée & la volonté ne sont ni ne peuvent être des qualités de la matiere. La troisieme enfin, que quand bien même l'ame ne seroit pas une substance distincte du corps, & qu'on supposeroit que la pensée & la volonté ne sont que des qualités de la matiere ; cela même ne prouveroit pas que la liberté de la volonté fût une chose impossible.
Je dis, 1°. que tout effet ne peut pas être produit par des causes externes, mais qu'il faut de toute nécessité reconnoitre un commencement d'action, c'est-à-dire, un pouvoir d'agir indépendamment d'aucune action antécédente, & que ce pouvoir est actuellement dans l'homme. Cela a déja été prouvé dans l'article du CONCOURS.
Je dis en second lieu, que la pensée & la volonté n'étant point des qualités de la matiere, elles ne peuvent pas par conséquent être soumises à ses lois ; car tout ce qui est fait ou composé d'une chose, il est toujours cette même chose dont il est composé. Par exemple, tous les changemens, toutes les compositions, toutes les divisions possibles de la figure ne sont autre chose que figure ; & toutes les compositions, tous les effets possibles du mouvement ne seront jamais autre chose que mouvement. Si donc il y a eu un tems où il n'y ait eu dans l'univers autre chose que matiere & que mouvement, il faudra dire qu'il est impossible que jamais il y ait pû avoir dans l'univers autre chose que matiere & que mouvement. Dans cette supposition, il est aussi impossible que l'intelligence, la réflexion & toutes les diverses sensations ayent jamais commencé à exister ; qu'il est maintenant impossible que le mouvement soit bleu ou rouge, & que le triangle soit transformé en un son. Voyez l'article de l'AME, où cela a été prouvé plus au long.
Mais quand même j'accorderois à Spinosa & à Hobbes que la pensée & la volonté peuvent être & sont en effet des qualités de la matiere, tout cela ne décideroit point en leur faveur la question présente sur la liberté, & ne prouveroit pas qu'une volonté libre fût une chose impossible ; car, puisque nous avons déja démontré que la pensée & la volonté ne peuvent pas être des productions de la figure & du mouvement, il est clair que tout homme qui suppose que la pensée & la volonté sont des qualités de la matiere, doit supposer aussi que la matiere est capable de certaines propriétés entierement différentes de la figure & du mouvement. Or si la matiere est capable de telles propriétés, comment prouvera-t-on que les effets de la figure & du mouvement, étant tous nécessaires, les effets des autres propriétés de la matiere entierement distinctes de celles-là, doivent être pareillement nécessaires ? Il paroit par là que l'argument dont Hobbes & ses sectateurs font leur grand bouclier, n'est qu'un pur sophisme ; car ils supposent d'un côté que la matiere est capable de pensée & de volonté, d'où ils concluent que l'ame n'est qu'une pure matiere. Sachant d'un autre côté que les effets de la figure & du mouvement doivent tous être nécessaires, ils en concluent que toutes les opérations de l'ame sont nécessaires ; c'est-à-dire, que lorsqu'il s'agit de prouver que l'ame n'est que pure matiere, ils supposent la matiere capable non seulement de figure & de mouvement, mais aussi d'autres propriétés inconnues. Au contraire, s'agit-il de prouver que la volonté & les autres opérations de l'ame sont des choses nécessaires, ils dépouillent la matiere de ces prétendues propriétés inconnues, & n'en font plus qu'un pur solide, composé de figure & de mouvement.
Après avoir satisfait à quelques objections qu'on fait contre la liberté, attaquons à notre tour les partisans de l'aveugle fatalité. La liberté brille dans tout son jour, soit qu'on la considere dans l'esprit, soit qu'on l'examine par rapport à l'empire qu'elle exerce sur le corps. Et 1°. quand je veux penser à quelque chose, comme à la vertu que l'aimant a d'attirer le fer ; n'est-il pas certain que j'applique mon ame à méditer cette question toutes les fois qu'il me plaît, & que je l'en détourne quand je veux ? Ce seroit chicaner honteusement que de vouloir en douter. Il ne s'agit plus que d'en découvrir la cause. On voit, 1°. que l'objet n'est pas devant mes yeux ; je n'ai ni fer ni aimant, ce n'est donc pas l'objet qui m'a déterminé à y penser. Je sais bien que quand nous avons vu une fois quelque chose, il reste quelques traces dans le cerveau qui facilitent la détermination des esprits. Il peut arriver de-là que quelquefois ces esprits coulent d'eux-mêmes dans ces traces, sans que nous en sachions la cause ; ou même un objet qui a quelque rapport avec celui qu'ils représentent, peut les avoir excités & réveillés pour agir, alors l'objet vient de lui-même se présenter à notre imagination. De même, quand les esprits animaux sont émus par quelque forte passion, l'objet se représente malgré nous ; & quoi que nous fassions, il occupe notre pensée. Tout cela se fait ; on n'en disconvient pas. Mais il n'est pas question de cela : car outre toutes ces raisons qui peuvent exciter en mon esprit une telle pensée, je sens que j'ai le pouvoir de la produire toutes les fois que je veux. Je pense à ce moment pourquoi l'aimant attire le fer ; dans un moment, si je veux, je n'y penserai plus, & j'occuperai mon esprit à méditer sur le flux & le reflux de la mer. De-là je passerai, s'il me plaît, à rechercher la cause de la pesanteur ; ensuite je rappellerai, si je veux, la pensée de l'aimant, & je la conserverai tant qu'il me plaira. On ne peut agir plus librement. Non seulement j'ai ce pouvoir, mais je sens & je sais que je l'ai. Puis donc que c'est une vérité d'expérience, de connoissance & de sentiment, on doit plutôt la considérer comme un fait incontestable que comme une question dont on doive disputer. Il y a donc sans contredit, au-dedans de moi, un principe, une cause supérieure qui régit mes pensées, qui les fait naître, qui les éloigne, qui les rappelle en un instant & à son commandement ; & par conséquent il y a dans l'homme un esprit libre, qui agit sur soi-même comme il lui plaît.
A l'égard des opérations du corps, le pouvoir absolu de la volonté n'est pas moins sensible. Je veux mouvoir mon bras, je le remue aussi-tôt ; je veux parler, & je parle à l'instant, &c. On est intérieurement convaincu de toutes ces vérités, personne ne les nie : rien au monde n'est capable de les obscurcir. On ne peut donner ni se former une idée de la liberté, quelque grande, quelque indépendante qu'elle puisse être, que je n'éprouve & ne reconnoisse en moi-même à cet égard. Il est ridicule de dire que je crois être libre, parce que je suis capable & susceptible de plusieurs déterminations occasionnées par divers mouvemens que je ne connois pas : car je sais, je connois & je sens que les déterminations, qui font que je parle, ou que je me tais, dépendent de ma volonté ; nous ne sommes donc pas libres seulement en ce sens, que nous avons la connoissance de nos mouvemens, & que nous ne sentons ni force ni contrainte ; au contraire, nous sentons que nous avons chez nous le maître de la machine qui en conduit les ressorts comme il lui plaît. Malgré toutes les raisons & toutes les déterminations qui me portent & me poussent à me promener, je sens & je suis persuadé que ma volonté peut à son gré arrêter & suspendre à chaque instant l'effet de tous ces ressorts cachés qui me font agir. Si je n'agissois que par ces ressorts cachés, par les impressions des objets, il faudroit nécessairement que j'accomplisse tous les mouvemens qu'ils seroient capables de produire ; de même qu'une bille poussée acheve sur la table du billard tout le mouvement qu'elle a reçu.
On pourroit alléguer plusieurs occasions dans la vie humaine, où l'empire de cette liberté s'exerce avec tant de pouvoir qu'elle dompte les corps, & en réprime avec violence tous les mouvemens. Dans l'exercice de la vertu, où il s'agit de résister à une forte passion, tous les mouvemens du corps sont déterminés par la passion ; mais la volonté s'y oppose & les reprime par la seule raison du devoir. D'un autre côté, quand on fait réflexion sur tant de personnes qui se sont privées de la vie, sans y être poussées, ni par la folie, ni par la fureur, &c. mais par la seule vanité de faire parler d'eux, ou pour montrer la force de leur esprit, &c. il faut nécessairement reconnoître ce pouvoir de la liberté plus fort que tous les mouvemens de la nature. Quel pouvoir ne faut-il pas exercer sur ce corps pour contraindre de sang-froid la main à prendre un poignard pour se l'enfoncer dans le coeur.
Un des plus beaux esprits de notre siecle a voulu essayer jusqu'à quel point on pouvoit soutenir un paradoxe. Son imagination libertine a osé se jouer sur un sujet aussi respectable que celui de la liberté. Voici l'objection dans toute sa force. Ce qui est dépendant d'une chose, a certaines proportions avec cette même chose-là ; c'est-à-dire, qu'il reçoit des changemens, quand elle en reçoit selon la nature de leur proportion. Ce qui est indépendant d'une chose, n'a aucune proportion avec elle ; ensorte qu'il demeure égal, quand elle reçoit des augmentations & des dimensions. Je suppose, continue-t-il, avec tous les Métaphysiciens, 1°. que l'ame pense suivant que le cerveau est disposé, & qu'à de certaines dispositions matérielles du cerveau, & à de certains mouvemens qui s'y font, répondent certaines pensées de l'ame. 2°. Que tous les objets même spirituels auxquels on pense, laissent des dispositions matérielles, c'est-à-dire des traces dans le cerveau. 3°. Je suppose encore un cerveau où soient en même tems deux sortes de dispositions matérielles contraires & d'égale force ; les unes qui portent l'ame à penser vertueusement sur un sujet, les autres qui la portent à penser vicieusement. Cette supposition ne peut être refusée ; les dispositions matérielles contraires se peuvent aisément rencontrer ensemble dans le cerveau au même degré, & s'y rencontrent même nécessairement toutes les fois que l'ame délibere, & ne sait quel parti prendre. Cela supposé, je dis, ou l'ame se peut absolument déterminer dans cet équilibre des dispositions du cerveau à choisir entre les pensées vertueuses & les pensées vicieuses, ou elle ne peut absolument se déterminer dans cet équilibre. Si elle peut se déterminer, elle a en elle-même le pouvoir de se déterminer, puisque dans son cerveau tout ne tend qu'à l'indétermination, & que pourtant elle se détermine ; donc ce pouvoir qu'elle a de se déterminer est indépendant des dispositions du cerveau ; donc il n'a nulle proportion avec elles ; donc il demeure le même, quoiqu'elles changent ; donc si l'équilibre du cerveau subsistant, l'ame se détermine à penser vertueusement, elle n'aura pas moins le pouvoir de s'y déterminer, quand ce sera la disposition matérielle à penser vicieusement qui l'emportera sur l'autre ; donc à quelque degré que puisse monter cette disposition matérielle aux pensées vicieuses, l'ame n'en aura pas moins le pouvoir de se déterminer au choix des pensées vertueuses ; donc l'ame a en elle-même le pouvoir de se déterminer malgré toutes les dispositions contraires du cerveau ; donc les pensées de l'ame sont toujours libres. Venons au second cas.
Si l'ame ne peut se déterminer absolument, cela ne vient que de l'équilibre supposé dans le cerveau ; & l'on conçoit qu'elle ne se déterminera jamais, si l'une des dispositions ne vient à l'emporter sur l'autre, & qu'elle se déterminera nécessairement pour celle qui l'emportera ; donc le pouvoir qu'elle a de se déterminer au choix des pensées vertueuses ou vicieuses, est absolument dépendant des dispositions du cerveau ; donc, pour mieux dire, l'ame n'a en elle-même aucun pouvoir de se déterminer, & ce sont les dispositions du cerveau qui la déterminent au vice ou à la vertu ; donc les pensées de l'ame ne sont jamais libres. Or, rassemblant les deux cas ; ou il se trouve que les pensées de l'ame sont toujours libres, ou qu'elles ne le sont jamais en quelque cas que ce puisse être ; or il est vrai & reconnu de tous que les pensées des enfans, de ceux qui rêvent, de ceux qui ont la fievre chaude, & des fous, ne sont jamais libres.
Il est aisé de reconnoître le noeud de ce raisonnement. Il établit un principe uniforme dans l'ame ; ensorte que le principe est toujours ou indépendant des dispositions du cerveau, ou toujours dépendant ; au lieu que dans l'opinion commune, on le suppose quelquefois dépendant, & d'autres fois indépendant.
On dit que les pensées de ceux qui ont la fievre chaude & des fous ne sont pas libres, parce que les dispositions matérielles du cerveau sont atténuées & élevées à un tel degré, que l'ame ne leur peut résister ; au lieu que dans ceux qui sont sains, les dispositions du cerveau sont modérées, & n'entraînent pas nécessairement l'ame. Mais, 1°. dans ce système, le principe n'étant pas uniforme, il faut qu'on l'abandonne ; si je puis expliquer tout par un qui le soit. 2°. Si, comme nous l'avons dit plus haut, un poids de cinq livres pouvoit n'être pas emporté par un poids de six, il ne le seroit pas non plus par un poids de mille ; car s'il résistoit à un poids de six livres par un principe indépendant de la pesanteur : ce principe, quel qu'il fût, d'une nature toute différente de celle des poids, n'auroit pas plus de proportion avec un poids de mille livres, qu'avec un poids de six. Ainsi, si l'ame résiste à une disposition matérielle du cerveau qui la porte à un choix vicieux, & qui, quoique modérée, est pourtant plus forte que la disposition matérielle à la vertu, il faut que l'ame résiste à cette même disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de l'autre ; parce qu'elle ne peut lui avoir résisté d'abord que par un principe indépendant des dispositions du cerveau, & qui ne doit pas changer par les dispositions du cerveau. 3°. Si l'ame pouvoit voir très-clairement, malgré une disposition de l'oeil qui devroit affoiblir la vue, on pourroit conclure qu'elle verroit encore malgré une disposition de l'oeil qui devroit empêcher entierement la vision, en tant qu'elle est matérielle. 4°. On convient que l'ame dépend absolument des dispositions du cerveau sur ce qui regarde le plus ou le moins d'esprit. Cependant, si sur la vertu ou le vice, les dispositions du cerveau ne déterminent l'ame que lorsqu'elles sont extrêmes, & qu'elles lui laissent la liberté lorsqu'elles sont modérées ; ensorte qu'on peut avoir beaucoup de vertu, malgré une disposition médiocre au vice : il devroit être aussi qu'on peut avoir beaucoup d'esprit, malgré une disposition médiocre à la stupidité, ce qu'on ne peut pas admettre. Il est vrai que le travail augmente l'esprit, ou pour mieux dire, qu'il fortifie les dispositions du cerveau, & qu'ainsi l'esprit croît précisément autant que le cerveau se perfectionne.
En cinquieme lieu, je suppose que toute la différence qui est entre un cerveau qui veille & un cerveau qui dort, est qu'un cerveau qui dort est moins rempli d'esprits, & que les nerfs y sont moins tendus ; desorte que les mouvemens ne se communiquent pas d'un nerf à l'autre, & que les esprits qui rouvrent une trace n'en rouvrent pas une autre qui lui est liée. Cela supposé, si l'ame est en pouvoir de résister aux dispositions du cerveau, lorsqu'elles sont foibles, elle est toujours libre dans les songes, où les dispositions du cerveau qui la portent à de certaines choses sont toujours très-foibles. Si l'on dit que c'est qu'il ne se présente à elle que d'une sorte de pensées qui n'offrent point matiere de délibération ; je prends un songe où l'on délibere si l'on tuera son ami, ou si l'on ne le tuera pas, ce qui ne peut être produit que par des dispositions matérielles du cerveau qui soient contraires ; & en ce cas il paroît que, selon les principes de l'opinion commune, l'ame devroit être libre.
Je suppose qu'on se réveille lorsqu'on étoit résolu à tuer son ami, & que dès qu'on est réveillé on ne le veut plus tuer ; tout le changement qui arrive dans le cerveau, c'est qu'il se remplit d'esprits, que les nerfs se tendent : il faut voir comment cela produit la liberté. La disposition matérielle du cerveau qui me portoit en songe à tuer mon ami, étoit plus forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arrive à mon cerveau fortifie également toutes les deux, & elles demeurent dans la même disposition où elles étoient ; l'une restant, par exemple, trois fois plus forte que l'autre ; & vous ne sauriez concevoir pourquoi l'ame est libre, quand l'une de ces dispositions a dix degrés de force, & l'autre trente, & pourquoi elle n'est pas libre quand l'une de ces dispositions n'a qu'un degré de force, & l'autre trois.
Si ce changement du cerveau n'a fortifié que l'une de ces dispositions, il faut pour établir la liberté, que ce soit celle contre laquelle je me détermine, c'est-à-dire, celle qui me portoit à vouloir tuer mon ami ; & alors vous ne sauriez concevoir pourquoi la force qui survient à cette disposition vicieuse est nécessaire, pour faire que je puisse me déterminer en faveur de la disposition vertueuse qui demeure la même ; ce changement paroît plutôt un obstacle à la liberté. Enfin, s'il fortifie une disposition plus que l'autre, il faut encore que ce soit la disposition vicieuse ; & vous ne sauriez concevoir non plus pourquoi la force qui lui survient est nécessaire pour faire que l'une puisse faire embrasser l'autre qui est toujours plus foible, quoique plus forte qu'auparavant.
Si l'on dit que ce qui empêche pendant le sommeil la liberté de l'ame, c'est que les pensées ne se présentent pas à elle avec assez de netteté & de distinction ; je réponds que le défaut de netteté & de distinction dans les pensées, peut seulement empêcher l'ame de se déterminer avec assez de connoissance ; mais qu'il ne la peut empêcher de se déterminer librement, & qu'il ne doit pas ôter la liberté, mais seulement le mérite ou le démérite de la résolution qu'on prend. L'obscurité & la confusion des pensées fait que l'ame ne sait pas assez surquoi elle délibere ; mais elle ne fait pas que l'ame soit entraînée nécessairement à un parti, autrement si l'ame étoit nécessairement entraînée, ce seroit sans doute par celles de ses idées obscures & confuses qui le seroient le moins ; & je demanderois, pourquoi le plus de netteté & de distinction dans les pensées la détermineroit nécessairement pendant que l'on dort, & non pas pendant que l'on veille ; & je ferois revenir tous les raisonnemens que j'ai faits sur les dispositions matérielles.
Reprenons maintenant l'objection par parties. J'accorde d'abord les trois principes que pose l'objection. Cela posé, voyons quel argument on peut faire contre la liberté. Ou l'ame, nous dit-on, se peut absolument déterminer dans l'équilibre des dispositions du cerveau à choisir entre les pensées vertueuses & les pensées vicieuses, ou elle ne peut absolument se déterminer dans cet équilibre. Si elle peut se déterminer ; elle a en elle-même le pouvoir de se déterminer. Jusqu'ici il n'y a point de difficulté ; mais d'en conclure que le pouvoir qu'a l'ame de se déterminer est indépendant des dispositions du cerveau, c'est ce qui n'est pas exactement vrai. Si vous ne voulez dire par-là que ce qu'on entend ordinairement, savoir que la liberté ne réside pas dans le corps, mais seulement que l'ame en est le siege, la source & l'origine, je n'aurai sur cela aucune dispute avec vous ; mais si vous voulez en inférer que, quelles que soient les dispositions matérielles du cerveau, l'ame aura toujours le pouvoir de se déterminer au choix qui lui plaira ; c'est ce que je vous nierai. La raison en est, que l'ame pour se déterminer librement, doit nécessairement exercer toutes ses fonctions, & que pour les exercer, elle a besoin d'un corps prêt à obéir à tous ses commandemens, de même qu'un joueur de luth, doit avoir un luth dont toutes les cordes soient tendues & accordées, pour jouer les airs avec justesse : or il peut fort bien se faire que les dispositions matérielles du cerveau soient telles que l'ame ne puisse exercer toutes ses fonctions, ni par conséquent sa liberté : car la liberté consiste dans le pouvoir qu'on a de fixer ses idées, d'en rappeller d'autres pour les comparer ensemble, de diriger le mouvement de ses esprits, de les arrêter dans l'état où ils doivent être pour empêcher qu'une idée ne s'échappe, de s'opposer au torrent des autres esprits qui viendroient à la traverse imprimer à l'ame malgré elle d'autres idées. Or le cerveau est quelquefois tellement disposé, que ce pouvoir manque absolument à l'ame, comme cela se voit dans les enfans, dans ceux qui rêvent, &c. Posons un vaisseau mal fabriqué, un gouvernail mal-fait, le pilote avec tout son art, ne pourra point le conduire comme il souhaite : de même aussi un corps mal formé, un tempérament dépravé produira des actions déréglées. L'esprit humain ne pourra pas plus apporter de remede à ce déréglement pour le corriger, qu'un pilote au désordre du mouvement de son vaisseau.
Mais enfin, direz-vous, le pouvoir que l'ame a de se déterminer, est-il absolument dépendant des dispositions du cerveau, ou ne l'est-il pas ? Si vous dites que ce pouvoir de l'ame est absolument dépendant des dispositions du cerveau, vous direz aussi que l'ame ne se déterminera jamais, si l'une des dispositions du cerveau ne vient à l'emporter sur l'autre, & qu'elle se déterminera nécessairement pour celle qui l'emportera. Si au contraire vous supposez que ce pouvoir est indépendant des dispositions du cerveau, vous devez reconnoître pour libres les pensées des enfans, de ceux qui rêvent, &c. Je réponds que le pouvoir que l'ame a de se déterminer est quelquefois dépendant des dispositions du cerveau, & d'autres fois indépendant. Il est dépendant toutes les fois que le cerveau qui sert à l'ame d'organe & d'instrument pour exercer ses fonctions, n'est pas bien disposé ; alors les ressorts de la machine étant détraqués, l'ame est entraînée sans pouvoir exercer sa liberté. Mais le pouvoir de se déterminer est indépendant des dispositions matérielles du cerveau, lorsque ces dispositions sont modérées, que le cerveau est plein d'esprits, & que les nerfs sont tendus. La liberté sera d'autant plus parfaite que l'organe du cerveau sera mieux constitué, & que ses dispositions seront plus modérées. Je ne saurois vous marquer quelles sont les bornes au-delà desquelles s'évanouit la liberté. Tout ce que je sais, c'est que le pouvoir de se déterminer sera absolument indépendant des dispositions du cerveau, toutes les fois que le cerveau sera plein d'esprits, que ses fibres seront fermes, qu'elles seront tendues, & que les ressorts de la machine ne seront point démontés, ni par les accidens, ni par les maladies. Le principe, dites-vous, n'est pas uniforme dans l'ame. Il est bien plus conforme à la Philosophie de supposer l'ame ou toujours libre ou toujours esclave. Et moi, je dis que l'expérience est la seule vraie Physique. Or que nous dit-elle cette expérience ? Elle nous dit que nous sommes quelquefois emportés malgré nous ; d'où je conclus, donc nous sommes quelquefois maîtres de nous ; la maladie prouve la santé, & la liberté est la santé de l'ame. Voyez dans le deuxieme discours sur la liberté ce raisonnement paré & embelli par M. de Voltaire de toutes les graces de la Poésie.
La liberté, dis-tu, t'est quelquefois ravie :
Dieu te la devoit-il immuable, infinie,
Egale en tout état, en tout tems, en tout lieu ?
Tes destins sont d'un homme, & tes voeux sont d'un Dieu.
Quoi ! dans cet océan, cet atome qui nage
Dira : L'immensité doit être mon partage.
Non, tout est foible en toi, changeant, & limité ;
Ta force, ton esprit, tes membres, ta beauté.
La nature, en tout sens, a des bornes prescrites ;
Et le pouvoir humain seroit seul sans limites ?
Mais, dis-moi : quand ton coeur formé de passions
Se rend, malgré lui-même, à leurs impressions,
Qu'il sent dans ses combats sa liberté vaincue,
Tu l'avois donc en toi, puisque tu l'as perdue.
Une fiévre brûlante attaquant tes ressorts,
Vient à pas inégaux miner ton foible corps.
Mais quoi ! par ce danger répandu sur ta vie,
Ta santé pour jamais n'est point anéantie,
On te voit revenir des portes de la mort,
Plus ferme, plus content, plus tempérant, plus fort.
Connois mieux l'heureux don, que ton chagrin reclame,
La liberté, dans l'homme, est la santé de l'ame.
On la perd quelquefois. La soif de la grandeur,
La colere, l'orgueil, un amour suborneur,
D'un desir curieux les trompeuses saillies ;
Hélas ! combien le coeur a-t-il de maladies !
Si un poids de cinq livres, dites-vous, pouvoit n'être pas emporté par un poids de six, il ne le seroit pas non plus par un poids de mille. Ainsi, si l'ame résiste à une disposition matérielle du cerveau qui la porte à un choix vicieux, & qui, quoique pourtant modérée, est plus forte que la disposition matérielle à la vertu ; il faut que l'ame résiste à cette même disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de l'autre. Je réponds qu'il ne s'ensuit nullement que l'ame puisse résister à une disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de la disposition matérielle à la vertu, précisément parce qu'elle aura résisté à cette même disposition matérielle du vice, quand elle étoit un peu plus forte que l'autre. Quand de deux dispositions contraires, qui sont dans le cerveau, l'une est infiniment plus forte que l'autre, il peut se faire que dans cet état, le mouvement naturel des esprits soit trop violent, & que par conséquent la force de l'ame n'ait nulle proportion avec celle de ces esprits qui l'emportent nécessairement. Quoique le principe par lequel je me détermine soit indépendant des dispositions du cerveau, puisqu'il réside dans mon ame, on peut dire néanmoins qu'il les suppose comme une condition, sans laquelle il deviendroit inutile. Le pouvoir de se déterminer n'est pas plus dépendant des dispositions du cerveau, que le pouvoir de peindre, de graver & d'écrire ; l'art du pinceau, du burin & de la plume ; & de même qu'on ne peut bien écrire, bien graver & bien peindre, si l'on n'a une bonne plume, un bon burin & un pinceau ; ainsi, l'on ne peut agir avec liberté, à moins que le cerveau ne soit bien constitué. Mais aussi de même que le pouvoir d'écrire, de graver & de peindre est absolument indépendant de la plume, du burin & du pinceau ; le pouvoir de se déterminer ne l'est pas moins des dispositions du cerveau.
On convient, dira-t-on, que l'ame dépend absolument des dispositions du cerveau sur ce qui regarde le plus ou le moins d'esprit : cependant, si sur la vertu & sur le vice, les dispositions du cerveau ne déterminent l'ame, que lorsqu'elles sont extrêmes, & qu'elles lui laissent la liberté lorsqu'elles sont modérées : ensorte qu'on peut avoir beaucoup de vertu, malgré une disposition médiocre au vice, il devroit être aussi qu'on peut avoir beaucoup d'esprit malgré une disposition médiocre à la stupidité. J'avoue que je ne sens pas assez le fin de ce raisonnement. Je ne saurois concevoir, pourquoi, pouvant avoir beaucoup de vertu malgré une disposition médiocre au vice, je pourrois aussi avoir beaucoup d'esprit malgré une disposition médiocre à la stupidité. Le plus ou le moins d'esprit dépend du plus ou du moins de délicatesse des organes : il consiste dans une certaine conformation du cerveau, dans une heureuse disposition des fibres. Toutes ces choses n'étant nullement soumises au choix de ma volonté, il ne dépend pas de moi de me mettre en état d'avoir, si je veux, beaucoup de discernement & de pénétration. Mais la vertu & le vice dépendent de ma volonté ; je ne nierai pourtant pas que le tempérament n'y contribue beaucoup, & ordinairement on se fie plus à une vertu qui est naturelle & qui a sa source dans le sang, qu'à celle qui est un pur effet de la raison, & qu'on a acquise à force de soins.
Je suppose, continue-t-on, qu'on se réveille, lorsqu'on étoit résolu à tuer son ami, & que dès qu'on est réveillé, on ne veut plus le tuer. La disposition matérielle du cerveau qui me portoit en songe à vouloir tuer mon ami, étoit plus forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arrive à mon cerveau fortifie également toutes les deux, ou elles demeurent dans la même disposition où elles étoient, l'une restant p. ex. trois fois plus forte que l'autre. Vous ne sauriez concevoir pourquoi l'ame est libre, quand l'une de ces dispositions a dix degrés de force, & l'autre trente ; & pourquoi elle n'est pas libre quand l'une de ces dispositions n'a qu'un degré de force, & l'autre que trois. Cette objection n'a de force, que parce qu'on ne démêle pas assez exactement les différences qui se trouvent entre l'état de veille & celui du sommeil. Si je ne suis pas libre dans le sommeil, ce n'est pas, comme le suppose l'objection, parce que la disposition matérielle du cerveau, qui me porte à tuer mon ami, est trois fois plus forte que l'autre. Le défaut de liberté vient du défaut d'esprit & du relâchement des nerfs. Mais que le cerveau soit une fois rempli d'esprits, & que les nerfs soient tendus, je serai toujours également libre, soit que l'une de ces dispositions ait dix degrés de force, & l'autre trente ; soit que l'une de ces dispositions n'ait qu'un degré de force, & l'autre que trois. Si vous en voulez savoir la raison, c'est que le pouvoir qui est dans l'ame de se déterminer est absolument indépendant des dispositions du cerveau, pourvû que le cerveau soit bien constitué, qu'il soit rempli d'esprits & que les nerfs soient tendus.
L'action des esprits dépend de trois choses, de la nature du cerveau sur lequel ils agissent, de leur nature particuliere & de la quantité, ou de la détermination de leur mouvement. De ces trois choses, il n'y a précisément que la derniere dont l'ame puisse être maîtresse. Il faut donc que le pouvoir seul de mouvoir les esprits suffise pour la liberté. Or, 1°. dites-vous, si le pouvoir de diriger le mouvement des esprits suffit pour la liberté, les enfans doivent être libres, puisque leur ame doit avoir ce pouvoir. 2°. Pourquoi l'ame des fous ne seroit-elle pas libre aussi ? Elle peut encore diriger le mouvement de ses esprits. 3°. L'ame ne devroit jamais avoir plus de facilité à diriger le mouvement de ses esprits que pendant le sommeil, & par conséquent elle ne devroit jamais être plus libre. Je réponds, que le pouvoir de diriger le mouvement de ses esprits ne se trouve ni dans les enfans, ni dans les fous, ni dans ceux qui dorment. La nature du cerveau des enfans s'y oppose. La substance en est trop tendre & trop molle ; les fibres en sont trop délicates, pour que leur ame puisse fixer & arrêter à son gré les esprits qui doivent couler de toutes parts, parce qu'ils trouvent par-tout un passage libre & aisé. Dans les fous, le mouvement naturel de leurs esprits est trop violent, pour que leur ame en soit la maîtresse. Dans cet état, la force de l'ame n'a nulle proportion avec celle des esprits qui l'emportent nécessairement. Enfin, le sommeil ayant détendu la machine du corps, & en ayant amorti tous les mouvemens, les esprits ne peuvent couler librement. Vouloir que l'ame dans cet assoupissement, où tous les sens sont enchaînés, & où tous les ressorts sont relâchés, dirige à son gré le mouvement des esprits ; c'est exiger qu'un joueur de lyre fasse resonner sous son archet une lyre dont les cordes sont détendues.
Un des argumens les plus terribles qu'on ait jamais opposé contre la liberté, est l'impossibilité d'accorder avec elle la prescience de Dieu. Il y a eu des philosophes assez déterminés pour dire que Dieu peut très-bien ignorer l'avenir, à-peu-près, s'il est permis de parler ainsi, comme un roi peut ignorer ce que fait un général à qui il aura donné la carte blanche ; c'est le sentiment des Sociniens.
D'autres soutiennent, que l'argument pris de la certitude de la prescience divine ne touche nullement à la question de la liberté ; parce que la prescience, disent-ils, ne renferme point d'autre certitude, que celle qui se rencontreroit également dans les choses, encore qu'il n'y eût point de prescience. Tout ce qui existe aujourd'hui existe certainement, & il étoit hier & de toute éternité aussi certainement vrai qu'il existeroit aujourd'hui, qu'il est maintenant certain qu'il existe. Cette certitude d'évenement est toujours la même, & la prescience n'y change rien. Elle est par rapport aux choses futures, ce que la connoissance est aux choses présentes, & la mémoire aux choses passées : or, l'une & l'autre de ces connoissances ne suppose aucune nécessité d'exister dans la chose ; mais seulement une certitude d'évenement qui ne laisseroit pas d'être, quand bien même ces connoissances ne seroient pas. Jusqu'ici, tout est intelligible. La difficulté est & sera toujours à expliquer, comment Dieu peut prévoir les choses futures, ce qui ne paroît pas possible, à moins de supposer une chaîne de causes nécessaires ; nous pouvons cependant nous en faire quelque espèce d'idée générale. Un homme d'esprit prévoit le parti que prendra dans telle occasion un homme, dont il connoît le caractere. A plus forte raison Dieu, dont la nature est infiniment plus parfaite, peut-il par la prévision avoir une connoissance beaucoup plus certaine des évenemens libres. J'avoue que tout cela me paroît très hazardé, & que c'est un aveu plutôt qu'une solution de la difficulté. J'avoue, enfin, qu'on fait contre la liberté, d'excellentes objections ; mais on en fait d'aussi bonnes contre l'éxistence de Dieu ; & comme malgré les difficultés extrêmes, contre la création & contre la providence, je crois néanmoins la providence & la création ; aussi je me crois libre, malgré les puissantes objections que l'on fera toujours contre cette malheureuse liberté. Eh ! comment ne la croirois-je pas ? Elle porte tous les caracteres d'une premiere vérité. Jamais opinion n'a été si universelle dans le genre humain. C'est une vérité pour l'éclaircissement de laquelle il n'est pas nécessaire d'approfondir les raisonnemens des livres : c'est ce que la nature crie ; c'est ce que les bergers chantent sur les montagnes, les poëtes sur les théâtres ; c'est ce que les plus habiles docteurs enseignent dans les chaires ; c'est ce qui se répete & se suppose dans toutes les conjonctures de la vie. Le petit nombre de ceux qui, par affectation de singularité, ou par des réflexions outrées, ont voulu dire ou imaginer le contraire, ne montrent-ils pas eux-mêmes par leur conduite, la fausseté de leurs discours ? Donnez-moi, dit l'illustre Fénelon, un homme qui fait le profond philosophe, & qui nie le libre arbitre : je ne disputerai point contre lui : mais je le mettrai à l'épreuve dans les plus communes occasions de la vie, pour le confondre par lui-même. Je suppose que la femme de cet homme lui soit infidele, que son fils lui désobéit & le méprise, que son ami le trahit, que son domestique le vole ; je lui dirai, quand il se plaindra d'eux, ne savez-vous pas qu'aucun d'eux n'a tort, & qu'ils ne sont pas libres de faire autrement ? Ils sont, de votre aveu, aussi invinciblement nécessités à vouloir ce qu'ils veulent, qu'une pierre l'est à tomber, quand on ne la soutient pas. N'est-il donc pas certain que ce bizarre philosophe qui ose nier le libre arbitre dans l'école, le supposera comme indubitable dans sa propre maison, & qu'il ne sera pas moins implacable contre ces personnes, que s'il avoit soutenu toute sa vie le dogme de la plus grande liberté ?
Vois de la liberté cet ennemi mutin,
Aveugle partisan d'un aveugle destin.
Entends comme il consulte, approuve ou délibere,
Entends de quel reproche il couvre un adversaire.
Vois comment d'un rival il cherche à se vanger ;
Comme il punit son fils & le veut corriger.
Il le croyoit donc libre ? Oui, sans doute ; & lui-même
Dément à chaque pas son funeste système.
Il mentoit à son coeur, en voulant expliquer
Le dogme absurde à croire, absurde à pratiquer.
Il reconnoît en lui le sentiment qu'il brave ;
Il agit, comme libre, & parle comme esclave.
M. Voltaire, 2. disc. sur la liberté.
M. Bayle s'est appliqué sur-tout à ruiner l'argument pris du sentiment vif que nous avons de notre liberté. Voici ses raisons : " Disons aussi que le sentiment clair & net que nous avons des actes de notre volonté, ne peut pas faire discerner si nous nous les donnons nous-mêmes, ou si nous les recevons de la même cause qui nous donne l'existence : il faut recourir à la réflexion pour faire ce discernement. Or je mets en fait que par des méditations purement philosophiques on ne peut jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous sommes la cause efficiente de nos volitions ; car toute personne qui examinera bien les choses, connoîtra évidemment que si nous n'étions qu'un sujet purement passif à l'égard de la volonté, nous aurions les mêmes sentimens d'expérience que nous avons lorsque nous croyons être libres. Supposez par plaisir que Dieu ait reglé de telle sorte les lois de l'union de l'ame & du corps, que toutes les modalités de l'ame soient liées nécessairement entr'elles avec l'interposition des modalités du cerveau, vous comprendrez qu'il ne vous arrivera que ce que nous éprouvons ; il y aura dans notre ame la même suite de pensées depuis la perception des objets des sens, qui est la premiere démarche, jusqu'aux volitions les plus fixes, qui sont la derniere démarche. Il y aura dans cette suite le sentiment des idées, celui des affirmations, celui des irrésolutions, celui des velléités, & celui des volitions : car soit que l'acte de vouloir nous soit imprimé par une cause extérieure, soit que nous le produisions nous-mêmes, il sera également vrai que nous voulons, & que nous sentons ce que nous voulons ; & comme cette cause extérieure peut mêler autant de plaisir qu'elle veut dans la volition qu'elle imprime, nous pourrions sentir quelquefois que les actes de notre volonté nous plaisent infiniment.... Ne comprenez-vous pas clairement qu'une girouette à qui l'on imprimeroit toujours tout-à-la-fois le mouvement vers un certain point de l'horison, & l'envie de se tourner de ce côté-là, seroit persuadée qu'elle se mouvroit d'elle-même pour exécuter les desirs qu'elle formeroit ? Je suppose qu'elle ne sauroit point qu'il y eût des vents, ni qu'une cause extérieure fît changer tout-à-la-fois & sa situation & ses desirs. Nous voilà naturellement dans cet état, &c ".
Tous ces raisonnemens de M. Bayle sont fort beaux, mais c'est dommage qu'ils ne soient pas persuasifs : ils confondent les nôtres ; & cependant je ne sais comment ils ne font aucune impression sur nous. Hé bien, pourrois-je dire à M. Bayle, vous dites que je ne suis pas libre : votre propre sentiment ne peut vous arracher cet aveu. Selon vous il n'est pas bien décidé qu'il soit au pur choix & au gré de ma volonté de remuer ma main ou de ne pas la remuer : s'il en est ainsi, il est donc déterminé nécessairement que d'ici à un quart-d'heure je leverai trois fois la main de suite, ou que je ne la leverai pas ainsi trois fois. Je ne puis donc rien changer à cette détermination nécessaire ? Cela supposé, en cas que je gage pour un parti plutôt que pour l'autre, je ne puis gagner que d'un côté. Si c'est sérieusement que vous prétendez que je ne suis pas libre, vous ne pourrez jamais sensément refuser une offre que je vais vous faire : c'est que je gage mille pistoles contre vous une, que je ferai, au sujet du mouvement de ma main, tout le contraire de ce que vous gagerez ; & je vous laisserai prendre à votre gré l'un ou l'autre parti. Est-il offre plus avantageuse ? Pourquoi donc n'accepterez-vous jamais la gageure sans passer pour fou & sans l'être en effet ? Que si vous ne la jugez pas avantageuse, d'où peut venir ce jugement, sinon de celui que vous formez nécessairement & invinciblement que je suis libre ; ensorte qu'il ne tiendroit qu'à moi de vous faire perdre à ce jeu non-seulement mille pistoles la premiere fois que nous les gagerions, mais encore autant de fois que nous recommencerions la gageure.
Aux preuves de raison & de sentiment, nous pouvons joindre celles que nous fournissent la morale & la religion. Otez la liberté, toute la nature humaine est renversée, & il n'y a plus aucune trace d'ordre dans la société. Si les hommes ne sont pas libres dans ce qu'ils font de bien & de mal, le bien n'est plus bien, & le mal n'est plus mal. Si une nécessité inévitable & invincible nous fait vouloir tout ce que nous voulons, notre volonté n'est pas plus responsable de son vouloir qu'un ressort de machine est responsable du mouvement qui lui est imprimé : en ce cas il est ridicule de s'en prendre à la volonté, qui ne veut qu'autant qu'une autre cause distinguée d'elle la fait vouloir. Il faut remonter tout droit à cette cause comme je remonte à la main qui remue le bâton, sans m'arrêter au bâton qui ne me frappe qu'autant que cette main le pousse. Encore une fois, ôtez la liberté, vous ne laissez sur la terre ni vice, ni vertu, ni mérite ; les récompenses sont ridicules & les châtimens sont injustes : chacun ne fait que ce qu'il doit, puisqu'il agit selon la nécessité ; il ne doit ni éviter ce qui est inévitable, ni vaincre ce qui est invincible. Tout est dans l'ordre, car l'ordre est que tout cede à la nécessité. La ruine de la liberté renverse avec elle tout ordre & toute police, confond le vice & la vertu, autorise toute infamie monstrueuse, éteint toute pudeur & tout remords, dégrade & défigure sans ressource tout le genre humain. Une doctrine si énorme ne doit point être examinée dans l'école, mais punie pas les magistrats.
Ah, sans la liberté, que seroient donc nos ames !
Mobiles agités par d'invincibles flammes,
Nos voeux, nos actions, nos plaisirs, nos dégoûts,
De notre être, en un mot, rien ne seroit à nous.
D'un artisan suprème impuissantes machines,
Automates pensans, mûs par des mains divines,
Nous serions à jamais de mensonge occupés,
Vils instrumens d'un Dieu qui nous auroit trompés.
Comment, sans liberté, serions-nous ses images ?
Que lui reviendroit il de ses brutes ouvrages ?
On ne peut donc lui plaire, on ne peut l'offenser ;
Il n'a rien à punir, rien à récompenser.
Dans les cieux, sur la terre, il n'est plus de justice :
Caton fut sans vertus, Catilina sans vice.
Le destin nous entraîne à nos affreux penchans,
Et ce cahos du monde est fait pour les méchans.
L'oppresseur insolent, l'usurpateur avare,
Cartouche, Mirwéis, ou tel autre barbare ;
Plus coupable enfin qu'eux le calomniateur
Dira, je n'ai rien fait, Dieu seul en est l'auteur ;
Ce n'est pas moi, c'est lui qui manque à ma parole,
Qui frappe par mes mains, pille, brûle, viole.
C'est ainsi que le Dieu de justice & de paix
Seroit l'auteur du trouble, & le dieu des forfaits.
Les tristes partisans de ce dogme effroyable,
Diroient-ils rien de plus s'ils adoroient le diable ?
Le second système sur la liberté est celui dans lequel on soutient que l'ame ne se détermine jamais sans cause & sans une raison prise d'ailleurs que du fond de la volonté : c'est-là sur-tout le système favori de M. Léibnitz. Selon lui la cause des déterminations n'est point physique, elle est morale, & agit sur l'intelligence même, de maniere qu'un homme ne peut jamais être poussé à agir librement, que par des moyens propres à le persuader. Voilà pourquoi il faut des lois, & que les peines & les récompenses sont nécessaires. L'espérance & la crainte agissent immédiatement sur l'intelligence : cette liberté est opposée à la nécessité physique ou fatale, mais elle ne l'est point à la nécessité morale, laquelle, pourvu qu'elle soit seule, ne s'étend qu'à des choses contingentes, & ne porte pas la moindre atteinte à la liberté. De ce genre est celle qui fait qu'un homme qui a l'usage de sa raison, si on lui offre le choix entre de bons alimens & du poison, se détermine pour les premiers. La liberté dans ce cas est entiere, & cependant le contraire est impossible. Qui peut nier que le sage, lorsqu'il agit librement, ne suive nécessairement le parti que la sagesse lui prescrit ?
La nécessité hypothétique n'est pas moins compatible avec la liberté : tous ceux qui l'ont regardée comme destructive de la liberté ont confondu le certain & le nécessaire. La certitude marque simplement qu'un évenement aura lieu, plutôt que son contraire, parce que les causes dont il dépend se trouvent disposées à produire leur effet ; mais la nécessité emporte la cause même par l'impossibilité absolue du contraire. Or la détermination des futurs contingens, fondement de la nécessité hypothétique, vient simplement de la nature de la vérité : elle ne touche point aux causes ; & ne détruisant point la contingence, elle ne sauroit être contraire à la liberté. Ecoutons M. Léibnitz. " La nécessité hypothétique est celle que la supposition ou hypothèse de la prévision & préordination de Dieu impose aux futurs contingens ; mais ni cette prescience ni cette préordination ne dérogent point à la liberté : car Dieu, porté par la suprème raison à choisir entre plusieurs suites de choses ou mondes possibles celui où les créatures libres prendroient telles ou telles résolutions, quoique non sans concours, a rendu par-là tout également certain & déterminé une fois pour toutes, sans déroger par-là à la liberté de ces créatures ; ce simple decret du choix ne changeant point, mais actualisant seulement leurs natures libres qu'il voyoit dans ses idées ".
Le troisieme système sur la liberté est celui de ceux qui prétendent que l'homme a une liberté qu'ils appellent d'indifférence, c'est-à-dire que dans les déterminations libres de la volonté, l'ame ne choisit point en conséquence des motifs, mais qu'elle n'est pas plus portée pour le oui que pour le non, & qu'elle choisit uniquement par un effet de son activité, sans qu'il y ait aucune raison de son choix, sinon qu'elle l'a voulu.
Ce qu'il y a de certain, c'est, 1°. qu'il n'y a point en Dieu de liberté d'équilibre ou d'indifférence. Un être tel que Dieu, qui se représente avec le plus grand degré de précision les différences infiniment petites des choses, voit sans doute le bon, le mauvais, le meilleur, & ne sauroit vouloir que conformément à ce qu'il voit ; car autrement il agiroit sans raison ou contre la raison, deux suppositions également injurieuses. Dieu suit donc toujours les idées que son entendement infini lui présente comme préférables aux autres ; il choisit entre plusieurs plans possibles le meilleur ; il ne veut & ne fait rien que par des raisons suffisantes fondées sur la nature des êtres & sur ses divins attributs.
2°. Les bienheureux dans le ciel n'ont pas non plus cette liberté d'équilibre : aucun bien ne peut balancer Dieu dans leur coeur. Il ravit d'abord tout l'amour de la volonté, & fait disparoître tout autre bien comme le grand jour fait disparoître les ombres de la nuit.
La question est donc de savoir si l'homme est libre de cette liberté d'indifférence ou d'équilibre. Voici les raisons de ceux qui soutiennent la négative.
1°. La chose paroît impossible. Il est question de choisir entre A & B ; vous dites que, toutes choses mises à part, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous choisissez A, pourquoi ? parce que je le veux, dites-vous ; mais pourquoi voulez-vous A plutôt que B ? vous répliquez, parce que je le veux : Dieu m'a donné cette faculté. Mais que signifie je veux vouloir, ou je veux parce que je veux ? Ces paroles n'ont d'autre sens que celui, je veux A ; mais vous n'avez pas encore satisfait à ma question : pourquoi ne voulez-vous point B ? est-ce sans raison que vous le rejettez ? Si vous dites A me plaît parce qu'il me plaît, ou cela ne signifie rien, ou doit être entendu ainsi, A me plaît à cause de quelque raison qui me le fait paroître préférable à B : sans cela le néant produiroit un effet, conséquence que sont obligés de digérer les défenseurs de la liberté d'équilibre.
2°. Cette liberté est opposée au principe de la raison suffisante : car si nous choisissons entre deux ou plusieurs objets, sans qu'il y ait une raison qui nous porte vers l'un plutôt que vers l'autre, voilà une détermination qui arrive sans aucune cause. Les défenseurs de l'indifférence répondent que cette détermination n'arrive pas sans cause, puisque l'ame elle-même, entant que principe actif, est la cause efficiente de toutes ses actions. Cela est vrai, mais la détermination de cette action, la préférence qui lui est donnée sur le parti opposé, d'où lui vient-elle ? " Vouloir, dit M. Léibnitz, qu'une détermination vienne d'une pleine indifférence absolument indéterminée, c'est vouloir qu'elle vienne naturellement de rien. L'on suppose que Dieu ne donne pas cette détermination : elle n'a point de source dans l'ame, ni dans le corps, ni dans les circonstances, puisque tout est supposé indéterminé ; & la voilà pourtant qui paroît & qui existe sans préparation, sans que Dieu même puisse voir ou faire voir comment elle existe ". Un effet ne peut avoir lieu sans qu'il y ait dans la cause qui le doit produire une disposition à agir de la maniere qu'il le faut pour produire cet effet. Or un choix, un acte de la volonté est un effet dont l'ame est la cause. Il faut donc, pour que nous fassions un tel choix, que l'ame soit disposée à le faire plutôt qu'un autre : d'où il résulte qu'elle n'est pas indéterminée & indifférente.
3°. La doctrine de la parfaite indifférence détruit toute idée de sagesse & de vertu. Si je choisis un parti, non parce que je le trouve conforme aux lois de la sagesse, mais sans aucune raison vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, & uniquement par une impétuosité aveugle qui se détermine au hasard, quelle louange pourrai-je mériter s'il arrive que j'aie bien choisi, puisque je n'ai point pris ce parti parce qu'il étoit le meilleur, & que j'aurois pû faire le contraire avec la même facilité ? Comment supposer en moi de la sagesse, si je ne me détermine pas par des raisons ? La conduite d'un être doué d'une pareille liberté, seroit parfaitement semblable à celle d'un homme qui décideroit toutes ses actions par un coup de dez ou en tirant à la courte paille : ce seroit en vain que l'on feroit des recherches sur les motifs par lesquels les hommes agissent : ce seroit en vain qu'on leur proposeroit des lois, des peines & des récompenses, si tout cela n'opere pas sur leur volonté indifférente à tout.
4°. La liberté d'indifférence est incompatible avec la nature d'un être intelligent qui, dès-là qu'il se sent & se connoît, aime essentiellement son bonheur, & par conséquent aime aussi tout ce qu'il croit pouvoir y contribuer. Il est ridicule de dire que ces objets sont indifférens à un tel être, & que, lorsqu'il connoît clairement que de deux partis l'un lui est avantageux & l'autre lui est nuisible, il puisse choisir aussi aisément l'un que l'autre. Déjà il ne peut pas approuver l'un comme l'autre ; or donner son approbation en dernier ressort, c'est la même chose que se déterminer : voilà donc la détermination qui vient des raisons ou des motifs. De plus, on conçoit dans la volonté l'effort d'agir qui en fait même l'essence, & qui la distingue du simple jugement. Or un esprit n'étant point susceptible d'une impulsion méchanique, qui est-ce qui pourroit l'inciter à agir, si ce n'est l'amour qu'il a pour lui-même & pour son propre bonheur ? C'est-là le grand mobile de tous les esprits ; jamais ils n'agissent que quand ils desirent d'agir : or qu'est-ce qui rend ce desir efficace, sinon le plaisir qu'on trouve à le satisfaire ? Et d'où peut naître ce desir, si ce n'est de la réprésentation de la perception de l'objet ? Un être intelligent ne peut donc être porté à agir que par quelque motif, quelque raison prise d'un bien réel ou apparent qu'il se promet de son action.
Tous ces raisonnemens, quelque spécieux qu'ils paroissent, n'ont rien d'assez solide à quoi ne répondent les défenseurs de la liberté d'indifférence. M. King, archevêque de Dublin, l'a soutenue en Dieu même, dans son livre sur l'origine du mal ; mais en disant que rien n'est bon ni mauvais en Dieu par rapport aux créatures avant son choix, il enseigne une doctrine qui va à rendre la justice arbitraire, & à confondre la nature du juste & de l'injuste. M. de Crouzas plaide en sa faveur dans la plûpart de ses ouvrages. Mais il y a des philosophes qui s'y sont pris autrement pour soutenir l'indifférence : d'abord ils avouent qu'une pareille liberté ne sauroit convenir à Dieu ; mais, continuent-ils, il faut raisonner tout autrement à l'égard des intelligences bornées & subalternes. Renfermées dans une certaine sphere d'activité plus ou moins grande, leurs idées n'atteignent que jusqu'à un certain degré dans la connoissance des objets ; & en conséquence il doit leur arriver de prendre pour égales des choses qui ne le sont point du tout. Les apparences font ici le même effet que la réalité ; & l'on ne disconviendra pas, que lorsqu'il s'agit de juger, de se déterminer, d'agir, il importe peu que les choses soient égales ou inégales, pourvu que les impressions qu'elles font sur nous soient les mêmes. On prévoit bien que les antagonistes de l'indifférence se hâteront de nier que des impressions égales puissent résulter d'objets inégaux. Mais cette supposition n'a pourtant rien qui ne suive nécessairement de la limitation qui fait le caractere essentiel de la créature. Dès-là que notre intelligence est bornée, ce qui différencie les objets doit nous échapper infailliblement, lorsqu'il est de nature à ne pouvoir être apperçu que par une vue extrêmement fixe & délicate. Et de-là, que suit-il ? sinon, que dans plusieurs occasions l'ame doit se trouver dans un état de doute & de suspension, sans savoir précisément à quel parti se déterminer. C'est aussi ce que justifie une expérience fréquente.
Ces principes posés, il en résulte que la liberté d'équilibre est moins une prérogative dont nous devions nous glorifier, qu'une imperfection dans notre nature & nos connoissances, qui croît ou décroît en raison réciproque de nos lumieres. Dieu prévoyant que notre ame, par une suite de son imperfection, seroit souvent irrésolue & comme suspendue entre deux partis, lui a donné le pouvoir de sortir de cette suspension, par une détermination dont le principe fût elle-même. Ce n'est point supposer que le rien produise quelque chose. Est-ce en effet alléguer un rien, quand on donne la volonté pour cause de nos actions en certains cas ? Que deviendroit cette activité qui est le propre des intelligences, si l'ame dans l'occasion ne pouvoit agir par elle-même, & sans être mise en action par une puissance étrangere ?
Il y a d'ailleurs mille cas dans la vie où le parfait équilibre a lieu ; par exemple, quand il s'agit de choisir entre deux louis-d'or qu'on me présente. Si l'on s'avise de me soutenir sérieusement que je suis nécessité, & qu'il y a une raison en faveur de celui que j'ai pris ; pour réponse je me mets à rire, tant je suis intimement persuadé qu'il est en mon pouvoir de prendre un des deux louis-d'or, plutôt que l'autre, & qu'il n'y a point pour ce choix de raison prévalente, puisque ces deux louis-d'or sont entierement semblables, ou qu'ils me paroissent tels.
De tout ce que nous avons dit sur la liberté, on en peut conclure que son essence consiste dans l'intelligence qui enveloppe une connoissance distincte de l'objet de la délibération. Dans la spontanéïté avec laquelle nous nous déterminons, & dans la contingence, c'est-à-dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique, l'intelligence est comme l'ame de la liberté, & le reste en est comme le corps & la base. La substance libre se détermine par elle-même, & cela suivant le motif du bien apperçu par l'entendement qui l'incline sans la nécessiter. Si à ces trois conditions, vous ajoutez l'indifférence d'équilibre, vous aurez une définition de la liberté, telle qu'elle se trouve dans les hommes pendant cette vie mortelle, & telle qu'elle a été définie nécessaire par l'Eglise pour mériter & démériter dans l'état de la nature corrompue. Cette liberté n'exclut pas seulement la contrainte (jamais elle ne fut admise par les fatalistes mêmes) ni la nécessité physique, absolue, fatale (ni les calvinistes, ni les jansénistes ne l'ont jamais reconnue) mais encore la nécessité morale, soit qu'elle soit absolue, soit qu'elle soit relative. La liberté catholique est dégagée de toute nécessité, suivant cette définition : ad merendum & demerendum in statu naturae lapsae, non requiritur in homine libertas à necessitate, sed sufficit libertas à coactione. Cette proposition ayant été condamnée comme hérétique, & cela dans le sens de Jansenius ; on ne souscrit à la décision de l'Eglise qu'autant qu'on reconnoît une liberté exempte de cette nécessité à laquelle Jansenius l'asservissoit. Or cette nécessité n'est que morale ; donc pour être catholique, il faut admettre une liberté libre de la nécessité morale, & par conséquent une liberté d'indifférence ou d'équilibre. Ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens, que la volonté ne panche jamais plus d'un côté que de l'autre, cet équilibre est ridicule & démenti par l'expérience ; mais plutôt en ce sens que la volonté domine ses penchans. Elle ne les domine pourrant pas tellement que nous soyons toûjours les maîtres de nos volitions directement. Le pouvoir de l'ame sur ses inclinations est souvent une puissance qui ne peut être exercée que d'une maniere indirecte ; à-peu-près comme Bellarmin vouloit que les papes eussent droit sur le temporel des rois. A la vérité, les actions externes qui ne surpassent point nos forces, dépendent absolument de notre volonté ; mais nos volitions ne dépendent de la volonté que par certains détours adroits, qui nous donnent moyen de suspendre nos résolutions ou de les changer. Nous sommes les maîtres chez nous, non pas comme Dieu l'est dans le monde, mais comme un prince sage l'est dans ses états, ou comme un bon pere de famille l'est dans son domestique.
LIBERTE NATURELLE, (Droit naturel) droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leurs personnes & de leurs biens, de la maniere qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de la loi naturelle, & qu'ils n'en abusent pas au préjudice des autres hommes. Les lois naturelles sont donc la regle & la mesure de cette liberté ; car quoique les hommes dans l'état primitif de nature, soient dans l'indépendance les uns à l'égard des autres, ils sont tous sous la dépendance des lois naturelles, d'après lesquelles ils doivent diriger leurs actions.
Le premier état que l'homme acquiert par la nature, & qu'on estime le plus précieux de tous les biens qu'il puisse posséder, est l'état de liberté ; il ne peut ni se changer contre un autre, ni se vendre, ni se perdre ; car naturellement tous les hommes naissent libres, c'est-à-dire, qu'ils ne sont pas soumis à la puissance d'un maître, & que personne n'a sur eux un droit de propriété.
Et vertu de cet état, tous les hommes tiennent de la nature même, le pouvoir de faire ce que bon leur semble, & de disposer à leur gré de leurs actions & de leurs biens, pourvu qu'ils n'agissent pas contre les lois du gouvernement auquel ils se sont soumis.
Chez les Romains un homme perdoit sa liberté naturelle, lorsqu'il étoit pris par l'ennemi dans une guerre ouverte, ou que pour le punir de quelque crime, on le réduisoit à la condition d'esclave. Mais les Chrétiens ont aboli la servitude en paix & en guerre, jusques-là, que les prisonniers qu'ils font à la guerre sur les infideles, sont censés des hommes libres ; de maniere que celui qui tueroit un de ces prisonniers, seroit regardé & puni comme homicide.
De plus, toutes les puissances chrétiennes ont jugé qu'une servitude qui donneroit au maître un droit de vie & de mort sur ses esclaves, étoit incompatible avec la perfection à laquelle la religion chrétienne appelle les hommes. Mais comment les puissances chrétiennes n'ont-elles pas jugé que cette même religion, indépendamment du droit naturel, reclamoit contre l'esclavage des negres ? c'est qu'elles en ont besoin pour leurs colonies, leurs plantations, & leurs mines. Auri sacra fames !
LIBERTE CIVILE, (Droit des nations) c'est la liberté naturelle dépouillée de cette partie qui faisoit l'indépendance des particuliers & la communauté des biens, pour vivre sous des lois qui leur procurent la sûreté & la propriété. Cette liberté civile consiste en même tems à ne pouvoir être forcé de faire une chose que la loi n'ordonne pas, & l'on ne se trouve dans cet état, que parce qu'on est gouverné par des lois civiles ; ainsi plus ces lois sont bonnes, plus la liberté est heureuse.
Il n'y a point de mots, comme le dit M. de Montesquieu, qui ait frappé les esprits de tant de manieres différentes, que celui de liberté. Les uns l'ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient donné un pouvoir tyrannique ; les autres pour la facilité d'élire celui à qui ils devoient obéir ; tels ont pris ce mot pour le droit d'être armé, & de pouvoir exercer la violence ; & tels autres pour le privilege de n'être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois. Plusieurs ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, & en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du gouvernement républicain, l'ont mise dans ce gouvernement, tandis que ceux qui avoient joui du gouvernement monarchique, l'ont placée dans la monarchie. Enfin, chacun a appellé liberté, le gouvernement qui étoit conforme à ses coutumes & à ses inclinations : mais la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; & si un citoyen pouvoit faire ce qu'elles défendent, il n'auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tous de même ce pouvoir. Il est vrai que cette liberté ne se trouve que dans les gouvernemens modérés, c'est-à-dire dans les gouvernemens dont la constitution est telle, que personne n'est contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, & à ne point faire celles que la loi lui permet.
La liberté civile est donc fondée sur les meilleures lois possibles ; & dans un état qui les auroit en partage, un homme à qui on feroit son procès selon les lois, & qui devroit être pendu le lendemain, seroit plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. Par conséquent, il n'y a point de liberté dans les états où la puissance législative & la puissance exécutrice sont dans la même main. Il n'y en a point à plus forte raison dans ceux où la puissance de juger est réunie à la législatrice & à l'exécutrice.
LIBERTE POLITIQUE, (Droit politique) la liberté politique d'un état est formée par des lois fondamentales qui y établissent la distribution de la puissance législative, de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & de la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, de maniere que ces trois pouvoirs sont liés les uns par les autres.
La liberté politique du citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui procede de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; & pour qu'on ait cette sûreté il faut que le gouvernement soit tel, qu'un citoyen ne puisse pas craindre un citoyen. De bonnes lois civiles & politiques assurent cette liberté ; elle triomphe encore, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime.
Il y a dans le monde une nation qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique ; & si les principes sur lesquels elle la fonde sont solides, il faut en reconnoître les avantages. C'est à ce sujet, que je me souviens d'avoir oui dire à un beau génie d'Angleterre, que Corneille avoit mieux peint la hauteur des sentimens qu'inspire la liberté politique, qu'aucun de leurs poëtes, dans ce discours que tient Viriate à Sertorius.
Affranchissons le Tage, & laissons faire au Tibre :
La liberté n'est rien quand tout le monde est libre.
Mais il est beau de l'être, & voir tout l'univers
Soupirer sous le joug, & gémir dans les fers.
Il est beau d'étaler cette prérogative
Aux yeux du Rhône esclave, & de Rome captive,
Et de voir envier aux peuples abattus,
Ce respect que le fort garde pour les vertus.
Sertorius, act. IV. sc. vj.
Je ne prétends point décider que les Anglois jouissent actuellement de la prérogative dont je parle ; il me suffit de dire avec M. de Montesquieu, qu'elle est établie par leurs lois ; & qu'après tout, cette liberté politique extrême ne doit point mortifier ceux qui n'en ont qu'une modérée, parce que l'excès même de la raison n'est pas toûjours desirable, & que les hommes en général s'accommodent presque toûjours mieux des milieux que des extrémités. (D.J.)
LIBERTE DE PENSER, (Morale) Ces termes, liberté de penser, ont deux sens ; l'un général, l'autre borné. Dans le premier ils signifient cette généreuse force d'esprit qui lie notre persuasion uniquement à la vérité. Dans le second, ils expriment le seul effet qu'on peut attendre, selon les esprits forts, d'un examen libre & exact, je veux dire, l'inconviction. Autant que l'un est louable & mérite d'être applaudi, autant l'autre est blamable, & mérite d'être combattu. La véritable liberté de penser tient l'esprit en garde contre les préjugés & la précipitation. Guidée par cette sage Minerve, elle ne donne aux dogmes qu'on lui propose, qu'un degré d'adhésion proportionné à leur degré de certitude. Elle croit fermement ceux qui sont évidens ; elle range ceux qui ne le sont pas parmi les probabilités ; il en est sur lesquels elle tient sa croyance en équilibre ; mais si le merveilleux s'y joint, elle en devient moins crédule ; elle commence à douter, & se méfie des charmes de l'illusion. En un mot elle ne se rend au merveilleux qu'après s'être bien prémunie contre le penchant trop rapide qui nous y entraîne. Elle ramasse sur-tout toutes ses forces contre les préjugés que l'éducation de notre enfance nous fait prendre sur la religion, parce que ce sont ceux dont nous nous défaisons le plus difficilement ; il en reste toujours quelque trace, souvent même après nous en être éloignés ; lassés d'être livrés à nous-mêmes, un ascendant plus fort que nous, nous tourmente & nous y fait revenir. Nous changeons de mode, de langage ; il est mille choses sur lesquelles insensiblement nous nous accoutumons à penser autrement que dans l'enfance ; notre raison se porte volontiers à prendre ces nouvelles formes ; mais les idées qu'elle s'est faites sur la religion, sont d'une espece respectable pour elle ; rarement ose-t-elle les examiner ; & l'impression que ces préjugés ont faite sur l'homme encore enfant, ne périt communément qu'avec lui. On ne doit pas s'en étonner ; l'importance de la matiere jointe à l'exemple de nos parens que nous voyons en être réellement persuadés, sont des raisons plus que suffisantes pour les graver dans notre coeur, de maniere qu'il soit difficile de les en effacer. Les premiers traits que leurs mains impriment dans nos ames, en laissent toujours des impressions profondes & durables ; telle est notre superstition, que nous croyons honorer Dieu par les entraves où nous mettons notre raison ; nous craignons de nous démasquer à nous-mêmes, & de nous surprendre dans l'erreur, comme si la vérité avoit à redouter de paroître au grand jour.
Je suis bien éloigné d'en conclure qu'il faille pour cela décider au tribunal de la fiere raison, les questions qui ne sont que du ressort de la foi. Dieu n'a point abandonné à nos discussions des mysteres qui, soumis à la spéculation, paroîtroient des absurdités. Dans l'ordre de la révélation, il a posé des barrieres insurmontables à tous nos efforts ; il a marqué un point où l'évidence cesse de luire pour nous ; & ce point est le terme de la raison ; mais là où elle finit, ici commence la foi, qui a droit d'exiger de l'esprit un parfait assentiment sur des choses qu'il ne comprend pas ; mais cette soumission de l'aveugle raison à la foi, n'ébranle pas pour cela ses fondemens, & ne renverse pas les limites de la connoissance. Eh quoi ? Si elle n'avoit pas lieu en matiere de religion, cette raison que quelques-uns décrient si fort, nous n'aurions aucun droit de tourner en ridicule les opinions avec les cérémonies extravagantes qu'on remarque dans toutes les religions, excepté la véritable. Qui ne voit que c'est-là ouvrir un vaste champ au fanatisme le plus outré, & aux superstitions les plus insensées ? Avec de pareils principes, il n'y a rien qu'on ne croie, & les opinions les plus monstrueuses, la honte de l'humanité, sont adoptées. La religion qui en est l'honneur, & qui nous distingue le plus des brutes, n'est-elle pas souvent la chose en quoi les hommes paroissent les moins raisonnables ? Nous sommes faits d'une étrange maniere ; nous ne saurions nous tenir dans un juste milieu. Si l'on n'est superstitieux, on est impie. Il semble qu'on ne puisse être docile par raison, & fidele en philosophe. Je laisse ici à décider laquelle des deux est la plus déraisonnable & la plus injurieuse à la religion, ou de la superstition ou de l'impiété. Quoi qu'il en soit, les bornes posées entre l'une & l'autre, ont eu moins à souffrir de la hardiesse de l'esprit, que de la corruption du coeur. La superstition est devenue impie, & l'impiété elle-même est devenue superstitieuse ; oui, dans toutes les religions de la terre, la liberté de penser qui insulte aux bons croyans, comme à des ames foibles, à des esprits superstitieux, à des génies serviles, est quelquefois plus crédule & plus superstitieuse qu'on ne le pense. Quel usage de raison puis-je appercevoir dans des hommes qui croient par autorité qu'il ne faut pas croire à l'autorité ? Quels sont la plûpart de ces enfans qui se glorifient de n'avoir point de religion ? A les entendre parler, ils sont les seuls sages, les seuls philosophes dignes de ce nom ; ils possedent eux seuls l'art d'examiner la vérité ; ils sont seuls capables de tenir leur raison dans un équilibre parfait, qui ne sauroit être détruit que par le poids des preuves. Tous les autres hommes, esprits paresseux, coeurs serviles & lâches, rampent sous le joug de l'autorité, & se laissent entraîner sans résistance, par les opinions reçues. Mais combien n'en voyons-nous pas dans leur société qui se laissent subjuguer par un enfant plus habile. Qu'il se trouve parmi eux un de ces génies heureux, dont l'esprit vif & original soit capable de donner le ton ; que cet esprit d'ailleurs éclairé se précipite dans l'inconviction, parce qu'il aura été la dupe d'un coeur corrompu : son imagination forte, vigoureuse, & dominante, exercera sur leurs sentimens un pouvoir d'autant plus despotique, qu'un secret penchant à la liberté prêtera à ses raisons victorieuses une force nouvelle. Elle fera passer son enthousiasme dans les jeunes imaginations, les fléchira, les pliera à son gré, les subjuguera, les renversera.
Le traité de la liberté de penser, de Collins, passe parmi les inconvaincus, pour le chef-d'oeuvre de la raison humaine ; & les jeunes inconvaincus se cachent derriere ce redoutable volume, comme si c'étoit l'égide de Minerve. On y abuse de ce que présente de bon ce mot, liberté de penser, pour la réduire à l'irreligion ; comme si toute recherche libre de la vérité, devoit nécessairement y aboutir. C'est supposer ce qu'il s'agissoit de prouver, savoir si s'éloigner des opinions généralement reçues, est un caractere distinctif d'une raison asservie à la seule évidence. La paresse & le respect aveugle pour l'autorité, ne sont pas les seules entraves de l'esprit humain. La corruption du coeur, la vaine gloire, l'ambition de s'ériger en chef de parti, n'exercent que trop souvent un pouvoir tyrannique sur notre ame, qu'elles détournent avec violence de l'amour pur de la vérité.
Il est vrai que les inconvaincus en imposent & doivent en imposer par la liste des grands hommes, parmi les anciens, qui selon eux se sont distingués par la liberté de penser, Socrate, Platon, Epicure, Ciceron, Virgile, Horace, Pétrone, Corneille Tacite. Quels noms pour celui qui porte quelque respect aux talens & à la vertu ! mais cette logique est-elle bien assortie avec le dessein de nous porter à penser librement ! Pour montrer que ces illustres anciens ont pensé librement, citer quelques passages de leurs écrits, où ils s'élevent au-dessus des opinions vulgaires, des dieux de leur pays, n'est-ce pas supposer que la liberté de penser est l'apanage des incrédules, & par conséquent supposer ce qu'il s'agissoit de prouver. Nous ne dirons pas que pour se persuader que ces grands hommes de l'antiquité ont été entierement libres dans leurs recherches, il faudroit avoir pénétré les secrets mouvemens de leur coeur, dont il est impossible que leurs ouvrages nous donnent une connoissance suffisante ; que si les incrédules sont capables de cette force incompréhensible de pénétration, ils sont fort habiles ; mais que s'ils ne le sont pas, il est constant que par un sophisme très-grossier qui suppose évidemment ce qui est en question, ils veulent nous engager à respecter comme d'excellens modeles, des sages prétendus, dont l'intérieur leur est inconnu, comme au reste des hommes. Cette maniere de raisonner feroit le procès à tous les honnêtes gens qui ont écrit pour ou contre quelque systême que ce soit, & accuseroit d'hypocrisie à Paris, à Rome, à Constantinople, dans tous les lieux de la terre, & dans tous les tems, ceux qui ont fait & qui font honneur aux nations. Mais ce qui nous fâche, c'est qu'un auteur ne se contente pas de nous donner pour modeles de la liberté de penser, quelques-uns des plus fameux sages du Paganisme ; mais qu'il étale encore à nos yeux des écrivains inspirés, & qu'il s'imagine prouver qu'ils ont pensé librement, parce qu'ils ont rejetté la religion dominante. Les prophetes, dit-il, se sont déchaînés contre les sacrifices du peuple d'Israel ; donc les prophetes ont été des patrons de la liberté de penser. Seroit-il possible que celui qui se mêle d'écrire, fût d'une infidélité ou d'une ignorance assez distinguée pour croire tout de bon que ces saints hommes eussent voulu détourner le peuple d'Israel du culte lévitique ? N'est-il pas beaucoup plus raisonnable d'interpréter leurs sentimens par leur conduite, & d'expliquer l'irrégularité de quelques expressions, ou par la véhemence du langage oriental qui ne s'asservit pas toujours à l'exactitude des idées, ou par un violent mouvement de l'indignation qu'inspiroit à des hommes saints l'abus que les peuples corrompus faisoient des préceptes d'une saine religion ? N'y a-t-il aucune difference entre l'homme inspiré par son Dieu, & l'homme qui examine, discute, raisonne, réfléchit tranquillement & de sang froid ?
On ne peut nier qu'il n'y ait eu & qu'il n'y ait parmi les inconvaincus des hommes du premier mérite ; que leurs ouvrages ne montrent en cent endroits de l'esprit, du jugement, des connoissances ; qu'ils n'aient même servi la religion, en en décriant les véritables abus ; qu'ils n'aient forcé nos théologiens à devenir plus instruits & plus circonspects ; & qu'ils n'aient infiniment contribué à établir entre les hommes l'esprit sacré de paix & de tolérance : mais il faut aussi convenir qu'il y en a plusieurs dont on peut demander avec Swift, " qui auroit soupçonné leur existence, si la religion, ce sujet inépuisable, ne les avoit pourvus abondamment d'esprit & de syllogismes ? Quel autre sujet renfermé dans les bornes de la nature & de l'art, auroit été capable de leur procurer le nom d'auteurs profonds, & de les faire lire ? Si cent plumes de cette force avoient été emploiées pour la défense du Christianisme, elles auroient été d'abord livrées à un oubli éternel. Qui jamais se seroit avisé de lire leurs ouvrages, si leurs défauts n'en avoient été comme cachés & ensevelis sous une forte teinture d'irreligion ". L'impiété est d'une grande ressource pour bien des gens. Ils trouvent en elle les talens que la nature leur refuse. La singularité des sentimens qu'ils affectent, marque moins en eux un esprit supérieur, qu'un violent desir de le paroître. Leur vanité trouvera-t-elle son compte à être simples approbateurs des opinions les mieux démontrées ? Se contenteront-ils de l'honneur subalterne d'en appuyer les preuves, ou de les affermir par quelques raisons nouvelles ? Non ; les premieres places sont prises, les secondes ne sauroient satisfaire leur ambition. Semblables à César, ils aiment mieux être les premiers dans un bourg, que les secondes personnes à Rome ; ils briguent l'honneur d'être chefs de parti, en ressuscitant de vieilles erreurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans une imagination que l'orgueil rend vive & féconde. Voyez l'art. INTOLERANCE & JESUS-CHRIST. (G)
LIBERTES DE L'EGLISE GALLICANE, (Jurisp.) Elles consistent dans l'observation d'un grand nombre de points de l'ancien Droit commun & canonique concernant la discipline ecclésiastique que l'Eglise de France a conservée dans toute sa pureté, sans souffrir que l'on admît aucune des nouveautés qui se sont introduites à cet égard dans plusieurs autres églises.
L'auteur anonyme d'un traité des libertés de l'Eglise gallicane, dont il est parlé dans les oeuvres de Bayle, tome I. p. 320. édit. de 1737, se trompe, lorsqu'il suppose que l'on n'a commencé à parler de nos libertés que sous le regne de Charles VI.
M. de Marca en son traité des libertés de l'Eglise gallicane, soutient que les libertés furent reclamées dès l'an 461 au premier concile de Tours, & en 794, au concile de Francfort.
Mais la premiere fois que l'on ait qualifié de libertés, le droit & la possession qu'a l'Eglise de France de se maintenir dans ses anciens usages, fut du tems de saint Louis, sous la minorité duquel, au mois d'Avril 1228, on publia en son nom une ordonnance adressée à tous ses sujets dans les diocèses de Narbonne, Cahors, Rhodès, Agen, Arles & Nîmes, dont le premier articles porte, que les églises du Languedoc jouiront des libertés & immunités de l'Eglise gallicane : libertatibus & immunitatibus utantur quibus utitur Ecclesia gallicana.
Les canonistes ultramontains prétendent que l'on ne pourroit autoriser nos libertés, qu'en les regardant comme des privileges & des concessions particulieres des papes, qui auroient bien voulu mettre des bornes à leur puissance, en faveur de l'Eglise gallicane : & comme on ne trouve nulle part un tel privilege accordé à cette église, ces canonistes concluent de là que nos libertés ne sont que des chimeres.
D'autres par un excès de zele pour la France, font consister nos libertés dans une indépendance entiere du saint siege, ne laissant au pape qu'un vain titre de l'Eglise, sans aucune jurisdiction.
Mais les uns & les autres s'abusent également ; nos libertés, suivant les plus illustres prélats de l'Eglise de France, les docteurs les plus célebres, & les canonistes les plus habiles, ne consistant, comme on l'a déjà dit, que dans l'observation de plusieurs anciens canons.
Ces libertés ont cependant quelquefois été appellées privileges & immunités, soit par humilité ou par respect pour le saint siege, ou lorsqu'on n'a pas bien pesé la force des termes ; car il est certain que le terme de privilege est impropre, pour exprimer ce que l'on entend par nos libertés, les privileges étant des exceptions & des graces particulieres accordées contre le droit commun, au lieu que nos libertés ne consistent que dans l'observation rigoureuse de certains points de l'ancien droit commun & canonique.
En parlant de nos libertés, on les qualifie quelquefois de saintes, soit pour exprimer le respect que l'on a pour elles, & combien elles sont précieuses à l'Eglise de France, soit pour dire qu'il n'est pas permis de les enfreindre sans encourir les peines portées par les lois : sanctae quasi legibus sancitae.
L'Eglise de France n'est pas la seule qui ait ses libertés ; il n'y en a guere qui n'ait retenu quelques restes de l'ancienne discipline ; mais dans toute l'église latine, il n'y a point de nation qui ait conservé autant de libertés que la France, & qui les ait soutenues avec plus de fermeté.
Nous n'avons point de lois particulieres qui fixent précisément les libertés de l'Eglise gallicane.
Lorsque quelqu'un a voulu opposer que nous n'avons point de concessions de nos libertés, on a quelquefois répondu par plaisanterie, que le titre est au dos de la donation de Constantin au pape Sylvestre, pour dire que l'on seroit bien embarrassé de part & d'autre de rapporter des titres en fait de droits aussi anciens ; mais nous ne manquons point de titres plus réels pour établir nos libertés, puisque les anciens usages de l'Eglise de France qui forment ses libertés, sont fondés sur l'ancien Droit canonique ; & à ce propos il faut observer que sous la premiere race de nos rois, on observoit en France le code des canons de l'Eglise universelle, composé des deux premiers conciles généraux, de cinq conciles particuliers de l'Eglise grecque, & de quelques conciles tenus dans les Gaules. Ce code ayant été perdu depuis le viij. siecle, le pape Adrien donna à Charlemagne le code des canons de l'Eglise romaine, compilé par Denis le Petit en 527. Ce compilateur avoit ajoûté au code de l'Eglise universelle 50 canons des apôtres, 27 du concile de Chalcédoine, ceux des conciles de Sardique & de Carthage, & les décrétales des papes, depuis Sirice jusqu'à Anastase.
Tel étoit l'ancien Droit canonique observé en France avec quelques capitulaires de Charlemagne. On regardoit comme une entreprise sur nos libertés tout ce qui y étoit contraire ; & l'on y a encore recours lorsque la cour de Rome veut attenter sur les usages de l'Eglise de France, conformes à cet ancien droit.
Les papes ont eux-mêmes reconnu en diverses occasions la justice qu'il y a de conserver à chaque église ses libertés, & singulierement celle de l'Eglise gallicane : cap. licet extra de frigidis & cap. in genesi extra de electione.
Nos rois ont de leur part publié plusieurs ordonnances, édits & déclarations, pour maintenir ces précieuses libertés. Les plus remarquables de ces lois, sont la pragmatique de saint Louis en 1268 ; la pragmatique faite sous Charles VII. en 1437 ; le concordat fait en 1516 ; l'édit de 1535, contre les petites dates ; l'édit de Moulins en 1580, & plusieurs autres plus récens.
Le parlement a toujours été très-soigneux de maintenir ces mêmes libertés, tant par les différens arrêts qu'il a rendus dans les occasions qui se sont présentées, que par les remontrances qu'il a faites à ce sujet à nos rois, entr'autres celles qu'il fit au roi Louis XI. en 1461, qui font une des principales pieces qui ont été recueillies dans le traité des libertés de l'Eglise gallicane, par Pierre Pithou.
Quoique le détail de nos libertés soit presqu'infini, parce qu'elles s'étendent sur tout notre Droit canonique ; elles se rapportent néanmoins à deux maximes fondamentales.
La premiere, que le pape & les autres supérieurs ecclésiastiques n'ont aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel de nos rois, ni sur la jurisdiction séculiere.
La seconde, que la puissance du pape, par rapport au spirituel, n'est point absolue sur la France, mais qu'elle est bornée par les canons & par les coutumes qui sont observés dans le royaume ; desorte que ce que le pape pourroit ordonner au préjudice de ces regles, est nul.
C'est de ces deux maximes que dérivent toutes les autres que Pierre Pithou a recueillies dans son traité des libertés de l'Eglise gallicane, qu'il dédia au roi, & qui fut imprimé pour la premiere fois en 1609, avec privilege.
On y joignit plusieurs autres pieces aussi fort importantes concernant les libertés de l'Eglise gallicane, telles que les rémontrances faites au roi Louis, & plusieurs mémoires & traités de Jacques Cappel, Jean du Tillet, du sieur Dumesnil, de Claude Fauchet, de Hotman, Coquille, &c. l'auteur étoit déja décédé.
Mais le traité de Pithou sur les libertés de l'Eglise, est un des plus fameux de ce recueil. Quoique cet opuscule ne contienne que huit ou dix pages d'impression, il a acquis parmi nous une telle autorité, qu'on a distingué les à linea qui sont au nombre de 83, comme autant d'articles & de maximes ; & on les cite avec la même vénération que si c'étoient autant de lois.
Ce recueil a depuis été réimprimé plusieurs fois avec des augmentations de diverses pieces, qui ont aussi pour objet nos libertés.
M. Pierre Dupuy publia en 1639, en 2 vol. in-4°. un commentaire sur le traité des libertés de l'Eglise gallicane de Pithou : la derniere édition qui est de 1731 augmentée par l'abbé Lenglet du Fresnoy, compose 4 volumes in-fol. y compris deux volumes de preuves.
Les autres auteurs qui ont écrit depuis sur les libertés de l'Eglise gallicane, n'ont fait aussi pour la plûpart que commenter les maximes recueillies par Pithou.
Pour la conservation de nos libertés, on a recours en France à quatre principaux moyens qui sont remarqués par Pithou, art. 75, 76, 77, 78, & 79 ; où il dit que les divers moyens ont été sagement pratiqués par nos ancêtres, selon les occurrences & les tems.
Ces moyens sont, 1°. que l'on confere avec le pape, pour se concilier à l'amiable sur les difficultés qui peuvent s'élever. 2°. De faire un examen scrupuleux des bulles & autres expéditions venant de Rome, afin qu'on ne laisse rien publier contre les droits du roi, ni contre ceux de l'Eglise gallicane. 3°. L'appel au futur concile ; enfin l'appel comme d'abus aux parlemens, en cas d'entreprise sur la jurisdiction séculiere, & de contravention aux usages de l'Eglise de France.
Voyez les traités faits par du Tillet, Hotman, Dupuy, Leschassier, Bouchel, bibl. du Droit franc. let. j. verb. jurisdict. bibliot. can. tom. I. pag. 543 & 547. D'Hericourt, loix ecclésiast. part. I. chap. 17. (A)
LIBERTE, (Inscript. Med.) La Liberté sur les médailles, tient de la main droite un bonnet qui est son symbole. Tout le monde sait qu'on le donnoit à ceux qu'on affranchissoit. Appien raconte qu'après l'assassinat de César, un des meurtriers porta par la ville un bonnet au bout d'une pique, en signe de liberté. Il y avoit sur le mont Aventin un fameux temple dédié à la Liberté, avec un parvis, autour duquel régnoit un portique, qu'on nommoit atrium libertatis. Sous ce portique étoit la célebre bibliotheque d'Asinius Pollion qui rebâtit cet édifice.
On érigea sous Tibere dans la place publique une statue à la Liberté, dès qu'on sut la mort de Séjan. Josephe rapporte qu'après le massacre de Caïus, Cassius Chéréa vint demander le mot aux consuls, ce qu'on n'avoit point vu de mémoire d'homme, & que le mot qu'ils lui donnerent, fut liberté.
Caïus étant décédé, on érigea sous Claude un monument à la Liberté ; mais Néron replongea l'empire dans une cruelle servitude. Sa mort rendit encore la joie générale. Tout le peuple de Rome & des provinces prit le bonnet de la liberté ; c'étoit un triomphe universel. On s'empressa de représenter par-tout dans les statues & sur les monnoies, l'image de la Liberté qu'on croyoit renaissante.
Une inscription particuliere nous parle d'une nouvelle statue de la Liberté, érigée sous Galba.
La voici telle qu'elle se lit à Rome sur la base de marbre qui soutenoit cette statue.
Imaginum domus Aug. cultoribus signum
Libertatis restitutae, Ser. Galbae imperatoris
Aug. curatores anni secundi, C. Turranius
Polubius, L. Calpurnius Zena, C. Murdius
Lalus, C. Turranius Florus C. Murdius
Demosthenes.
Sur le côté gauche de la base est écrit.
Dedic. id. Octob. C. Bellico Natale Cos.
P. Cornelio Scipione Asiatico.
Ces deux consuls furent subrogés l'année 68 de Jesus-Christ.
Ce fut sur le modele de cette statue ou de quelque autre pareille, qu'on frappa du tems du même empereur tant de monnoies, qui portent au revers, libertas August. libertas restituta, libertas publica. Les provinces à l'imitation de la capitale, dresserent de pareilles statues. Il y a dans le cabinet du roi de France une médaille grecque de Galba, avec le type de la Liberté, & le mot . (D.J.)
LIBERTE, (Mythol. Iconol.) déesse des Grecs & des Romains. Les Grecs l'invoquoient sous le nom d'Eleuthérie, & quelquefois ils disoient , dieux de la liberté. Les Romains qui l'appellerent Libertas, eurent cette divinité en singuliere vénération, lui bâtirent des temples, des autels en nombre, & lui érigerent quantité de statues. Tiberius Gracchus lui consacra sur le mont Aventin un temple magnifique, soutenu de colonnes de bronze, & décoré de superbes statues. Il étoit précédé d'une cour qu'on appelloit atrium Libertatis.
Quand Jules César eut soumis les Romains à son empire, ils éleverent un temple nouveau en l'honneur de cette déesse, comme si leur liberté étoit rétablie par celui qui en sappa les fondemens ; mais dans une médaille de Brutus, on voit la Liberté sous la figure d'une femme, tenant d'une main le chapeau, symbole de la liberté, & deux poignards de l'autre main avec l'inscription, idibus Martiis, aux ides de Mars.
La déesse étoit encore représentée par une femme vêtue de blanc, tenant le bonnet de la main droite, & de la gauche une javeline ou verge, telle que celle dont les maîtres frappoient leurs esclaves lorsqu'ils les affranchissoient : il y a quelquefois un chat auprès d'elle.
Dans d'autres médailles, elle est accompagnée de deux femmes, qu'on nommoit Adioné & Abéodoné, & qu'on regardoit comme ses suivantes ; parce que la liberté renferme le pouvoir d'aller & de venir où l'on veut.
Quelques villes d'Italie, comme Bologne, Gènes, Florence, portoient autrefois dans leurs drapeaux, dans leurs armoiries, le mot libertas, & ils avoient raison ; mais cette belle devise ne leur convient plus aujourd'hui : c'est à Londres qu'il appartient d'en faire trophée. (D.J.)
LIBERTE DE COUR, terme de Commerce, c'est l'affranchissement dont jouit un marchand de la jurisdiction ordinaire des lieux où il fait son négoce, & le privilege qu'a un étranger de porter les affaires concernant son trafic par-devant un juge de sa nation.
Ce terme a particulierement lieu par rapport aux villes hanséatiques, qui dans tous les comptoirs qu'elles avoient autrefois dans les principales villes de commerce de l'Europe, comme Londres, Anvers, &c. entretenoient une espece de consul, & sous lui un greffier, par-devant lequel tous les marchands de leur hanse ou ligue devoient se pourvoir en premiere instance, & dont les jugemens se portoient par appel & en dernier ressort, par-devant les juges & magistrats des villes hanséatiques, dont l'assemblée résidoit à Lubeck.
Ce qui reste aujourd'hui des villes hanséatiques qui sont réduites à sept ou huit, jouit encore de ce privilege, mais seulement parmi leurs propres négocians. Voyez HANSE & HANSEATIQUES, ou ANSEATIQUES. Dictionn. de Comm.
LIBERTE, en Peinture, est une habitude de main que le peintre acquiert par la pratique. Légereté & liberté de pinceau, different en ce que légereté suppose plus de capacité dans un peintre que liberté ; ces deux termes sont cependant fort analogues.
LIBERTE, parmi les Horlogers, signifie la facilité qu'une piece a pour se mouvoir. On dit, par exemple, qu'une roue est fort libre, ou qu'elle a beaucoup de liberté, lorsque la plus petite force est capable de la mettre en mouvement. Voyez JEU.
LIBERTE, (Maréchal) la liberté de la langue. Voyez LANGUE. Sauteur en liberté. Voyez SAUTEUR.
LIBERTE, FACILITE, LEGERETE, FRANCHISE, (Beaux-Arts) ces termes ordinairement synonymes dans les beaux-arts, sont l'expression de l'aisance dans leur pratique, & cette aisance ajoute des graces aux mérites des ouvrages. Il y a une liberté délicate, que possédent les grands maîtres, & qui n'est sensible qu'aux yeux savans ; mais voyez FRANCHISE de pinceau, de burin, & FACILITE, Peinture. (D.J.)
|
| LIBERTINAGE | S. m. (Mor.) c'est l'habitude de céder à l'instinct qui nous porte aux plaisirs des sens ; il ne respecte pas les moeurs, mais il n'affecte pas de les braver ; il est sans délicatesse, & n'est justifié de ses choix que par son inconstance ; il tient le milieu entre la volupté & la débauche ; quand il est l'effet de l'âge ou du tempérament, il n'exclud ni les talens ni un beau caractere ; César & le maréchal de Saxe ont été libertins. Quand le libertinage tient à l'esprit, quand on cherche plus des besoins que des plaisirs, l'ame est nécessairement sans goût pour le beau, le grand & l'honnête. La table, ainsi que l'amour, a son libertinage ; Horace, Chaulieu, Anacréon étoient libertins de toutes les manieres de l'être ; mais ils ont mis tant de philosophie, de bon goût & d'esprit dans leur libertinage, qu'ils ne l'ont que trop fait pardonner ; ils ont même eu des imitateurs que la nature destinoit à être sages.
|
| LIBERTINI | LES, (Littérat. sacrée) en grec , actes des apôtres, chap. vj. v. 9. Voici le passage : Surrexerunt autem quidam de synagoga, quae appellabatur libertinorum, & Cyrenensium, & Alexandrinorum, & eorum qui erant à Ciciliâ & Asiâ, disputantes cum Stephano : " Or quelques-uns s'éleverent de la synagogue, nommée des libertins, des Cyrénéens, & des Alexandrins, des Ciliciens, & des Asiatiques, disputant avec Etienne. "
Le P. Amelotte, MM. de Sacy, Huré & quantité d'autres, traduisent libertinorum, par affranchis, parce que les Romains nommoient liberti, leurs affranchis, & les enfans des affranchis étoient proprement appellés libertini ; mais libertini de la version latine, n'est que le mot exprimé dans l'original grec . Or ce mot grec n'est point du corps de la langue grecque, & ne se trouve point dans un seul auteur. Il n'a donc rien de commun avec la signification ordinaire du mot latin, dans le sens d'affranchi. Suidas qui avoit pris ce mot des actes, dit , nom de peuple ; c'est une autorité qu'on peut compter pour quelque chose.
Après les libertini, le livre des actes nomme les Cyrénéens, les Alexandrins, peuples d'Afrique, & commence par les plus éloignés. Les Romains auroient-ils eu en Afrique une colonie nommée Libertina, où il y auroit eu des Juifs, comme il y en avoit à Alexandrie & à Cyrène ? c'est ce qu'on ignore. On sait seulement qu'il y avoit en Afrique un siege épiscopal de ce nom ; car à la conférence de Carthage, ch. cxvj, il se trouva deux évêques, Victor & Janvier, l'un catholique, l'autre donatiste, qui prenoient chacun la qualité de episcopus ecclesiae libertinensis. (D.J.)
|
| LIBERTINS | S. m. pl. (Théolog.) fanatiques qui s'éleverent en Hollande vers l'an 1528, dont la croyance est qu'il n'y a qu'un seul esprit de Dieu répandu par-tout, qui est & qui vit dans toutes les créatures ; que notre ame n'est autre chose que cet esprit de Dieu ; qu'elle meurt avec le corps ; que le péché n'est rien, & qu'il ne consiste que dans l'opinion, puisque c'est Dieu qui fait tout le bien & tout le mal : que le paradis est une illusion, & l'enfer un phantome inventé par les Théologiens. Ils disent enfin, que les politiques ont inventé la religion pour contenir les peuples dans l'obéissance de leurs lois ; que la régénération spirituelle ne consistoit qu'à étouffer les remords de la conscience ; la pénitence à soutenir qu'on n'avoit fait aucun mal ; qu'il étoit licite & même expédient de feindre en matiere de religion, & de s'accommoder à toutes les sectes.
Ils ajoutoient à tout cela d'horribles blasphèmes contre Jesus-Christ, disant qu'il n'étoit rien qu'un je ne sais quoi composé de l'esprit de Dieu & de l'opinion des hommes.
Ce furent ces maximes qui firent donner à ceux de cette secte le nom de libertins, qu'on a pris depuis dans un mauvais sens.
Les libertins se repandirent principalement en Hollande & dans le Brabant. Leurs chefs furent un tailleur de Picardie nommé Quentin, & un nommé Coppin ou Chopin, qui s'associa à lui & se fit son disciple. Voyez le Dictionn. de Trévoux.
LIBERTINS, (Jurisprud.) du latin liberti ou libertini, se dit quelquefois dans notre langue pour désigner les esclaves affranchis ou leurs enfans ; mais on dit plus communément affranchis, à moins que ce ne soit pour désigner spécialement les enfans des affranchis. A Rome dans les premiers tems de la république, on distinguoit les affranchis des libertins ; les esclaves affranchis étoient appellés liberti quasi liberati, & leurs enfans libertini, terme qui exprimoit des personnes issues de ceux qu'on appelloit liberti : cependant la plûpart des jurisconsultes & des meilleurs écrivains de Rome, ont employé indifféremment l'un & l'autre terme pour signifier un affranchi, & l'on en trouve un exemple dans la premiere des Verrines. Voyez AFFRANCHIS, AFFRANCHISSEMENT, ESCLAVES, LIBERTE, MANUMISSION, SERFS. (A)
|
| LIBERTINUS | (Littérat.) Cic. ce mot veut dire un affranchi qui a été délivré de l'esclavage, & mis en liberté. Dans les premiers tems de la république, libertinus étoit liberti filius, le fils d'un affranchi, lequel affranchi se nommoit proprement libertus ; mais sur la fin de la république, quelque tems avant Cicéron, & depuis sous les empereurs, on n'observa plus cette différence, & les affranchis furent appellés indifféremment liberti & libertini ; cette remarque est de Suétone. (D.J.)
|
| LIBÉTHRA | (Géogr. anc.) ville de Grece sur le mont Olympe du côté de la Macédoine, qui ne subsistoit déja plus du tems de Pausanias. Il nous a raconté l'histoire populaire de sa destruction.
Mais la Thessalie étoit encore célebre par la fontaine Libéthra, fons Libethrius, sources fameuses que les écrits des poëtes ont immortalisées, & qui valurent aux muses, le surnom de Libéthrides ; Virgile n'a pas oublié de les en honorer.
Nymphae, noster amor, Libethrides, aut mihi carmen
Quale meo Codro, concedite.
Eglog. 7. v. 21.
Enfin, la Béotie avoit une montagne nommée Libéthrienne, mons Libethrius, située à deux petites lieues de Coronée. On y voyoit des statues des nymphes & des muses Libéthrides, de même qu'une fontaine libéthriade, où étoit une belle pierre façonnée comme le sein d'une femme, & l'eau sortoit de ses mamelles, comme le lait sort du mamelon. (D.J.)
|
| LIBÉTHRIDES | S. f. pl. (Littérat.) surnom des nymphes qui habitoient près du mont Libéthrien, en Béotie ; mais la fontaine Libéthria valut aux muses le même nom de Libéthrides dans les écrits des Poëtes. Voyez LIBETHRA. (D.J.)
|
| LIBISOSA | (Géog. anc.) ancienne ville d'Espagne, colonie des Romains, Libisosana colonia, dont le peuple étoit nommé Libisosani. On avoit accordé à cette colonie les mêmes privileges qu'aux villes d'Italie. Le village de Lesuza dans la nouvelle Castille, à quatre lieues d'Alicarez, où l'on a trouvé une ancienne inscription, donne lieu de croire que ce lieu seroit un reste de la Libisosa ou Libisosana des Romains. (D.J.)
|
| LIBITINAIRE | Libitinarius, s. m. (Littérat.) les Libitinaires étoient, chez les Romains, des gens qui vendoient & fournissoient tout ce qui étoit nécessaire pour la cérémonie des convois. On les appelloit ainsi, parce qu'ils avoient leur magasin au temple de Proserpine ou de Vénus libitine. Nous avons parlé des Libitinaires assez au long, au mot FUNERAILLES des Romains, tom. VII. pag. 370, le lecteur y peut recourir. (D.J.)
|
| LIBITINE | Libitina, (Littérat.) déesse qui présidoit aux funérailles. Elle fut ainsi nommée, non parce qu'elle ne plaît à personne, quia nemini libeat, comme disent les partisans de l'antiphrase, mais parce qu'elle nous enleve quand il lui plaît, pro libitu ; cette déesse étoit la même que Vénus Infera ou Epithymbia des Grecs, dont il est fait mention parmi les dieux infernaux dans quelques anciennes épitaphes.
Elle avoit un temple à Rome où l'on louoit, où l'on vendoit tout ce qui étoit nécessaire aux funérailles, & l'on donnoit une certaine piece d'argent pour chaque personne qu'on enterroit ou que l'on portoit au bucher. On mettoit cet argent dans le trésor de Libitine, c'est-à-dire de ses prêtres ; ceux qui étoient préposés pour le recevoir, écrivoient sur un registre le nom de chaque mort pour lequel on payoit cette espece de tribut, & ce registre s'appelloit le registre de Libitine, Libitinae ratio.
Le roi Servius Tullius avoit établi cet usage, qui servoit chaque année à faire connoître le nombre des morts dans la ville de Rome, & par conséquent l'accroissement ou la diminution de ses habitans. C'est aussi par ce tribut que les revenus des prêtres de Libitine grossissoient dans les tems de mortalité ; Suétone écrit que sous le regne de Néron, il y eut une automne si funeste, qu'elle fit porter trente mille pieces d'argent au trésor de Libitine.
Cette divinité donna son nom au temple qui lui étoit dédié, aux prêtres qui la servoient, aux gens qui vendoient sous leurs ordres les choses nécessaires aux funérailles, à une porte de Rome par laquelle on sortoit les cadavres hors de la ville, enfin au brancart sur lequel on portoit les corps à leur sépulture. (D.J.)
LIBITINE porte, (Littérat.) libitinensis porta, Lamprid. Porte de l'amphithéatre des Romains, par laquelle on sortoit les corps des gladiateurs qui avoient été tués dans les jeux publics ; on l'avoit ainsi nommée du même nom d'une autre grande porte de Rome, par laquelle on portoit les morts hors de la ville. (D.J.)
|
| LIBONGOS | S. m. (Commerce) grosse étoffe qui est propre pour la traite que les européens font à Loango & autres lieux de la côte d'Afrique.
|
| LIBONOTUS | (Géog. marit. anc.) l'un des douze vents des anciens ; nos dictionnaires traduisent ce mot latin par le vent de sud-ouest, le vent qui souffle entre le midi & l'occident ; mais cette traduction n'est pas absolument exacte, parce que nous n'avons point sur notre boussole de nom qui marque au juste ce rhumb de vent des anciens : en voici la raison.
Aristote & Pline ont divisé les vents en douze ; le quart de cercle qui s'étend entre le midi, notus ou auster, & l'occident zephirus ou favonius, se trouve partagé en deux intervalles de trente degrés chacun, & ces deux espaces sont remplis par deux vents, savoir Libonotus & Africus, éloignés l'un de l'autre à distance égale.
Le premier est au milieu entre le vent d'Afrique, nommé par les Grecs, & le vent du midi nommé dans la même langue, notus en latin.
Ainsi cette division par douze, ne sauroit s'accorder avec la nôtre qui est par trente-deux ; le vent dont le libonotus approche le plus, c'est le sud-ouest quart au sud ; & comme nous disons sud-ouest pour signifier le vent qui souffle au milieu précisément, entre le sud & l'ouest, d'un nom composé de ces deux ; de même les anciens ont uni les noms de lips & notus, & ont appellé libonotus le vent qui souffle précisément entre ces deux autres vents. (D.J.)
|
| LIBORA | (Géog. anc.) ville de l'Espagne Tarragonoise, au pays des Carpitaniens, selon Ptolémée liv. ch. vj. c'est présentement Talavera de la Reyna. (D.J.)
|
| LIBOURET | S. m. (Pêche) instrument que l'on emploie à la pêche du maquereau. C'est une ligne : le pêcheur en prend une très-déliée qu'il nomme bauffe, & qu'il change tous les jours, dans la crainte que la dérive continuelle qui affoiblit le bauffe ne le rompe, & que le plomb qui est au bout & qui peut peser huit, dix à douze livres, ne soit perdu. A un pié près du plomb, on amarre avec un noeud coulant un bâton gros comme un tuyau de plume, dont la longueur soit d'environ sept à huit pouces ; à l'autre bout de ce bâton on frappe la premiere pille ou petite ligne qui porte un ain ou un hameçon de la grosseur de ceux dont on se sert pour le merlan. L'on amorce cet hameçon avec un petit morceau de harang, d'orphie ou autre chair de poisson frais. Cette pille est fine, mais forte. Deux brasses plus haut sur le même bauffe ou ligne de plomb, il y a une autre manoeuvre apareillée de même, & ainsi de deux brasses en deux brasses. Il y a six hameçons sur chaque bauffe, de maniere qu'ils ne peuvent se mêler ; & chaque bateau qui pêche au maquereau avec le libouret a trois bauffes, un à l'avant & les autres à chaque côté de l'arriere. Cette pêche se fait près des côtes escarpées où les autres pêches sont impraticables ; on n'y prend guere que des poissons saxatiles & ronds ; les poissons plats cherchent les sables & les terres basses. Voyez dans nos Planches de pêche le libouret ; celui de l'Amirauté de Poitou qu'on nomme aussi archer, est fait de baleine ou de la canne des îles pliée de maniere qu'elle forme une espece d'o surmonté d'un v, en cette façon . Il y a un petit organeau au bout. La ligne que le pêcheur tient à la main passe dans le rond, & est arrêtée par le plomb qui pese au plus deux ou trois livres. A chaque pointe de l'archet ou du quart de cercle, est frappée une pille d'une brasse de longueur ou environ. La pille est armée par le bout d'un hameçon.
|
| LIBOURNE | liburnum, (Géog.) &, selon M. de Valois, Ellae-borna, c'est-à-dire la borne de l'Ile, ville de France en Guyenne, dans le Bourdelois, plusieurs fois prise & reprise durant les guerres avec les Anglois, & durant les troubles de France. On ne voit pas que ce lieu ait été marqué dans l'antiquité, quoique le nom latin Liburnum qu'on lui donne ait un certain air d'ancienneté. Cette petite ville marchande & assez peuplée, est au confluent de l'Ile avec la Dordogne, qui est fort large en cet endroit, à 5 lieues N. E. de Bourdeaux, & 122 S. O. de Paris. Long. 17. 24. 32. latit. 44. 55. 2. (D.J.)
|
| LIBRA | (Astronomie) nom latin de la constellation de la balance. Voyez BALANCE.
|
| LIBRAIRE | S. m. & f. marchand qui vend des livres & qui en imprime, s'il est du nombre des imprimeurs, typographus, bibliopola, librarius.
On peut dire encore qu'un libraire est un négociant censé lettré, ou doit l'être. Ce que j'avance par rapport aux lettres ne doit pas paroître étrange, si l'on considere que c'est aux Plantins, aux Vitrés, aux Robert, Charles & Henri Etienne, qu'on doit tant de belles éditions greques & latines recommandables sur-tout par leur exactitude, & à quelques-uns de ceux du dernier siecle, nombre de belles éditions, parmi lesquels priment les Rigaud-Anisson, Mabre-Cramoisy, P. le Petit, & autres.
Le nombre des Libraires de Paris n'est pas fixé, mais celui des Imprimeurs l'est à trente-six.
Avant d'être reçu, on subit un examen sur le fait de la Librairie, suivant les ordonnances de plusieurs de nos Rois, confirmées par Louis XIV. & Louis XV.
Il faut que le candidat ait été préalablement examiné par le recteur, qui lui donne un certificat comme il est congru en langues latine & grecque.
Il parut il y a quelques années à Léipsick, une dissertation qui a pour titre, de Librariis & Bibliopolis antiquorum. Ces Bibliopoles des anciens étoient ce que nous appellons maintenant Libraires ; c'est-à-dire, marchands de livres ; & ceux que les anciens nommoient Libraires, Librarii, étoient ceux qui écrivoient les livres pour le public, & pour les Bibliopoles, c'étoient les copistes.
A Francfort, au tems des foires, il y a des magasins ouverts, sur lesquels sont les titres des plus fameux libraires : officina Elzeviriana, Frobeniana, Morelliana, Jansoniana, &c.
LIBRAIRE. Il y avoit autrefois dans quelques églises cathédrales une dignité qui donnoit le nom de libraire à celui qui en étoit revêtu, librarius. Il y en a qui croient que le libraire étoit ce que nous appellons aujourd'hui chantre ou grand-chantre.
LIBRAIRE, terme d'Antiquité. On appelloit autrefois en latin notaires ceux qui savoient l'art d'écrire en notes abrégées, dont chacune valoit un mot ; & on nommoit libraires ou antiquaires, ceux qui transcrivoient en beaux caracteres, ou du-moins lisibles, ce qui avoit été écrit en note. On appelle aujourd'hui, en termes de palais, l'un la minute, & l'autre la grosse. Librarius. Plus de sept notaires étoient toujours prêts à écrire ce qu'il dictoit, & se soulageoient en se succédant tour-à-tour. Il n'avoit pas moins de libraires pour mettre les notes au net. Fleury.
|
| LIBRAIRIE | S. f. l'art, la profession de Libraires. Typographorum, vel Bibiopolarum ars, conditio. C'est un homme qui est de pere en fils dans la Librairie. Il se plaint que la Librairie ne vaut plus rien, que le trafic des livres ne va plus. Toute la Librairie s'est assemblée pour élire un syndic & des adjoints.
LIBRAIRIE, signifioit autrefois une bibliotheque, un grand amas de livres, bibliotheca. Henri IV. dit à Casaubon qu'il vouloit qu'il eût soin de sa librairie. Colom. On appelloit au siecle passé, dans la maison du roi, maître de la librairie, l'officier que nous nommons communément aujourd'hui bibliothécaire du roi. M. de Thou a été maître de la librairie. M. Bignon l'est aujourd'hui. On dit aussi garde de la librairie, tant du cabinet du louvre que de la suite de S. M. Les librairies des monasteres étoient autant de magasins de manuscrits. Pasq. En ce sens, il est hors d'usage. Les capucins & quelques autres religieux disent encore notre librairie, pour dire notre bibliotheque.
LIBRAIRIE, (Comm.) la librairie dans son genre de commerce, donne de la considération, si celui qui l'exerce, a l'intelligence & les lumieres qu'elle exige. Cette profession doit être regardée comme une des plus nobles & des plus distinguées. Le commerce des livres est un des plus anciens que l'on connoisse ; dès l'an du monde 1816, on voyoit déja une bibliotheque fameuse construite par les soins du troisieme roi d'Egypte.
La Librairie se divise naturellement en deux branches, en ancienne & en nouvelle : par l'une, on entend le commerce des livres vieux ; par l'autre, celui des livres nouveaux. La premiere demande une connoissance très-étendue des éditions, de leur différence & de leur valeur, enfin une étude journaliere des livres rares & singuliers. Feu MM. Martin, Boudot, & Piget ont excellé dans cette partie ; d'autres suivent aujourd'hui avec distinction la même carriere. Dans la nouvelle Librairie, cette connoissance des éditions, sans être essentielle, ni même nécessaire, n'est point du tout inutile, & peut faire beaucoup d'honneur à celui qui la possede ; son étude particuliere doit être celle du goût du public, c'est de le sonder continuellement, & de le prévenir : quelquefois il est visible, il ne s'agit plus que de le suivre.
Charlemagne associant la Librairie à l'université, lui adjugea les mêmes prérogatives ; dès-lors elle partagea avec ce corps les mêmes droits & privileges qui la rendirent franche, quitte & exemte de toutes contributions, prêts, taxes, levées, subsides & impositions mises & à mettre, imposées & à imposer sur les arts & métiers. Philippe VI. dit de Valois, honora aussi la Librairie de sa protection par plusieurs prérogatives ; Charles V. les confirma, & en ajouta encore de nouvelles ; enfin Charles VI. se fit un plaisir de suivre l'exemple de ses prédécesseurs : l'Imprimerie n'existoit pas encore. La naissance de cet art heureux, qui multiplie à l'infini avec une netteté admirable & une facilité incompréhensible, ce qui coutoit tant d'années à copier à la plume, renouvella la Librairie ; alors que d'entreprises considérables étendirent son commerce ou plutôt le recréerent ! Cette précieuse découverte fixa les regards de nos souverains, & huit rois consécutifs la jugerent digne de leur attention ; la Librairie partagea encore avec elle ses privileges. Ce n'est pas qu'actuellement ces exemptions, dont nous avons parlé plus haut, subsistent en entier ; le tems qui détruit tout, la nécessité de partager la charge de l'état, & d'être avant tout citoyen, les ont presque abolies.
Le chancelier de France est le protecteur né de la Librairie. Lorsque M. de Lamoignon succéda dans cette place à M. d'Aguesseau, d'heureuse mémoire, sachant combien les Lettres importent à l'état, & combien tient aux Lettres la Librairie, ses premiers soins furent de lui choisir pour chef un magistrat amateur des Savans & des Sciences, savant lui-même. Sous les nouveaux auspices de M. de Malesherbes, la Librairie changea de face, prit une nouvelle forme & une nouvelle vigueur ; son commerce s'aggrandit, se multiplia ; desorte que depuis peu d'années, & presque à la fois, l'on vit éclorre & se consommer les entreprises les plus considérables. L'on peut en citer ici quelques-unes : l'histoire des voyages, l'histoire naturelle, les transactions philosophiques, le catalogue de la bibliotheque du roi, la diplomatique, les historiens de France, le recueil des ordonnances, la collection des auteurs latins, le Sophocle en grec, le Strabon en grec, le recueil des planches de l'Encyclopédie ; ouvrages auxquels on auroit certainement pu joindre l'Encyclopédie même, si des circonstances malheureuses ne l'avoient suspendue. Nous avouerons ici avec reconnoissance ce que nous devons à sa bienveillance. C'est à ce magistrat, qui aime les Sciences, & qui se récrée par l'étude de ses pénibles fonctions, que la France doit cette émulation qu'il a allumée, & qu'il entretient tous les jours parmi les Savans ; émulation qui a enfanté tant de livres excellens & profonds, desorte que sur la Chimie seulement, sur cette partie autrefois si négligée, on a vû depuis quelque tems plus de traités qu'il n'y avoit de partisans de cette science occulte il y a quelques années.
|
| LIBRARII | S. m. pl. (Hist. Littér.) nom que les anciens donnoient à une espece de copistes, qui transcrivoient en beaux caracteres, ou au-moins en caracteres lisibles, ce que les notaires avoient écrit en notes & avec des abréviations. Voyez NOTE, NOTAIRE, CALLIGRAPHE.
|
| LIBRATION | S. f. (en Astronom.), est une irrégularité apparente dans le mouvement de la lune, par laquelle elle semble balancer sur son axe ; tantôt de l'orient à l'occident, & tantôt de l'occident à l'orient ; de-là vient que quelques parties du bord de la lune qui étoient visibles, cessent de l'être & viennent à se cacher dans le côté de la lune que nous ne voyons jamais, pour redevenir ensuite de nouveau visibles.
Cette libration de la lune a pour cause, l'égalité de son mouvement de rotation sur son axe, & l'inégalité de son mouvement dans son orbite ; car si la lune se mouvoit dans un cercle dont le centre fût le même que celui de la terre, & qu'en même-tems elle tournât autour de son axe dans le tems précis de sa période autour de la terre ; le plan du méridien de la lune passeroit toujours par la terre, & cet astre tourneroit vers nous constamment & exactement la même face ; mais comme le mouvement réel de la lune se fait dans une ellipse dont la terre occupe le foyer, & que le mouvement de la lune sur son propre centre est uniforme, c'est-à-dire, que chaque méridien de la lune décrit par ce mouvement des angles proportionnels aux tems ; il s'ensuit de-là que ce ne sera pas constamment le même méridien de la lune qui viendra passer par la terre.
Soit A L R, (fig. astron.) l'orbite de la lune, dont le foyer T est au centre de la terre. Si l'on suppose d'abord la lune en A, il est clair que le plan d'un de ses méridiens M N étant prolongé, passera par le point T, ou par le centre de la terre. Or, si la lune n'avoit aucune rotation autour de son axe, comme elle s'avance chaque jour sur son orbite, ce même méridien M N seroit toujours parallele à lui-même, & la lune étant parvenue en L, ce méridien paroîtroit dans la situation représentée par P Q, c'est-à-dire, parallélement à M N : mais le mouvement de rotation de la lune autour de son axe qui est uniforme, est cause que le méridien M N, change de situation ; & parce qu'il décrit des angles proportionnels au tems & qui répondent à quatre angles droits dans l'espace d'une révolution périodique, il sera par conséquent dans une situation m L n, tel que l'angle Q L N qu'il forme avec P Q, seroit à un angle droit ou de 90d, comme le tems que la lune emploie à parcourir l'arc A L est au quart du tems périodique. Mais le tems que la lune emploie à parcourir l'arc A L, est au quart du tems périodique, comme l'aire A T L est à l'aire A C L, ou au quart de l'aire elliptique ; ainsi l'angle Q L N sera à un angle droit dans le même rapport : & d'autant que l'aire A T L est beaucoup plus grande que l'aire A C L, de même l'angle Q L N sera nécessairement plus grand qu'un angle droit. Or, puisque Q L T est un angle aigu, il s'ensuit que l'angle Q L N qui est obtus sera plus grand que l'angle Q L T, & partant la lune étant en L, ce même méridien m n dont le plan passoit par le centre de la terre, lorsque la lune étoit au point A, ne sauroit être dirigé vers le point T ou vers le centre de la terre. Il est donc vrai de dire, que l'hémisphère visible de la lune ou qui est tourné vers la terre en L, n'est plus exactement le même qu'il étoit apperçu lorsque la lune s'est trouvée en A, & qu'ainsi au-delà du point Q de la circonsérence du disque, on pourra découvrir quelques régions qui n'étoient nullement visibles auparavant. Enfin, lorsque la lune sera parvenue au point R de son orbite où elle est périgée, comme son méridien m n aura précisément achevé une demi-révolution, alors le plan de ce méridien passera exactement par le centre de la terre. On verra donc en ce cas le disque de la lune au même état que lorsqu'elle étoit apogée en A ; d'où il suit que les termes de la libration de la lune sont l'apogée & le périgée, & que ce phénomene peut s'observer deux fois dans chaque lunaison, ou dans chaque mois périodique. Inst. Astr. de M. le Monnier.
Au reste, si la figure de la lune étoit parfaitement sphérique, comme on l'a supposé jusqu'ici, la libration seroit purement optique ; mais j'ai prouvé dans mes Recherches sur le système du monde II. part. art. 363 & suiv. que si la lune s'écarte tant soit peu de la figure sphérique, il peut & il doit y avoir une cause physique dans la libration. Comme ce détail est trop étendu & trop géométrique pour être inseré ici, j'y renvoie le lecteur. (O)
Libration de la terre ; c'est, suivant quelques anciens astronomes, le mouvement par lequel la terre est tellement retenue dans son orbite, que son axe reste toujours parallele à l'axe du monde.
C'est ce que Copernic appelloit les mouvemens de libration.
Mais il paroît que ce nom est fort impropre ; car on pourroit plutôt dire que l'axe de la terre auroit une libration du midi au nord ou du nord au midi, si cet axe ne demeuroit pas toujours parallele à lui-même. Pour qu'il demeure dans cet état, il n'est besoin d'aucune force extérieure, il a dû prendre cette situation dès que la terre a commencé à tourner, & l'a conservée depuis par la propriété qu'ont tous les corps de rester dans l'état qui leur a été donné, à moins qu'une cause extérieure & étrangere ne les en tire. Toute la question qu'on peut faire ici, c'est de savoir pourquoi l'axe de la terre est dans cette situation, & pourquoi il n'est pas perpendiculaire à l'écliptique, plutôt que de lui être incliné de la valeur de 23 degrés & demi. A cela on peut répondre que cette situation est peut-être nécessaire pour la distribution alternative des différentes saisons entre les habitans de la terre. Si l'axe de la terre étoit perpendiculaire à l'écliptique, les habitans de l'équateur auroient tous vûs le soleil sur leurs têtes, & les habitans des poles ne le verroient jamais qu'à leur horison ; desorte que les uns auroient un chaud insupportable, tandis que les autres souffriroient un froid excessif. C'est peut-être là, si on peut parler ainsi, la raison morale de cette situation de l'axe de la terre. Mais quelle en est la cause physique ? Il n'est pas si facile de la trouver ; on doit même avouer que dans le système de M. Newton on ne peut guère en apporter d'autres, que la volonté du Créateur ; mais il ne paroît pas que dans les autres systèmes on explique plus heureusement ce phénomene.
M. Pluche, auteur du Spectacle de la Nature, prétend que l'axe de la terre n'a pas toujours été incliné au plan de l'écliptique ; qu'avant le déluge, il lui étoit perpendiculaire, & que les hommes jouissoient alors d'un printems perpétuel ; que Dieu voulant les punir de leurs désordres & les détruire entierement, se contenta d'incliner quelque peu l'axe de la terre vers les étoiles du nord, que par ce moyen l'équilibre des parties de l'athmosphere fut rompu, que les vapeurs qu'elle contenoit retomberent avec impétuosité sur le globe, & l'inonderent. On ne voit pas trop sur quelles raisons M. Pluche, d'ailleurs ennemi déclaré des systèmes, a appuyé celui-ci : aussi a-t-il trouvé plusieurs adversaires ; un d'entr'eux a fait imprimer dans les mémoires de Trévoux de 1745 plusieurs lettres contre cette opinion.
Quoi qu'il en soit, il y a réellement dans l'axe de la terre, en vertu de l'action de la lune & du soleil, un mouvement de libration ou de balancement, mais ce mouvement est très-petit ; & c'est celui qu'on appelle plus proprement nutation. Voyez NUTATION. (O)
LIBRATION, (Peinture). Voyez PONDERATION.
|
| LIBRE | adj. (Gram.) Voyez les articles LIBERTE.
LIBRES, s. m. pl. (Théol.) On donna ce nom à des hérétiques, qui dans le seizieme siecle suivoient les erreurs des Anabaptistes, & prenoient ce nom de libres, pour secouer le joug du gouvernement ecclésiastique & séculier. Ils avoient les femmes en commun, & appelloient spirituels les mariages contractés entre un frere & une soeur ; défendant aux femmes d'obéir à leurs maris, lorsqu'ils n'étoient pas de leur secte. Ils se croyoient impeccables après le baptême, parce que selon eux, il n'y avoit que la chair qui péchât, & en ce sens ils se nommoient les hommes divinisés. Prateole. Voyez LIBERI. Gautier, chron. sect. 16. c. 70.
LIBRE, (Ecrivain), est en usage dans l'écriture pour désigner un style vif, un caractere coulant libre, une main qui trace hardiment ses traits. Voyez nos Planches d'Ecriture & leur explication, tome II. part. II.
LIBRE, parmi les Horlogers, se dit d'une piece ou d'une roue, &c. qui a de la liberté. Voyez LIBERTE, JEU, &c.
|
| LIBRIPEUS | S. m. (Hist. anc.) C'étoit dans chaque ville un essayeur des monnoies d'or & d'argent ; les Grecs avoient une fonction pareille. On donnoit le même nom à celui qui pesoit la paye des soldats, & à celui qui tenoit la balance, lorsqu'on émancipoit quelqu'un à prix d'argent. D'où l'on voit que dans ces circonstances & d'autres, l'argent ne se comptoit pas, mais se pesoit.
|
| LIBUM | S. m. (Hist. anc.) gâteau de sesame, de lait & de miel, dont on se servoit dans les sacrifices, sur-tout dans ceux qu'on faisoit à Bacchus & aux Lares, & à la fête des termes. Libum Testativum, se disoit de Testa, ou du vaisseau où le gâteau se cuisoit.
|
| LIBURNE | S. m. Liburnus, (Hist. rom.) huissier qui appelloit les causes qu'on devoit plaider dans le barreau de Rome ; c'est ce que nous apprenons de Martial qui tâche de détourner Fabianus, homme de bien, mais pauvre, du dessein de venir à Rome où les moeurs étoient perdues ; procùl horridus liburnus ; & Juvenal dans sa quatrieme Satyre,
Primus, clamante liburno,
Currite, jàm sedit.
L'empereur Antonin décida dans la loi VII. ff. de integ. restit. que celui qui a été condamné par défaut, doit être écouté, s'il se présente avant la fin de l'audience, parce qu'on présume qu'il n'a pas entendu la voix de l'huissier, liburni. Il ne faut donc pas traduire liburnus par crieur public, comme ont fait la plûpart de nos auteurs, trop curieux du soin d'appliquer tous les usages aux nôtres. (D.J.)
LIBURNE, s. f. (Arch. nav.) liburna dans Horace, liburnica dans Suetone & dans Lucain ; sorte de frégate légere, de galiote, ou de brigantin à voiles & à rames, qu'employoient les Liburniens pour courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que les liburnes servoient beaucoup en guerre pour des pirateries, à cause qu'elles étoient bonnes voilieres. La flotte d'Octave en avoit un grand nombre qui lui furent très-utiles à la bataille d'Actium. Végece prétend qu'elles étoient de différentes grandeurs, depuis un rameur jusqu'à cinq sur chaque rame ; mais nous ne comprenons rien à la disposition & à l'arrangement de ces rangs de rames, dont plusieurs auteurs ont tâché de nous représenter la combinaison. Il ne s'agit pas ici d'une spéculation stérile, il s'agit d'une exécution pratique. (D.J.)
|
| LIBURNIE | Liburnia, (Géog. anc.) province de l'Illyrie, le long de la mer Adriatique, aux confins de l'Italie. Elle est entre l'Istrie & la Dalmatie, & s'étend depuis le mont Albius, jusqu'à la mer Adriatique. Le fleuve Arsia la séparoit de l'Istrie, & le fleuve Titius, de la Dalmatie. Ptolemée vous indiquera les villes de la Liburnie, & les îles adjacentes. Le P. Briet prétend que les Liburniens occupoient la partie occidentale de la Dalmatie, & indique leurs villes. Il paroît que la Croatie remplace aujourd'hui l'ancienne Liburnie.
Nous savons encore plus sûrement, que ce peuple avoit autrefois passé la mer, & possédé une partie de la côte orientale d'Italie ; il en fut chassé de même que les Sicules, par les Ombres ; ceux-ci en furent dépossédés à leur tour par les Etrusques, & les Etrusques par les Gaulois. Comme ils se servoient de petits vaisseaux légers, de différentes grandeurs, on donna le nom de Liburnes à tous les vaisseaux de même construction en ce genre. (D.J.)
|
| LIBURNUM | S. n. (Littér.) sorte de chaise roulante chez les Romains, ou plutôt de litiere, fort commode pour lire, écrire & dormir. On leur donna ce nom, parce qu'elles avoient la figure d'une frégate liburnienne. (D.J.)
|
| LIBYAEGYPTII | (Géogr. anc.) ancien peuple de la Lybie proprement dite ; les Nitriotes & les Oasites en faisoient partie ; on connoît à-présent les deserts de Nitrie, & la situation d'Oasis ; ainsi l'on est au fait des Lybyaegyptiens. (D.J.)
|
| LIBYCA OSTIA | (Géogr. anc.) Pline, l. III. c. jv. nomme ainsi les deux moyennes embouchures du Rhône ; ce sont celles qui forment la Camargue ; ces deux embouchures avoient outre ce nom commun, leur nom particulier ; l'une s'appelloit Hispaniense ostium, & l'autre Metapinum ostium. (D.J.)
|
| LIBYCUM MARE | c'est-à-dire la mer de Libye, (Géog. anc.) Les anciens nommoient ainsi la côte de la mer Méditerranée, qui étoit le long de la Libye maréotide. Elle étoit bornée au levant par la mer d'Egypte, & au couchant par la mer d'Afrique. (D.J.)
|
| LIBYE | LA, (Géog. anc.) Les Grecs ont souvent employé ce mot pour désigner cette partie du monde que nous appellons présentement Afrique, qui n'étoit alors que le nom d'une de ses provinces. Les poëtes latins se sont conformés à cet usage, & ont pris la Libye pour l'Afrique en général, ou pour des lieux d'Afrique qui n'étoient pas même de la Libye proprement dite. Virgile dit dans son Aenéide, l. I. v. xxij.
Hinc populum latè regem, belloque superbum
Venturum excidio Libyae.
On voit bien que le poëte parle ici de Carthage favorisée de Junon, & dont la ruine devoit être l'ouvrage des Romains.
Il y avoit cependant en Afrique des pays auxquels le nom de Libye étoit propre dans l'esprit des Géographes : telle étoit la Maréotide, ou la Libye maréotide, pays situé entre Alexandrie & la Cyrénaïque. Cette Libye répondoit en partie à la Marmarique de Ptolémée.
Ce géographe, l. IV. c. jv. appelle aussi Libye intérieure, un vaste pays d'Afrique, borné au nord par les trois Mauritanies & la Cyrénaïque, & par l'Ethiopie ; au midi, par le golfe de l'Océan, qui est aujourd'hui le grand golfe de Guinée. Nous sommes dispensés d'insérer ici le chapitre ou Ptolémée traite de ce pays, 1°. parce qu'il est très-long, & que nous devons être très-concis. 2°. Parce que du tems de Ptolémée on n'avoit qu'une connoissance très-superficielle de ce pays, & que de nos jours nous ne sommes guere plus éclairés. Nous remarquerons seulement que la Libye étoit anciennement un des greniers de l'Italie, à cause de la grande quantité de blé qu'on en tiroit. Elle en fournissoit à Rome quarante millions de boisseaux par an, pour la subsistance pendant huit mois de l'année.
|
| LIBYPHAENICES | (Géog. anc.) ou LIBOPHENICES, suivant Diodore, l. XX. Pline, Solin, & Marianus Capella nomment ainsi les Phéniciens établis en Afrique. Cette dénomination désignoit les Carthaginois ; mais elle pouvoit aussi distinguer les Phéniciens établis en Afrique, des Syro-Phéniciens, c'est-à-dire des Phéniciens qui étoient demeurés en Syrie, dont la Phénicie faisoit partie.
|
| LIBYSSA | (Géog. anc.) Libyssa selon Pline, & Libyssa selon Ptolémée, ancienne ville maritime d'Asie, dans la Bithynie. Pline dit que cette ville n'existoit déjà plus de son tems, & qu'on n'y voyoit que le tombeau d'Annibal, dont Plutarque parle au long dans la vie de Flaminius. Ce fut à Libyssa selon Eutrope, que ce grand capitaine termina sa carriere par le poison, & qu'il sut éviter en mourant volontairement, la douleur d'être livré par Prusias aux Romains.
Libyssa n'étoit qu'une bourgade du tems d'Annibal ; son tombeau l'illustra ; il s'y forma une ville qui fut fortifiée avec le tems. Belon même croit avoir vû le tombeau du vainqueur de Flaminius & de Terentius Varro ; selon lui, ce lieu se nomme Diaribe. Pierre Gilles prétend que ce lieu est un simple village qu'il appelle Diacibyssa.
Appien ne connoît en cet endroit ni ville, ni bourg, ni village ; il n'a vû qu'une riviere nommée Libyssus. Mais qui empêche qu'il n'y ait eu un village, une ville, une campagne, & une riviere de même nom, dans un endroit qu'Annibal avoit choisi pour sa retraite ?
|
| LICATE LA | en latin Leocata, (Géog.) petite ville de Sicile, dans la vallée de Noto, dans un pays fertile en blé, avec un port sur la côte méridionale. Elle est sur les confins de la vallée de Mazara, & s'avance dans la mer en forme de presqu'île, à l'embouchure de la riviere de Salso. Long. 30. 15. lat. 37. 44.
|
| LICATII | (Géograph. anc.) ou LICATES selon Pline, liv. III. ch. xx. ancien peuple de la Vindélicie, dont Auguste triompha. Ptolémée les met au bord du Lycias, aujourd'hui la riviere de Lecke. (D.J.)
|
| LICE | S. f. (Gramm.) champ clos ou carriere où les anciens chevaliers combattoient soit à outrance, soit par galanterie, dans les joûtes & les tournois. C'est aussi une simple carriere à courre la bague, & à disputer le prix de la course à pié ou à cheval. Lice dans les maneges est une barriere de bois qui borde & termine la carriere du manege.
LICES, (Venerie) on appelle ainsi les chiennes courantes.
|
| LICÉ | ou LYCÉE, (Hist. philosoph.) en Architecture, étoit une académie à Athènes où Platon & Aristote enseignoient la Philosophie. Ce lieu étoit orné de portiques & d'arbres plantés en quinconces. Les philosophes y disputoient en se promenant.
|
| LICENCE | S. f. (Gramm. Littérat. & Morale) relâchement que l'on se permet contre les lois des moeurs ou des Arts. Il y a donc deux sortes de licence, & chacune des deux peut être plus ou moins vicieuse, ou même ne l'être point du tout.
Les grands principes de la Morale sont universels ; ils sont écrits dans les coeurs, on doit les regarder comme inviolables, & ne se permettre à leur égard aucune licence, mais on ne doit pas s'attacher trop minutieusement aux dernieres conséquences que l'on en peut tirer, ce seroit s'exposer à perdre de vûe les principes mêmes.
Un homme qui veut, pour ainsi dire, chicaner la vertu & marquer précisément les limites du juste & de l'injuste, examine, consulte, cherche des autorités, & voudroit trouver des raisons pour s'assurer, s'il est permis, par exemple, de prendre cinq pour cent d'intérêt pour de l'argent prêté à six mois ; & quand il a ou qu'il croit avoir là-dessus toutes les lumieres nécessaires, il prête à cinq pour cent tant que l'on veut, mais ni à moins, ni sans intérêt, ni à personne qui n'ait de bonnes hypotheques à lui donner.
Un autre moins scrupuleux sur les petits détails, sait seulement que si tout ne doit plus être commun entre les hommes parce qu'il y a entr'eux un partage fait & accepté, qu'au moins il faut, quand on aime ses freres, tâcher de rétablir l'égalité primitive. En partant de ce principe, il prête quelquefois à moins de cinq pour cent, quelquefois sans intérêt, & souvent il donne. Il s'accorde une licence par rapport à la loi de l'usage, mais cette licence ainsi rachetée n'est-elle pas louable ?
On appelle licences dans les Arts, des fautes heureuses, des fautes que l'on n'a pas faites sans les sentir, mais qui étoient préférables à une froide régularité : ces licences, quand elles ne sont pas outrées, sont pour les grands génies, comme celles dont je viens de parler sont pour les grandes ames.
Dans les licences morales il faut éviter l'éclat, il faut éviter les yeux des foibles, il faut faire au dehors à-peu-près ce qu'ils font ; mais pour leur propre bonheur, penser & se conduire autrement qu'eux.
La licence en Théologie, en Droit, en Medecine, est le pouvoir que l'on acquiert de professer ces sciences & de les enseigner : ce pouvoir s'accorde à l'argent & au mérite, quelquefois à l'un des deux seulement. De licence on a fait le mot licencieux, produit par la licence. La signification de ce mot est plus étendue que celle du substantif d'où il dérive ; il exprime un assemblage de licences condamnables. Ainsi des discours licencieux, une conduite licencieuse sont des discours & une conduite où l'on se permet tout, où l'on n'observe aucune bienséance, & que par conséquent l'on ne sauroit trop soigneusement éviter.
LICENCE, (Jurisprud. & Théolog.) signifie congé ou permission accordée par un supérieur dans les universités. Le terme de licence signifie quelquefois le cours d'étude au bout duquel on parvient au degré de licencié ; quelquefois par ce terme on entend le degré même de licence. L'empereur Justinien avoit ordonné que l'on passeroit quatre ans dans l'étude des lois. Ceux qui avoient satisfait à cette obligation étoient dit avoir licence & permission de se retirer des études : c'est de là que ce terme est usité en ce sens.
Le degré de licence est aussi appellé de cette maniere, parce qu'on donne à celui qui l'obtient la licence de lire & enseigner publiquement, ce que n'a pas un simple bachelier. Voyez ci-après LICENCIE. (A)
LICENCE poëtique, (Belles-lettres) liberté que s'arrogent les Poëtes de s'affranchir des regles de la Grammaire.
Les principales licences de la poésie latine, consistent dans le diastole ou l'allongement des syllabes breves, dans le systole ou l'abrégement des syllabes longues, dans l'addition ou pléonasme, dans le retranchement ou apherese, dans les transpositions ou métathese : desorte que les poëtes latins manient les mots à leur gré, & sont en état de former des sons qui peignent les choses qu'ils veulent exprimer. Horace se plaignoit que les poëtes de son tems abusoient de ces licences, & data romanis venia est indigna poetis. Aussi a-t-on dépouillé peu-à-peu les Poëtes de leurs anciens privileges.
Les poëtes grecs avoient encore beaucoup plus de liberté que les latins : cette liberté consiste en ce que, 1°. ils ne mangent jamais la voyelle devant une autre voyelle du mot suivant, que quand ils mettent l'apostrophe ; 2°. ils ne mangent point l'm devant une voyelle ; 3°. ils usent souvent de synalephe, c'est-à-dire qu'ils joignent souvent deux mots ensemble ; 4°. leurs vers sont souvent sans césure ; 5°. ils emploient souvent & sans nécessité le vers spondaïque ; 6°. ils ont des particules explétives qui remplissent les vuides ; 7°. enfin ils emploient les différens dialectes qui étendent & resserrent les mots, font les syllabes longues ou breves, selon le besoin du versificateur. Voyez DIALECTE.
Dans la versification françoise on appelle licence certains mots qui ne seroient pas reçus dans la prose commune, & qu'il est permis aux Poëtes d'employer. La plûpart même de ces mots, sur-tout dans la haute poésie, ont beaucoup plus de grace & de noblesse que ceux dont on se sert ordinairement ; le nombre n'en est pas grand, voici les principaux : les humains ou les mortels pour les hommes ; forfait pour crime ; glaive pour épée ; les ondes pour les eaux ; l'Eternel au lieu de Dieu, ainsi des autres qu'on rencontre dans nos meilleurs poëtes. (G)
LICENCES en Peinture, ce sont les libertés que les Peintres prennent quelquefois de s'affranchir des regles de la perspective & des autres lois de leur art. Ces licences sont toujours des fautes, mais il y a des licences permises, comme de faire des femmes plus jeunes qu'elles n'étoient lorsque s'est passé la scene qu'on représente ; de mettre dans un appartement ou dans un vestibule celles qui se sont passées en campagne, lors cependant que le lieu n'est pas expressément décidé ; de rendre Dieu, les saints, les anges ou les divinités payennes témoins de certains faits, quoique les histoires sacrées ou prophanes ne nous disent point qu'ils y aient assisté, &c. Ces licences sont toujours louables, à proportion qu'elles produisent de beaux effets.
|
| LICENCIÉ | LICENCIé
Ce degré de licence revient à-peu-près au titre de que du tems de Justinien les étudians en Droit prenoient à la fin de la cinquieme & derniere année de leur cours d'étude ; ce titre signifiant des gens qui sont capables d'enseigner les autres.
L'édit du mois d'Avril 1679, portant réglement pour le tems des études en Droit, ordonne entr'autres choses, que nul ne pourra prendre aucuns degrés ni lettres de licence en Droit canonique ou civil dans aucune des facultés du royaume, qu'il n'ait étudié trois années entieres à compter du jour qu'il se sera inscrit sur le registre de l'une desdites facultés ; qu'après avoir été reçu bachelier, pour obtenir des lettres de licence, on subira un second examen à la fin de ces trois années d'études, après lequel le récipiendaire soutiendra un acte public.
Les lettres de licence sont visées par le premier avocat général avant que le licencié soit admis à prêter le serment d'avocat.
Ceux qui ont atteint leur vingt-cinquieme année peuvent, dans l'espace de six mois, soutenir les examens & actes publics, & obtenir les degrés de bachelier & de licencié à trois mois l'un de l'autre.
Dans quelques universités, le degré de licencié se confond avec celui de docteur ; cela a lieu sur-tout en Espagne & dans quelques universités de France qui avoisinent ce même pays. Voyez BACHELIER, DROIT, DOCTEUR, FACULTE DE DROIT. (A)
|
| LICENCIEMENT | S. m. (Art milit.) c'est l'action de réformer des corps de troupes en tout ou en partie, de congédier & renvoyer dans leurs paroisses les soldats qui le composent.
En France les inspecteurs généraux d'infanterie & de cavalerie sont chargés de cette opération pour les troupes reglées, les intendans des provinces pour les milices.
Troupes réglées. Lorsqu'il s'agit de licencier quelques compagnies d'un corps, l'inspecteur commence par incorporer les moins anciennes ou les plus foibles dans les autres, qu'il complete des soldats les plus en état de servir ; il tire ensuite des compagnies conservées les soldats qui se trouvent ou incapables de continuer leur service, ou dans le cas d'entrer à l'hôtel des Invalides : après eux les soldats les moins bons à conserver, & sur-tout ceux de nouvelle recrue, comme étant moins propres à entretenir dans le corps l'esprit de valeur qu'ils n'ont pu encore acquérir, & plus capables de reprendre le travail de la terre ; enfin ceux qui par l'ancienneté de leur service ont droit de prétendre d'être congédiés les premiers, & de préférence les hommes mariés. Les capitaines ne peuvent rien répéter aux soldats congédiés du prix de leurs engagemens, étant, dans le licenciement, renvoyés comme surnuméraires.
Les réformés sont ensuite partagés par bandes, suivant leurs provinces, & conduits sans armes sur des routes avec étape, par des officiers chargés de leurs congés, qu'ils leur remettent successivement dans les lieux de la route les plus à portée de leurs villages. Pour leur faciliter les moyens de s'y rendre, le roi leur fait payer en même tems trois livres de gratification à chacun, leur laissant de plus l'habit uniforme & le chapeau. Ils doivent s'y acheminer immédiatement après la délivrance de leurs congés, sous peine, à ceux qui sont rencontrés sur les frontieres sortant du royaume pour passer à l'étranger, d'être arrêtés & punis comme deserteurs ; & à ceux qui s'arrêtent dans les villages de la route sans raison légitime, d'être arrêtés comme vagabonds.
A l'égard des soldats licenciés des régimens étrangers au service de sa majesté, on les fait conduire sur des routes par des officiers jusqu'à la frontiere, où ils reçoivent une gratification en argent pour leur donner moyen de gagner leur pays.
Nous avons l'expérience qu'au moyen de ces prudentes mesures, les réformes les plus nombreuses n'ont pas causé le moindre trouble à la tranquillité publique.
Les précautions sont les mêmes dans les réformes de la cavalerie & des dragons ; les inspecteurs y ajoûtent, par rapport aux chevaux, l'attention de faire tuer tous ceux qui sont soupçonnés de morve, de faire brûler leurs équipages, & de réformer toutes les jumens, pour être distribuées & vendues dans les campagnes.
Lorsque le licenciement est peu considérable, ou que les réformés se trouvent de provinces différentes & écartés les uns des autres de maniere à ne pouvoir être rassemblés pour marcher ensemble, les inspecteurs les laissent partir seuls, & en ce cas leur font délivrer la subsistance en argent à proportion de l'éloignement des lieux où ils doivent se rendre, outre la gratification ordonnée.
Au moment du licenciement on fait visiter les réformés soupçonnés de maux vénériens, de scorbut ou autres maladies contagieuses ; & ceux qui s'en trouvent atteints, sont traités avant leur départ, & guéris dans les hôpitaux militaires.
Milices. Pour exécuter le licenciement d'un bataillon de milice, l'intendant commence par en constater l'état par une revûe, en distinguant les miliciens de sa généralité de ceux qui n'en sont pas ; il complete les compagnies de grenadiers & de grenadiers postiches, avec ce qu'il y a de plus distingué, de mieux constitué, & de meilleure volonté dans les soldats des autres compagnies ; il délivre des congés absolus à l'excédent du complet, en les donnant d'abord aux miliciens étrangers à la province, ensuite aux plus anciens miliciens de la province & aux plus âgés de même date de service ; il conserve les sergens & grenadiers royaux qui ont la volonté de continuer à servir, fait déposer en magasin les habits, armes & équipemens des soldats, & sépare le bataillon, jusqu'à ce qu'il plaise au roi d'en ordonner l'assemblée, soit pour être employé à son service, soit seulement pour passer en revûe & être exercé pendant quelques jours aux manoeuvres de guerre. Voy. LEVEES DE TROUPES.
Dans plusieurs généralités, les intendans, lors du licenciement, congédient par préférence, comme surnuméraires & sans distinction d'ancienneté de service de milice, tous les hommes mariés que des conjonctures forcées ont obligé d'y entrer.
On permet, par distinction, aux sergens & grenadiers d'emporter leurs habits, à charge de les tenir & représenter en bon état.
Lors du renvoi des miliciens, on leur paie trois jours de solde après celui de la séparation, pour leur donner moyen de se retirer chez eux.
Tant que dure la séparation des bataillons de milice, le roi accorde trois sols par jour aux sergens des compagnies de grenadiers royaux, un sol aux grenadiers, dix-huit deniers aux tambours desdites compagnies, & deux sols aux sergens des compagnies de grenadiers postiches & de fusiliers.
Les miliciens qui ont servi six années & obtenu leur congé absolu, ne peuvent plus être assujettis au service de la milice ; ils jouissent de l'exemption de la taille pendant l'année de la date de leur congé, en vertu de certificats qui leur sont à cet effet délivrés par les intendans ; & ceux qui se marient dans le cours de cette année, jouissent de ce privilege encore deux années de plus.
L'exemption a lieu tant pour la taille industrielle que pour la personnelle, pour leurs biens propres ou ceux du chef de leurs femmes ; & dans le cas où ils prendroient pendant ce tems des fermes étrangeres, ils sont, pour raison de leur exploitation, taxés d'office modérément par les intendans.
Dans les provinces où la taille est réelle, ils y sont sujets, mais exempts des impositions extraordinaires.
Pendant leur service les miliciens doivent être diminués de dix livres sur leurs cottes personnelles pour chaque année ; ils sont aussi exempts de capitation & de collecte pendant ce tems, s'ils ne font valoir que leurs biens propres, & leurs peres de collecte pour le même tems, pendant lequel encore leur cotte à la taille ne peut être augmentée.
Ceux qui ont été incorporés dans les troupes doivent jouir des mêmes exemptions.
C'est par ces adoucissemens qu'on tempere, autant qu'il est possible, la rigueur du service forcé du milicien, & la sévérité d'un état auquel il ne s'est pas voué volontairement.
Lors de la séparation des bataillons, on a, pour les miliciens attaqués de maladies contagieuses, la même attention que pour les soldats réformés des autres troupes ; on les fait recevoir, traiter & guérir dans les hôpitaux du roi, avant de permettre leur retour dans les paroisses. Cette sage précaution est aussi glorieuse au prince qu'avantageuse à l'humanité.
L'évenement d'un licenciement desiré par le soldat, est une espece de disgrace pour l'officier. Il nous reste à dire un mot sur le sort des guerriers malheureux qui s'y trouvent enveloppés.
L'inspecteur examine d'abord les officiers qui par leur âge, leurs blessures ou leurs infirmités sont reconnus hors d'état de continuer à servir, & dans le cas de mériter des pensions de retraite ou d'être admis à l'hôtel des invalides ; sur les mémoires qui en sont dressés, il y est pourvu par le ministere, suivant l'exigence des cas.
Lorsque la réforme du corps est générale, tous les autres officiers sont renvoyés dans leurs provinces, où ils jouissent d'appointemens de réforme suivant leurs grades, à l'exception des lieutenans les moins anciens, qui n'ont pu encore mériter cette récompense par leurs services.
S'il ne s'agit que d'une simple réduction de compagnies, le principe est de placer, dans l'arrangement du corps, les plus anciens capitaines à la tête des compagnies conservées ; les moins anciens aux places de capitaines en second ; après eux les plus anciens lieutenans, & de préférence tous les maréchaux des logis ou sergens qui, par la distinction ou ancienneté de leurs services, ont été élevés au grade d'officier. Si quelques circonstances ne permettent pas de conserver ces officiers de fortune, le roi, dans ce cas, leur accorde quinze sols par jour pour les aider à subsister pendant la paix.
Les lieutenans les moins anciens sont renvoyés dans leurs provinces, avec une gratification pour leur donner moyen de s'y rendre, en attendant que les circonstances permettent de les rappeller au service.
Nous nous bornons à ces connoissances générales sur les opérations des deux sortes de licenciemens, & renvoyons aux ordonnances militaires pour les autres détails qui y ont rapport. Cet article est de M. DURIVAL cadet.
|
| LICENTEN | (Comm.) licence, permission. Ce terme est usité en Hollande, pour signifier les passeports qu'on délivre dans les bureaux des convois ou douannes, pour pouvoir charger ou décharger les marchandises des vaisseaux qui entrent ou sortent par mer, ou celles qui se voiturent par terre : il signifie aussi les droits d'entrée & de sortie. Diction. de Commerce.
|
| LICHANOS | S. f. est en Musique le nom que donnoient les Grecs à la troisieme corde de chacun de leurs deux premieres tétracordes ; parce que cette troisieme corde se touchoit de l'index. Lichanos, dit Boëce, idcirco, quoniam Lichanos dicitur, quem nos indicem vocamus.
La troisieme corde à l'aigu, du plus bas tétracorde qui étoit celui des hypates, s'appelloit quelquefois lichanos hypaton, quelquefois hypaton diatonos, enharmonios, ou cromatiké, selon le genre. Celle du second tétracorde, ou du tétracorde des moyennes, s'appelloit lichanos meson, ou meson diatonos, &c. Voyez TETRACORDE. (S)
|
| LICHAS | (Géog. an.) rocher qui étoit entre l'Eubée & la Grece propre. On connoit l'origine fabuleuse qu'Ovide lui donne dans ses métamorphoses, l. IX. v. 226 & suiv. Strabon dit que les Lichades, ainsi nommées de Lichas, étoient au nombre de trois, qu'il place sur la côte des Locres Epicnémédiens.
|
| LICHE | S. f. (Hist. nat. Ichnolog.) glaucus secundus. Rond. Poisson de mer ; on le nomme pélamide en Languedoc. Il differe de la biche, en ce qu'il n'est pas si grand. Voyez BICHE. Il a sur le dos sept aiguillons, dont la pointe est dirigée en arriere, & un trait qui s'étend en serpentant depuis les ouies jusqu'au milieu du corps, & de là en ligne droite jusqu'à la queue ; le corps est plus étroit que celui de la biche. Il n'y a point de taches noires sur les nageoires du dessus & du dessous ; au reste ces deux poissons se ressemblent. Rond. hist. des pois. liv. VIII. Voyez POISSONS.
|
| LICHEN | S. m. (Hist. nat. Botan.) genre de plante qui n'a point de fleur ; son fruit a la forme d'un bassin. Il contient une poussiere ou semence qui paroît être arrondie, lorsqu'on la voit au microscope. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LICHEN de Grece, (Botan. exot.) espece de lichen qui sert à teindre en rouge. M. de Tournefort qui en a donné le premier la description, le nomme lichen graecus, polypoïdes, tinctorius, Coroll. 40.
Il croît par bouquets grisâtres, longs d'environ deux ou trois pouces, divisés en petits brins, presque aussi menus que du crin, & partagés en deux ou trois cornichons, déliés à leur naissance, arrondis, & roides, mais épais de près d'une ligne dans la suite, courbés en faucille, & terminés quelquefois par deux pointes : ces cornichons sont garnis dans leurs longueurs d'un rang de bassins plus blancs que le reste, de demi-ligne de diamètre, relevés de petites verrues, semblables aux bassins du polype de mer ; toute la plante est solide, blanche, & d'un goût salé.
Elle n'est pas rare dans les îles de l'Archipel, mais son usage pour la teinture n'est connu qu'à Amorgos.
Elle vient sur les rochers de cette île, & sur ceux de Nicomia. Il y a beaucoup d'apparence qu'elle servoit autrefois à mettre en rouge les tuniques d'Amorgos, qui étoient si recherchées. Cette plante se vendoit encore dans l'Archipel sur la fin du dernier siecle, dix écus le quintal, ce qui feroit vingt écus de nos jours ; on la transportoit à Aléxandrie & en Angleterre, pour l'employer à teindre en rouge, comme on se servoit en France de la parelle d'Auvergne ; mais l'usage de la cochenille a fait tomber toutes les teintures que les plantes peuvent fournir. (D.J.)
|
| LICHI | S. m. (Botan. exot.), fruit très-commun & très-estimé à la Chine ; je trouve son nom écrit lici, letchi, litchi, lithi, ou bien en deux syllabes séparées, li-chi, li-ci, let-chi, lit-chi, li-thi ; ce ne seroit rien, si j'en trouvois des descriptions uniformes & instructives dans les relations de nos missionnaires, mais il s'en faut de beaucoup ; la plûpart seulement s'accordent à dire, que c'est le fruit d'un arbre grand & élevé, dont les feuilles ressemblent à celles du laurier ; & que c'est aux extrémités des branches, qu'il produit ce fruit comme en grappes, beaucoup plus claires que celles du raisin, & pendant à des queues plus longues.
Le lichi est de la grosseur d'un petit abricot, oblong, mollet, couvert d'une écorce mince, chagrinée, de couleur ponceau éclatant, contenant un noyau blanc, succulent, de très-bon goût & d'une odeur de rose ; le P. Boym a fait graver la figure de ce fruit dans sa flora sinensis, mais elle ne s'accorde point avec d'autres descriptions plus modernes.
Le lichi vient dans les provinces de Canton, de Fokien, & autres provinces méridionales. Les Chinois l'estiment singulierement pour le goût & pour les qualités bienfaisantes ; car ils assurent qu'il donne de la force & de la vigueur sans échauffer, hormis qu'on n'en mange avec excès. Le P. Dentrecolles ajoute dans les lettres édifiantes, tome XXIV. qu'il en est de ce fruit comme de nos melons de l'Europe, que pour l'avoir excellent, il faut le manger sur le lieu même, & le cueillir dans son point de maturité, très-difficile à attraper, parce qu'il n'a qu'un moment favorable. Cependant comme dans tout l'empire on fait grand cas de ce fruit sec, on le laisse sécher dans sa pellicule, où il se noircit & se ride comme nos pruneaux. On en mange toute l'année par cette méthode ; on le vend à la livre, & l'on en met dans le thé pour procurer à cette liqueur un petit goût aigrelet.
Les lichi qu'on apporte à Péking pour l'empereur, & qu'on renferme dans des vases pleins d'eau-de-vie, où l'on mêle du miel & d'autres ingrédiens, conservent bien un air de fraîcheur, mais ils perdent beaucoup de la finesse, & de l'excellence de leur goût.
Le noyau du lichi un peu roti & réduit en poudre fine, passe chez les Chinois pour un spécifique contre les douleurs de gravelle & de colique néphrétique. On voit par-là, que l'on met sa confiance à la Chine, ainsi qu'en Europe, dans tous les remedes de bonnes femmes ; les maux finissent, & les remedes inutiles ou ridicules se maintiennent en crédit. (D.J.)
|
| LICHNOIDE | Lichnoïdes, (Bot.) genre de plante à fleurs sans pétales, ressemblantes en quelque maniere à une silique, creuses & remplies d'air entre chaque noeud. Ces fleurs sont stériles & nues ; elles n'ont point de calice, de pistil, ni d'étamines ; elles sont renfermées & réunies dans une masse gélatineuse. On trouve une, ou deux, ou trois de ces masses dans des loges creuses, trouées par le haut & formées par la substance de la plante même. On n'en connoît pas encore les semences. Nova plantarum genera, &c. par M. Micheli.
|
| LICHO | (Géog. anc.) riviere de l'Asie mineure, qui est le Lycus de Phrygie, dont Laodicée sur le Lycus prenoit le nom. Voyez LAODICEE sur le Lycus ; LYCUS. (D.J.)
|
| LICHOS | (Géog. anc.) fleuve de la Phénicie, selon Pomponius Mela, liv. I. ch. xij. c'est aussi le Lycos de Pline. (D.J.)
|
| LICHTEN | S. m. (Comm.) petits bâtimens qui servent à Amsterdam pour le transport des marchandises du magasin au port, ou du port au magasin. Ce sont des especes d'alleges de 30 à 36 lasts de grains ; c'est encore la voiture des blés, & des sels, &c. Dict. de Comm.
|
| LICHTENBERG | (Géog.) ce n'est qu'un château de France dans la basse-Alsace ; mais ce château est le chef-lieu d'un comté de même nom. Il est sur un rocher près des montagnes de Vosges, à cinq lieues de Haguenau. Long. 25 d. 9'. 55''. lat. 48 d. 55'. 12''. (D.J.)
|
| LICHTENSTEIN | ou LIECHTENTEIG, (Géog.) ville de Suisse dans le Tockembourg, remarquable parce que le conseil du pays s'y tient. Elle est sur le Thour : long. 26. 50. lat. 47. 25. (D.J.)
|
| LICHTSTALL | ou LIECHSTALL, (Géog.) Quelques françois portés à estropier tous les noms, ont rendu celui-ci méconnoissable, en écrivant Liefstall ; c'est une jolie petite ville de Suisse au canton de Bâle, sur l'Ergetz, à 3 lieues de Bâle : long. 25. 32. lat. 47. 50. (D.J.)
|
| LICITATION | S. f. (Jurisprud.) est l'acte par lequel un immeuble commun à plusieurs personnes, & qui ne peut se partager commodément, est adjugé à l'un d'entr'eux, ou même à un étranger.
L'usage de la licitation a été emprunté des Romains ; il remonte jusqu'à la loi des XII. tables, qui porte que les biens sujets à licitation, sont ceux qui ne peuvent se partager commodément, ou que l'on n'a pas voulu partager.
Cette loi met dans la même classe les associés & les co-héritiers.
L'édit perpétuel s'en explique de même, liv. X.
Le principe de la licitation se trouve dans la loi 5, au cod. communi dividundo, qui est que in communione vel societate nemo compellitur invitus detineri.
Cette même loi décide qu'il n'importe à quel titre la chose soit commune entre les co-propriétaires, soit cum societate vel sine societate.
Pour être en droit de provoquer la licitation d'un héritage ou autre immeuble, il n'est pas nécessaire qu'il y ait impossibilité physique de le partager ; il suffit que l'on soit convenu de ne point partager la chose, ou qu'en la partageant, il y eût de l'incommodité ou de la perte pour quelqu'un des co-propriétaires.
La licitation est toûjours sous-entendue dans la demande à fin de partage, c'est-à-dire, que si le partage ne peut se faire commodément, ce sera une suite nécessaire d'ordonner la licitation.
Dès que les co-propriétaires ont choisi cette voie, on présume qu'il y auroit eû pour eux de l'inconvénient d'en user autrement, attendu que chacun aime assez ordinairement à prendre sa part en nature.
Chez les Romains, on ne pouvoit liciter sans une estimation préalable, comme il résulte des termes de l'édit perpétuel de la loi 3, communi dividundo.
Pour faire un partage ou une licitation, il falloit se pourvoir devant le juge qui donnoit des arbitres ou experts, & qui adjugeoit sur leur avis.
Les notaires ne les pouvoient pas faire, parce qu'ils n'avoient pas la jurisdiction volontaire comme ils l'ont parmi nous ; les partages ou licitations se faisoient par adjudication de portion : or il n'y avoit que le magistrat qui pût se servir de ces termes, do, addico ; & pour la licitation, il disoit ad talem summam condemno.
Les étrangers n'étoient admis aux encheres, que quand les co-propriétaires déclaroient n'être pas en état de porter la licitation au prix où elle devoit monter, ce que l'on n'exige point parmi nous ; il suffit que les propriétaires y consentent.
On a aussi retranché dans notre usage à l'égard des majeurs, l'obligation de liciter devant le juge. La licitation peut se faire à l'amiable devant un notaire, ou en justice.
Il n'est plus pareillement besoin d'un rapport préalable, pour savoir si la chose est partageable ou non, ni d'une estimation ; tout cela ne s'observe plus que pour les licitations des biens des mineurs, lesquelles ne peuvent être faites qu'en justice ; & en ce cas, on y admet toûjours les étrangers afin de faire le profit du mineur.
La licitation faite sans fraude entre plusieurs copropriétaires qui sont unis par un titre commun, tels que co-héritiers, co-légataires, co-donataires, associés, co-acquéreurs, ne produit point de droits seigneuriaux, quand même les étrangers auroient été admis aux encheres, à-moins que ce ne soit un étranger à qui l'adjudication ait été faite.
Mais les acquéreurs intermédiaires, c'est-à-dire, ceux qui achetent d'un des co-héritiers, co-légataires, ou autres co-propriétaires, & qui demeurent adjudicataires de la totalité par licitation, doivent des droits seigneuriaux pour les portions qu'ils acquierent par la voie de la licitation.
L'héritage échu par licitation à un des co-héritiers, est propre pour le tout, quoiqu'il soit chargé d'une soute & retour de partage. Voyez les titres du digeste, fam. ercisc. & le titre du code communi divid. le traité de M. Guyot, sur les licitations par rapport aux fiefs. (A)
|
| LICITE | adj. (Jurisprud.) se dit de tout ce qui n'est point défendu par les lois ; celui qui fait une chose licite ne commet point de mal, & conséquemment ne peut être puni ; cependant non omne quod licet honestum est, & celui qui fait quelque chose de licite, mais qui est contraire à quelque bienséance, perd du côté de la confiance & de la considération ; cela est même quelquefois capable de le faire exclure de certains honneurs. Ce qui est illicite est opposé à licite. Voyez ILLICITE. (A)
|
| LICITER | v. act. (Jurisprud.) signifie poursuivre la vente & adjudication d'un bien qui est possédé par indivis entre plusieurs co-propriétaires, & qui ne peut sans inconvénient se partager. Voyez ci-devant LICITATION. (A)
|
| LICIUM | S. m. (Littérat.) habit & ceinture particuliere aux officiers publics, établis pour exécuter les ordres des magistrats ; le licium que portoient les licteurs étoit mélangé de différentes couleurs, comme on le voit par ce passage de Pétrone, nec longè à praecone, Asciltos stabat, amictus veste discoloriâ, atque in lance argentea indicium & fidem praeferebat. Chez les Romains on cherchoit le larcin chez autrui avec un bassin & une ceinture de filasse, per lancem liciumque ; & le larcin ainsi trouvé, s'appelloit conceptum furtum, lance & licio ; d'où vient dans le Droit actio concepti, parce qu'on avoit action contre celui chez qui l'on trouvoit la chose perdue. (D.J.)
|
| LICNON | (Littérat.) ; c'étoit dans les fêtes de Bacchus le van mystique de ce dieu, chose essentielle aux Dionisiaques, & sans laquelle on ne pouvoit pas les célébrer convenablement. Il y avoit des gens destinés à porter le van du dieu le licnon sacré : on les appelloit par cette raison les Lichnophores, . Voyez Poter, Archaeol. graec. l. II. c. xx. tom. I. p. 383.
|
| LICODIA | (Géog.) petite ville de Sicile, dans la vallée de Noto, à 30 milles de Syracuse. Long. 32. 50. lat. 36. 56.
|
| LICOLA | LAGO DI, (Géog.) reste du lac Lucrin, ancien lac de la Campanie (aujourd'hui du royaume de Naples, dans la terre de Labour), & près de l'ancienne ville de Bayes. L'an 1538 un tremblement de terre bouleversa ce lac, élevant de son fonds une montagne de cendres, & changeant le reste en un marais fangeux qui ne produit plus que des roseaux. Voyez LUCRINUS LACUS, Géog. (D.J.)
|
| LICOND | ou ALICONDA, s. m. (Hist. nat. Bot.) grand arbre qui croît en Afrique dans les royaumes de Congo, de Benguela, ainsi que dans d'autres parties. On dit qu'il devient d'une grosseur si prodigieuse, que dix hommes ont quelquefois de la peine à l'embrasser ; mais il se pourrit facilement au point qu'il est sujet à être abattu par le vent ; ce qui est cause que l'on évite de bâtir des cabanes dans son voisinage : on craint aussi la chûte de son fruit qui est gros comme une citrouille. L'écorce de cet arbre battue & mise en macération, donne une espece de filasse dont on fait de grosses cordes ; en la battant avec des masses de fer, on parvient à en faire une espece d'étoffe dont les gens du commun couvrent leur nudité. L'écorce du fruit, quand elle a été séchée, fait toute sorte d'ustensiles de ménage, & donne une odeur aromatique aux liqueurs qui y séjournent. Dans les tems de disette le peuple se nourrit avec la pulpe de ce fruit, & même avec les feuilles de l'arbre ; les plus larges servent à couvrir les toîts des cabanes ; on les brûle aussi pour avoir leurs cendres & pour en faire du savon. Comme ces arbres sont très-souvent creux, ils servent de citernes ou de réservoirs aux habitans, qui en tirent une quantité prodigieuse d'eau du ciel qui s'y est amassée.
|
| LICORNE | S. f. (Hist. nat.) animal fabuleux : on dit qu'il se trouve en Afrique, & dans l'Ethiopie ; que c'est un animal craintif, habitant le fond des forêts, portant au front une corne blanche de cinq palmes de long, de la grandeur d'un cheval médiocre, d'un poil brun tirant sur le noir, & ayant le crin court, noir, & peu fourni sur le corps, & même à la queue. Les cornes de licorne qu'on montre en différens endroits, sont ou des cornes d'autres animaux connus, ou des morceaux d'ivoire tourné, ou des dents de poissons.
LICORNE FOSSILE, (Hist. nat.) en latin unicornu fossile. Quelques auteurs ont donné ce nom à une substance osseuse, semblable à de l'ivoire ou à une corne torse & garnie de spirales qui s'est trouvée, quoique rarement, dans le sein de la terre. M. Gmelin dans son voyage de Sibérie, croit que ce sont des dents d'un poisson. Il rapporte qu'en 1724 on trouva sous terre une de ces cornes, dans le territoire de Jakutsk en Sibérie ; il présume qu'elle n'appartient point à l'animal fabuleux à qui on a donné le nom de licorne ; mais il croit avec beaucoup de vraisemblance qu'elle vient de l'animal cétacé, qu'on nomme narhwal. Le même auteur parle d'une autre corne de la même espece, qui fut trouvée en 1741, dans un terrein marécageux du même pays : cependant il observe que le narhwal que l'on trouve communément dans les mers du Groenland, ne se rencontre point dans la mer Glaciale qui borne le nord de la Sibérie.
Ce qui sembleroit jetter du doute sur cette matiere, c'est un fait rapporté par l'illustre Léibnitz dans sa Protogée ; il dit d'après le témoignage du célebre Otton Guerike, qu'en 1663 on tira d'une carriere de pierre à chaux de la montagne de Zeunikenberg, dans le territoire de Quedlimbourg, le squelete d'un quadrupede terrestre, accroupi sur les parties de derriere, mais dont la tête étoit élevée, & qui portoit sur son front une corne de cinq aunes, c'est-à-dire d'environ dix piés de longueur, & grosse comme la jambe d'un homme, mais terminée en pointe. Ce squelete fut brisé par l'ignorance des ouvriers, & tiré par morceaux de la terre ; il ne resta que la corne & la tête qui demeurerent en entier, ainsi que quelques côtes, & l'épine du dos ; ces os furent portés à la princesse abbesse de Quedlimbourg. M. de Léibnitz donne dans ce même ouvrage la représentation de ce squelete. Il dit à ce sujet, que suivant le rapport d'Hieronymus Lupus, & de Balthasar Tellez, auteurs portugais, il se trouve chez les Abyssins un quadrupede de la taille d'un cheval, dont le front est armé d'une corne. Voyez Léibnitz, Protogaea, pag. 63 & 64. Malgré toutes ces autorités, il est fâcheux que le squelete dont parle Léibnitz, n'ait point été plus soigneusement examiné, & il y a tout lieu de croire que cette corne appartenoit réellement à un poisson.
Il ne faut point confondre la corne ou la substance osseuse dont il s'agit ici, avec une autre substance terreuse, calcaire, & absorbante, que quelques auteurs ont très-improprement appellée unicornu fossile, & qui, suivant les apparences, est une espece de craie ou de marne. Voyez UNICORNU FOSSILE. (-)
LICORNE, (Blason) la licorne est un des supports des armes d'Angleterre. Voyez SUPPORT.
Les hérauts représentent cet animal passant & quelquefois rampant.
Quand il est dans cette derniere attitude, comme dans les armes d'Angleterre, pour parler proprement, il faut dire qu'il est saillant d'argent ; une licorne saillant de sable, armée, onglée, &c.
|
| LICOSTOMO | (Géog.) Scotusa ou Scotussa, ancienne ville de Grece dans la Thessalie, aujourd'hui dite province de Janna, sur le Pénée auprès du golfe de Salonique, Salonichi, avec un évêché suffragant de Larisse. (D.J.)
|
| LICO | ou LICOL, s. m. terme de Bourrelier-Sellier, c'est un harnois de tête dont on se sert pour attacher les chevaux dans l'écurie, & le licol est composé de quatre pieces, savoir une museliere, une têtiere, deux montans qui joignent la museliere à la têtiere, qui d'ailleurs sont jointes sous la gorge par un anneau auquel est assujetti une longe de corde, de cuir, ou de crin, par laquelle on attache le cheval à l'auge ou au ratelier. Voyez les Planches.
|
| LICTEUR | S. m. (Littérat.) en latin lictor, huissier qui marchoit devant les premiers magistrats de Rome, & qui portoit la hache enveloppée dans un faisceau de verges : il faisoit tout ensemble l'office de sergent & de bourreau.
Romulus établit des licteurs, pour rendre la présence des magistrats plus respectable, & pour exécuter sur le champ les jugemens qu'ils prononceroient. Ils furent nommés licteurs, parce qu'au premier commandement du magistrat, ils lioient les mains & les piés du coupable, lictor à ligando. Apulée croit qu'ils tiroient leur nom d'une ceinture ou courroie qu'ils avoient autour du corps, & qu'on appelloit licium. Voyez LICIUM.
Quoi qu'il en soit, ils étoient toûjours prêts à délier leurs faisceaux de verges, pour fouetter ou pour trancher la tête, selon l'ordre qu'ils recevoient, I, lictor, colliga manus, expedi virgas, plecte securi. Ils étoient cependant, malgré leur vil emploi, de condition libre, de race d'affranchi ; & on n'admettoit point d'esclave à cet office.
Quand les dictateurs paroissoient en public, ils étoient précédés par vingt-quatre licteurs ; les consuls par douze ; les pro-consuls, les préteurs, les généraux par six ; le préteur de la ville par deux ; & chaque vestale qui paroissoit en public, en avoit un par honneur. Comme les édiles & les tribuns ne jouissoient point de l'exercice de la haute justice, les huissiers qui les précédoient s'appelloient viatores, parce qu'ils étoient souvent en route pour donner des ajournemens aux parties.
La charge des licteurs consistoit en trois ou quatre points, 1°. submotio, c'est-à-dire à contenir le peuple assemblé, & chaque tribu dans son poste ; à appaiser le tumulte s'il s'en élevoit ; à chasser les mutins de la place, ce qu'ils exécutoient avec beaucoup de violence ; enfin, à écarter & à dissiper la foule. Horace, Ode XVI. l. II. fait une belle allusion à cette premiere fonction des licteurs, quand il dit :
Non enim gazae, neque consularis
Submovet lictor miseros tumultus
Mentis, & curas laqueata circum Tecta volantes.
Eussions-nous encore une escorte plus nombreuse que celle de nos consuls, nous ne viendrions pas à bout de dissiper le tumulte de nos passions, ni les soucis importuns qui voltigent autour des lambris dorés ; le licteur peut bien écarter, submovere, le peuple, mais non pas les troubles de l'esprit.
Matronae non summovebantur à magistratibus, dit Festus : les dames avoient ce privilége à Rome, de n'être point obligées de se retirer devant le magistrat ; ni licteurs, ni huissiers, ne pouvoient les contraindre de faire place ; on le défendit à ces gens-là, de peur qu'ils ne se servissent de ce prétexte, pour les pousser ou les toucher. Ils ne pouvoient pas même faire descendre leurs maris, lorsqu'ils étoient en carosse avec elles.
La seconde fonction des licteurs se nommoit animadversio ; ils devoient avertir le peuple de l'arrivée ou de la présence des magistrats, afin que chacun leur rendit les honneurs qui leur étoient dus, & qui consistoient à s'arrêter, à se lever si l'on étoit assis, à descendre de cheval ou de chariot, & à mettre bas les armes si on en portoit.
La troisieme fonction des licteurs s'appelloit praeitio ; ils précedoient les magistrats, marchoient devant eux, non tous ensemble, ni deux ou trois de front, mais de file, un à un, & à la suite les uns des autres. De-là vient que dans Tite-Live, dans Valere-Maxime, dans Ciceron, on lit souvent primus, proximus, secundus lictor. Lipse rapporte une inscription qui fait mention du proximus lictor.
Une quatrieme fonction des licteurs, étoit de marcher dans les triomphes devant le char du triomphateur, en portant leurs faisceaux entourés de branches de laurier.
Je ne m'amuserai point à chercher si dans les cas ordinaires, ils portoient leurs faisceaux droits, ou sur l'épaule ; je remarquerai seulement, qu'outre les faisceaux, ils tenoient des baguettes à la main, dont ils se servoient pour faire ouvrir la porte des maisons où le magistrat vouloit entrer.
Pline observe que Pompée après avoir vaincu Mithridate, défendit à son licteur de se servir de ses baguettes pour faire ouvrir la porte de Possidonius, dont il respectoit le savoir & la vertu.
Enfin, quand les Magistrats vouloient plaire au peuple & gagner sa faveur, ils faisoient écarter leurs licteurs, & c'est ce qu'on appelloit submittere fasces. Voyez FAISCEAUX. Mais les magistrats n'eurent le glaive en main que sous la république & les premiers empereurs ; ce furent ensuite les soldats du prince qui prirent la place de licteurs, pour arrêter les coupables, & pour trancher la tête. Voyez Rosinus, Pitiscus, Bombardini, de carcere, Middleton, & autres. (D.J.)
|
| LIDA | (Géog.) en latin Lida, petite ville de Pologne avec une citadelle, située dans la Lithuanie, au palatinat de Troki, dont elle est à 17 lieues S. E. sur le ruisseau de Dzila. Long. 44. 4. latit. 53. 50. (D.J.)
|
| LIDD | ou LIDDE, (Géogr. sacrée) ancienne ville dans la Palestine, & de la tribu d'Ephraim. Les Grecs l'appellent encore Diospolis, la ville de Jupiter. Elle étoit une des onze toparchies de la terre promise. S. Pierre y guérit un paralytique, & cette ville, du tems du regne des Chrétiens, devint un évêché, mais aujourd'hui Lidda, n'est plus qu'un petit bourg, où l'on tient un marché par semaine. Voyez le P. Roger, voyage de la Terre sainte, liv. I. chap. xiij.
|
| LIDDEL | LA, (Géog.) riviere de l'Ecosse méridionale ; elle a ses sources dans la province de Liddesdale, à laquelle elle donne son nom, va se joindre à la riviere d'Esck, & elles se rendent ensemble dans la baie de Solway.
|
| LIDDESDALE | Liddesdalia, (Géog.) province de l'Ecosse méridionale, aux confins de l'Angleterre, où elle est séparée par une chaîne de montagnes du Northumberland au levant, & du Cumberland au midi. Elle prend son nom de la riviere de Liddel, qui l'arrose. Il faut rapporter à cette province l'Eskdale, l'Eusdale & le Wachopdale, trois territoires qui tirent leurs noms des petites rivieres, l'Esck, l'Ew & le Wachop. (D.J.)
|
| LIÉ | (Gramm.) participe du verbe lier. Voyez LIER.
LIE : on dit, en Peinture, des lumieres bien liées, des grouppes qui se lient bien, c'est-à-dire qui se communiquent bien, & qui, quoique séparés, forment une belle union. Lorsqu' entre deux objets éclairés, il se trouve un espace qui ne l'est pas, & qu'il seroit avantageux qu'il le fût, le peintre place dans cet intervalle quelque objet qui par la saillie reçoit la lumiere, de façon qu'elle se lie aux autres lumieres, & semblent n'en faire qu'une avec elles. Il y a des auteurs qui se servent du mot dénouer, mais il n'est pas d'usage.
LIE, en terme de Blason, se dit non seulement des cercles des tonneaux, quand l'osier qui les tient est d'un autre émail, mais aussi de tout ce qui est attaché.
Gondy à Florence, d'or à deux masses d'armes en sautoir de sable, liées de gueule.
LIEES, adj. en Musique ; notes liées sont deux ou plusieurs notes qu'on passe d'un seul coup d'archet sur le violon & le violoncelle, ou d'un seul coup de langue sur la flûte & sur le haut-bois.
Dans la mesure à trois tems, les croches sur un mouvement lent sont assez souvent liées de deux en deux selon le goût françois. (S)
|
| LIE-DE-VIN | (Chimie.) Voyez à l'article VIN.
LIE, s. f. (Vinaigrier) c'est la partie la plus épaisse & la plus grossiere des liqueurs, qui forme un sédiment en tombant au fond des tonneaux, lorsque les liqueurs se sont éclaircies.
Les Vinaigriers font un grand commerce de lie de vin qu'ils font sécher, & dont ils forment des pains, après en avoir retiré ce qui y reste de liqueur par le moyen de petits pressoirs de bois. Voyez VINAIGRIER.
Les Cabaretiers marchands de vin & autres qui vendent le vin en détail, sont tenus de vendre leur lie aux Vinaigriers, & il ne leur est pas permis d'en faire des eaux de-vie.
La lie brulée & préparée d'une certaine maniere, forme la gravelée, dont les Teinturiers & autres artisans se servent dans les ouvrages de leur métier.
C'est avec de la lie que les Chapeliers foulent leurs chapeaux.
LIE D'HUILE, (Mat. méd.) en latin amurca, du mot grec , qui signifie la même chose, est la résidence qui se fait au fond du vaisseau, où l'on a mis l'huile d'olive nouvellement exprimée pour la laisser dépurer.
Elle est émolliente, adoucissante, résolutive, propre pour calmer la douleur de tête, étant appliquée sur le front, & pour arrêter les fluxions. Lemery, traité des drogues simples.
|
| LIEBAN | ou LIEVANA, (Géog.) petite contrée d'Espagne dans l'Asturie de Santillane. L'abbé de Vayrac lui donne neuf lieues de long & quatre de large. C'est un petit canton entrecoupé de hautes montagnes.
|
| LIECHTENAW | (Géog.) nom de deux petites villes, l'une dans la basse Alsace, au-delà du Rhin, entre Strasbourg & Bâle. Long. 26. 40. lat. 48. 43.
L'autre petite ville de ce nom est dans la Franconie, sur la riviere de Berzel, à deux lieues d'Anspach ; mais elle appartient à la ville de Nuremberg. Long. 28. 1. lat. 49. 15.
|
| LIEFKENSHOEK | (Géogr.) fort des Pays-bas hollandois, sur la rive gauche de l'Escaut, vis-à-vis de Lille. C'est auprès de ce fort que le général Coëhorn força les lignes des François en 1703. Long. 21. 45. latit. 51. 17. (D.J.)
|
| LIÉGE | S. m. suber, (Hist. nat. Bot.) genre de plante qui differe du chêne & du chêne-verd, en ce que son écorce est épaisse, spongieuse & legere. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIEGE, grand arbre toujours verd, qui croît en Espagne, en Italie, dans la Provence, le Languedoc, & sur-tout dans la Guienne, où il se trouve une grande quantité de ces arbres. Le liége prend une tige assez droite jusqu'à douze ou quinze piés ; il donne peu de branches, & son tronc devient plus gros par proportion que celui d'aucun autre arbre d'Europe : son écorce, qui est très-épaisse, se détache de l'arbre au bout d'un certain nombre d'années : sa feuille est plus large ou plus étroite selon les especes de cet arbre : ses fleurs ou chatons mâles ressemblent à ceux de nos chênes ordinaires, & il en est de même du fruit qui est un gland, ensorte que le liege, dont la feuille a beaucoup de rapport avec celle du chêne verd, ne differe sensiblement de ce dernier que par la qualité de son écorce.
On peut élever des liéges dans différens terreins à force de soins & de culture ; mais ils se plaisent singulierement dans les terres sablonneuses, dans des lieux incultes, & même dans des pays de landes. On a même observé que la culture & la bonne qualité du terrein étoient très-contraires à la perfection que doit avoir son écorce, relativement à l'usage qu'on en fait.
La seule façon de multiplier cet arbre, c'est d'en semer le gland aussi-tôt qu'il est en maturité ; on pourra cependant différer jusqu'au printems, pourvu que l'on ait eu la précaution indispensable de le conserver dans de la terre seche ou dans du sable. Comme cet arbre réussit très-difficilement à la transplantation, il sera plus convenable de semer les glands dans des pots ou terrines, dont la terre soit assez ferme pour tenir aux racines, lorsqu'il sera question d'en tirer les jeunes plants. La trop grande humidité les fait pourrir, il faudra les arroser modérément. Les glands semés au commencement de Mars, leveront au bout de cinq ou six semaines, ils auront l'automne suivante huit à neuf pouces de hauteur la plûpart, & dans la seconde année ils s'éleveront à environ deux piés. Il sera tems alors de les transplanter en tournant le pot ; & s'il y a plusieurs plants dans un même pot, comme cela arrive ordinairement, il faudra, en les séparant, conserver la terre autant qu'il sera possible autour des racines de chaque plant. Il n'aura pas fallu manquer d'avoir attention d'abriter les pots pendant les hivers contre les gelées. Si l'on a beaucoup de glands à semer, & qu'on se détermine à les mettre en pleine terre, il faudra de grandes précautions pour les garantir des fortes gelées ; on pourra les lever au bout de deux ans, & même différer jusqu'à trois ou quatre ; mais ce sera le plus long terme, encore faudra-t-il avoir eu l'attention de faire fouiller un an auparavant autour des racines pour couper les plus fortes, & même le pivot du jeune arbre, & l'obliger par ce moyen à faire du chevelu, afin qu'on puisse l'enlever avec la motte de terre. Le mois d'Avril est le tems le plus convenable pour la transplantation des jeunes liéges ; & si on n'avoit pu les enlever en motte, il faudroit y suppléer en leur mettant au pié de la terre bien meuble & réduite en bouillie à force d'eau, ensuite les garnir de paille pour les garantir des chaleurs & des sécheresses, & leur conserver la fraîcheur des arrosemens, qu'il ne faut faire qu'une fois par semaine & avec ménagement ; l'excès à cet égard en détruiroit plus que tous les autres accidens.
Cet arbre est délicat ; on ne doit pas s'attendre qu'il puisse résister à tout âge en plein air aux hivers rigoureux, qu'on n'éprouve que trop souvent dans la partie septentrionale de ce royaume. Il ne faut donc exposer à toute l'intempérie des saisons que les plants qui seront forts, très-vifs, bien enracinés & bien repris, & les mettre à l'exposition la plus chaude, ou au moins parmi d'autres arbres toujours verds.
L'écorce est la partie de cet arbre la plus utile. Dès que les liéges ont douze ou quinze ans, on les écorce pour la premiere fois : on recommence au bout de sept ou huit ans, & ainsi de suite pendant plus de cent cinquante ans, sans qu'il paroisse que ce retranchement leur fasse tort. L'écorce des vieux arbres est la meilleure, & ce n'est guere qu'à la troisieme levée qu'elle commence à être d'assez bonne qualité. Rien de plus connu que les différens usages que l'on peut faire de cette écorce que l'on nomme liége ; entr'autres on en fait le noir d'Espagne qui s'emploie dans les arts. Les glands peuvent servir à nourrir & à engraisser le bétail & la volaille, & on assure qu'il est assez doux pour que les hommes puissent en manger, en le faisant griller comme les châtaignes. Son bois est aussi d'une grande utilité ; il est très-propre aux ouvrages du charpentier ; il est bon à brûler & à faire le meilleur charbon : on peut en tirer le même service que du bois du chêne verd. On distingue deux especes de liége ; l'un à feuilles larges, ovales & un peu dentelées, & les feuilles de l'autre espece sont longues, étroites & sans aucunes dentelures ; son gland est plus petit. Du reste, il n'y a nulle différence essentielle entre ces deux especes. Article de M. D'AUBENTON.
Cet arbre de moyenne hauteur que Tournefort appelle avec la plûpart des botanistes, suber latifolium, perpetuò virens, est une espece de chêne toujours verd ; mais son tronc est plus gros, il est d'un tissu fort compact, & jette peu de branches. Son écorce est beaucoup plus épaisse que celle du chêne verd, fort légere, spongieuse, raboteuse, de couleur grise, tirant sur le jaune ; elle se fend d'elle-même, creve & se sépare de l'arbre, si l'on n'a pas soin de l'en détacher, parce qu'elle est poussée par une autre écorce rougeâtre qui se forme dessous. Ses feuilles ont aussi la figure de celles de l'yeuse, vertes par-dessus, blanchâtres par-dessous ; mais elles sont plus larges, plus longues, plus molles & plus vertes en dessus ; quelquefois elles sont un peu dentelées par les bords, & piquantes, d'autres fois unies & sans dentelures. Ses chatons & ses glands sont pareillement semblables à ceux du chêne verd ; mais le gland du liége est plus long, plus obtus, d'un goût plus désagréable que celui de l'yeuse. Il en part ordinairement deux d'un même pédicule, qui est ferme & court. Le calice du gland est aussi plus grand & plus velu que celui de l'yeuse.
Cet arbre croît dans les pays chauds, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Provence, en Gascogne, vers les Pyrénées & en Roussillon. Il donne une écorce plus épaisse, & meilleure à proportion qu'il vieillit, & c'est de cette écorce inutile en Médecine, mais qu'on emploie à divers autres usages, que cet arbre tire tout son lustre. Son fruit sert à nourrir les cochons, & les engraisse mieux, à ce qu'on dit, que les glands des autres chênes. (D.J.)
LIEGE, (Mat. méd.) on trouve encore parmi le peuple des femmes qui croient à la vertu du liége porté en amulete pour faire perdre le lait sans danger. Les Médecins & les gens raisonnables n'ont plus de foi pour les propriétés de cette classe, quoiqu'ils attachent encore un collier de bouchons de liége enfilés au cou de leurs chiennes & de leurs chattes qui ont perdu leurs petits. (b)
LIEGE, (Arts & Comm.) écorce extérieure de l'arbre qui porte le même nom.
Pour lever cette écorce, on fend le tronc de l'arbre depuis le haut jusqu'en bas, en faisant aux deux extrémités une incision coronale. On choisit ensuite un tems sec & assuré pour lever cette grosse écorce ; car l'écorce inférieure, qui est encore tendre, se gâteroit & feroit périr l'arbre, s'il survenoit des pluies abondantes après la récolte du liége. Il est vrai que ce mal n'arrive guere dans les pays chauds, où le tems est en général fort constant. Quand on a dépouillé l'arbre, qui pour cela ne meurt pas, on met l'écorce en pile dans quelque mare, dans quelque étang, où on la charge de pierres pesantes pour l'applatir de toutes parts & la réduire en tables. On la retire ensuite de la mare, on la nettoie, on la fait sécher, & quand elle est suffisamment seche on la met en balles pour la commodité du transport.
On emploie le liége pour les pantoufles, pour des patins, mais sur-tout pour boucher des cruches & des bouteilles ; les pêcheurs s'en servent aussi à faire ce qu'ils appellent des patenostres pour suspendre leurs filets sur l'eau. Enfin, le liége sert à divers autres usages. Les Espagnols, par exemple, le calcinent dans des pots couverts pour le reduire en une cendre noire, extrêmement légere, que nous appellons noir d'Espagne, qui est fort employé par plusieurs ouvriers. Aujourd'hui on fait ce noir par-tout, & mieux que sur les lieux.
On distingue dans le commerce, dit M. Savary, deux sortes de liége, le liége blanc ou de France, & le liége noir ou d'Espagne. Le liége blanc doit être choisi en belles tables unies, légeres, sans noeuds ni crevasses, d'une moyenne épaisseur, d'un gris jaunâtre dessus & dedans, & qui se coupent nettement. Le liége noir doit avoir les mêmes qualités, à la réserve de l'épaisseur & de la couleur extérieure ; car le plus épais & le plus noir au dehors, est le plus estimé. (D.J.)
LIEGE FOSSILE, (Hist. nat.) suber montanum : on nomme ainsi une espece de pierre extrêmement légere qui paroît composée de fibres ou de filets flexibles, & d'un tissu spongieux comme le liége. Wallerius le regarde comme une espece d'amiante, aussi-bien que la chair fossile, caro fossilis, qui se trouve en quelques endroits du Languedoc. Cette pierre entre en fusion dans le feu, & s'y change en un verre noir. Voyez Wallerius, minéralogie.
LIEGE, (Géog.) ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, capitale de l'évêché du même nom, dont l'évêque est souverain, & suffragant de Cologne.
On nomme aujourd'hui cette ville en latin Leodium, Leodicum & Leodica ; selon Boxhornius on la nommoit anciennement Legia, à cause d'une légion romaine que les habitans du pays défirent, de même que cinq cohortes commandées par Cotta & par Sabinus, comme le remarque César, liv. V. On l'appelle en allemand Luttich, & en Hollandois Luyk.
La plûpart des meilleurs écrivains prétendent que S. Hubert, originaire d'Aquitaine, qui florissoit en 700, fut le premier évêque de cette ville, qu'il la fonda, lui donna le nom de Legia, & qu'avant son tems ce n'étoit qu'un village.
Quoique cette ville soit soumise à son évêque pour le temporel & le spirituel, elle jouit de si grands privileges qu'on peut la regarder comme une république libre, gouvernée par ses bourgmestres, par ses sénateurs & par ses autres magistrats municipaux ; car elle a trente-deux colléges d'artisans, qui partagent une partie de l'autorité dans le gouvernement, & portent l'aisance dans la ville ; mais le nombre de ses églises, de ses abbayes, & de ses monasteres, lui font un tort considérable. Pétrarque en sortant de cette ville, écrivit à son amante : Vidi Leodium insignem clero locum ; il diroit encore la même chose.
Son évêché renfermoit autrefois tout le comté de Namur, une grande partie du duché de Gueldres & de celui de Brabant. Il n'a plus cette étendue, cependant il comprend encore sous sept archidiaconés vingt & un doyennés ruraux, & en tout environ 1500 paroisses.
Le pays de Liege est divisé en dix drossarderies ou grands bailliages qui sont à la collation du prince, quelques villes, Liege, Tongres, Huy, Maseick, Dinant, Hassel, &c. plusieurs gros bourgs, baronies & seigneuries, sur lesquelles l'évêque a la jurisdiction de prince ou d'évêque. Le terroir y est fertile en grains, fruits & venaison. Il se trouve dans le pays des mines de fer & quelques-unes de plomb, avec des carrieres d'une espece de charbon de terre, qu'on appelle de la houille.
La ville de Liege est située dans une vallée agréable, abondante, environnée de montagnes que des vallons séparent, avec des prairies bien arrosées, sur la Meuse, à 5 lieues N. E. de Huy, 4 S. de Mastricht, 14 N. E. de Namur, 25 S. O. de Cologne, 26 N. de Luxembourg, 30 N. O. de Mons, 77 N. E. de Paris. Long. selon Cassini, 26d. 6'. 30''. latit. 50. 40.
" C'est ici qu'est décédé à l'âge de 55 ans, le 7 Août 1106, Henri IV, empereur d'Allemagne, pauvre, errant, & sans secours, plus misérablement encore que Grégoire VII, & plus obscurément, après avoir si long-tems tenu les yeux de l'Europe ouverts sur ses victoires, sur ses grandeurs, sur ses infortunes, sur ses vices & sur ses vertus. Il s'écrioit en mourant, au sujet de son fils Henri V : Dieu des vengeances, vous vengerez ce parricide ! De tous tems les hommes ont imaginé que Dieu exauçoit les malédictions des mourans, & sur-tout des peres ; erreur utile & respectable, si elle arrêtoit le crime ". Voltaire, Hist. universelle, tom. I. pag. 280. (D.J.)
LIEGE, c'est un morceau de bois en forme de petite aîle, qui est aux deux côtés du pommeau de la selle, & qui s'appelle batte, lorsqu'il est couvert de cuir & embelli de clous. On dit : ce liege est décollé. Ce mot vient de ce qu'autrefois la batte étoit de liége ; mais on la fait aujourd'hui de bois. Voyez SELLE.
|
| LIEN | S. m. (Gramm.) il se dit de tout ce qui unit deux choses l'une à l'autre ; il se prend au physique & au moral. Le lien d'une gerbe ; le lien de l'amitié.
LIEN, double, (Jurisprud.) voyez DOUBLE LIEN.
LIENS, (Chirurgie) bandes de soie, de fil ou de laine, dont on se sert pour contenir les malades, principalement dans l'opération de la taille, afin qu'ils ne changent point de situation, & ne puissent faire aucuns mouvemens qui pourroient rendre dangereuse à différens égards une opération qui exige une si grande précision.
On met ordinairement le malade sur le bord d'une table garnie d'un matelas, & de quelques oreillers pour soutenir la tête & les épaules. Cette situation presque horisontale, est préférable au plan incliné qu'on obtenoit avec une chaise renversée sous le matelas, ou avec un dossier à crémailliere, Planche XII. fig. 2.
Lorsque le malade est assis sur le bord de la table, on applique les liens. Ce sont ordinairement des bandes de cinq ou six aunes de long, larges de trois ou quatre travers de doigt. On pose le milieu des deux liens sur le col au-dessus des épaules : deux aides placés, l'un à droite, l'autre à gauche, font passer, chacun de son côté un chef de liens par-devant la clavicule, & l'autre chef sur l'omoplate. Ils les amenent sous l'aisselle où on les tourne deux ou trois fois en les cordelant. Ensuite on fait approcher les genoux du malade le plus que l'on peut vers son ventre, & dans ce tems on fait passer un des liens entre les cuisses & l'autre par dehors ; on les joint ensemble tous deux par-dessus, en les cordelant une fois. On fait pareillement approcher les talons du malade vers les fesses, tandis qu'on engage la jambe de la même façon. Après quoi on lui fait mettre quatre doigts de la main sous le pié, & le pouce au-dessous de la malléole externe, comme s'il vouloit prendre son talon. Dans cette situation, on lui engage les poignets & la main avec la jambe & le pié, observant de passer les chefs de liens par-dessous le pié en forme d'étrier, & ensuite on les conduit entre les piés & les pouces des mains, parce qu'il faut serrer médiocrement ; ce qui suffiroit néanmoins pour incommoder les pouces, si on les engageoit. Voyez Pl. IX. fig. 3. Elle représente en outre la situation d'un aide qui comprime sur les épaules ; & montre d'un côté l'attitude de ceux qui doivent contenir les jambes & les cuisses pendant l'opération.
Cet appareil a quelque chose d'effrayant pour le malade. On pourroit se dispenser de cette maniere de lier qui imprime quelquefois de la terreur aux assistans mêmes. M. Rau ne se servoit que de lacs pour contenir & fixer simplement les mains avec les piés, au moyen de quelques circonvolutions des chefs d'une bande. M. Ledran a imaginé des liens assez commodes, & qui assujettissent suffisamment les malades, sans l'embarras des grands liens ordinaires. Une tresse de fil fort, large de deux pouces, longue de deux piés ou environ a ses deux bouts réunis par une couture. Cette tresse pliée en deux, n'a plus qu'un pié de long. Un noeud coulant fait d'une pareille tresse, rapproche & embrasse ensemble les deux côtés de ce lien, qui alors fait une espece de 8. Ce noeud n'est pas fixe : on peut le faire couler vers l'un ou l'autre bout du lien. Voyez Pl. IX. fig. 6. & 7.
Pour s'en servir, chacun des deux aides passe une des mains du malade dans un des bouts du lien, & il l'assujettit avec le noeud coulant à l'endroit de la jointure du poignet ; aussi-tôt il fait passer l'autre bout du lien dans le pié, en forme d'étrier. Il porte une de ses mains entre les bras & le jarret du malade pour le lui soutenir, & de l'autre main il lui soutient le pié.
Plusieurs lithotomistes prennent pour liens des ceintures de laine en réseau, dont les couriers se serrent le ventre. On met cette ceinture en double : on fait dans l'anse un noeud coulant dans lequel on engage le poignet ; les deux chefs servent à fixer la main & le pié par différens croisés, & l'on en noue les extrémités. Cette ligature molette & épaisse peut être serrée assez fermement, & elle ne laisse aucune impression comme les bandes de fil. J'en ai introduit l'usage à l'hôpital de la charité de Paris en 1758.
On ne lie point les petits enfans : il suffit de les contenir de la façon que le représente la fig. 4. Planche XII.
On donne aussi le nom de liens à des rubans de fil larges d'un pouce ou environ, dont on se sert pour contenir les fanons dans l'appareil d'une fracture. Nous en avons parlé au mot FANON, terme de Chirurgie. (Y)
LIEN, d'assemblage, outil de Charron. Voyez BRIDE.
LIEN, terme de Chapelier, se dit du bas de la forme du chapeau, ou de l'endroit du chapeau jusqu'où ils font descendre la ficelle.
LIENS, (Charpente) est une piece de bois qui se met en angle sous une autre piece pour la soutenir & l'allier avec une autre, comme les jambes de force avec les entraits, &c. Voyez nos Pl. de Charpente & leur explic. tom. II. part. I.
LIEN, (Serrurerie) c'est une piece qui, dans les grilles, rampes, & autres ouvrages de cette nature, lie les rouleaux ensemble dans les parties où ils se touchent, & fait solidité & ornement aux panneaux. Le lien à cordon est celui au milieu du champ duquel on a pratiqué l'ornement appellé cordon.
Le lien est fait d'une lame de fer battue, épaisse d'une ligne ou deux, suivant l'ouvrage, large de sept à huit ; on tourne cette lame sur un mandrin ; on laisse aux deux bouts de quoi former des tenons qui recevront la quatrieme partie du lien, qui sera percée à ses extrémités de trous où les tenons entreront & seront rivés.
Les liens à cordons s'estampent ; ils sont de quatre pieces : on déformeroit le cordon en les pliant, s'ils n'étoient que de deux.
LIENS, (Vitrier) sont de petites bandes de plomb d'une ou deux lignes de large sur une d'épaisseur, qui sont soudées sur le plomb des panneaux, & qui servent à attacher les verges de fer pour entretenir lesdits panneaux.
Moule à liens est un moule à deux branches comme un gaufrier, qui sert à faire plusieurs liens à-la-fois.
|
| LIENNE | S. f. terme de Tisserand ; ce sont les fils de la chaîne dans lesquels la trame n'a point passé, parce qu'ils n'ont pas été levés ou baissés par les marches.
|
| LIENTERIE | S. f. (Medecine) . Ce nom est composé de deux mots grecs, , qui signifie glissant, poli ; & , intestin. On s'en sert pour désigner un flux de ventre alimenteux, dans lequel on rend par les selles les alimens indigérés tels qu'on les a pris. L'étymologie de ce nom vient de l'idée fausse qu'avoient les anciens, regardant cette maladie comme une suite nécessaire du poli contre nature des intestins ; ils l'appelloient lienterie, comme s'ils eussent dit , polissure des intestins. Le symptôme principal, univoque, nécessaire, seul diagnostic, est cette excrétion fréquente des alimens inaltérés ; à ce symptôme se joignent quelquefois des nausées, vomissemens, pesanteur d'estomac, ptialisme, &c. d'autres fois des douleurs, tranchées ; les selles sont sanguinolentes. Assez souvent la lienterie est précédée, mais rarement accompagnée de , faim canine, à la suite de laquelle vient l'anorexie ou défaut d'appétit, & enfin la lienterie se déclare ; la maigreur, la foiblesse, l'exténuation ne tardent pas à gagner. Hippocrate, d'après l'observation, regarde cette maladie comme plus commune en automne, & particulierement affectée aux adultes, Aphor. 22 & 41. lib. III. D'autres pensent au contraire qu'elle doit être plus fréquente en hiver & plus appropriée aux gens vieux.
Pour que cette maladie ait lieu, il faut absolument qu'il ne se fasse aucune digestion dans l'estomac, que les alimens éludent entierement l'action dissolvante des sucs gastriques, , dit Aretée. Cette condition, qui est absolument necessaire, suffit ; car lorsque les menstrues de l'estomac n'ont fait aucune impression sur les alimens, ils sont insolubles & inaltérables par les sucs des intestins. La premiere élaboration doit précéder nécessairement la seconde, & la seconde coction, suivant l'axiome justement reçu, ne sauroit corriger les vices de la premiere. La foiblesse, l'atonie extrême de l'estomac, la vappidité des sucs gastriques, sont une cause très-simple, mais peut-être pas aussi fréquente, de ce défaut total de digestion : il est assez difficile à comprendre comment l'estomac pourroit venir à ce dernier point de relâchement, excepté peut-être quelques cas très-rares de paralysie de viscere, encore y auroit-il alors lienterie ? Comment les alimens seroient-ils poussés dans le pylore, car ce passage est une excrétion active ? Il pourroit aussi se faire que le cours des humeurs qui concourent à la digestion stomachale fût intercepté : alors il y auroit indigestion totale, & peut-être aussi lienterie.
On a cru, & sans doute avec plus de raison, que la digestion pouvoit être empêchée par quelqu'irritation dans les intestins, par des ulceres, par exemple ; c'est un sentiment qu'Asclepiade a le premier soutenu, que Galien a réfuté, que quelques modernes ont renouvellé, & qui pourroit être appuyé, 1°. sur l'Aphorisme 75. liv. VII. d'Hippocrate, , à la dissenterie survient la lienterie ; 2°. sur les symptômes qu'on observe dans quelques lienteries, douleurs, tranchées, excrétions sanguinolentes, &c ; 3°. sur l'observation de Bontius, medecine des Indiens, liv. III. chap. xij, qui dit avoir trouvé des abscès au mésentere de la plûpart des personnes qui étoient mortes de la lienterie ; 4°. sur l'analogie qui nous fait voir dans le diabete l'irritation des reins, suivie de l'excrétion des boissons inaltérées, sous le nom & par les conduits de l'urine ; 5°. sur l'épidémicité de cette maladie dans certaines constitutions de l'air ; 6°. enfin, parce qu'il est certain qu'une irritation dans les intestins est très-capable d'empêcher la digestion, & d'attirer, pour me servir des termes expressifs & usités des anciens, les alimens dans leur conduit. Il est incontestable que les lavemens pris en certaine quantité & forts, dérangent, troublent & arrêtent la digestion : je suis persuadé qu'on pourroit par ce moyen exciter une lienterie artificielle.
La polissure, laevitas, des intestins paroît par-là être une cause très-insuffisante & précaire de la lienterie, tout au plus pourroit-elle déterminer une passion coeliaque ; il en est de même de l'obstruction des vaisseaux lactés, qui est aussi fort inutile dans cette maladie, & qui n'est propre qu'à occasionner le flux chyleux. La plûpart des auteurs admettent pour cause de la lienterie toute sorte d'abscès, de suppurations internes aux reins, aux poumons, les vapeurs noires, comme dit Menjot, qui s'échappent d'une vomique ouverte, parce qu'on a observé dans la même personne ces deux maladies en même tems. Ils raisonnent à-peu-près comme ceux qui attribuent à l'opération d'un remede la guérison d'une maladie aiguë, effet constant de la nature ; post hoc, concluent-ils, ego propter hoc. L'excrétion des alimens inaltérés, le défaut en conséquence du nouveau chyle, pour nourrir & séparer, donnent la raison de tous les phénomenes qu'on observe dans cette maladie, de l'exténuation, de la maigreur, de la mort prochaine, &c. On observe cependant que ces accidens ne sont pas aussi promts que dans ceux qui ne mangent pas du tout ; cependant les alimens sont souvent rendus peu de tems après avoir été pris, & sans la moindre altération : ce qui peut dépendre & de la sensation agréable & restaurante qu'opere le poids des alimens sur l'estomac, & de ce qu'il échappe toujours des alimens quelques particules subtiles, quelques vapeurs qui entrent par les pores absorbans de l'estomac & des intestins : , dit Hippocrate, l'esprit est aussi nourriture.
Il n'est pas possible de se méprendre dans la connoissance de cette maladie. Pour la différencier des autres flux de ventre avec lesquels elle a quelque rapport, il n'y a qu'à examiner la nature des excrémens ; on la distinguera surement, 1°. de la passion coeliaque, qui n'en est qu'un degré, une demi-lienterie, si l'on peut ainsi parler ; parce que les alimens ont souffert l'action des menstrues gastriques, ils sont dans un état chimeux ; 2°. du flux chyleux dans lequel on voit du chyle mêlé avec les excremens ; 3°. du cours de ventre colliquatif, par l'odeur fétide, putride, cadavéreuse qui s'exhale des excrémens, par leur couleur, &c. &c. &c. Il est à propos pour la pratique de ne pas confondre les causes qui ont produit la lienterie : elles se réduisent à deux chefs principaux, comme nous avons dit ; les unes consistent dans l'abolition absolue des fonctions digestives de l'estomac, les autres dans l'irritation du conduit intestinal. Lorsque la lienterie doit être attribuée à la premiere cause, la faim canine, ensuite le défaut d'appétit, quelquefois aussi la passion coeliaque précédent ; il y a ptyalisme, pesanteur d'estomac, &c. Lorsqu'elle dépend de l'irritation & sur-tout de l'exulcération des intestins, elle succede à la dissenterie, n'est point précédée de passion coeliaque, de faim canine, &c. Le malade éprouve des ardeurs, des tranchées, un morsus formicans dans le bas-ventre ; il y a soif, sécheresse dans le gosier, âpreté & rudesse de la langue, les excrétions sont sanieuses, &c.
La lienterie n'est jamais, comme quelques autres cours de ventre, salutaire, critique ; c'est une maladie très-grave, sur-tout funeste aux vieillards : il est rare qu'on en guérisse. Nicolas Pechlin raconte n'avoir vu que trois personnes lientériques, dont aucune ne put réchapper. C'est à tort que M. Lieutaud dit, & sur-tout sans restriction, que la passion coeliaque est plus dangereuse que la lienterie. " Lorsque la lienterie est jointe à une respiration difficile & point de côté, elle se termine en éthisie, tabem. Les malades qui, après avoir été tourmentés long-tems de lienterie, rendent par les selles des vers avec des tranchées & des douleurs violentes, deviennent enflés quand ces symptomes disparoissent ". Hippocrate, coac. praenot.
Le danger dans la lienterie est proportionné à la fréquence des selles, à la diminution des urines, à l'état des excrémens plus ou moins altérés. Le danger est pressant & la mort prochaine si le visage est rouge, marqueté de différentes couleurs, si le bas-ventre est mol, sale & ridé, & sur-tout si dans ces circonstances le malade est âgé. Il y a au contraire espoir de guérison si les symptômes precédens manquent, si la quantité des urines commence à se proportionner à celle de la boisson, si le corps prend quelque nourriture, s'il n'y a point de fievre, si le malade rend des vents mêlés avec les excrémens. Hippocrate regarde comme un signe très-favorable s'il survient des rots acides qui n'avoient pas encore paru ; il a vérifié ce prognostic heureux dans Demanéta : ce qui prouve un commencement de digestion ; car une indigestion totale ou un refroidissement extrême est , sans vents ; peut-être aussi, dit-il, les rots acides emportent la polissure des intestins.
Il est à présumer que la lienterie par irritation est moins dangereuse que l'autre, qui marque un affaissement absolu, un anéantissement extrême de l'estomac.
Curation. Chaque espece de lienterie demande des remedes particuliers ; il est des cas où il ne faut qu'animer, fortifier l'estomac & en reveiller le ton engourdi ; les stomachiques astringens, absorbans, sont les remedes indiqués pour remplir ces vûes. Waldschimidius remarque que dans ce cas-là les stomachiques les plus simples, les plus faciles à préparer, sont les plus appropriés & réussissent le mieux. Les plus efficaces sont, suivant cet auteur, la muscade, le gingembre en conserve, le vin d'absynthe préparé avec le mastic & les sudorifiques, l'exercice, l'équitation, & comme dit un auteur moderne, le mariage, produisent dans ces cas-là de grands effets. Si les forces de l'estomac n'étoient qu'oppressées & non pas épuisées, l'émétique pourroit convenir ; son administration pouvant avoir des suites fâcheuses, il est plus prudent de s'en abstenir. Hippocrate nous avertit d'éviter dans les lienteries les purgations par le haut, sur-tout pendant l'hiver, Aphor. 12. lib. IV. Puisque les rots sont avantageux dans cette maladie, il seroit peut-être utile de les exciter par les remedes appropriés, comme l'ail, la rue, que Martial appelle ructatricem. Ces remedes seroient plus goûtés en Espagne, où c'est une coutume & non pas une indécence de chasser les vents incommodes par les voies les plus obvies.
Si la lienterie dépend d'une irritation dans le conduit intestinal, il faut emporter la cause irritante, si on la connoît, sinon tâcher d'en émousser l'activité par les laitages affadissans les plus convenables, pris sur-tout en lavement ; on ne doit pas négliger les stomachiques : l'émétique seroit encore ici plus pernicieux. Si l'on a quelques marques d'ulceres dans les intestins, il faut avoir recours aux différens baumes de copahu, de la Mecque, du Canada, &c. les lavemens térébenthinés peuvent être employés avec succès. (M)
|
| LIENT | ou LUENTZ, (Géog.) en latin Loncium, petite ville du Tirol sur la Drave, à 4 milles germaniques d'Iunichen. Longit. 29. 10. latit. 47. 15. (D.J.)
|
| LIER | v. act. (Gramm.) il désigne l'action d'attacher ensemble des choses auparavant libres & séparées. Il se prend au moral & au physique : l'homme est lié par sa promesse : les pierres sont liées par les barres de fer qui vont de l'une à l'autre.
LIER, en terme de cuisine, est l'action d'épaissir les sauces avec farine, chapelure de pain, & autres ingrédiens propres à cet usage.
LIER, (Venerie) se dit du faucon qui enleve la proie en l'air en la tenant fortement dans ses serres, ou, lorsque l'ayant assommée, il la lie & la tient serrée à terre.
On dit aussi que deux oiseaux se lient lorsqu'ils se font compagnie & s'unissent pour poursuivre le héron & le serrer de si près, qu'ils semblent le lier & le tenir dans leurs serres. A l'égard de l'autour, on dit empiéter.
|
| LIR | ou LIERE, (Géogr.) mais en écrivant Liere, on prononce Lire ; ville des Pays-Bas autrichiens dans le Brabant, au quartier d'Anvers, sur la Nèthe, à 2 lieues de Malines & 3 d'Anvers. Cet endroit seroit bien ancien si c'étoit le même que Ledus ou Ledo, marqué dans la division du royaume de Lothaire, l'an 876 ; mais c'est une chose fort douteuse : on ne voit point que Lire ait été fondée avant le xiij. siecle. Long. 22. 11. lat. 51. 9.
Nicolas de Lyre ou Lyranus, religieux de l'ordre de saint François dans le xjv. siecle, & connu par de petits commentaires rabbiniques sur la Bible, dont la meilleure édition parut à Lyon en 1590, n'étoit pas natif de Lire en Brabant, comme plusieurs l'ont écrit, mais de Lire, bourg du diocèse d'Evreux en Normandie. On a prétendu qu'il étoit juif de naissance, mais on ne l'a jamais prouvé.
|
| LIERNE | S. f. (Hydr.) piece de bois qui sert à tirer les fils de pieux d'une palée ; elle est boulonnée & n'a point d'entailles comme la morze pour accoler les pieux. On lierne souvent les pieux d'un batardeau. (K)
LIERNE, (Coupe des pierres) C'est une des nervures des voûtes gothiques qui lie le nerf appellé tierceron avec celui de la diagonale, qu'on appelle ogive.
LIERNES, (Charpenterie) servent à porter les planchers en galetas, & s'assemblent sous le faît d'un poinçon à l'autre. Voyez nos Pl. de Charpente & leur explic.
LIERNES, terme de riviere, planches d'un bateau foncet, qui sont entretaillées dans les clans & dans les bras des lieures.
|
| LIERRE | hedera, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en rose composée de plusieurs pétales disposés en rond ; il sort du milieu de la fleur un pistil qui devient dans la suite une baie presque ronde & remplie de semences arrondies sur le dos, & plates sur les autres côtés. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIERRE, hedera, arbrisseau grimpant, toujours verd, qui est très-connu, & que l'on trouve partout, dans les pays tempérés, & même assez avant sous la zone glaciale ; il se plaît sur-tout dans les forêts, & dans les lieux négligés ou abandonnés. Tantôt on le voit ramper & se confondre avec les herbes les plus communes & les plus inutiles ; tantôt on l'apperçoit au-dessus des plus hautes murailles, & jusqu'à la cime des plus grands arbres. Un seul plan de lierre, à force de tems, s'empare d'un vieux château ; il en couvre les murs, domine sur les toits ; l'espace ne lui suffit pas ; il surabonde, & présente l'aspect d'une forêt qui va s'élever. Partout où se trouve cet arbrisseau, il annonce l'insuffisance du propriétaire, ou son manquement de soin. On peut donc regarder le lierre comme le symbole d'une négligence invétérée. C'est un objet importun, nuisible, & si tenace, qu'il est souvent très-difficile de s'en débarrasser. Cependant il peut avoir malgré cela de l'utilité, de l'agrément & de la singularité.
Le tronc du lierre grossit avec l'âge, & il s'en trouve quelquefois qui ont un pié & demi de tour : cet arbrisseau s'attache fortement à tous les objets qu'il peut atteindre, & qui peuvent le soutenir & l'élever au moyen de quantité de fibres ou griffes dont ses branches sont garnies ; elles s'appliquent sur le mortier des murailles, & sur l'écorce des arbres, avec une ténacité à l'épreuve de la force des vents & des autres injures du tems. Ces griffes ont tant d'activité, qu'elles corrompent & brisent le mortier des murailles, & quelquefois les font écrouler, sur-tout lorsque l'arbrisseau vient à périr. On observe que ces griffes qui semblent être des racines, n'en font pas les fonctions ; car quand on coupe un lierre au-dessus des racines qui sont en terre, le tronc & toutes les branches se dessechent & périssent ; & si quelque partie continue de végéter, ce sera parce que quelques branches se seront insinuées dans le mur, & y auront pris racine ; c'est dans ce cas qu'il est très-difficile de les faire périr. La même force des griffes en question agit sur les plus gros arbres ; dès que le lierre s'en est emparé, il enveloppe le tronc, se répand sur toutes les branches, pompe la seve, couvre les feuilles, & fait tant d'obstacles à la végétation, que l'arbre périt à la fin. On peut remarquer sur le lierre des feuilles de trois différentes formes, selon la différence de son âge. Pendant qu'il rampe à terre dans sa premiere jeunesse, elles sont de la figure d'un fer de lance allongé sans échancrure ; quand il s'est attaché aux murs ou aux arbres, ses feuilles sont échancrées en trois parties ; elles sont d'un verd plus brun que les premieres, & elles sont mouchetées de taches blanchâtres ; mais lorsque l'arbrisseau domine sur les objets auxquels il s'est attaché, ses feuilles sont presqu'ovales, & d'un verd jaunâtre. Au surplus, sa feuille à tout âge, est toujours ferme, épaisse, luisante en-dessus, & à l'épreuve de toutes les intempéries. Le lierre ne donne ses fleurs qu'au mois de Septembre ; elles viennent en bouquet, sont petites, de couleur d'herbe, sans nul agrément, ni d'autre utilité que de servir à la récolte des abeilles. Les fruits qui succedent, sont des baies rondes, de la grosseur d'un pois ; elles deviennent noires dans leur maturité qui est à sa perfection au mois de Janvier : mais elles restent long-tems sur les branches.
Le lierre est un arbrisseau sauvage, agreste, dur, solitaire, impraticable, qui craint l'éducation, qui se refuse à la culture, & qui dépérit sous la contrainte ; il n'est même pas aisé de le multiplier ; ses graines, quoique semées immédiatement après leur maturité, ne levent souvent qu'au bout de deux ans. On croiroit qu'au moyen des fibres ou griffes dont les branches de cet arbrisseau sont garnies à chaque noeud, il doit être facile de le faire venir de bouture, mais il a été bien reconnu que ces fibres ne se convertissent point en racines, & qu'elles n'en favorisent nullement la venue : toutes les boutures de lierre que j'ai fait faire, n'ont jamais réussi. On peut le multiplier de branches couchées, qui n'auront de bonnes racines qu'au bout de deux ans. Le plus court parti sera de prendre dans les bois des jeunes plants enracinés ; il faudra les planter dans un terrein frais & à l'ombre, pour y greffer ensuite les variétés qui ont de l'agrément.
On ne fait nul usage en France du lierre ordinaire dans les jardins ; cependant les arbres toujours verds & robustes étant en petit nombre, on a besoin quelquefois de faire usage de tout. On pourroit employer cet arbrisseau à faire des buissons, des palissades, des portiques dans des lieux serrés, couverts, ou à l'ombre : on pourroit aussi lui faire prendre une tige, & lui former une tête réguliere ; c'est peut-être de tous les arbrisseaux celui qui souffre le plus d'être privé du grand air ; on voit en Italie des salles ou grottes en maçonnerie, qui sont garnies en-dedans, avec autant de goût que d'agrément, de la verdure des lierres plantés au-dehors.
Cet arbrisseau peut être de quelqu'utilité, & on lui attribue des propriétés : ses feuilles font une bonne nourriture en hiver pour le menu bétail ; elles sont de quelqu'usage en Medecine ; & on prétend que leur décoction noircit les cheveux. On a observé que les feuilles de mûrier qui avoient été prises sur des arbres voisins d'un lierre, avoient fait mourir les vers-à-soie qui en avoient mangé. Son bois est blanc, tendre, poreux, & filandreux, qualités qui l'empêchent de se gerser, de se fendre en se desséchant, & qui par-là le rendent propre à certains ouvrages du tour : mais ce bois est difficile à travailler.
Quelques-uns des anciens auteurs qui ont traité de l'agriculture, comme Pline, Caton & Varron ; plusieurs modernes, tels que Wecherus, Porta & Angran, donnent pour un fait certain qu'un vaisseau fait avec un morceau de bois de lierre récemment coupé, peut servir à constater si l'on a mêlé de l'eau dans le vin ; & que l'épreuve s'en fait en mettant le mêlange dans le vaisseau de lierre qui retient l'une des liqueurs, & laisse filtrer l'autre. Les anciens disent que c'est le vin qui passe, & que l'eau reste. Les modernes assurent au contraire que le vaisseau de lierre retient le vin, & qu'il laisse passer l'eau. Mais par différentes expériences faites dans plusieurs tasses de lierre, dont le bois avoit été coupé & travaillé le même jour ; & pareilles épreuves répétées dans les mêmes tasses après un desséchement de quatre ans ; il a constamment résulté que dans les tasses dont le bois étoit verd, la liqueur composée d'un tiers d'eau sur deux tiers de vin, a entierement filtré en vingt-quatre heures de tems ; & que dans les mêmes tasses desséchées, pareille composition de liqueur a filtré en entier en trois fois vingt-quatre heures. Par d'autres épreuves faites dans les deux états des tasses, avec de l'eau & du vin séparément & sans mêlange, l'un & l'autre ont filtré également & dans le même espace de tems ; ensorte que dans toutes ces différentes épreuves, il n'est resté aucune liqueur dans les tasses ; il m'a paru que ce qui avoit pu induire en erreur à ce sujet, c'étoit la différence de couleur qui se trouvoit dans la liqueur filtrée dans différens tems de la filtration. Dans les épreuves faites avec un mêlange d'eau & de vin dans une tasse de bois verd, la liqueur qui a filtré au commencement, au lieu de conserver la couleur ou le goût du vin, n'a qu'une teinte roussâtre, de la couleur du bois avec le mauvais goût de la seve du lierre ; c'est sans doute ce qui a fait croire que ce n'étoit que l'eau qui passoit au commencement ; mais à mesure que se fait la filtration, la couleur roussâtre se charge peu-à-peu d'une teinte rougeâtre qui se trouve à la fin de couleur de peau d'oignon ; & le goût du vin en est si fort altéré, qu'à peine peut-on l'y reconnoître. Les mêmes circonstances se sont trouvées dans la filtration de pareille mêlange de liqueur, à-travers les tasses de bois sec, & dans la filtration du vin sans mêlange, dans les tasses de bois verd & de bois sec, si ce n'est que la liqueur filtrée du vin sans mêlange, étoit un peu plus colorée à la fin ; mais le goût du vin n'y étoit non plus presque pas reconnoissable.
Dans les pays chauds, il découle naturellement ou par incision faite au tronc des plus gros lierres, une gomme qui est de quelqu'usage en Medecine, & qui peut servir d'un bon dépilatoire.
Il n'y a qu'une seule espece de lierre dont on connoît trois variétés.
1°. Le lierre dont les cimes sont jaunes. C'est un accident passager qui est causé par le mauvais état de l'arbrisseau ; c'est une marque de sa langueur & de son dépérissement. J'ai vû des lierres affectés de cette maladie, périr au bout de deux ou trois ans ; & comme toutes les cimes étoient d'un jaune vif & brillant qui faisoit un bel aspect ; j'en tirai des plants, mais après quelques années ils dégénérerent & reprirent leur verdure naturelle.
2°. Le lierre à feuille panachée de blanc.
3°. Le lierre à feuille panachée de jaune. La beauté de ces deux variétés peut grandement contribuer à l'ornement d'un jardin ; elles ne sont nullement délicates, & on peut les multiplier en les greffant sur le lierre commun ; la greffe en approche leur réussit très aisément. Cet article est de M. DAUBENTON.
LIERRE DE BACCHUS, (Botan.) c'est le lierre à fruit jaune, ou pour parler noblement, à fruit doré, comme Pline s'exprime d'après Dioscoride & Théophraste ; nos botanistes modernes l'appellent aussi hedera dionysios. Il n'est pas moins commun en Grece, que le lierre ordinaire l'est en France ; mais les Turcs s'en servent aujourd'hui pour leurs cauteres, tandis qu'autrefois on l'employoit aux plus nobles usages. Ses feuilles, selon la remarque de Pline, sont d'un verd plus gai que celles du lierre ordinaire, & ses bouquets couleur d'or, lui donnent un éclat particulier. Ses feuilles cependant sont si semblables à celles du lierre commun, qu'on auroit souvent de la peine à les distinguer, si on ne voyoit le fruit, & peut-être que ces especes ne different que par la couleur de cette partie. Les piés qui ont levé de la graine jaune de ce lierre, semée dans le jardin royal de Paris, étoient semblables aux piés qui levent de la graine de notre lierre en arbre. Leurs feuilles étoient pareillement anguleuses ; cependant les fruits different beaucoup.
Ceux de lierre jaune sont, au rapport de M. Tournefort qui les a vûs sur les lieux, de gros bouquets arrondis, de deux ou trois pouces de diametre, composés de plusieurs grains sphériques, un peu angulaires, épais d'environ quatre lignes, & un peu applatis sur le devant, où ils sont marqués d'un cercle duquel s'éleve une pointe haute de demi-ligne.
La peau qui est feuille morte ou couleur d'ocre, est charnue ; elle renferme trois ou quatre graines séparées par des cloisons fort-minces ; chaque graine est longue d'environ deux lignes & demie, blanche en-dedans, grisâtre, veinée de noirâtre, & relevée de petites bosses en-dehors ; elles n'ont point de goût, & leur figure approche assez de celle d'un petit rein ; la chair qui couvre ces graines, est douçâtre d'abord, ensuite elle paroît mucilagineuse. On vend ces graines dans le marché aux herbes de Constantinople.
Le lierre qui produit ce fruit doré, étoit spécialement consacré à Bacchus, ou parce qu'il fut jadis caché sous cet arbre, ou par d'autres raisons que nous ignorons. Plutarque dans ses propos de table, dit que ce dieu apprit à ceux qui étoient épris de ses fureurs, à se couronner des feuilles de cet arbre, à cause de la vertu qu'elles ont d'empêcher qu'on ne s'enivre.
On en couronnoit aussi les poëtes, comme on le voit dans Horace, & dans la septieme éclogue de Virgile, sur laquelle Servius observe qu'on en agissoit ainsi, parce que les poëtes sont consacrés à Bacchus, & sujets comme lui à des enthousiasmes ; ou bien parce que l'éclat des beaux vers, semblable à celui du fruit de cet arbre, dure éternellement, & acquiert à leurs auteurs l'honneur de l'immortalité.
Il n'est pas surprenant que les bacchantes ayent autrefois employé le lierre pour garnir leurs thyrses & leurs coëffures. Toute la Thrace est couverte de ces sortes de plantes. (D.J.)
LIERRE TERRESTRE, (Botan.) plante dont plusieurs Botanistes modernes ont fait par erreur une des especes de lierre, à cause de quelque légere ressemblance qu'ils ont trouvée de ses tiges rampantes & de ses feuilles, avec celles du véritable lierre ; mais c'est un genre de plante particulier, que nos Botanistes appellent communément chamaeclema, & dont voici les caracteres.
Sa racine trace & pénetre fort avant dans la terre ; ses feuilles sont épaisses, arrondies, sillonnées & dentelées ; le casque de la fleur est droit, rond, fendu en deux ; la levre supérieure est découpée en deux ou trois segmens. Les fleurs naissent aux côtes des noeuds des tiges.
La plus commune espece de lierre terrestre est nommée par Tournefort, calamintha humilior, folio rotundiore, I. R. H. 194. chamaecissus sive hedera terrestris, par J. Bauh. 3. 855. chamaeclema vulgaris, par Boërh. J. A. 172. hedera terrestris, par C. B. Pin. 306. Park. Chab. Buxb. & autres.
Cette plante se multiplie le long des ruisseaux, dans les haies & dans les prés, par le moyen de ses jets quadrangulaires, rampans & fibreux. Elle pousse des tiges grêles, quarrées, rougeâtres, velues, qui prennent racine par de petites fibres. Sur ces tiges, naissent des feuilles opposées deux à deux, rudes, arrondies, à oreilles, larges d'un pouce, un peu velues, découpées, crénelées symmétriquement, & portées sur de longues queues.
Ses fleurs naissent aux noeuds des tiges, disposées par anneaux au nombre de trois, quatre, & même davantage, dans chaque aisselle des feuilles. Elles sont bleues, d'une seule piece, en gueule ; la levre supérieure est partagée en deux segmens, & est réfléchie vers les côtés ; l'inférieure est divisée en quatre. Leur tuyau est panaché de lignes & de taches pourprées-foncées, son ouverture est parsemée de poils courts & semblables à du duvet.
Le pistil de la fleur est grêle & fourchu. Le calice est oblong, étroit, rayé, & découpé sur les bords en cinq quartiers ; il se renfle quand la fleur est séchée ; il contient quatre semences oblongues, arrondies & lisses. Elle fleurit au mois d'Avril & de Mai.
Toute cette plante a une saveur amere, une odeur forte, qui approche en quelque maniere de la menthe. Elle est toute d'usage. On la regarde comme très-apéritive, détersive, discussive & vulnéraire, employée soit intérieurement, soit extérieurement. Les vertus qu'on lui attribue, dépendent les unes de son huile, & les autres de son sel essentiel, qui n'est pas fort différent du tartre vitriolé, mêlé avec un peu de sel ammoniacal. On prépare dans les boutiques une eau distillée, une conserve, un extrait, un syrop, des fleurs & des feuilles de cette plante.
LIERRE, GOMME DE, (Hist. nat. des drog. exot.) larme qui découle du lierre-en-arbre des pays chauds de l'Asie. Dioscoride l'appelle . Elle étoit connue des anciens Grecs, comme elle l'est encore des Grecs modernes. On la nomme improprement gomme ; c'est une substance résineuse, séche, dure, compacte, d'une couleur de rouille de fer foncée. Elle paroît transparente, rouge & parsemée de miettes rougeâtres quand on la brise en petits morceaux. Elle a un goût un peu âcre, légerement astringent & aromatique. Elle est sans odeur, si ce n'est lorsqu'on l'approche de la flamme ; car elle répand alors une odeur assez agréable qui approche de celle de l'encens, & elle jette une flamme claire qu'on a de la peine à éteindre.
On nous l'apporte de Perse, & autres pays orientaux, où on peut seulement la ramasser en certaine quantité. Je sais bien que Ray, Bauhin, Pomet, & autres, disent qu'on a trouvé de cette résine, ou de semblable, sur de vieux lierres, dans la province de Worcester, près de Genève & à Montpellier ; mais ces exemples ne prouvent autre chose, sinon que cette résine se voit rarement dans nos pays européens. Après tout, c'est une simple curiosité, car elle ne nous est d'aucun service. Les anciens la mettoient parmi les dépilatoires ; mais, comme elle n'a point cette vertu, il y a quelque erreur dans leurs manuscrits, ou bien ils entendoient quelque autre chose que ce que nous entendons par le mot françois. (D.J.)
LIERRE, hedera arborea, (Mat. med.) Les medecins ont attribué plusieurs vertus medicinales aux feuilles & aux baies de cette plante, sur-tout employées extérieurement, car ils en ont redouté l'usage intérieur, & ce fondés principalement sur l'autorité des anciens. Quelques-uns ont tenté cependant de les donner à petites doses, & ils prétendent avoir reconnu qu'elles possédoient une vertu diaphorétique & antipestilentielle ; quoi qu'il en soit, ce remede est d'un usage très-rare dans la pratique ordinaire de la Medecine.
Les feuilles de lierre ne sont presque employées que dans un seul cas ; on les applique assez ordinairement sur les cauteres. On croit qu'elles les garantissent d'inflammation, & qu'elles en augmentent l'écoulement ; peut-être ne fournissent-elles qu'une espece de compresse qui laisse appercevoir tout le pus ou toute la sérosité qui coulent de l'ulcere, parce qu'elle ne l'absorbe point.
Les anciens recommandoient les feuilles de lierre cuites dans du vin pour les brûlures & les ulceres malins, & pour résoudre les gonflemens & les duretés de la rate ; mais nous avons de meilleurs remedes contre les brûlures & les ulceres, voyez BRULURE & ULCERE ; & nous manquons d'observations sur les effets des applications extérieures dans les affections des visceres. Voyez TOPIQUE.
La larme résineuse, connue dans les boutiques sous le nom de gomme de lierre, découle dans les pays chauds de l'arbre qui fait le sujet de cet article. C'est une larme dure, séche, d'une couleur de rouille foncée : quand on la brise en petits morceaux, elle paroît transparente, rouge, & parsemée de petits points moins brillans ; elle a un goût un peu âcre, légerement astringent, & tant soit peu aromatique ; elle répand, quand on la brûle, une odeur agréable qui approche de l'encens.
La larme ou gomme de lierre n'est pas une résine pure ; car deux livres de cette matiere ont laissé dans la distillation, selon le rapport de Geoffroy, dix onces & cinq gros de résidu charbonneux, qui étant calciné à blancheur, a pesé encore sept gros & quarante grains ; or les résines pures ne donnent pas, à beaucoup près, dans la distillation un produit fixe si abondant. Voyez RESINE.
Nous employons fort peu la gomme de lierre, nous la faisons seulement entrer dans quelques préparations officinales ; par exemple, dans le baume de fioravanti, dans les pilules balsamiques de Stahl, & dans celles de Becker ; trois compositions qui se trouvent dans la pharmacopée de Paris. (b)
LIERRE TERRESTRE, (Mat. med.) les feuilles & les sommités de cette plante sont d'usage en Medecine. Elles sont ameres & un peu aromatiques ; elles donnent dans la distillation une eau aromatique d'une odeur assez desagréable & de peu de vertu, & une petite quantité d'huile essentielle. Elles ont été célébrées principalement par un prétendu principe balsamique ou même bitumineux, comme l'appelle Geoffroy, qu'on leur a supposé. Cependant cette plante est presque absolument extractive, selon l'éxamen chimique qu'en rapporte Cartheuser dans sa Matiere medicale. Il est vrai que le même auteur a observé que l'infusion, la décoction, & même l'extrait des feuilles de lierre terrestre retenoient l'odeur balsamique de la plante, & que toutes ces préparations avoient une saveur âcre, vive & pénétrante.
On peut juger par ces qualités extérieures, que l'usage du lierre terrestre peut être réellement salutaire dans plusieurs des maladies pour lesquelles il a été recommandé ; qu'il peut, par exemple, faciliter l'expectoration des glaires épaisses retenues dans les poumons, & être employé par conséquent utilement dans l'asthme humide, dans les phthisies commençantes, dans certaines toux violentes & opiniâtres, dans l'extinction de voix, &c. qu'il doit exciter la transpiration, les urines & les regles ; que la vertu la plus remarquable qu'on lui ait attribué, savoir celle de déterger & consolider les ulceres des parties internes, peut ne pas être absolument imaginaire.
Quant à la qualité lithontriptique qu'on lui a aussi accordée, nous la lui refuserons formellement avec la plus saine partie des Medecins modernes. Voyez LITHONTRIPTIQUE.
Cette plante se prescrit en décoction & en infusion, dans de l'eau ou dans du vin, depuis une pincée jusqu'à une demi-poignée pour trois ou quatre tasses, que l'on peut prendre le matin ou dans le cours de la journée dans des intervalles réglés.
On en donne aussi assez communément la décoction coupée avec pareille quantité de lait, sur-tout dans les maladies de poitrine.
Quelques medecins prescrivent aussi les feuilles seches réduites en poudre, à la dose de demi-gros jusqu'à un, prise deux fois le jour, avec l'eau distillée de la même plante, ou dans une autre liqueur appropriée. Willis propose ce remede pour la toux opiniâtre & la phthisie. Voyez sa Pharm. ration.
On fait avec les sommités de lierre terrestre, une conserve & un syrop simple, qui sont des remedes un peu plus doux que l'infusion & que la décoction ; on en prépare aussi un extrait qui a une saveur trop vive, comme nous l'avons déja observé, pour qu'on puisse le donner seul, mais qu'on peut faire entrer avec avantage dans les compositions magistrales sous forme solide. Les feuilles de cette plante entrent dans l'eau vulnéraire, & ses sommités dans le baume vulnéraire. (b)
|
| LIESINA | (Géog.) par les Esclavons Huar, île de Dalmatie dans le golfe de Venise, au fond du golfe de Tarente, à 8 milles de la terre-ferme. Elle n'a que 16 milles dans sa plus grande largeur, 70 de longueur, & 130 de circuit. Elle appartient aux Vénitiens. La petite ville de Liesina en est la capitale. (D.J.)
LIESINA, (Géog.) ville de Dalmatie, capitale de l'isle de même nom, avec titre de comté, & un évêché suffragant de Spalatro. Elle est bâtie au pié de deux montagnes, n'a point d'enceinte de murailles, & est dominée par une forteresse. Longit. 34. 58. lat. 43. 30. (D.J.)
|
| LIESS | ou NOTRE-DAME DE LIESSE, Nostra Domina de Laetitia, (Géog.) les actes de Charles VI. roi de France, écrits par un moine de son tems, nomment ce lieu Liens ; nos anciennes tables géographiques l'appellent Liance ou Lience, que le peuple a changé vraisemblablement en celui de Liesse, à ce que pense M. de Valois dans sa Notit. Gall. pag. 275.
Quoi qu'il en soit, c'est un bourg de France en Picardie, au diocèse de Laon, & à trois lieues E. de cette ville ; il est très-connu par une image de la sainte Vierge, qui y attire les pélerinages de petit peuple, & l'entretient dans l'oisiveté. Il vaudroit bien mieux qu'il fût remarquable par quelque bonne manufacture, qui occupât les habitans & les mît à l'aise. Long. 21. 30. lat. 49. 36. (D.J.)
|
| LIESSIES | Laetitia, (Géog.) petite ville, ou plutôt bourg du Hainaut, remarquable par son abbaye de Bénédictins, fondée en 751. Ce lieu a pris son nom des peuples qu'on nommoit Laeti, & qui faisoient une partie des Nerviens. Liessies est sur la petite riviere d'Hespres, diocèse de Cambray, à 4 lieues de Maubeuge, & à 8 lieues S. de Mons. Long. 21. 34. lat. 50. 18. (D.J.)
|
| LIEU | locus, s. m. (en Philosophie) c'est cette partie de l'espace immobile qui est occupée par un corps. Voyez CORPS & ESPACE.
Aristote & ses sectateurs divisent le lieu en interne & en externe.
Le lieu interne est cet espace ou cette place qu'un corps contient.
Le lieu externe est celui qui renferme le corps : Aristote l'appelle encore la premiere surface concave & immobile du corps environnant.
On dispute fort dans les écoles sur la question du lieu interne. On demande, si c'est un être réel qui existe indépendamment des corps, ou seulement un être imaginaire ; c'est-à-dire, si c'est seulement une aptitude & une capacité de recevoir des corps ?
Il y en a qui soutiennent que c'est un être positif, incorporel, éternel, indépendant & infini ; & ils poussent leur assertion jusqu'à prétendre que le lieu interne constitue l'immensité de Dieu.
Les Cartésiens, au contraire, soutiennent que le lieu interne, considéré par abstraction, n'est pas différent de l'étendue des corps qui y sont contenus, & qu'ainsi il ne differe en rien des corps eux-mêmes. Voyez MATIERE.
Les Scholastiques mettent pareillement en question, si le lieu externe est mobile ou immobile. On déduit son immobilité de cette considération, que tout ce qui se meut doit nécessairement quitter sa place ; ce qui ne pourroit arriver, si le lieu s'en alloit avec le mobile ; car si le lieu se mouvoit avec le mobile, le mobile ne changeroit pas de place. D'autres traitent d'absurde cette opinion d'Aristote ; ils prétendent que si un corps en mouvement change de lieu en ce sens qu'il répond continuellement par la surface extérieure à différens corps ou à différentes parties de l'espace, on devroit dire par la même raison qu'un corps réellement en repos change continuellement de place.
Par exemple, qu'une tour dans une plaine, ou un rocher au milieu de la mer, sont continuellement en mouvement, ou changent de place, à cause que l'un & l'autre sont perpétuellement enveloppés de nouvel air ou de nouvelle eau.
Pour résoudre cette difficulté, on a eu recours à une infinité d'expédiens. Les Scotistes tiennent que le lieu n'est immobile qu'équivalemment. Ainsi, disent-ils, quand le vent souffle, il est vrai que l'air qui environne la surface de la tour s'en éloigne ; mais tout de suite un autre air semblable & équivalent en prend la place. Les Thomistes aiment mieux déduire l'immobilité du lieu externe, de ce qu'il garde toujours la même distance au centre & aux points cardinaux du monde. Les Nominaux prétendent que l'immobilité du lieu externe consiste dans une correspondance avec certaine partie virtuelle de l'immensité divine. Nous passons légerement sur toutes ces rêveries qui doivent nécessairement trouver leur place dans un ouvrage destiné à l'histoire de l'esprit humain, mais qui ne doivent aussi y occuper que très-peu d'espace.
Les Cartésiens nient absolument que le lieu externe soit une surface environnante ou un corps environné : ils prétendent que c'est seulement la situation d'un corps parmi d'autres corps voisins, considéré comme en repos. Ainsi la tour, disent-ils, sera réputée rester dans le même lieu, quoique l'air environnant soit changé, puisqu'elle conserve toujours la même situation par rapport aux montagnes, aux arbres & aux autres parties de la terre qui sont en repos. Voyez MOUVEMENT.
Il est visible que la question du lieu tient à celle de l'espace. Voyez ESPACE & ÉTENDUE.
Les Cartésiens ont raison, si l'espace & l'étendue ne sont rien de réel & de distingué de la matiere ; mais si l'étendue ou l'espace & la matiere sont deux choses différentes, il faut alors regarder le lieu comme une chose distinguée des corps, & comme une partie immobile & pénétrable de l'espace indéfini : on peut voir aux articles cités la discussion de cette opinion ; il est certain que suivant notre maniere ordinaire de concevoir, & indépendamment de toute subtilité philosophique, il y a un espace indéfini que nous regardons comme le lieu général de tous les corps, & que les différentes parties de cet espace, lesquelles sont immobiles, sont le lieu particulier des différens corps qui y répondent. Au reste, comme on l'a remarqué au mot ÉLEMENS DES SCIENCES, cette question du lieu est absolument inutile à la théorie du mouvement tel que tous les hommes le conçoivent. Quoi qu'il en soit, c'est de cette idée vulgaire & simple de l'espace & du lieu qu'on doit partir quand on voudra donner une notion simple & claire du mouvement.
C'est aussi d'après cette idée que M. Newton distingue le lieu en lieu absolu & en lieu relatif.
Le lieu absolu est cette partie de l'espace infini & immobile qui est occupée par un corps.
Le lieu relatif est l'espace qu'occupe un corps considéré par rapport aux autres objets qui l'environnent.
M. Locke observe que le lieu se prend aussi pour cette portion de l'espace infini que le monde matériel occupe ; il ajoute cependant que cet espace seroit plus proprement appellé étendue.
La véritable idée du lieu, selon lui, est la position relative d'une chose par rapport à sa distance de certains points fixes ; ainsi nous disons qu'une chose a ou n'a pas changé de place ou de lieu, quand sa distance n'a point changé par rapport à ces points. Quant à la vision du lieu des corps. Voyez VISION & VISIBLE.
Lieu dans l'optique ou lieu optique, c'est le point auquel l'oeil rapporte un objet.
Ainsi les points D, E, (Pl. opt. fig. 68.) auxquels deux spectateurs en d & en e rapportent l'objet C, sont appellés lieux optiques. Voyez VISION.
Si une ligne droite joignant les lieux optiques D, E, est parallele à une ligne droite qui passe par les yeux des spectateurs d, e, la distance des lieux optiques D, E sera à la distance des spectateurs d, e, comme la distance E C est à la distance C e.
Le lieu optique ou simplement le lieu d'une étoile ou d'une planete, est un point dans la surface de la sphere du monde, comme C ou B (Pl. ast. fig. 27.) auquel un spectateur placé en E ou en I, rapporte le centre de l'étoile ou de la planete S. Voyez ÉTOILE, PLANETE, &c.
Ce lieu se divise en vrai & en apparent. Le lieu vrai est ce point B de la surface de la sphere où un spectateur, placé au centre de la terre, voit le centre de l'étoile ; ce point se détermine par une ligne droite, tirée du centre de la terre par le centre de l'étoile, & terminée à la sphere du monde. Voyez SPHERE.
Le lieu apparent, est ce point de la surface de la sphere, où un spectateur placé sur la surface de la terre en E, voit le centre de l'étoile S. Ce point C se trouve par le moyen d'une ligne qui va de l'oeil du spectateur à l'étoile, & se termine dans la sphere des étoiles. Voyez APPARENT.
La distance entre ces deux lieux optiques, savoir le vrai & l'apparent, fait ce qu'on appelle la parallaxe. Voyez PARALLAXE.
Le lieu astronomique du soleil, d'une étoile ou d'une planete, signifie simplement le signe & degré du zodiaque, où se trouve un de ces astres. Voyez SOLEIL, ÉTOILES, &c.
Ou bien c'est le degré de l'écliptique, à compter du commencement d'Aries, qui est rencontré par le cercle de longitude de la planete ou de l'étoile, & qui par conséquent indique la longitude du soleil, de la planete ou de l'étoile. Voyez LONGITUDE.
Le sinus de la plus grande déclinaison du soleil, qui est environ 23°. 30'. est au sinus d'une déclinaison quelconque actuelle, donné ou observé, par exemple, 23°. 15', comme le rayon est au sinus de la longitude ; ce qui donneroit, si la déclinaison étoit septentrionale, le 20°. 52'. des gémeaux ; & si elle étoit méridionale, 20°. 52'. du capricorne pour le lieu du soleil.
Le lieu de la lune est le point de son orbite où elle se trouve en un tems quelconque. Voyez LUNE & ORBITE.
Le lieu est assez long à calculer à cause des grandes inégalités qui se rencontrent dans les mouvemens de la lune, ce qui exige un grand nombre d'équations & de réductions avant que l'on trouve le lieu vrai. Voyez ÉQUATION & LUNE.
Le lieu excentrique d'une planete dans son orbite, est le lieu de l'orbite où paroîtroit cette planete, si on la voyoit du soleil. Voyez EXCENTRIQUE.
Ainsi supposons que N E O R (Pl. ast. fig. 26.) soit le plan de l'écliptique, N P O Q, l'orbite de la planete, le soleil en S, la terre en T, & la planete en P ; la ligne droite S P donne le lieu excentrique dans l'orbite.
Le lieu héliocentrique d'une planete ou son lieu réduit à l'écliptique, ou bien le lieu excentrique dans l'écliptique, est ce point de l'écliptique, auquel on rapporte une planete vue du soleil. Voyez HELIOCENTRIQUE.
Si on tire la perpendiculaire P S à l'écliptique, la ligne droite R S, indique le lieu héliocentrique ou le lieu réduit à l'écliptique.
Le lieu géocentrique est ce point de l'écliptique, auquel on rapporte une planete vue de la terre. Voyez GEOCENTRIQUE.
Ainsi NEOR représentant l'écliptique, &c. T, R donnera le lieu géocentrique. Sur le calcul du lieu d'une planete, voyez PLANETE, ÉQUATION, &c. Chambers. (O)
LIEU GEOMETRIQUE, signifie une ligne par laquelle se résout un problème géométrique. Voyez PROBLEME & GEOMETRIQUE.
Un lieu est une ligne dont chaque point peut également résoudre un problème indéterminé. S'il ne faut qu'une droite pour construire l'équation du problème, le lieu s'appelle alors lieu à la ligne droite ; s'il ne faut qu'un cercle, lieu au cercle ; s'il ne faut qu'une parabole, lieu à la parabole ; s'il ne faut qu'une ellipse, lieu à l'ellipse ; & ainsi des autres, &c.
Les anciens nommoient lieux plans, les lieux des équations qui se réduisent à des droites ou à des cercles ; & lieux solides ceux qui sont ou des paraboles, ou des hyperboles, ou des ellipses.
M. Wolf donne une autre définition des lieux, & il les range en différens ordres, selon le nombre de dimensions auxquelles la quantité indéterminée s'éleve dans l'équation. Ainsi ce sera un lieu du premier ordre, si l'équation est x = ; un lieu du second ordre, si c'est y2 = a x, ou y2 = a2 - x2, &c. un lieu du troisieme, si on a pour équation y3 = a2 x, ou y3 = a x2 - x3... &c.
Pour mieux concevoir la nature des lieux géométriques, supposons deux droites inconnues & variables A P, P M (Pl. d'analyse, fig. 29, 30), qui fassent entr'elles un angle donné quelconque. A P M, dont nous nommerons l'une, par exemple A P, qui a son origine fixe en A, & qui s'étend indéfiniment dans une direction donnée, x, & l'autre P M, qui change continuellement de position & de grandeur, mais qui reste toujours parallele à elle-même, y. Supposons de plus une équation qui ne contienne d'inconnues que ces deux quantités x, y, mêlées avec des quantités connues, & qui exprime le rapport de la variable A P, x, à la valeur de P M, ou de l'y correspondante ; enfin imaginons qu'à l'extrémité de chaque valeur possible de x, on ait tracé en effet l'y correspondante que cette équation détermine ; la ligne droite ou courbe qui passera par les extrémités de toutes les y ainsi tracées, ou par tous les points M, sera nommée en général lieu géométrique, & lieu de l'équation proposée en particulier.
Toutes les équations dont les lieux sont du premier ordre peuvent se réduire à quelqu'une des quatre formules suivantes : 1°. y = : 2°. y = + c : 3°. y = - c : 4°. y = c - , dans lesquelles la quantité inconnue y est supposée toujours avoir été délivrée de fractions, la fraction qui multiplie l'autre inconnue x est supposée réduite à cette expression b/a ; & tous les autres termes sont comme censés réduits à celui + c. Le lieu de la premiere formule est d'abord déterminé, puisqu'il est évident que c'est une droite qui coupe l'axe dans son origine A, & qui fait avec lui un angle tel que les deux inconnues x, y soient toûjours entr'elles comme a est à b. Or supposant ce premier lieu connu, il faudra pour trouver celui de la seconde formule y = + c, prendre d'abord sur la ligne A P (fig. 31.), une partie A B = a, & tirer B E = b & A D = c paralleles à P M. Vous tirerez ensuite du même côté que A P & vers E la ligne A E d'une longueur indéfinie, & la ligne droite & indéfinie D M parallele à A E ; je dis que la ligne D M est le lieu de l'équation, ou la formule que nous voulions construire. Car si par un point quelconque M de cette ligne, on tire M P parallele à A Q, les triangles A B E, A P F, seront semblables ; ce qui donnera A B, a, B E, b : : A P, x. P F = , & par conséquent P M (y) = P F () + F M (c). Si on fait c = 0, c'est-à-dire si les points D A tombent l'un sur l'autre, & D M sur A F, la ligne A F sera alors le lieu de l'équation y = . Pour trouver le lieu de la troisieme formule, il faudra s'y prendre de cette sorte : vous ferez A B = a (fig. 32.) & vous tirerez les droites B E = b, A D = c paralleles à P M, l'une de l'un des côtés de A P, & l'autre de l'autre côté : par les points A, E, vous tirerez la droite A E, que vous prolongerez indéfiniment vers E, & par le point D la ligne D M, parallele à A E, je dis que la droite indéfinie G M sera le lieu cherché. Car nous aurons toûjours P M (y) = P F, () - F M (c). Enfin pour trouver le lieu de la quatrieme formule, sur A P (fig. 33.), vous prendrez A B = a, & vous tirerez B E = b, & A D = c, l'une d'un des côtés de A P, & l'autre de l'autre côté. De plus, par les points A, E, vous tirerez A E, que vous prolongerez indéfiniment vers E, & par le point D la ligne D M parallele à A E, je dis que D G sera le lieu cherché. Car si par un de ses points quelconques M on tire la ligne M P parallele à A Q, on aura toûjours P M (y) = F M (c) - P F ().
Il s'ensuit de là qu'il n'y a de lieu du premier degré que les seules lignes droites ; ce qui peut se voir facilement, puisque toutes les équations possibles du premier degré se réduisent à l'une des formules précédentes.
Tous les lieux du second degré ne peuvent être que des sections coniques, savoir la parabole, l'ellipse ou le cercle, qui est une espece d'ellipse, & l'hyperbole, qui dans certains cas devient équilatere : si on suppose donc donnée une équation indéterminée, dont le lieu soit du second degré, & qu'on demande de décrire la section conique qui en est le lieu ; il faudra commencer par considérer une parabole, une ellipse & une hyperbole quelconque, en la rapportant à des droites ou des coordonnées, telles que l'équation qui en exprimera la nature, se trouve être par là la plus composée & la plus générale qu'il soit possible. Ces équations les plus générales, ou ces formules de trois sections coniques & de leurs subdivisions étant découvertes, & en ayant examiné les caracteres, il sera aisé de conclure à laquelle d'entr'elles se rapportera l'équation proposée, c'est-à-dire quelle section conique cette même équation aura pour lieu. Il ne s'agira plus après cela que de comparer tous les termes de l'équation proposée avec ceux de l'équation générale du lieu, auquel on aura trouvé que cette équation se rapporte, cela déterminera les coefficiens de cette équation générale, ou ce qui est la même chose, les droites qui doivent être données de proportion & de grandeur pour décrire le lieu ; & ces coefficiens, ou ces droites étant une fois déterminées, on décrira facilement le lieu, par les moyens que les traités des sections coniques fournissent.
Par exemple que A P, x, P M, y soient deux droites inconnues & variables (fig. 34) ; & que m, p, r, s, soient des droites données ; sur la ligne A P, prenez la portion A B = m, & tirez B E = n, A D = r ; & par le point A, tirez A E = e, & par le point D, la ligne indéfinie D G parallele à A E ; sur D G, prenez D C = s, & prenant C G pour diametre, les ordonnées paralleles à P M, & la ligne C H = p pour parametre, décrivez la parabole C M, & elle sera le lieu de la formule générale suivante.
y y - x y + x x = 0.
- 2 r y + . x
- x
+ r r
+ p s.
car si d'un de ses points quelconques M on tire l'ordonnée P M, les triangles A B E, A P F, seront semblables, & par conséquent
A B (m) : A E (e) : : A P (x) : A F ou D G = & A B (m) : B E (n) : : A P (x) : P F = , & par conséquent G M ou P M - P F - F G = y - - r, & C G ou D G - D C = - s. Mais par la nature de la parabole = CG x CH; & cette derniere équation deviendra la formule générale elle-même, si on y substitue à la place des droites qui sont employées, leurs valeurs marquées ci-dessus.
Cette équation est la plus générale qui puisse appartenir à la parabole, puisqu'elle renferme 1°. le quarré de chacune des inconnues x, y ; 2°. le produit x y de l'une par l'autre ; 3°. les inconnues linéaires x, y, & un terme tout constant. Une équation du second degré, ou les indéterminées x, y, se trouvent mêlées, ne sauroit contenir un plus grand nombre de termes.
Par le point fixe A, tirez la droite indéfinie A Q, (fig. 35.) parallele à P M ; prenez A B = m, tirez B E = n parallele à A P, & par les points déterminés A E, la droite A E = e ; sur A P, prenez A D = r, tirez la droite indéfinie D G, parallele à A E, & prenez la portion D C = s. Enfin prenant pour diametre C G, & supposant les ordonnées paralleles à A P, & pour parametre la ligne C H = p, décrivez une parabole C M ; cette parabole seroit le lieu de cette seconde équation ou formule.
x x - y x + y y = o.
- 2 r x - y
+ r r
+ p s.
car si d'un point quelconque M on tire la droite M Q parallele à A P, on aura A B (m) : A E (e) : : A Q ou P M (y) : A F ou D G = & A B (m) : B E (n) : : A Q (y) : Q F = , & par conséquent G M ou Q M - Q F - F G = x - - r ; & C G ou D G - D C = - s : & ainsi par la propriété de la parabole, vous trouverez encore la seconde des équations générales ou des formules précédentes ; & vous vous y prendrez de la même sorte, pour trouver les équations générales ou les formules des autres sections coniques.
Si on demande maintenant de décrire la parabole qui doit être le lieu de l'équation suivante, que nous supposerons donnée y y - 2 a y - b x + c c = 0, comme y y se trouve ici sans fraction, de même que dans notre premiere formule, il vaudra mieux comparer la proposée avec cette premiere formule qu'avec l'autre ; & d'abord puisque le rectangle x y ne se trouve point dans la proposée, ou qu'il peut y être censé multiplié par 0, nous en conclurons que la fraction doit être = 0, & par conséquent aussi qu'on doit avoir n, ou B E = 0 ; desorte que les points B, E, doivent être co-incidens, ou que la droite A E doit tomber sur A B & lui être égale, c'est-à-dire que m = e : détruisant donc dans la formule tous les termes affectés de n/m ou de n, & substituant par-tout m à la place de e, elle se changera en y y - 2 r y - p x + r r + p s = 0, & comparant encore les termes correspondans - 2 r y, & - 2 a y, - p x & - b x, enfin r r + p s, & c c, nous aurons r = a, p = b, & en substituant ces valeurs dans la derniere équation de comparaison, a a + b s = c c, ou bien s = , qui par conséquent sera une quantité négative, si a est plus grand que c, comme nous le supposons ici. Il ne serviroit de rien de comparer les deux premiers termes, parce qu'étant les mêmes des deux côtés, savoir y y, cette comparaison ne pourroit rien faire découvrir.
Or les valeurs de m, n, r, p, s, ayant été ainsi trouvées, on construira facilement le lieu cherché par les moyens qui nous ont servi à la construction de la formule & de la maniere suivante, comme B E (n) est = 0 (fig. 36.) & que les points B, E, coincident, ou que A E tombe sur A P, il faudra par cette raison tirer du point A la droite A D (r) parallele à P M & = a, & la droite D G parallele à A P, dans laquelle vous marquerez la droite D C (s) = , laquelle doit être prise au-delà de l'origine, dans un sens opposé à D G ou A P, parce que la fraction est négative par la supposition. Ensuite regardant D C comme diametre, prenant des ordonnées paralleles à P M, & la droite C H (p) = b pour parametre ; vous décrirez une parabole, je dis qu'elle sera le lieu de l'équation donnée, & il est en effet aisé de le prouver. Si c'eût été le quarré x x qui se fût trouvé tout-d'un-coup sans fraction dans la proposée, il auroit été alors plus naturel de se servir de la seconde formule. On voit au reste qu'au moyen d'une division fort facile, on peut délivrer des fractions tel des deux quarrés qu'on voudra ; & il faudroit commencer par cette division, si l'on voyoit que la comparaison des termes en dût devenir plus simple.
Voilà une idée de la méthode de construire les lieux des équations lorsqu'ils doivent être des sections coniques, ou ce qui est la même chose, lorsque les équations ne passent pas le second degré : car on doit sentir que les lieux à l'ellipse & à l'hyperbole, doivent se déterminer par une méthode semblable.
Mais une pareille équation étant donnée, au lieu de demander comme tout-à-l'heure, d'en construire le lieu, si on se contente de demander quelle doit être l'espece de la section conique qui en est le lieu, si c'est une parabole, une ellipse ou même un cercle, un hyperbole équilatere, ou non équilatere, il faudroit pour en juger, commencer par faire passer d'un même côté tous les termes de l'équation, de façon qu'il restât zero de l'autre côté ; & cela étant fait, il pourroit se présenter deux cas différens.
Premier cas ; supposons que le rectangle x y, ne se trouve point dans l'équation ; alors 1°. s'il n'y a qu'un des deux quarrés y y, ou x x, le lieu sera une parabole. 2°. Si les deux quarrés s'y trouvent tout-à-la-fois & avec le même signe, le lieu sera une ellipse, & en particulier un cercle, lorsque ni l'un ni l'autre des deux quarrés n'aura de coefficient, ou (si on n'avoit point réduit l'un d'eux à n'en point avoir), lorsqu'ils auront les mêmes coefficiens, & que de plus l'angle des coordonnées sera droit. 3°. si les deux quarrés x x, & y y se trouvent dans l'équation, & avec des signes différens, le lieu sera une hyperbole laquelle deviendra équilatere dans les mêmes suppositions, qui font de l'ellipse un cercle.
Second cas ; quand le rectangle x y se trouve dans l'équation, alors 1°. s'il ne s'y trouve aucun des deux quarrés, qu'il ne s'y en trouve qu'un, ou encore qu'ils s'y trouvent tous deux avec différens signes, ou enfin que s'y trouvant tous deux avec les mêmes signes, le quarré du coefficient qui multiplie x y, soit plus grand que le quadruple du rectangle des coefficiens de x x & y y, dans toutes ces suppositions le lieu sera une hyperbole. 2°. Si ces deux quarrés s'y trouvant toujours, & étant de même signe ; si le quarré du coefficient x y, est plus petit que le quadruple du rectangle des coefficiens de x x & y y, le lieu sera alors une ellipse. 3°. Enfin, si dans la même supposition ce quarré & le quadruple du rectangle dont nous venons de parler, sont égaux entr'eux, le lieu sera alors une parabole.
Cette méthode de construire les lieux géometriques, en les rapportant aux équations les plus composées qu'il soit possible, est dûe à M. Craig, auteur anglois, qui l'a publiée le premier dans son traité de la quadrature des courbes, en 1693. Elle est expliquée fort au long dans le septieme & le huitieme livre des sections coniques de M. le Marquis de l'Hôpital, qui sans doute en auroit fait honneur au géometre anglois, s'il eût eu le tems de mettre la derniere main à son ouvrage.
M. Guisnée, dans son application de l'Algebre à la Géométrie, donne une autre méthode pour construire les lieux géométriques. Elle est plus commode à certains égards que la précédente, en ce qu'elle apprend à construire tout d'un coup & immédiatement une équation donnée, sans la rapporter à une équation plus générale ; mais d'un autre côté elle demande aussi dans la pratique plus de précaution pour ne se point tromper.
Nous ne devons pas oublier de dire que M. l'abbé de Gua, dans les usages de l'analyse de Descartes, pag. 342, remarque une espece de faute qu'on pourroit reprocher aux auteurs qui ont écrit jusqu'ici sur la construction des lieux géométriques, & fait voir cependant que cette faute n'a point dû tirer à conséquence dans les regles ou les méthodes que ces auteurs ont données.
Cette faute, qu'il seroit trop long de détailler ici, consiste en général en ce que ces auteurs n'ont enseigné à réduire à l'hyperbole entre ses asymptotes, que les lieux où il manque un des quarrés x, y. On peut réduire à l'hyperbole entre ses asymptotes une équation même qui contiendroit ces deux quarrés, mais alors aucune des deux asymptotes ne seroit parallele à la ligne des x, ni à celle des y. Voyez TRANSFORMATION DES AXES ; voyez aussi sur les lieux en général, & sur ceux aux sections coniques en particulier ; les articles COURBE, EQUATION, CONIQUE, ELLIPSE, CONSTRUCTION, &c. (O)
LIEUX-COMMUNS, (Rhétor.) ce sont dans l'art oratoire, des recueils de pensées, de réflexions, de sentences, dont on a rempli sa mémoire, & qu'on applique à propos aux sujets qu'on traite, pour les embellir ou leur donner de la force. Démosthène n'en condamne pas l'emploi judicieux ; il conseille même aux orateurs qui doivent souvent monter sur la tribune pour y traiter différens sujets, de faire une provision d'exordes & de péroraisons. Cicéron, (& nous n'avons rien au dessus de ses préceptes, ni peut-être de ses exemples) vouloit, de plus que Démosthène, qu'on eût des sujets entiers traités d'avance & des discours préparés dans l'occasion, aux noms & aux circonstances près ; mais ces beaux génies n'avoient-ils pas un fond assez riche dans leur propre enthousiasme, & dans la fécondité de leurs talens, sans recourir à ces sortes de ressources ? Il semble que leur méthode ne pouvoit guere être d'usage que pour les esprits médiocres qui faisoient à Athènes & à Rome une espece de trafic de l'éloquence. Cette même méthode serviroit encore moins dans notre barreau, où l'on ne traite que de petits objets de droit écrit & de droit coutumier, dans lesquels il ne s'agit que d'exposer ses demandes ou ses moyens d'appel, selon les regles de la jurisprudence des lieux. (D.J.)
LIEUX, les, s. m. pl. (Archit. mod.) terme synonyme à aisance, commodités, privés. Voyez ces trois mots.
On pratique ordinairement les lieux à rez-de-chaussée, au haut d'un escalier ou dans les angles. Dans les grands hôtels & dans les maisons commodes, on les place dans de petits escaliers, jamais dans les grands ; dans les maisons religieuses & de communauté, les aisances sont partagées entre plusieurs cabinets de suite, avec une cuillier de pierre, percée pour la décharge des urines.
Elles doivent être carrelées, pavées de pierre ou revêtues de plomb, & en pente du côté du siege, avec un petit ruisseau pour l'écoulement des eaux dans la chaussée, percée au bas de la devanture.
On place présentement les aisances dans les garderobes, où elles tiennent lieux de chaises percées : on les fait de la derniere propreté, & en forme de baguette, dont le lambris se leve & cache la lunette. La chaussée d'aisance est fort large & fort profonde, pour empêcher la mauvaise odeur : on y pratique aussi de larges ventouses ; le boisseau qui tient à la lunette est en forme d'entonnoir renversé, & soutenu par un cercle de cuivre à feuillure, dans lequel s'ajuste une soupape de cuivre, qui s'ouvre & se ferme en levant & fermant le lambris du dessus, ce qui empêche la communication de la mauvaise odeur. On pratique dans quelque coin de ces lieux, ou dans les entresolles au-dessus, un petit réservoir d'eau, d'où l'on amene une conduite, à l'extrémité de laquelle est un robinet qui sert à laver les urines qui pourroient s'être attachées au boisseau & à la soupape. On pratique aussi une autre conduite qui vient s'ajuster dans le boisseau, & à l'extrémité de laquelle est un robinet. Ce robinet se tire au moyen d'un registre vers le milieu du boisseau, ce qui sert à se laver à l'eau chaude & à l'eau froide, suivant les saisons. Ces robinets s'appellent flageolets, & ces aisances lieux à l'angloise, parce que c'est aux Anglois qu'on en doit l'invention. (D.J.)
LIEU, (Maréch.) ce terme se dit de la posture & de la situation de la tête du cheval ; ainsi un cheval qui porte en beau lieu, ou simplement qui porte beau, est celui qui soutient bien son encolure, qui l'a élevée, & tournée en arc comme le cou d'un cygne, & qui tient la tête haute sans contrainte, ferme & bien placée. Voyez ENCOLURE.
LIEU HILEGIAUX, en terme d'Astrologie, sont ceux qui donnent à la planete qui s'y trouve le pouvoir de dominer sur la vie qu'on lui attribue. Voyez HILEGIAU.
LIEU, terme de Pêche, sorte de poisson du genre des morues, & semblable aux éperlans, excepté qu'il est plus gros & plus ventru, & que sa peau est beaucoup plus noire. Cette pêche commence à Pâques, & finit à la fin de Juin, parce qu'alors les Pêcheurs s'équipent pour la pêche du congre ; ce sont les grands bateaux qui y sont employés ; la manoeuvre de cette pêche est particuliere ; il faut du vent pour y réussir, & que le bateau soit à la voile ; on amorce les ains ou hameçons d'un morceau de peau d'anguille, en forme de petite sardine ; le lieu qui est fort vorace & goulu, n'a pas le tems par la dérive du bateau d'examiner l'appât & de le dévorer ; ainsi il sert à faire la pêche de plusieurs lieux.
On sale ce poisson pendant deux jours, après l'avoir dépouillé de sa tête & ouvert par le ventre. Deux fois vingt-quatre heures après on le retire du sel, on le lave dans l'eau de mer, & on l'expose à terre au soleil pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il soit sec ; quand son apprêt est fini, on le met en grenier, & les Pêcheurs le viennent vendre à la saint Michel aux marchands d'Audierne qui l'achetent depuis sept jusqu'à dix livres le cent pesant ; ces derniers le mettent en paquets de deux quintaux pesant, & l'envoient ensuite à leur risque à Bordeaux en tems de foire.
Ce poisson au contraire du congre sec qui déperit continuellement par les mites qui le consomment, ne déperit point par la garde ; quand il est une fois bien sec, il augmente de poids par l'humidité ; la consommation s'en fait en France ; on prépare le lieu sec comme on fait la morue de même qualité.
Les Pêcheurs sont tous à la part ; le bateau, le maître & chaque matelot n'ont chacun également qu'un lot.
Ils ont de cinq principales especes d'ains ; les plus gros semblables à ceux des Pêcheurs de Terre-neuve sur le Banc, servent à la pêche des congres & des posteaux ; les deuxiemes à prendre les lieux ; les troisiemes pour la pêche des vieilles ; les quatriemes hameçons ou claveaux servent à prendre des dorées, des plombs, & autres semblables poissons, dont les chairs servent de boîte & d'appât aux claveaux, & les plus petits pour les moindres dorées qui servent aussi à boiter ; cette derniere sorte d'hameçons & plusieurs autres moindres servent pour le même usage.
|
| LIEUE | S. f. (Géog.) sorte de mesure itinéraire dont se servent les François & les Espagnols, pour marquer la distance d'un lieu à un autre. Les Anglois, les Italiens, les Allemands, &c. usent du mot de mille, quoiqu'ils ne donnent pas la même étendue à leurs milles. Il en est de même des lieues françoises ; la lieue gauloise étoit de quinze cent pas romains ; la lieue commune de France est de deux mille, la grande de trois mille cinq cent, & même plus.
Vigenere & M. d'Ablancourt ne sauroient être approuvés dans leurs évaluations des lieues. L'un & l'autre, en traduisant les auteurs latins, évaluent toûjours quatre milles anciens à une lieue, premiere faute ; & secondement ils confondent le mille romain avec le mille italique.
Ménage dérive le mot de lieue de leuca, leuga, ou lega, c'est tout comme il voudra ; mais il faut remarquer que ces trois mots ont été inconnus aux auteurs de la bonne latinité, & que ce sont ceux de la basse-latinité qui s'en sont les premiers servis.
Il est encore à propos d'observer, que les mots leg. lega, & leuga, désignent dans Antonin, une lieue de quinze cent pas : cependant quelquefois, & non pas toûjours (comme l'a imaginé Zurita), le mot leg signifie dans l'itinéraire de ce géographe, legio, légion, & cela est clair ; quand après le mot leg est ajouté le mot ala, ou des nombres, comme I. IX. XI. XIV. &c. suivis des noms italica, ionia, gemina, & autres semblables, qui sont certainement des noms de légions, le bon sens aidé d'un peu de savoir, fera sans peine ce discernement, & distinguera sans erreur les passages d'Antonin, où il s'agit de légions, de ceux qui désignent les distances par lieues.
Il me reste à rapporter nos diverses lieues de France à un degré de l'équateur.
Or, les lieues communes de France, de trois milles romains, ou de 2282 toises, sont de 25 au degré, plus 15 toises.
Les lieues de Paris, de Sologne, de Touraine, de 2000 toises, sont de 28 un quart au degré.
Les lieues de Beauce, de Gatinois, contenant 1700 toises, sont de 34 au degré.
Les lieues de Bretagne, d'Anjou, comprennent 2300 toises, & sont de 24 trois quarts au degré.
Les lieues de Normandie, de Champagne, sont de 25 au degré.
Les lieues de Picardie contiennent 2250 toises, & sont de 25 au degré, plus 810 toises.
Les lieues d'Artois, sont de 28 au degré.
Les lieues du Maine, du Perche, du Poitou, sont de 24 au degré.
Les lieues du Berry, sont de 26 au degré, moins un onzieme.
Les lieues de Bourbonnois, sont de 23 au degré.
Les lieues de Lyonnois, contiennent 2450 toises, & sont de 23 au degré, plus 710 toises.
Les lieues de Bourgogne, sont de 21 & demi au degré.
Les lieues de Gascogne & de Provence, contiennent 3000 toises, & sont de 19 au degré ; voilà nos plus grandes lieues. (D.J.)
LIEUES mineures de longitude, (Géog. & Navig.) c'est ce qu'on appelle autrement milles de longitude, ou côté mécodynamique. Voyez MILLE DE LONGITUDE, CODYNAMIQUEIQUE. C'est le chemin qu'un vaisseau fait réellement en longitude, c'est-à-dire la somme des petites portions de paralleles à l'équateur qu'il parcourt durant sa route ; on appelle ce chemin lieues mineures, pour le distinguer des lieues majeures, qui ne sont autre chose que le même chemin fait en longitude, & estimé par un arc de l'équateur, c'est-à-dire l'arc de l'équateur, ou le nombre de degrés compris entre le méridien d'où le vaisseau part, & celui où il est arrivé.
|
| LIEUTENANT | S. m. (Jurisprud.) est un officier de judicature lequel tient la place du premier officier de la jurisdiction en son absence.
Un magistrat ou un autre juge ne peut régulierement se créer à lui-même un lieutenant ; car la puissance publique que donne l'office est un caractere imprimé dans la personne qui est pourvue de l'office, & qu'elle ne peut transmettre, soit à une personne privée, soit même à quelqu'un qui auroit pareil serment à justice ; le pouvoir de chaque officier étant limité au fait de sa charge, hors laquelle il n'est plus qu'homme privé, à moins que par le titre de son office il n'ait aussi le pouvoir de faire les fonctions d'un autre officier en son absence.
Chez les Romains, les magistrats, même ceux qui avoient l'administration de la justice, avoient liberté de commettre en tout ou en partie, à une ou plusieurs personnes, les fonctions dépendantes de leur office.
Les proconsuls qui avoient le gouvernement des provinces, tant pour les armes que pour la justice & les finances, avoient ordinairement des especes de lieutenans distincts pour chacune de ces trois fonctions ; savoir, pour les armes, legatum, c'est-à-dire un député ou commis, lequel ne se mêloit point de la justice, à moins que le proconsul ne le lui eût mandé expressément. Pour la justice, ils avoient un assesseur, assessorem ; & pour les finances, un questeur. Quelquefois pour ces trois fonctions ils n'avoient qu'un même lieutenant, lequel, sous les derniers empereurs, s'appelloit & quelquefois vicarius ; mais ce dernier titre se donnoit plus ordinairement à ceux que l'empereur envoyoit dans les provinces où il n'y avoit point de gouverneur, lesquels en ce cas en étoient gouverneurs en chef, étant vicaires, non du gouverneur, mais de l'empereur même.
Les légats des proconsuls étoient choisis par le sénat, mais les assesseurs étoient choisis par les gouverneurs de provinces ; & lorsque les légats avoient outre les armes l'administration de la justice, ils tenoient cette derniere fonction de la volonté du gouverneur.
Les gouverneurs des provinces & plusieurs autres des principaux officiers de l'empire, avoient aussi coutume d'envoyer par les villes de leur département des commis appellés , ce que Julian, interprete des novelles, traduit par locum tenentes, d'où nous avons sans doute tiré le terme de lieutenant. Mais Justinien, en sa novelle 134, supprima ces sortes d'officiers, voulant que les défenseurs des cités, choisis par les habitans, fissent la charge des gouverneurs des provinces en leur absence.
Mais cela n'empêcha pas qu'il ne fût toujours libre à l'officier de commettre & de léguer quelqu'un pour faire sa charge ; les fonctions même de la justice, quoique les plus importantes & les plus difficiles, pouvoient presque toutes être déléguées même à des personnes privées.
D'abord pour ce qui est de la simple jurisdiction, il est certain qu'elle pouvoit être déléguée : celui auquel elle étoit entierement commise pouvoit même subdéléguer & commettre à diverses personnes des procès à juger.
L'appel du commis ou délégué général se relevoit devant le supérieur du magistrat qui l'avoit commis, parce que ce délégué étoit comme nos lieutenans ; il n'exerçoit d'autre jurisdiction que celle de son commettant & en son nom. Il y a même lieu de croire que les sentences de ce délégué général étoient intitulées du nom du magistrat qui l'avoit commis, de même qu'en France les sentences rendues par le lieutenant ne laissent pas d'être intitulées du nom du bailli.
Il y avoit pourtant un cas où l'on appelloit du légat au proconsul ; mais apparemment que dans ce cas le légat avoit quelque jurisdiction qui lui étoit propre.
Du simple juge délégué on se pourvoyoit devant le délégué général qui l'avoit commis, mais ce n'étoit pas par voie d'appel proprement dit ; car le simple délégué n'avoit pas proprement de jurisdiction ; il ne donnoit qu'un avis, lequel n'avoit de soi aucune autorité jusqu'à ce que le déléguant l'eût approuvé.
Le pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, ne pouvoit pas être délégué indistinctement, car il comprenoit deux parties.
L'une attachée à la jurisdiction & pour la manutention d'icelle, qui emportoit seulement droit de legere correction : cette premiere partie étoit toûjours censée déléguée à celui auquel on commettoit l'entiere jurisdiction, mais non pas au délégué particulier.
La seconde partie du mixtum imperium, qui consistoit à décerner des decrets, à accorder des restitutions en entier, recevoir des adoptions, manumissions, faire des émancipations, mises en possession & autres actes semblables, n'étoit pas transférée à celui auquel la jurisdiction étoit commise, parce que ces actes légitimes tenoient plus du commandement que de la jurisdiction ; le mandataire de jurisdiction ou délégué général n'avoit pas droit de monter au tribunal & d'occuper le siége du magistrat, comme font présentement les lieutenans en l'absence du premier officier du siége ; & c'est encore une raison pour laquelle le délégué général ne pouvoit faire les actes qui devoient être faits pro tribunali. On pouvoit néanmoins déléguer quelques-uns de ces actes légitimes, pourvu que ce fût par une commission expresse & spéciale.
L'usage de ces commissions ou délégations avoit commencé à Rome pendant l'état populaire ; les magistrats étant en petit nombre & le peuple ne pouvant s'assembler aussi souvent qu'il auroit fallu pour donner lui-même toutes les commissions nécessaires, il falloit nécessairement que les magistrats substituassent des personnes pour exercer en leur place les moindres fonctions de leur charge. Les grands officiers avoient même le pouvoir d'en instituer d'autres au-dessous d'eux.
Mais toutes ces délégations & commissions étant abusives, furent peu-à-peu supprimées sous les empereurs. Le titre du code de officio ejus qui vice praesidis administrat, ne doit pas s'entendre d'un juge délégué ou commis par le président, mais de celui qui étoit envoyé au lieu du président pour gouverner la province, soit par l'empereur ou par le préfet du prétoire.
Il fut donc défendu par le droit du code de commettre l'entiere jurisdiction, du-moins à d'autres qu'aux légats ou aux lieutenans en titre d'office ; il fut même défendu aux magistrats de commettre les procès à juger, à moins que ce ne fussent des affaires légeres. C'est pourquoi les juges délégués n'étant plus mandataires de jurisdiction, furent appellés juges pédanées, comme on appelloit auparavant tous ceux qui n'avoient point de tribunal ou prétoire ; & qui jugeoient de plano.
En France, sous la premiere & la seconde race, tems auquel les ducs & les comtes avoient dans les provinces & villes de leur département l'administration de la justice aussi bien que le commandement des armes & le gouvernement des finances ; comme ils étoient plus gens d'épée que de lettres, ils commettoient l'exercice de la justice à des clercs ou lettrés qui rendoient la justice en leur nom, & que l'on appelloit en quelques endroits vicarii, d'où est venu le titre de viguier ; en d'autres vice-comites, vicomtes ; & en d'autres, prevôts, quasi praepositi juridicundo ; & ailleurs châtelains, quasi castrorum custodes.
Les vicomtes tenoient un rang plus distingué que les simples viguiers & prevôts, parce qu'ils étoient au lieu des comtes, soit que les villes où ils étoient établis n'eussent point de comte, ou que le comte n'y fît pas sa résidence, soit qu'ils y fussent mis par les ducs ou comtes, soit qu'ils fussent établis par le roi même comme gardiens des comtés, en attendant qu'il y eût mis un comte en titre.
Les vicomtes & les autres lieutenans des ducs n'avoient au commencement que l'administration de la justice civile & l'instruction des affaires criminelles ; ils ne pouvoient pas condamner à aucune peine capitale.
Lorsqu' Hugues Capet parvint à la couronne, la plûpart des vicomtes & autres lieutenans des ducs & comtes qui étoient établis hors des villes, usurperent la propriété de leurs charges à l'exemple des ducs & des comtes, ce que ne purent faire ceux des villes, qui administroient la justice sous les yeux d'un duc ou d'un comte. En Normandie ils sont aussi demeurés simples officiers.
Les ducs & les comtes s'étant rendus propriétaires de leurs gouvernemens, cesserent de rendre la justice & en commirent le soin à des baillis : le roi fit la même chose dans les villes de son domaine.
Ces baillis, qui étoient d'épée, étoient néanmoins tenus de rendre la justice en personne ; il ne leur étoit pas permis d'avoir un lieutenant ordinaire. Philippe le Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, régla que le prevôt de Paris n'auroit point de lieutenant certain résident, mais que s'il étoit absent par nécessité, il pourroit laisser un prud'homme pour lui tant qu'il seroit nécessaire.
Il enjoignit de même en 1302 à tous baillis, sénéchaux & autres juges, de desservir leur charge en personne ; & Philippe V. en 1318 leur défendit nommément de faire desservir leurs offices par leurs lieutenans, à moins que ce ne fût par congé spécial du roi, à peine de perdre leurs gages.
Les choses étoient encore au même état en 1327 : le prevôt de Paris avoit un lieutenant ; mais celui-ci ne siégeoit qu'en son absence.
Les auditeurs étoient aussi obligés d'exercer en personne ; & en cas d'exoine seulement, le prevôt de Paris devoit les pourvoir de lieutenans.
Il y avoit aussi à-peu-près dans le même tems, un lieutenant criminel au châtelet, ce qui fit surnommer l'autre lieutenant civil.
Philippe de Valois, dans une ordonnance du mois de Juillet 1344, fait mention d'un lieutenant des gardes des foires de Champagne, qu'il avoit institué. Le chancelier & garde scel de ces foires avoit aussi son lieutenant ; mais ces lieutenans n'avoient de fonction qu'en l'absence de l'officier qu'ils représentoient.
Ce même prince défendit en 1346 aux verdiers, châtelains & maîtres sergens, d'avoir des lieutenans, à moins que ce ne fût pour recevoir l'argent de leur recette ; & en cas de contravention, les maîtres des eaux & forêts les pouvoient ôter & punir. Il excepta seulement de cette regle ceux qui demeuroient en son hôtel ou en ceux de ses enfans, encore ne fut-ce qu'à condition qu'ils répondroient du fait de leurs lieutenans s'il advenoit aucune méprise, comme si c'étoit leur propre fait. Ce réglement fut renouvellé par Charles V. en 1376, & par Charles VI. en 1402.
Le roi Jean défendit encore en 1351 à tous sénéchaux, baillis, vicomtes, viguiers & autres ses juges, de se donner des lieutenans, substitutos aut locum tenentes, sinon en cas de nécessité, comme de maladie ou autre cas semblable.
Il y avoit cependant dès-lors quelques juges qui avoient des lieutenans, soit par nécessité ou permission du roi ; car dans les lettres de 1354 il est parlé des lieutenans des maîtres particuliers des monnoies.
Le connétable & les maréchaux de France ou leurs lieutenans, connoissoient des actions personnelles entre ceux qui étoient à la guerre ; il est parlé de ces lieutenans dans une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, suivant laquelle il semble que l'amiral, le maître des arbalétriers & le maître des eaux & forêts, eussent aussi des lieutenans, quoique cela ne soit pas dit de chacun d'eux spécialement ; il est seulement parlé de leurs lieutenans in globo.
Le concierge du palais, appellé depuis bailli, avoit aussi, dès 1358, son lieutenant ou garde de sa justice.
Il paroît même que depuis quelque tems il arrivoit assez fréquemment que les juges royaux ordinaires avoient des lieutenans ; car Charles V. en qualité de lieutenant du roi Jean, défendit en 1356 aux sénéchaux, baillis ou autres officiers exerçans jurisdiction, de ne prendre point pour leurs lieutenans les avocats, procureurs ou conseillers communs & publics de leur cour, ou d'aucun autre seigneur, à peine, par ceux qui auroient accepté ces places de lieutenans, d'être privés des offices qu'ils auroient ainsi pris par leur convoitise, & d'être encore punis autrement.
Le roi Jean étant de retour de sa prison en Angleterre, ordonna aux baillis & sénéchaux de résider dans leurs baillies & sénéchaussées, spécialement dans les guerres, sans avoir de lieutenans, excepté lorsqu'ils iroient à leurs besoignes hors de leur baillie ; ce qui ne leur étoit permis qu'une fois chaque année, & pendant un mois ou cinq semaines au plus.
Il défendit aussi, par la même ordonnance, aux baillis & à leurs lieutenans, de s'attribuer aucune jurisdiction appartenante aux prevôts de leurs bailliages.
Le bailli de Vermandois avoit pourtant dès 1354, un lieutenant à Chauny, mais c'étoit dans une ville autre que celle de sa résidence.
Le bailli de Lille avoit aussi un lieutenant en 1365, suivant des lettres de Charles V. qui font aussi mention du lieutenant du procureur du roi de cette ville, qui est ce que l'on a depuis appellé substitut.
Le bailli de Rouen avoit en 1377 un lieutenant, auquel on donnoit le titre de lieutenant-général du bailliage.
On trouve des provisions de lieutenant données dans la même année par le sénéchal de Toulouse, à vénérable & discrette personne, Pierre de Montrevel, docteur ès lois, & juge-mage de Toulouse. Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit obligé d'aller souvent en Aquitaine ; mais il le nomme pour tenir sa place, soit qu'il fût dans ladite sénéchaussée ou absent, toties quoties non in dictâ senescalliâ adesse vel abesse contingerit ; il ordonne que l'on obéisse à ce lieutenant comme à lui-même, & déclare que par cette institution il n'a point entendu révoquer ses autres lieutenans, mais plutôt les confirmer ; ce qui fait connoître qu'il en avoit apparemment dans d'autres villes de son ressort.
Ordinairement, dès que le juge étoit de retour & présent en son siége, le lieutenant ne pouvoit plus faire de fonction ; c'est pourquoi dans la confirmation des priviléges de la ville de Lille en Flandres, faite par Charles VI. au mois de Janvier 1392, il est dit que les lieutenans qui avoient été nommés par le bailli ou par le prevôt de cette ville, lorsque ceux-ci devoient s'absenter, ou qu'ils ne pouvoient vaquer à leurs fonctions, ne pouvoient exercer cet office lorsque le bailli ou le prevôt étoit présent ; mais que si le titre de lieutenant leur avoit été conféré par des lettres de provision, ils le conservoient jusqu'à ce qu'elles eussent été révoquées.
Quelques considérables que soient les places de lieutenans dans les principaux siéges royaux, le bailli ou autre premier officier a toûjours la supériorité & la prééminence sur le lieutenant ; c'est en ce sens que dans des lettres de 1394, le lieutenant du bailli de Meaux, en parlant de ce bailli, le nomme son seigneur & maître.
Le roi ordonnoit quelquefois lui-même à certains juges d'établir un lieutenant lorsque cela paroissoit nécessaire ; c'est ainsi que Charles VI. en 1397, ordonna qu'il seroit établi à Condom un lieutenant du sénéchal d'Agen par lequel il seroit institué ; que ce lieutenant devoit résider continuellement dans la ville, & connoître des causes d'appel.
Charles VII. voyant que les baillis & sénéchaux n'étoient point idoines au fait de judicature, leur ordonna en 1453 d'établir de bons lieutenans, sages, clercs & prud'hommes qui seroient choisis par délibération du conseil, & sans exiger d'eux aucune somme d'or ou d'argent ou autre chose ; que ces lieutenans ne prendront ni gages ni pensions d'aucuns de leurs justiciables, mais ils seront salariés & auront gages ; qu'ils ne pourront être destitués sans cause raisonnable ; qu'à chaque bailliage il n'y aura qu'un lieutenant général & qu'un lieutenant particulier, & que ce dernier n'aura de puissance au siége qu'en l'absence du lieutenant général.
Le parlement avoit rendu dès l'année 1438, un arrêt pour la réformation des abus de ce royaume, & notamment par rapport aux baillifs ; en conséquence de quoi, & de l'ordre de Charles VII. Regnaud de Chartres, archevêque de Rheims & chancelier de France, fut commis & député pour aller par toute la France mettre & instituer des lieutenans des baillifs & sénéchaux, gens versés au fait de judicature.
Quelque tems après, Charles VII. & Charles VIII. ôterent aux baillifs & sénéchaux le pouvoir de commettre eux-mêmes leurs lieutenans, & nos rois commencerent dès-lors à ériger en titre formé des offices de lieutenans des baillifs & sénéchaux.
Il y eut pourtant quelque variation à ce sujet ; car Louis XII. en 1499, ordonna que l'élection de ces lieutenans se feroit en l'auditoire des bailliages & sénéchaussées, en y appellant les baillis & sénéchaux, & autres officiers royaux, & ce quinzaine après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut lui aussi qui ordonna que les lieutenans généraux des baillis seroient docteurs ou licenciés en une université fameuse.
Chenu dans son Traité des offices, dit avoir vû des élections faites en la forme qui vient d'être dite du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant général, de lieutenant particulier au bailliage de Berri, & de lieutenant en la conservation.
Depuis ce tems il a été fait diverses créations de lieutenans généraux & particuliers, de lieutenans civils & de lieutenans criminels, & de lieutenans criminels de robe courte, tant dans les siéges royaux ordinaires, que dans les siéges d'attribution ; quelques-uns ont été supprimés ou réunis à d'autres, lorsque le siége ne pouvoit pas comporter tant d'officiers.
L'édit de 1597, fait en l'assemblée de Rouen, ordonnoit que nul ne sera reçu lieutenant général de province qu'il ne soit âgé de trente-deux ans complets, & n'ait été conseiller pendant six ans dans un parlement. Les ordonnances de François I. & celle de Blois, ne requierent que trente ans, ce que la cour, par un arrêt de 1602, a étendu à tous les lieutenans généraux & particuliers des bailliages grands & petits.
Voyez ci-après LIEUTENANT CIVIL, LIEUTENANT CRIMINEL, LIEUTENANT GENERAL, LIEUTENANT PARTICULIER. (A)
LIEUTENANT CIVIL, (Jurisprud.) est un magistrat de robe longue qui tient le second rang entre les officiers du châtelet de Paris ; il a le titre de lieutenant général civil, parce qu'il étoit autrefois le seul lieutenant du prevôt de Paris. Présentement il prend le titre de lieutenant civil de la prevôté & vicomté de Paris.
Anciennement le prevôt de paris jugeoit seul en personne au châtelet toutes les affaires civiles, criminelles & de police ; il ne lui étoit pas permis d'avoir aucun lieutenant ordinaire en titre.
Suivant l'article 11. de l'ordonnance de 1254, il devoit exercer personnellement son office, & ne pouvoit commettre de lieutenant que dans le cas de maladie ou autre légitime empêchement, & pour ledit tems seulement.
Cette ordonnance fut renouvellée par celle de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, qui porte, art. 7. que le prevôt n'aura point de lieutenant certain résident ; mais que s'il est absent par nécessité, il pourra laisser un prudhomme pour lui tant qu'il retournera ou que nécessité sera.
Le prevôt de Paris choisissoit à sa volonté ce lieutenant & pouvoit le destituer de même.
Les registres du châtelet, & autres actes publics, nous ont conservé les noms de ceux qui ont rempli la place de lieutenant civil ; le plus ancien que l'on trouve est Jean Poitaut, qui est qualifié lieutenant du prevôt de Paris en 1321.
Il est parlé de ces lieutenans dans plusieurs articles de l'ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, par lesquels il paroit que le prevôt de Paris n'avoit alors qu'un seul lieutenant qui expédioit, en l'absence du prevôt, toutes les causes, tant civiles que criminelles. Les auditeurs du châtelet avoient aussi déja des lieutenans, mais ils n'étoient pas qualifiés lieutenans du prevôt de Paris.
Ce premier office de lieutenant du prevôt de Paris est celui qui s'est perpétué en la personne du lieutenant civil. Il fut le seul lieutenant du prevôt de Paris jusques vers l'an 1337 que le prevôt de Paris nomma un autre lieutenant pour le criminel.
En effet on trouve qu'en 1337 Pierre de Thuilliers qui étoit examinateur, étoit en même tems lieutenant civil ; & il est évident qu'il ne fut nommé civil que pour le distinguer de lieutenant criminel, aussi les monumens publics font-ils mention de ce dernier à peu-près dans le même tems.
Il y avoit un lieutenant civil en 1346, en 1360, & en 1366.
Il y a eu plusieurs fois dans le même tems deux lieutenans civils, qui exerçoient alternativement ; en 1369, c'étoient deux avocats du châtelet qui faisoient alternativement la fonction de lieutenant civil. Ils la remplissoient encore de même en 1372, en 1404 & en 1408, c'étoient deux examinateurs qui étoient lieutenans civils.
Dans la suite, quelques-uns de ceux qui remplirent cette place, ne furent pas toujours attentifs à prendre le titre de lieutenant civil ; c'est ainsi qu'en 1479 Charles Dubus sieur de Lardy est qualifié simplement lieutenant du prevôt de Paris ; & en 1481 Nicolas Chapelle examinateur, se disoit commis du prevôt de Paris à tenir le siege de l'audience.
Les noms de ceux que l'on trouve avoir rempli cette place en 1378, 1392, 1407, 1413, 1417, 1421, 1427, 1432 & 1433, prouvent qu'insensiblement les lieutenans du prevôt de Paris étoient devenus ordinaires, & que l'on reconnut la nécessité de les rendre tels pour l'expédition des affaires qui se multiplioient de jour en jour.
Ce fut par ce motif que l'ordonnance du mois d'Avril 1454, art. lxxxvij. permit au prevôt de Paris de commettre des lieutenans, non plus à tems seulement comme autrefois, mais indéfiniment, pourvu que ce fût par le conseil des officiers de son siege.
Ce pouvoir donné au prevôt de Paris, fut confirmé par l'ordonnance du mois de Juillet 1493, art. lxxiij. laquelle défend en même tems au prevôt de Paris de révoquer ses lieutenans après qu'ils auront été une fois commis, sauf au cas qu'il y eût cause raisonnable à la remontrer au roi, qui s'en est réservé la connoissance.
Cette ordonnance doit être regardée comme l'époque de l'érection des lieutenans en titre d'office, au lieu de simples commissions qu'ils étoient auparavant.
La disposition de l'ordonnance de 1493 fut renouvellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47.
Le pouvoir d'élire & commettre des lieutenans fut ôté au prevôt de Paris par l'ordonnance de 1510, art. 41. & il ne lui resta plus que celui de choisir & nommer au Roi, par forme d'élection, trois sujets suffisans & capables, pour être l'un d'eux pourvu par S. M. vacation avenant de cet office.
Enfin, le prevôt de Paris a perdu jusqu'à ce droit de nomination par la vénalité des charges qui a été introduite sous François I.
Jean Alligret fut le premier lieutenant civil élu en titre, en conséquence de l'ordonnance de 1493. Il fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496.
Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & depuis ce tems a toujours été remplie par des personnes également distinguées par leur naissance & par leurs vertus, tels que les de Mesmes, les Miron, les Seguier, les le Jay, les Bailleul, les le Camus & les d'Argouges.
L'office de lieutenant civil souffrit pendant quelque tems un démembrement par l'érection qui fut faite en 1522 d'un bailliage à Paris, ou conservation des privileges royaux de l'université, composé entr'autres officiers d'un lieutenant général ; mais ce nouveau tribunal ayant été supprimé en 1526, & réuni à la prevôté de Paris, l'office de lieutenant général de la conservation fut depuis éteint & réuni à celui de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1564.
Sous François I. cet office eut le même sort que tous les autres par rapport à la vénalité ; on faisoit cependant encore prêter serment aux officiers à leur réception, de n'avoir rien donné pour leur office. Le parlement en usa ainsi à la réception de Jacques Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1551.
Mais bien-tôt après, dans des lettres de jussion qui furent données en 1556 pour la réception de Jean Moulnier ou Mesnier, il est dit qu'il avoit payé 10000 écus d'or sol au Roi pour l'office de lieutenant civil ; ce qui, en évaluant l'écu à 46 sols, feroit 23000 livres, somme considérable pour ce tems-là.
L'office de président au présidial qui avoit été créé au mois de Juin 1557, fut réuni à celui de lieutenant civil par lettres patentes & édit des 14 & 22 Juillet 1558.
Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil, depuis 1596, jusqu'en 1609, & depuis 1613 jusqu'en 1637, furent en même tems prevôts des marchands.
Après la mort du dernier, le Roi donna le 9 Novembre 1637 une déclaration portant que dorénavant la charge de lieutenant civil ne seroit plus exercée que par commission de trois ans, sauf à proroger, & qu'elle ne pourroit plus être exercée avec celle de prevôt des marchands par une seule & même personne. La veuve du dernier titulaire reçut du Roi 360000 livres pour le remboursement de cet office.
Le 10 Novembre 1637, Isaac de l'Affermes, maitre des requêtes, fut commis à l'exercice de la charge de lieutenant civil pour trois ans ; sa commission étant finie, fut renouvellée d'abord pour deux ans, ensuite pour deux autres années, puis pour trois ans, mais le 8 d'Avril 1643 la commission fut révoquée.
Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par un édit rétabli la charge de lieutenant civil ; Dreux d'Aubray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai suivant, & l'exerça jusqu'à sa mort arrivée le 12 Septembre 1666 ; le prix de sa charge fut de 550000 liv.
Au mois de Mars 1667, l'office de lieutenant civil fut de nouveau supprimé, & en son lieu & place furent créés deux autres offices, l'un de lieutenant civil, & l'autre de lieutenant de police.
Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé un nouveau châtelet qu'il démembra de l'ancien, y créa un lieutenant civil ; mais ce nouveau châtelet ayant été supprimé au mois de Septembre 1684, l'office de lieutenant civil du nouveau châtelet fut aussi supprimé & réuni à celui de l'ancien châtelet. Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi, par arrêt de son conseil du 14 Octobre 1684, ordonna que Jean le Camus, resté seul lieutenant civil, payeroit au trésorier des revenus casuels une somme de 100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieutenant civil demeureroit fixée à 400000 liv. En 1710 elle a été fixée à 500000 livres. M. d'Argouges, maître des requêtes honoraire, a rempli dignement cette charge jusqu'en 1762, que M. d'Argouges son fils, maître des requêtes, qui en avoit déjà la survivance, lui a succédé.
Le lieutenant civil est donc le second officier du châtelet, & le premier des lieutenans de la prevôté & vicomté de Paris. C'est lui qui préside à toutes les assemblées du châtelet, soit pour réceptions d'officiers, enregistrement, & autres affaires de la compagnie.
C'est lui qui préside à l'audience du parc civil, qui recueille les opinions, & prononce les jugemens, lors même que le prevôt de Paris y vient prendre place.
Il donne aussi audience les mercredi & samedi en la chambre civile, où il n'est assisté que du plus ancien des avocats du Roi.
Toutes les requêtes en matieres civiles sont adressées au prevôt de Paris ou au lieutenant civil.
Il répond en son hotel sur les requêtes à fin de permission d'assigner dans un délai plus bref que celui de l'ordonnance, ou à fin de permission de saisir, & autres semblables, ou pour être reçu appellant desdites sentences des juges ressortissans au présidial ; c'est aussi lui qui fait les rôles des causes d'appel qui se plaident le jeudi au présidial.
Il regle pareillement en son hotel les contestations qui s'élevent à l'occasion des scellés, inventaires ; & le rapport qui lui en est fait par les officiers, s'appelle référé.
Les procès-verbaux d'assemblée de parens pour les affaires des mineurs, ou de ceux que l'on fait interdire, & les procès-verbaux tendans au jugement d'une demande & séparation se font aussi en son hotel.
On lui porte aussi en son hotel les testamens trouvés cachetés après la mort des testateurs, à l'effet d'être ouverts en sa présence, & en celle des parties intéressées, pour être ensuite le testament déposé chez le notaire qui l'avoit en dépôt, ou au cas qu'il n'y en eût point, chez le notaire qu'il lui plaît de commettre. (A)
LIEUTENANT CRIMINEL, est un magistrat établi dans un siege royal pour connoître de toutes les affaires criminelles.
Le premier lieutenant criminel fut établi au châtelet de Paris.
On a déjà observé dans l'article précédent, qu'anciennement le prevôt de Paris n'avoit point de lieutenant ; que cela lui étoit défendu, sinon en cas d'absence, de maladie, ou autre empêchement, & que dans ces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que pour le tems où cela étoit nécessaire.
Il ne commettoit d'abord qu'un seul lieutenant qui expédioit en son absence toutes les affaires tant civiles que criminelles. Dans la suite il en commit un pour le civil, & un pour le criminel. Il paroît que cela se pratiquoit déja ainsi dès 1337, puisque l'on trouve dès-lors un lieutenant du prevôt de Paris, distingué par le titre de lieutenant civil.
Le premier lieutenant criminel connu est Pierre de Lieuvits en 1343. Il y en avoit en 1366, 1395, 1405, 1407, 1418 ; celui qui l'étoit en 1432, l'étoit encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieutenans étoient devenus ordinaires, ce qui a été observé par rapport à l'office de lieutenant civil.
L'ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au prevôt de Paris de commettre des lieutenans indéfiniment, pourvû que ce fût par le conseil de son siege, il est à croire que cela fut observé ainsi pour l'office de lieutenant criminel.
Il fut ensuite défendu au prevôt de Paris, par l'ordonnance de 1493, art. 73, de révoquer ses lieutenans, sans cause raisonnable, dont le roi se réserva la connoissance, au moyen de quoi depuis ce tems ces lieutenans du prevôt de Paris ne furent plus de simples commis du prevôt, mais des officiers en titre.
Le premier lieutenant criminel qui fut pourvû en titre, en conséquence de ce réglement, fut Jean de la Porte, en 1494.
En 1529, Jean Morin qui possédoit l'office de lieutenant général en la conservation, fut pourvû de la charge de lieutenant criminel, & obtint des lettres de compatibilité.
La chambre ordonnée par François I. en 1533, pour la police de Paris, & obvier au danger de la peste, consulta entr'autres personnes le lieutenant criminel de la prevôté de Paris, pour faire un réglement.
Jacques Tardieu dont l'histoire est connue, fut reçû lieutenant criminel le 31 Mars 1635, & exerça jusqu'au 24 Août 1665, que ce magistrat & sa femme furent assassinés dans leur hôtel, rue de Harlay, par deux voleurs.
Le roi ayant par édit du mois de Février 1674, divisé le châtelet en deux sieges différens, l'un appellé l'ancien châtelet, l'autre le nouveau ; il créa pour le nouveau châtelet un office de lieutenant criminel qui subsista jusqu'au mois de Septembre 1684, que le nouveau châtelet ayant été supprimé & incorporé à l'ancien, l'office de lieutenant criminel du nouveau châtelet fut aussi réuni à l'ancien, moyennant une finance de 50000 liv. au moyen de quoi l'office de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par arrêt du Conseil du 14 Octobre 1684 : il avoit depuis été fixé à 250000 liv. par un autre arrêt du conseil, du 24 Novembre 1699, & lettres sur ledit arrêt, en forme d'édit des mêmes mois & an, registrées au parlement le 25 Décembre suivant ; & en conséquence MM. le Conte & Negre l'avoient acquis sur le pié de 250000 liv. mais par arrêt du conseil du 18 Mars 1755, revêtu depuis de lettres-patentes du 29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l'acquisition de cette charge à M. de Sartine, depuis lieutenant général de police, & maître des requêtes, a réduit & modéré à la somme de 100000 liv. toutes les finances qui pouvoient en avoir été payées ci-devant, & s'est chargé de rembourser le surplus montant à 150000 liv.
Le lieutenant criminel du châtelet est le juge de tous les crimes & délits qui se commettent dans la ville & faubourgs, prevôté & vicomté de Paris, même par concurrence & prévention avec le lieutenant criminel de robe-courte, des cas qui sont de la compétence de cet officier.
Dans le cas où le lieutenant criminel est juge en dernier ressort, il doit avant de procéder à l'instruction, faire juger sa compétence en la chambre du conseil.
Il donne audience deux fois la semaine, les mardi & vendredi, dans la chambre criminelle, où il n'est assisté d'aucuns conseillers, mais seulement d'un des avocats du roi ; on y plaide les matieres de petit criminel, c'est-à-dire celles où il s'agit seulement d'injures, rixes & autres matieres légeres qui ne méritent pas d'instruction.
Il préside aussi en la chambre criminelle au rapport des procès criminels, qui y sont jugés avec les conseillers de la colonne qui est de service au criminel.
Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la compagnie de robe-courte, avec 10 archers qui font le service auprès de lui en habit d'ordonnance, dans l'intérieur de la jurisdiction, pour être à portée d'exécuter sur-le-champ ses ordres, cet exempt ne devant point quitter le magistrat. Il y en a un autre aussi à ses ordres, pour exécuter les decrets ; ce dernier exempt réunit ordinairement la qualité d'huissier, afin de pouvoir écrouer.
Outre l'huissier audiencier qui est de service auprès du lieutenant criminel, ce magistrat a encore trois autres huissiers, l'un à cheval, & les deux autres à verge, qui dans l'institution devoient le venir prendre en son hôtel, & l'accompagner en son hôtel ; mais dans l'usage présent ils se trouvent seulement à l'entrée du tribunal où ils accompagnent le lieutenant criminel jusqu'à son cabinet, & restent auprès de lui pour prendre ses ordres.
Il paroît par l'édit de François I. du 14 Janvier 1522, portant création des lieutenans criminels, en titre d'office ; qu'avant cette création il y avoit dejà des lieutenans criminels dans quelques sieges autres que la prevôté de Paris ; le motif que cet édit donne de la création des lieutenans criminels, est que le roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d'expédition des procès criminels ; l'édit créa donc un lieutenant criminel dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & baillie, & autres jurisdictions du royaume, pour connoître de tous cas, crimes, délits & offenses qui seroient commis dans le siege où il seroit établi, & dans son ressort.
Cet édit n'eut pas d'abord sa pleine & entiere exécution ; quelques-uns de ces offices furent remplis du tems de François I. & d'Henri II. ce dernier défendit même aux lieutenans criminels, par l'édit des présidiaux, d'assister au jugement des procès civils.
Mais plusieurs lieutenans généraux trouverent le moyen de se faire pourvoir de l'office de lieutenant criminel, pour l'exercer avec leur office de lieutenant général, civil & particulier, & obtinrent des dispenses à cet effet ; d'autres firent supprimer pour leur siege l'office de lieutenant criminel, pour connoître de toutes matieres civiles & criminelles ; il intervint à ce sujet plusieurs jugemens & déclarations pour la compatibilité de ces offices, ou des fonctions civiles & criminelles.
Henri II. trouvant qu'il y avoit en cela de grands inconvéniens, par un édit du mois de Mai 1552, ordonna que l'édit de 1522 seroit exécuté selon sa forme & teneur, en conséquence que dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & jurisdiction présidiale, il y aura un juge & magistrat criminel, lequel avec le lieutenant particulier, & les conseillers établis en chaque présidial, qu'il appellera selon la gravité & poids des matieres, connoîtra privativement à tous autres juges, de toutes affaires criminelles, sans qu'il puisse tenir aucun office de lieutenant général, civil ni particulier, ni assister au jugement d'aucun procès civil ; cependant depuis on a encore uni dans quelques sieges les fonctions de lieutenant criminel à celles de lieutenant général.
L'édit de 1552 déclare que le roi n'entend pas priver les prevôts étant ès villes où sont établis les sieges présidiaux, de l'exercice & autorité de la justice civile & criminelle qui leur appartient au-dedans des limites de leur prevôté.
Henri II. fit le même établissement pour la Bretagne, par un autre édit daté du même tems.
La déclaration du mois de Mai 1553, portant réglement sur les différends d'entre les lieutenans criminels & les autres officiers des présidiaux, leur attribue privativement à tous autres, la connoissance des lettres de rémission & pardon, des appellations en matiere criminelle interjettées des juges subalternes, des procès criminels où les parties sont reçues en procès ordinaire, ce qui a été confirmé par plusieurs autres déclarations.
Lorsque les prevôts des maréchaux provinciaux furent supprimés par l'édit de Novembre 1544, on attribua aux lieutenans criminels établis dans les présidiaux, & aux lieutenans particuliers des autres sieges, la connoissance des délits dont connoissoient auparavant ces prevôts des maréchaux.
Le même édit ordonne que les lieutenans criminels feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieutenans de robe-courte, archers & sergens extraordinaires, pour la recherche des malfaiteurs.
Sur les fonctions des lieutenans criminels, Voyez Joly, tom. I. liv. iij. tit. 10. le traité de la police, par Delamare ; le recueil des ordonnances de la troisieme race, Neron, Fontanon. Voyez aussi l'article LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE-COURTE. (A)
LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE du châtelet de Paris, est un des quatre lieutenans du prevôt de cette ville. Il est reçu au parlement comme le prevôt & les autres lieutenans ; & c'est le doyen des conseillers de la grande chambre qui va l'installer au châtelet, où il siege l'épée au côté, & avec une robe plus courte que la robe ordinaire des magistrats.
Il seroit assez difficile de fixer le tems de sa création, son établissement étant fort ancien. Cette charge n'a été d'abord exercée que par commission ; ce fut Henri II., qui par un édit de 1554, la créa en titre d'office ; il n'y eut originairement que vingt archers pour l'exercice de cette charge ; mais par la suite des tems le nombre des officiers & archers en a été considérablement augmenté. Il paroît par un édit de François I. de 1526, & différens autres de Henri II. & sur-tout celui de 1554, que le nombre des habitans de Paris qui étoit considérable dès ce tems-là, est ce qui a donné lieu à la création de cette charge. Par ces différens édits, il est enjoint au lieutenant criminel de robe courte de faire des chevauchées dans les rues, & de visiter les tavernes, & mauvais lieux de la ville & faubourgs de Paris ; & enfin d'arrêter tous gens malvivans pour en être fait justice.
La compagnie du lieutenant criminel de robe courte est spécialement attachée au parlement pour lui prêter main forte dans l'exécution de ses arrêts, en matiere criminelle ; c'est par cette raison que la garde de Damiens lui fut remise le jour de son exécution.
Le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris, n'est point de la même classe que les lieutenans criminels de robe courte qui furent créés par la suite. Il existoit long-tems avant eux, & ces derniers ne furent créés que pour remplacer les prevôts criminels provinciaux, qui furent supprimés, & auxquels on n'accordoit d'autre attribution que celle des prevôts supprimés. L'on ne voit rien de semblable dans les différens édits de création du lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses fonctions sont illimitées ; il paroît être chargé de la poursuite de toutes sortes de crimes & délits ; il instruit ses procès sans assesseur, & les juge à la chambre criminelle du châtelet. Il n'y a point de procureur du roi particulier pour lui ; c'est celui du châtelet qui en fait les fonctions, comme procureur du roi de cette jurisdiction : aussi les lieutenans criminels de robe courte ayant été supprimés, & les prevôts retablis, il fut dit par l'édit de Henri II. de 1555, que la suppression des lieutenans criminels de robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Paris ; & il fut par le même édit maintenu & conservé dans ses fonctions ; il y fut même augmenté : car cet édit le charge de tenir la main à la punition des contrevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances faits pour la police de Paris, & sur les abus, malversations & monopoles qui pourroient avoir été commis, tant par les débardeurs & déchargeurs de foin, de bois, & autres denrées qui se descendent & amenent par eau & par terre en cette ville, que sur les particuliers qui les conduiront ; & ce par concurrence avec les juges à qui la connoissance en appartient.
Lors de la rédaction de l'ordonnance criminelle de 1670, le lieutenant criminel de robe courte étoit dans la jouissance de connoître à la charge de l'appel de toutes sortes de crimes & délits qui se commettoient dans l'étendue de la ville, prévôté & vicomté de Paris ; il y a même des arrêts rendus sur l'appel de ses jugemens dans toute espece de cas ; & comme cette ordonnance déterminoit la matiere des fonctions des prevôts des maréchaux & lieutenans criminels de robe courte, en les resserrant dans de certaines bornes, il sembloit que le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris par sa seule dénomination devoit être enveloppé dans cette modification ; néanmoins il en fut excepté, & par l'article 28 du titre deuxieme de ladite ordonnance, il est dit : " entendons rien innover aux droits & fonctions de notre lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris. "
L'édit de 1691 portant réglement entre le lieutenant criminel du châtelet, & celui de robe courte, fixe les cas dont celui-ci peut connoître à charge de l'appel, ensorte qu'il semble être devenu différent de ce qu'il étoit auparavant ; cependant depuis cet édit, l'on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoître & juger, à la charge de l'appel, dans des cas de toutes autres especes que ceux déterminés par cet édit ; & les arrêts qui sont intervenus en conséquence ont confirmé sa procédure, suivant cet édit.
Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre tous les mois un exempt & dix archers pour exécuter les decrets décernés par le lieutenant criminel, & même un plus grand nombre s'il étoit nécessaire.
En cas d'absence du lieutenant criminel de robe courte, ou légitime empêchement, c'est un des lieutenans particuliers qui fait ses fonctions ; & s'il arrive quelque contestation entre le lieutenant criminel de robe longue & celui de robe courte au sujet de leurs fonctions, c'est au parlement à qui la connoissance en est reservée aux termes du même édit.
Les quatre lieutenans & le guidon de sa compagnie peuvent recevoir plainte, & informer dans tous les cas de sa compétence, suivant l'édit de 1682.
Les officiers & archers de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte sont pourvus par le roi sur sa nomination, & sont reçus par lui. Il y a un commissaire & contrôleur des guerres particuliers pour la revûe de sa compagnie, & elle se fait devant lui-seul. (A)
LIEUTENANT PARTICULIER, est un magistrat établi dans certains siéges royaux, qui a rang après le lieutenant général ; on l'appelle particulier pour le distinguer du lieutenant général, qui par le titre de son office a droit de présider par-tout où il se trouve, au lieu que le lieutenant particulier préside seulement à certaines audiences, ou en l'absence du lieutenant général.
Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieutenant particulier, l'un créé par édit du mois de Mai 1544, l'autre qui fut créé pour le nouveau châtelet en 1674, & qui a été conservé nonobstant la réunion faite des deux châtelets en 1684.
Jusqu'en 1586 les lieutenans particuliers avoient été également assesseurs civils & criminels, & en cette qualité ils substituoient & remplaçoient les lieutenans criminels, aussi-bien que les lieutenans civils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un édit par lequel il démembra des offices de lieutenans particuliers, la connoissance des matieres criminelles, & créa des assesseurs criminels pour connoître des crimes, & substituer & remplacer les lieutenans criminels : on attribua aussi à ces offices d'assesseurs criminels le titre de premier conseiller au civil, pour en l'absence des lieutenans civils & particuliers, & de l'assesseur civil, les remplacer & substituer.
Ces offices d'assesseurs criminels furent depuis supprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & ensuite retablis par édit du mois de Juin 1596 ; ce dernier édit ne parle que des fonctions d'assesseurs criminels, & non de premier conseiller en la prevôté.
Depuis, suivant un accord fait entre les conseillers du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux arrêts du conseil des 27 Novembre 1604 & 29 Novembre 1605, l'office d'assesseur criminel fut uni à celui de lieutenant particulier de la prevôté.
Les lieutenans particuliers président alternativement de mois en mois, l'un à l'audience du présidial, l'autre à la chambre du conseil ; & en l'absence des lieutenans civil de police & criminel, ils les remplacent dans leurs fonctions.
Celui qui préside à la chambre du conseil, tient tous les mercredis & samedis, à la fin du parc civil, l'audience de l'ordinaire, & ensuite celle des criées.
Ils peuvent avant l'audience rapporter en la chambre du conseil, & en la chambre criminelle, les procès qui leur ont été distribués.
Il y a un semblable office de lieutenant particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée, & dans plusieurs autres jurisdictions royales, ordinaires, qui préside en l'absence du lieutenant général.
Il y a aussi un lieutenant particulier en la table de marbre. (A)
LIEUTENANT GENERAL DE POLICE, ou LIEUTENANT DE POLICE, (Jurisp.) est un magistrat établi à Paris & dans les principales villes du royaume, pour veiller au bon ordre, & faire exécuter les réglemens de police ; il a même le pouvoir de rendre des ordonnances, portant réglement dans les matieres de police qui ne sont pas prévûes par les ordonnances, édits & déclarations du roi, ni par les arrêts & réglemens de la cour, ou pour ordonner l'exécution de ces divers réglemens relativement à la police. C'est à lui qu'est attribuée la connoissance de tous les quasi-délits en matiere de police, & de toutes les contestations entre particuliers pour des faits qui touchent la police.
Le premier lieutenant de police est celui qui fut établi à Paris en 1667 ; les autres ont été établis à l'instar de celui de Paris en 1669.
Anciennement le prevôt de Paris rendoit la justice en personne avec ses conseillers, tant au civil qu'au criminel ; il régloit aussi de même tout ce qui regardoit la police.
Il lui étoit d'abord défendu d'avoir des lieutenans, sinon en cas de maladie ou autre empêchement, & dans ce cas il ne commettoit qu'un seul lieutenant, qui régloit avec les conseillers tout ce qui regardoit la police.
Lorsque le prevôt de Paris commit un second lieutenant pour le criminel, cela ne fit aucun changement par rapport à la police, attendu que ces lieutenans civils & criminels n'étoient point d'abord ordinaires (ils ne le devinrent qu'en 1454) ; d'ailleurs le prevôt de Paris jugeoit en personne avec eux toutes les causes de police, soit au parc civil ou en la chambre criminelle, suivant que cela se rencontroit.
L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieutenans du prevôt de Paris, fit naître peu de tems après une contestation entre le lieutenant civil & le lieutenant criminel pour l'exercice de la police ; car comme cette partie de l'administration de la justice est mixte, c'est-à-dire qu'elle tient du civil & du criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel prétendoient chacun qu'elle leur appartenoit.
Cette contestation importante demeura indécise entr'eux, depuis 1500 jusqu'en 1630 ; & pendant tout ce tems ils exercerent la police par concurrence, ainsi que cela avoit été ordonné par provision, par un arrêt du 18 Février 1515, d'où s'ensuivirent de grands inconvéniens.
Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le lieutenant civil tiendroit la police deux fois la semaine ; qu'en cas d'empêchement de sa part, elle seroit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieutenant particulier.
Les droits de prérogatives attachés au magistrat de police de la ville de Paris, furent réglés par un édit du mois de Décembre de l'année 1666, lequel fut donné à l'occasion des plaintes qui avoient été faites du peu d'ordre qui étoit dans la police de la ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait rechercher les causes d'où ces défauts pouvoient procéder, & ayant fait examiner en son conseil les anciennes ordonnances & réglemens de police, ils se trouverent si prudemment concertés, que l'on crut qu'en apportant l'application & les soins nécessaires pour leur exécution, la police pourroit être aisément retablie. Le préambule de cet édit annonce aussi que par les ordres qui avoient été donnés, le nettoyement des rues avoit été fait avec exactitude ; que comme le défaut de la sûreté publique exposeroit les habitans de Paris à une infinité d'accidens, S. M. avoit donné ses soins pour la rétablir, & pour qu'elle fût entiere, S. M. venoit de redoubler la garde ; qu'il falloit aussi pour cet effet régler le port d'armes, & prévenir la continuation des meurtres, assassinats, & violences qui se commettoient journellement, par la licence que des personnes de toute qualité se donnoient de porter des armes, même de celles qui sont le plus étroitement défendues ; qu'il étoit aussi nécessaire de donner aux officiers de police un pouvoir plus absolu sur les vagabonds & gens sans aveu, que celui qui est porté par les anciennes ordonnances.
Cet édit ordonne ensuite l'exécution des anciennes ordonnances & arrêts de réglement touchant le nettoyement des rues, il enjoint au prevôt de Paris, ses lieutenans, commissaires du châtelet, & à tous autres officiers qu'il appartiendra d'y tenir la main.
L'édit défend la fabrication & le port des armes prohibées dont il fait l'énumération. Il est enjoint à ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les mains du commissaire du quartier, & dans les provinces, entre les mains des officiers de police.
Il est dit que les soldats des gardes françoises & suisses ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou corps-de-garde, s'ils sont en garde, à six heures du soir depuis la Toussaints, & à neuf heures du soir depuis Pâques, avec épées ou autres armes, s'ils n'ont ordre par écrit de leur capitaine, à peine des galeres ; à l'effet de quoi leur procès leur sera fait & parfait par les juges de police ; & que pendant le jour ces soldats ne pourront marcher en troupe ni être ensemble hors de leur quartier en plus grand nombre que quatre avec leurs épées.
Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur suite, doivent être arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne, être conduits aux galeres pour y servir comme forçats, sans autre forme ni figure de procès ; & à l'égard des femmes & filles qui les accompagnent & vaguent avec eux, elles doivent être fouettées, flétries & bannies hors du royaume ; & l'édit porte que ce qui sera ordonné à cet égard par les officiers de police, sera exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.
Il enjoint aussi aux officiers de police d'arrêter ou faire arrêter tous vagabonds, filoux & gens sans aveu, & de leur faire & parfaire le procès en dernier ressort, l'édit leur en attribuant toute cour, jurisdiction & pouvoir à ce nécessaires, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts & reglemens à ce contraires, auxquels il est dérogé par cet édit ; & il est dit qu'on réputera gens vagabonds & sans aveu ceux qui n'auront aucune profession ni métier, ni aucuns biens pour subsister, qui ne pourront faire certifier de leurs bonne vie & moeurs par personnes de probité connues & dignes de foi, & qui soient de condition honnête.
La déclaration du 27 Août 1701, a confirmé le lieutenant général de police dans le droit de juger en dernier ressort les mendians, vagabonds & gens sans aveu ; mais il ne peut les juger qu'avec les officiers du châtelet au nombre de sept.
L'édit de 1666 regle aussi l'heure à laquelle les colleges, académies, cabarets & lieux où la biere se vend à pot, doivent être fermés.
Il est dit que les ordonnances de police pour chasser ceux chez lesquels se prend & consomme le tabac, qui tiennent académies, brelans, jeux de hasard, & autres lieux défendus, seront exécutés ; & qu'à cet effet la publication en sera renouvellée.
Défenses sont faites à tous princes, seigneurs & autres personnes, de donner retraite aux prévenus de crimes, vagabonds & gens sans aveu.
L'édit veut que la police générale soit faite par les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux prétendus privilégiés, ainsi que dans les autres quartiers de la ville, sans aucune différence ni distinction ; & qu'à cet effet le libre accès leur y soit donné : qu'à l'égard de la police particuliere, elle sera faite par les officiers qui auront prévenu ; & qu'en cas de concurrence, la préférence appartiendra au prevôt de Paris. Il fut néanmoins ajoûté par l'arrêt d'enregistrement, qu'à l'égard de la police, la concurrence ni la prévention n'auroit pas lieu dans l'étendue de la jurisdiction du bailliage du palais.
Enfin, il est encore enjoint par le même édit à tous compagnons chirurgiens, qui travaillent en chambre, de se retirer chez les maîtres, & aux maîtres, de tenir boutique ouverte ; comme aussi de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par le commissaire son rapport à la police, le tout sous les peines portées par cet édit, ce qui doit aussi être observé à l'égard des hôpitaux, dont l'infirmier ou administrateur qui a le soin des malades doit faire sa déclaration au commissaire du quartier.
C'est ainsi que la compétence des officiers de police étoit déjà reglée, lorsque par édit du mois de Mars 1667, Louis XIV. supprima l'office de lieutenant civil qui existoit alors, & créa deux nouveaux offices, l'un de lieutenant civil, l'autre de lieutenant de police, pour être remplis par deux différens officiers. Il regla par ce même édit la compétence de chacun de ces deux officiers.
Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de la sureté de la ville, prevôté & vicomté de Paris, du port d'armes prohibées par les ordonnances, du nettoyement des rues & places publiques, circonstances & dépendances ; c'est lui qui donne les ordres nécessaires en cas d'incendie & inondation : il connoît pareillement de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas & magasins qui en peuvent être faits, de leur taux & prix, de l'envoi des commissaires & autres personnes nécessaires sur les rivieres pour le fait des amas de foin, botelage, conduite & arrivée à Paris. Il regle les étaux des boucheries & leur adjudication ; il a la visite des halles, foires & marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs, & lieux mal fermés ; il connoît aussi des assemblées illicites, tumultes, séditions & desordres qui arrivent à cette occasion, des manufactures & de leur dépendance, des élections des maîtres & des gardes des six corps des marchands, des brevets d'apprentissages, reception des maîtres, de la réception des rapports, des visites, des gardes des marchands & artisans, de l'exécution de leurs statuts & reglemens, des renvois des jugemens ou avis du procureur du roi du châtelet sur le fait des arts & métiers ; il a le droit d'étalonner tous les poids & balances de toutes les communautés de la ville & fauxbourgs de Paris, à l'exclusion de tous autres juges ; il connoît des contraventions commises à l'exclusion des ordonnances, statuts & reglemens qui concernent l'imprimerie, en l'impression des livres & libelles défendus, & par les colporteurs qui les distribuent ; les chirurgiens sont tenus de lui déclarer les noms & qualités des blessés, il peut aussi connoître de tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait de police, leur faire le procès sommairement & les juger seul, à moins qu'il y ait lieu à peine afflictive, auquel cas il en fait son rapport au présidial ; enfin c'est à lui qu'appartient l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts & reglemens concernant la police.
Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau châtelet, composé entr'autres officiers d'un lieutenant de police, aux mêmes droits & fonctions que celui de l'ancien châtelet ; mais attendu l'inconvénient qu'il y avoit à établir deux lieutenans de police dans Paris, le nouvel office fut réuni à l'ancien par déclaration du 18 Avril de la même année, pour être exercé sous le titre de lieutenant général de police.
Comme il arrivoit fréquemment des conflits de jurisdiction entre le lieutenant général de police & les prevôts des marchands & échevins de Paris, leur jurisdiction fut reglée par un édit du mois de Juin 1700.
Cet édit ordonne que le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins exercent, chacun en droit soi, la jurisdiction qui leur est attribuée par les ordonnances sur le commerce des blés & autres grains ; qu'ils les fassent exécuter à cet égard, ensemble les reglemens de police, comme ils avoient bien & dûement fait jusqu'alors ; savoir, que le lieutenant général de police connoit dans toute l'étendue de la prevôté & vicomté de Paris, & même dans les huit lieues aux environs de la ville, de tout ce qui regarde la vente, livraison & voiture des grains que l'on y amene par terre, quand même ils auroient été chargés sur la riviere, pourvû qu'ils en ayent été déchargés par la suite sur la terre, à quelque distance que ce puisse être de la ville ; comme aussi de toutes les contraventions qui pourroient être faites aux ordonnances & reglemens, quand même on prétendroit que les grains auroient été destinés pour cette ville, & qu'ils devroient y être amenés par eau, & ce jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au lieu où on les doit décharger sur les rivieres qui y affluent. Les prevôt des marchands & échevins connoissent dans les autres cas de la vente, livraison & voiture des grains qui viennent par eau.
Ils ont aussi la connoissance de ce qui regarde la vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieutenant général de police a toute jurisdiction, police & connoissance de la vente & commerce qui se fait des vins lorsqu'on les amene par terre à Paris, & des contraventions qui peuvent être faites aux ordonnances & reglemens de police, même sur ceux qui y ont été amenés par les rivieres, aussi-tôt qu'ils sont transportés des bateaux sur lesquels ils ont été amenés des ports & étapes de ladite ville, dans les maisons & caves des marchands de vin, & sans que les officiers de la ville puissent y faire aucunes visites, ni en prendre depuis aucune connoissance sous prétexte de mesures, ou sous quelque autre que ce puisse être.
Les prevôt des marchands & échevins connoissent de la voiture qui se fait par eau des bois de mairain, & de charronage, & reglent les ports de la ville où ils doivent être amenés & déchargés ; le lieutenant de police connoît de sa part de tout ce qui regarde l'ordre qui doit être observé entre les charrons & autres personnes qui peuvent employer lesdits bois de mairain & de charronage que l'on amene en la ville de Paris.
De même, quoique le bureau de la ville connoisse de tout ce qui regarde les conduites des eaux & entretien des fontaines publiques, le lieutenant général de police connoit de l'ordre qui doit être observé entre les porteurs d'eau, pour la puiser & pour la distribuer à ceux qui en ont besoin, ensemble de toutes les contraventions qu'ils pourroient faire aux reglemens de police ; il peut aussi leur défendre d'en puiser en certains tems & en certains endroits de la riviere lorsqu'il le juge à propos.
Par rapport aux quais, le bureau de la ville y a jurisdiction, pour empêcher que l'on n'y mette aucunes choses qui puissent empêcher la navigation sur la riviere, ou occasionner le dépérissement des quais dont la ville est chargée : du reste, le lieutenant général de police exerce sur les quais toute la jurisdiction qui lui est attribuée dans le reste de la ville, & peut même y faire porter les neiges lorsqu'il le juge absolument nécessaire pour le nettoyement de la ville & pour la liberté du passage dans les rues.
La publication des traités de paix se fait en présence des officiers du châtelet, & des prevôt des marchands & échevins, suivant les ordres que le roi leur en donne, & en la forme en laquelle elle a été faite à l'occasion des traités de paix conclus à Riswik.
Lorsqu'on fait des échafauds pour des cérémonies ou des spectacles que l'on donne, au sujet des fêtes & des réjouissances publiques, les officiers, tant du châtelet, que de l'hôtel-de-ville, exécutent chacun les ordres particuliers qu'il plaît au roi de leur donner à ce sujet ; & lorsqu'ils n'en ont point reçu, le lieutenant général de police a de droit l'inspection sur les échafauds, & donne les ordres qu'il juge nécessaires pour la solidité de ceux qui sont faits dans les rues & même sur les quais, & pour empêcher que les passages nécessaires dans la ville n'en soient embarrassés ; les prevôt des marchands & échevins prennent le même soin, & ont la même connoissance sur ceux qui peuvent être faits sur le bord & dans le lit de la riviere, & dans la place de greve.
Lorsqu'il arrive un débordement d'eau, qui fait craindre que les ponts sur lesquels il y a des maisons bâties ne soient emportés, & que l'on ne puisse passer surement sur ces ponts, le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins donnent conjointement, concurremment, par prévention, tous les ordres nécessaires pour faire déloger ceux qui demeurent sur ces ponts & pour en fermer les passages ; & en cas de diversité de sentimens, ils doivent se retirer sur le champ vers le parlement pour y être pourvû ; & en cas que le parlement ne fût pas assemblé ; ils doivent s'adresser à celui qui y préside pour être réglés par son avis.
Les teinturiers, dégraisseurs & autres ouvriers qui sont obligés de se servir de l'eau de la riviere pour leurs ouvrages, doivent se pourvoir pardevers les prévôt des marchands & échevins pour en obtenir la permission d'avoir des bateaux ; mais lorsqu'ils n'ont pas besoin de bateaux, ils doivent se pourvoir seulement pardevers le lieutenant général de Police.
Ce magistrat connoît, à l'exclusion des prevôt des marchands & échevins, de ce qui regarde la vente & le débit des huîtres, soit qu'elles soient amenées en cette ville par eau, ou par terre, sans préjudice néanmoins de la jurisdiction des commissaires du parlement, sur le fait de la marée.
Cet édit porte aussi, qu'il connoîtra de tout ce qui regarde l'ordre & la police, concernant la vente & le commerce du poisson d'eau-douce, que l'on amenera à Paris.
Il est enjoint au surplus par ce même édit de 1700 au lieutenant général de police, & aux prevôt des marchands & échevins, d'éviter autant qu'il leur est possible, toutes sortes de conflits de jurisdiction, de regler s'il se peut à l'amiable & par des conférences entr'eux, ceux qui seroient formés, & de les faire enfin régler au parlement le plus sommairement qu'il se pourra, sans qu'ils puissent rendre des ordonnances, ni faire de part & d'autre aucuns réglemens au sujet de ces sortes de contestations, ni sous aucun prétexte que ce puisse être.
Le lieutenant général de police a encore la connoissance & jurisdiction sur les recommandaresses & nourrices dans la ville & fauxbourgs de Paris ; le préambule de la déclaration du 29 Janvier 1715 porte, que l'exécution du réglement que S. M. avoit fait sur cette matiere, regardoit naturellement le magistrat qui est chargé du soin de la police dans Paris, & que S. M. avoit jugé à-propos de réformer l'ancien usage, qui sans autre titre que la possession avoit attribué au lieutenant criminel du châtelet, la connoissance de ce qui concerne les fonctions des recommandaresses, pour réunir à la police une inspection qui en fait véritablement partie & qui a beaucoup plus de rapport à la jurisdiction du lieutenant général de police, qu'à celle du lieutenant criminel.
Le dispositif de cette déclaration porte entr'autres choses, que dans chacun des quatre bureaux de recommandaresses, il y aura un registre qui sera paraphé par le lieutenant général de police. Que chacun de ces quatre bureaux sera sous l'inspection d'un des commissaires du châtelet, qui examinera & visera tous les mois les registres, & qu'en cas de contravention à cette déclaration, il en référera au lieutenant général de police pour y être par lui pourvû, ainsi qu'il appartiendra, & que chacun de ces registres lui sera représenté quatre fois l'année, même plus souvent, s'il le juge à-propos, pour l'arrêter & viser pareillement.
Les certificats que les recommandaresses donnent aux nourrices doivent être représentés par celles-ci à leur curé, qui leur en donne un certificat, & elles doivent l'envoyer au lieutenant général de police, lequel le fait remettre aux recommandaresses.
En cas que les peres & meres manquent à payer les mois dûs aux nourrices, & de répondre à l'avis qui leur en a été donné, les nourrices doivent en informer, ou par elles-mêmes, ou par l'entremise du curé de leur paroisse, le lieutenant général de police qui y pourvoit sur le champ.
Les condamnations qu'il prononce contre les peres & meres, sont exécutées par toutes voies dûes & raisonnables, même par corps, s'il est ainsi ordonné par ce magistrat, ce qu'il peut faire en tout autre cas que celui d'une impuissance connue & effective ; la déclaration du premier Mars 1727 ordonne la même chose ; cette derniere déclaration qui concerne les recommandaresses, nourrices, & les meneurs ou meneuses, rappelle aussi ce qui est dit dans celle de 1715, concernant la jurisdiction du lieutenant général de police sur les recommandaresses, & ajoute, que les abus qui s'étoient glissés dans leur fonction ont été réprimés, par les soins que ce magistrat s'étoit donnés pour faire exécuter la déclaration de 1715.
Il est enjoint par celle de 1727, aux meneurs ou meneuses, de rapporter un certificat de leur curé. Ces certificats doivent être enregistrés par les recommandaresses, & mis en liasse pour être visés par le lieutenant général de police, ou d'un commissaire au châtelet par lui commis.
Les meneurs ou meneuses de nourrices sont aussi tenus aux termes de cette même déclaration, d'avoir un registre paraphé du lieutenant général de police, ou d'un commissaire au châtelet par lui commis, pour y écrire les sommes qu'ils reçoivent pour les nourrices.
La déclaration du 23 Mars 1728 enjoint aux ouvriers qui fabriquent des bayonnettes à ressort, d'en faire leur déclaration au juge de police du lieu, & veut que ces ouvriers tiennent un registre de vente qui soit paraphé par le juge de police.
Cette déclaration a été suivie d'une autre du 25 Août 1737, qui est aussi intitulée, comme concernant le port d'armes, mais qui comprend de plus tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport aux soldats qui s'y trouvent, l'heure de leur retraite, les armes qu'ils peuvent porter, la maniere dont ils peuvent faire des recrues dans Paris ; il est enjoint à cette occasion aux officiers, sergens, cavaliers, dragons & soldats, & à tous autres particuliers qui auront commission de faire des recrues à Paris, d'en faire préalablement leur déclaration au lieutenant général de police, à peine de nullité des engagemens ; enfin, il est dit que la connoissance de l'exécution de cette déclaration & des contraventions qui pourroient y être faites, appartiendra au lieutenant géneral de police de la ville de Paris ; sauf l'appel au parlement.
C'est par une suite & en vertu de cette déclaration, que le lieutenant général de police connoît de tout ce qui concerne le racolage & les engagemens forcés.
Ce magistrat a aussi concurremment avec les trésoriers de France, l'inspection & jurisdiction à l'occasion des maisons & bâtimens de la ville de Paris qui sont en péril imminent ; celui de ces deux tribunaux qui a prévenu demeure saisi de la contestation, & si les assignations sont du même jour, la préférence demeure au lieutenant général de police ; c'est ce qui résulte de deux déclarations du roi, l'une & l'autre du 18 Juillet 1729.
Toutes les contestations qui surviennent à l'occasion des bestiaux vendus dans les marchés de Sceaux & de Poissy, soit entre les fermiers & les marchands forains, & les bouchers & chaircuitiers, même des uns contre les autres, pour raison de l'exécution des marchés entre les forains & les bouchers, même pour cause des refus que pourroit faire le fermier, de faire crédit à quelques-uns des bouchers, sont portées devant le lieutenant général de police, pour y être par lui statué sommairement, & ses ordonnances & jugemens sont éxécutés par provision, sauf l'appel en la cour ; telle est la disposition de l'édit du mois de Janvier 1707, de la déclaration du 16 Mars 1755, & de l'arrêt d'enregistrement du 18 Août suivant.
Lorsque des gens sont arrêtés pour quelque léger délit qui ne mérite pas une instruction extraordinaire, & que le commissaire juge cependant à-propos de les envoyer en prison par forme de correction ; c'est le lieutenant général de police qui décide du tems que doit durer leur détention.
On porte aussi devant lui les contestations sur les saisies que les gardes des corps & communautés font sur ceux, qui sans qualités se mêlent du commerce & de la fabrication des choses dont ils ont le privilege, les discussions entre les différens corps & communautés pour raison de ces mêmes privileges.
Les commissaires reçoivent ses ordres pour l'exécution des réglemens de police, & lui font le rapport des contraventions qu'ils ont constatées, & en général de l'exécution de leurs commissions ; ces rapports se font en l'audience de la chambre de police, où il juge seul toutes les causes de sa compétence.
A l'audience de la grande police, qui se tient au parc civil ; il juge sur le rapport des commissaires, les femmes & les filles débauchées.
Enfin pour résumer ce qui est de la compétence de ce magistrat, il connoît de tout ce qui regarde le bon ordre & la sureté de la ville de Paris, de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de cette ville, du prix, taux, qualités, poids, balances & mesures, des marchandises, magasins & amas qui en sont faits ; il regle les étaux des bouchers, les adjudications qui en sont faites ; il a la visite des halles, foires, marchés, hôtelleries, brelands, tabagies, lieux malfamés ; il connoît des différends qui surviennent entre les arts & métiers, de l'exécution de leurs statuts & réglemens, des manufactures, de l'élection des maîtres & gardes des marchands, communautés d'artisans, brevets d'apprentissage, du fait de l'Imprimerie, des libelles & livres défendus, des crimes commis en fait de police, & il peut juger seul les coupables, lorsqu'il n'échet pas de peine afflictive ; enfin, il a l'exécution des ordonnances, arrêts & réglemens.
Les appellations de ses sentences se relevent au parlement, & s'exécutent provisoirement, nonobstant opposition ou appellation.
Le procureur du roi du châtelet a une chambre particuliere, où il connoît de tout ce qui concerne les corps des marchands, arts & métiers, maîtrises, réceptions des maîtres & jurandes ; il donne ses jugemens qu'il qualifie d'avis, parce qu'ils ne sont exécutoires qu'après avoir été confirmés par sentence du lieutenant général de police, lequel a le pouvoir de les confirmer ou infirmer ; mais s'il y a appel d'un avis, il faut relever l'appel au parlement.
Le lieutenant général de police est commissaire du roi pour la capitation & autres impositions des corps d'arts & métiers, & il fait en cette partie, comme dans bien d'autres, les fonctions d'intendant pour la ville de Paris.
Le roi commet aussi souvent le lieutenant général de police pour d'autres affaires qui ne sont pas de sa compétence ordinaire ; de ces sortes d'affaires, les unes lui sont renvoyées pour les juger souverainement & en dernier ressort à la bastille, avec d'autres juges commis ; d'autres, pour les juger au châtelet avec le présidial. Quelques-unes, mais en très-petit nombre, sont jugées par lui seul en dernier ressort, & la plus grande partie est à la charge de l'appel au conseil. (A)
LIEUTENANT DE ROBE COURTE est un officier qui porte une robe beaucoup plus courte que les autres, & qui siége l'épée au côté.
Au bailliage & capitainerie royal des chasses de la varenne du louvre, grande venerie & fauconnerie de France, il y a un lieutenant de robe courte qui siége après le lieutenant général en charge.
Il y a aussi des lieutenans criminels de robe courte, voyez LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE COURTE. (A)
LIEUTENANS GENERAUX, (Art milit.) dans l'artillerie, sont des officiers qui, sous les ordres du grand-maître, commandent à toute l'artillerie dans les provinces de leur département ; ils donnent les ordres à tous les lieutenans & commissaires provinciaux ; ils ont le droit de faire emprisonner ou interdire ceux des officiers qui peuvent faire des fautes dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent se faire donner les inventaires de toutes les munitions qui sont dans les magasins des places, toutes les fois qu'ils le jugent à-propos ; faire des tournées dans ces places deux fois l'année pour examiner les poudres & les autres munitions, & remédier à tout ce qui se trouve défectueux, &c.
Les départemens de ces officiers sont l'Ile de France, la Picardie, le Boulonnois, Soissonnois, Flandre & Hainault ; les Trois-Evêchés, & les places de la Moselle & de la Sare ; la Champagne, l'Alsace, duché & comté de Bourgogne ; le Lyonnois, Bresse & Bugey ; Dauphiné & Provence ; Languedoc & Roussillon ; Guyenne, Navarre, Biscaye, Béarn, pays d'Aunis & Angoumois ; Bretagne, Touraine, Anjou & Maine ; la Normandie : ce qui fait en tout treize départemens pour toute l'étendue de la France.
LIEUTENANT GENERAL, (Art milit.) C'est dans le militaire de France un officier qui est immédiatement subordonné au maréchal de France. Le lieutenant général est le premier entre ceux qu'on appelle officiers généraux : c'est un grade où l'on parvient après être monté à celui de brigadier & ensuite à celui de maréchal de camp.
Les ordonnances de Louis XIV. données en 1703, considérant l'armée comme partagée en trois gros corps, savoir, de l'infanterie au centre & des deux aîles de cavalerie, de la droite & de la gauche, portent que trois lieutenans généraux auront le commandement de ces trois corps, c'est-à-dire qu'il y en aura un pour l'infanterie, & les deux autres pour les aîles de la cavalerie.
Il y a ordinairement trois autres lieutenans généraux pour la seconde ligne, mais ils sont subordonnés à ceux de la premiere. S'il y a un plus grand nombre de lieutenans généraux dans une armée, ils servent sous les premiers, ou bien ils commandent des reserves ou des camps volans.
Lagarde d'un lieutenant général est de trente soldats avec un sergent, commandés par un lieutenant. Ses appointemens montent à quatre mille livres par mois de quarante-cinq jours, y compris le pain de munition, deux aides de camp & ses gardes.
Dans un siége, le lieutenant général de service est à la droite des attaques, & le maréchal de camp à la gauche.
En campagne, les lieutenans généraux ont alternativement un service ou un commandement qui dure un jour : c'est ce qu'on appelle parmi eux être de jour, ce qui veut dire le jour de service de ces officiers. Celui qui est de jour commande ou a le pas sur tous les autres lieutenans généraux de l'armée, quoique leur grade soit plus ancien.
Pour qu'un lieutenant général jouisse des droits & des prérogatives de sa place en campagne, il faut qu'il ait pour cet effet des lettres du roi, qu'on appelle lettres de service.
Pour servir avec distinction dans le grade de lieutenant général, il faut beaucoup d'expérience & de capacité. Les fonctions bien ou mal remplies de cet emploi, décident souvent du gain ou de la perte d'une bataille : le général ne pouvant point être partout, ni remédier à tout, c'est aux lieutenans généraux à prendre leur parti suivant que les circonstances l'exigent. Un lieutenant général intelligent qui verra un moment décisif pour battre l'ennemi, ne manquera pas d'en profiter ; s'il a moins de connoissance, il attendra les ordres du général, & il manquera l'occasion.
LIEUTENANT GENERAL, (Hist. milit. de France.) Ce fut en 1633, sous le regne de Louis XIII. qu'on commença à connoître en France le titre de lieutenant général dans les armées, n'y ayant auparavant que des maréchaux de camp, & même en fort petit nombre, sous les maréchaux de France. Melchior-Mitte de Chevrieres, marquis de Saint-Chamond, est le premier pour qui on trouve des pouvoirs de lieutenant général, en date du 6 Février de l'année 1633. Le P. Daniel ne l'a pas connu.
Leur nombre fut augmenté sous Louis XIV. à la guerre de 1667, & bien multiplié depuis la guerre de 1672. Cette institution étoit utile, 1°. pour mettre un grade entre le maréchal de camp & le maréchal de France, comme on en mit aussi par le grade de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp, & pour soutenir l'ambition des officiers, en leur faisant voir de plus près les différens degrés d'honneur qui les attendent : 2°. parce que chacun de ces grades augmentant les fonctions de l'officier, le rend plus capable du commandement : 3°. parce que les armées étant devenues plus nombreuses, il falloit plus d'officiers généraux à leurs divisions. Henault. (D.J.)
LIEUTENANT DE ROI, (Art milit.) c'est un officier qui commande dans une place de guerre en l'absence du gouverneur, & immédiatement avant le major.
LIEUTENANT COLONEL, (Art milit.) c'est le second officier d'un régiment ; il est avant tous les capitaines, & commande le régiment en l'absence du colonel.
C'est le roi qui choisit ordinairement les lieutenans colonels parmi les officiers de service qui ont donné en plusieurs occasions des marques de valeur & de conduite, parce que le régiment roule presque toujours sous la discipline du lieutenant colonel. Les colonels, pour l'ordinaire, étant de jeunes gens de qualité qui pensent moins au service qu'à leurs plaisirs, on prend communément pour cet emploi, lorsqu'il vient à vaquer, le plus ancien capitaine, parce qu'il est rare qu'étant parvenu à cette ancienneté, il n'ait pas toutes les qualités convenables pour s'en bien acquiter. Il doit être actif, vigilant, & connoître toutes les fonctions des différentes charges du régiment, afin de savoir si ceux qui les possedent s'en acquitent bien ; il doit savoir la force de chaque compagnie pour employer les meilleurs hommes dans les occasions, où il faut qu'il soit assuré de la valeur de sa troupe ; il doit tenir la main à la discipline du régiment, savoir attaquer & défendre un poste qui lui est confié, s'y retrancher selon le terrein & la conséquence du poste ; savoir mener un régiment au combat, faire une retraite quand il y est forcé, & donner à son bataillon les différentes formes, selon qu'il est attaqué dans le combat ou dans la retraite. Au siége d'une place, il fait, dans l'absence du colonel, les mêmes fonctions, qui sont de faire défense à tous soldats du régiment de sortir du camp la veille du jour qu'il doit monter la garde de la tranchée ; & après avoir reçu l'ordre du lieutenant général ou du maréchal de camp qui est de jour, il conduit le régiment dans les postes, pour relever les autres ; il marche à l'endroit de l'attaque le plus à couvert qui lui est possible. Lorsqu'il est arrivé, il visite les travaux, fait exécuter les ordres qu'il a reçus, & prend un grand soin des officiers & des soldats : son poste est à la gauche du colonel lorsque le régiment n'a qu'un bataillon ; car quand il est de plusieurs, le colonel commande le premier, & le lieutenant colonel le second. Maximes & instructions sur l'art militaire, par M. de Quincy.
Dans le régiment des gardes françoises, celui qui commande la colonelle sous le colonel, porte le titre de capitaine-lieutenant commandant la colonelle. Dans le corps de cavalerie étrangere, le lieutenant colonel est le premier capitaine du régiment qui le commande en l'absence du colonel. Dans les régimens françois de cavalerie, c'est le major qui fait les fonctions de lieutenant colonel, & qui en a les prérogatives.
Comme la charge de lieutenant colonel est considérable & importante, & qu'elle est exercée par des officiers de mérite & d'expérience, le roi y a ajoûté des distinctions qui sont marquées dans ses ordonnances.
Il y dispense les lieutenans colonels des régimens d'infanterie de monter la garde dans les places ; il ordonne que bien que les colonels soient présens au corps, les lieutenans colonels auront le choix des logemens préférablement aux capitaines, sans qu'ils soient obligés de les tirer avec eux. Qu'en outre, il leur soit loisible de choisir, après les colonels, celui des quartiers dans lesquels ils viendront commander, encore bien que leurs compagnies ne s'y trouvent point logées. Que quand les régimens seront en bataille, & que les colonels seront présens à la tête, les lieutenans colonels conserveront le pas devant tous les capitaines. Qu'en l'absence des colonels, ils auront le commandement sur tous les quartiers des régimens, & qu'ils commanderont le second bataillon quand le colonel sera présent pour commander le premier.
Il est encore ordonné que les lieutenans colonels des régimens de cavalerie, en l'absence des mestres-de-camp, & sous leur autorité en leur présence, commanderont lesdits régimens de cavalerie, & ordonneront à tous les capitaines des compagnies & à tous les officiers desdits régimens, ce qu'ils auront à faire pour le service de sa majesté, & pour le maintien & rétablissement desdites compagnies ; & que partout où ils se trouveront, ils commanderont à tous capitaines & majors de cavalerie. Histoire de la milice françoise.
LIEUTENANT, (Art milit.) dans une compagnie de cavalerie, d'infanterie & de dragons, c'est le second officier ; il commande en l'absence du capitaine, & il a le même pouvoir que lui dans la compagnie.
Quand une compagnie d'infanterie est en ordonnance, le lieutenant se porte à la gauche du capitaine, & à la droite, si l'enseigne s'y rencontre.
Il y a des lieutenans en pié & des réformés ; les rangs de ceux ci sont réglés par les ordonnances à-peu-près de la même maniere que ceux des colonels & capitaines en pié, avec les colonels & capitaines reformés.
LIEUTENANT GENERAL DES ARMEES NAVALES, (Art milit.) c'est un des premiers grades de la marine de France. Cet officier a le commandement immédiatement après le vice-amiral ; il précede les chefs d'escadre & leur donne l'ordre. Les fonctions du lieutenant général sont marquées en dix articles dans l'ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine, du 15 Avril 1689, titre III. qu'il est inutile de transcrire ici.
LIEUTENANT DE VAISSEAU, (Art milit.) C'est un officier qui a rang immédiatement après le capitaine, qui commande & en fait toutes les fonctions en l'absence de ce dernier. Les fonctions particulieres du lieutenant sont réglées par la même ordonnance de 1689, titre IX.
|
| LIEUVIN | (Géog.) en latin Lexoviensis ager ; petite contrée de France en Normandie, au diocèse de Lisieux, dont elle fait partie. Le Lieuvin comprend Lisieux, Honfleur, trois ou quatre bourgs, sept abbayes, & quelques bailliages. Ce petit pays, un des plus fertiles de la Normandie, abonde en pommes, en grains & en pâturages ; il a d'ailleurs des mines, des forges & des manufactures de grossieres étoffes de laine, qui occupent utilement les habitans, & les tirent de la pauvreté. (D.J.)
|
| LIEVE | S. f. (Jurisprud.) est un extrait d'un papier terrier d'une seigneurie, qui sert de memoire au receveur pour faire payer les cens & rentes, & autres droits seigneuriaux.
En quelques endroits on appelle ces sortes de registres, cueilloir ou cueilleret.
La lieve contient la désignation de chaque héritage par le terroir & la contrée où il est assis, le nom du tenancier, les confins, la qualité & quotité de la redevance dont il est chargé.
Ces sortes de papiers de recette ne sont pas vraiment authentiques ; cependant les lieves anciennes & faites dans un tems non suspect, servent quelquefois de preuves pour faire de nouveaux terriers quand des titres ont été perdus par guerre ou par incendie, comme il est porté dans l'édit de Melun en faveur des ecclésiastiques.
Quand les lieves sont affirmées, elles font foi en justice. Voyez des Pommiers, sur la coutume de Bourbonnois, art. xxij. n°. 14. & suiv. (A)
LIEVE la (Géog.) petite riviere des Pays-Bas ; elle a sa source en Flandres, près de Damme, entre Bruges & l'Ecluse, & se jette dans les fossés de Gand. (D.J.)
|
| LIEVRE | S. m. lepus, (Hist. nat. Zoolog.) animal quadrupede qui a la tête longue, étroite, arquée depuis le bout du museau jusqu'à l'origine des oreilles ; le museau gros, la levre supérieure fendue jusqu'aux narines ; les yeux grands, ovales, & placés sur les côtés de la tête ; le corps allongé ; la queue courte, & les jambes de derriere beaucoup plus longues que celles de devant, qui sont courtes & minces. Le pié de derriere, le métatarse & le tarse dénotent par leur grosseur, de même que les lombes, que l'on appelle le rable, la force que le lievre a pour la course, & la longueur des jambes de derriere, marque la facilité avec laquelle il s'élance en-avant. Il a quatre doigts dans les piés de derriere, & cinq dans ceux de devant. Le mâle a deux scrotum, un de chaque côté, mais ils ne paroissent que lorsqu'il est avancé en âge ; les autres parties extérieures de la génération sont aussi très-peu apparentes. Au contraire le gland du clitoris de la femelle est presque aussi gros que celui de la verge du mâle ; l'orifice de son prépuce n'est guere plus éloigné de l'anus que la vulve ; ce n'est pourtant qu'à cette différence de longueur du perinée, que l'on peut reconnoître le sexe de ces animaux à la premiere inspection : on s'y trompe souvent ; on a même cru que les lievres étoient hermaphrodites.
Le lievre a le poil fort touffu ; le dos, les lombes, le haut de la croupe & des côtés du corps, ont une couleur roussâtre avec des teintes blanchâtres & noirâtres ; le sommet de la tête est mêlé de fauve & de noir ; les yeux sont environnés d'une bande de couleur blanchâtre ou blanche, qui s'étend enavant jusqu'à la moustache, & en-arriere jusqu'à l'oreille. Tout le reste du corps a différentes teintes de fauve & de roussâtre, de blanc, de noirâtre, &c. La plûpart des levrauts ont au sommet de la tête une petite marque blanche que l'on appelle l'étoile ; pour l'ordinaire elle disparoît à la premiere mue ; quelquefois elle reste même dans l'âge le plus avancé.
Les lievres multiplient beaucoup ; ils peuvent engendrer en tout tems, & dès la premiere année de leur vie ; les femelles ne portent que pendant trente ou trente-un jours ; elles produisent trois ou quatre petits. Ces animaux dorment ou se reposent au gîte pendant le jour ; ils ne se promenent, ne mangent, & ne s'accouplent que pendant la nuit ; ils se nourrissent de racines, de feuilles, de fruits, d'herbes laiteuses, d'écorces d'arbres, excepté celles de l'aune & du tilleul. Les lievres dorment les yeux ouverts ; ils ne vivent que sept ou huit ans au plus ; on n'entend leur voix que lorsqu'on les saisit ou qu'on les fait souffrir ; c'est une voix forte & non pas un cri aigre ; ils sont solitaires & fort timides ; ils ne manquent pas d'instinct pour leur conservation, ni de sagacité pour échapper à leurs ennemis. Ils se forment un gîte exposé au nord en été, & au midi en hiver ; on les apprivoise aisement, mais ils s'échappent, lorsqu'il s'en trouve l'occasion.
Les lievres qui sont dans les pays de collines élevées, ou dans les plaines en montagnes, sont excellens au goût ; ceux qui habitent les plaines basses ou les vallées, ont la chair insipide & blanchâtre ; enfin, ceux qui sont vers les marais & les lieux fangeux, ont la chair de fort mauvais goût : on les appelle lievres ladres. Les lievres de montagne sont plus grands & plus gros que les lievres de plaine ; ils ont plus de brun sur le corps & plus de blanc sous le cou. Sur les hautes montagnes & dans les pays du nord, ils deviennent blancs pendant l'hiver, & reprennent en été leur couleur ordinaire ; il y en a qui sont toûjours blancs ; on trouve des lievres presque par-tout. On a remarqué qu'il y en a moins en Orient qu'en Europe, & peu ou point dans l'Amérique méridionale. Hist. nat. gen. & part. tom. VI.
Le lievre, Chasse du lievre, est un animal qui vit solitairement ; il n'a pas besoin d'industrie pour se procurer sa nourriture. Excepté l'ouie qu'il a très-fine, tous ses sens sont obtus. Enfin, il n'a que la fuite pour moyen de défense. Aussi sa vie est-elle uniforme, ses moeurs sont-elles simples. La crainte forme son caractere ; son repos même est accompagné de surveillance. Il dort presque tout le jour ; mais il dort les yeux ouverts. Le moindre bruit l'effraye, & son inquiétude lui sert ordinairement de sauvegarde.
Les lievres ne quittent guère le gîte pendant le jour, à moins qu'on ne les en chasse. Le soir ils se rassemblent sur les blés, ou bien dans les autres lieux où ils trouvent commodément à paître. Pendant la nuit ils mangent, ils jouent, ils s'accouplent. La répétition de ces actes si simples fait presque toute l'histoire naturelle de la vie d'un lievre. Cependant lorsque ces animaux sont chassés, on les voit déployer une industrie & des ruses, dont l'uniformité de leur vie ne les laisseroit pas soupçonner. Voyez INSTINCT.
Les lievres sont fort lascifs, & multiplient beaucoup ; mais moins que les lapins, parce qu'ils engendrent un peu plus tard, & que les portées sont moins nombreuses. On peut les regarder comme animaux sédentaires. Ils passent tout l'été dans les grains : pendant la récolte, l'importunité que leur causent les moissonneurs, leur fait chercher les guerets ou les bois voisins ; mais ils ne s'écartent jamais beaucoup du lieu où ils sont nés, & ils ne sont point sujets aux émigrations si familieres à d'autres especes.
Le tempérament des lievres est assez délicat, surtout dans les pays où on les conserve en abondance. Ils souffrent promtement du défaut de nourriture pendant la neige. Le givre qui couvre l'herbe les rend sujets à des maladies qui les tuent. Ils sont aussi fort exposés, sur-tout pendant leur jeunesse, aux oiseaux de proie & aux bêtes carnassieres. Mais malgré ces dangers, leur multiplication devient bien-tôt excessive par-tout où ils sont épargnés par les hommes.
LIEVRE, (Diete, & Mat. méd.). Le jeune lievre ou le levraut fournit un aliment délicat, succulent, relevé par un fumet qui est peut-être un principe utile & bienfaisant. Il a été dès long-tems compté parmi les mets les plus exquis ; les personnes accoutumées à une nourriture legere digerent très-bien cette viande, mangée rôtie & sans assaisonnement. Les estomacs accoutumés aux nourritures grossieres & irritantes s'en accommodent mieux, en la mangeant avec les assaisonnemens les plus vifs, comme le fort vinaigre & le poivre, soit rôtie, soit bouillie ou cuite dans une sauce très piquante, c'est-à-dire, sous la forme de ce ragout vulgairement appellé civet. Voyez CIVET.
On mange le levraut rôti dans quelques provinces du royaume, en Gascogne & en Languedoc, par exemple, avec une sauce composée de vinaigre & de sucre, qui est mauvaise, mal-saine en soi essentiellement ; mais qui est sur-tout abominable pour tous ceux qui n'y sont pas accoutumés.
L'âge où le levraut est le plus parfait, est celui de sept à huit mois. Lorsqu'il est plus jeune, qu'il n'a par exemple, que trois ou quatre mois, sa chair n'est point faite, & est de difficile digestion, comme celle de beaucoup de jeunes animaux, par sa fadeur, son peu de consistance, son état pour ainsi dire glaireux. Voyez VIANDE. A un an il est encore très-bon.
Le vieux lievre est en général, dur, sec, & par-là de difficile digestion. Mais il convient mieux par cela même aux manoeuvres & aux paysans. Aussi les paysans dans les pays heureux où ils participent assez à la condition commune des hommes, pour être en état de servir quelquefois sur leurs tables des alimens salutaires & de bon goût ; préferent-ils par instinct un bon vieux lievre, un peu ferme & même dur, à un levraut tendre & fondant, & à toutes les viandes de cette derniere espece. Voyez REGIME.
Les femelles pleines sont communément assez tendres ; & dans les pays, comme dans le bas-Languedoc, où le lievre est d'ailleurs excellent, on les sert rôties sur les bonnes tables. Les vieilles hases & les bouquins ne se mangent en général, qu'en ragoût ou en pâté.
Le lievre varie considérablement en bonté, selon le pays qu'il habite. Le plus excellent est celui des climats tempérés & secs, & qui habite dans ces climats les lieux élevés ; mais non pas cependant les montagnes proprement dites, qui sont froides & humides dans tous les climats. Ceux qui vivent sur les côteaux, dans les provinces méridionales du royaume sont des plus parfaits. Ceux des environs de Paris ne font pas même soupçonner ce que peut être un bon lievre de Languedoc.
La seule qualité particuliere & vraiment médicamenteuse de la chair de lievre, qui soit démontrée par l'expérience, c'est qu'elle lâche assez constamment le ventre, & purge même efficacement plusieurs sujets. Cette qualité est confirmée par l'expérience ; & c'est sans fondement que quelques auteurs, entr'autres le continuateur de la Cynosure d'Herman, avancent que cette chair resserre le ventre.
Il n'est point d'animal chez qui on ait trouvé tant de parties médicamenteuses, que dans celui-ci. Schroeder en compte quatorze, & le continuateur de la Cynosure d'Herman en grossit encore la liste. Mais toutes ces drogues sont absolument hors d'usage, excepté les poils qui entrent dans une espece d'emplâtre agglutinatif, qui est de Galien, & qui est d'ailleurs composé d'aloës, de myrrhe & d'encens. Cet emplâtre est vanté comme un spécifique pour arrêter le sang après l'artériotomie ; mais on peut assurer que les poils de lievre, soit entiers, soit brûlés, selon l'ancienne recette, sont l'ingrédient le moins utile de cette composition, ou pour mieux dire, en sont un ingrédient absolument inutile. D'ailleurs, on n'applique plus d'emplâtre pour arrêter le sang, dans l'opération de l'artériotomie ; la compression suffit, & ce n'est presque que ce moyen, ou l'agaric de Brossart qu'on emploie dans ce cas. Voyez ARTERIOTOMIE. (B).
LIEVRE, (Pelletterie.) Le lievre fournit outre sa chair, deux sortes de marchandises dans le commerce ; savoir, sa peau & son poil.
Les Pelletiers fourreurs préparent les peaux de lievre toutes chargées de leur poil, & en font plusieurs sortes de fourrures qui sont très-chaudes, & qu'on croit même fort bonnes pour la guérison de toutes sortes de rhumatismes.
Le poil du lievre est d'une couleur rougeâtre ; mais il vient de Moscovie des peaux de lievres toutes blanches, qui sont beaucoup plus estimées que celles de France.
Le poil de lievre, détaché de la peau, étoit autrefois d'un grand usage en France pour la chapellerie ; mais par un arrêt du conseil de l'année 1700, il est défendu expressément aux Chapeliers de s'en servir.
Avant que de couper le poil de dessus la peau pour en faire des chapeaux ; on en arrache le plus gros qui est sur la superficie, parce qu'il n'y a que celui du fond, dont on puisse faire usage.
LIEVRE DE MER, lepus marinus. (Hist. nat.) Animal qui n'a point de sang & qui est mis au rang des animaux mous, comme la séche, le polype, &c. Rondelet fait mention de trois especes de lievres de mer, très-différens du poisson que l'on appelle en Languedoc lebre de mar. Voyez SCORPIOIDES.
Le lievre de mer des anciens est donc, selon Rondelet, un poisson mou que Dioscoride a comparé à un calemar & Aelien à un limaçon, tiré hors de sa coquille : Pline le désigne comme une masse ou une piece de chair sans forme. On a donné à cet animal le nom de lievre, parce qu'il a une couleur rouge fort obscure qui approche de celle du lievre. Les anciens disent que le lievre de mer est venimeux, que lorsqu'on en a mangé, on enfle, on pisse le sang, le poumon s'ulcere, &c. Dioscoride donne pour remede, le lait d'ânesse, la décoction de mauve, &c.
La premiere espece de lievre de mer, selon Rondelet, est la plus venimeuse. Cet animal a un os comme la séche sous le dos, & deux nageoires recourbées aux côtés ; sa queue est menue d'un côté, & recoquillée : il a entre la queue & le dos deux petites cornes molles & charnues, comme celles des limaçons. La tête ressemble à celle du poisson appellé marteau ; il y a de l'autre côté une ouverture qui laisse passer une masse de chair que l'animal avance & retire à son gré. La bouche est placée entre les deux côtés de la tête. Les parties internes ressemblent à celles de la séche ; il a aussi une liqueur noire.
Le lievre de mer de la seconde espece ne differe de celui de la premiere, que par l'extérieur qui est symmétrique, & non pas irrégulier, comme dans la premiere espece. La bouche est placée entre deux larges excroissances charnues ; il n'y a point d'os comme à la séche sous le dos, mais au-dehors ; il y a deux petites cornes molles, plus petites & plus pointues que dans le premier lievre de mer : le second est le plus grand.
La troisieme espece de lievre de mer est très-différente des deux premieres ; Rondelet ne lui a donné le même nom, qu'à cause qu'elle a la même propriété venimeuse ; cependant c'est aussi un animal mou, de figure très-informe. Voyez Rond. Hist. des poissons, liv. XVII.
LIEVRE, bec de, (Physiolog.) division difforme de l'une ou de l'autre des deux levres. Vous en trouverez la méthode curative au mot BEC DE LIEVRE.
Comme il y a plusieurs accidens qui dépendent de la situation & de la compression du corps de l'enfant dans l'utérus, peut-être, dit un homme d'esprit, qu'on pourroit expliquer celui-ci par cette cause.
Il peut arriver qu'un doigt de l'enfant appliqué sur la levre la presse trop dans un point : cette compression en gênera les vaisseaux, & empêchera que la nourriture y soit portée. Cette partie trop mince & trop foible en proportion des parties latérales qui reçoivent tout leur accroissement, se déchirera au moindre effort, la levre sera divisée.
Il est vrai, continue-t-il, que si on ne fait attention qu'à l'effort nécessaire pour diviser avec quelqu'instrument la levre d'un enfant nouveau né, on a peine à croire que la pression d'un de ses doigts puisse causer cette division tandis qu'il est dans le sein de sa mere ; mais on est moins surpris du phénomene, on en comprend mieux la possibilité, quand on se rappelle qu'une soie qui lie la branche d'un arbrisseau, devenant supérieure à tout l'effort de la seve, l'empêche de croître ou occasionne la division de l'écorce & des fibres ligneuses.
Cette supériorité de force qui se trouve dans les liquides, dont l'impulsion donne l'accroissement aux animaux, aux végétaux, consiste principalement dans la continuité de son action ; mais cette action considérée dans chaque instant est si foible, que le moindre obstacle peut la surmonter. En appliquant ce principe à un enfant nouvellement formé, dont les chairs n'ont presque aucune consistance, & en qui l'action des liquides est proportionnée à cette foiblesse, l'on reconnoîtra avec combien de facilité la levre d'un enfant peut être divisée par la compression continuelle faite par l'action de ses doigts, dont la solidité & la résistance surpassent de beaucoup celle de la levre. La division de la levre supérieure est quelquefois petite, quelquefois considérable, quelquefois double ; & toutes ces différences s'expliquent encore aisément par le même principe. Je conviens de tout cela, mais j'ajoute que cette hypothèse qu'on nomme principe, n'est qu'un roman de l'imagination, une de ces licences ingénieuses, de ces fictions de l'esprit humain qui, voulant tout expliquer, tout deviner, ne tendent qu'à nous égarer au lieu de répandre la lumiere dans le méchanisme de la nature. (D.J.)
LIEVRE ou saisine de beaupré, (Marine) ce sont plusieurs tours de corde qui tiennent l'aiguille de l'éperon avec le mât de beaupré.
LIEVRE, lepus, (Astronomie) constellation dans l'hémisphere méridional, dont les étoiles sont dans le catalogue de Ptolémée au nombre de douze, dans celui de Tycho au nombre de treize, & dans le catalogue anglois au nombre de dix-neuf.
|
| LIGAMENT | S. m. (Anatomie) partie du corps blanche, fibreuse, serrée, compacte, plus simple & plus pliante que le cartilage, difficile à rompre ou à déchirer, ne prêtant presque point, ou ne prêtant que très-difficilement lorsqu'on la tire.
Le ligament est composé de plusieurs fibres très-déliées & très-fortes, qui, par leur différent arrangement, forment ou des cordons étroits, ou des bandes, ou des toiles minces. Ils paroissent servir à attacher, à soutenir, à contenir, à borner & à garantir d'autres parties, soit dures, soit molles.
Ainsi leurs usages sont, 1°. de lier les os ensemble dans leurs conjonctions, & d'empêcher qu'ils ne puissent se luxer que par d'extrêmes violences ; 2°. de suspendre & arrêter certaines parties molles dans leur situation, comme la matrice, le foie & autres ; 3°. de former des especes d'anneaux ou de poulies qui empêchent l'écartement des tendons de certains muscles, comme on le voit aux ligamens annulaires de la jonction du poignet.
Les ligamens considérés en eux-mêmes, different à raison de leur consistance & de leur sensibilité : à l'égard de leur consistance, on les appelle ligamens cartilagineux, membraneux & nerveux, selon qu'ils ont plus de rapport aux cartilages, aux membranes & aux nerfs. Pour ce qui concerne leur sensibilité, on conçoit que ceux qui sont des productions de parties tendineuses & nerveuses, sont beaucoup plus sensibles que les autres.
Les ligamens sont ou propres à des parties molles, ou communes aux autres parties molles & aux parties dures. Quant aux ligamens des parties molles, voyez-en l'article à chacune des parties qui en ont, ou voyez-les sous les noms particuliers que les Anatomistes leur ont donnés. Nous ne parlerons ici que des ligamens qui sont attachés aux os seuls & à leurs cartilages.
On peut en établir deux classes générales ; les uns sont employés aux articulations mobiles des os, les autres lient les os ou s'y attachent indépendamment de leurs articulations.
Les ligamens qui servent aux articulations mobiles des os, & que l'on peut appeller ligamens articulaires, sont de plusieurs especes.
Il y en a qui ne font que retenir & affermir les articulations, rendre leurs mouvemens sûrs, & empêcher que les os ne quittent leur assemblage naturel, comme il arrive dans les luxations. Ces ligamens sont comme des cordons plus ou moins applatis, ou comme des bandelettes, tantôt étroites, tantôt un peu larges, quelquefois assez minces, mais toujours très-fortes & prêtant très-peu. Tels sont les ligamens des articulations ginglymoïdes, c'est-à-dire en charniere, & ceux qui lient les corps de vertebres ensemble.
Immédiatement au-dessous des ligamens articulaires, il se trouve une membrane assez mince, laquelle s'attache de part & d'autre autour de l'articulation, pour empêcher l'écoulement de la synovie, qui humecte continuellement la surface des cartilages de l'articulation.
Il y a de ces ligamens qui font tout ensemble l'office de lien ou de bande pour tenir les os assemblés, & de capsule pour servir de reservoir au mucilage. Ils environnent les articulations orbiculaires, comme celle de l'os du bras avec l'omoplate, celle du fémur avec l'os innominé, &c.
Il y a aussi des ligamens qui sont cachés dans les articulations, même par la capsule ; tel est celui de la tête du fémur, appellé communément, mais improprement, le ligament rond, & ceux de la tête du tibia, que l'on nomme ligamens croisés.
Les autres ligamens de la premiere classe, c'est-à-dire ceux qui sont attachés aux os, indépendamment de leurs articulations, sont encore de deux sortes.
Les uns sont lâches, & ne font que borner, ou limiter les mouvemens de l'os ; tels sont ceux qui attachent les clavicules aux apophyses épineuses des vertebres ; les autres sont bandés & tendus ; tels sont ceux qui vont de l'acromion à l'apophyse coracoïde ; ceux qui sont attachés par un bout à l'os sacrum, & par l'autre à l'os ischion, &c.
Enfin, il se trouve des ligamens, qui quoiqu'attachés aux os, ou aux cartilages, servent aussi à d'autres parties, comme aux muscles, ou aux tendons, soit pour les contenir, les brider, les borner, en assurer ou en échanger la direction dans certains mouvemens ; tels sont les ligamens interosseux de l'avant-bras, ou de la jambe, ceux qu'on nomme tant à la main qu'au pié, annulaires, les ligamens latéraux du cou, & quantité d'autres.
Outre toutes ces différences de ligamens, on peut encore remarquer d'autres variétés par rapport à leur consistance, leur solidité, leur épaisseur, leur figure, & leur situation.
Il y a des ligamens qui sont presque cartilagineux, comme celui qui entoure la tête du rayon, la petite tête de l'os du coude, & les gaines annulaires des doigts.
Il y en a qui ont une certaine élasticité, par laquelle ils se laissent allonger par force, & se raccourcissent aussi-tôt qu'ils cessent d'être tirés ; tels sont les ligamens qui attachent l'os hyoïde aux apophyses styloïdes, les ligamens des vertebres lombaires, & autres.
Quelquefois les ligamens se ramollissent & se relâchent, lorsqu'ils sont abreuvés par des humeurs surabondantes, ou viciées ; ce qui fait que les os, ou les parties molles qu'ils maintenoient dans leur situation s'en échappent ; ensorte que le relâchement de ces ligamens cause des dislocations de causes internes, des descentes de matrices, &c. & ces sortes d'accidens sont très difficiles à guérir.
On peut consulter sur les ligamens considérés d'un oeil anatomique, l'ouvrage de Walther, (A. F.) de articulis & ligamentis, Lips. 1728. in-4°. avec figures ; mais la Physiologie n'est pas encore parvenue à nous donner de grandes lumieres sur les ligamens des parties molles ; leur structure & leurs usages sont trop cachés à nos foibles yeux. (D.J.)
LIGAMENT coronaire du foie, (Anatom.) on donne vulgairement ce nom à l'attache immédiate de la surface postérieure & supérieure du foie, & principalement de son grand lobe, avec la portion aponévrotique du diaphragme qui lui répond ; desorte que la substance du foie, & celle du diaphragme, s'entretouchent dans cet endroit, & les membranes de l'un & de l'autre s'unissent à la circonférence de cette attache, laquelle n'a environ que deux travers de doigt d'étendue.
Ainsi le grand lobe du foie est attaché au diaphragme, principalement à l'aile droite de sa portion tendineuse par une adhérence immédiate & large, sans que la membrane du péritoine y intervienne ; car elle ne fait que se replier tout autour de cette adhérence, pour former la membrane externe de tout le reste du corps du foie.
Or cette adhérence large est improprement & mal-à-propos nommée ligament coronaire ; car 1°. ce n'est pas un ligament ; 2°. cette adhérence n'est ni ronde, ni circulaire, & par conséquent ne forme point une couronne ; 3°. elle n'est pas dans la partie supérieure de la convexité du foie, mais le long de la partie posterieure du grand lobe ; de maniere que l'extrémité large de cette adhérence est tout proche de l'échancrure ; & l'autre qui est pointue, regarde l'hypocondre droit.
LIGAMENS latéraux du foie, (Anat.) ce sont deux petits ligamens qui se remarquent à droite & à gauche, tout le long du bord postérieur du petit lobe, & de la portion du grand lobe, qui n'est pas immédiatement collée au diaphragme.
Ces ligamens sont formés de la duplicature de la membrane du foie, qui au lieu de se terminer au bord postérieur de ce viscere, s'avance environ un pouce au-delà, tout le long de ce bord, & vient s'unir ensuite à la portion de la membrane du diaphragme qui est vis-à-vis.
|
| LIGAS | S. m. (Bot. exot.) c'est une des trois especes d'arbres d'anacarde, & la plus petite ; la moyenne s'appelle anacarde des boutiques, & la troisieme se nomme cajou ou acajou. Voyez ANACARDE & ACAJOU.
Le ligas, suivant la description du P. Georges Camelli, est un arbre sauvage des Philippines. Il est de médiocre grandeur ; il vient sur les montagnes, & ses jeunes pousses répandent, étant cassées, une liqueur laiteuse, qui en tombant sur les mains ou sur le visage, excite d'abord une démangeaison, & peu-à-peu l'enflure. La feuille de cet arbre est longue d'un empan & plus, d'un verd foncé, rude, & qui a peu de suc. Ses fleurs sont petites, blanches, découpées en forme d'étoile, & disposées en grappe à l'extrémité des tiges. Ses fruits sont de la grosseur de ceux que porte l'érable : leur couleur est d'un rouge safrané, & leur goût acerbe comme celui des pommes sauvages. Au sommet de ces fruits est attaché un noyau noir, lisse, luisant, & plus long que les fruits : l'amande qu'il contient étant mâchée, picote & resserre un peu le gosier.
LIGATURE, s. f. (Théolog.) chez les Théologiens mystiques, signifie une suspension totale des facultés supérieures ou des puissances intellectuelles de l'ame. Ils prétendent que quand l'ame est arrivée à une parfaite contemplation, elle reste privée de toutes ses opérations & cesse d'agir, afin d'être plus propre & mieux disposée à recevoir les impressions & communications de la grace divine. C'est cet état passif que les mystiques appellent ligature.
LIGATURE, (Divinat.) se dit d'un état d'impuissance vénérienne causée par quelque charme ou maléfice.
L'existence de cet état est prouvée par le sentiment commun des Théologiens & des Canonistes, & rien n'est si fréquent dans le Droit canon, que les titres de frigidis & maleficiatis, ni dans les decrétales des papes que des dissolutions de mariage ordonnées pour cause d'impuissance, soit de la part du mari, soit de la part de la femme, soit de tous deux en même tems provenue de maléfice. L'Eglise excommunie ceux qui par ligature ou autre maléfice, empêchent la consommation du saint mariage. Enfin, le témoignage des historiens & des faits certains concourent à établir la réalité d'une chose si surprenante.
On appelle communément ce maléfice, nouer l'éguillette : les rabbins prétendent que Cham donna cette maladie à son pere Noé, & que la plaie dont Dieu frappa Abimelech roi de Gerare, & son peuple, pour le forcer à rendre à Abraham Sara qu'il lui avoit enlevée, n'étoit que cette impuissance réciproque répandue sur les deux sexes.
Delrio, qui traite assez au long de cette matiere dans ses disquisitions magiques, liv. III. part. I. quest. iv. sect. 3. pag. 417. & suivantes, dit que les sorciers font cette ligature de diverses manieres, & que Bodin en rapporte plus de cinquante dans sa démonomanie, & il en rapporte jusqu'à sept causes, telles que le dessechement de semence & autres semblables, qu'on peut voir dans son ouvrage ; & il observe que ce maléfice tombe plus ordinairement sur les hommes que sur les femmes, soit qu'il soit plus difficile de rendre celles-ci stériles, soit, dit-il, qu'y ayant plus de sorcieres que de sorciers, les hommes se ressentent plutôt que les femmes de la malice de ces magiciennes. On peut, ajoute-t-il, donner cette ligature pour un jour, pour un an, pour toute la vie, ou du-moins jusqu'à ce que le noeud soit dénoué, mais il n'explique ni comment ce noeud se forme, ni comment il se dénoue.
Kempfer parle d'une sorte de ligature extraordinaire qui est en usage parmi le peuple de Macassar, de Java, de Siam, &c. par le moyen de ce charme ou maléfice, un homme lie une femme ou une femme un homme, ensorte qu'ils ne peuvent avoir de commerce vénérien avec aucune autre personne, l'homme étant rendu impuissant par rapport à toute autre femme, & tous les autres hommes étant rendus tels par rapport à cette femme.
Quelques philosophes de ces pays-là prétendent qu'on peut faire cette ligature en fermant une serrure, en faisant un noeud, en plantant un couteau dans un mur, dans le même tems précisément que le prêtre unit les parties contractantes, & qu'une ligature ainsi faite peut être rendue inutile, si l'époux urine à-travers un anneau : on dit que cette superstition regne aussi chez les Chrétiens orientaux.
Le même auteur raconte que durant la cérémonie d'un mariage en Russie, il remarqua un vieil homme qui se tenoit caché derriere la porte de l'église, & qui marmottant certaines paroles, coupoit en même tems en morceaux une longue baguette qu'il tenoit sous son bras ; pratique qui semble usitée dans les mariages des gens de distinction de ce pays, & avoir pour but de rendre inutiles les efforts de toute autre personne qui voudroit employer la ligature.
Le secret d'employer la ligature est rapporté par Kempfer, de la même maniere que le lui enseigna un adepte en ce genre ; comme c'est une curiosité, je ne ferai pas de difficulté de l'ajoûter ici dans les propres termes de l'auteur, à la faveur desquelles elle passera beaucoup mieux qu'en notre langue.
Puella amasium vel conjux maritum ligatura, absterget à concubitûs actu, Priapum indutio, ut seminis quantum potest excipiat. Hoc probe convolutum sub limine domûs suae in terram sepeliet, ibi quamdiu sepultum reliquerit, tamdiu ejus hasta in nullius praeter quam sui (fascinantis) servitium obediet, & prius ab hoc nexu non liberabitur quam ex claustro liminis liberetur ipsum linteum. Vice versâ vir lecti sociam ligaturus, menstruatum ab ea linteum comburito ; ex cineribus cum propriâ urinâ subactis efformato figuram Priapi, vel si cineres (peut-être faut-il mentulae) junculae fingendae non sufficient, eosdem subigito cum parte terrae quam recens perminxerit. Formatum iconem caute exsiccato, siccumque asservato loco sicco ne humorem contrahat. Quamdiu sic servaveris, omnes arcus dum ad scopum sociae collimaverint, momento contabescent. Ipse vero Dominus abrunum hunc suum prius humectato. Quandiu sic manebit, tandiu suspenso nexu Priapus ipsi parebit, quin & alios quot quot faemina properantes admiserit.
Tout cela sans doute est fondé sur un pacte tacite ; car quelque relation qu'aient les matieres qu'on emploie dans ce charme avec les parties qu'on veut lier ou rendre impuissantes, il n'y a point de système de Physique qui puisse rendre raison des effets qu'on attribue à ce linge maculé & à cette figure.
M. Marshal parle d'une autre sorte de ligature qu'il apprit d'un brachmane dans l'Indostan : " Si l'on coupe en deux, dit-il, le petit ver qui se trouve dans le bois appellé lukerata kara, ensorte qu'une partie de ce ver remue, & que l'autre demeure sans mouvement : si l'on écrase la partie qui remue, & qu'on la donne à un homme avec la moitié d'un escarbot, & l'autre moitié à une femme ; ce charme les empêchera l'un & l'autre d'avoir jamais commerce avec une autre personne. " Transact. philosoph. n°. 268.
Ces effets surprenans bien attestés, paroissent aux esprits sensés procéder de quelque cause surnaturelle, principalement quand il n'y a point de vice de conformation dans le sujet, & que l'impuissance survenue est perpétuelle ou du moins de longue durée. Les doutes fondés qu'elle doit suggérer n'ont pas empêché Montagne, tout pyrrhonien qu'il étoit, de regarder ces nouemens d'éguillettes comme des effets d'une imagination vivement frappée, & d'en chercher les remedes dans l'imagination même, en la séduisant sur la guérison comme elle a été trompée sur la nature du mal.
" Je suis encore en ce doute, dit-il, que ces plaisantes liaisons dequoi notre monde se voit si entravé, qu'il ne se parle d'autre chose, ce sont volontiers des impressions de l'appréhension & de la crainte : car je sais par expérience, que tel de qui je puis répondre, comme de moi-même, en qui il ne pouvoit choir soupçon aucun de foiblesse, & aussi peu d'enchantement, ayant oui faire le conte à un sien compagnon d'une défaillance extraordinaire en quoi il étoit tombé sur le point qu'il en avoit le moins de besoin, se trouvant en pareille occasion, l'horreur de ce conte lui vint à coup si rudement frapper l'imagination, qu'il encourut une fortune pareille : ce vilain souvenir de son inconvénient le gourmandant & tyrannisant, il trouva quelque remede à cette rêverie, par une autre rêverie. C'est qu'advenant lui-même, & prêchant avant la main, cette sienne subjection, la contention de son ame se soulageoit, sur ce qu'apportant ce mal comme attendu, son obligation en amoindrissoit & lui en penoit moins. Quand il a eu loi, à son choix (sa pensée desbrouillée & desbandée, son corps se trouvant en son Deu) de le faire lors premierement tenter, saisir & surprendre à la connoissance d'autrui, il s'est guéri tout net.... Ce malheur n'est à craindre qu'aux entreprises où notre ame se trouve outre mesure tendue de desir & de respect ; & notamment où les commodités se rencontrent impourvues & pressantes. On n'a pas moyen de se ravoir de ce trouble. J'en sais à qui il a servi d'apporter le corps même, demi rassasié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur de cette fureur, & qui par l'aage se trouve moins impuissant de ce qu'il est moins puissant : & tel autre à qui il a servi aussi qu'un ami l'ait asseuré d'être fourni d'une contre-batterie d'enchantements certains à le préserver. Il vaut mieux que je die comment ce fut ".
" Un comte de très-bon lieu, de qui j'étois fort privé, se mariant avec une belle dame qui avoit été poursuivie de tel qui assistoit à la fête, mettoit en grande peine ses amis, & nommément une vieille dame sa parente qui présidoit à ces nopces, & les faisoit chez elle, craintive de ces sorcelleries, ce qu'elle me fit entendre. Je la priai s'en reposer sur moi ; j'avois de fortune en mes coffres certaine petite piece d'or plate, où étoient gravées quelques figures célestes contre le coup de soleil, & pour ôter la douleur de tête la logeant à point sur la cousture du test ; & pour l'y tenir, elle étoit cousue à un ruban propre à rattacher sous le menton : rêverie germaine à celle dont nous parlons.... J'advisai d'en tirer quelque usage, & dis au comte qu'il pourroit courre fortune comme les autres, y ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter une ; mais que hardiment il s'allast coucher. Que je lui ferois un tour d'ami, & n'épargnerois à son besoin un miracle qui étoit en ma puissance : pourveu que sur son honneur, il me promist de le tenir très-fidelement secret. Seulement comme sur la nuit on iroit lui porter le réveillon, s'il lui étoit mal allé, il me fist un tel signe. Il avoit eu l'ame & les oreilles si battues, qu'il se trouva lié du trouble de son imagination, & me fit son signe à l'heure susdite. Je lui dis à l'oreille qu'il se levât sous couleur de nous chasser, & prinst en se jouant la robe de nuit que j'avois sur moi (nous étions de taille fort voisine) & s'en vestit tant qu'il auroit exécuté mon ordonnance qui fut, quand nous serions sortis, qu'il se retirât à tomber de l'eau, dist trois fois telles paroles & fist tels mouvemens. Qu'à chacune de ces trois fois, il ceignit le ruban que je lui mettois en main, & couchast bien soigneusement la médaille qui y étoit attaché sur ses roignons, la figure en telle posture. Cela fait, ayant à la derniere fois bien estreint ce ruban, pour qu'il ne se peust ni desnouer, ni mouvoir de sa place, qu'en toute assurance, il s'en retournast à son prix faict, & n'oubliast de rejetter ma robe sur son lit, en maniere qu'elle les abriast tous deux. Ces singeries sont le principal de l'effet : notre pensée ne se pouvant démesler, que moyens si étranges ne viennent de quelqu'abstruse science. Leur inanité leur donne poids & révérence. Somme, il fut certain que mes caracteres se trouverent plus vénériens que solaires, & plus en action qu'en prohibition. Ce fut une humeur prompte & curieuse qui me convia à tel effet, éloigné de ma nature, &c. " Essais de Montaigne, liv. I. chap. xx. édit. de M. Coste, pag. 81. & suiv.
Voilà un homme lié du trouble de son imagination, & guéri par un tour d'imagination. Tous les raisonnemens de Montaigne & les faits dont il les appuie se réduisent donc à prouver que la ligature n'est quelquefois qu'un effet de l'imagination blessée ; & c'est ce que personne ne conteste : mais qu'il n'y entre jamais du maléfice, c'est ce qu'on ne pourroit en conclure qu'en péchant contre cette regle fondamentale du raisonnement, que quelques faits particuliers ne concluent rien pour le général, parce qu'il est en ce genre des faits dont on ne peut rendre raison par le pouvoir de l'imagination, tel qu'est l'impuissance à l'égard de toutes personnes, à l'exclusion de celle qui a fait la ligature pour jouir seule de son amant ou de son mari, & celle qui survient tout-à-coup la premiere nuit d'un mariage à un homme qui a donné auparavant toutes les preuves imaginables de virilité, sur-tout quand cette impuissance est ou durable ou perpétuelle.
LIGATURE, terme de Chirurgie, fascia, bande de drap écarlate, coupée à droit fil suivant la longueur de sa chaîne, large d'un travers de pouce ou environ, longue d'une aune, qui sert à serrer suffisamment le bras, la jambe ou le col pour faciliter l'opération de la saignée.
La ligature, en comprimant les vaisseaux, interrompt le cours du sang, fait gonfler les veines qu'on veut ouvrir, les assujettit & les rend plus sensibles à la vue & au toucher.
La maniere d'appliquer la ligature pour les saignées du bras ou du pié, est de la prendre par le milieu avec les deux mains, de façon que le côté intérieur soit sur les quatre doigts de chaque main, & que les pouces soient appuyés sur le supérieur. On pose ensuite la ligature environ quatre travers de doigt audessus de l'endroit où l'on se propose d'ouvrir la veine ; puis glissant les deux chefs de la ligature à la partie opposée, on les croise en passant le chef interne du côté externe, & ainsi de l'autre, afin de les conduire tous deux à la partie extérieure du bras où on les arrête par un noeud en boucle.
Cette méthode de mettre la ligature, quoique pratiquée presque généralement, est sujette à deux défauts assez considérables ; le premier, c'est qu'en croisant les deux chefs de la ligature sous le bras, on les fronce de maniere qu'on ne serre point uniment ; le second, c'est qu'en fronçant ainsi la ligature on pince le malade. Les personnes sensibles & délicates souffrent souvent plus de la ligature que de la saignée. Il est très-facile de remédier à ces inconvéniens ; on conduira les deux chefs de la ligature en ligne droite, & au lieu de les croiser à la partie opposée de l'endroit où l'on doit saigner, on fera un renversé avec l'un des chefs, qui par ce moyen sera conduit fort également sur le premier tour, jusqu'à la partie extérieure du membre où il sera arrêté avec l'autre chef par un noeud coulant en forme de boucle.
Les chirurgiens phlébotomistes trouvent que dans la saignée du pié, lorsque les vaisseaux sont petits, on parvient plus facilement à les faire gonfler en mettant la ligature au-dessous du genou sur le gras de la jambe. Cette ligature n'empêcheroit pas qu'on n'en fît une seconde près du lieu où l'on doit piquer pour assujettir les vaisseaux roulans. Dans cette même circonstance, on se trouve très-bien dans les saignées du bras de mettre une seconde ligature au-dessous de l'endroit où l'on saignera.
Pour saigner la veine jugulaire, on met vers les clavicules sur la veine qu'on doit ouvrir une compresse épaisse : on fait ensuite avec une ligature ordinaire, mais étroite, deux circulaires autour du col, desorte qu'elle contienne la compresse : on la serre un peu & on la noue par la nuque par deux noeuds ; l'un simple & l'autre à rosette. On engage antérieurement, vis-à-vis de la trachée artere, un ruban ou une autre ligature dont les bouts seront tirés par une aide ou par le malade, s'il est en état de le faire. Par ce moyen la ligature circulaire ne comprime pas la trachée artere, & fait gonfler les veines jugulaires externes, & sur-tout celle sur laquelle est la compresse ; on applique le pouce de la main gauche sur cette compresse, & le doigt index au-dessus sur le vaisseau, afin de l'assujettir & de tendre la peau. On pique la veine jugulaire au-dessus de la ligature, à raison du cours du sang qui revient de la partie supérieure vers l'inférieure, à la différence des saignées du bras & du pié où l'on ouvre la veine au-dessous de la ligature, parce que le sang suit une direction opposée, & remonte en retournant des extrémités au centre.
L'académie royale de Chirurgie a donné son approbation à une machine qui lui a été présentée pour la saignée de la jugulaire. C'est une espece de carcan qui a du mouvement par une charniere qui répond à la nuque ; antérieurement les deux portions de cercle sont unies par une crémailliere, au moyen de laquelle on serre plus ou moins. La compression se fait déterminément sur l'une des veines jugulaires, par le moyen d'une petite pelote qu'on assujettit par le moyen d'un ruban sur la partie concave d'une des branches du collier. Voyez le second tome des Mém. de l'acad. de Chirurgie.
Le mot LIGATURE, ligatio, vinctura, se dit aussi d'une opération de Chirurgie, par laquelle on lie avec un ruban de fil ciré une artere ou une veine considérable, pour arrêter ou prévenir l'hémorrhagie. Voyez HEMORRHAGIE, ANEVRISME, AMPUTATION. On fait avec un fil ciré la ligature du cordon ombilical aux enfans nouveaux-nés. On se sert avec succès de la ligature pour faire tomber les tumeurs qui ont un pédicule, les excroissances sarcomateuses de la matrice & du vagin. Voyez POLYPE.
J'ai donné dans le second tome des mémoires de l'académie royale de Chirurgie, l'histoire des variations de la méthode de lier les vaisseaux après l'amputation ; les accidens qui pourroient résulter de la ligature des vaisseaux avoient été prévus par Gourmelen, antagoniste d'Antoine Paré. Il n'est pas possible, disoit-il, que des parties tendineuses, nerveuses & aponévrotiques, liées & étranglées par une ligature, n'excitent des inflammations, des convulsions, & ne causent promtement la mort. Cette imputation, quelque grave qu'elle soit, n'est que trop véritable ; mais Paré n'a pas encouru les reproches qu'on ne pouvoit faire à la méthode qu'il pratiquoit. Il ne se servoit pas d'aiguilles, du moins le plus communément ; ainsi il ne risquoit pas alors de lier & d'étrangler des parties nerveuses & tendineuses. Il saisissoit l'extrémité des vaisseaux avec de petites pinces, & quand il les avoit amenées hors des chairs, il en faisoit la ligature avec un fil double, de la même façon que nous lions le cordon ombilical. Si l'hémorrhagie survenoit, & qu'on ne pût se servir du bec de corbin, il avoit recours à l'aiguille : elle avoit quatre pouces de long, & voici comment il s'en servoit. Ayant bien considéré le trajet du vaisseau, il piquoit sur la peau, un pouce plus haut que la plaie, il enfonçoit l'aiguille à-travers les chairs, un demi-doigt à côté du vaisseau, & la faisoit sortir un peu plus bas que son orifice. Il repassoit sous le vaisseau par le dedans de la plaie, afin de le comprendre avec quelque peu de chairs dans l'anse du fil, & faisoit sortir l'aiguille à un travers de doigt de la premiere ponction faite sur les tégumens. Il mettoit entre ces deux points une compresse assez épaisse, sur laquelle il lioit les deux extrémités du fil, dont l'anse passoit dessous le vaisseau. Paré assure positivement que jamais on n'a manqué d'arrêter le sang, en suivant cette méthode. Guillemeau en a fait l'éloge, & a fait graver une figure qui représente la disposition des deux points d'aiguille. Dionis en fait mention : & de toutes les manieres de faire la ligature, c'étoit celle qu'il démontroit par préférence dans ses leçons au jardin royal : il la pratiquoit avec deux aiguilles. Les chirurgiens des armées faisoient la ligature sans percer la peau, comme nous l'avons décrite au mot amputation. M. Monro, célebre professeur d'Anatomie à Edimbourg, a écrit sur cette matiere, & conseille de ne prendre que fort peu de chairs avec le vaisseau. Il assure que les accidens ne viennent que pour avoir compris dans le fil qui servit à faire la ligature, plus de parties qu'il ne falloit ; & qu'il n'y a aucune crainte quand on se sert de fils applatis & rangés en forme de rubans, que la ligature coupe le vaisseau. Des chirurgiens modernes prescrivent dans les traités d'opérations qu'ils ont donnés au public, de prendre beaucoup de chair ; mais ce sont des opérations mal concertées.
Nous avons parlé au mot hémorragie de différens moyens d'arrêter le sang, & nous avons vu que la compression méthodique étoit préférable en beaucoup de cas à la ligature : l'artere intercostale a paru l'exiger nécessairement. M. Gerard, chirurgien de Paris distingué, si l'on en croit ses contemporains, par une dextérité singuliere, a imaginé le moyen de faire la ligature des arteres intercostales, lorsqu'elles seront ouvertes dans quelque endroit favorable. Après avoir reconnu ce lieu, on aggrandit la plaie ; on prend une aiguille courbe capable d'embrasser la côte, & enfilée d'un fil ciré, au milieu duquel on a noué un bourdonnet. On la porte dans la poitrine, à côté où l'artere est blessée, & du côté de son origine. On embrasse la côte avec l'aiguille, dont on fait sortir la pointe au-dessus de ladite côte, & on retire l'aiguille en achevant de lui faire décrire le demi-cercle de bas en haut. On tire le fil jusqu'à ce que le bourdonnet se trouve sur l'artere. On applique sur le côté qui est embrassé par le fil, une compresse un peu épaisse, sur laquelle on noue le fil, en le serrant suffisamment pour comprimer le vaisseau qui se trouve pris entre le bourdonnet & la côte.
M. Goulard, chirurgien de Montpellier, a imaginé depuis une aiguille particuliere pour cette opération : nous en avons donné la description au mot aiguille. Après l'avoir fait passer par-dessous la côte, & percer les muscles au-dessus, on dégage un des brins de fil ; on retire ensuite l'aiguille de la même maniere qu'on l'avoit fait entrer : on fait la ligature comme on vient de le dire. Cette aiguille grossit l'arsenal de la Chirurgie, sans enrichir l'art. L'usage des aiguilles a paru fort douloureux ; les plaies faites à la plevre & aux muscles intercostaux, sont capables d'attirer une inflammation dangereuse à cette membrane. La compression, si elle étoit praticable avec succès, meriteroit la préférence. M. Lottari, professeur d'Anatomie à Turin, a présenté à l'académie royale de Chirurgie un instrument pour arrêter le sang de l'artere intercostale : il est gravé dans le second tome des mémoires de cette compagnie. C'est une plaque d'acier poli, & coudée par une de ses extrémités pour former un point de compression sur l'ouverture de l'artere intercostale. On matelasse cet endroit avec une compresse : l'autre extrémité de la plaque est contenu par le bandage.
Une sagacité peu commune, jointe à des lumieres supérieures, a fait imaginer à M. Quesnay un moyen bien simple, par lequel en suppléant à la plaque de M. Lottari, il sauva la vie à un soldat qui perdoit son sang par une artere intercostale ouverte. Il prit un jetton d'ivoire, rendu plus étroit par deux sections paralleles ; il fit percer deux trous à une de ses extrémités pour pouvoir passer un ruban : il lui fit un fourreau avec un petit morceau de linge. Le jetton ainsi garni fut introduit à plat jusque derriere la côte ; il poussa ensuite de la charpie entre le jetton & le linge dont il étoit recouvert, pour faire une pelote dans la poitrine. Les deux chefs du ruban servirent à appliquer le jetton, de façon à faire une compression sur l'orifice de l'artere.
M. Belloq a examiné dans un mémoire inséré dans le second tome de ceux de l'académie de Chirurgie, les avantages & les inconvéniens de ces différens moyens ; il les a cru moins parfaits qu'une machine en forme de tourniquet, très-compliquée, dont on voit la figure à la suite de la description qu'il en a donnée. (Y)
LIGATURE, (Thérapeutique) outre les usages ordinaires & chirurgicaux des ligatures pratiquées sur les vaisseaux sanguins, le cordon ombilical, &c. dans la vûe d'arrêter l'écoulement du sang, & celles qu'on pratique aussi sur certaines tumeurs ou excroissances, comme porreaux, loupes, pour les détacher ou faire tomber, voyez LIGATURE Chir. les fortes ligatures sont comptées encore parmi les moyens d'exciter de la douleur, & de remédier parlà à diverses maladies. On les emploie dans la même vûe & aux mêmes usages que les frictions & les ventouses seches, que l'application des corps froids ou des corps brûlans, & dans les longs évanouissemens, les affections soporeuses & les hémorrhagies. Voyez ces articles. (b)
LIGATURE, (Musique) Dans nos anciennes musiques étoit l'union de plusieurs notes passées diatoniquement sur une même syllabe. La figure de ces notes qui étoit quarrée, donnoit beaucoup de facilité à les lier ainsi ; ce qu'on ne sauroit faire aujourd'hui qu'au moyen du chapeau, à cause de la rondeur des notes. Voyez CHAPEAU, LIAISON.
La valeur des notes qui composoient la ligature, varioit beaucoup selon qu'elles montoient ou descendoient ; selon qu'elles étoient différemment liées ; selon qu'elles étoient à queue ou sans queue ; selon que ces queues étoient placées à droite ou à gauche, ascendantes ou descendantes : enfin, selon un nombre infini de regles si parfaitement ignorées aujourd'hui, qu'il n'y a peut-être pas un seul musicien dans tout le royaume de France qui entende cette partie, & qui soit en état de déchiffrer correctement des musiques de quelque antiquité.
A la traduction de quelques manuscrits de Musique du xiij. & du xiv. siecle, qu'on se propose de donner bientôt au public, on y joindra un sommaire des anciennes regles de la Musique, pour mettre chacun en état de la déchiffrer par soi-même ; c'est là qu'on trouvera suffisamment expliqué tout ce qui regarde les anciennes ligatures. (S)
LIGATURE, (Comm.) petites étoffes de peu de valeur, de 7/16 de large, & la piece de 30 aunes. Elles se fabriquent en Normandie & en Flandres. Les premieres sont de fil, de lin & de laine, & les secondes toutes de lin : elles sont à petits carreaux ou à grandes couleurs : on les emploie en meubles.
Il y a une autre étoffe de même nom qui est soie & fil, du reste tout-à-fait semblable à la premiere.
LIGATURE, (Comm.) noeud qui lie les masses de soie ou celles de fil de chevron. Il faut que la ligature soit petite. Si elle est grosse, elle sera fournie de soie ou de fil de moindre valeur que la masse, & il y aura du déchet.
LIGATURE, dans l'Imprimerie, peut si l'on veut s'entendre des lettres doubles, voyez LETTRES DOUBLES ; mais il appartient plus positivement aux caracteres grecs, dont quelques-uns liés ensemble donnent des syllabes & des mots entiers. Voyez démonstration de la casse greque, Pl. d'Imprimerie.
|
| LIGE | adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui lie plus étroitement que les autres.
Fief-lige est celui pour lequel le vassal s'oblige de servir son seigneur envers & contre tous. Vassal lige est celui qui possede un fief lige ; hommage lige est l'hommage dû pour un tel fief. Voyez FIEF-LIGE & HOMMAGE-LIGE. (A)
|
| LIGÉE | Ligea, (Géogr.) île imaginaire, forgée par Folin, qui dit qu'elle prit ce nom d'une des trois sirenes, dont le corps fut jetté dans cette île. Ligée est à la vérité le nom d'une sirene, mais il n'y a point d'île qui se nomme de la sorte ; aucune des îles sirenuses ne s'appelle ainsi. Enfin la sirene Ligée eut sa sépulture à Terine, qui est une ville en terre ferme. Voyez TERINE & SIRENUSES, îles. (D.J.)
|
| LIGENCE | S. f. (Gramm. Jurisprud.) qualité d'un fief qu'on tient nûement & sans moyen d'un seigneur dont on devient ainsi homme lige. La ligence est aussi le droit du vassal à l'égard de son seigneur, comme de faire la garde de son château en tems de guerre. Un fief de ligence est celui auquel cette prérogative est attachée.
|
| LIGNAGE | (Jurisprud.) signifie en général cognation, en matiere de succession aux propres, ou de retrait lignager : quand on parle de lignage, on entend ceux qui sont de la même ligne, c'est-à-dire d'un même ordre ou suite de personnes. Voyez LIGNE. (A)
|
| LIGNE | S. f. (Géométrie) quantité qui n'est étendue qu'en longueur, sans largeur ni profondeur.
Dans la nature, il n'y a point réellement de ligne sans largeur ni même sans profondeur ; mais c'est par abstraction qu'on considere en Géométrie les lignes comme n'ayant qu'une seule dimension, c'est-à-dire la longueur : sur quoi voyez l'article GEOMETRIE.
On regarde une ligne comme formée par l'écoulement ou le mouvement d'un point. Voyez POINT.
Il y a deux especes de lignes, les droites & les courbes. Voyez DROITE & COURBE.
Si le point A se meut vers B (Pl. géom. fig. 1), il décrit par ce mouvement une ligne, & s'il va vers B par le plus court chemin, cette ligne sera une droite. On doit donc définir la ligne droite la plus courte distance entre deux points. Si le point qui décrit la ligne, s'écarte de côté ou d'autre, & qu'il décrive par exemple, une des lignes A C B, A c B, il décrira ou une ligne courbe, comme A c B, ou bien deux ou plusieurs droites, comme A C B.
Les lignes droites sont toutes de même espece ; mais il y a des lignes courbes d'un nombre infini d'especes. Nous en pouvons concevoir autant qu'il y a de différens mouvemens composés, ou autant qu'on peut imaginer de différentes lois de rapports entre les ordonnés & les abscisses. Voyez COURBE.
Les lignes courbes se divisent ordinairement en géométriques & méchaniques.
Les lignes géométriques sont celles dont tous les points peuvent se trouver exactement & sûrement. Voyez GEOMETRIQUE & COURBE.
Les lignes méchaniques sont celles dont quelques points, ou tous les points se trouvent par tâtonnement, & d'une maniere approchée, mais non pas précisément. Voyez MECHANIQUE & COURBE.
C'est pourquoi Descartes & ceux qui suivent sa doctrine, définissent les lignes géométriques, celles qui peuvent être exprimées par une équation algébrique d'un degré déterminé : on donne aussi le nom de lieu à cette espece de lignes. Voyez LIEU.
Et ils définissent les lignes méchaniques, celles qui ne peuvent être exprimées par une équation finie, algébrique, & d'un degré déterminé.
D'autres pensent que les lignes que Descartes appelle méchaniques, bien qu'elles ne soient pas désignées par une équation finie, n'en sont cependant pas moins déterminées par leur équation différentielle, & qu'ainsi elles ne sont pas moins géométriques que les autres. Ils ont donc préféré d'appeller celles qui peuvent se réduire à une équation algébrique finie, & d'un degré déterminé, lignes algébriques, & celles qui ne le peuvent, lignes transcendantes. Voyez ALGEBRIQUES & TRANSCENDANTES. Au fond toutes ces dénominations sont indifférentes, pourvu qu'on s'explique & qu'on s'entende ; car il faut éviter ce qui seroit une pure question de nom.
Les lignes géométriques ou algébriques, se divisent en lignes du premier ordre, du second ordre, du troisieme ordre. Voyez COURBE.
Les lignes droites considérées par rapport à leurs positions respectives, sont paralleles, perpendiculaires ou obliques les unes aux autres. Voyez les articles PARALLELE, PERPENDICULAIRE, &c.
Le second livre d'Euclide traite principalement des lignes, de leur division ou multiplication.
LIGNE, en Géographie & Navigation ; lorsque l'on se sert de ce terme, sans aucune autre addition, il signifie l'équateur ou la ligne équinoxiale. Voyez EQUATEUR & EQUINOXIALE.
Cette ligne rapportée au ciel, est un cercle que le soleil décrit à peu près le 21 Mars & le 21 Septembre ; & sur la terre c'est un cercle fictif qui répond au cercle céleste, dont nous venons de parler, il divise la terre du nord au sud en deux parties égales, & il est également éloigné des deux poles, de façon que ceux qui vivent sous la ligne ont toûjours les deux poles dans leur horison. Voyez POLE.
Les latitudes commencent à se compter de la ligne. Voyez LATITUDE.
Les marins sont dans l'usage de baptiser les nouveaux matelots, & les passagers, la premiere fois qu'ils passent la ligne. Voyez BAPTEME de la ligne.
La ligne des absides, en Astronomie, est la ligne qui joint les absides ou le grand axe de l'orbite d'une planete. Voyez ABSIDE.
La ligne de foi est une ligne ou regle qui passe au milieu d'un astrolabe d'un demi-cercle d'arpenteur, ou d'un instrument semblable, & sur laquelle sont placées les pinnules ; on l'appelle autrement alidade. Voyez ALIDADE, &c.
Une ligne horisontale est une ligne parallele à l'horison. Voyez HORISON.
La ligne des noeuds, en Astronomie, est la ligne qui joint les deux noeuds d'une planete, ou la commune section du plan de son orbite, avec le plan de l'écliptique.
Ligne géométrale, en Perspective, c'est une ligne droite tirée d'une maniere quelconque sur le plan géométral.
Ligne de terre ou fondamentale, en Perspective, c'est une ligne droite dans laquelle le plan géométral & celui du tableau se rencontrent ; telle est la ligne N I (Pl. Persp. fig. 12.) formée par l'interjection du plan géométral L M, & du plan perspectif H L.
Ligne de front, en Perspective, c'est une ligne droite parallele à la ligne de terre.
Ligne verticale, en Perspective, c'est la commune section du plan vertical & de celui du tableau.
Ligne visuelle, en Perspective, c'est la ligne ou le rayon qu'on imagine passer par l'objet & aboutir à l'oeil.
Ligne de station, en Perspective, selon quelques auteurs, c'est la commune section du plan vertical & du plan géométral ; d'autres entendent par ce terme la hauteur perpendiculaire de l'oeil au-dessus du plan géométral ; d'autres une ligne tirée sur ce plan, & perpendiculaire à la ligne qui marque la hauteur de l'oeil.
Ligne objective, en Perspective, c'est une ligne tirée sur le plan géométral, & dont on cherche la représentation sur le tableau.
Ligne horisontale, en Gnomonique, est la commune section de l'horison & du plan du cadran. Voyez HORISONTAL & CADRAN.
Lignes horaires, ou lignes des heures, ce sont les intersections des cercles horaires de la sphere, avec le plan du cadran. Voyez HORAIRE, HEURE & CADRAN.
Ligne soustilaire, c'est la ligne sur laquelle le stile ou l'éguille d'un cadran est élevée, & c'est la representation d'un cercle horaire perpendiculaire au plan du cadran, ou la commune section du cercle avec le cadran. Voyez SOUSTILAIRE.
Ligne équinoxiale, en Gnomonique, c'est l'intersection du cercle équinoxial & du plan du cadran.
Ligne de direction, en Méchanique, c'est celle dans laquelle un corps se meut actuellement, ou se mouvroit s'il n'en étoit empêché. Voyez DIRECTION.
Ce terme s'emploie aussi pour marquer la ligne qui va du centre de gravité d'un corps pesant au centre de la terre, laquelle doit de plus passer par le point d'appui ou par le support du corps pesant, sans quoi ce corps tomberoit nécessairement.
Ligne de gravitation d'un corps pesant, c'est une ligne tirée de son centre de gravité au centre d'un autre vers lequel il pese ou gravite ; ou bien, c'est une ligne selon laquelle il tend en bas. Voyez GRAVITATION.
Les lignes du compas de proportion, sont les lignes des parties égales, la ligne des cordes, la ligne des sinus, la ligne des tangentes, la ligne des secantes, la ligne des polygones, la ligne des nombres, la ligne des heures, la ligne des latitudes, la ligne des méridiens, la ligne des métaux, la ligne des solides, la ligne des plans. Voyez-en la construction & l'usage au mot COMPAS DE PROPORTION.
Il faut pourtant observer que l'on ne trouve pas absolument toutes ces lignes sur le compas de proportion, qui est une des pieces de ce qu'on appelle en France étui de mathématiques ; mais elles sont toutes tracées sur l'instrument que les Anglois appellent secteur, & qui revient à notre compas de proportion. Chambers. (E)
LIGNE ou ÉCHELLE DE GUNTER, autrement appellée ligne des nombres, (Arith.) est une ligne ou regle divisée en plusieurs parties, & sur laquelle sont marqués certains chiffres, au moyen desquels on peut faire méchaniquement différentes opérations arithmétiques, &c.
Cette ligne ainsi nommée de Gunter son inventeur, n'est autre chose, selon Chambers, que les logarithmes transportés des tables sur une regle, pour produire à peu près, par le moyen d'un compas qu'on applique à la regle, les mêmes opérations que produisent les logarithmes eux-mêmes, par le moyen de l'arithmétique additive ou soustractive.
Chambers s'étend beaucoup sur les usages de cette ligne. Mais comme ces usages sont peu commodes & assez fautifs dans la pratique, nous n'en dirons rien de plus ici, & nous nous contenterons de renvoyer au mot COMPAS DE PROPORTION, où l'on trouvera des méthodes pour faire d'une maniere simple & abrégée, à peu près les mêmes opérations qui se pratiquent par le moyen de la ligne de Gunter. Voyez aussi LOGARITHME. Cette ligne, ou échelle de Gunter, appellée ainsi par Chambers, est vraisemblablement la même qu'on appelle autrement échelle angloise, ou échelle des logarithmes ; on en peut voir la description & les usages dans le Traité de navigation de M. Bouguer, p. 410-419. (O)
LIGNE de la plus vîte descente. Voyez BRACHYSTOCHRONE & CYCLOÏDE.
LIGNE de la section, dans la Perspective, est la ligne d'intersection du plan à projetter avec le plan du tableau.
LIGNE de la plus grande ou de la plus petite longitude d'une planete, dans l'ancienne Astronomie, est cette portion de la ligne des absides, qui s'étend depuis le centre du monde jusqu'à l'apogée ou périgée de la planete.
LIGNE de la moyenne longitude, est celle qui traverse le centre du monde, faisant des angles droits avec la ligne des absides, & qui y forme un nouveau diametre de l'excentrique ou déférent. Ses points extrêmes sont appellés longitude moyenne.
LIGNE de l'anomalie d'une planete, (Astron.) dans le système de Ptolémée, est une ligne droite tirée du centre de l'excentrique au centre de la planete. Cette dénomination n'a plus lieu, ainsi que les deux précédentes, dans la nouvelle Astronomie.
LIGNE du vrai lieu ou du lieu apparent d'une planete, (Astron.) est une ligne droite tirée du centre de la terre ou de l'oeil de l'observateur par la planete, & continuée jusqu'aux étoiles fixes. En effet, la ligne du vrai lieu & la ligne du lieu apparent sont différentes, & elles forment entr'elles un angle qu'on appelle parallaxe. Voyez LIEU & PARALLAXE. La lune est de toutes les planetes celle dont la ligne du vrai lieu differe le plus de la ligne de son lieu apparent. La ligne du vrai lieu des étoiles fixes est sensiblement la même que celle de leur lieu apparent, & les lignes du vrai lieu & du lieu apparent d'une planete sont d'autant plus proches de se confondre que la planete est plus éloignée de la terre. Voyez PARALLAXE.
LIGNE de l'apogée d'une planete, dans l'ancienne Astronomie, est une ligne droite tirée du centre du monde par le point de l'apogée jusqu'au zodiaque du premier mobile. Dans la nouvelle Astronomie il n'y a proprement de ligne d'apogée que pour la lune qui tourne autour de la terre, & cette ligne est celle qui passe par le point de l'apogée de la lune & par le centre de la terre.
LIGNE du mouvement moyen du soleil, (dans l'ancienne Astronomie) est une ligne droite tirée du centre du monde jusqu'au zodiaque du premier mobile, & parallele à une ligne droite tirée du centre de l'excentrique au centre du soleil. Cette derniere ligne s'appelle aussi
LIGNE du mouvement moyen du soleil dans l'excentrique, pour la distinguer de la ligne de son mouvement moyen dans le zodiaque du premier mobile. Ces dénominations ne sont plus en usage dans l'Astronomie moderne.
LIGNE du mouvement vrai du soleil, dans l'ancienne Astronomie, est une ligne tirée du centre du soleil par le centre du monde ou de la terre, & continuée jusqu'au zodiaque du premier mobile.
Dans la nouvelle Astronomie, c'est une ligne tirée par les centres de la terre & du soleil, le soleil étant regardé comme le centre du monde.
LIGNE synodique, (Astronomie) dans certaines théories de la lune, est le nom qu'on donne à une ligne droite qu'on suppose tirée par les centres de la terre & du soleil. On a apparemment appellé ainsi cette ligne, parce que le mois synodique lunaire commence ou est à son milieu, lorsque la lune se trouve dans cette ligne, prolongée ou non ; voyez MOIS SYNODIQUE. Cette ligne étant continuée au-travers des orbites, est appellée ligne des vraies syzygies. Mais la ligne droite qu'on imagine passer par le centre de la terre & le lieu moyen du soleil aux syzygies, est appellée ligne des moyennes syzygies. Voyez SYZYGIES.
LIGNE HELISPHERIQUE, en termes de Marine, signifie la ligne du rhumb de vent. Voyez RHUMB.
On l'appelle ainsi, parce qu'elle tourne autour du pole en forme d'hélice ou de spirale, & qu'elle s'en approche de plus en plus sans jamais y arriver. On l'appelle aussi plus ordinairement loxodromie. Voyez LOXODROMIE.
LIGNE D'EAU, (Hydraul.) c'est la cent quarante-quatrieme partie d'un pouce circulaire, parce qu'il ne s'agit pas dans la mesure des eaux de pouce quarré, elle se fait au pouce circulaire qui a plus de relation avec les tuyaux circulaires par où passent les eaux des fontaines.
Pour savoir ce que fournit une ligne d'eau en un certain tems. Voyez ECOULEMENT. (K)
LIGNE, (Hydraul.) la ligne courante est ordinairement divisée en 12 points, quoique quelques-uns ne la divisent qu'en 10 points ou parties.
On distingue la ligne en ligne droite, en circulaire, en curviligne ou courbe.
La droite est la plus courte de toutes ; la circulaire est celle qui borde un bassin ou toute figure ronde.
La courbe est une portion de cercle.
On dit une ligne quarrée, une ligne cube, en énonçant la valeur du pouce quarré qui contient 144 lignes quarrées, & du pouce cube qui contient 1728 lignes cubes.
On dit encore, en parlant de nivellement, une ligne de niveau, de pente, de mire.
Une ligne véritablement de niveau, parcourant le globe de la terre, est réputée courbe, à cause que tous les points de son étendue sont également éloignés du centre de la terre.
Une ligne de pente suit le penchant naturel du terrein.
Une ligne de mire est celle qui dirige le rayon visuel pour faire poser des jalons à la hauteur requise de la liqueur colorée des fioles de l'instrument. (K)
LIGNES PARALLELES, ou PLACES D'ARMES, (Art milit.) sont dans la guerre des sieges, des parties de tranchées qui entourent tout le front de l'attaque, & qui servent à contenir des soldats, pour soutenir & protéger l'avancement des approches.
La premiere fois que ces sortes de lignes ou places d'armes ont été pratiquées, fut au siege de Mastrick, fait en 1673, par le roi en personne. Elles sont de l'invention du maréchal de Vauban, qui s'en servit dans ce siege avec tant d'avantage, que cette importante place fut prise en treize jours de tranchée ouverte.
Depuis ce tems, elles ont toujours été employées dans les différens sieges que les François ont faits, mais avec plus ou moins d'exactitude. Le siege d'Ath fait en 1697, est celui où elles ont été exécutées avec le plus de précision ; & le peu de tems & de monde que ce siege coûta, en a démontré la bonté.
On construit ordinairement trois lignes paralleles ou places d'armes dans les sieges.
La figure de la premiere doit être circulaire, un peu applatie sur le milieu : elle doit aussi embrasser toutes les attaques, par son étendue qui sera fort grande, & déborder la seconde ligne de 25 à 30 toises de chaque bout. Quant à ses autres mesures, on peut lui donner depuis 12 jusqu'à 15 piés de large, sur 3 de profondeur ; remarquant que dans les endroits où l'on ne pourroit pas creuser 3 piés, à cause du roc ou du marais qui se peuvent rencontrer dans le terrein qu'elle doit occuper, il faudra l'élargir davantage, afin d'avoir les terres nécessaires à son parapet. Jusqu'à ce qu'elle soit achevée on n'y doit pas faire entrer les bataillons, mais seulement des détachemens, à mesure qu'elle se perfectionnera.
Les usages de cette ligne ou place d'armes, sont,
1°. De protéger les tranchées qui se poussent en avant jusqu'à la deuxieme.
2°. De flanquer & de dégager la tranchée.
3°. De garder les premieres batteries.
4°. De contenir tous les bataillons de la garde, sans en embarrasser la tranchée.
5°. De leur faire toujours front à la place, sur deux ou trois rangs de hauteur.
6°. De communiquer les attaques de l'un à l'autre, jusqu'à ce que la seconde ligne soit établie.
7°. Elle fait encore l'effet d'une excellente contrevallation contre la place, de qui elle resserre & contient la garnison.
La seconde ligne doit être parallele à la premiere, & figurée de même, mais avoir moins d'étendue de 25 à 30 toises de chaque bout, & plus avancée vers la place, de 120, 140 ou 145 toises. Ses largeur & profondeur doivent être égales à celles de la premiere ligne. Il faut faire des banquettes à l'une & à l'autre, & border leur sommet de rouleaux de fascines piquetées pour leur tenir lieu de sacs à terre, ou de paniers ; jusqu'à ce qu'elle soit achevée, on n'y fait entrer que des détachemens : pendant qu'on y travaille, la tranchée continue toujours son chemin, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la distance marquée pour la troisieme ligne ; desorte que la seconde n'est pas plutôt achevée, qu'on commence la troisieme, & avant même qu'elle le soit totalement ; pour lors on y fait entrer les bataillons de la premiere ligne, & on ne laisse dans celle-ci que la réserve qui est environ le tiers de la garde ; pendant tout cela le travail de la tranchée fait son chemin de l'une à l'autre, jusqu'à la troisieme.
Les propriétés de la seconde ligne sont les mêmes que celles de la premiere ; il n'y a point d'autre différence, si ce n'est qu'elle approche plus près de la place à 120, 140, ou 145 toises, un peu plus ou un peu moins, au-delà de la seconde ligne ; on établit la troisieme, plus courte & moins circulaire que les deux premieres, ce que l'on fait pour approcher du chemin couvert, autant que l'on peut, & éviter les enfilades qui sont là fort dangereuses.
Desorte que si la premiere ligne est à 300 toises des angles les plus près du chemin couvert, la seconde n'en est plus qu'à 160, & la troisieme à 15 ou 20 toises seulement ; ce qui suffit à l'aide des demi-places d'armes, pour soutenir toutes les tranchées que l'on pousse en avant, quand les batteries ont tellement pris l'ascendant sur les ouvrages de la place, que le feu est éteint ou si fort affoibli, qu'on peut impunément le mépriser.
Mais si la garnison est forte & entreprenante, & que les batteries à ricochets ne puissent être employées, il faut s'approcher jusqu'à la portée de la grenade, c'est-à-dire à 13 ou 14 toises près des angles saillans : comme les sorties sont bien plus dangereuses de près que de loin, il faut aussi plus perfectionner cette ligne que les deux autres, lui donner plus de largeur, & la mettre en état de faire un grand feu, & qu'on puisse passer par-dessus en poussant les sacs à terre, ou les rouleaux de fascines devant soi ; ce qui se fait en lui donnant un grand talud intérieur avec plusieurs banquettes depuis le pié jusqu'au haut du talud.
C'est sur le revers de cette derniere ligne, qu'il faut faire amas d'outils, de sacs à terre, picquets, gabions & fascines, fort-abondamment, pour fournir au logement du chemin couvert, & les ranger en tas séparés, près des débouchemens, avant que de rien entreprendre sur le chemin couvert ; sur quoi il y a une chose bien sérieuse à remarquer, c'est que comme les places de guerre sont presque toutes irrégulieres, & différemment situées, il s'en trouve sur les hauteurs où le ricochet ayant peu de prise, ne pourroit pas dominer avec assez d'avantage, soit parce que les angles des chemins couverts en sont trop élevés, & qu'on ne trouve pas de situation propre à placer ces batteries : telle est par exemple la tête de terra nova au château de Namur ; telle étoit celle du fort Saint-Pierre à Fribourg en Brisgaw : tel est encore le fort Saint-André de Salins, la citadelle de Perpignan, celle de Bayonne, celle de Montmidi, quelques têtes de Philipsbourg, & plusieurs autres de pareille nature.
Il y a encore celles où les situations qui pourroient convenir aux ricochets, sont ou des marais, ou des lieux coupés de rivieres qui empêchent l'emplacement des batteries, & celles enfin où les glacis élevés par leur situation, sont si roides qu'on ne peut plonger le chemin couvert, par les logemens élevés en cavaliers, qu'on peut faire vers le milieu du glacis. Lorsque cela se rencontrera, on pourra être obligé d'attaquer le chemin couvert de vive force ; en ce cas il faudra approcher la troisieme ligne à la portée de la grenade, comme il a été dit, ou bien en faire une quatrieme, afin, de n'avoir pas une longue marche à faire pour joindre l'ennemi, & toujours la faire large & spacieuse, afin qu'on y puisse manoeuvrer aisément, & qu'elle puisse contenir beaucoup de monde, & une grande quantité de matériaux sur ses revers.
Cette ligne achevée, on y fera entrer le gros de la garde, ou les gens commandés, & l'on placera la réserve dans la deuxieme ligne. La premiere ligne demeurera vuide, & ne servira plus que de couvert au petit parc, à l'hôpital de la tranchée, qu'on fait avancer jusqu'aux fascines de provision que la cavalerie décharge dans les commencemens le long de ses bords ; & quand il s'agit de troupes extraordinaires, de la garde ou des travailleurs, ce qui n'arrive que quand on veut attaquer le chemin couvert, ou quelques autres pieces considérables des dehors, on les y peut mettre en attendant qu'on les emploie.
Au surplus, si le travail de la premiere & seconde nuit de tranchée peut se poser à découvert, celui des deux premieres places d'armes pourra se poser de même, parce qu'on est assez loin de la place, pour que le feu n'en soit pas encore fort dangereux ; & ce n'est guere que depuis la deuxieme ligne qu'on commence à marcher à la sappe ; mais pour ne point perdre de tems, & pouvoir avancer de jour & de nuit, on peut employer la sappe à l'exécution de la deuxieme.
Outre les propriétés que la troisieme ligne a communes avec les deux premieres, elle a encore celle de contenir les soldats commandés qui doivent attaquer, & tous les matériaux necessaires sur ces revers.
C'est enfin là où on délibere & résoud l'attaque du chemin couvert, où l'on fait les dispositions, où l'on regle les troupes qui doivent attaquer, & d'où l'on part pour l'insulte du chemin couvert.
Il faut observer que c'est de la seconde ligne qu'on doit ouvrir une tranchée contre la demi-lune C, Pl. XV. de Fortification, fig. 2. qui se conduit comme les autres, c'est-à-dire à la sappe & le long de sa capitale prolongée ; & quand les trois têtes de tranchées seront parvenues à la distance demandée pour l'établissement de la troisieme ligne, on y pourra employer six sappes en même tems, savoir deux à chacune, qui prenant les unes à la droite & les autres à la gauche, se seront bientôt jointes ; & comme les parties plus voisines de la tranchée se perfectionnent les premieres, on y pourra faire entrer le détachement à mesure qu'elles s'avançent, & on les fortifiera plus ou moins, selon que les sorties seront plus ou moins à appréhender.
Les propriétés des trois lignes paralleles sont,
1°. De lier & de communiquer les attaques les unes aux autres, par tous les endroits où il est besoin.
2°. C'est sur leurs revers que se font tous les amas de matériaux.
3°. Elles dégagent les tranchées & les débarrassent des troupes, laissant le chemin libre aux allans & venans.
4°. C'est dans ces lignes que se rangent les détachemens commandés pour les attaques, & que se reglent toutes les dispositions quand on veut entreprendre quelque chose de considérable, soit de vive force ou autrement.
5°. Elles ont enfin pour propriété singuliere & très-estimable d'empêcher les sorties, ou du-moins de les rendre inutiles, & de mettre en état de ne point manquer le chemin couvert. Attaque des places par M. le maréchal de Vauban. Voyez ces différentes lignes, Pl. XV. de Fortification, fig. 2.
LIGNE MAGISTRALE, (Art milit.) c'est, dans la fortification, la principale ligne du plan : c'est elle qui se trace d'abord, & de laquelle on compte la largeur du parapet, du terre-plein, du rempart, du talud, &c.
LIGNES DE COMMUNICATION, (Art milit.) en terme de guerre, ou simplement LIGNES, sont des fossés de six ou sept piés de profondeur, & de douze de largeur, qu'on fait d'un ouvrage ou d'un fort à un autre, afin de pouvoir aller de l'un à l'autre sûrement, particulierement dans un siége. Voyez COMMUNICATION.
Les LIGNES DE COMMUNICATION sont encore les parties de l'enceinte d'une place de guerre qui a une citadelle, qui joignent la ville à la citadelle. Voyez CITADELLE.
LIGNE DE TROUPE, c'est une suite de bataillons & d'escadrons placés à côté les uns des autres sur la même ligne droite, & faisant face du même côté. Voyez ORDRE DE BATAILLE & ARMEE.
Parmi les lignes de troupes il y en a de pleines, & d'autres qui sont tant pleines que vuides. Les premieres sont celles qui n'ont point d'intervalle entre les bataillons & les escadrons, & les autres sont celles qui en ont. Voyez ARMEE.
Lorsque les troupes sont en ligne, on dit qu'elles sont en ordre de bataille ou simplement en bataille. Ainsi mettre des troupes en ligne, c'est les mettre en bataille.
LIGNE DE MOINDRE RESISTANCE, (Art milit.) c'est dans l'artillerie celle qui, partant du centre du fourneau ou de la chambre de la mine, va rencontrer perpendiculairement la superficie extérieure la plus prochaine. On l'appelle ligne de moindre résistance, parce que comme elle exprime la plus courte distance du fourneau à la partie extérieure des terres dans lesquelles il est placé, elle offre la moindre opposition à l'effort de la poudre, ce qui la détermine à agir selon cette ligne. Voyez MINE.
LIGNE DE DEFENSE, en terme de fortification, c'est une ligne que l'on imagine tirée de l'angle du flanc à l'angle flanqué du bastion opposé.
Il y a deux sortes de lignes de défense, savoir la rasante & la fichante.
La ligne de défense est rasante lorsqu'elle suit le prolongement de la face du bastion, comme la ligne C F, Planche premiere de fortification, fig. premiere ; elle est fichante lorsque ce même prolongement donne sur la courtine : alors la partie de la courtine comprise entre cette ligne & l'angle du flanc, se nomme second flanc. Voyez FEU DE COURTINE.
Le nom de ligne de défense rasante lui vient de ce que le soldat placé à l'angle du flanc, peut raser, avec la balle de son fusil, toute la longueur de la face du bastion opposé ; & le nom de fichante, de ce que la face du bastion donnant sur la courtine, le soldat de l'angle du flanc alignant son fusil sur la face du bastion opposé, sa balle entre dans le bastion, se trouvant ainsi tirée dans une direction qui concourt avec cette face.
La ligne de défense exprime la distance qu'il doit y avoir entre le flanc & la partie la plus éloignée du bastion qu'il doit défendre. C'est pourquoi il s'agit de déterminer, 1°. quelle est cette partie ; 2°. avec quelles armes on doit la défendre ; & 3°. quelle est la portée de ces armes, & par conséquent la longueur de la ligne de défense.
On regle la longueur de la ligne de défense par la distance du flanc aux parties du bastion opposé qui en sont les plus éloignées, & qui ne peuvent pas être défendues par ce bastion : ces parties sont de deux sortes ;
1°. Celles qui sont absolument les plus éloignées, comme la contrescarpe vis-à-vis la pointe du bastion : cette partie étant vûe de deux flancs, & vis-à-vis de l'angle flanqué où le passage du fossé ne se fait point pour l'ordinaire, il en résulte qu'elle n'est pas celle qui a le plus besoin de défense.
2°. Celles qui sont les plus nécessaires à défendre sont, par exemple, la moitié ou les deux tiers de la face du bastion, parce que c'est-là que l'ennemi attache le mineur & qu'il cherche à faire breche. Ainsi en prenant pour la longueur de la ligne de défense la distance de l'angle du flanc à la moitié ou aux deux tiers de la face du bastion opposé, & réglant cette distance sur la moyenne portée des armes avec lesquelles on veut défendre ou flanquer toutes les parties de l'enceinte de la place, il s'ensuit que le flanc défendra la partie la plus essentielle, c'est-à-dire l'endroit de la face du bastion où l'ennemi doit s'attacher pour faire breche, & qu'il défendra aussi la contrescarpe vis-à-vis l'angle flanqué, parce que la grande portée des armes en usage pourra parvenir jusqu'à cette contrescarpe, qui n'est pas fort éloignée de l'angle flanqué.
Pour la défense de toutes les parties de la fortification, on se sert du fusil & du canon. Ainsi la ligne de défense doit être de la longueur de la moyenne portée de celle de ces deux armes qu'on juge la plus avantageuse.
Il y a eu autrefois une grande diversité de sentiment à ce sujet entre les Ingénieurs ; les uns vouloient que la ligne de défense fût réglée sur la portée du canon, parce que par-là on éloignoit davantage les bastions les uns des autres, ce qui diminuoit la dépense de la fortification ; les autres prétendoient que cette ligne fût déterminée par la portée du mousquet (qui est à-peu-près la même que celle du fusil dont on se sert genéralement aujourd'hui à la place de mousquet). Ils alléguoient pour cela que les coups du canon sont fort incertains ; que lorsqu'il vient à être démonté, on ne peut le rétablir sans perdre bien du tems, ce qui rend le flanc inutile pendant cet intervalle. Cette question a été décidée en faveur de ces derniers, avec d'autant plus de raison, que la défense du fusil n'exclud point celle du canon, ce qui n'est point réciproque à l'égard du canon. D'ailleurs, comme le dit le chevalier de Ville, il faut, lorsque l'on fortifie une place, fermer les yeux & ouvrir la bourse. La ligne de défense étant ainsi fixée à la portée du fusil, il a fallu apprendre de l'expérience quelle est cette portée : on l'a trouvée de 120, 140, & même de 150 toises pour les fusils en usage dans les places. Il s'ensuit donc que sa longueur est déterminée depuis 120 jusqu'à 150 toises, mais non au-delà.
Il se trouve cependant quelques fronts de places où la ligne de défense est plus longue, mais ces fronts ne sont pas alors fort exposés ; ils se trouvent le long des rivieres ou vis-à-vis des endroits dont l'accès n'est pas facile. Dans ce cas la ligne de défense peut excéder sa longueur ordinaire sans inconvénient. D'ailleurs cette longueur se trouve encore raccourcie ou diminuée par la tenaille qui est vis-à-vis la courtine, & qui corrige une partie de ce qu'elle peut avoir de défectueux : je dis une partie, parce que la défense de la tenaille étant fort oblique, n'équivaut jamais à celle du flanc, qui est bien plus direct. Voyez DEFENSE.
Lorsqu'il se trouve des fronts de places où la ligne de défense excede la portée du fusil, on doit corriger cet inconvénient en construisant des flancs bas en espece de fausse braie vis-à-vis les flancs. (Q)
LIGNES, (Art milit.) c'est ainsi qu'on appelle, dans la fortification passagere & dans la guerre des siéges, des retranchemens fort étendus, dont l'objet est de fermer l'entrée d'un pays à l'ennemi, & de couvrir les troupes qui font un siege contre les attaques extérieures, & contre les entreprises des assiégés. Ces dernieres lignes sont appellées lignes de circonvallation & de contrevallation. Voyez CIRCONVALLATION & CONTREVALLATION.
Toutes les lignes sont formées d'un fossé & d'un parapet avec sa banquette : elles sont flanquées par des redans ou par des bastions ; elles ont aussi quelquefois des dehors & un avant-fossé : ces dehors sont ordinairement des demi-lunes & des redoutes.
Ces lignes de circonvallation & de contrevallation sont de la plus haute antiquité ; il n'en est pas de même de celles qui ont pour objet de couvrir un pays ou une province pour empêcher l'ennemi d'y pénétrer : l'usage selon M. de Feuquiere, ne s'en est introduit que sous le regne de Louis XIV. Ceux qui l'ont proposé ont cru pouvoir garantir par-là un pays des contributions, donner la facilité aux partis de faire des courses chez l'ennemi, & assurer la communication d'une place à une autre, sans qu'il soit besoin d'y employer des escortes. Le célebre auteur que nous venons de citer, trouve avec raison qu'il n'est point aisé de faire des lignes qui remplissent ces trois objets. " L'expérience, dit-il, ne nous a que trop convaincus que les lignes n'empêcheront point le pays de contribuer, puisqu'il ne faut, pour établir la contribution, qu'avoir trouvé une seule fois l'occasion de forcer cette ligne pendant le cours d'une guerre, pour que la contribution soit établie ; après quoi, quand même les troupes qui ont forcé les lignes auroient été obligées de se retirer promtement, la contribution se trouve avoir été demandée ; & dans un traité de paix, pour peu que le traité se fasse avec égalité, il faut tenir compte des sommes imposées, quoique non levées : ensorte qu'elles entrent en compensation avec celles qui au tems du traité se trouvent dûes par le pays ennemi. Ainsi les lignes ne sont d'aucune utilité pour garantir de la contribution.
La seconde raison, qui est celle d'établir des contributions dans le pays ennemi, n'est pas bonne, parce que ce ne sont pas les partis qui sortent des lignes qui l'établissent, mais ceux qui sortent des places ".
A l'égard des communications, si l'on considere ce que coûte la construction, l'entretien des lignes & la quantité de troupes qu'il faut pour les garder, on trouvera qu'il y a plus d'avantage à faire escorter les convois & à employer les troupes à la garde des places.
Les lignes faites pour la défense d'une longue étendue de pays, ont aussi beaucoup d'inconveniens : il faut une grande quantité de troupes pour les garder ; & comme l'ennemi peut les attaquer par telle partie qu'il juge à propos, il est difficile de réunir assez de force dans le même lieu pour lui resister. Si l'on se trouve d'ailleurs en état de sortir sur l'ennemi, on ne peut le faire qu'en défilant & avec une grande perte de tems.
Le seul cas où les lignes peuvent être d'une bonne défense, c'est lorsqu'elles ont peu d'étendue, & qu'elles ferment néanmoins l'entrée d'un grand pays à l'ennemi, qu'elles sont soutenues par des places ou par des especes de camps retranchés de distance en distance, de maniere qu'ils peuvent se secourir les uns & les autres, & qu'on puisse réunir ensemble assez de troupes pour battre l'ennemi qui auroit percé dans quelqu'étendue de la ligne. Ce n'est que par des postes particuliers fortifiés dans l'intérieur de la ligne, que l'on peut parvenir à la soutenir contre les attaques de l'ennemi : c'est aussi ce que l'on doit faire dans les lignes de circonvallation, si l'on veut se mettre en état d'en chasser l'ennemi lorsqu'il a pu y pénétrer. Les princes d'Orange ne manquoient pas, à l'imitation des anciens, de suivre cette méthode ; non-seulement leurs lignes étoient exactement fortifiées, mais les différens quartiers des troupes dans les lignes l'étoient également. Il en étoit alors à-peu-près de l'ennemi qui avoit pénétré dans la ligne, comme il en seroit d'un assiégeant qui, ayant forcé les troupes qui défendent la breche d'un ouvrage, y trouveroit des retranchemens qui contiendroient de nouvelles troupes contre lesquelles il faudroit soutenir une nouvelle attaque, & qui pourroient, en tombant vigoureusement sur lui, profiter du désordre des siennes pour les chasser entierement de l'ouvrage.
Si des lignes sont fort étendues, ce que l'on peut faire de mieux lorsque l'ennemi vient pour les attaquer, c'est de réunir les troupes ensemble, de leur faire occuper un poste avantageux vers le centre, où l'on puisse combattre avec quelque espérance de succès. Si l'on se trouve trop foible pour oser risquer le combat, l'on doit abandonner les lignes & se retirer en arriere dans les lieux les plus favorables à la défense d'un petit nombre contre un grand.
M. de Feuquiere, après avoir exposé le peu d'avantage qu'on avoit tiré des lignes construites de son tems, conclud de-là " que ces lignes ne peuvent trouver de considération que dans l'esprit d'un général borné qui ne sait pas se tenir près de son ennemi en sûreté par la situation & la bonté d'un poste qu'il se sera choisi pour contenir son ennemi sans être forcé de combattre malgré lui, & qui se croit toujours commis dès qu'il ne voit point de terre remuée entre son ennemi & lui ". Cet illustre auteur observe que M. le Prince & M. de Turenne n'ont jamais en besoin de lignes pour se soutenir pendant des campagnes entieres à portée des armées ennemies quelque supériorité que ces armées eussent sur les leurs ; qu'ils les ont empêché de pénétrer dans le pays, en se présentant toujours de près à leur ennemi, & cela par le choix seul des postes qu'ils ont su prendre. M. le maréchal de Créquy en a usé de même dans des campagnes difficiles contre M. le duc de Lorraine. M. le maréchal de Luxembourg, contre le sentiment duquel l'usage des lignes s'est établi en France, a toujours été persuadé que cet usage étoit pernicieux à un général qui sait la guerre ; & il n'a jamais voulu, quelque commodité qui pût en résulter, que son armée campât dans le dedans des lignes. (Q)
LIGNE BLANCHE, linea alba, (Anatomie) est une espece de bande qui est formée du concours des tendons des muscles obliques & du transverse, & qui partage l'abdomen en deux par le milieu. Voyez ABDOMEN.
Elle est appellée ligne, parce qu'elle est droite, & blanche, à cause de sa couleur.
La ligne blanche reçoit un rameau de nerf de l'intercostal dans chacune de ses digitations ou dentelures, qui sont visibles à l'oeil, sur-tout dans les personnes maigres.
On donne aussi ce nom à une espece de ligne qui se remarque le long de la partie moyenne & postérieure du pharynx. Voyez PHARYNX.
LIGNE de Marcation, (Hist. mod.) ou ligne de division, de partition, établie par les papes pour le partage des Indes entre les Portugais & les Espagnols ; l'invention de cette ligne fictice est trop plaisante pour ne la pas transcrire ici d'après l'auteur de l'Essai sur l'hist. générale.
Les Portugais dans le xv. siecle demanderent aux papes la possession de tout ce qu'ils découvriroient dans leurs navigations ; la coutume subsistoit de demander des royaumes au saint siege, depuis que Grégoire VII. s'étoit mis en possession de les donner. On croyoit par-là s'assurer contre une usurpation étrangere, & intéresser la religion à ces nouveaux établissemens. Plusieurs pontifes confirmerent donc au Portugal les droits qu'il avoit acquis, & qu'un pontife ne pouvoit lui ôter.
Lorsque les Espagnols commencerent à s'établir dans l'Amérique, le pape Alexandre VI, en 1493, divisa les deux nouveaux mondes, l'américain & l'asiatique, en deux parties. Tout ce qui étoit à l'orient des îles Açores, devoit appartenir au Portugal ; tout ce qui étoit à l'occident, fut donné par le saint siege à l'éspagne. On traça une ligne sur le globe qui marqua les limites de ces droits réciproques, & qu'on appella la ligne de marcation, ou la ligne alexandrine ; mais le voyage de Magellan dérangea cette ligne. Les îles Marianes, les Philippines, les Molucques, se trouvoient à l'orient des découvertes portugaises. Il falut donc tracer une autre ligne, qu'on nomme la ligne de démarcation ; il n'en coûtoit rien à la cour de Rome de marquer & de démarquer.
Toutes ces lignes furent encore dérangées, lorsque les Portugais aborderent au Brésil. Elles ne furent pas plus respectées par les Hollandois qui débarquerent aux Indes orientales, par les François & par les Anglois qui s'établirent ensuite dans l'Amérique septentrionale. Il est vrai qu'ils n'ont fait que glaner après les riches moissons des Espagnols ; mais enfin ils y ont eu des établissemens considérables, & ils en ont encore aujourd'hui.
Le funeste effet de toutes ces découvertes & de ces transplantations, a été que nos nations commerçantes se sont fait la guerre en Amérique & en Asie, toutes les fois qu'elles se la sont faites en Europe ; & elles ont réciproquement détruit leurs colonies naissantes. Les premiers voyages ont eu pour objet d'unir toutes les nations. Les derniers ont été entrepris pour nous détruire au bout du monde ; & si l'esprit qui regne dans les conseils des puissances maritimes continue, il n'est pas douteux qu'on doit parvenir au succès de ce projet, dont les peuples de l'Europe payeront la triste dépense. (D.J.)
LIGNE, (Jurisprud.) se prend pour un certain ordre, dans lequel des personnes se trouvent disposées de suite, relativement à la parenté ou affinité qui est entr'elles. On distingue plusieurs sortes de lignes.
LIGNE ASCENDANTE, est celle qui comprend les ascendans, soit en directe, comme le fils, le pere, l'ayeul, bisayeul, & toujours en remontant ; ou en collatérale, comme le neveu, l'oncle, le grand-oncle, &c.
LIGNE COLLATERALE, est celle qui comprend les parens, lesquels ne descendent pas les uns des autres, mais qui sont joints à latere, comme les freres & soeurs, les cousins & cousines, les oncles, neveux & nieces ; & la ligne collatérale est ascendante ou descendante. Voyez LIGNE ASCENDANTE, GNE DESCENDANTEANTE.
LIGNE DEFAILLANTE ou ETEINTE, est lorsqu'il ne se trouve plus de parens de la ligne dont procede un héritage.
Dans ce cas les coutumes de Bourbonnois, Anjou, Maine & Normandie, font succéder le seigneur à l'exclusion des parens d'une autre ligne. Mais la coutume de Paris, art. 30, & la plûpart des autres coutumes font succéder une ligne au défaut de l'autre par préférence au seigneur.
LIGNE DESCENDANTE, est celle où l'on considere les parens en descendant, comme en directe le pere, le fils, le petit-fils, &c. & en collatérale, l'oncle, le neveu, le petit-neveu, &c.
LIGNE DIRECTE, est celle qui comprend les parens ou alliés qui sont joints ensemble en droite ligne, & qui descendent les uns des autres, comme le trisayeul, le bisayeul, l'ayeul, le pere, le fils, le petit-fils, &c.
La ligne directe, est ascendante ou descendante ; c'est-à-dire, qu'on considere la ligne directe en remontant ou descendant ; en remontant, c'est le fils, le pere, l'ayeul ; en descendant, c'est tout le contraire, l'ayeul, le pere, le fils, &c.
LIGNE EGALE, c'est lorsque deux parens collatéraux sont éloignés chacun d'un même nombre de degrés de la souche commune. Voyez LIGNE INEGALE.
LIGNE ETEINTE, Voyez LIGNE DEFAILLANTE.
LIGNE FRANCHE, dans la coutume de Sens, art. 30, s'entend de la ligne de celui des conjoints qui étoit légitime.
LIGNE INEGALE, c'est lorsque des deux parens collatéraux l'un est plus éloigné que l'autre de la souche commune, comme l'oncle & le neveu, le cousin-germain & le cousin issu de germain.
LIGNE MATERNELLE, est le côté des parens maternels.
LIGNE PATERNELLE, est le côté des parens paternels.
LIGNE TRANSVERSALE, est la même chose que ligne collatérale.
LIGNE, (Marine), mettre en ligne. C'est la disposition d'une armée navale sur la même ligne le jour du combat. L'avant-garde, le corps de bataille & l'arriere-garde se mettent sur une seule ligne pour faire face à l'ennemi, & ne point s'embarrasser les uns les autres pour envoyer leurs bordées.
Lorsqu'il s'agit d'évolutions navales, on dit garder sa ligne, venir à sa ligne, marcher en ligne, &c.
Ligne, (Marine), vaisseau de ligne, se dit d'un vaisseau de guerre, assez fort pour se mettre en ligne un jour de combat.
Ligne du fort, (Mar.) en parlant d'un vaisseau, se dit de l'endroit où il est le plus gros.
Ligne de l'eau, (Mar.) c'est l'endroit du bordage jusqu'où l'eau monte, quand le bâtiment a sa charge & qu'il flotte.
Ligne, (Mar.) c'est un petit cordage. Les lignes, soit pour sonder ou pour plusieurs autres usages, sont ordinairement de trois cordons, & trois à quatre fils à chaque cordon.
Lignes d'amarrage, (Mar.) ce sont les cordes qui servent à lier & attacher le cable dans l'arganeau, & qui renforcent & assurent les hausieres & les manoeuvres.
Lignes ou équillettes, (Mar.) elles servent à lasser les bonnettes aux grandes voiles.
Lignes de sonde, (Mar.) Voyez SONDE.
LIGNE DE COMPTE, terme de commerce & de teneur de livres : il signifie quelquefois chaque article qui compose un registre ou un compte. On dit en ce sens, j'ai mis cette somme en ligne de compte, pour dire, j'en ai chargé mon registre, mon compte. Quelquefois on ne l'entend que de la derniere ligne de chaque article ; dans ce sens on dit tirer en ligne des sommes, c'est-à-dire, les mettre vis-à-vis de la derniere ligne de chaque article, dans les différens espaces marqués pour les livres, sols & deniers.
Tirer hors de ligne ou hors ligne : c'est mettre les sommes en marge des articles, devant & proche la derniere ligne. Voyez LIVRES & REGISTRES. Dict. de commerce.
LIGNES, (Musique) sont ces traits horisontaux & paralleles qui composent la portée, & sur lesquels, ou dans les espaces qui les séparent, on place les différentes notes selon leurs degrés. La portée du plein-chant n'est composée que de quatre lignes ; mais en musique, elle en a cinq stables & continuelles, outre les lignes accidentelles qu'on ajoute de tems-en-tems, au-dessus ou au-dessous de la portée, pour les notes qui passent son étendue. Voyez PORTEE. (S)
LIGNE à plomb, (Architect.) se dit en terme d'ouvrier, d'une ligne perpendiculaire, il l'appelle ainsi, parce qu'il la trace ordinairement par le moyen d'un plomb. Voyez PLOMB.
Les mâçons & limosins appellent lignes, une petite cordelette ou ficelle, dont ils se servent pour élever les murs droits, à plomb, & de même épaisseur dans leur longueur.
LIGNE, (être en) en fait d'escrime ; on est en ligne, lorsqu'on est diamétralement opposé à l'ennemi, & lorsque la pointe de votre épée est vis-à-vis son estomac.
Ainsi l'on dit vous êtes hors la ligne, votre épée est hors la ligne, pour faire sentir qu'on est déplacé.
LIGNE, en terme d'Imprimerie, est une rangée ou suite de caracteres, renfermée dans l'étendue que donne la justification prise avec le composteur : la page d'impression est composée d'un nombre de lignes qui doivent être bien justifiées, & les mots espacés également.
LIGNE de la done, en terme de Manege, est la ligne circulaire ou ovale que le cheval suit en travaillant autour d'un pilier ou d'un centre imaginaire.
LIGNE du banquet, (Maréch.) c'est celle que les éperonniers s'imaginent en forgeant un mors, pour déterminer la force ou la foiblesse qu'ils veulent donner à la branche, pour la rendre hardie ou flasque.
LIGNE, (Pêche), instrument de pêche, composé d'une forte baguette, d'un cordon & d'un hameçon qu'on amorce, pour prendre du poisson médiocre : cet hameçon est attaché au cordon, qui pend au bout de la baguette ; mais la matiere du cordon, son tissu & sa couleur, ne sont pas indifférentes.
Les cordons de fil valent moins que ceux de soie, & ceux-ci moins que ceux de crin de cheval ; les uns & les autres veulent être d'une seule matiere, c'est-à-dire, qu'il ne faut point mêler ensemble le fil & la soie, ou la soie & le crin.
Les crins de cheval doivent être ronds & tortillés, de même grosseur & grandeur, autant qu'il est possible ; on les trempe une heure dans l'eau après les avoir cordonnés, pour les empêcher de se froncer ; ensuite on les retord également, ce qui les renforce beaucoup, pourvû qu'on ne les serre point en les tordant.
Les meilleures couleurs dont on puisse teindre les cordons d'une ligne, sont le blanc ou le gris, pour pêcher dans les eaux claires, & le verd-d'oseille, pour pêcher dans les eaux bourbeuses ; mais le verd d'eau pâle seroit encore préférable.
Pour avoir cette derniere couleur, on fera bouillir dans une pinte d'eau d'alun, une poignée de fleurs de souci, dont on ôtera l'écume qui s'éleve dessus dans le bouillonnement ; ensuite on mettra dans la liqueur écumée, demi-livre de verd-de-gris en poudre, qu'on fera bouillir quelque tems. Enfin, on jettera un ou plusieurs cordons de ligne dans cette liqueur, & on les y laissera tremper dix ou douze heures, ils prendront un verd d'eau bleuâtre qui ne se déteindra point. (D.J.)
LIGNE, (Pêche de mer) ce sont des cordes, à l'extrémité desquelles sont ajustés des ains ou hameçons garnis d'appât qui attirent le poisson. Voyez HAMEÇON.
Les lignes consistent en une corde menue & forte, sur laquelle de distance en distance sont frappés des piles ou ficelles de huit piés de long qui portent l'ain à leur extrémité ; à un pié de distance de l'ain est fixé un petit morceau de liege, que le pêcheur nomme corsiron ou cochon. C'est le corsiron qui fait flotter l'ain. Toutes les cordes, tant grosses que petites, sont aussi garnies de liege, soit qu'il faille pêcher à la côte ou à la mer. Voyez LIBOURNE.
De la pêche à la ligne à pié sur les roches. Ceux qui font cette pêche, prennent une perche légere de dix à douze piés de long, au bout de laquelle est frappée une ligne un peu forte, longue d'environ une brasse & demie. A deux piés environ de l'ain est frappé un plomb, pour faire caler bas l'hameçon garni d'appâts différens, selon les saisons. Le pêcheur se plante debout sur la pointe de la roche. Il y place sa perche, de maniere que cette pointe fasse fonction de point d'appui, & sa perche de levier, & qu'il puisse la lever promtement, lorsqu'il arrive que le poisson mord à l'appât. Il ne faut pas que le vent pousse trop à la cale. Le tems favorable ce sont les mois d'Octobre & de Novembre. On prend ainsi des congres, des merlus, des colins & des urats ou carpes de mer, tous poissons de roche.
Des lignes au doigt, ou qu'on tient à la main, pour mieux sentir que le poisson a pris l'appât : elles ne different des autres qu'en ce qu'elles n'ont que deux ains ; & elles ont, comme le libourne, un plomb qui les fait caler.
Les pêcheurs & riverains de Plough ou Molin, dans le ressort de l'amirauté de Vannes, se servent de lignes différemment montées, & ont leur manoeuvre. Ils sont deux à trois hommes au plus d'équipage dans leurs petits bateaux, qu'ils nomment fortans Chaque pêcheur a une ligne de dix à douze brasses de long au plus. Le bout qui joint la pile ou l'avancart, est garni de plommées à environ deux brasses de long, pour faire jouer la ligne sur le fond avec plus de facilité. L'hameçon est garni de chair de poisson, ou d'un morceau de leur peau, pris sur le dos, & coupé en long en forme de sardine. Le pêcheur qui est debout dans le fortan, traîne & agite continuellement sa ligne qu'il tient à la main. Le bateau est à la voile. L'appât est entraîné avec rapidité ; & le poisson qui le suit, le gobe d'autant plus avidement.
Plus il fait de vent, plus les pêcheurs chargent le bas de leur ligne de plommée, afin que la traîne en soit moins précipitée. On ne pêche de cette maniere que les poissons blancs, comme bart, loubines, mulets, rougets, morues, maquereaux, &c.
De la pêche du maquereau à la ligne, à la perche, à la mer & au large des côtes. Il y a a saint Jacut onze petits bateaux pêcheurs du port au plus de cinq ou six tonneaux, montés ordinairement de huit, neuf, à dix hommes d'équipage, qui font en mer la pêche avec les folles, les demi-folles, ou roussetieres, les cordes grosses & moyennes, & la pêche de la ligne au doigt pour le maquereau, & de la ligne à la perche. Leurs bateaux ont deux mâts ; chaque mât une voile. Ils s'éloignent quelquefois en mer de dix, douze à quinze lieues. Quand ils sont au lieu de la pêche, chacun prend sa ligne qui a sept à huit piés de long, & pêche les uns à bas bord, les autres à stribord. Le bateau a amené ses deux voiles, & dérive à la marée.
Cette pêche du maquereau dure environ cinq à six semaines. Elle commence à la saint Jean, & finit au commencement d'Août. Chaque équipage prend par jour favorable jusqu'à cinq à six mille maquereaux. Les uns se servent de la perche, d'autres de la ligne au doigt ; mais le plomb de celle-ci n'est environ que d'une demi-once.
Comme la manoeuvre de cette seconde maniere est moins embarrassante que celle à la perche, les pêcheurs quittent de jour en jour leur perche pour se servir de la ligne au doigt.
Ces pêcheurs affarent ou bortent le maquereau avec des sauterelles ou puces de mer, que leurs femmes, filles, veuves & enfans pêchent de marée à autre, pour en fournir les équipages des bateaux. Ils substituent à cet appât de petits morceaux de maquereaux qu'ils levent vers la queue.
|
| LIGNEUL | S. m. (Cordonnier, Bourrelier, &c.) c'est du fil de chanvre jaune, plié en plusieurs doubles & frotté de poix, dont on se sert pour coudre le cuir, & qu'on emploie aux usages les plus grossiers.
|
| LIGNEUX | adj. (Bot.) c'est par cette épithete qu'on désigne la partie solide & intérieure des plantes & des arbres. On dit une fibre ligneuse. Si le corps ligneux est coupé horisontalement, on y apperçoit des cercles concentriques de différentes épaisseurs. Ligneux se dit aussi de ce qui tient à la nature du bois, comme de la coque de noix, des racines de certaines plantes.
|
| LIGNITE | S. f. (Hist. nat.) nom donné par un auteur italien, nommé Ludovico Doleo, à une pierre qu'il dit avoir comme des veines de bois & la transparence du verre.
|
| LIGNITZ | Lignicium, (Géograph.) ville forte de Bohème, dans la Silésie, capitale d'une principauté de même nom. On a prétendu qu'elle avoit été fondée par les Lygiens ; mais ce peuple n'avoit point de villes, & d'ailleurs nous ne savons pas assez précisément quel pays il occupoit. Ceux qui croient que Lignitz est l'Hegetmatia de Ptolémée, ne sont pas mieux fondés, puisque du tems de ce géographe la Germanie au-delà du Rhin étoit aussi sans villes ; les urnes & autres monumens que l'on a découverts aux environs de Lignitz, ne prouvent point une origine romaine ; les Sarmates & les Slaves brûloient leurs morts, de même que les Romains ; & de plus, on trouve ces sortes d'antiquités dans toute la Silésie. Enfin Lignitz n'étoit qu'un village quand Boleslas, surnommé le Haut, l'entoura de murs, & en fit une ville. Elle est sur le ruisseau de Cat à 2 milles N. de Jawer, à 7 N. O. de Breslaw, & autant S. de Glogaw. Long. 33. 50. lat. 51. 55.
Un gentilhomme, né à Lignitz, Gaspard de Schwencfeld, fit beaucoup de bruit dans le xvj. siecle, par ses erreurs & son fanatisme. Il finit ses jours à Ulm en 1561, âgé de 71 ans. Mais les persécutions continuelles qu'il essuya pendant sa vie, lui procurerent, après sa mort, un grand nombre de sectateurs ; alors tous ses ouvrages dispersés furent recueillis avec soin, & réimprimés ensemble en 1592, en quatre volumes in-4 °. Il y soutient que l'administration des sacremens est inutile au salut ; que la manducation du corps & du sang de Jesus-Christ se fait par la foi ; qu'il ne faut baptiser personne avant sa conversion ; qu'il suffit de se confesser à notre Sauveur ; que celui-là seul est un vrai chrétien qui est illuminé ; que la parole de Dieu est Jesus-Christ en nous ; cette derniere proposition est un non-sense, diroient les Anglois, & je crois qu'ils auroient raison. (D.J.)
LIGNITZ, terre de, (Hist. nat. Mat. médicale) terre bolaire jaune, très fine, qui se trouve près de la ville de Lignitz en Silésie, elle est d'une couleur très-vive ; sa surface est unie ; elle ne fait point effervescence avec les acides ; calcinée, elle devient brune & non rouge. On en fait usage dans la Médecine.
|
| LIGNON | (Géog.) riviere de France dans le haut Forez ; elle a sa source aux confins de l'Auvergne, au-dessus de Thiers, & se jette dans la Loire, proche de Feurs : mais elle tire son plus grand lustre de ce que M. d'Urfé a choisi ses bords pour y mettre la scene des bergers de son Astrée, ce qui a fait dire à M. de Fontenelle :
O rives du Lignon ! ô plaines du Forez !
Lieux consacrés aux amours les plus tendres !
Montbrison, Marcilly, noms toujours pleins d'attrais !
Que n'êtes-vous peuplés d'Hylas & de Sylvandres ?
(D.J.)
|
| LIGNY | (Géog.) en latin moderne Lincium, Liniacum ou Ligniacum, ville de France avec titre de comté dans le duché de Bar, dont elle est la plus considérable après la capitale. Longuerue vous en donnera toute l'histoire. Ligny est sur l'Orney, à trois lieues S. E. de Bar-le-duc, huit O. de Toul, cinquante-deux S. E. de Paris. Long. 23. 2. lat. 48. 26. (D.J.)
|
| LIGOR | (Géog.) ville d'Asie, capitale d'un petit pays de même nom, sur la côte orientale de la presqu'île de Malaca, avec un port difficile d'entrée & un magasin de la compagnie hollandoise. Elle appartient, ainsi que le pays, au roi de Siam. Long. 118. 30. lat. 7. 40. (D.J.)
|
| LIGUE | (Gramm.) union ou confédération entre des princes ou des particuliers pour attaquer ou pour se défendre mutuellement.
LIGUE, la, (Hist. de France) on nomme ainsi par excellence toutes les confédérations qui se formerent dans les troubles du royaume contre Henri III. & contre Henri IV. depuis 1576 jusqu'en 1593.
On appella ces factions la sainte union ou la sainte ligue ; les zélés catholiques en furent les instrumens, les nouveaux religieux les trompettes, & les lorrains les conducteurs. La mollesse d'Henri III. lui laissa prendre l'accroissement, & la reine mere y donna la main ; le pape & le roi d'Espagne la soutinrent de toute leur autorité ; ce dernier à cause de la liaison des calvinistes de France avec les confédérés des pays-bas ; l'autre par la crainte qu'il eut de ces mêmes huguenots, qui, s'ils devenoient les plus forts, auroient bientôt sappé sa puissance. Abrégeons tous ces faits que j'ai recueillis par la lecture de plus de trente historiens.
Depuis le massacre de la saint Barthélemi, le royaume étoit tombé dans une affreuse confusion, à laquelle Henri III. mit le comble à son retour de Pologne. La nation fut accablée d'édits bursaux, les campagnes désolées par la soldatesque, les villes par la rapacité des financiers, l'Eglise par la simonie & le scandale.
Cet excès d'opprobre enhardit le duc Henri de Guise à former la ligue projettée par son oncle le cardinal de Lorraine, & à s'élever sur les ruines d'un état si mal-gouverné. Il étoit devenu le chef de la maison de Lorraine en France, ayant le crédit en main, & vivant dans un tems où tout respiroit les factions ; Henri de Guise étoit fait pour elle. Il avoit, dit-on, toutes les qualités de son pere avec une ambition plus adroite, plus artificieuse & plus effrénée, telle enfin qu'après avoir causé mille maux au royaume, il tomba dans le précipice.
On lui donne la plus belle figure du monde, une éloquence insinuante, qui dans le particulier triomphoit de tous les coeurs ; une libéralité qui alloit jusqu'à la profusion, un train magnifique, une politesse infinie, & un air de dignité dans toutes ses actions ; fin & prudent dans les conseils, promt dans l'exécution, secret ou plutôt dissimulé sous l'apparence de la franchise ; du reste accoutumé à souffrir également le froid & le chaud, la faim & la soif, dormant peu, travaillant sans cesse, & si habile à manier les affaires, que les plus importantes ne sembloient être pour lui qu'un badinage. La France, dit Balzac, étoit folle de cet homme-là ; car c'est trop peu de dire amoureuse ; une telle passion alloit bien près de l'idolâtrie. Un courtisan de ce regne prétendoit que les huguenots étoient de la ligue quand ils regardoient le duc de Guise. C'est de son pere & de lui que la maréchale de Retz disoit, qu'auprès d'eux tous les autres princes paroissoient peuple.
On vantoit aussi la générosité de son coeur ; mais il n'en donna pas un exemple, quand il investit lui-même la maison de l'amiral Coligny, & qu'attendant dans la cour l'exécution de l'assassinat de ce grand homme, qu'il fit commettre par son valet (Besme), il cria qu'on jettât le cadavre par les fenêtres, pour s'en assurer & le voir à ses piés : tel étoit le duc de Guise, à qui la soif de régner applanit tous les chemins du crime.
Il commença par proposer la ligue dans Paris, fit courir chez les bourgeois, qu'il avoit déja gagnés par ses largesses, des papiers qui contenoient un projet d'association, pour défendre la religion, le roi & la liberté de l'état, c'est-à-dire pour opprimer à la fois le roi & l'état, par les armes de la religion ; la ligue fut ensuite signée solemnellement à Péronne, & dans presque toute la Picardie, par les menées & le credit de d'Humieres gouverneur de la province. Il ne fut pas difficile d'engager la Champagne & la Bourgogne dans cette association, les Guises y étoient absolus. La Tremouille y porta le Poitou, & bientôt après toutes les autres provinces y entrerent.
Le roi craignant que les états ne nommassent le duc de Guise à la tête du parti qui vouloit lui ravir la liberté, crut faire un coup d'état, en signant lui-même la ligue, de peur qu'elle ne l'écrasât. Il devint, de roi, chef de cabale, & de pere commun, ennemi de ses propres sujets. Il ignoroit que les princes doivent veiller sur les ligues, & n'y jamais entrer. Les rois sont la planéte centrale qui entraîne tous les globes dans son tourbillon : ceux ci ont un mouvement particulier, mais toujours lent & subordonné à la marche uniforme & rapide du premier mobile. En vain, dans la suite, Henri III. voulut arrêter les progrès de cette ligue : il ne sut pas y travailler ni l'éteindre ; elle éclata contre lui, & fut cause de sa perte.
Comme le premier dessein de la ligue étoit la ruine des calvinistes, on ne manqua pas d'en communiquer avec dom Juan d'Autriche, qui, allant prendre possession des Pays Bas, se rendit déguisé à Paris, pour en concerter avec le duc de Guise : on se conduisit de même avec le légat du pape. En conséquence la guerre se renouvella contre les protestans ; mais le roi s'étant embarqué trop légérement dans ces nouvelles hostilités, fit bien-tôt la paix, & créa l'ordre du S. Esprit, comptant, par le serment auquel s'engageoient les nouveaux chevaliers, d'avoir un moyen sûr pour s'opposer aux desseins de la ligue. Cependant dans le même tems, il se rendit odieux & méprisable, par son genre de vie efféminée, par ses confrairies, par ses pénitences, & par ses profusions pour ses favoris, qui l'engagerent à établir sans nécessité des édits bursaux, & à les faire vérifier par son parlement.
Les peuples voyant que du trône & du sanctuaire de la Justice, il ne sortoit plus que des édits d'oppression, perdirent peu à peu le respect & l'affection qu'ils portoient au prince & au parlement. Les chefs de la ligue ne manquerent pas de s'en prévaloir, & en recueillant ces édits onéreux, d'attiser le mépris & l'aversion du peuple.
Henri III. ne regnoit plus : ses mignons disposoient insolemment & souverainement des finances, pendant que la ligue catholique & les confédérés protestans se faisoient la guerre malgré lui dans les provinces ; les maladies contagieuses & la famine se joignoient à tant de fléaux. C'est dans ces momens de calamités, que, pour opposer des favoris au duc de Guise, il dépensa quatre millions aux nôces du duc de Joyeuse. De nouveaux impôts qu'il mit à ce sujet, changerent les marques d'affection en haine & en indignation publique.
Dans ces conjonctures, le duc d'Anjou son frere, vint dans les Pays-Bas, chercher au milieu d'une désolation non moins funeste, une principauté qu'il perdit par une tirannique imprudence, que sa mort suivit de près.
Cette mort rendant le roi de Navarre le plus proche héritier de la couronne, parce qu'on regardoit comme une chose certaine, qu'Henri III. n'auroit point d'enfans, servit de prétexte au duc de Guise, pour se déclarer chef de la ligue, en faisant craindre aux François d'avoir pour roi un prince séparé de l'Eglise. En même tems, le pape fulmina contre le roi de Navarre & le prince de Condé, cette fameuse bulle dans laquelle il les appelle génération bâtarde & détestable de la maison de Bourbon ; il les déclare en conséquence déchus de tout droit & de toute succession. La ligue profitant de cette bulle, força le roi à poursuivre son beau-frere qui vouloit le secourir, & à seconder le duc de Guise qui vouloit le détrôner.
Ce duc, de son côté, persuada au vieux cardinal de Bourbon, oncle du roi de Navarre, que la couronne le regardoit, afin de se donner le tems, à l'abri de ce nom, d'agir pour lui-même. Le vieux cardinal, charmé de se croire l'héritier présomptif de la couronne, vint à aimer le duc de Guise comme son soutien, à haïr le roi de Navarre son neveu, comme son rival, & à lever l'étendart de la ligue contre l'autorité royale, sans ménagement, sans crainte & sans mesure.
Il fit plus ; il prit en 1585, dans un manifeste public, le titre de premier prince du sang, & recommandoit aux François de maintenir la couronne dans la branche catholique. La manifeste étoit appuyé des noms de plusieurs princes, & entr'autres, de ceux du roi d'Espagne & du pape à la tête : Henri III. au lieu d'opposer la force à cette insulte, fit son apologie ; & les ligueurs s'emparerent de quelques villes du royaume, entr'autres, de Tours & de Verdun.
C'est cette même année 1585, que se fit l'établissement des seize, espece de ligue particuliere pour Paris seulement, composée de gens vendus au duc de Guise, & ennemis jurés de la royauté. Leur audace alla si loin, que le lieutenant du prevôt de l'île de France révéla au roi l'entreprise qu'ils avoient formée de lui ôter la couronne & la liberté. Henri III. se contenta de menaces, qui porterent les seize à presser le duc de Guise de revenir à Paris. Le roi écrivit deux lettres au duc, pour lui défendre d'y venir.
M. de Voltaire rapporte à ce sujet une anecdote fort curieuse ; il nous apprend qu'Henri III. ordonna qu'on dépêchât ses deux lettres par deux couriers, & que, comme on ne trouva point d'argent dans l'épargne pour cette dépense nécessaire, on mit les lettres à la poste ; desorte que le duc de Guise se rendit à Paris, ayant pour excuse, qu'il n'avoit point reçû d'ordre contraire.
De-là suivit la journée des barricades, trop connue pour en faire le récit ; c'est assez de dire que le duc de Guise, se piquant de générosité, rendit les armes aux gardes du roi qui suivant le conseil de sa mere, ou plutôt de sa frayeur, se sauva en grand desordre & à toute bride à Chartres. Le duc, maître de la capitale, négocia avec Catherine de Médicis un traité de paix qui fut tout à l'avantage de la ligue, & à la honte de la royauté.
A peine le roi l'eut conclu, qu'il s'apperçut, quand il n'en fut plus tems, de l'abîme que la reine mere lui avoit creusé, & de l'autorité souveraine des Guises, dont l'audace portée au comble, demandoit quelque coup d'éclat. Ayant donc médité son plan, dans un accès de bile noire à laquelle il étoit sujet en hiver, il convoqua les états de Blois, & là, il fit assassiner le 23 & le 24 Décembre le duc de Guise, & le cardinal son frere.
Les lois, dit très-bien le poëte immortel de l'histoire de la ligue, les lois sont une chose si respectable & si sainte, que si Henri III. en avoit seulement conservé l'apparence, & qu'ayant dans ses mains le duc & le cardinal, il eût mis quelque formalité de justice dans leur mort, sa gloire, & peut-être sa vie eussent été sauvées ; mais l'assassinat d'un héros & d'un prêtre le rendirent exécrable aux yeux de tous les catholiques, sans le rendre plus redoutable.
Il commit une seconde faute, en ne courant pas dans l'instant à Paris avec ses troupes. Les ligueurs, ameutés par son absence, & irrités de la mort du duc & du cardinal de Guise, continuerent leurs excès. La Sorbonne s'enhardit à donner un decret qui délioit les sujets du serment de fidélité qu'ils doivent au roi, & le pape l'excommunia. A tous ces attentats, ce prince n'opposa que de la cire & du parchemin.
Cependant le duc de Mayenne en particulier se voyoit chargé à regret de venger la mort de son frere qu'il n'aimoit pas, & qu'il avoit autrefois appellé en duel. Il sentoit d'ailleurs que tôt ou tard le parti des Ligueurs seroit accablé ; mais sa position & son honneur emporterent la balance. Il vint à Paris, & s'y fit déclarer lieutenant général de la couronne de France, par le conseil de l'union : ce conseil de l'union se trouvoit alors composé de 70 personnes.
L'exemple de la capitale entraîna le reste du royaume ; Henri III. réduit à l'extrémité, prit le parti, par l'avis de M. de Schomberg, d'appeller à son aide le roi de Navarre qu'il avoit tant persécuté ; celui-ci, dont l'ame étoit si belle & si grande, vole à son secours, l'embrasse, & décide qu'il falloit se rendre à force ouverte dans la capitale.
Déja les deux rois s'avançoient vers Paris, avec leurs armées réunies, fortes de plus de trente mille hommes ; déja le siége de cette ville étoit ordonné, & sa prise immanquable, quand Henri III. fut assassiné, le premier Août 1589, par le frere Jacques Clement, dominicain : ce prêtre fanatique fut encouragé à ce parricide par son prieur Bourgoin, & par l'esprit de la ligue.
Quelques Historiens ajoutent, que Madame de Montpensier eut grande part à cette horrible action, moins peut-être par vengeance du sang de son frere, que par un ancien ressentiment que cette dame conservoit dans le coeur, de certains discours libres tenus autrefois par le roi sur son compte, & qui découvroient quelques défauts secrets qu'elle avoit : outrage, dit Mézerai, bien plus impardonnable à l'égard des femmes, que celui qu'on fait à leur honneur.
Personne n'ignore qu'on mit sur les autels de Paris le portrait du parricide ; qu'on tira le canon à Rome, à la nouvelle du succès de son crime ; enfin, qu'on prononça dans cette capitale du monde catholique l'éloge du moine assassin.
Henri IV (car il faut maintenant l'appeller ainsi avec M. de Voltaire, puisque ce nom si célebre & si cher est devenu un nom propre) Henri IV. dis-je, changea la face de la ligue. Tout le monde sait comment ce prince, le pere & le vainqueur de son peuple, vint à bout de la détruire. Je me contenterai seulement de remarquer, que le cardinal de Bourbon, dit Charles X. oncle d'Henri IV. mourut dans sa prison le 9 Mai 1590 ; que le cardinal Cajetan légat à latere, & Mendoze ambassadeur d'Espagne, s'accorderent pour faire tomber la couronne à l'infante d'Espagne, tandis que le duc de Lorraine la vouloit pour lui-même, & que le duc de Mayenne ne songeoit qu'à prolonger son autorité. Sixte V. mourut dégouté de la ligue. Grégoire XIV. publia sans succès, des lettres monitoriales contre Henri IV. en vain le jeune cardinal de Bourbon neveu du dernier mort, tenta de former quelque faction en sa faveur ; en vain le duc de Parme voulut soutenir celle d'Espagne, les armes à la main ; Henri IV. fut partout victorieux ; par-tout il battit les troupes des ligueurs, à Arques, à Ivry, à Fontaine françoise, comme à Coutras. Enfin, reconnu roi, il soumit par ses bienfaits, le royaume à son obéissance : son abjuration porta le dernier coup à cette ligue monstrueuse, qui fait l'événement le plus étrange de toute l'histoire de France.
Aucuns regnes n'ont fourni tant d'anecdotes, tant de piéces fugitives, tant de mémoires, tant de livres, tant de chansons satyriques, tant d'estampes, en un mot, tant de choses singulieres, que les regnes d'Henri III. & d'Henri IV. Et, en admirant le regne de ce dernier monarque, nous ne sommes pas moins avides d'être instruits des faits arrivés sous son prédécesseur, que si nous avions à vivre dans des tems si malheureux. (D.J.)
LIGUE, (Géog.) nom commun aux trois parties qui composent le pays des Grisons ; l'une se nomme la ligue grise ou haute, l'autre la ligue de la Cadée, & la troisieme la ligue des dix jurisdictions, ou des dix droitures. Voyez GRISONS.
La ligue grise, ou la ligue haute, en allemand, graw-bunds, en latin, foedus superius, ou foedus canum, est la plus considérable des trois, & a communiqué son nom à tout le pays. C'est ici que se trouvent les trois sources du Rhin. Cette ligue est partagée en huit grandes communautés, qui contiennent vingt-deux jurisdictions. Les habitans de la ligue grise parlent, les uns allemand, les autres italien, & d'autres un certain jargon qu'ils appellent roman : ce jargon est un mélange d'italien ou de latin, & de la langue des anciens Lépontiens.
La ligue de la Cadée, ou maison de Dieu, en allemand, gotts hansf-bundt, est partagée en onze grandes communautés, qui se subdivisent en vingt-une jurisdictions. Dans les affaires générales qui se nomment autrement dietes, cette ligue a vingtquatre voix. Voyez CADEE.
La ligue des dix jurisdictions, ou dix droitures, tire son nom des dix jurisdictions qui la forment, sous sept communautés générales : tous les habitans de cette derniere ligue, à un ou deux villages près, parlent allemand. (D.J.)
|
| LIGUGEY | (Géogr.) en latin Locociacum, Locogeiacum, & dans ces derniers tems Ligugiacum. C'est le Lieudiacum qui est le premier monastere des Gaules, dont l'histoire ait parlé. S. Martin, par goût pour la solitude, l'établit à trois lieues de Poitiers, avant son épiscopat, c'est-à-dire avant l'an 371. Devenu évêque, il fonda celui de Marmoutier à environ une lieue de Tours, dans un endroit desert. Ces deux monasteres, alors composés de cellules de bois, furent ruinés avec le tems : celui de Ligugey est devenu, par je ne sai quelle cascade, un prieuré appartenant aux Jésuites ; mais celui de Marmoutier forme une abbaye célebre dans l'ordre de S. Benoît, qui produit aux moines dix-huit mille livres de rente annuelle, & seize mille livres à l'abbé. On nomma par excellence ce dernier monastere, à cause du nombre des pasteurs qu'il a donnés à l'Eglise, Majus monasterium, d'où l'on a fait en notre langue Marmoutier. Les bâtimens en sont aujourd'hui magnifiques, & à cet égard il mérite encore le nom qu'il porte. (D.J.)
|
| LIGUIDONIS | LIGUIDONIS
|
| LIGURI | (LA) Liguria, (Géogr. anc.) ancienne province de la Gaule cispadane, sur la mer de Ligurie. On a compris quelquefois dans cette province divers peuples des Alpes, qui venoient pour la plupart des Liguriens.
Les habitans de la Ligurie tiroient leur origine des Celtes : les Grecs les appelloient Ligus, Lygies, & quelquefois Ligustini ; les Romains les nommoient Ligures. Ptolémée vous indiquera les villes de la Ligurie.
Selon le P. Briet, Antiq. ital. part. II. liv. V. la Ligurie comprenoit ce que nous appellons aujourd'hui le marquisat de Saluces, partie du Piémont, la plus grande partie du Montferrat, toute la côte de Gènes, la seigneurie de Mourgues, autrement Monaco, partie du comté de Nice, & la partie du duché de Milan qui est au-deçà du Pô.
Selon le même géographe, les Liguriens étoient divisés en Liguriens chevelus, Ligures capillati, & en Liguriens montagnards, Ligures montani. Les Liguriens chevelus occupoient les côtes de la mer, & les Liguriens montagnards habitoient l'Apennin & les Alpes.
Les Liguriens passoient pour des hommes vigoureux, adonnés au travail, vivant de lait, de fromage, & usant, dit Strabon, d'une boisson faite avec de l'orge. Ils supportoient constamment la fatigue & la peine, assuetum malo Ligurem. Virgile néanmoins les dépeint comme des gens faux & fourbes. Claudien infinue la même chose, & Servius les traite de menteurs.
|
| LIGURIENS | Ligurini, (Géog. anc.) habitans de la Ligurie. Les peuples qui habitoient la vraie Ligurie, ayant envoyé des colonies en Italie, y introduisirent leur nom, en s'y établissant eux mêmes. Le mot ligus en grec signifie un amateur de la poésie & de la musique. Les Grecs ont souvent impose aux nations d'Europe, d'Asie & d'Afrique, des noms sous lesquels nous les reconnoissons encore aujourd'hui, parce qu'ils les ont tirés de quelque qualité morale ou corporelle qui leur étoit particuliere. On sait combien les Bardes ont été chers à la Provence & au Dauphiné ; & personne n'ignore qu'on voit encore peu de peuples en Europe, qui aiment tant la danse, les vers & les chansons.
|
| LIGUSTICUM, MARE | (Géogr. anc.) on nommoit ainsi le golfe de Lyon dans sa partie orientale, depuis l'Arne riviere de Toscane, jusqu'à Marseille ; mais Niger appelle mer Ligustique cette étendue de mer qui va depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la Sicile.
|
| LIGYRIENS | Ligyrii, (Géog. anc.) peuples anciens de la Thrace ; ils avoient un lieu saint consacré à Bacchus, qui rendoit des oracles, au rapport de Macrobe, saturn. lib. I. ch. xviij. (D.J.)
|
| LILAC | S. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir, partagée pour l'ordinaire en quatre parties. Il sort du calice un pistil attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur ; ce pistil devient dans la suite un fruit applati en forme de langue, qui se partage en deux parties, & qui est divisé par une cloison en deux loges remplies de semences applaties & bordées. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LILAC, (Hist. natur.) petit arbre qui nous est venu de l'Asie, & que l'on cultive en Europe pour l'agrément. Il fait une tige assez droite, prend peu de grosseur, se garnit de beaucoup de branches, & ne s'éleve au plus qu'à vingt piés. Il fait quantité de petites racines fibreuses qui s'entremêlent & s'étendent peu. Sa feuille est grande, faite en coeur, d'un verd tendre & luisant ; elle paroît de très-bonne heure au printems. Sur la fin d'Avril, ses fleurs annoncent le retour de la belle saison ; elles viennent en grosses grappes au bout des branches de l'année précédente, & il y a toujours deux grappes ensemble. Leur couleur varie selon les especes : il y a des lilacs à fleur de couleur gris de lin fort tendre ; d'autres à fleur plus foncée tirant sur le pourpre, & d'autres à fleur blanche. Toutes ces fleurs ont de la beauté & une odeur délicieuse ; elles sont remplacées par des petites gousses de la forme d'un fer de pique, qui deviennent rouges au tems de leur maturité ; elles contiennent des semences menues, oblongues, applaties, aîlées, & d'une couleur rousse. Cet arbre est très-robuste, il croît promtement, & donne bientôt des fleurs. Il se plaît à toutes les expositions, réussit dans tous les terreins, se multiplie plus que l'on ne veut, & n'exige aucune culture.
On pourroit élever le lilac de semence ou de branches couchées ; mais la voie la plus courte & la seule usitée, c'est de le multiplier par les rejettons qui viennent en quantité sur ses racines : le mois d'Octobre est le vrai tems de les transplanter, parce que les boutons de cet arbre, qui sont en séve dès le mois de Décembre, grossissent pendant l'hiver & s'ouvrent de bonne heure au printems. Plus les lilacs sont gros, mieux ils reprennent, & ils donnent d'autant plus de fleurs qu'ils se trouveront dans un terrein sec & léger, mais ils s'éleveront beaucoup moins. On en voit souvent qui sont enracinés dans les murailles, & qui s'y soutiennent à merveille. Il ne faut d'autre soin à cet arbre que de supprimer les rejettons qui viennent tous les ans sur ses racines, & qui affoiblissent la principale tige. On doit aussi avoir attention de tailler cet arbre avec ménagement, on se priveroit des fleurs en accourcissant toutes ses branches. Son bois, quoique blanc, est dur, solide & compacte, cependant on n'en fait nul usage : on ne connoît non plus aucune utilité dans les autres parties de cet arbre : on le cultive uniquement pour l'agrément.
Les lilacs sont d'un grand ornement dans les bosquets ; on en fait même des massifs entiers, qui font au printems la plus agréable décoration dans un grand jardin.
Il y a des lilacs de deux especes différentes, & chaque espece a plusieurs variétés : on les divise en grands lilacs & en lilacs de Perse.
Grands lilacs. 1°. Le lilac ordinaire. Sa fleur est d'une couleur gris de lin tendre.
2°. Le lilac à fleur pourpre. Sa fleur est plus grosse & plus fournie que celle du précédent ; l'arbre en donne une plus grande quantité : c'est le plus beau de tous les lilacs & le moins commun.
3°. Le lilac à fleur blanche. Sa fleur n'est ni si grande ni si garnie que celles des précédens, mais elle semble être argentée.
4°. Le lilac à fleur blanche & à feuille panachée de jaune.
5°. Le lilac à fleur blanche & à feuille panachée de blanc.
Ces deux variétés ne sont pas d'une grande beauté, leur aspect présente plus de langueur que d'agrément. Ceux qui veulent tout rassembler dans une collection, pourront se les procurer en les faisant greffer en écusson ou en approche sur d'autres lilacs.
C'est principalement aux grands lilacs qu'on pourra appliquer ce qui a été dit ci-dessus.
Lilacs de Perse. 6°. Le lilac de Perse à feuille de troëne. Sa fleur est d'un rouge pâle.
7°. Le lilac de Perse à fleur blanche. Sa couleur n'est pas bien tranchée, c'est un rouge si pâle qu'il incline à la blancheur : cette variété est encore très-rare.
8°. Le lilac de Perse à feuille découpée ; c'est le plus beau des lilacs de Perse, par l'agrément de sa feuille qui est très-joliment découpée, & par la beauté de sa fleur qui est d'une vive couleur de pourpre fort apparente.
Ces lilacs sont des arbrisseaux qui ne s'élevent qu'à huit ou dix piés. Ils se garnissent de beaucoup de branches qui sont fort menues ; leur feuille est infiniment plus petite que celle des grands lilacs ; leur fleur est en plus petits bouquets, mais elle a plus d'odeur, & souvent les branches en sont garnies sur toute leur longueur. Elle paroit huit jours plus tard que celle des grands lilacs, & elle dure plus longtems. Il faut aux lilacs de Perse une bonne terre, meuble, franche, un peu humide. Ils donnent rarement des rejettons au pié ; il faut les multiplier de branches couchées que l'on fait au printems, elles auront au bout d'un an des racines suffisantes pour la transplantation, qui se doit faire pour le mieux en automne. Tous les lilacs peuvent se greffer les uns sur les autres, soit en écusson, soit en approche. Les lilacs de Perse peuvent contribuer à l'ornement d'un jardin ; on en fait des buissons dans les plates-bandes. On peut aussi leur faire prendre une tige & une tête réguliere, & on peut encore en former des palissades de dix piés de hauteur : c'est peut-être la forme qui leur convient le mieux ; & lorsque ces palissades ont pris trop d'épaisseur, il n'y a qu'à forcer la taille jusqu'auprès des principales branches, & bien-tôt la palissade se regarnira de jeunes rejettons : on peut même faire cette opération au mois de Juillet sans inconvénient. Article de M. D'AUBENTON.
LILAC, (Botan.) quoique le nom de lilac soit étranger, la plûpart de nos botanistes l'ont conservé ; quelques autres l'ont rendu mal-à-propos par syringa, qui est une plante d'un genre tout différent. Nos dames se sont contentées d'adoucir le nom arabe, d'écrire & de prononcer lilas, & elles l'ont emporté sur les Botanistes ; les Anglois l'appellent the pipe-trée.
La racine de cette plante est déliée, ligneuse, & rampante ; elle produit un arbrisseau qui parvient à la hauteur d'un arbre médiocre, & s'éleve à dixhuit ou vingt piés, & plus ; ses tiges sont menues, droites, rameuses, assez fermes, couvertes d'une écorce grise-verdâtre, remplies d'une moëlle blanche & fongueuse. Ses feuilles sont opposées l'une à l'autre, larges, pointues, lisses, molles, luisantes, vertes quelquefois, panachées de jaune ou de blanc, & attachées à de longues queues ; elles ont un goût un peu âcre & amer.
Ses fleurs sont petites, monopétales, ramassées en touffes, de couleur bleue, quelquefois d'un rouge bleu, d'autres fois d'un rouge-foncé, & d'autres fois blanches ou argentées, selon les especes de lilacs, mais toûjours d'une odeur douce & fort agréable.
Chacune de ces fleurs est en entonnoir, ou en tuyau évasé par le haut, & découpé en quatre ou cinq parties, garni de deux ou trois étamines courtes, à sommets jaunes. Le calice est d'une seule piece, tubuleux, court, & divisé en quatre segmens ; l'ovaire est placé au centre du calice qui est dentelé.
Quand les fleurs sont passées, il leur succede des fruits comprimés, oblongs, assez semblables à une langue, ou à un fer de pique. Ils prennent une couleur rouge en mûrissant, & se partagent en deux loges, qui contiennent des semences menues, oblongues, applaties, pointues par les deux bouts, bordées d'un feuillet membraneux & comme aîlé, de couleur rousse.
Le lilac nous est venu selon Mathiole de Constantinople, & selon d'autres de l'orient. Il fleurit au mois d'Avril, & n'a point d'usage médicinal. Mais comme la mode regne encore de le cultiver dans nos jardins, à cause de la beauté de ses fleurs, il nous faut dire un mot de sa culture.
LILAC, (Agriculture) rien n'est plus beau que le lilac, ou, pour parler comme tout le monde, le lilas en fleur, soit en buissons dans des plates-bandes de parterre, soit en allées, soit dans des quarrés de bosquets, sur-tout quand on les oppose, ou qu'on les entremêle avec goût. D'ailleurs, ils ont l'avantage d'être aisés à élever, de croître dans toutes sortes d'expositions & de terreins. Il est vrai qu'ils poussent plus vigoureusement dans des terres fortes & humides ; mais c'est dans les terres seches qu'ils donnent le plus de fleurs ; & c'est aussi le cas de la plûpart des plantes.
Les lilas bleus, blancs, & pourpre-foncé, montent d'ordinaire à la hauteur de vingt piés, & forment l'embellissement des allées & des bosquets, lorsque dans le printems, la nature ouvre son sein pour enchanter nos regards ; ici le lilas-blanc étendant ses branches, produit à leurs extrémités des panaches de fleurettes argentines, soutenues sur de courts pédicules. Là, le lilas bleu présente de longues grappes de charmantes fleurs, dont l'air est embaumé ; mais le lilas pourpre nous plaît encore davantage, & par le nombre des fleurs qu'il donne, & par les touffes qui en sont plus pressées, & par l'attrait de leurs belles couleurs ; le mêlange de l'opposition ingénieuse de ces trois lilas ne sert que mieux à relever le lustre de chacun en particulier.
On multiplie les lilas, en couchant au mois d'Octobre ses jeunes branches dans la terre, ou bien en détachant ses rejettons, & les plantant tout de suite dans une terre legere, où on les laisse trois ou quatre ans, avant que de les transplanter à demeure.
Les lilas à feuilles de troëne, que nous nommons noblement lilas de Perse, ne montent point en arbre, & ne forment que des arbrisseaux qui ne s'élevent guere au-dessus de six ou sept piés ; mais c'est par cela même qu'ils servent à décorer tous les lieux où sont placés les arbustes de leur taille. Ils donnent des bouquets plus longs, plus déliés que les autres lilas, & en même tems d'une odeur plus agréable.
Quoiqu'on puisse multiplier de rejettons les lilas de Perse, le meilleur est de les multiplier de marcottes ; on peut les planter dans les plates-bandes des parterres ; on peut les tailler en buisson ou en globe posé sur une tige, en s'y prenant de bonne heure. Enfin, on peut les élever en caisse, mais c'est une chose inutile ; car ils ne sont point délicats, toute terre & toute exposition leur sont presque indifférentes.
|
| LILÉE | (Géog. anc.) Lilaea, ville de Grece, dans la Phocide, du côté du mont Parnasse. Apollon & Diane avoient chacun un temple dans cette ville : comme elle étoit située auprès des sources de Céphise, la fable dit qu'elle tiroit son nom de la nayade Lilée, fille de ce fleuve.
|
| LILIBÉE | (Géog.) Lilibaeum, ville de Sicile, dans sa partie occidentale, près du cap de même nom, à l'opposition de l'embouchure du port de Carthage. Cette ville fut ensuite nommée Helvia Colonia ; elle étoit fort grande du tems des Romains, qui y avoient jusqu'à dix mille hommes de garnison, au rapport de Tite-Live, l. XXI. c. xlix.
Le siége qu'ils firent de cette ville, dont Polybe, l. I. c. x. nous a laissé une si belle description, est au jugement de Folard, le chef-d'oeuvre de l'intelligence & de la capacité militaire, tant pour l'attaque, que pour la défense. Lilybée ne tomba sous la puissance de Rome, qu'après une suite de victoires sur les Carthaginois ; c'est présentement Marsaglia. Le cap Lilybée, Lilibaeum promontorium, s'appelle de nos jours Capo-Bolo, ou Lilibaeo.
|
| LILINTGOW | (Géog.) en latin Lindum, ancienne ville d'Ecosse, dans la province de Lothiane, sur un lac très-poissonneux, à 4 lieues N. E. d'Edimbourg, 130 N. O. de Londres. Long. 14. 20. lat. 56. 18. (D.J.)
|
| LILITH | S. m. (Hist. anc.) les Juifs se servent de ce mot pour marquer un spectre de nuit qui enleve les enfans & les tue ; c'est pourquoi, comme l'a remarqué R. Léon de Modene, lorsqu'une femme est accouchée, on a coutume de mettre sur de petits billets, aux quatre coins de la chambre où la femme est en couche, ces mots, Adam & Eve : Lilith hors d'ici, avec le nom de trois anges ; & cela pour garantir l'enfant de tout sortilége. M. Simon, dans sa remarque sur ces paroles de Léon de Modene, observe que Lilith, selon les fables des Juifs, étoit la premiere femme d'Adam, laquelle refusant de se soumettre à la loi, le quitta & s'en alla dans l'air par un secret de magie. C'est cette Lilith que les Juifs superstitieux craignent comme un spectre, qui apparoît en forme de femme, & qui peut nuire à l'enfantement. Buxtorf, au chap. ij. de sa Synagogue, parle assez au long de cette Lilith, dont il rapporte cette histoire tirée d'un livre juif. Dieu ayant créé Adam, lui donna une femme qui fut appellée Lilith, laquelle refusa de lui obéir : après plusieurs contestations ne voulant point se soumettre, elle prononça le grand nom de Dieu Jehova, selon les mysteres secrets de la cabale, & par cet artifice elle s'envola dans l'air. Quelque instance que lui eussent fait plusieurs anges qui lui furent envoyés de la part de Dieu, elle ne voulut point retourner avec son mari. Cette histoire n'est qu'une fable ; & cependant les Juifs cabalistiques, qui sont les auteurs d'une infinité de contes ridicules, prétendent la tirer du premier chapitre de la Genèse, qu'ils expliquent à leur maniere. R. Léon de Modene, Cérem. part. IV. chap. viij.
|
| LILIUM | (Chimie & Mat. med.) ce remede qui est fort connu encore sous le nom de lilium de Paracelse, à qui on l'a attribué sur un fondement assez frivole, & sous celui de la teinture des métaux, est un de ceux que l'abbé Rousseau a célebrés dans son livre des secrets & remedes éprouvés. M. Baron nous avertit dans une dissertation très-étendue & très-profonde sur cette préparation, dissertation qui fait une de ses additions à la chimie de Lémery, qu'on doit bien se garder de croire que l'abbé Rousseau soit l'inventeur de ce remede, puisque, selon la remarque de M. Burlet, le premier qui ait rendu publique la description de la teinture des métaux, est l'auteur anonyme d'un livre intitulé Chimia rationalis, imprimé à Leyde en 1687. On s'est un peu écarté depuis ce tems du procédé de l'inventeur. Voici celui qui est décrit dans la Pharmacopée de Paris ; prenez des régules de cuivre, d'étain, & d'antimoine martial, de chacun quatre onces, (voyez sous le mot ANTIMOINE, regule martial, regule de vénus, regule jovial) mettez-les en poudre, mêlez-les exactement, & réduisez-les par la fusion en un seul regule selon l'art : mettez-le de nouveau en poudre, & mêlez-le avec du nitre très-pur & du tartre, l'un & l'autre en poudre, de chacun dix-huit onces, projettez ce mêlange dans un creuset, & le faites détonner, & ensuite faites-le fondre à un feu très-fort, versez la matiere dans un mortier pour l'y réduire en poudre dès qu'elle sera prise, & versez la encore toute chaude dans un matras ; versez dessus sur le champ suffisante quantité d'esprit-de-vin rectifié, digerez pendant quelques jours au bain de sable en agitant de tems en tems, & vous aurez une teinture profondément colorée.
Le lilium est fort communément employé dans la pratique de la Medecine comme un cordial très-actif, & même par quelques medecins, (ceux de Montpellier, par exemple) comme la derniere ressource pour soutenir un reste de vie prêt à s'éteindre. La teinture des métaux differe à peine quant à sa constitution intérieure ou chimique de la teinture du sel de tartre, & n'en differe point du tout quant à ses qualités medicinales ; ensorte que c'est par une erreur, ou du-moins une inexactitude, que nous devons relever ici, que le lilium est qualifié de préparation d'antimoine dans l'art. ANTIMOINE. Voyez ESPRIT-DE-VIN à l'art. VIN, SEL DE TARTRE à l'art. TARTRE, & TEINTURE.
On trouve encore parmi les secrets de l'abbé Rousseau, & dans la chimie de Lémery, une autre préparation chimique, sous le nom de lilium minéral, ou sel métallique. Cette préparation n'est autre chose qu'un alkali fixe, qui ayant été tenu dans une longue & forte fusion avec un regule composé de cuivre, d'étain, & de régule martial, qui se réduit en chaux dans cette opération, a été rendu très-caustique par l'action de ces chaux, desquelles on le sépare ensuite par la lotion. Toute cette opération n'est bonne à rien qu'à fournir la matiere de la teinture des métaux, supposé que la teinture des métaux soit elle-même une préparation fort recommandable. Car quant à son produit plus immédiat, le prétendu sel métallique, il n'est & ne doit être d'aucun usage en Medecine, ni intérieurement, parce qu'il est vraiment corrosif ; ni extérieurement, parce que la pierre à cautere avec laquelle il a beaucoup d'analogie, vaut mieux, & se prépare par une manoeuvre beaucoup plus simple. Voyez PIERRE A CAUTERE. (b)
|
| LILIUM LAPIDEUM | (Hist. nat.) Voyez LIS DE PIERRE.
|
| LILLE | (Géog.) grande, belle, riche & forte ville de France, capitale de la Flandre françoise, & d'une châtellenie considérable, avec une citadelle construite par le maréchal de Vauban, qui est la plus belle de l'Europe.
Lille a commencé par un château, qu'un des comtes de Flandres fit bâtir avant l'an 1054. Baudouin, comte de Flandres, en fit une ville, qu'il appelle Isla dans ses lettres, & nomme son territoire Islense territorium. Rigord dans les gestes du roi Auguste, ad ann. 1215, la nomme Insula. Guillaume le Breton lui donne aussi ce dernier nom dans le vers suivans.
Insula, villa placens, gens callida, lucra sequendo ;
Insula, quae nitidis se mercatoribus ornat,
Regna coloratis illuminat extera pannis.
Les François disent l'Isle, ou Lille, & les Allemands Ryssel. Elle a été appellée Insula, à cause de sa situation entre deux rivieres, la Lys & la Deule, qui l'environnent de toutes parts.
Louis XIV. s'est emparé de Lille par droit de conquête ; il l'enleva à l'Espagne en 1667. Les alliés la prirent en 1708, & la rendirent à la France par le traité d'Utrecht ; Longuerue, Corneille, Piganiol de la Force, Savary, & la Martiniere, vous instruiront de tous les détails qui concernent cette ville, ses manufactures, son commerce, son administration, sa châtellenie, &c.
Sa position est à 5 lieues N. O. de Tournai, 7 N. de Douai, 13 S. O. de Gand, 15 S. O. de Dunkerque, 15. N. O. de Mons, 52 N. E. de Paris. Long. selon Cassini, 20d. 36'. 30''. lat. 50. 38.
On sait peut-être qu'Antoinette Bourignon, cette célèbre visionnaire du siecle passé, naquit à Lille en 1616. Comme elle étoit riche, elle acheta sous le nom de son directeur l'île de Nordstrand, près de Holstein, pour y rassembler ceux qu'elle prétendoit associer à sa secte. Elle fit imprimer à ses frais dix-huit volumes in-8°. de pieuses rêveries, où il ne s'agit que d'inspirations immédiates, & dépensa la moitié de son bien à s'acquérir des prosélytes ; mais elle ne réussit qu'à se rendre ridicule, & à s'attirer des persécutions, attachées d'ordinaire à toute innovation. Enfin, desespérant de s'établir dans son île, elle la revendit aux Jansénistes, qui ne s'y établirent pas davantage. Elle mourut à Franeker en 1680.
Dominique Baudius, grand poëte latin, étoit aussi né à Lille ; mais il fut nommé professeur dans l'université de Leyden, où il donna plusieurs ouvrages estimés, & y mourut en 1613, à cinquante-deux ans. Le vin & les femmes ont été les deux écueils sur lesquels sa réputation fit naufrage. Ses lettres dont on fait tant de cas, procurent, ce me semble, plus de plaisir & d'utilité aux lecteurs, que d'honneur à la mémoire de l'auteur. Il est vrai qu'elles sont pleines d'esprit & de politesse, mais elles le sont aussi d'amour-propre, & l'auteur s'y montre en même tems trop gueux, trop intéressé, & trop importun à ses amis.
Matthias de Lobel, botaniste, compatriote de Baudius, eut une conduite plus sage que lui dans les pays étrangers. Il mourut à Londres en 1616, âgé de soixante-dix-neuf ans ; le meilleur ouvrage qu'il ait donné sont ses Adversaria, & la meilleure édition est d'Angleterre en 1655, in-4°.
La ville de Lille a encore produit, dans le dernier siecle, quelques artistes de mérite, comme Monnoyer, aimable peintre des fleurs, & les Vander-Méer, qui ont excellé à représenter le païsage, les vûes de marine, les moutons. (D.J.)
|
| LILLERS | (Géog.) Lilercum, petite ville de France en Artois, sur le Navez, à 7 lieues d'Arras, entre Aire & Béthune. Ses fortifications ont été démolies. Long. 20. 7. lat. 50. 35. (D.J.)
|
| LILLO | (Géog.) fort des Pays-bas Hollandois sur l'Escaut, à 3 lieues d'Anvers ; les habitans d'Anvers qui soutenoient le parti des confédérés, le bâtirent en 1583, pour se conserver la navigation de l'Escaut, & les Espagnols furent obligés d'en lever le siége en 1588. Long. 21. 47. lat. 51. 18. (D.J.)
|
| LIMA | (Géog.) ville de l'Amérique méridionale au Pérou, dont elle est la capitale, ainsi que la résidence du vice-roi, avec un archevêché érigé en 1546, & une espece d'université, dirigée par des moines, & fondée par Charles-Quint en 1545.
François Pizarre jetta les fondemens de Lima en 1534 ou 1535, & douze Espagnols sous ses ordres commencerent à s'y loger. Le nombre des habitans augmenta promtement ; on alligna les rues, on les fit larges, & on divisa la ville en quarrés, que les Espagnols appellent quadras.
Le roi d'Espagne y établit un vice-roi, avec un pouvoir absolu, mais dont le gouvernement ne dure que sept ans ; les autres charges se donnent, ou plutôt se vendent, pour un tems encore plus court, savoir pour cinq ans, pour trois ans. Cette politique, établie pour empêcher que les pourvûs ne forment des partis contre un prince éloigné d'eux, est la principale cause du mauvais gouvernement de la colonie, de toutes sortes de déprédations, & du peu de profit qu'elle procure au roi ; aucun des officiers ne se soucie du bien public.
Le pere Feuillée, M. Frezier, & les lettres édifiantes, vous instruiront en détails très-étendus, du gouvernement de Lima, de son audience royale, de son commerce, de ses tribunaux civils & ecclésiastiques, de son université, de ses églises, de ses hôpitaux, & de ses légions de moines, qui par leurs logemens, ont absorbé la plus belle & la plus grande partie de la ville ; ils vous parleront aussi de la quantité de couvens de filles, qui n'y sont guère moins nombreux ; enfin des moeurs dissolues qui regnent dans un pays, où la fertilité, l'abondance de toutes choses, la richesse & l'oisiveté, ne peuvent inspirer que l'amour & la mollesse.
On n'y éprouve jamais l'intempérie de l'air, les nuages y couvrent ordinairement le ciel, pour garantir ce beau climat des rayons que le soleil y darderoit perpendiculairement. Ces nuages ne font quelquefois que s'abaisser en brouillards, pour rafraîchir la surface de la terre, fertile en toutes fortes de fruits délicieux de l'Europe & des îles Antilles, oranges, citrons, figues, raisins, olives, ananas, goyaves, patates, bananes, sandies, melons, lucumos, chérimolas, & autres.
Les campagnes de la grande vallée de Lima offrent des prairies vertes toute l'année, ici tapissées de luzerne, là des fruits dont nous venons de parler : la belle riviere de Lima arrose cette vallée par une infinité de canaux pratiqués au milieu des plaines.
En un mot, Lima donneroit l'idée du séjour le plus riant, si tous ces avantages n'étoient pas troublés par de fréquens tremblemens de terre, qui doivent inquieter sans cesse ses habitans. Il y en eut un le 17 Juin 1678, qui ruina une grande partie de la ville. Celui de 1682 démolit presque entierement les édifices publics. Depuis la plûpart des maisons des particuliers y ont été faites généralement d'un seul étage, & seulement couvertes de roseaux, sur lesquels on répand de la cendre, pour empêcher que la rosée ne passe à-travers.
Enfin, le 28 Octobre 1746, on entendit à Lima, sur les dix heures & demie du soir, un bruit souterrain, qui précede toûjours en ce pays-là les tremblemens de terre, & dure assez long-tems pour qu'on puisse sortir des maisons. Les secousses vinrent ensuite, & furent si violentes, qu'en quatre à cinq minutes de tems, il n'est resté de toute cette capitale que vingt maisons sur pié. Soixante-quatorze églises ou couvens, le palais du vice-roi, l'audience royale, les hôpitaux, les tribunaux, & tous les édifices publics, qui étoient plus élevés & plus solidement bâtis que les autres, ont été ruinés de fond en comble.
Le Callao, ville fortifiée & port de Lima, à deux lieues de cette capitale, fut vraisemblablement renversé par les mêmes secousses ; dans le même tems où le tremblement se fit sentir, la mer s'éloigna du rivage à une grande distance ; elle revint ensuite avec tant de furie, qu'elle submergea treize des vaisseaux qu'elle avoit laissés à sec & sur le côté dans le port. Elle porta quatre autres vaisseaux fort avant dans les terres, où elle s'étendit à une de nos lieues, rasant entierement Callao & engloutissant tous ses habitans, au nombre d'environ cinq mille, & plusieurs de ceux de Lima qu'elle trouva sur le chemin.
Les oscillations que fit la mer jusqu'à-ce qu'elle eût repris son assiette naturelle, couvrirent les ruines de cette malheureuse ville de tant de sable, qu'il reste à peine quelque vestige de sa situation. On avoit trouvé déjà onze cens quarante-un corps ensevelis sous ses décombres au départ du premier vaisseau qui porta cette triste nouvelle en Europe ; j'ignore combien on en a déterré dans la suite.
Mais on a travaillé insensiblement à tirer des ruines de Lima la plus grande partie des effets précieux qui y ont été enfouis, & à rebâtir les édifices publics plus bas qu'ils n'étoient avant cet accident.
Cette ville a à l'orient les hautes montagnes des Andes, autrement appellées les Cordelieres ; elle est arrosée par la belle riviere qui descend de ces hautes montagnes, au sud est la grande vallée de Lima, dont nous avons parlé.
La position de cette ville sur la carte d'Amérique, publiée en 1700 par M. Halley, revient à 78 degrés, 40 minutes de longitude occidentale du méridien de Paris ; & suivant le pere Feuillée, la long. est 275d. 53'. 30''. lat. 12d. 3'. 16''. Selon Cassini la long. de cette ville est 299d. 1'. 0''. lat. 12. 1. 15. (D.J.)
LIMA, l'Audience de (Géog.) grande province du Pérou, dont Lima la capitale a succédé à Cusco. Cette province est bornée au nord par l'Audience de Quito, à l'orient par la Cordeliere des Andes, au midi par l'Audience de los Charcas, & à l'occident par la mer du sud. Les principales montagnes qu'on trouve dans cette Audience, sont la Sierra & les Andes. La riviere de Moyabamba prend sa source dans cette province, & après avoir été grossie des eaux de plusieurs autres rivieres, elle va se jetter dans celle des Amazones. (D.J.)
LIMA, la vallée de, (Géog.) appellée aussi avant Pizarre, la vallée de Rimac, du nom de l'idole qui y rendoit des oracles ; or soit par la corruption du mot, soit par la difficulté aux Espagnols de dire Rimac, ils ont prononcé Lima : cette vallée s'étend principalement à l'ouest de la ville de Lima jusqu'à Callao, & au sud jusqu'à la vallée de Pachacamac. La luzerne y vient en abondance, & sert à nourrir les bêtes de charge pendant toute l'année. (D.J.)
LIMA, la riviere de, (Géog.) belle riviere de l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'Audience & dans la vallée de Lima : elle descend de ces hautes montagnes de la Cordeliere des Andes, passe au nord de la ville de Lima, & le long de ses murailles ; elle arrose toute la vallée par un grand nombre de canaux qu'on a pratiqués, & va se jetter dans la mer, au nord de la ville de Callao, détruite par le tremblement de terre de 1746, où elle fournit de l'eau pour l'aiguade des vaisseaux. (D.J.)
|
| LIMACE | S. f. (Hist. nat. Zoolog.) limax, insecte dont on distingue plusieurs especes ; il y a des limaces noires, des grises tachetées ou non tachetées, des jaunes parsemées de taches blanches, & des rouges.
La limace rouge a quatre cornes comme le limaçon, mais plus petites, voyez LIMAÇON ; la tête est distinguée de la poitrine par une raie noirâtre comme la poitrine l'est du ventre. L'animal peut faire rentrer sa tête en entier dans le corps : la bouche est formée par deux lèvres ; on y voit une dent en forme de croissant, qui est à la mâchoire de dessus, & qui a quinze pointes. Selon Lister, la limace a le milieu du dos revêtu d'une espece de capuchon qui lui tient lieu de coquille, & sous lequel elle cache sa tête, son cou, & même son ventre dans le besoin, & un osselet large, & légérement convexe. Cet auteur dit avoir tiré par une légere incision faite au centre du capuchon, deux petites pierres de même figure & de même grandeur, la premiere au mois de Mars, & la seconde au mois d'Août. Les limaces sont hermaphrodites : dans l'accouplement la partie masculine se gonfle & sort par une large ouverture qui se trouve au côté droit du cou près des cornes. On voit quelquefois ces animaux suspendus en l'air la tête en bas, la queue de l'un contre celle de l'autre par le moyen d'une sorte de cordon formé de leur bave, & attaché à un tronc ou à une branche d'arbre. Leurs oeufs sont sphériques, blanchâtres, à peu près comme des grains de poivre blanc ; mais ils jaunissent un peu avant d'éclorre. Les limaces vivent d'herbe, de champignons, & même on peut les nourrir avec du papier mouillé ; elles restent à l'ombre dans les lieux humides. Hist. nat. des anim. par Mrs de Nobleville & Salerne, tom. I.
LIMACE, pierre de, (Hist. nat.) pierre ou os qui se trouve, dit-on, dans la tête des limaces sans coquilles qu'on rencontre dans les bois. On a prétendu qu'en la portant on pouvoit se guérir de la fievre quarte. M. Hellwig, médecin, dit qu'en Italie on avoit encore, de son tems, beaucoup de foi dans les vertus de cette pierre ou substance qui, selon lui, est produite par le suc épais & visqueux qui sort de la tête des limaces lorsqu'on y fait une ouverture, & qui se durcit assez promtement & prend de la consistance. Pline lui a attribué encore d'autres vertus qui paroissent assez apocryphes. Voyez Ephemerid. nat. curiosorum, decur. II. ann. VII. & Boëtius de Boot.
|
| LIMAÇON | S. m. (Hist. nat. Zoolog.) cochlea, animal testacée : il y en a un très-grand nombre d'especes, tant terrestres qu'aquatiques ; on leur donne aussi le nom de limas. Voyez COQUILLAGES & COQUILLES. Pour donner une idée des coquillages de ce genre, nous rapporterons seulement ici une courte description du limaçon commun des jardins, appellé vulgairement l'escargot. Cet animal est oblong ; il n'a ni piés ni os : on y distingue seulement la tête, le cou, le dos, le ventre, & une sorte de queue ; il est logé dans une coquille d'une seule piece, d'où il sort en grande partie, & où il rentre à son gré. La peau est lisse & luisante sous le ventre, ferme, sillonnée, & grainée sur le dos, plissée & étendue de chaque côté en forme de fraises, au moyen desquelles l'animal rampe comme un ver. La tête a une bouche & des levres, & quatre cornes, deux grandes placées plus haut que les deux autres, qui ont moins de longueur. Les grandes sont pyramidales & terminées par un petit bouton rempli d'une humeur jaunâtre, au milieu duquel on apperçoit un point noirâtre assez ressemblant à une prunelle ; les petites cornes ne different des grandes, qu'en ce qu'elles n'ont que le tiers de leur grosseur & de leur grandeur, & que l'on ne voit pas à leur extrémité un point noirâtre. On a prétendu que le bouton des grandes cornes étoit un oeil ; mais l'opinion la plus accréditée est que ces quatre cornes ne sont que des antennes que l'animal emploie pour sentir les obstacles qui se rencontrent dans son chemin ; la bouche est grande & garnie de dents. Les limaçons ont chacun les deux sexes ; ils sont hermaphrodites ; il y a au côté droit du cou un trou fort apparent, qui est en même tems le conduit de la respiration, la vulve & l'anus, & qui même a différentes cavités, & en particulier a des intestins tortueux qui flottent dans le ventre. Au tems de l'accouplement ces intestins se gonflent & se renversent, de façon qu'ils se présentent à l'ouverture de l'anus alors fort dilatée, sous la figure d'une partie masculine & d'une partie féminine. Il sort par la même ouverture du cou un aiguillon fait en forme de lance à quatre aîles terminée en pointe très-aiguë & assez dure, quoique friable. Lorsque deux limaçons se cherchent pour s'accoupler, ils tournent l'un vers l'autre la fente de leur cou, & dès qu'ils se touchent par cet endroit, l'aiguillon de l'un pique l'autre ; cette sorte de fleche ou de petit dard se sépare du corps de l'animal auquel il étoit, tombe par terre, ou est emporté par le limaçon qui en a été piqué : celui-ci se retire ; mais peu de tems après il revient & pique l'autre à son tour. Après ce préliminaire, l'accouplement ne manque jamais de se faire. Les limaçons s'accouplent jusqu'à trois fois de quinze jours en quinze jours, & à chaque fois on voit un nouvel aiguillon. M. du Verney a comparé cette régénération à celle du bois du cerf. L'accouplement dure dix ou douze heures, pendant lesquelles ces animaux sont comme engourdis : la fécondation n'a lieu qu'après le troisieme accouplement. Au bout d'environ dix-huit jours, les limaçons pondent par l'ouverture de leur cou des oeufs qu'ils cachent en terre ; ces oeufs sont en grand nombre, sphériques, blancs, revêtus d'une coque molle & membraneuse, collés ensemble en maniere de grappe, & gros comme de petits pois ou des grains de vesce. Aux approches de l'hiver, le limaçon s'enfonce dans la terre, ou se retire dans quelque trou ; il forme à l'ouverture de sa coquille avec sa bave un petit couvercle blanchâtre & circulaire de matiere un peu dure & solide lorsqu'elle est condensée, néanmoins poreuse & mince pour laisser entrer & sortir l'air. L'animal reste ainsi pendant six ou sept mois sans mouvement & sans prendre de nourriture ; au printems il ouvre sa coquille. Les limaçons mangent les feuilles, les fruits, les grains, plusieurs plantes ; ils font de grands dégâts dans les jardins pendant la nuit, sur-tout lorsqu'il pleut : les tortues détruisent beaucoup de ces animaux. Hist. nat. des anim. par M M. de Nobleville & Salerne, tom. I.
LIMAÇON, (Diete & Mat. med.) on emploie indifféremment les gros limaçons des vignes, ou les petits limaçons des jardins.
Les paysans en font des potages & différens ragoûts dans plusieurs provinces du royaume. Il est peu de mets aussi dégoutans pour les personnes qui n'y sont point accoutumées ; on peut croire même que celles qui en mangeroient sans rebut, le digéreroient difficilement. Leur chair spongieuse, mollasse, & l'espece de suc visqueux & fade dont elle est chargée, paroissent peu propres à exciter convenablement le jeu des organes de la digestion, & à être pénétrés par les humeurs digestives.
C'est cependant par cette qualité de nourriture insipide & glutineuse, lenta, que la chair & les bouillons de limaçons ont été fort vantés comme un excellent remede contre le marasme & la phthisie ; mais ces bouillons sont encore plus inutiles ou plus nuisibles que ceux de grenouille & de tortue, &c.
On distille les limaçons avec le petit-lait pour en retirer une eau qui passe pour adoucir merveilleusement la peau, & pour blanchir le teint ; mais nous pensons que la petite quantité de parties gélatineuses qui sont élevées avec l'eau par la distillation, ne suffisent point pour lui communiquer une vertu réellement adoucissante, quoiqu'elle lui donne la propriété de graisser & de se corrompre. Voyez EAUX DISTILLEES.
La liqueur qui découle des limaçons pilés & saupoudrés d'un peu de sel ou de sucre, est un remede plus réel ; celle-ci est véritablement muqueuse ; elle peut soulager la douleur, étant appliquée sur les tumeurs goutteuses, phlegmoneuses, &c. Elle est capable d'adoucir la peau ; elle est sur-tout recommandable contre les vraies inflammations des yeux, c'est-à-dire celles qui sont accompagnées de chaleur & de douleur vive.
Les coquilles de limaçons sont comptées parmi les alkalis terreux dont on fait usage en Medecine. Voyez TERREUX, Pharmacie. (b)
LIMAÇON, insecte du, (Insectolog.) petit animal à qui le corps des limaçons terrestres sert de domicile.
Il y a quantité d'insectes qui vivent sur la surface extérieure du corps de quelque animal ; tels sont les poux que l'on voit sur les quadrupedes, les oiseaux, & même sur les mouches, les frelons, les scarabées, &c. Il est d'autres insectes, qui vivent dans le corps de quelqu'autre animal, & l'on peut ranger sous ce dernier genre, toutes les especes de vers, que la dissection a fait découvrir dans le corps de diverses sortes d'animaux ; mais les insectes dont nous allons parler d'après M. de Reaumur, (Mém. de l'Ac. des Scienc. ann. 1710.) habitent tantôt la surface extérieure d'une des parties du corps du limaçon terrestre, & tantôt ils vont se cacher dans les intestins de cet animal. Expliquons ces phénomenes.
On sait que le collier du limaçon est cette partie qui entoure son cou ; que ce collier a beaucoup d'épaisseur, & que c'est presque la seule épaisseur de ce collier que l'on apperçoit, lorsque le limaçon s'est tellement retiré dans sa coquille, qu'il ne laisse voir, ni sa tête, ni son empatement ; c'est donc sur le collier que l'on trouve premierement les insectes dont il s'agit ici. Ils ne sont jamais plus aisés à observer, que lorsque le limaçon est renfermé dans sa coquille, quoiqu'on puisse les remarquer dans diverses autres circonstances. Les yeux seuls, sans être aidés du microscope, les apperçoivent d'une maniere sensible ; mais ils ne les voyent guère en repos ; ils marchent presque continuellement & avec une extrême vîtesse, ce qui leur est assez particulier.
Quelques petits que soient ces animaux, il ne leur est pas possible d'aller sur la surface supérieure du corps du limaçon, la coquille est trop exactement appliquée dessus : en revanche, ils ont d'autres pays intérieurs, où ils peuvent voyager. Le limaçon leur en permet l'entrée, toutes les fois qu'il ouvre son anus, qui est dans l'épaisseur du collier. Il semble que les petits insectes attendent ce moment favorable, pour se nicher dans les intestins du limaçon ; du moins, ne sont-ils pas long-tems à profiter de l'occasion qui se présente d'y aller. Ils s'approchent du bord du trou & s'enfoncent aussitôt dedans, en marchant le long de ses parois ; desorte qu'on ne voit plus au bout de quelques instans sur le collier, aucun des petits animaux qu'on y observoit auparavant.
L'empressement qu'ils ont à se rendre dans les intestins du limaçon, semblent indiquer que c'est là le séjour qu'ils aiment : mais le limaçon les oblige de revenir sur le collier toutes les fois qu'il fait sortir ses excrémens ; car ses excrémens occupant à-peu-près la largeur de l'intestin, chassent en avançant tout ce qui se présente en leur chemin ; de sorte que lorsque ces insectes arrivent au bord de l'anus ils sont contraints d'aller sur le collier ; & comme cette opération du limaçon dure quelque-tems, ils se promenent pendant ce tems-là sur le collier, d'où ils ne peuvent pas rentrer toujours quand il leur plaît dans les intestins, parce que le limaçon leur en a souvent fermé la porte, pendant qu'ils parcouroient le collier.
On peut observer tout cela sur toutes les especes de limaçons terrestres, & plus communément sur les gros limaçons des jardins. Il y a même certaines especes de petits limaçons, chez lesquels on découvre ces insectes, jusqu'au milieu de leurs intestins. Cependant, quoiqu'on trouve ces animalcules sur les différentes especes de limaçons terrestres, il ne faut pas les y chercher indifféremment en tous tems, car on en découvre rarement pendant les tems pluvieux. Ainsi pour ne se point donner la peine d'observer inutilement, il ne faut examiner les limaçons, qu'après une sécheresse. Apparemment qu'elle est propre à faire éclorre ces insectes, ou peut-être aussi, qu'elle empêche la destruction de ceux qui sont déjà formés.
Le corps seul du limaçon est un terrein convenable à ces insectes. On ne les voit jamais sur sa coquille, & si on use de force pour les obliger d'y aller, ils ne sont pas long-tems après qu'on leur a rendu la liberté, sans regagner le collier dont on les a chassés.
A la vûe simple, ils paroissent ordinairement d'une couleur très-blanche ; quelques-uns sont d'un blanc sale, & quelqu'autres d'un blanc dans lequel on auroit mêlé une très-légere teinture de rouge.
Un bon microscope est nécessaire pour appercevoir nettement leurs différentes parties. Il découvre leur trompe, dont ils se servent apparemment à sucer le limaçon ; elle est placée cette trompe au milieu de deux petites cornes très-mobiles, non-seulement de haut en bas, de droite à gauche, comme celles de la plûpart des insectes ; mais encore en elle-même, en s'allongeant & se racourcissant, comme celles des limaçons ; aussi arrive-t-il qu'on considere souvent ce petit animal, sans appercevoir ses cornes.
Son corps est divisé en six anneaux, & la partie antérieure à laquelle sont jointes la trompe & les cornes. Il a quatre jambes de quatre côtés, toutes garnies de grands poils ; elles paroissent terminées par quelques pointes, à-peu-près comme le seroient les jambes de diverses especes de scarabées, auxquelles on auroit ôté la derniere articulation, qui est terminée par deux petits crochets. Leur dos est arrondi, & élevé par rapport aux côtés. Les côtés ont chacun trois ou quatre grands poils. Leur anus est aussi entouré de quatre à cinq poils d'une pareille longueur ; mais on n'en voit point sur le ventre.
Au reste, les limaçons de mer ne sont guère plus heureux que les limaçons de terre. Swammerdam a observé & a décrit les vermisseaux qui percent, criblent leurs coquilles, y établissent leur domicile, & finissent par attaquer la peau même du limaçon. (D.J.)
LIMAÇON de mer, (Conchyliographie). Espece de limaçon du genre des aquatiques. Leur coquille, dit M. Tournefort, est à-peu-près de même forme & de même grosseur que celle des limaçons de nos jardins, mais elle a près d'une ligne d'épaisseur, c'est une nacre luisante en dedans ; le dehors est le plus souvent couvert d'une écorce tartareuse & grisâtre, sous laquelle la nacre est marbrée de taches noires disposées comme en échiquier : il s'en trouve quelques-unes sans écorce, à fond roussâtre, & à taches noirâtres : la spire est plus pointue que celle des limaçons ordinaires ; ce poisson qui est long-tems hors de l'eau, se promene sur les rochers, & tire ses cornes comme le limaçon de terre ; elles sont minces, longues de cinq ou six lignes, composées de fibres longitudinales à deux plans externes & internes, entrecoupées de quelques anneaux ou muscles annulaires : c'est par le jeu de ces fibres, que ses cornes rentrent ou sortent au gré de l'animal.
Le devant du limaçon de mer, est un gros muscle ou plastron, coupé en dessous en maniere de langue, vers la racine de laquelle est attaché le fermoir ; ce fermoir est une lame ronde, mince comme une écaille de carpe, luisante, souple, large de quatre lignes, roussâtre, marquée de plusieurs cercles concentriques ; le plastron est si fortement attaché par sa racine contre la coquille, que l'animal n'en sauroit sortir, qu'après qu'on l'a fait bouillir ; on le retire alors tout entier, & l'on s'apperçoit que cette racine en se courbant, s'applique fortement au tournant du limaçon, dans sa surface intérieure ; le plastron qui est creusé en gouttiere soutient les visceres de l'animal enfermés dans une espece de bourse, tournée en tire-bourre, où aboutit le conduit de la bouche.
Il faut que le lecteur se contente ici de cette description grossiere. C'est dans Swammerdam qu'il trouvera les merveilles délicates de la structure du limaçon aquatique & de sa coquille. (D.J.)
LIMAÇON, (en Anat.), la troisieme partie du labyrinthe ou de la cavité intérieure de l'oreille. Voyez OREILLE.
Le limaçon est directement opposé aux canaux demi-circulaires, & on le nomme de la sorte par rapport à la ressemblance qu'il a avec la coquille dans laquelle le limaçon est renfermé. Il donne passage à la portion noble du nerf auditif ; son canal est divisé par une cloison ou septum, composée de deux substances, l'une presqu'entierement cartilagineuse, & l'autre membraneuse.
Les deux canaux que forme cette cloison s'appellent échelles ; l'un qui aboutit au tympan par la fenêtre ronde, s'appelle échelle du tympan ; l'autre qui communique avec le vestibule par la fenêtre ovale, s'appelle échelle du vestibule. Le premier est le supérieur & le plus grand, l'autre est l'inférieur & le moindre. Voyez LABYRINTHE.
LIMAÇON, (en Architect.) Voyez VOUTE EN LIMAÇON.
LIMAÇON, (Horlogerie) piece de la quadrature d'une montre ou d'une pendule à répétition.
Sa forme en général est en ligne spirale ; mais cette ligne est le résultat de différens ressauts formés par des arcs de cercle qui sont tous d'un même nombre de degrés, & qui ont successivement des rayons de plus petits en plus petits.
Le limaçon des heures, par exemple, étant divisé en douze parties, a douze ressauts, chacun desquels comprend un arc de trente degrés. Voyez les figures des Pl. d'Horlogerie ; celui des quarts étant divisé en quatre parties, n'a que quatre ressauts, dont chacun a quatre-vingt-dix degrés. Voyez les mêmes Planches.
Le limaçon des heures tient toujours concentriquement avec l'étoile ; c'est par les différens ressauts que la répétition est déterminée à sonner plus ou moins de coups, selon l'heure marquée, comme il est expliqué à l'article REPETITION ; il fait son tour en douze heures. Voyez REPETITION.
|
| LIMAGNE | LA, (Géog.) contrée de France dans la basse Auvergne, le long de l'Allier. Elle est d'environ 15 lieues d'étendue du nord au sud : ses lieux principaux sont Clermont, Riom, Issoire, Brioude, &c. Grégoire de Tours appelle ce pays la Limane, en latin Limane. C'est une des plus agréables plaines & des plus fertiles qu'il y ait en France. Mais Sidonius Apollinaris, lib. IV. epist. 21, en a fait une trop belle description pour que je puisse la supprimer. Taceo, dit-il, territorium, viatoribus molle, fructuosum aratoribus, venatoribus voluptuosum, quod montium cingunt dorsa pascuis, latera vinetis, terrena villis, saxosa castellis, opaca lustris, aperta culturis, concava fontibus, abrupta fluminibus, quod denique hujusmodi est, ut semel visum, advenis multis, patriae oblivionem saepe persuadeas. (D.J.)
|
| LIMAILLE | S. f. (Chimie) le produit de la limation, ou action de limer.
L'opération qui réduit un corps en limaille par le moyen de la lime ou de la rape, voyez LIME & RAPE. est du genre des opérations méchaniques, auxiliaires ou préparatoires que les Chimistes emploient ; & elle est de l'espece des disgrégatives, c'est-à-dire de celles qui servent à rompre l'aggrégation, à diviser la masse des corps. Voyez à l'article OPERATIONS CHIMIQUES.
On réduit en limaille proprement dite les corps durs & malléables, savoir les métaux qui résistent par ces qualités à l'action du pilon, bien plus commode & plus expéditif quand on peut le mettre en usage.
La sciure des bois est aussi une espece de limaille : on exécute, par le moyen de la rape, la division de ces matieres, quand on les destine à quelqu'usage chimique ou pharmaceutique. (b)
LIMAILLE DE FER, (Mat. med.) Voyez MARS.
|
| LIMANDE | S. f. paser asper sive squamosus, (Hist. nat. Icthiolog.) Rond. poisson plat très-commun dans la mer ; il ne differe du quarrelet qu'en ce qu'il a le corps plus épais & de grandes écailles après sur les bords, & qu'il n'a point de tubercules sur la tête, ni de taches rouges. Ray, Synopsis meth. piscium. Voyez QUARRELET & POISSON.
|
| LIMAT | LE, (Géog.) riviere de Suisse ; elle a sa source au comté de Sargans, sur les confins des Grisons, auprès des Alpes ; passe à Zurich, à Baden, & se perd dans l'Aar. (D.J.)
|
| LIMBE | S. m. (Astr.) bord extérieur & gradué d'un astrolabe, d'un quart de cercle, ou d'un instrument de mathématique semblable. Voyez ASTROLABE, QUART DE CERCLE, &c.
On se sert aussi de ce mot, mais plus rarement, pour marquer le cercle primitif dans une projection de la sphere sur un plan, c'est-à-dire le cercle sur lequel se fait la projection.
Limbe signifie encore le bord extérieur du soleil & de la lune. Voyez DISQUE & ECLIPSE, &c.
Les Astronomes observent les hauteurs du limbe inférieur & du limbe supérieur du soleil, pour trouver la vraie hauteur de cet astre, c'est-à-dire celle de son centre. Pour cela ils retranchent la hauteur du bord supérieur de celle du bord inférieur, & ils prennent la moitié du reste qu'ils ajoûtent à la hauteur du bord inférieur ou qu'ils retranchent de la hauteur du bord supérieur, ce qui donne la hauteur du centre.
Les Astronomes observent souvent des ondulations dans le limbe du soleil, ce qui peut provenir de différentes causes, soit des vapeurs dont l'air est chargé, soit peut-être d'une athmosphere qui environne le corps de cet astre. (O)
|
| LIMBOURG | Limburgum, (Géogr.) ville des Pays-Bas autrichiens, capitale d'un grand duché de même nom. Louis XIV. prit Limbourg en 1675, & les Impériaux, réunis aux alliés, s'en rendirent maîtres en 1702 : elle est demeurée à la maison d'Autriche par les traités de Rastadt & de Bade, après avoir été démantelée. Cette ville est sur une montagne près de la Veze, dans une situation agréable, à 6 lieues de Liege, à 4 d'Aix-la-Chapelle, & à 7 de Mastricht. Long. 23. 43. lat. 50. 36. (D.J.)
|
| LIME | S. f. (Gramm. & Arts méchaniq.) morceau de fer ou d'acier trempé, dont on a rendu la surface raboteuse ou hérissée d'inégalités, à l'aide desquelles on réduit en poussiere les corps les plus durs.
Ainsi, eu égard à la qualité des inégalités, il y a des limes douces & des limes rudes ; eu égard au volume, il y en a de grosses & de petites ; eu égard à la forme, il y en a de plates, de rondes, de quarrées, &c.
Elles sont à l'usage de presque tous les ouvriers en métaux & en bois.
LIMES, outils d'Arquebusier. Les Arquebusiers se servent de limes d'Allemagne, d'Angleterre, limes carlettes, demi-rondes, queue de rat, limes douces, &c. de toutes sortes de grandeurs, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite. Voyez les Pl. d'Arqueb.
Limes en tiers-point, ces limes sont à trois côtés fort petites & fort menues ; les Arquebusiers s'en servent pour vuider des trous en bois & des ornemens.
LIME, en terme de Bijoutier, est un outil d'acier taillé de traits en sens contraire, qui forment autant de petites pointes qui mangent les métaux. La lime est d'un usage presque universel dans tous les Arts. On en fait en Angleterre, en Allemagne, à Genève, en Forès & à Paris : celles d'Angleterre passent pour les meilleures ; elles different de celles d'Allemagne, qui tiennent le second rang. Les limes d'Angleterre, pour l'Horlogerie, peuvent n'être taillées que d'un côté ; mais celles dont se servent les Bijoutiers, venant aussi d'Angleterre, sont taillées des deux côtés ; elles sont faites à la main, au lieu que les autres se font au moulin. Celles de Genève les suivent pour la bonté ; celles qu'on fait à Paris & en Forès imitent celles d'Angleterre & d'Allemagne par la forme, mais elles n'approchent point de leur bonté.
Il y a des limes de toutes grosseurs & de toutes sortes de formes ; & comme elles varient selon le goût & les besoins, nous ne parlerons que de celles qui sont connues par un usage courant & ordinaire, savoir des limes rudes, des bâtardes, des demi-bâtardes, des douces, des rondes, demi-rondes, triangulaires, &c. des limes feuille de sauge, à aiguilles, coutelles, à ouvrir, à refendre, limes tranchantes, coutelles arrondies, &c. Voyez tous ces mots à leur article.
LIME tranchante est une lime aiguë des deux côtés & plus épaisse du milieu, formant un losange allongé de toute grandeur & grosseur. Voyez LIME A COUTEAU & Pl. d'Horlogerie.
Limes d'aiguille ou à aiguille dont se servent les Bijoutiers & plus souvent les Metteurs en oeuvre pour les enjolivemens des corps de bagues & le réparer de tous leurs ouvrages à jour ; ainsi nommées, parce qu'elles ont toujours un trou à la tête comme les aiguilles, & que les petites paroissent être faites du même fil dont on fait les aiguilles ; il y en a de toutes formes & grosseurs.
Lime à arrondir ou demi ronde, en terme de Bijoutier, est une lime qui a deux angles tranchans, une face plate & l'autre ronde & obtuse : on s'en sert pour former des cercles ou demi-cercles, soit convexes ou concaves, dans une piece quelconque ; il y en a de toute grosseur & grandeur.
Lime coutelle, en terme de Bijoutier, se dit d'une lime dont la feuille ressemble à une lame de couteau, aiguë par un côté & un peu large par l'autre, comme le dos d'un couteau : elles sont taillées des trois côtés. Voyez lime à efflanquer, Pl. d'Horlogerie.
Lime coutelle arrondie, en terme de Bijoutier, est une lime dont le dos un peu large est arrondi & forme une portion de cercle d'un angle à l'autre.
Limes douces, (Bijoutier) En général sont celles dont les dents sont très-fines. Les limes rudes ayant fait par leurs dents aiguës des traits profonds, presque des cavités, on se sert de celles-ci en les passant en sens contraire sur ces mêmes traits, pour atteindre ces cavités, préparer les pieces au poli, & empêcher par-là le trop grand déchet que feroit ce même poli, s'il falloit atteindre à la ponce ou à la pierre des traits aussi profonds. Il y en a de toutes formes & grosseurs.
Lime feuille de sauge, (Bijoutier) se dit d'une espece de lime dont la feuille n'a que deux angles, & vont toujours en grossissant en rond en forme d'amande jusqu'au milieu de la feuille. Il y en a de toutes grandeurs & de toutes grosseurs. Voyez Pl. d'Horl.
Limes rudes, (Bijoutier) en général sont celles dont les dents sont très-aiguës ; elles servent à ébaucher les ouvrages, à leur donner la premiere figure, & à fixer les formes & les angles, étant plus propres que les autres à former la vivacité des contours ; les bâtardes & les douces ne font que conserver les formes & adoucir les traits profonds qu'ont faites ces premieres limes. Il y en a de toutes formes, grosseur & grandeur.
LIMES, terme & outils de Chaînetier ; ils s'en servent pour polir, dégrossir leurs ouvrages ; ils ont des limes douces, bâtardes, queues de rat ou rondes, &c.
LIMES EN CARRELET, outil de Charron, c'est une lime à trois côtés, de la longueur environ de huit ou dix pouces, emmanchée avec un morceau de bois d'environ deux pouces. Elle sert aux charrons pour rendre les dents de leurs scies plus aiguës.
LIME, (Coutelier) les Couteliers emploient toutes sortes de limes. Voyez cet article.
LIME, en terme de Doreur. Voyez à l'article ORFEVRE.
LIME, en terme de Cloutier faiseur d'aiguilles courbes, est un instrument d'acier à quatre faces plus ou moins douces, dont les carnes servent à évuider. Voyez différentes sortes de limes, Pl. d'Horlogerie, & la fig. du Cloutier d'épingles, qu'on appelle degrossoir.
LIME ou COUPERET, (Emailleur) Les Emailleurs nomment ainsi un outil d'acier plat & tranchant, dont ils se servent pour couper l'émail qu'ils ont réduit en canon ou tiré en filets. Il leur sert à peu-près comme le diamant aux Vitriers pour couper leur verre. Ils appellent cet outil une lime, parce qu'il est ordinairement fait de quelque vieille lime. Voyez EMAIL. Voyez les fig. de l'Emailleur.
LIME, outil de Ferblantier. Ce sont des limes ordinaires, rondes, demi-rondes & plates, & servent aux Ferblantiers pour rabattre la soudure qui fait une élévation trop forte.
LIME, outil des Fourbisseurs. Les Fourbisseurs se servent de limes rondes, demi-rondes, plates & étroites pour différens usages de leur métier, & principalement pour diminuer de grosseur les soies des lames d'épées, & pour aggrandir dans la garde le trou dans lequel la soie doit passer.
LIMES, outils de Gaînier. Les Gaîniers ont des limes plates, rondes & demi-rondes, qui leur servent à polir en-dedans leurs ouvrages.
LIME, (Horlogerie) outil dont la plupart des ouvriers qui travaillent les métaux, se servent pour donner aux pieces qu'ils travaillent, la figure requise. C'est presque toujours un long morceau d'acier trempé le plus dur qu'il est possible, dont la surface incisée & taillée en divers sens, présente un grand nombre de petites dents à peu-près semblables à celles d'un rochet de l'horlogerie, qui seroient appliquées par leur base au plan de la lime. Chacune de ces dents, lorsqu'on lime, produit un effet semblable à celui du ciseau d'un rabot de menuisier, lorsqu'on le pousse sur un morceau de bois.
Les limes, selon l'usage pour lequel on les destine, different par leur grandeur, grosseur & figure. Elles se divisent d'abord en trois classes ; savoir, les limes rudes, les batardes dont le grain est beaucoup moins gros, & les douces dont la taille est encore plus fine.
Les Horlogers sont ceux qui font usage d'un plus grand nombre de limes. Celles qui sont particulierement propres à ces sortes d'artistes sont,
1°. Les limes à couteaux (Pl. & explic. des Pl. d'Horlogerie) dont on se sert pour différens usages, en particulier pour former & enfoncer les pas de la vis sans fin.
2°. Celles que l'on nomme limes à feuille de sauge, sont pointues & en demi-rond des deux côtés. Elles sont particulierement utiles pour croiser les roues, les balanciers, &c.
3°. Les limes à charniere propres à différens usages.
4°. Celles dont on voit la forme à la suite des précédentes, servent à limer dans des endroits où une lime droite ne pourroit atteindre, comme dans une boîte, un timbre, &c. on les nomme lime à timbre, ou limes à creusure.
5°. Celles dont on se sert pour arrondir différentes pieces, & particulierement les dents des roues ou les aîles d'un pignon, & que pour cet effet on nomme limes à arrondir.
6°. Celles qu'on emploie pour efflanquer les aîles d'un pignon, & qu'on appelle limes à efflanquer.
7°. Les limes à pivot qui sont fort douces, & servent à rouler les pivots sur le tour.
8°. Les limes à égaler ou égalir, qui sont de très-petites limes à charniere fort douces, dont on se sert pour égaler toutes les fentes d'une denture, & pour en rendre le pié ou fond plus quarré.
9°. Les limes à lardon, avec lesquelles on fait dans la potence les rainures dans lesquelles doivent entrer les lardons, & celles où doivent être ajustées des pieces en queue d'aronde.
10°. Celles à dossier, qui sont des limes à égaler, ajustées par le moyen de deux ou trois vis entre deux plaques fort droites & d'égale largeur, en telle sorte qu'on peut faire déborder plus ou moins les côtés de ces plaques. On se sert de cette espece de lime pour enfoncer également toutes les dents d'une roue, ce qu'on fait en limant le fond des fentes avec la lime jusqu'à-ce que toutes les dents portent sur les côtés du dossier.
11°. Les limes à rouler les pivots de roue de rencontre ; elles sont faites en crochet, comme on le voit dans la figure, parce que le pivot qui roule dans la potence, se trouvant dans la creusure de la roue de rencontre, il seroit impossible de le rouler, lorsque cette roue est montée, avec une lime à pivot droite.
12°. Les limes à roue de rencontre qui servent pour limer les faces des dents de cette roue.
Enfin, les limes pour limer & adoucir intérieurement le champ de roues qui en ont au moyen de la partie demi-ronde.
Ils donnent encore le nom de lime à des morceaux de métal qui ont la même figure, & avec lesquels ils polissent, lesquels peuvent être d'étain, de cuivre ou d'acier.
Toutes les limes sont emmanchées, comme les figure les représentent, d'un manche de bois garni d'une virole de cuivre.
LIME DE CUIVRE A MAIN, (Marqueterie) à l'usage de ceux qui travaillent en pierres de rapport. Voyez Pl. de Marqueterie & PIERRES de rapport.
LIME A DECOUVRIR, (Metteur en oeuvre) cet outil est une lime ordinaire détrempée, c'est-à-dire passée au feu pour lui faire perdre sa dureté, avec lequel on enleve le superflu des sertissures, en limant de bas en haut, & appuyant en même sens avec une certaine force jusqu'à-ce que la matiere étendue par ce mouvement, s'amincisse & se coupe sur le feuilleti de la pierre. Si on se servoit d'une lime trempée, elle mordroit trop sur l'argent, & ne le presseroit pas assez sur la pierre, ce qui est un des principaux buts de cette opération.
LIMES, en terme d'Orfevre en grosserie, c'est l'outil dont l'usage soit le plus universel avec le marteau parmi les Orfevres. Les grossiers se servent comme les Bijoutiers, Metteurs en oeuvre, &c. des limes rondes, demi-rondes, plates, bâtardes, &c. Voyez toutes sortes de limes au bijoutier, Planche d'Orfév. & explic.
LIME PLATE A COULISSE, en terme d'Orfévres en tabatiere, est une espece de lame de couteau taillée en lime sur le dos, dont on se sert pour ébaucher les coulisses. Voyez COULISSES. Voyez les Planches.
Il n'y a que les Orfevres grossiers, & ceux qui fabriquent les tabatieres d'argent, qui s'en servent ; les Bijoutiers en or ébauchent leurs coulisses avec une échope ronde, quelques-uns même la font toute entiere à l'échope, & s'ils se servent d'une lime, c'est de la cylindrique, pour la finir & la dresser parfaitement.
LIME RONDE A COULISSE, en terme d'Orfevres en tabatiere, est une petite lime exactement ronde & cylindrique qu'on insinue dans la coulisse pour la finir. Voyez COULISSE, & fig.
Cet outil demande bien des qualités pour être bon ; il doit être bien rond, exactement droit, d'une taille ni trop rude ni trop fine, & d'une trempe séche sans être cassante ; quoique celles d'Angleterre soient bonnes, souvent elles ne réunissent pas toutes ces qualités : nous avons un ouvrier à Paris & de Paris (le sieur Rollin) qui y réussit parfaitement, & il est à souhaiter qu'il ait des successeurs ; son ouvrage est desiré chez tous les étrangers, même par les Anglois.
LIME A PALETTE, (Tailland.) c'est ainsi qu'on désigne entre les limes celle qui a une palette au bout de sa queue.
LIME ou RAPE, (Pharmacie) instrument dont on se sert en Pharmacie pour réduire en poudre ou en particules déliées les substances qu'on ne peut pulvériser à cause de leur dureté ; telles sont la corne de cerf, le sassafras, les santaux, le gaïac, & autres substances semblables.
LIME, s. f. instrument de Chirurgie, dont se servent les dentistes pour séparer les dents trop pressées, diminuer celles qui sont trop longues, ôter des pointes ou inégalités contre lesquelles la langue ou les gencives peuvent porter, ce qui occasionne des ulcères, &c.
Ces limes doivent être d'un bon acier & bien trempées ; on ne les fait pas faire chez les couteliers ; on les achete des quinquailliers qui en font venir en gros. La figure & la grandeur des limes sont différentes. Les plus grandes ont environ trois pouces de long, d'autres n'ont que deux pouces, & d'autres moins. Il faut en avoir de grandes, de petites, de larges, de grosses, de fines, & même plusieurs de chaque espece pour s'en servir au besoin. M. Fauchart, dans son traité intitulé le Chirurgien-Dentiste, en décrit de huit especes ; 1°. une mince & plate qui ne sert qu'à séparer les dents ; 2°. une un peu plus grande & plus épaisse, pour rendre les dents égales en longueur ; 3°. une appellée à couteau, dont l'usage est de tracer le chemin à une autre lime ; 4°. une plate & un peu pointue, pour élargir les endroits séparés, lorsqu'ils sont atteints de carie ; 5°. une nommée feuille de sauge, qui a deux surfaces convexes, pour faire des échancrures un peu arrondies sur les endroits cariés ; 6°. une demi-ronde pour augmenter les échancrures faites avec la précédente ; 7°. une ronde & pointue, nommée queue de rat, pour échancrer & augmenter la séparation proche de la gencive ; 8°. enfin une lime recourbée, propre à séparer avec facilité les dents du fond de la bouche. Nous avons fait graver quelques limes droites, Planche XXV. fig. 8.
Il seroit trop long de décrire toutes les circonstances qu'il faut observer dans l'usage des limes. En général il faut les appuyer médiocrement lorsque les dents font de la douleur, & les conduire toûjours le plus droit qu'il est possible de dehors en dedans, & de dedans en dehors. Pour éviter que les limes ne soient trop froides contre les dents, & que la limaille ne s'y attache, on doit, lorsqu'on s'en sert, les tremper de tems en tems dans l'eau chaude, & les nettoyer avec une petite brosse. Quand on lime les dents chancelantes, il faut les attacher à leurs voisines par un fil ciré en plusieurs doubles, auquel on fait faire autant de tours croisés qu'il en faut pour affermir ces dents contre les autres. S'il y avoit un intervalle assez large entre la dent solide & la dent chancelante, on remplit cet espace avec un petit coin de bois ou de plomb en forme de coulisse.
L'attitude des malades & celle de l'opérateur sont différentes, suivant la situation de la dent, à droite ou à gauche, sur le devant ou dans le fond de la bouche, en haut ou en bas. Ce sont des détails de pratique qui s'apprennent par l'usage. M. de Garengeot dans son Traité des instrumens, après avoir parlé succinctement des limes pour les dents & de leurs propriétés, assure avoir vû plusieurs personnes qui se sont fait égaliser les dents, & qui trois ou quatre ans après auroient souhaité qu'on n'y eût jamais touché, parce qu'elles s'étoient cariées. L'inconvénient de l'usage indiscret de la lime ne détruit pas les avantages que procure cet instrument lorsqu'il est conduit avec prudence, méthode & connoissance de cause. (Y)
LIME, machine à tailler les limes, les rapes, &c. Il y en a de plusieurs sortes, les unes pour tailler les grandes limes, d'autres pour tailler les petites ; mais la construction des unes & des autres a pour objet de remplir ces trois indications. Que la lime avance à la rencontre du ciseau qui doit la tailler d'une quantité uniforme à chaque levée du marteau ; que le marteau leve également à chaque passage des levées fixées sur l'arbre tournant, afin que les entailles que forme le ciseau soient d'égale profondeur, & que le ciseau, relevé par un ressort, se dégage de lui-même des tailles de la lime.
La machine représentée Pl. de Tailland. est supposée mue par une roue à aubes ou à pots, dont l'arbre porte un hérisson A, dont les alluchons conduisent les fuseaux d'une lanterne B, portée par un arbre horisontal 1 ; cet arbre est garni de plusieurs levées 2, 2, qui venant appuyer sur les queues 3, 3 des marteaux 5, 5, les élevent à chaque révolution de l'arbre autant de fois qu'il y a de levées dans sa circonférence.
Au devant de l'arbre sont élevés quatre poteaux espacés en trois intervalles égaux ; ces poteaux sont assemblés par leur partie inférieure dans une semelle du patin, & par leur partie supérieure avec une des poutres du plancher de l'attelier ; c'est entre ces poteaux que sont placés les axes des marteaux, comme on voit en F dans le plan ; les queues de ces marteaux traversent les arbres où elles sont arrêtées par des coins ; ces axes terminés en pivots par leurs extrémités, sont frettés de différentes bandes de fer, pour empêcher de fendre.
Au dessous des axes des marteaux & parallelement sont placés les axes des mains ou porte-ciseaux visibles en G, dans le plan & aussi dans le profil. Le bras 6, 7 est assemblé perpendiculairement sur l'axe où il est affermi à angles droits par deux écharpes, qui avec l'axe forment un triangle isocele, ce qui maintient le bras dans la même situation, & l'empêche d'avoir d'autre mouvement que le vertical ; l'autre extrémité 6 du bras, terminée par un bossage servant de main, est percé d'un trou vertical circulaire, dans lequel entre la poignée arrondie du ciseau 8, affuté à deux biseaux inégaux. Le bras est relevé par le ressort 9, 10, saisi en 9 par un étrier mobile sur une cheville qui traverse le bras de l'arbre, ou par une ficelle qui embrasse à-la-fois le bras & l'extrémité terminée en crochet du ressort ; ce ressort est fixé par son autre extrémité 10 dans deux pitons affermis sur l'entre-toise qui relie ensemble deux des six poteaux, qui avec quelques-autres pieces forment les trois cages ou établis de cette machine.
La cage est composée de deux jumelles horisontales, supportées chacune par deux poteaux, & évuidées intérieurement pour servir de coulisse au chariot qui porte les limes ; ce chariot représenté en plan en H, & aussi dans le profil, est une forte table de fer recouverte d'une table de plomb, & quelquefois d'étain, sur laquelle on pose les limes que l'on veut tailler, & où elles sont fixées par deux brides qui en recouvrent les extrémités ; ces brides sont elles-mêmes affermies par des vis sur le chariot.
Au dessous du chariot & directement vis-à-vis de la main qui tient le ciseau, est placée une enclume montée sur son billot, & d'un volume suffisant pour opposer aux coups réitérés du marteau, une résistance convenable ; c'est sur la surface de cette enclume que porte le chariot qui est mu dans ses coulisses par le moyen d'un cric représenté dans le profil.
Ce cric est composé d'une roue dentée en rochet, l'arbre de cette roue porte un pignon, & ce pignon engrene dans une cramaillere assemblée par une de ses extrémités au chariot qu'elle tire en avant. Lorsque l'arbre de la lanterne B en tournant rencontre par les dents dont il est armé celles du rochet du cric, ce rochet, qui tourne d'une dent à chaque levée du marteau, est fixé par un valet ou cliquet poussé par un ressort, à mesure qu'une dent échappe, le chariot devant être immobile pendant la descente du marteau.
Après que la lime a été taillée dans toute sa longueur, si l'on veut arrêter le mouvement du cric, on le peut, soit en éloignant l'axe de celui-ci, soit en relevant la cramailliere de dessus le pignon qui la conduit ; ce qui permet de ramener le chariot d'où il étoit parti. On suspend aussi le marteau par le talon 5 à un crochet fixe au-dessus, à une des pieces de comble de l'attelier, ce qui met sa queue hors de prise aux levées de l'arbre tournant, sans cependant suspendre son effet sur les autres parties de la machine.
Il résulte de cette construction, que pendant que les levées de l'arbre tournant relevent les marteaux, une des dents fixes sur l'arbre fait tourner une de celles du rochet du cric, celui-ci amene le chariot qui porte la lime du côté de l'arbre ; la queue du marteau venant à échapper la levée, celui-ci retombe sur l'extrémité de la tête du ciseau 8, ce qui en porte le tranchant sur la surface lisse de la lime, où la force du coup le fait entrer, ce qui forme une taille. Après le coup, le ressort 9 & 10 releve assez & le bras & le marteau pour dégager le tranchant du ciseau de dedans la taille de la lime, ce qui laisse au chariot la liberté de se mouvoir en long pendant que l'arbre tournant ayant présenté à la queue du marteau une nouvelle levée, releve celui-ci pour recommencer la même manoeuvre, jusqu'à ce que la lime soit taillée dans toute sa longueur.
La poignée du ciseau de forme ronde qui entre dans la main du bras où elle est fixée par une vis, est formée ainsi pour pouvoir orienter le tranchant du ciseau à la longueur de la lime sous un angle convenable, cette premiere taille devant être recoupée par une seconde autant ou plus ou moins inclinée à la longueur que l'exigent les différentes sortes de limes dont divers artisans font usage. Les tailles plus ou moins serrées des lignes, dépendent du moins ou du plus de vîtesse du chariot, que l'on peut régler par le nombre des dents du cric, & par le nombre des aîles du pignon qui conduit la cramailliere du chariot ; y ayant des limes qui dans l'intervalle d'un pouce n'ont que 12 tailles, & d'autres qui en ont jusqu'à 180 ou 200 dans le même intervalle, il faut donc changer de rochets pour chaque sorte de nombre, ou se servir d'une autre machine, comme nous dirons plus bas.
La pesanteur du marteau fait les tailles plus ou moins profondes, & on conçoit bien que les limes dont les tailles sont fort près l'une de l'autre, doivent être frappées moins profondément & les autres à proportion. On commence à tailler les limes par le côté de la queue, c'est la partie qui doit entrer dans le manche de cet outil, afin que la rebarbe en vive-arrête d'une taille ne soit point rabattue par le biseau du ciseau. La seconde taille qui recoupe la premiere commence aussi du côté de la queue, sur laquelle est imprimée la marque de l'ouvrier ; ces deux tailles divisent la surface de la lime en autant de pyramides quadrangulaires qu'il y a de carreaux dans les intersections des différentes tailles.
Les limes dont la forme est extrêmement variée, tant pour la grandeur que pour le profil, & encore par le plus ou moins de proximité des tailles, prennent des noms ou de leur usage ou de leur ressemblance avec quelques productions connues, soit naturelles, soit artificielles. Ainsi la lime dont le profil ou section perpendiculaire à la longueur est un cercle, & dont la grosseur va en diminuant, est nommée queue de rat ; on en fabrique de toutes sortes de longueurs, depuis dix-huit pouces jusqu'à un demi-pouce, & de chaque longueur en toutes sortes de tailles : ainsi de toutes les autres sortes de limes ; celles dont la coupe est un triangle se nomment carrelettes, & servent entr'autres usages à affuter les scies des menuisiers, ébénistes & autres ; celles dont la coupe est une ellipse, servent pour les scieurs de long ; celles dont la coupe est un parallélogramme rectangle, & qu'on appelle limes à dresser, ont quelquefois une des faces unie & sans être taillée ; celles dont la coupe est composée de deux arcs ou segmens de cercle adossés en cette forte (), se nomment feuilles de sauge, à cause de leur ressemblance avec la feuille de cette plante. Enfin rien de plus varié que les especes de limes, y en ayant de différentes grandeurs, de toutes les formes, & de chacunes d'elles de différente finesse de taille, &c.
Mais une distinction plus générale, mais trop vague des limes, quelle que puisse être d'ailleurs leur forme & leur grandeur, est celle qui les divise en rudes, bâtardes & douces. On entend par limes rudes celles dont les aspérités formées par les tailles sont plus éminentes & plus éloignées les unes des autres ; celles dont le grain est plus serré, sont appellées bâtardes ; enfin celles dont le grain est presqu'insensible, sont appellées douces. Au lieu de ces dénominations trop incertaines, on auroit dû distinguer les limes les unes des autres par numéros déduits du nombre des tailles renfermées dans la longueur d'un pouce, comme on a distingué les différens fils métalliques les uns des autres par des numéros dont l'augmentation fait connoître la diminution de diametre des mêmes fils. Voyez CORDES DE CLAVECIN.
Les limes se divisent encore en deux sortes, limes simplement dites, & limes à main : ces dernieres sont toutes celles qui, moins longues que quatre ou cinq pouces, peuvent être conduites sur les ouvrages avec une seule main, au lieu que les limes de huit pouces & au-dessus qu'on pourroit appeller limes à bras, exigent, pour être conduites sur l'ouvrage, le secours des deux mains, dont l'une tient le manche de la lime, & l'autre appuie sur son extrêmité.
Au lieu de la machine que nous venons d'expliquer, & dans laquelle le chariot qui porte les limes est mobile, on pourroit en construire une où il seroit sédentaire ; en ce cas ce seroient les marteaux, le guide ciseau qui marcheroient au-devant de la lime que l'on commence toûjours à tailler du côté de la queue, & le rappel de l'équipage des marteaux pourroit être une vis dont la tête garnie d'un rochet denté d'un nombre convenable pour la sorte de taille qu'on voudroit faire, seroit de même conduit par l'arbre tournant qui leve les marteaux ; & au lieu de marteaux on peut substituer un mouton dont les chûtes réitérées sur la tête du ciseau produiroient le même effet : enfin on pourroit changer la direction du mouvement du chariot ou de l'équipage du marteau par les mêmes moyens employés pour changer le mouvement des rouleaux du laminoir. Voyez LAMINOIR, SONNETE, &c.
Après que les limes ont été taillées, on les trempe en paquet, voyez TREMPE EN PAQUET, & elles sont entierement achevées. Il faut observer que les pieces d'acier dont on fait les limes, ont été elles-mêmes limées avant d'être portées sous le ciseau, & même pour les petites limes des Horlogers, qu'elles ont été émoulues avant d'être taillées. Il n'est pas inutile d'observer que le tranchant du ciseau doit être bien dressé & adouci sur la pierre à l'huile, puisque cette condition est essentielle pour que la lime soit bien taillée : on pose les limes sur du plomb ou de l'étain, pour que le côté taillé ne se meurtrisse point lorsqu'on taille le côté opposé.
Les rapes se taillent aussi à la machine, voyez RAPE ; la seule différence est qu'on se sert d'un poinçon au lieu du ciseau. La rape est une lime dont les cavités faites les unes après les autres ne communiquent point ensemble comme celles des limes ; on s'en sert principalement pour travailler les bois.
La planche suivante représente en plan & en profil une petite machine à tailler les limes des Horlogers ; elle est composée d'un chassis de métal établi sur une barre de même matiere, qui avec deux piliers forme la cage de cette machine ; les longs côtés du chassis servent de coulisse à un chariot, fig. 3, comme on peut voir par le plan, fig. premiere. Ce chariot, dont la face inférieure repose aussi sur un petit tas tenant lieu d'enclume, a une oreille taraudée en écrou, dans lequel passe la vis qui sert de rappel.
La tige de cette vis, après avoir traversé le pilier de devant, porte une roue garnie d'un nombre convenable de chevilles, & après la roue cette même tige porte une manivelle par le moyen de laquelle on communique le mouvement aux marteaux, dont l'un sert pour tailler la lime lorsque le chariot est amené du côté de la manivelle, & l'autre pour la retailler une seconde fois lorsque tournant la manivelle dans le sens opposé on fait rétrograder le chariot : pour cela on lâche le ressort qui pousse la tige d'un des marteaux, forée en canon & mobile sur la tige de l'autre, ce qui éloigne la palette de celui-ci des chevilles de la roue, & permet à la palette de l'autre marteau de s'y présenter. La main qui porte le ciseau susceptible d'être orienté, comme dans la machine précédente pour former les tailles & les contre-tailles, fig. 5. est, comme on voit fig. 2, relevée par un ressort fixé à la piece sur laquelle cette main est mobile. La partie supérieure de cette piece porte une vis qui venant appuyer contre un coude du porte-ciseau, sert à limiter l'action du ressort, & fait que le tranchant du ciseau ne s'éloigne de la lime qu'autant qu'il faut pour qu'il soit dégagé des tailles qu'il y a imprimées. Voyez les figures & leur explication. (D)
|
| LIMENARQUE | S. m. (Hist. anc.) inspecteur établi sur les ports pour que l'entrée n'en fût point ouverte aux pirates, & qu'il n'en sortît point de provisions pour l'ennemi. Ils étoient à la nomination des décurions, & devoient être des hommes libres. Le mot de limenarque est composé de limon, porte, & de archos, préfet.
|
| LIMÉNÉTIDE | Limenetis, (Littér.) surnom que les Grecs donnerent à Diane, comme déesse présidant aux ports de mer. Sous cette idée, sa statue la représentoit avec une espece de cancre marin sur la tête. Ce nom est tiré de , un port. (D.J.)
|
| LIMENTINUS | (Mythol.) dieu des Romains, gardien du seuil de la porte des maisons, qui s'appelle en latin limen ; mais je crois que c'est un dieu fait à plaisir, comme Forcule, Cardée, & tant d'autres. Les poëtes, les auteurs latins n'en parlent point & ne le connoissent point. (D.J.)
|
| LIMERIG | ou LIMRICK, (Géog.) on la nomme aussi Lough-Meath ; quelques-uns la prennent pour le Laberus des anciens. C'est une forte ville d'Irlande, capitale du comté de même nom qui a 48 milles de longueur, sur 27 de largeur ; elle est fertile, bien peuplée, avec un château & un bon port. Elle a droit de tenir un marché public, envoie deux députés au parlement d'Irlande, & a un siége épiscopal qui est aujourd'hui la métropole de la province de Munster. Cette ville essuya deux siéges fort rudes en 1690 & en 1691. Elle est sur le Shanon, à 14 lieues S. de Carloway, 17 N. de Cork, 23 O. de Waterford, 32 S. O. de Dublin. Long. 9. 12. lat. 52. 34. (D.J.)
|
| LIMES | (Topograph.) ce mot latin répond au mot limites que nous en avons emprunté, & signifie bornes ou l'extrêmité qui sépare une terre, un pays d'avec un autre. Dans les pays que les Romains distribuoient aux colonies, les champs étoient partagés entre les habitans, à qui l'on les donnoit à cultiver, & on les séparoit par des limites qui consistoient ou en un sentier battu par un homme à pié, ou en pierres qui tenoient lieu de bornes ; ces pierres étoient sacrées, & on ne pouvoit les déplacer sans crime. Hygin a fait un traité exprès sur ce sujet, intitulé de limitibus constituendis.
Le mot limes désigne encore la frontiere lorsqu'il est question d'un état tout entier. C'est ainsi qu'Auguste, maître de l'Empire, s'arrogea despotiquement un certain nombre de provinces, fixa leurs limites, & mit dans chacune de ces provinces un certain nombre de légions pour les défendre en cas de besoin. Les limites de l'Empire changerent avec l'Empire ; tantôt on ajouta de nouvelles frontieres, & tantôt on les diminua. Dioclétien fit élever à leur extrêmité des forteresses & des places de guerre pour y loger des soldats ; Constantin en retira les troupes pour les mettre dans les villes : alors les barbares trouvant les frontieres de l'Empire dégarnies d'hommes & de soldats, n'eurent pas de peine à y entrer, à les piller ou à s'en emparer. Telle fut la fin de l'Empire romain, dont Horace disoit d'avance, jam Roma mole ruit suâ. (D.J.)
LIMES, la cité de, (Géog.) plaine remarquable de France en Normandie au pays de Caux, à demi-lieue de Dieppe, vers l'orient d'été. Les savans du pays nomment en latin ce lieu, castrum Caesaris, le camp de César : du-moins sa situation donne lieu de soupçonner que ce pouvoit être autrefois un camp des Romains ; mais qu'on en ait l'idée qu'on voudra, la cité de Limes n'est à présent qu'un simple pâturage. (D.J.)
|
| LIMIER | S. m. (Venerie) c'est le chien qui détourne le cerf & autres grandes bêtes. Voyez l'explication des Chasses.
|
| LIMINARQUE | S. m. (Littér. mod.) officier destiné à veiller sur les frontieres de l'empire, & qui commandoit les troupes destinées à les garder. Ce terme, comme plusieurs autres qui se sont établis au tems du bas-empire, a été formé de deux mots, l'un latin, limen, porte, entrée, parce que les frontieres d'un pays en sont pour ainsi dire les portes ; & l'autre, grec, qui signifie commandant. (D.J.)
|
| LIMIRAVEN | S. m. (Hist. nat. Bot.) arbre de l'île de Madagascar. Ses feuilles ressemblent à celles du chataigner ; elles croissent cinq à cinq. On leur attribue d'être cordiales.
|
| LIMITATIF | adj. (Jurisp.) se dit de ce qui restraint l'exercice d'un droit sur un certain objet seulement, à la différence de ce qui est simplement démonstratif, & qui indique bien que l'on peut exercer son droit sur un certain objet, sans néanmoins que cette indication empêche d'exercer ce même droit sur quelqu'autre chose ; c'est ainsi que l'on distingue l'assignat limitatif de celui qui n'est que démonstratif. Voyez ASSIGNAT. (A)
|
| LIMITE | S. f. (Mathémat.) On dit qu'une grandeur est la limite d'une autre grandeur, quand la seconde peut approcher de la premiere plus près que d'une grandeur donnée, si petite qu'on la puisse supposer, sans pourtant que la grandeur qui approche, puisse jamais surpasser la grandeur dont elle approche ; ensorte que la différence d'une pareille quantité à sa limite est absolument inassignable.
Par exemple, supposons deux polygones, l'un inscrit & l'autre circonscrit à un cercle, il est évident que l'on peut en multiplier les côtés autant que l'on voudra ; & dans ce cas, chaque polygone approchera toujours de plus en plus de la circonférence du cercle, le contour du polygone inscrit augmentera, & celui du circonscrit diminuera ; mais le périmetre ou le contour du premier ne surpassera jamais la longueur de la circonférence, & celui du second ne sera jamais plus petit que cette même circonférence ; la circonférence du cercle est donc la limite de l'augmentation du premier polygone, & de la diminution du second.
1°. Si deux grandeurs sont la limite d'une même quantité, ces deux grandeurs seront égales entr'elles.
2°. Soit A x B le produit des deux grandeurs A, B. Supposons que C soit la limite de la grandeur A, & D la limite de la quantité B ; je dis que C x D, produit des limites, sera nécessairement la limite de A x B, produit des deux grandeurs A, B.
Ces deux propositions, que l'on trouvera démontrées exactement dans les institutions de Géométrie, servent de principes pour démontrer rigoureusement que l'on a l'aire d'un cercle, en multipliant sa demi-circonférence par son rayon. Voyez l'ouvrage cité p. 331. & suiv. du second tome. (E)
La théorie des limites est la base de la vraie Métaphysique du calcul différenciel. Voyez DIFFERENTIEL, FLUXION, EXHAUSTION, INFINI. A proprement parler, la limite ne coïncide jamais, ou ne devient jamais égale à la quantité dont elle est la limite ; mais celle-ci s'en approche toujours de plus en plus, & peut en différer aussi peu qu'on voudra. Le cercle, par exemple, est la limite des polygones inscrits & circonscrits ; car il ne se confond jamais rigoureusement avec eux, quoique ceux-ci puissent en approcher à l'infini. Cette notion peut servir à éclaircir plusieurs propositions mathématiques. Par exemple, on dit que la somme d'une progression géométrique décroissante dont le premier terme est a & le second b, est ; cette valeur n'est point proprement la somme de la progression, c'est la limite de cette somme, c'est-à-dire la quantité dont elle peut approcher si près qu'on voudra, sans jamais y arriver exactement. Car si e est le dernier terme de la progression, la valeur exacte de la somme est , qui est toujours moindre que , parce que dans une progression géométrique même décroissante, le dernier terme e n'est jamais = 0 : mais comme ce terme approche continuellement de zéro, sans jamais y arriver, il est clair que zéro est sa limite, & que par conséquent la limite de est , en supposant e = 0, c'est-à-dire en mettant au lieu de e sa limite. Voyez SUITE ou SERIE, PROGRESSION, &c. (O)
LIMITE des Planetes, (Astronom.) sont les points de leur orbite où elles sont le plus éloignées de l'écliptique. Voyez ORBITE.
Les limites sont à 90 degrés des noeuds, c'est-à-dire des points où l'orbite d'une planete coupe l'écliptique.
LIMITES, en Algebre, sont les deux quantités entre lesquelles se trouvent comprises les racines réelles d'une équation. Par exemple, si on trouve que la racine d'une équation est entre 3 & 4, ces nombres 3 & 4 seront ses limites. Voy. les articles EQUATION, CASCADE & RACINE.
Limites d'un problème sont les nombres entre lesquels la solution de ce problème est renfermée. Les problèmes indéterminés ont quelquefois, & même souvent, des limites, c'est-à-dire que l'inconnue est renfermée entre de certaines valeurs qu'elle ne sauroit passer. Par exemple, si on a y = , il est clair que y ne sauroit être plus grande que a, puisque faisant x = 0, on a y = a ; & que faisant x = a, on a y = 0, & qu'enfin x > a, rend y imaginaire, soit que x soit positive ou négative. Voyez PROBLEME & DETERMINE. (O)
|
| LIMITES | (Jurisprud.) sont les bornes de quelque puissance ou de quelque héritage. Les limites des deux puissances spirituelle & temporelle sont la distinction de ce qui appartient à chacune d'elles.
Solon avoit fait une loi par laquelle les limites des héritages étoient distingués par un espace de cinq piés qu'on laissoit entre deux pour passer la charrue ; & afin que l'on ne pût se méprendre sur la propriété des territoires, cet espace de cinq piés étoit imprescriptible.
Cette disposition fut d'abord adoptée chez les Romains par la loi des douze tables. La loi Manilia avoit pareillement ordonné qu'il y auroit un espace de cinq ou six piés entre les fonds voisins. Dans la suite on cessa de laisser cet espace, & il fut permis d'agir pour la moindre anticipation qui se faisoit sur les limites. C'est ce que l'on induit ordinairement de la loi quinque pedum, au code finium regundorum, laquelle n'est pourtant pas fort claire.
Depuis que l'on eut cessé de laisser un espace entre les héritages voisins, on marqua les limites par des bornes ou pierres, & quelquefois par des terres.
Dans les premiers tems de la fondation de Rome, c'étoient les freres Arvales qui connoissoient des limites.
Le tribun Mamilius fut surnommé Limitaneus, parce qu'il avoit fait une loi sur les limites.
Il y avoit chez les Romains, comme parmi nous, des arpenteurs, mensores, que les juges envoyoient sur les lieux pour marquer les limites.
Ce qui concerne les limites & l'action de bornage, est traité dans les titres du digeste & du code finium regundorum, & dans l'histoire de la Jurisprudence rom. de M. Terrasson, part. II. §. 10. p. 168. Voyez ARPENTAGE, ARPENTEURS, BORNES, BORNAGE. (A)
|
| LIMITROPHE | adj. (Géog.) ce mot se dit des terres, des pays, qui se touchent par leurs limites, qui sont contigus l'un à l'autre ; ainsi la Normandie & la Picardie sont limitrophes. Nous avons reçu ce mot en Géographie, car celui de voisin n'est pas si propre, ni si juste, & quand il le seroit, nous aurions dû encore adopter celui de limitrophe, pour rendre notre langue plus riche & plus abondante. (D.J.)
|
| LIMMA | S. m. en Musique, est ce qui reste d'un ton majeur après qu'on en a retranché l'apotome, qui est un intervalle plus grand d'un comma que le semi-ton moyen, par conséquent le limma est moindre d'un comma que le semi-ton majeur.
Les Grecs divisoient le ton majeur en plusieurs manieres : de l'une de ces divisions inventée par Pythagore selon les uns, & selon d'autres par Philolaüs, résultoit l'apotome d'un côté, & de l'autre le limma, dont la raison est de 243 à 256. Ce qu'il y a ici de singulier, c'est que Pythagore faisoit du limma un intervalle diatonique qui répondoit à notre semi-ton majeur ; desorte que, selon lui, l'intervalle du mi au fa étoit moindre que celui du fa à son dièse, ce qui est tout au contraire selon nos calculs harmoniques.
La génération du limma, en commençant par ut, se trouve à la cinquieme quinte si ; car alors la quantité dont ce si est surpassé par l'ut, est précisément ce rapport que nous venons d'établir.
Il faut remarquer que Zarlin, qui s'accorde avec le P. Mersenne sur la division pythagorique du ton majeur en limma & en apotome, en applique les noms tout différemment ; car il appelle limma la partie que le P. Mersenne appelle apotome, & apotome celle que le P. Mersenne appelle limma. Voyez APOTOME. Voyez aussi ENHARMONIQUE. (S)
|
| LIMNADE | S. f. (Mythol.) en latin limnas, gén. ados, nymphe d'étang ; les nymphes, les déesses des étangs furent nommées limnées, limnades, limniades, du mot grec , qui signifie un étang, un marais. (D.J.)
|
| LIMNAE | (Géog. anc.) ville de Thrace dans la Chersonese, auprès de Sestos. 2°. Limnae étoit encore un lieu du Péloponnèse, aux confins de la Laconie & de la Messénie, célebre par le temple de Diane, qui en tira son nom de Diane lemnéenne. Les Messéniens violerent les filles qui s'étoient rendues dans ce temple, pour y sacrifier à la déesse. On demanda justice de cette violence, & le refus des Messéniens donna lieu à une guerre cruelle, qui causa la ruine de leur ville. 3°. Enfin, limnae étoit un quartier d'une tribu de l'Attique, située proche la ville d'Athènes où il y avoit un temple de Bacchus, dans lequel on célébroit une fête en son honneur le 12 du mois Anthestorion ; & on y faisoit combattre de jeunes gens à la lutte. C'étoit dans ce temple qu'on lisoit un decret des Athéniens, qui obligeoit leur roi, lorsqu'il vouloit se marier, de prendre une femme du pays, & une femme qui n'eût point été mariée auparavant. (D.J.)
|
| LIMNATIDE | (Litt.) Limnatis, surnom de Diane, qui étoit regardée comme la patrone des pêcheurs d'étangs, lesquels par reconnoissance célébroient entr'eux en l'honneur de la déesse, une fête nommée limnatidie. (D.J.)
|
| LIMNOS | (Géog. anc.) isle de l'Océan britannique, que Ptolémée met sur la côte orientale d'Irlande. Cambden dit, que cette isle est nommée Lymen par les Bretons, Hamsey par les Anglois, & dans la vie de saint David évêque, Limencia insula. (D.J.)
|
| LIMNOSTRACITE | (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs, à la petite huître épineuse qui se trouve quelquefois dans le sein de la terre.
|
| LIMODORE | S. m. (Hist. nat. Bot.) Limodorum, genre de plante à fleur polypetale, anomale, ressemblante à la fleur de satirion ; le calice devient un fruit ou une bourse percée de trois ouvertures auxquelles tiennent trois panneaux chargés de semences très-petites. Tournefort, Instit. rei herbar. Voyez PLANTE.
|
| LIMOGES | (Géog.) ancienne ville de France, capitale du Limousin, avec un évêché suffragant de Bourges. Cette ville a souvent changé de maîtres, depuis qu'elle tomba au pouvoir des Visigoths dans le cinquieme siecle, jusqu'en 1360 qu'elle fut cedée à l'Angleterre par le traité de Bretigny ; mais bientôt après, sous Charles V. les Anglois en perdirent la souveraineté, & n'ont pu s'y rétablir dans les siecles suivans : ainsi Limoges se trouve réunie à la couronne depuis 390 ans.
Les Latins appellent cette ville Ratiastum, vicus Ratiniensis, civitas Ratiaca, Lemorica, Lemovicina urbs. Elle est située en partie sur une colline, & en partie dans un vallon, sur la Vienne, à 20 lieues N. E. de Périgueux, 28 S. E. de Poitiers, 44 N. E. de Bordeaux, 100 S. O. de Paris. Longit. 18. 57. lat. 45. 48.
M. d'Aguesseau (Henri François), chancelier de France, mort à Paris en 1751, naquit à Limoges en 1668 : il doit être mis au rang des hommes illustres de notre siecle soit comme savant, soit comme magistrat.
Limoges est aussi la patrie d'Honoré de Sainte-Marie carme déchaussé, connu par ses dissertations historiques sur les ordres militaires, & par ses réflexions sur les regles & les usages de la critique, en trois volumes in 4° : il devoit s'en tenir là, & ne point écrire sur l'amour divin. Il mourut à Lille en 1720, à 78 ans. (D.J.)
|
| LIMON | S. m. (Hist. nat.) limus, lutum. On entend en général par limon, la terre qui a été délayée & entraînée par les eaux, & qu'elles ont ensuite déposée. On voit par-là que le limon ne peut point être regardé comme une terre simple, mais comme un mêlange de terres de différentes espéces, mêlange qui doit nécessairement varier. En effet, les eaux des rivieres en passant par des terreins différens, doivent entraîner des terres d'une nature toute différente ; ainsi une riviere qui passera dans un canton où la craie domine, se chargera de craie ou de terre calcaire ; si cette même riviere passe ensuite par un terrein de glaise ou d'argille, le limon dont elle se chargera, sera glaiseux. Il paroît cependant qu'il doit y avoir de la différence entre ce limon & la glaise ordinaire, vû que l'eau, en la délayant, a du lui enlever une portion de sa partie visqueuse & tenace ; par conséquent elle aura changé de nature, & elle ne doit plus avoir les mêmes qualités qu'auparavant. Ce qui vient d'être dit du limon des rivieres, peut encore s'appliquer à celui des marais, des lacs, & de la mer même : en effet, les eaux des ruisseaux, des pluies, & des fleuves qui vont s'y rendre, doivent y porter des terres de différentes qualités. A ces terres il s'en joint souvent une autre qui est formée par la décomposition des végétaux : c'est à cette terre qu'il faut attribuer la partie visqueuse & la couleur noire ou brune du limon que l'on trouve, sur-tout au fond des eaux stagnantes ; c'est encore de cette décomposition des plantes vitrioliques & des feuilles, que paroît venir la partie ferrugineuse qui se trouve souvent contenue dans quelques especes de limon.
Le limon que déposent les rivieres, mérite toute l'attention des Naturalistes : il est très-propre à leur faire connoître la formation du tuf & de plusieurs des couches, dont nous voyons différens terreins composés : on pourra en juger par les observations suivantes, que M. Schober directeur des mines du sel-gemme de Wicliska en Pologne, a faites sur le limon que dépose la Sala : ces observations sont tirées du magazin de Hambourg, tome III.
La Sala ou Saale est une riviere à peu-près de la force de la Marne ; après avoir traversé la Thuringe, elle se jette dans l'Elbe. M. Schober s'étant apperçu qu'à la suite de grandes pluies, cette riviere s'étoit chargée de beaucoup de terres, fut tenté de calculer combien elle pouvoit entraîner de parties terrestres en vingt-quatre heures. Pour avoir un prix commun, il puisa à cinq heures du soir de l'eau de la Sala, dans un vaisseau qui contenoit dix livres, trois onces, & deux gros d'eau. Vingt-quatre heures après, il puisa la même quantité d'eau dans un vaisseau tout pareil ; il laissa ces deux vaisseaux en repos, afin que le limon eût tout le tems de se déposer. Au bout de quelques jours, il décanta l'eau claire qui surnageoit au dépôt, & ayant recueilli le limon qui étoit au fond, il le fit secher au soleil, il trouva que l'eau du premier vaisseau avoit déposé deux onces & deux gros & demi d'un limon argilleux, & que celle du second vaisseau n'en avoit déposé que deux gros. Ainsi, vingt livres six onces & demie d'eau avoient donné deux onces & quatre gros & demi de limon séché. M. Schober humecta de nouveau ce limon argilleux, & il en forma un cube d'un pouce en tout sens : ce cube pesoit une demi-once & 3 4/25 gros, d'où l'on voit qu'un pié cube, ou 1728 pouces cubiques, devoit peser 96 livres & 10 1/2 onces. Le pié cube d'eau pese cinquante livres ; ainsi en prenant 138 piés cubes de l'eau, telle que celle qui avoit été puisée dans le premier vaisseau, pour produire un pié cubique de limon, il faudra compter 247 piés cubes d'eau pour les deux expériences prises à la fois. M. Schober a trouvé qu'il passoit 1295 piés cubes d'eau en une heure, par une ouverture qui a 1 pouce de largeur & 12 pouces de hauteur. L'eau de la Sala, resserrée par une digue, passe par un espace de 372 piés, ce qui fait 4464 pouces ; si elle est restée aussi trouble & aussi chargée de terre que celle du premier vaisseau, seulement pendant une heure de tems, il a dû passer pendant cette heure, 5780880 piés cubes d'eau, qui ont dû entraîner 41890 piés cubes de limon ; ce qui produit une quantité suffisante de limon pour couvrir une surface quarrée de 204 piés, de l'épaisseur d'un pié. Mais si l'on additionne le produit des deux vaisseaux, on trouvera que, puisque 20 livres 6 1/2 onces d'eau ont donné 2 onces 4 1/2 de limon ; & si on suppose que l'eau a coulé de cette maniere, pendant vingt-quatre heures ; on trouvera, dis-je, que pendant ce tems, il a dû s'écouler 138741120 piés cubes d'eau, qui ont dû charrier 561705 piés cubes de limon, quantité qui suffit pour couvrir d'un pié d'épaisseur une surface quarrée de 749 piés.
On peut conclure de-là que, si une petite riviere, telle que la Sala, entraîne une si grande quantité de limon, l'on doit présumer que les grandes rivieres, telles que le Rhin, le Danube, &c. doivent en plusieurs siécles, en entraîner une quantité immense, & les porter au fond de la mer, dont par conséquent, le lit doit hausser continuellement. Cependant tout ce limon ne va point à la mer : il en reste une portion considérable qui se dépose en route sur les endroits qui sont inondés par les débordemens des rivieres. Suivant la nature du limon qui se dépose, il se forme dans les plaines qui ont été inondées, différentes couches, qui par la suite des tems se changent en tuf ou en pierre, & qui forment cette multitude de lits ou de couches de différente nature, que nous voyons se succéder les unes aux autres dans la plûpart des plaines qui sont sujettes aux inondations des grandes rivieres.
Nous voyons aussi que le limon apporté par les rivieres ne produit point toujours les mêmes effets ; souvent il engraisse les terres sur lesquelles il se répand : c'est ce qu'on voit sur-tout dans les inondations du Nil, dont le limon gras & onctueux fertilise le terrein sablonneux de l'Egypte ; d'autres fois ce limon nuit à la fertilité des terres, parce qu'il est plus maigre, plus sablonneux, & en général moins adapté à la nature du terrein sur lequel les eaux l'ont déposé. Il y a du limon qui est nuisible aux terres, parce qu'étant trop chargé de parties végétales acides (pour se servir de l'expression vulgaire), il rend le terrein trop froid ; quelquefois aussi ce limon étant trop gras, & venant à se répandre sur un terrein déja gras & compacte, il le gâte & lui ôte cette juste proportion qui est si avantageuse pour la végétation. (-)
LIMON, s. m. (Médec. Pharmac. Cuisine, Arts) fruit du limonier. L'écorce des limons est remplie d'une huile essentielle, âcre, amere, aromatique, fortifiante & cordiale, composée de parties très-subtiles ; elle brûle à la flamme, & se trouve contenue dans de petites vessies transparentes. Le suc des limons communique, par son acidité, une belle couleur pourpre à la conserve de violette, & au papier bleu ; il est pareillement renfermé dans des cellules particulieres.
L'huile essentielle des limons, vulgairement nommée huile de neroli, a les mêmes propriétés que celle de citron.
Pour faire l'eau de limon, on distille au bain-marie des limons, pilés tout entiers, parce que de cette maniere, la partie acide est imbue de l'huile essentielle, & acquiert une vertu cardiaque, sans échauffer.
Tout le monde sait, que la limonade est un breuvage que l'on fait avec de l'eau, du sucre & des limons. Cette liqueur factice a eu l'honneur de donner son nom à une communauté de la ville de Paris, qui n'étoit d'abord que des especes de regrattiers, lesquels furent érigés en corps de jurande en 1678.
Il ne faut pas confondre la simple limonade faite d'eau de limons & de sucre, avec celle dont on consomme une si grande quantité dans les îles de l'Amérique, & qu'on nomme limonade à l'angloise ; cette derniere est composée de vin de Canarie, de jus de limon, de sucre, de cannelle, de gérofle, & d'essence d'ambre ; c'est une boisson délicieuse.
Le suc de limon est ajouté à divers purgatifs, pour les rendre moins desagréables & plus efficaces dans leur opération. Par exemple, on prend séné oriental une drachme, manne trois onces, sel végétal un gros, coriandre demi-gros, feuilles de pinprenelle deux poignées, limon coupé par tranches ; on verse sur ces drogues, deux pintes d'eau bouillante ; on macere le tout pendant la nuit, on le passe ; on y ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'écorce de citron, & l'on partage cette tisane laxative en quatre prises, que l'on boit de deux en deux heures.
Pour faire dans le scorbut un gargarisme propre aux gencives, on peut prendre esprit de cochléaria & esprit de vin, ana une once, suc de limon deux onces, eau de cresson quatre onces, mais il est aisé de combiner & de multiplier, suivant les cas, ces sortes d'ordonnances à l'infini.
Les limons sont plus acides au goût, que les oranges & les citrons ; c'est pourquoi il est vraisemblable, qu'ils sont plus rafraîchissans. Du reste, tout ce qu'on a dit du citron, de ses vertus, de ses usages & de ses préparations, s'applique également au fruit du limonier.
Il abonde dans les îles orientales & occidentales. On trouve en particulier à Tunquin, deux sortes de limons, les uns jaunes, les autres verds ; mais tous si aigres, qu'il n'est pas possible d'en manger, sans se gâter l'estomac. Ces fruits ne sont pas cependant inutiles aux Tunquinois, ni aux autres peuples des Indes. Non-seulement ils s'en servent, comme nous de l'eau-forte, pour nettoyer le cuivre, le laiton & autres métaux, quand ils veulent les mettre en état d'être dorés ; mais aussi pour les teintures, & surtout pour teintures en soie.
Un autre usage qu'ils en tirent, est pour blanchir le linge ; l'on en met dans les lessives, particulierement des toiles fines, ce qui leur donne un blanc & un éclat admirable, comme on peut le remarquer principalement dans toutes les toiles de coton du Mogol, qui ne se blanchissent qu'avec le jus de ces sortes de limons.
Nos teinturiers se servent aussi du suc de limon en Europe, pour changer diverses couleurs & les rendre plus fixes. Les lettres que l'on écrit avec ce suc sur du papier, paroissent lorsqu'on les approche du feu. C'est une espece d'encre sympathique ; mais il y en a d'autres bien plus curieuses. Voyez ENCRE SYMPATHIQUE.
On peut consulter sur les limons tous les auteurs cités au mot CITRONNIER, & entr'autres Ferrarius, qui en a le mieux traité. (D.J.)
LIMON, s. m. (terme de Charron). Ces limons sont les deux maîtres brins d'une charrette, qui sont de la longueur de quatorze ou quinze piés sur quatre ou cinq pouces de circonférence ; cela forme en même tems le fond de la charrette & le brancart pour mettre en limon : ces deux limons sont joints ensemble à la distance de cinq piés, par quatre ou six éparts sur lesquels on pose les planches du fond. Les limons sont troués en dessus, à la distance de six pouces pour placer les roulons des ridelles. Voyez nos Pl. du Charron.
Limons de traverse, terme de Charron ; ce sont les morceaux de bois, longs d'environ huit ou dix piés, dans lesquels s'enchâssent les roulons par le milieu & qui terminent les ridelles par en-haut, il y en a ordinairement deux de chaque côte. Voyez nos Pl. du Charron, qui représentent une charrette.
LIMON, du latin limus, tourné de travers (coupe des pierres) signifie, la pierre ou piece de bois qui termine & soutient les marches d'une rampe, sur laquelle on pose une balustrade de pierre ou de fer pour servir d'appui à ceux qui montent. Cette piece est droite dans les rampes droites, & gauche par ses surfaces supérieure & inférieure, dans les parties tournantes des escaliers.
LIMON, (Charpente), est une piece de charpente omeplat, c'est-à-dire plus que plat, laquelle sert dans les escaliers à soutenir le bout des marches qui portent dedans, & qui portent par les bouts dans les noyaux ou courbes des escaliers. Voyez les fig. des Pl. de Charpente.
LIMON, faux, (Charpent.) est celui qui se met dans les angles des baies, des portes & des croisées, & dans lequel les marches sont assemblées, comme dans les limons.
LIMONADE, s. f. (Pharmac. Mat. méd. & diete) La limonade est une liqueur aussi agréable que salutaire, dont nous avons exposé les propriétés médicinales à l'article CITRON. Voyez cet article.
Pour faire de la bonne limonade, il faut prendre des citrons frais & bien sains, les partager par le milieu, en exprimer le suc, en les serrant entre les mains, étendre ce suc dans suffisante quantité d'eau pour qu'il ne lui reste qu'une saveur aigrelette légere, une agréable acidité ; passer cette liqueur sur le champ à travers un linge très-propre, pour en séparer les pepins & une partie de la pulpe du citron qui peut s'en être détachée en les exprimant, & qui en séjournant dans la liqueur y porteroit une amertume désagréable ; ou bien ôter l'écorce des citrons, partager leur pulpe par le milieu, les enfermer dans un linge blanc, les exprimer fortement & ajouter de l'eau jusqu'à agréable acidité ; de quelque façon qu'on s'y soit pris pour obtenir la liqueur aigrelette & dépurée, on l'édulcore ensuite avec suffisante quantité de sucre, dont on aura frotté une petite partie contre une écorce de citron, pour aromatiser agréablement la liqueur par le moyen de l'oleo-saccharum, qu'on aura formé par cette manoeuvre.
Remarquez que cette maniere d'aromatiser la limonade est plus commode & meilleure que la méthode ordinaire & plus connue des limonadiers, qui consiste à y faire infuser quelques jets de citron, qui fournissent toujours un peu d'extrait amer & dur. (b)
|
| LIMONADIER | S. m. (Com.) marchand de liqueurs ; ils ont été érigés en corps de jurande en 1673 ; leurs statuts sont de 1676. Ils ont quatre jurés, dont deux changent tous les ans : les apprentifs sont brevetés pardevant notaire ; ils servent trois ans, & font chef d'oeuvre. Les fils de maîtres en sont exempts ; ils peuvent faire & vendre de l'eau-de-vie & autres liqueurs, en gros & en détail. Ils ne font maintenant qu'une communauté avec les caffetiers.
|
| LIMONEUX | adj. (Gramm. & Agricult.) On dit d'une terre qui a été couverte autrefois des eaux d'une riviere, qu'elle est limoneuse ; d'un lieu abreuvé d'eaux croupissantes, dont la terre est détrempée, qu'il est limoneux ; des eaux & du fond d'une riviere, qu'ils sont limoneux.
|
| LIMONIADE | (Mythol.) Limonias ; les Limoniades étoient les nymphes des prés, du mot grec , un pré ; ces nymphes étoient sujettes à la mort, comme les Pans & les Faunes. (D.J.)
|
| LIMONIATES | (Hist. nat.) nom dont Pline s'est servi pour désigner une espece d'émeraude.
|
| LIMONIER | S. m. (Hist. nat. Bot.) limon, genre de plante dont les feuilles & les fleurs ressemblent à celles du citronnier, mais dont le fruit a la forme d'un oeuf & la chair moins épaisse ; il est divisé en plusieurs loges qui sont remplies de suc & de vésicules, & qui renferme des semences. Ajoûtez à ces caracteres le port du limonier qui suffit aux jardiniers pour le distinguer de l'oranger & du citronnier. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIMONIER, limon, arbre toujours verd, de moyenne grandeur, qui vient de lui-même dans les grandes Indes, & dans l'Amérique méridionale. Dans ces pays, cet arbre s'éleve à environ trente piés, sur trois ou quatre de circonférence. Il est toujours tortu, noueux, branchu & très-mal-fait, à moins qu'il ne soit dirigé dans sa jeunesse. Son écorce est brune, seche, ferme & unie. Ses feuilles sont grandes, longues & pointues, sans aucun talon ou appendice au bas. Elles sont fermes, lisses & unies, d'un verd tendre & jaunâtre très brillant. L'arbre donne pendant l'été des fleurs blanches en dedans, purpurines en dehors ; elles sont rassemblées en bouquets, & plus grandes que celles des orangers & des citronniers. Le fruit que produit la fleur est oblong, terminé en pointe, & assez semblable pour la forme & la grosseur à celui du citronnier ; si ce n'est qu'il a des verrucités ou proéminences qui le rendent plus ou moins informe. Sous une écorce jaune, moëlleuse & épaisse, ce fruit est divisé en plusieurs cellules, rempli d'un suc aigre ou doux, selon la qualité des especes ; & ces cavités contiennent aussi la semence qui doit multiplier l'arbre. C'est principalement par la forme irréguliere de son fruit qu'on distingue le limonier du citronnier ; & on fait la distinction de l'un & de l'autre d'avec l'oranger, par leurs feuilles qui n'ont point de talon ou d'appendice. Cet arbre est à-peu-près de la nature des orangers, mais son accroissement est plus promt, ses fruits viennent plus tôt à maturité ; il est un peu plus robuste, & il lui faut des arrosemens plus abondans. La feuille, la fleur, le fruit, & toutes les parties de cet arbre ont une odeur aromatique très-agréable.
Les bonnes especes de limons se multiplient par la greffe en écusson, ou en approche sur les limons venus de graine, ou sur le citronnier ; mais ces greffes viennent difficilement sur des sujets d'oranger. A cet égard le citronnier est encore ce qu'il y a de mieux, parce qu'il croît plus vîte que le limonier, & cette force de seve facilite la reprise des écussons, & les fait pousser vigoureusement. Il faut à cet arbre même culture & mêmes soins qu'aux orangers : ainsi, pour éviter les répétitions, voyez ORANGER.
Les especes de limons les plus remarquables sont ;
Le limon aigre & le limon doux : ce sont les especes les plus communes.
Le limonier à feuilles dorées, & celui à feuilles argentées. Ces deux variétés sont délicates ; il leur faut quelques soins de plus qu'aux autres pour empêcher leurs feuilles de tomber.
Le limon en forme de poire ; c'est l'espece la plus rare.
Le limon impérial ; ce fruit est très-gros, très-beau, & d'une agréable odeur.
La pomme d'Adam. Cette espece étant plus délicate que les autres, demande aussi plus de soin pendant l'hiver, autrement son fruit seroit sujet à tomber dans cette saison.
Le limonier sauvage. Cet arbre est épineux ; ses feuilles sont d'un verd foncé, & joliment découpées sur ses bords.
Le limon sillonné. Ce fruit n'est pas si bon, & n'a pas tant de suc que le limon commun.
Le limon double. Cette espece est plus curieuse que bonne : ce sont deux fruits réunis, dont l'un sort de l'autre.
La lime aigre & la lime douce, sont deux especes rares & délicates, auxquelles il faut de grands soins pendant l'hiver, si on veut leur faire porter du fruit.
Le limonier à fleur double. Cette production n'est pas bien constante dans cet arbre ; il porte souvent autant de fleurs simples que de fleurs doubles.
Si l'on veut avoir de plus amples connoissances de ces especes de limons, ainsi que de beaucoup d'autres variétés que l'on cultive en Italie, on peut consulter les hespérides de Ferrarius, qui a traité complete ment de ces sortes d'arbres. Article d e M. D'AUBENTON.
LIMONIER, (Maréchallerie) on appelle ainsi un cheval de voiture attelé entre deux limons. Voyez LIMON.
|
| LIMONIUM | S. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en oeillet, composée ordinairement de plusieurs pétales qui sortent d'un calice fait en forme d'entonnoir. Il sort du calice un pistil qui devient dans la suite une semence oblongue, enveloppée d'un calice ou d'une capsule. Il y a des especes de ce genre, dont les fleurs sont monopétales, en forme d'entonnoir & découpées. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LIMOSINAGE | S. m. (Maçon.) c'est toute maçonnerie faite de moilons brutes à bain de mortier, c'est-à-dire en plein mortier, & dressée au cordeau avec paremens brutes, à laquelle les Limosins travaillent ordinairement dans les fondations : on appelle aussi cette sorte d'ouvrage, limosinerie.
|
| LIMOURS | (Géog.) petite ville de France dans le Hurepoix, au diocèse de Paris, à 8 lieues S. O. de Paris. Long. 20. 3. lat. 48. 31.
|
| LIMOUSIN | S. m. ou le LIMOSIN, (Géog.) en latin Lemovicia ; province de France, bornée nord par la Manche & par l'Auvergne, sud par le Quercy, ouest par le Périgord.
Ce pays & sa capitale tirent leurs noms du peuple Lemovices, qui étoient les plus vaillans d'entre les Celtes du tems de César, ayant soutenu opiniâtrement le parti de Vercengétorix. Auguste, dans la division qu'il fit de la Gaule, les attribua à l'Aquitaine. Présentement le Limousin se divise en haut & bas ; le climat du haut est froid, parce qu'il est montueux ; mais le bas Limousin est fort tempéré, & donne de bons vins : dans quelques endroits, le pays est couvert de forêts de chataigniers. Il a des mines de plomb, de cuivre, d'étain, d'acier & de fer ; mais son principal commerce consiste en bestiaux & en chevaux. Il y a trois grands fiefs titrés dans cette province ; le vicomté de Turenne, le duché-pairie de Ventadour & le duché-pairie de Noailles. Tout le Limousin est régi par le Droit écrit, le Droit romain, & est du ressort du parlement de Bordeaux.
C'est ici le lieu de dire un mot d'un pape Grégoire XI. & de quatre hommes de lettres ; Martial d'Auvergne, Jean d'Aurat, Jacques Merlin, & Pierre de Montmaur, nés tous cinq en Limousin, mais dans des endroits obscurs ou ignorés. Martial d'Auvergne, procureur au parlement de Paris, sur la fin du XV. siecle s'est fait connoître par ses arrêts d'amour, imprimés de nos jours très-joliment en Hollande in-8°. avec des commentaires ingénieux.
D'Aurat, en latin Auratus, servit dans ce royaume au rétablissement des lettres grecques sous François I. A l'âge de 72 ans il se remaria avec une jeune fille de 20 ans, & dit plaisamment à ses amis qu'il falloit lui permettre cette faute comme une licence poétique. Il eut un fils de ce mariage, & mourut la même année, en 1588.
Merlin fleurissoit aussi sous le même prince. L'on trouve de l'exactitude & de la sincérité dans sa collection des conciles, & il a l'honneur d'y avoir songé le premier. Il publia les oeuvres d'Origène, avec l'apologie complete de ce pere de l'Eglise, qui n'est pas une besogne aisée ; il mourut en 1541.
Montmaur, professeur en langue grecque à Paris, au commencement du siecle passé, mourut en 1648. On ignore pourquoi tous les meilleurs poëtes & les meilleurs esprits du tems conspirerent contre lui, sans qu'il y ait donné lieu par aucun écrit satyrique, ou par un mauvais caractere. Il ne paroît même pas qu'il fût méprisable, du-moins du côté de l'esprit, car il savoit faire dans l'occasion des reparties très-spirituelles. On raconte qu'un jour chez le président de Mesmes, il se forma contre lui une grande cabale, soutenue par un avocat fils d'un huissier. Dès que Montmaur parut, cet avocat lui cria, guerre, guerre. Vous dégénerez bien, lui dit Montmaur, car votre pere ne fait que crier paix-là, paix-là : ce coup de foudre accabla le chef des conjurés. Une autre fois que Montmaur dînoit chez le chancelier Seguier, on laissa tomber sur lui un plat de potage en desservant. Il sut se posséder à merveille, & dit en regardant le chancelier, qu'il soupçonna d'être l'auteur de cette piece ; summum jus, summa injuria ; cette promte allusion qu'on ne peut rendre en françois est des plus ingénieuses. Enfin les raisons de la conspiration générale contre le malheureux Montmaur, ne sont pas parvenues jusqu'à nous.
Le pape Grégoire XI. limousin comme lui, n'avoit pas autant d'esprit & d'érudition. " On sait les ressorts ridicules qu'employerent les Florentins pour lui persuader de quitter Avignon, & de venir résider à Rome. Ils lui députerent sainte Catherine de Sienne, qui prétendoit avoir épousé J. C. & ils y joignirent les révélations de sainte Brigite, à laquelle un ange dicta plusieurs lettres pour le pontife. Il céda & transfera le saint siége d'Avignon à Rome au bout de 72 ans ; mais ce ne fut pas sans plonger l'Europe dans de nouvelles dissensions, dont il ne fut pas le témoin ; car il mourut l'année suivante 1378. Essai sur l'Histoire générale, tome II. " (D.J.)
|
| LIMPIDE | adj. LIMPIDITé, s. f. (Gram.) ils ne se disent guere que des fluides : ils en marquent la clarté, la pureté, & l'extrême transparence, Voyez TRANSPARENT.
|
| LIMPOURG | ou LIMPURG, Limpurgum, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans la Wétéravie, autrefois libre & impériale, mais depuis sujette à l'électeur de Trèves. Elle est entre Wetzlar & Nassau, à trois milles germaniques de cette derniere. Long. 25. 48. lat. 58. 18. (D.J.)
|
| LIMUS | S. m. (Hist. anc.) espece d'habillement, tel que les victimaires en étoient revêtus dans les sacrifices. Il prenoit au nombril, & descendoit sur les piés, laissant le reste du corps nud. Il étoit bordé par en bas d'une frange de pourpre en falbalas. Limus signifie oblique. Il y avoit des domestiques qu'on appelloit limocincti, de leur habit & de leur ceinture.
|
| LIMYRE | Lymira, (Géog. anc.) ville d'Asie dans la Lycie, située sur les bords d'une riviere du même nom. Limyre, est bien connue dans l'histoire, parce que ce fut dans cette ville, dit Velleius Paterculus, liv. II. chap. cij. que mourut de maladie, l'an 757 de Rome, Caius César, fils d'Agrippa & de Julie, la seule héritiere du nom des Césars. La naissance de ce prince, célébrée dans tout l'empire par des réjouissances publiques en 734, donnoit à Auguste un petit-fils qui pouvoit le consoler de la perte de Marcellus ; mais pour le malheur de l'empereur, Caius n'eut pas une plus heureuse destinée. (D.J.)
|
| LIN | linum, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en oeillet ; elle a plusieurs pétales disposées en rond, qui sortent d'un calice composé de plusieurs feuilles, & ressemblant en quelque sorte à un tuyau ; il sort aussi de ce calice un pistil qui devient ensuite un fruit presque rond, terminé pour l'ordinaire en pointes & composé de plusieurs capsules ; elles s'ouvrent du côté du centre du fruit, & elles renferment une semence applatie presqu'ovale, plus pointue par un bout que par l'autre. Tournefort. Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIN, (Botan.) Des 31 especes de lin que distingue Tournefort, nous ne considérons que la plus commune, le lin ordinaire qu'on seme dans les champs, & qui est nommé par les Botanistes, linum sativum, vulgare, caeruleum, en Anglois manur'd-flax.
Sa racine est fort menue, garnie de peu de fibres ; sa tige est cylindrique, simple le plus souvent, creuse, grêle, lisse, haute d'une coudée ou d'une coudée & demie, branchue vers le sommet. Cette tige est revêtue d'une écorce rude ; on a découvert en la battant, qu'elle est composée d'un grand nombre de fils très-déliés. Ses feuilles sont pointues, larges de deux ou trois lignes, longues d'environ deux pouces, placées alternativement, ou plutôt sans ordre sur la tige, molles, lisses. Ses fleurs sont jolies, petites, peu durables, & d'un beau bleu. Elles naissent au sommet des tiges, portées sur des pédicules grêles, assez longs. Elles sont disposées en oeillet, composées chacune de cinq pétales, arrondis à leur bord, & rayés. Leur calice est d'une seule piece en forme de tuyau, découpé en cinq parties.
Le pistil qui s'éleve du fond du calice, devient un fruit de la grosseur d'un pois chiche, presque sphérique, & terminé en pointe. Ce fruit est composé de plusieurs capsules en dedans qui s'ouvrent du côté du centre ; elles sont remplies de graines applaties, presqu' ovalaires, obtuses d'un côté, pointues de l'autre, lisses, luisantes, & d'une couleur fauve, tirant sur le pourpre.
On seme le lin dans les champs ; il fleurit au mois de Juin. Sa graine seule produit un trafic considérable, indépendamment de son emploi en Médecine ; mais la culture de la plante est bien précieuse à d'autres égards. De sa petite graine, il s'éleve un tuyau grêle & menu, qui étant brisé, se réduit en filamens, & acquiert par la préparation la mollesse de la laine. On la file ensuite pour la couture, les points ou les dentelles. Enfin, on en fait la toile & le papier qui sont d'un usage immense, & qu'on ne sauroit assez admirer. Voyez donc LIN, (Agriculture) (D.J.)
LIN SAUVAGE PURGATIF, (Botan.) il est appellé linum catharticum, ou linum sylvestre catharticum, par la plûpart des botanistes, linum pratense, flosculis exiguis, par C. B. P. 214, & par Tournefort I. R. H. 340 ; en anglois purging flax.
Sa racine est menue, blanche, ligneuse, garnie de quelques fibrilles. Ces tiges sont fort grêles, un peu couchées sur terre, mais bientôt après elles s'élevent à la hauteur d'une palme & plus. Elles sont cylindriques, rougeâtres, branchues à leur sommet, & panchées. Ses feuilles inférieures sont arrondies & terminées par une pointe mousse ; celles du milieu & du haut des tiges, sont opposées deux à deux, nombreuses, petites, longues d'un demi-pouce, larges de deux ou trois lignes, lisses & sans queue. Ses fleurs sont portées sur de longs pédicules ; elles sont blanches, en oeillets, à cinq pétales, pointus & entiers. Elles sont garnies de cinq étamines jaunes, renfermées dans un calice à cinq feuilles. Les capsules séminales qui succedent à la fleur sont petites, cannelées, & contiennent une graine luisante, applatie, oblongue, semblable à celle du lin ordinaire, mais plus menue.
Le lin sauvage croît aux lieux élevés, secs, comme aussi dans les champs parmi les avoines, & fleurit en Juin & Juillet.
Cette plante paroît contenir un sel essentiel tartareux, vitriolique, uni à une grande quantité d'huile fétide. Elle est d'un goût amer, desagréable, & qui excite des nausées. On en fait peu d'usage, parce qu'elle purge violemment, & presque aussi fortement que la gratiole. Le médecin qui s'en serviroit pour l'hydropisie, ne doit jamais la donner que dans les commencemens du mal, & à des corps très-robustes. (D.J.)
LIN INCOMBUSTIBLE, (Hist. nat.) c'est un des noms de l'amiante. Voyez AMIANTE.
Vous trouverez dans cet article les observations les plus vraies & les plus importantes sur cette substance minérale.
Sa nature est très-compacte & très-cotonneuse. Toutes ses parties sont disposées en fibres luisantes, & d'un cendré argentin, très-déliées, arrangées en lignes perpendiculaires, unies par une matiere terreuse, capables d'en être séparées dans l'eau & de résister à l'action du feu.
Cette matiere minérale est un genre de fossile très-abondant. Du tems de Pline on ne l'avoit encore découvert qu'en Egypte, dans les deserts de Judée, dans l'Eubée près de la ville de Corinthe, & dans l'île de Candie, pays dont le lin portoit les noms. Nos modernes en ont aujourd'hui trouvé dans toutes les îles de l'Archipel, en divers endroits de l'Italie, sur-tout aux montagnes de Volterre, en Espagne dans les Pyrénées, dans l'état de Gènes, dans l'île de Corse, en France dans le comté de Foix, à Namur dans les pays-bas, en Baviere, en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, &c. Il faut avouer aussi que toutes ces nouvelles découvertes ne nous fournissent guere que des especes d'amiante de rebut, dont on ne sauroit tirer parti dans les Arts.
La maniere de filer cette matiere minérale, est la seule chose qui touche notre curiosité. Quoiqu'elle ait été pratiquée par les anciens orientaux, le secret n'en étoit pas connu des Romains, puisqu'au rapport de Pline, la valeur de l'asbeste filé égaloit le prix des perles les plus cheres ; & que du tems de Néron, on regardoit avec admiration, & comme un trésor, une serviette de cette toile que cet empereur possédoit.
Les Grecs n'ont pas été plus éclairés sur l'art de filer l'asbeste ; car à l'exception de Strabon qui n'en dit que deux mots, aucun de leurs auteurs ne l'a décrite : cependant puisque Pline a vu de ses yeux des nappes de lin vif que l'on jettoit au feu pour les nettoyer lorsqu'elles étoient sales ; il en résulte qu'on avoit quelque part le secret d'en faire des toiles ; & les ouvrages tissus de ce fil, qui ont paru de siecle en siecle, prouvent que ce secret ne s'est pas perdu, & qu'il se trouve du lin incombustible propre à cette manufacture.
En effet, l'histoire moderne nous apprend que Charles-Quint avoit plusieurs serviettes de ce lin, avec lesquelles il donnoit le divertissement aux princes de sa cour, lorsqu'il les régaloit, d'engraisser & de salir ces sortes de serviettes, de les jetter au feu, & de les en retirer nettes & entieres. L'on a vu depuis à Rome, à Venise, à Londres & en d'autres villes, divers particuliers prendre ce plaisir à moins de frais que cet empereur. On a présenté à la société royale un mouchoir de lin vif, qui avoit un demi-pié de long sur demi pié de large ; mais on n'indiqua point l'art du procédé, ni d'où l'on avoit tiré le fossile.
Enfin, Ciampini (Jean Justin) né à Rome en 1633, & mort dans la même ville en 1698, a la gloire de nous avoir appris le premier, en 1691, le secret de filer le lin incombustible, & d'en faire de la toile. Le lecteur trouvera le précis de sa méthode au mot AMIANTE ; mais il faut ici transcrire la maniere dont M. Mahudel l'a perfectionné, parce que les objets qui concernent les Arts sont particulierement du ressort de ce Dictionnaire.
Choisissez bien, dit ce savant, Mém. de littér. tom. VI, édit. in-12. l'espece de lin incombustible, dont les fils soient longs & soyeux. Fendez votre minéral délicatement en plusieurs morceaux avec un marteau tranchant. Jettez ces morceaux dans de l'eau chaude. Amman veut qu'on les fasse infuser dans une lessive préparée avec des cendres de chêne pourri, & des cendres gravelées, & qu'on les laisse ensuite macérer environ un mois dans l'eau douce. M. Mahudel prétend que l'eau chaude suffit en y laissant les morceaux d'asbête pendant un tems proportionné à la dureté de leurs parties terreuses : remuez-les ensuite, dit-il, plusieurs fois dans l'eau & divisez-les avec les doigts en plus de parcelles fibreuses que vous pourrez, ensorte qu'elles se trouvent insensiblement dépouillées de l'espece de chaux qui les tenoit unies ; cette chaux se détrempant dans l'eau, blanchit l'amiante & l'épaissit. Changez l'eau cinq ou six fois, & jusqu'à ce que vous connoissiez par sa clarté que les fils seront suffisamment rouis.
Après cette lotion, étendez-les sur une claie de jonc pour en faire égoutter l'eau : exposez les au soleil ; & lorsqu'ils seront bien secs, arrangez-les sur deux cardes à dents fort fines, semblables à celles des cardeurs de laine. Séparez-les tous en les cardant doucement, & ramassez la filasse qui est ainsi préparée ; alors ajustez-la entre les deux cardes que vous coucherez sur une table, où elles vous tiendront lieu de quenouille, parce que c'est des extrêmités de ces cardes que vous tirerez les fils qui se présenteront.
Ayez sur cette table une bobine pleine de lin ordinaire filé très-fin, dont vous tirerez un fil en même tems que vous en tirez deux ou trois d'amiante ; & avec un fuseau assujetti par un peson, vous unirez tous ces fils ensemble, ensorte que ce fil de lin commun soit couvert de ceux d'asbeste, qui par ce moyen ne feront qu'un même corps.
Pour faciliter la filure, on aura de l'huile d'olive dans un mouilloir, où l'on puisse de tems-en-tems tremper le doigt, autant pour les garantir de la corrosion de l'asbeste que pour donner plus de souplesse à ces fils.
Dès qu'on est ainsi parvenu à la maniere d'en allonger le continu, il est aisé en les multipliant ou en les entrelaçant, d'en former les tissus plus ou moins fins, dont on tirera, en les jettant au feu, l'huile & les fils de lin étrangers qui y sont entrés.
On fait actuellement aux Pyrenées des cordons, des jarretieres & des ceintures avec ce fil, qui sont des preuves de la possibilité de les mettre en oeuvre. Il est certain qu'avec un peu plus de soins que n'y donnent les habitans de ces montagnes, & avec de l'asbeste choisie, il s'en feroit des ouvrages très-délicats.
Cependant, quand on pourroit en façonner de ces toiles si vantées par les anciens, de plus belles mêmes que les leurs, & en plus grande quantité, il sera toujours vrai de dire que par la friabilité du minéral dont elles tirent leur origine, elles ne pourront être de durée au service, & n'auront jamais qu'un usage de pure curiosité.
Les engraisser & les salir pour avoir le plaisir de les retirer du feu nettes & entieres, c'est à quoi se rapporte presque tout ce qu'en ont vu les auteurs qui ont écrit avant & après Pline.
L'usage des chemises, ou des sacs de toile d'amiante, employés au brûlement des morts, pour séparer leurs cendres de celles des autres matieres combustibles, seroit un point plus intéressant pour l'histoire romaine, s'il étoit bien prouvé. Mais Pline, liv. XIII. chap. j. dit que cette coutume funéraire ne s'observoit qu'à l'égard des rois.
Un autre usage du lin d'asbeste étoit d'en former des meches perpétuelles, qui avoient la propriété d'éclairer toûjours, sans aucune déperdition de leur substance, & sans qu'il fût besoin de les moucher, quelque grande que pût être la quantité d'huile qu'on vouloit qu'elles consumassent. On s'en servoit dans les temples pour les lampes consacrées aux dieux. Louis Vives, espagnol, qui vivoit au commencement du quinzieme siecle, dit avoir vû employer de ces mêches à Paris. Il est singulier que cet usage commode, & fondé sur une expérience certaine, ne subsiste plus.
M. Mahudel assure avoir observé que les filamens de lin incombustible, sans avoir été même dépouillés par la lotion des parties terreuses qui les unissent, étant mis dans un vase plein de quelque huile ou graisse que l'on voudra, éclairent tant que dure la substance oléagineuse.
Les Transactions philosophiques, Juin 1685, parlent d'un autre moyen d'employer le lin incombustible. On en peut fabriquer un papier assez bien nommé perpétuel, parce que toutes les fois qu'on a écrit dessus, on en efface l'écriture en le jettant au feu, où il n'est pas plus endommagé que la toile de ce minéral. On dit que l'on conserve une feuille de ce papier dans le cabinet du roi de Danemarck ; & Charleton témoigne que de son tems on fabriquoit de ce papier près d'Oxford.
Quant aux vertus médicinales attribuées au lin incombustible, il faut toutes les reléguer au nombre des chimeres. Il est si peu propre, par exemple, à guerir la gale, étant appliqué extérieurement en forme d'onguent, qu'il excite au contraire des démangeaisons à la peau. Bruckmann a réfuté plusieurs autres fables semblables, dans son ouvrage latin intitulé Historia naturalis lapidis, , Brunsvig, 1727, in-4°. j'y renvoye les curieux, & je remarque en finissant, que l'asbeste est le seul lin incombustible dont on peut faire des toiles & du papier ; ses mines ne sont pas communes ; celles de l'amiante le sont beaucoup ; mais comme ses fils sont courts & se brisent, on n'en peut tirer aucun parti. (D.J.)
* LIN, Culture du lin, (Econom. rustiq.) du choix de la graine de lin. On la fait venir communément de l'île de Casan. On la nomme graine de Riga ou de tonneau. C'est la plus chere, & elle est estimée la meilleure. Mais celle du pays, quand elle est belle, ne se distinguant pas facilement de celle de Riga, les commissionnaires l'enferment dans des tonneaux semblables, & la vendent pour telle. Elle n'est pas mauvaise, mais il faut avoir l'attention de la laisser reposer, ou de la semer dans un terrein distant de quelques lieues de celui où elle aura été recueillie.
Pour se mettre à couvert de l'inconvénient d'être trompé dans l'achat de la graine, il y a des gens qui prennent le parti de conserver la leur, quand elle est épuisée, c'est-à-dire lorsqu'elle a été semée trois ou quatre fois de suite au même lieu, & de la garder un ou deux ans dans des sacs, bien mêlée de paille hachée. Elle reprend vigueur, ou plutôt elle devient par l'interruption, propre au terrein où l'on en a semé d'autre, & on l'emploie avec succès.
Des qualités que doit avoir la graine pour être bonne. Il faut qu'elle soit pesante & luisante. On observe, quand on l'achete, que le marché sera nul, si elle ne germe pas bien ; & pour en faire l'essai, on en seme une poignée, quelque tems avant la semaille.
Quel est son prix. Elle n'a point de prix fixe. On distingue la nouvelle de la vieille. Au tems où l'on nous a communiqué ce mémoire, c'est-à-dire, lorsque nous commençâmes cet ouvrage, que tant de causes iniques ont suspendu, la nouvelle valoit année commune, vingt francs la raziere. Elle n'est pas moins bonne, lorsqu'elle a produit une ou deux fois. La troisieme année elle diminue de moitié ; la quatrieme, on la porte au moulin pour en exprimer l'huile. Alors son prix est réduit à six livres, bon an, mal an.
La raziere est une mesure qui doit contenir à peu près, cent livres, poids de marc, de graine bien seche.
Ce qu'il faut de graine pour semer une mesure de terre, dont la grandeur sera déterminée ci-après, relativement à la toise de Paris. Un avot fait le quart d'une raziere sur un cent de terre. Le cent de terre contient cent verges quarrées, ou dix mille piés de onze pouces, la verge étant de dix piés ; ou neuf mille cent soixante-six, & huit pouces de roi ; ou deux cent cinquante-quatre toises, trois piés, neuf pouces & quatre lignes. Cette mesure est la seizieme partie d'un bonier, & le bonier est par conséquent de quatre mille soixante & quatorze toises, cinq pouces, quatre lignes. Mais l'arpent est de neuf cent toises ; il faut donc pour l'équivalent d'un bonier, quatre arpens & demi, vingt-quatre toises, cinq pouces & quatre lignes. Voilà la mesure sur laquelle tout est fixé dans cet article. Elle ne s'accorde pas avec celle du colsat, où l'on a fait usage de celle de Paris. Il y a ici plus d'exactitude.
De la nature de la terre propre au lin. Il n'y faut point de pierres ; la plus pesante est la meilleure, sur-tout si sa couleur est noire, si elle est mêlée de sable, comme à Saint-Amand & aux environs, où les lins sont très-hauts & très-fins, & sont employés en dentelles & en toiles de prix. Dans la châtellenie de Lille, d'où ce mémoire vient, la hauteur ordinaire des lins est depuis six paumes jusqu'à douze au plus. Il y a peu d'endroits où il monte davantage. On seroit content, si l'on avoit la bonne qualité, l'abondance & la hauteur de huit paumes.
De la préparation de la terre. Il faut la bien fumer avant l'hiver. Quatre charretées de fumier suffisent pour l'étendue que nous avons déterminée. Chaque charretée doit peser environ quatorze cent, poids de marc. On laboure après avoir fumé.
Lorsque le tems de semer approche, on donne un second labour, sur-tout si la terre ne se manie pas assez facilement pour qu'il suffise d'y faire passer deux ou trois fois la herse, afin de l'ameublir convenablement ; on l'applanit ensuite au cylindre. On ne peut l'aplanir trop bien. On seme. On repasse la herse. La semence est couverte. Un dernier tour de cylindre acheve de l'affermir en terre.
Il y en a qui emploient à la préparation de la terre de la fiente de pigeon en poudre, mais elle brûle le lin, lorsque l'année est seche. D'autres jettent cette fiente dans le pureau des vaches, & arrosent la terre préparée de ce mêlange, ou même le répandent sur le terrein avant le premier labour, afin qu'au printems la chaleur en soit éteinte. Ces deux cultures sont moins dangereuses, mais la derniere consomme beaucoup de matiere.
Du tems de la semaille. On seme à la fin de Mars ou au commencement du printems, selon le tems. Il ne le faut pas pluvieux. Plus tôt on seme, mieux on fait. Le lin ne grandit plus lorsque les chaleurs sont venues. C'est alors qu'il graine.
Du prix de la semaille. Un avot de graine, sur le pié de vingt francs la raziere, coutera cent sols ; les quatre charretées de fumier, douze francs ; un sac de fiente de pigeon, quatre livres ; deux labours, une livre, dix-sept sols, six deniers ; trois herses, au moins neuf sols ; trois cylindres, au moins neuf sols ; la semaille, une livre, trois sols. Tous ces prix peuvent avoir changé.
Faut-il faire à la terre quelque façon après la semaille ? Aucune.
Faut-il faire au lin quelque façon avant la recolte ? Pas d'autre que de sarcler. On sarcle quand il est monté de deux ou trois pouces. Pour ne le pas gâter, le sarcleur se déchausse. Ce travail est plus ou moins couteux, selon que la terre est plus ou moins sale. On en estime la dépense année commune, à trente-sept sols. S'il se peut achever à six personnes en un jour, c'est six sols deux deniers pour chacune.
Dans les cantons où le lin s'éleve à plus de dix ou douze paumes, on le soutient par des ramures ; mais il n'en est pas ici question.
Quel tems lui est le plus propre dans les différentes saisons. Il ne lui faut ni un tems trop froid, ni un tems trop chaud. S'il fait trop sec, il vient court ; trop humide, il verse. Les grandes chaleurs engendrent souvent de très-petites mouches ou pucerons, qui ravagent la pousse quand elle commence. Elle en est quelquefois toute noire. Il n'y a que la pluie qui secourt le lin contre cette vermine. La cendre jettée fait peu d'effet, & puis il en faudroit trop sur un grand espace. Les taupes & leurs longues tramées retournent le germe, & le rendent stérile. On les prend, & l'on raffermit avec le pié les endroits gâtés.
Du tems de la récolte. On la fait à la fin de Juin, lorsque le lin jaunit & que la feuille commence à tomber.
De la maniere de recueillir. On l'arrache par poignée. On le couche à terre comme le blé. On le releve vingt-quatre heures après, à moins qu'on ne soit hâté de le relever plus tôt, par la crainte de la pluie. Alors on dresse de grosses poignées les unes contre les autres, en forme de chevron ; de maniere que les têtes se touchent ou se croisent ; & que le vuide du bas forme une tente où l'air soit admis entre les brins. C'est là ce qu'on appelle mettre en chaîne. Le paysan dit qu'on les fait si longues qu'on veut ; mais il semble que les plus courtes recevront plus d'air par le bas.
Lorsqu'il est assez sec, on le met en bottes, que l'on range en lignes droites de front, sur l'épaisseur desquelles on couche d'un bout à l'autre, quatre autres bottes, afin que la graine soit couverte, & que le tout soit à l'abri de la pluie. Ces lignes se font aussi longues qu'on veut, par la raison contraire à la longueur des chaînes. Les bottes ont communément six paumes de tour.
Quand la graine est bien seche, on met le lin dans la grange ou le grenier, qu'il faut garantir soigneusement des souris. Elles aiment la graine que l'on bat, avant que de rouir. On remet le lin en bottes. On les lie bien serré en deux ou trois endroits sur la longueur. Ces bottes sont plus grosses du double que les précédentes ; c'est-à-dire qu'on en prend deux des précédentes, & qu'on les met l'une la tête au pié de l'autre qui a sa tête au pié de la premiere. Elles résistent mieux, & occupent moins d'espace. Deux bottes ainsi liées, s'appellent un bonjeau.
C'est ainsi qu'on les fait rouir. On a pour ce travail le choix de trois saisons, ou Mars, ou Mai, ou Septembre. Le mois de Mai n'est pas regardé comme le moins favorable.
Du rouir. Rouir, c'est coucher les bonjeaux les uns contre les autres dans une eau courante, & les retourner tous les jours à la même heure, jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que le lin est assez roui. Pour s'en assurer, on tire deux ou trois tiges, que l'on brise avec les mains ; quand la paille se détache bien, il est assez roui. Le rouir dure huit jours, plus ou moins, selon que l'eau est plus ou moins chaude.
Aussitôt qu'il est tiré du rouir, on va l'étendre fort épais sur une herbe courte ; là il blanchit. On le retourne avec une gaule au bout de trois ou quatre jours, & on le laisse trois ou quatre autres exposé. Quand il est sec & blanc, on le remet en bottes, & on le reporte au grenier. Alors les souris n'y font plus rien, & il ne dépérit pas. Lorsqu'il est à bas prix, ceux qui sont en état d'attendre, le peuvent sans danger.
Lorsqu'on ne se défait pas de son lin en bottes, il s'agit de l'écanguer.
Ecanguer le lin. Ecanguer le lin, c'est en séparer toute la paille, ou chenevotte, par le moyen d'une planche échancrée d'un côté à la hauteur de ceinture d'homme, & montée sur des piés. L'écangueur étend le lin par le milieu de la longueur, sur l'échancrure ; il le tient d'une main, de l'autre il frappe avec un écang de bois dans l'endroit ou le lin répond à l'échancrure ; par ce moyen il est brisé ; la paille tombe, & il ne reste que la soie. On travaille ainsi le lin sur toute sa longueur, passant successivement d'une portion écanguée à une portion qui ne l'est pas.
Après cette opération on le remet en bottes qui ont perdu de leur volume ; de cent bottes dépouillées par l'écangue, il en reste au plus une quarantaine du poids chacune de 3 liv. 1/4 ou de quatorze onces.
Du prix du travail précédent. Pour arracher & coucher, vingt-deux sols ; pour relever, six sols trois deniers ; pour botteler & mettre en chaîne, six sols trois deniers ; pour battre & rebotteler, trente sols ; pour rouir, vingt sols ; pour blanchir & renfermer, quarante sols ; pour écanguer & rebotteler, neuf francs.
Des bottes & des graines qu'on retire année commune du terrein donné ci-dessus. Il donnera cent bottes à la dépouille, comme il a été dit ci-dessus, & deux avots & demi de graine.
Du prix du lin. Cette appréciation n'est pas facile. Le prix varie sans cesse. Point de récolte plus incertaine. Elle manque des quatre, cinq, six années de suite. La dépense excede quelquefois le produit, parce qu'il péche en qualité & en quantité. Il arrive que pour ne pas tout perdre, après avoir fumé la terre & semé le lin, on sera obligé de labourer & de semer en avoine. Aussi beaucoup de gens se rebutent-ils de la culture du lin.
On vend le lin de trois manieres différentes ; ou sur la terre, avec ou sans la graine, que le vendeur se reserve ; ou après avoir été recueilli, avec ou sans la graine ; ou après avoir été écangué. Dans le premier cas, on en tirera trente livres avec la graine, ou vingt-cinq sans la graine ; dans le second, trente-cinq livres avec la graine, ou trente livres sans la graine ; dans le troisieme, soixante livres.
Dépense du lin sur terre jusqu'à ce qu'il soit en état d'être vendu.
On sera peut-être surpris de voir le produit augmenté de cent sols depuis la recolte, la dépense ne l'étant que de trente-quatre sols six deniers. Cet accroissement n'est pas trop fort, relativement au danger que court celui qui dépouille ; car les grandes pluies qui noircissent le lin, malgré toutes les précautions, avant qu'il soit renfermé, peuvent le rabaisser considérablement. Il en est de même du péril du roui & du blanchissage. Il faut encore ajoûter à cela le loyer, la dixme, les impositions, le ravage de la guerre fréquente en Flandres, les rentes seigneuriales dont les terres sont chargées, l'entretien du ménage, &c.
Ce qui soutient l'agriculteur, c'est l'espérance d'une bonne année qui le dédommagera ; & puis il met en lin & en colsat, sa terre qui repose, aulieu de la laisser en jachere.
Il faut savoir que la même terre ne porte lin qu'une fois tous les cinq à six ans. On l'ensemence autrement dans l'intervalle ; on aime cependant à semer le lin sur une terre qui a porté du treffle, & le blé vient très-bien après le lin.
De la culture du lin. Les agriculteurs distinguent trois sortes de lins, le froid, le chaud, & le moyen entre les extrêmes.
Le lin chaud croît le premier. Il pousse fort d'abord & s'éleve beaucoup au-dessus des autres ; mais cette vigueur apparente ne dure pas ; il s'arrête & reste au-dessous des autres. Il a d'ailleurs un autre défaut considérable, c'est d'abonder en graine, & par conséquent en têtes ; or ces têtes naissent quelquefois de fort bas ; quand on travaille le lin, elles cassent, se détachent, & le lin déjà court, se raccourcit encore.
Le lin froid croît au contraire fort lentement d'abord. On en voit qui six semaines & plus après avoir été semé, n'a pas la hauteur de deux doigts ; mais il devient vigoureux & finit par s'élever audessus des autres ; il porte peu de graines ; il a peu de branches ; il ne se raccourcit pas autant que le chaud ; en un mot ses qualités sont aussi bonnes que celles du lin chaud sont mauvaises.
Le lin moyen participe de la nature du froid & du chaud. Il ne croît pas si vîte que le lin chaud ; il porte moins de graine ; il s'éleve davantage. Quant à la maturité, le lin chaud murit le premier, le moyen ensuite, le froid le dernier.
Ces especes de lins sont très-mêlées ; mais ne pourroit-on pas les séparer ? On ne fait pour avoir la graine du lin froid, que de l'acheter en tonnes de linuise de Riga en Livonie. On en trouve à Coutras, à Saint-Amant, à Valenciennes, &c. mais on peut être trompé.
La linuise de Riga est la meilleure. Le lin froid se défend mieux contre la gelée que toutes les autres especes. Mais comme la linuise n'est jamais parfaite, il vient à la récolte des plantes d'autres sortes de lins ; le mêlange s'accroît à chaque semaille, les lins chauds produisant plus de grains que les lins froids, & l'on est forcé de revenir à l'achat de nouvelle linuise tous les trois ou quatre ans.
La linuise de Riga est mêlée d'une petite semence rousse & oblongue avec quelques brins de lin & un peu de la terre du pays. On la reconnoît à cela. Mais comme il faut purger la linuise de ces ordures, il arrive aussi que les marchands les gardent, & s'en servent pour tromper plus surement, en les mêlant à de la linuise du pays. Il n'y a aucun caractere qui spécifie une linuise du pays d'une linuise de Riga.
On considere dans le lin la longueur, la finesse & la force. Pour avoir la longueur, il ne suffit pas de s'être pourvû de bonne graine, il faut l'avoir semée en bonne terre & bien meuble, qui seche facilement après l'hiver, & qui soit de grand jet ; c'est-à-dire, qui pousse toutes les plantes qu'on y seme avant l'hiver ; on aura par ce moyen de la longueur. Mais il faut savoir si l'on veut ou si l'on ne veut pas le ramer. Dans ce dernier cas, on peut s'en tenir à une terre qui ait porté du blé, de l'avoine ou du treffle dans l'année ; labourer ou fumer modérément avant l'hiver. Dans le dernier, les frais seront considérables ; il faut pour s'assurer du succès, choisir une terre en jachere, la bien cultiver pendant l'été, fumer extraordinairement, & laisser passer l'hiver sur un labour fait dans le mois d'Août. Par ce moyen elle se disposera beaucoup mieux au printems vers le 20 de Mars. Si la terre est assez seche pour pouvoir être bien labourée, hersée & ameublie, on y travaillera, & l'on semera. Plus tôt on semera, mieux on fera, plus le lin aura de force. Il faut si bien choisir son tems, que l'on n'essuie pas de grandes pluies pendant ce travail, la terre en seroit gâtée & le travail retardé.
Un des moyens les plus surs, est de semer en même tems que le lin la fiente de pigeon bien pulvérisée, de herser immédiatement après, & de resserrer la graine avec un bon rouleau bien lourd. On prépare, ou plutôt on tue toutes les mauvaises graines contenues dans la fiente de pigeon, en l'arrosant d'eau, ce qui l'échauffe. Quand on juge que l'espece de fermentation occasionnée par l'eau a tué les graines de la fiente, & éteint sa chaleur propre, on la fait sécher & on la bat.
On obtient la finesse du lin en le semant dru. En semant jusqu'à deux avots de linuise, mesure de l'Isle, sur chaque cent de terre, contenant cent verges quarrées, de dix piés la verge, on s'en est fort bien trouvé : d'autres se réduisent à une moindre quantité. Il s'agit ici de lins ramés. Un avot de semaille pour les autres lins, suffit par cent de terre.
Aussi-tôt que le lin peut être sarclé, il faut y procéder. On ne pourra non plus le ramer trop tôt. Il seroit difficile d'expliquer cette opération. Il faut la voir faire, & si l'on n'a pas d'ouvriers qui s'y entendent, il faut en appeller des endroits où l'on rame.
Il ne faut jamais attendre pour recueillir que le lin soit mûr. En le cueillant, toûjours un peu verd, on l'étend derriere soi sur les ramures. On retourne quand il est sec d'un côté : ensuite on le range droit autour d'une perche fichée en terre. On l'y attache par le haut, même à plusieurs étages : quand il est assez sec, on le lie par bottes & on le serre.
Il faut sur-tout bien prendre garde qu'il ne soit mouillé, lorsque les petites feuilles commencent à secher ; s'il lui survient cet accident, il noircira comme de l'encre & sans remede. Lorsqu'il est assez sec pour être lié, sans qu'il y ait risque qu'il moisisse, on l'emporte, comme on a dit, & l'on fait secher la graine ; pour cet effet on dresse les bottes & l'on les tient exposées au soleil. Si le tems est fixé au beau, on les laisse dehors la nuit, sinon on les remet à sec.
Il ne faut pas sur-tout qu'il soit trop serré, ni trop tôt entassé, car il se gâteroit par le haut. On le visitera souvent dans les tems humides, principalement au commencement. On reconnoîtra la secheresse du lin à la siccité de sa graine.
Quand la graine est bien seche, il faudra battre la tige le plus tôt possible, pour se garantir du dégât des souris. On ne bat pas avec le fléau ; on a une piece de bois épaisse de deux pouces & demi à trois pouces, plus longue que large, emmanchée d'un gros bâton un peu recourbé ; c'est avec cet instrument qu'on écrase la tête du lin qu'on tient sous le pié, & qu'on frappe de la main. Ensuite on vanne la graine & l'on en fait de l'huile, ou on la garde, selon qu'elle est ou maigre ou pleine.
Il s'agit ensuite de le rouir. On commence par le bien arranger à mesure qu'on le bat. On le lie par grosses poignées qu'on attache par le haut avec du lin même. On range ensuite les poignées les unes sur les autres, les racines en dehors à chaque bout ; & quand on a formé une botte de six à sept piés de tour, on a deux bons liens dont on la serre à chaque extrêmité, après quoi on jette les bottes en grande eau ; & on les charge de bois, de maniere qu'elles soient arrêtées, pressées & toutes couvertes. Il faut que l'eau soit belle. Les eaux coulantes sont préférables aux croupissantes ; mais le rouir en est dur. Le point important est de le tirer à tems du rouir. Il faut avoir égard à la saison & aux circonstances, & même à l'usage auquel on destine le lin.
On choisit ordinairement pour rouir le lin, les mois ou de Mai ou de Septembre. Si les eaux sont froides, on l'y laisse plus long-tems. Si les eaux sont chaudes & le tems orageux, le rouir ira plus vîte. Il faut veiller à ceci avec attention. On attend communément que sa soie se détache bien du pié & qu'elle se leve facilement d'un bout à l'autre de la tige. Alors il faut se hâter de le retirer, le faire essuyer, l'étendre sur l'herbe courte, le secher, le retourner, & le lier.
Plus le lin a été roui, moins il a de force. Aussi s'il a été ramé & qu'on le destine à la malquinerie, il faut le retirer aussi-tôt qu'il se pourra tiller. Il ne peut être trop fort, pour le filer si fin, & pour soutenir les opérations par lesquelles il passera. Il faudra d'abord le mailler, c'est-à-dire, l'écraser à grands coups de mail. Le mail est une piece de bois emmanchée & pareille à celle qui sert à battre la linuise. On le brisera ensuite à grands coups d'une lame de bois, large de trois ou quatre pouces, plate & un peu aiguisée, comme on l'a pratiqué aux lins plus communs. On l'écorchera après cela, ou si l'on veut on le dégagera de sa paille avec trois couteaux, qu'on employera l'un après l'autre, & sur lesquels on le frottera jusqu'à ce que toute la paille soit enlevée. Les couteaux sont plus larges par le bout que vers le manche, où ils n'ont qu'environ dix lignes de large. Ils ne sont pas coupans ; le tranchant en est arrondi ; ils vont en augmentant de finesse, & le plus grossier sert le premier. Enfin le lin étant parfaitement nettoyé, on le pliera, & l'on le laissera plié jusqu'à ce qu'on veuille le mettre en ouvrage. Toutes ces opérations supposent des ouvriers attentifs & instruits.
Il y a beaucoup moins de façons aux lins non ramés, qu'on appelle gros lins : si on les passe aux couteaux, c'est seulement pour les polir un peu. On peut donc les rouir plus fort. Quand on les voudra filer, on se contentera de les séranner. Voyez comment on séranne à l'article CHANVRE.
Quant au filer des lins fins, on n'y procede qu'après les avoir passés ou refendus à la brosse ou peigne ; il faut que tous les brins en soient bien séparés, bien dégagés. On pousse cet affinage selon la qualité du lin & de l'ouvrage auquel on destine le fil.
Un arpent de terre d'un lin ramé fin & de trois à quatre piés de hauteur, vaut au-moins deux cent écus, argent comptant, vendu sur terre, tous frais & risques à la charge du marchand. Quand il n'est pas ramé, il faut qu'il soit beau pour être vendu la moitié de ce prix.
Au reste, il ne faut avoir égard à ces prix que relativement au tems où nous avons obtenu le mémoire, je veux dire, le commencement de cet ouvrage. Nous en avons déjà averti, & nous y revenons encore : tout peut avoir considérablement changé depuis.
On trouve dans les mémoires de l'académie de Suede, année 1746, une méthode pour préparer le lin d'une maniere qui le rende semblable à du coton ; & M. Palmquist, qui la propose, croit que par son moyen on pourroit se passer du coton. Voici le procédé qu'il indique : on prend une chaudiere de fer fondu ou de cuivre étamé ; on y met un peu d'eau de mer ; on répand sur le fond de la chaudiere parties égales de chaux & de cendres de bouleau ou d'aûne ; après avoir bien tamisé chacune de ces matieres, on étend par-dessus une couche de lin, qui couvrira tout le fond de la chaudiere ; on remettra pardessus assez de chaux & de cendres, pour que le lin en soit entierement couvert ; on fera une nouvelle couche de lin, & l'on continuera à faire de ces couches alternatives, jusqu'à ce que la chaudiere soit remplie à un pié près, pour que le tout puisse bouillonner. Alors on mettra la chaudiere sur le feu ; on y remettra de nouvelle eau de mer, & on fera bouillir le mêlange pendant dix heures, sans cependant qu'il seche ; c'est pourquoi on y remettra de nouvelle eau de mer à mesure qu'elle s'évaporera. Lorsque la cuisson sera achevée, on portera le lin ainsi préparé à la mer, où on le lavera dans un panier, & on le remuera avec un bâton de bois bien uni & bien lisse. Lorsque tout sera refroidi au point de pouvoir y toucher avec les mains, on savonnera ce lin doucement comme on fait pour laver le linge ordinaire, & on l'exposera à l'air pour se sécher, en observant de le mouiller & de le retourner souvent, sur-tout lorsque le tems est sec. On finira par bien laver ce lin ; on le battra, on le lavera de nouveau, & on le fera sécher. Alors on le cardera avec précaution, comme cela se pratique pour le coton, & ensuite on le mettra en presse entre deux planches, sur lesquelles on placera des pierres pesantes. Au bout de deux fois vingt-quatre heures ce lin sera propre à être envoyé comme du coton. Voyez les mémoires de l'académie de Suede, année 1746.
LIN, (Pharmacie & Mat. med.) la semence seule de cette plante est d'usage en Medecine : elle est composée d'une petite amande émulsive, & d'une écorce assez épaisse, qui contient une grande quantité de mucilage.
La graine de lin concassée ou réduite en farine & imbibée avec suffisante quantité d'eau, fournit un excellent cataplasme émollient & résolutif, dont on fait un usage fort fréquent dans les tumeurs inflammatoires.
On fait entrer aussi cette graine à la dose d'une pincée, dans les décoctions pour les lavemens, contre les tranchées, la dyssenterie, le tenesme, & les maladies du bas-ventre & de la vessie.
On s'en sert aussi, quoique plus rarement, pour l'usage intérieur : on l'ajoûte aux tisanes & aux apozèmes adoucissans, qu'on destine principalement à tempérer les ardeurs d'urine, à calmer les coliques néphrétiques par quelque cause d'irritation qu'elles soient occasionnées, à faciliter même l'excrétion & la secrétion des urines, & la sortie du gravier & des petites pierres. On doit employer dans ces cas la graine de lin à fort petite dose, & ne point la faire bouillir, parce que le mucilage qu'elle peut même fournir à froid, donneroit à la liqueur, s'il y étoit contenu en trop grande quantité, une consistance épaisse & gluante, qui la rendroit très-desagréable au goût, & nuisible à l'estomac.
L'infusion de graine de lin est excellente contre l'action des poisons corrosifs : on peut dans ce cas-ci, on doit même charger la liqueur, autant qu'on doit l'éviter dans le cas précédent.
Le mucilage de graine de lin tiré avec l'eau rose, l'eau de fenouil, ou telle autre prétendue ophthalmique, est fort recommandé contre les ophthalmies douloureuses ; mais cette propriété, aussi-bien que toutes celles que nous avons rapportées, lui sont communes avec tous les mucilages. Voyez MUCILAGE.
On retire de la graine de lin une huile par expression, que plusieurs auteurs ont recommandée tant pour l'usage intérieur que pour l'usage extérieur ; mais que nous n'employons que pour le dernier, parce qu'elle est très-inférieure pour le premier à la bonne huile d'olives & à l'huile d'amandes douces, qui sont presque les seules que nous employons intérieurement. Au reste, l'huile de lin n'a dans aucun cas que les qualités génériques des huiles par expression. Voyez à l'article HUILE. (b)
|
| LINAIRE | S. f. linaria, (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale, anomale, en forme de masque terminé en-arriere par une queue, divisée par-devant en deux levres ; celle du dessus est découpée en deux ou en plusieurs parties, & la levre du dessous en trois parties : le pistil est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & devient dans la suite un fruit ou une coque arrondie, divisée en deux loges par une cloison, & remplie de semences qui sont attachées à un placenta, & qui sont plates & bordées dans quelques especes de ce genre, rondes & anguleuses dans d'autres. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
On vient de lire les caracteres de ce genre de plante, qu'il importe aux gens de l'art de connoître parce que plusieurs auteurs ont rangé mal-à-propos parmi les linaires, des plantes qui appartenoient à d'autres genres. M. de Tournefort compte 57 especes de celui-ci. Arrêtons-nous à notre seule linaire commune, en anglois toad-flax, & par les Botanistes, linaria vulgaris, lutea, flore majore, C. B. P. 212. J. R. H. 170.
Ses racines sont blanches, dures, ligneuses, rampantes, & fort traçantes ; il sort de la même racine plusieurs tiges hautes d'un pié, ou d'une coudée, cylindriques, lisses, d'un verd de mer, branchues à leur sommet, garnies de beaucoup de feuilles, placées sans ordre, étroites, pointues, semblables à celles de l'ésule ; desorte que si elles avoient du lait, il seroit difficile de l'en distinguer, avant qu'elle fleurisse ; ses fleurs sont au sommet des tiges & des rameaux, rangées en épi, portées chacune sur un pédicule court, qui sort de l'aisselle des feuilles ; elles sont d'une seule piece, irrégulieres, en masque, jaunes, prolongées à la partie postérieure en éperon, en maniere de corne, oblong, pointu de même que celle du pié d'alouette ; & c'est en cela qu'elles different des fleurs du muffle de veau ; elles sont partagées en deux levres par-devant, dont la supérieure se divise en especes de petites oreilles, & l'inférieure en trois segmens. Leur calice est petit, découpé en cinq quartiers ; il en sort un pistil attaché à la partie postérieure de la fleur, en maniere de clou. Ce pistil se change dans la suite en un fruit à deux capsules, ou en une coque arrondie, partagée en deux loges par une cloison mitoyenne, & percée de deux trous à son extrêmité. Quand elle est mûre, elle est remplie de graines plates, rondes, noires, bordées d'un feuillet.
La saveur de cette plante est un peu amere & un peu âcre ; elle est fréquente sur le bord des champs, & dans les pâturages stériles. Son odeur est fétide, appésantissante ou somnifere ; on en fait rarement usage intérieurement, mais c'est un excellent anodin extérieur pour calmer les douleurs des hémorrhoïdes fermées, soit qu'on l'emploie en cataplasme ou en liniment. (D.J.)
LINAIRE, (Mat. med.) plante presque absolument inusitée, dont plusieurs medecins ont dit cependant de fort belles choses. Voici par exemple, une partie de ce qu'en dit Tournefort, hist. des plantes des environs de Paris, herb. 1. La linaire résout le sang ou les matieres extravasées dans les porosités des chairs, & ramollit en même tems les fibres dont la tension extraordinaire cause des douleurs insupportables dans le cancer. L'onguent de linaire est excellent pour appaiser l'inflammation des hémorrhoïdes : voici comment on le prépare ; on fait bouillir les feuilles de cette plante dans l'huile où l'on a fait infuser des escarbots ou des cloportes : on passe l'huile par un linge, & l'on y ajoute un jaune d'oeuf durci, & autant de cire neuve qu'il en faut pour donner la consistance d'onguent. Cet auteur rapporte, d'après Hortius, une fort bonne anecdote, à propos de cet onguent. Il dit qu'un landgrave de Hesse donnoit tous les ans un boeuf bien gras à Jean Vultius son medecin, pour lui avoir appris ce secret. Cette récompense, toute bizarre & peu magnifique qu'elle peut paroître, étoit cependant bien au-dessus du service rendu. Cet onguent de linaire que nous venons de décrire, est un mauvais remede ; ou pour le moins la linaire en est-elle un ingrédient fort inutile. Voyez HUILE & ONGUENT. (b)
|
| LINANGES | (Géog.) les Allemands disent & écrivent Leinengen, petit pays d'Allemagne enclavé dans le bas-Palatinat, avec titre de comté. (D.J.)
|
| LINCE | S. f. (Commerce) sorte de satins de la Chine, ainsi appellés de la maniere dont ils sont pliés.
|
| LINCEUL | S. m. (Gram.) ce mot avoit autrefois une acception assez étendue ; il se disoit de tout tissu de lin, de toutes sortes de toile ; à présent il ne se dit plus que du drap dont on nous enveloppe après la mort ; l'unique chose de toutes nos possessions que nous emportions au tombeau.
|
| LINCHANCHI | (Géog.) ville de l'Amérique, dans la nouvelle Espagne, au pays d'Incatan, à 4 lieues de Sélam. Long. 289. 45. lat. 20. 40. (D.J.)
|
| LINCOLN | (Géog.) ville d'Angleterre, capitale de Lincolnshire, avec un évêché suffragant de Cantorberi, & titre de comté. Elle envoie deux députés au parlement. Son nom latin est Lindum, & par les écrivains du moyen âge, Lindecollinum, ou Lindecollina, felon Bede. Le nom breton est Lindecylne, dont la premiere syllabe signifie un lac, un marais. Les anciens peuples de l'île l'appelloient Lindcoit, à cause des forêts qui l'environnoient. Les Saxons la nommoient Lin-cyllanceartep, & les Normands, Nichol.
Cette ville a été quelquefois la résidence des rois de Mercie. Elle est sur le Witham, à 24 milles N. E. de Nottingham, 39 N. de Pétersboroug, 51 S. d'York, 155 N. de Londres. Long. selon Street, 19d 40' 49''. lat. 53. 15.
|
| LINCOLNSHIRE | (Géogr.) pays des anciens Coritains, aujourd'hui province maritime d'Angleterre, bornée à l'est par l'océan germanique. Elle a 180 milles de tour, & contient environ 174 mille arpens. C'est un pays fertile, & très-agréable du côté du nord & de l'ouest. L'Humber qui sépare cette province d'Yorkshire, & la Trente qui en sépare une partie du Nottinghamshire, sont ses deux premieres rivieres, outre lesquelles il y a le Wittham, le Neu, & le Wéland, qui la traversent. Cette province, l'une des plus grandes d'Angleterre, est divisée en trois parties nommées Lindsey, Holland, & Kesteven. Lindsey qui est la plus considérable, contient les parties septentrionales ; Holland est au sud-est, & Kesteven à l'ouest de Holland. Ses villes principales sont Lincoln capitale, Boston, Grimsby, Grantham, Kirton, & Granesboroug.
La province de Lincoln doit à jamais se glorifier d'avoir produit Newton, cette espece de demi-dieu, qui le premier a connu la lumiere, & qui à l'âge de 24 ans, avoit déja fait toutes ses découvertes, celle-là même du calcul des fluxions, ou des infiniment petits ; il se contenta de l'invention d'une théorie si surprenante, sans songer à s'en assurer la gloire, sans se presser d'annoncer à l'univers son génie créateur, & son intelligence sublime. On peut (M. de Fontenelle la remarqué dans son éloge) on peut lui appliquer ce que Lucain dit du Nil, dont les anciens ignoroient la source : qu'il n'a pas été permis aux hommes de voir Newton foible & naissant. Il a vécu 85 années, toujours heureux, & toujours vénéré dans sa patrie ; il a vû son apothéose ; son corps après sa mort fut exposé sur un lit de parade ; ensuite on le porta dans l'abbaye de Westminster ; six d'entre les premiers pairs d'Angleterre soutinrent le poële, & l'évêque de Rochester fit le service, accompagné de tout le clergé de l'église : en un mot on enterra Newton à l'entrée du choeur de cette cathédrale, comme on enterreroit un roi qui auroit fait du bien au monde.
Hîc situs ille est, cui rerum patuerê recessus,
Atque arcana poli.
|
| LINDAU | en latin Landivia & Lindavium, (Géog.) ville libre & impériale, dans la Souabe, avec une célebre abbaye de chanoinesses, sur laquelle on peut voir le P. Helyot, tom. VI. chap. liij.
On attribue la fondation de cette abbaye à Albert, maire du palais de Charlemagne, qui prit soin de la doter & de l'enrichir. Avec le tems, l'abbesse devint princesse de l'empire, & eut son propre maire elle-même. Les chanoinesses de cette abbaye font preuve de trois races, ne portent aucun habit qui les distingue, peuvent se marier, & ne sont tenues qu'à chanter au choeur, & à dire les heures canoniales. Quoique la ville de Lindau soit luthérienne, elle n'en vit pas moins bien avec l'abbesse & les chanoinesses, qui sont bonnes catholiques.
Cette ville qui est une vraie république, & qui entr'autres privileges, jouit du droit de battre monnoie, a pour chef un bourgmestre, & un stad-amman, qu'elle élit tous les deux ans du corps des patriciens ou des plébéiens, pour gouverner avec le sénat, & huit tribuns du peuple, sans l'aveu desquels tribuns on ne peut résoudre aucune affaire importante, comme de religion, de guerre, de paix, ou d'alliance. On change les magistrats tous les ans.
La situation de cette petite ville n'est pas moins avantageuse que celle de son gouvernement ; elle est dans une île du lac de Constance, dont le tour est de 4 milles 450 pas proche la terre-ferme, à laquelle elle est attachée par un pont de pierre, long de 290 pas, entre l'Algow au couchant, la Suisse au levant, les Grisons au midi, & le reste de la Souabe au nord ; ensorte qu'elle paroît comme l'étape des marchandises de diverses nations. Ceux de Souabe & de Baviere y font des amas de froment, de sel & de fer, qu'ils vendent ensuite aux Suisses & aux Grisons. On y porte des montagnes de Suisse, d'Appenzel, & des Grisons, du beurre, du fromage, des planches, des chevrons, & autres marchandises qui passent par Nuremberg & par Augsbourg, pour être conduites en Italie. Sa position est à 5 lieues S. E. de Buckhorn, 10 S. de Constance, 30 S. O. d'Augsbourg. Long. selon Gaube, 26d. 21'. 30''. Lat. 51. 30.
|
| LINDES | Lindus ou Lindos, (Géog. anc.) ancienne ville de l'île de Rhodes, selon tous les auteurs, Strabon, l. XIV. Pomponius Méla, l. II. c. vij. Pline, l. V. c. xxxj. & Ptolémée, l. V. c. ij. Diodore de Sicile en attribue la fondation à Tlépoleme fils d'Hercule, & d'autres aux Héliades, petits-fils du Soleil. Quoi qu'il en soit de l'origine fabuleuse de cette ville, elle eut le bonheur de se conserver, & de n'être point absorbée par la capitale. Eustathe dit que de son tems elle avoit encore de la réputation. Elle se glorifioit de son temple, dont Minerve avoit pris le surnom de Lindienne, & d'être la patrie de Cléobule, un des sept sages de la Grece, mort sous la 70 olympiade, homme célebre par sa figure, par sa bravoure, par ses talens, & par son aimable fille Cléobuline.
Lindes étoit une place importante, du tems que les chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem possédoient l'île de Rhodes ; elle étoit défendue par une forteresse, & un bon port au pié, avec une grande baie d'un fond net, ferme & sablonneux.
|
| LINDISFARNE | Lindisfarna, lindisfarnensis insula, (Géog.) île d'Angleterre, sur la côte de Northumberland ; elle perdit le nom de Lindisfarne, pour prendre d'abord celui de Haligeland, & ensuite celui de Holy-Island, qu'elle porte aujourd'hui, & qui signifie pareillement île sainte. Le nom de Lindisfarne dérive du breton, lyn un lac, un marais. Voyez sur l'île même, le mot HOLY-ISLAND, (Géog.)
|
| LINDKOPING | Lidae forum, (Géog.) petite ville de Suede, dans la Westro-Gothie, sur le lac Waner, à l'embouchure de la Lida dans ce lac, à 2 milles N. O. de Skara, 30 N. O. de Falkoping, 28 S. O. de Mariestad. Long. selon Celsius, 38. 54. 5. lat. 58. 25.
|
| LINDSEY | (Géog.) contrée d'Angleterre en Lincolnshire, dont elle fait une des trois parties ; elle a conservé l'ancien nom de cette province, qui s'appelloit en latin Lindissa.
|
| LINÉAIRE | adj. (Mathémat.) Un problème linéaire est celui qui n'admet qu'une solution, ou qui ne peut être résolu que d'une seule façon. Voyez PROBLEME, TERMINEMINE.
On peut définir plus exactement encore le problème linéaire, celui qui est résolu par une équation qui ne monte qu'au premier degré ; comme si l'on demande de trouver une quantité x qui soit égale à a + b, on aura l'équation linéaire ou du premier degré, x = a + b, & le problème linéaire. Comme toutes les équations qui ne montent qu'au premier degré n'ont qu'une solution, & que toutes les autres en ont plusieurs, on voit que cette seconde définition revient assez à la premiere. Il faut cependant y mettre cette restriction, qu'un problème linéaire n'a véritablement qu'une solution possible ou imaginaire ; au lieu qu'il y a des problèmes qui n'ont réellement qu'une solution possible, quoiqu'elles en ayent plusieurs imaginaires ; ce qui arrive si l'équation qui donne la solution du problème est d'un degré plus élevé que l'unité, & qu'elle n'ait qu'une racine réelle & les autres imaginaires. Voyez EQUATION & RACINE. Par exemple, cette équation x3 = a3, n'a qu'une solution possible, savoir x = a, mais elle en a deux imaginaires, savoir x = - (a/2) + . Ainsi le problème n'est pas proprement linéaire. Equation linéaire est celle dans laquelle l'inconnue n'est élevée qu'au premier degré. Voyez DIMENSION.
Les quantités linéaires sont celles qui n'ont qu'une dimension : on les appelle linéaires par les rapports qu'elles ont aux simples lignes, & pour les distinguer des quantités de plusieurs dimensions qui représentent des surfaces ou des solides. Ainsi a est une quantité linéaire, au lieu que le produit a b est une quantité de deux dimensions qui représente le produit de deux lignes a b, c'est-à-dire un parallélogramme dont a seroit la hauteur & b la base. Cependant l'expression a b est quelquefois linéaire, par exemple quand elle désigne une quatrieme proportionnelle aux trois quantités 1, a, b ; car l'on a en ce cas 1, a : : b. = a b ; ainsi a b exprime alors une simple ligne, ce qu'il faut bien observer, le dénominateur 1 étant sous-entendu. Voyez DIVISION & MULTIPLICATION. (O)
|
| LINÉAL | adj. (Jurispr.) se dit de ce qui est dans l'ordre d'une ligne. Une substitution est graduelle & linéale lorsque sa progression suit l'ordre des lignes de degré en degré. (A)
|
| LINÉAMENT | S. m. (Divin.) trait fini ou petits signes qu'on observe dans le visage, & qui en font la délicatesse. C'est ce qui fait qu'on conserve toûjours le même air, & qu'un visage ressemble à un autre.
C'est par-là que les Physionomistes prétendent juger du tempérament & des inclinations. Voyez PHYSIONOMIE & VISAGE.
Les Astrologues, Devins & autres charlatans, s'imaginent aussi connoître par ce moyen quelle doit être la bonne ou mauvaise fortune d'une personne.
|
| LINFICIUS LAPIS | (Hist. nat.) pierre inconnue qui, si l'on s'en rapporte à Ludovico Doleo, avoit la vertu de guérir le mal caduc & un grand nombre d'autres maladies.
|
| LINGAM | (Histoire des Indiens) autrement LINGAN ou LINGUM ; divinité adorée dans les Indes, sur-tout au royaume de Carnate : cette divinité n'est cependant qu'une image infâme qu'on trouve dans tous les pagodes d'Isuren. Elle offre en spectacle l'union des principes de la génération, & c'est à cette idée monstrueuse que se rapporte le culte le plus religieux. Les bramines se sont reservé le privilege de lui présenter des offrandes ; privilege dont ils s'acquitent avec un grand respect & quantité de cérémonies. Une lampe allumée brûle continuellement devant cette idole ; cette lampe est environnée de plusieurs autres branches, & forme un tout assez semblable au chandelier des Juifs qui se voit dans l'arc triomphal de Titus ; mais les dernieres branches du candélabre ne s'allument que lorsque les bramines font leur offrande à l'idole. C'est par cette représentation qu'ils prétendent enseigner que l'être suprème qu'ils adorent sous le nom d'Isuren, est l'auteur de la création de tous les animaux de différentes especes. Voyez de plus grands détails dans le christianisme des Indes de M. de la Croze, ouvrage bien curieux pour qui sait le lire en philosophe. (D.J.)
|
| LINGE | S. m. (Gramm.) il se dit en général de toute toile mise en oeuvre. Il y a le linge de table, le linge fin, le gros linge, le linge de jour, le linge de nuit. &c. Voyez l'article TOILE.
|
| LINGELLE | S. f. Comm.) Voyez FLANELLE.
|
| LINGEN | (Géogr.) ville d'Allemagne dans la Westphalie, capitale d'un petit comté de même nom que le roi de Prusse possede aujourd'hui. Lingen est sur l'Embs, à 12 lieues N. O. d'Osnabruck, 15 N. O. de Munster. Long. 25. 5. lat. 52. 32. (D.J.)
|
| LINGERES | S. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s'appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l'apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu'une apprentisse à-la-fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l'une femme & l'autre fille.
|
| LINGERIE | S. f. il a deux acceptions ; il se dit de l'endroit destiné dans une grande maison à serrer le linge, & de tout commerce en linge, comme dans cette phrase, il fait la lingerie, où le mot lingerie se prend dans le même sens que dans celle-ci : il fait la bijouterie.
|
| LINGHE | LA, ou la LINGE, (Géog.) riviere des Pays-Bas ; elle a sa source en Gueldres dans le haut Betuwe, & tombe à Gorkom dans la Meuse. (D.J.)
|
| LINGONS | (Géogr. anc.) Lingones dans Tacite, nom d'un ancien peuple & d'une ancienne province de France, aujourd'hui le Langresi. César est le premier qui ait fait mention de ce peuple ; il leur ordonne de lui fournir du froment qu'ils recueilloient en abondance, au rapport de Claudien, II. stilic, v. 94. Strabon a corrompu le nom des Lingones, car tantôt il les appelle Liggones, & tantôt Lincasii.
Ces peuples, aussi-bien que les Aedui, eurent le titre d'alliés des Romains ; ce qui fait que Pline les appelle Lingones foederati. De son tems ils étoient attribués à la Gaule belgique, & dans la suite ils furent mis dans la Gaule celtique. Comme ils sont situés au milieu de ces deux Gaules, il n'est pas étonnant qu'ils aient été attribués tantôt à l'une, tantôt à l'autre.
Tacite, hist. liv. I. fait mention de civitas Lingonum ; mais par le mot civitas on ne doit point entendre la capitale seulement, il faut entendre tout le pays, solum Lingonicum, comitatum Lingonicum, pagum Lingonicum, qui étoit très-opulent au rapport de Frontin, & qui fournit 70 mille hommes armés à l'empereur Domitien.
Aussi met-on sous la dépendance des anciens Lingons une grande quantité de pays ; savoir le pays des Altuarii, le Duesnois, le LÉçois, le Dijénois (aujourd'hui le Dijonois), l'Onchois, le Tonnerrois, le Bassigny, le pays de Bar-sur-Seine & de Bar-sur-Aube : du-moins presque tous ces pays étoient compris anciennement sous la dénomination de pagus Lingonicus. Son état présent est bien différent ; il fait seulement une partie de la généralité & du gouvernement de Champagne, quoique le diocèse de l'évêque s'étende plus loin. Voyez LANGRES.
Il ne faut pas confondre les Ligones de la Gaule belgique ou celtique, avec les Ligones, peuples de la Caule cispadane : ceux-ci tiroient leurs noms des Gaulois Ligons, qui avoient passé en Italie avec les Boiens : leur pays n'étoit pas considérable ; ils étoient séparés des Veneti par le Pô, de la Toscane par l'Apennin, des Boïens, au couchant, par la riviere d'Idice, & étoient bornés à l'orient par le fleuve Montone. L'on voit par-là que leur territoire comprenoit une partie du Bolognèse, de la Romagne propre, & de la Romagne florentine. (D.J.)
|
| LINGOT | S. m. (Chimie) morceau de métal brut qui n'est ni monnoyé ni ouvragé, n'ayant reçu d'autre façon que celle qu'on lui a donnée dans la mine en le fondant & le jettant dans une espece de moule ou creux que l'on appelle lingotiere.
Les lingots sont de divers poids & figures, suivant les différens métaux dont ils sont formés. Il n'y a que l'or, l'argent, le cuivre & l'étain qui se jettent en lingots.
|
| LINGOTIERE | S. f. en terme d'Orfevrerie, est un morceau de fer creux & long pour recevoir la matiere en fusion, ce qui forme le lingot. Le plus grand mérite d'une lingotiere est d'être sans paille ; il y en a de différentes grandeurs, avec des piés ou sans piés. Il faut qu'elles soient un peu plus larges du haut que du bas pour que le lingot puisse sortir en la renversant. Quand on voit que la matiere est bientôt prête à jetter, l'on fait chauffer la lingotiere assez pour que le suif fonde promtement ; quand on en met pour la graisser, l'on n'en laisse que ce qui est resté après l'avoir retournée, ensuite l'on jette. Voyez JETTER. Il y en a quelques-unes où il y a une petite élévation pour poser le creuset, afin de faciliter celui qui jette. Voyez nos Pl. d'Orfevr.
|
| LINGUAL | LE, adj. (Anat.) ce qui appartient à la langue. Voyez LANGUE.
Nerf lingual, voyez HYPOGLOSSE.
Artere sub-linguale, voyez RANINE.
Glande sub-linguale, voyez HYPOGLOTIDE.
LINGUAL, adj. (Bandage) terme de Chirurgie. Machine pour la réunion des plaies transversales de la langue, imaginé par M. Pibrac, & décrite dans une dissertation qu'il a donnée à l'académie royale de Chirurgie, sur l'abus des sutures, tom. III.
Les sutures ont prévalu dans presque tous les cas sur les autres moyens de réunion, parce qu'il a toujours été plus facile d'en faire usage, que d'appliquer son esprit dans des circonstances difficiles à imaginer un bandage qui remplît, par un procédé nouveau, toutes les intentions de l'art & de la nature. Ambroise Paré, le premier auteur qui ait parlé expressément du traitement des plaies de la langue, rapporte trois observations de plaies à cette partie, auxquelles il a fait la suture avec succès. Elle avoit été coupée entre les dents à l'occasion de chûtes sur le menton. Ce grand praticien prescrit la précaution de tenir la langue avec un linge, de crainte qu'elle n'échappe dans l'opération. La suture est très-difficile, quelque précaution qu'on prenne, sur-tout pour peu que la division soit éloignée de l'extrêmité. Ambroise Paré ne désespéroit pas qu'on ne réussît à trouver un meilleur moyen : M. Pibrac l'a imaginé. Une demoiselle, dans un accès d'épilepsie, se coupa la langue obliquement entre les dents : la portion divisée qui ne tenoit plus que par une petite quantité de fibres sur un des côtés, étoit pendante hors de la bouche ; en attendant qu'on avisât aux moyens les plus convenables, M. Pibrac crut devoir retenir cette portion par un morceau de linge en double qu'il mit transversalement en forme de bande entre les dents. Le succès avec lequel la portion de langue coupée fut retenue dans la bouche, suggéra à M. Pibrac l'invention d'une petite bourse de linge fin pour loger exactement la langue, voyez Pl. XXXVI. fig. 1 & 2 ; il trouva le moyen de l'assujettir, en l'attachant à un fil d'archal a a replié sous le menton, & qu'il étoit facile de fixer par deux rubans b, b, b, liés derriere la tête : ce qui représente assez bien un bridon. La langue est vûe dans la bourse, fig. 2, & la machine en place, fig. 3.
Rien n'est plus commode que cet instrument pour réunir les plaies de la langue & maintenir cette partie sans craindre le moindre dérangement. Il suffit de fomenter la plaie à-travers la poche avec du vin dans lequel on a fait fondre du miel rosat. S'il s'amasse quelqu'espece de limon dans le petit sac, il est aisé de le nettoyer avec un pinceau trempé dans le vin miellé, & d'entretenir par ce moyen la plaie toujours nette.
Ce bandage est extrêmement ingénieux & d'une utilité marquée : cette invention enrichit réellement la Chirurgie ; c'est un présent fait à l'humanité, cet éloge est mérité. L'inconvénient de notre siecle, c'est qu'on loue avec un faste imposant des inventions superflues ou dangereuses comme utiles & admirables, & que le suffrage public instantané est pour ceux qui se vantent le plus, & dont la cabale est la plus active. Le bandage lingual a été placé sans ostentation dans les mémoires de l'académie royale de Chirurgie, & ne sera vu dans tous les tems qu'avec l'approbation qui lui est dûe. (Y)
LINGUALE, adj. f. (Gram.) Ce mot vient du latin lingua la langue, lingual, qui appartient à la langue, qui en dépend.
Il y a trois classes générales d'articulations, les labiales, les linguales & les gutturales. (Voyez H & LETTRES.) Les articulations linguales, sont celles qui dépendent principalement du mouvement de la langue ; & les consonnes linguales sont les lettres qui représentent ces articulations. Dans notre langue, comme dans toutes les autres, les articulations & les lettres linguales sont les plus nombreuses, parce que la langue est la principale des parties organiques, nécessaires à la production de la parole. Nous en avons en françois jusqu'à treize, que les uns classifient d'une maniere, & les autres d'une autre. La division qui m'a paru la plus convenable, est celle que j'ai déja indiquée à l'article LETTRES, où je divise les linguales en quatre classes, qui sont les dentales, les sifflantes, les liquides & les mouillées.
J'appelle dentales celles qui me paroissent exiger d'une maniere plus marquée, que la langue s'appuie contre les dents pour les produire : & nous en avons cinq ; n, d, t, g, q, que l'on doit nommer ne, de, te, gue, que, pour la facilité de l'épellation.
Les trois premieres, n, d, t, exigent que la pointe de la langue se porte vers les dents supérieures, comme pour retenir le son. L'articulation n le retient en effet, puisqu'elle en repousse une partie par le nez, selon la remarque de M. de Dangeau, qui observa que son homme enchifrené, disoit, je de saurois, au lieu de je ne saurois : ainsi n est une articulation nasale. Les deux autres d & t sont purement orales, & ne different entr'elles que par le degré d'explosion plus ou moins fort, que reçoit le son, quand la langue se sépare des dents supérieures vers lesquelles elle s'est d'abord portée ; ce qui fait que l'une de ces articulations est foible, & l'autre forte.
Les deux autres articulations g & q ont entr'elles la même différence, la premiere étant foible & la seconde forte ; & elles différent des trois premieres, en ce qu'elles exigent que la pointe de la langue s'appuie contre les dents inférieures, quoique le mouvement explosif s'opere vers la racine de la langue. Ce lieu du mouvement organique a fait regarder ces articulations comme gutturales par plusieurs auteurs, & spécialement par Wachter, Glossar. germ. Proleg. sect. 2. § 20. & 21. Mais elles ont de commun avec les trois autres articulations dentales, de procurer l'explosion au son & en augmentant la vîtesse par la résistance, & d'appuyer la langue contre les dents ; ce qui semble leur assurer plus d'analogie avec celles-là, qu'avec l'articulation gutturale h, qui ne se sert point des dents, & qui procure l'explosion au son par une augmentation réelle de la force. Voyez H. Mais voici un autre caractere d'affinité bien marqué dans les événemens naturels du langage ; c'est l'attraction entre le n & le d, telle qu'elle a été observée entre le m & le b (Voyez LETTRES), & la permutation de g & de d. " Je trouve, dit M. de Dangeau (opusc. pag. 59.), que l'on a fait.... de cineris, cendre ; de tenor, tendre ; de ponere, pondre ; de veneris dies, vendredi ; de gener, gendre ; de generare, engendrer ; de minor, moindre. Par la même raison à peu près, on a changé le g en d, entre un n & un r ; on a fait de fingere, feindre ; de pingere, peindre ; de jungere, joindre ; de ungere, oindre ; parce que le g est à peu près la même lettre que le d ". On voit dans les premiers exemples, que le n du mot radical a attiré le d dans le mot dérivé ; & dans les derniers, que le g du primitif est changé en d dans le dérivé ; ce qui suppose entre ces articulations une affinité qui ne peut être que celle de leur génération commune.
Les articulations linguales que je nomme sifflantes, different en effet des autres, en ce qu'elles peuvent se continuer quelque-tems & devenir alors une espece de sifflement. Nous en avons quatre, z, s, j, ch, qu'il convient de nommer ze, se, je, che. Les deux premieres exigent une disposition organique toute différente des deux autres ; & elles different du fort au foible ; ainsi que les deux dernieres. On doit bien juger que ces lettres sont plus ou moins commuables entr'elles, à raison de ces différences. Ainsi le changement de z en s est une regle générale dans la formation du tems, que je nommerois présent postérieur, mais que l'on appelle communément le futur des verbes en de la quatrieme conjugaison des barytons ; de : au contraire, dans le verbe allemand zischen, siffler, qui vient du grec , le ou s grec est changé en z, & le ou z grec est changé en sch qui répond à notre ch françois. " Quand les Parisiens, dit encore M. de Dangeau (Opusc. pag. 50.), prononcent les mots chevaux & cheveux, ils prononceroient très-distinctement le ch de la premiere syllabe, s'ils se vouloient donner le tems de prononcer l'e féminin, & qu'ils prononçassent ces mots en deux syllabes : mais s'ils veulent, en pressant leur prononciation, manger cet e féminin, & joindre sans milieu la premiere consonne avec l'v, consonne qui commence la seconde syllabe ; cette consonne qui est foible affoiblit le ch qui devient j, & ils diront jvaux, & jveux ".
Au reste, ces quatre articulations linguales ne sont pas les seules sifflantes : les deux semi-labiales v & f, sont dans le même cas, puisqu'on peut de même les faire durer quelque-tems, comme une sorte de sifflement. Elles different des linguales sifflantes par la différence des dispositions organiques, qui font du même organe diversement arrangé deux instrumens aussi différens que le haut-bois, par exemple, & la flûte. L'articulation gutturale h, qui n'est qu'une expiration forte & que l'on peut continuer quelque-tems, est encore par-là même analogue aux autres articulations sifflantes. De-là encore la possibilité de mettre les unes pour les autres, & la réalité de ces permutations dans plusieurs mots dérivés : h pour f dans l'espagnol humo, fumée, venu de fumus ; f pour h dans le latin festum venu de ; v pour h dans vesta dérivé de ; pour s dans verro qui vient de ; s pour h dans super au lieu du grec , &c.
Les articulations linguales liquides sont ainsi nommées, comme je l'ai déja dit ailleurs, (Voyez L.) parce qu'elles s'allient si bien avec plusieurs autres articulations qu'elles n'en paroissent plus faire ensemble qu'une seule, de même que deux liqueurs s'incorporent au point qu'il résulte de leur mélange une troisieme liqueur qui n'est plus ni l'une ni l'autre. Nous en avons deux le & re représentées par l & r : la premiere s'opere d'un seul coup de la langue vers le palais ; la seconde est l'effet d'un trémoussement réitéré de la langue. Le titre de la dénomination qui leur est commune, est aussi celui de leur permutation respective ; comme dans varius qui vient de , où l'on voit tout à la fois le changé en v, & le en r ; de même milites a été d'abord substitué à melites, descendu de mérites par le changement de r en l, & ce dernier mot venoit de mereri, selon Vossius, dans son traité de litterarum permutatione.
Pour ce qui est des articulations mouillées, je n'entreprendrai pas d'assigner l'origine de cette dénomination : je n'y entends rien, à moins que le mot mouillé lui-même, donné d'abord en exemple de l mouillé, n'en soit devenu le nom, & ensuite du gn par compagnie : ce sont les deux seules mouillées que nous ayons. (B. E. R. M.)
|
| LINGUES | S. m. (Com.) Satin- lingues ; il est fabriqué parmi nous, on l'envoie à Smyrne.
|
| LINIERE | S. f. (Jardinage) C'est le lieu où est semé le lin.
|
| LINIMENT | S. m. (Pharm.) espece de remede composé externe, qui s'applique en en frottant légerement, enduisant & oignant les parties.
Le liniment proprement dit, doit être d'une consistance moyenne entre l'huile par expression, ou entre le baume artificiel & l'onguent ; & il ne differe que par cette consistance de ces deux autres préparations pharmaceutiques. Leur composition & leurs usages sont d'ailleurs les mêmes. Ce sont toujours des huiles, des graisses, des résines, des baumes naturels, des bitumes destinés à amollir, assouplir, détendre, calmer, résoudre : & même cette différence unique qui dépend de la consistance, ne détermine que d'une maniere fort vague & fort arbitraire, la dénomination de ce genre de remedes : ensorte qu'on appelle presqu'indifféremment baume, liniment, ou onguent, des mélanges de matieres grasses destinés à l'application extérieure, & qu'il importe très-peu en effet de les distinguer.
Quoi qu'il soit presque essentiel à ce genre de remede, d'être composé de matieres grasses, & que l'élégance de la préparation, l'obligation de faire de ses différens ingrédiens un tout exactement mêlé, lié, aggrégé, en exclue les matieres non miscibles aux corps gras ; cependant sub assiduâ conquassatione, en battant long-tems avec les huiles, ou d'autres matieres grasses résoutes, des liqueurs aqueuses, pures ou acidules, on parvient à les incorporer ensemble sous la forme d'un tout assez lié. Le cerat de Galien qui est un liniment proprement dit, & le nutritum vulgaire qui est appellé onguent, contiennent le premier, de l'eau, & le second, du vinaigre.
On peut donc absolument, si l'on veut, prescrire sur ce modele des linimens magistraux, dans lesquels on fera entrer des décoctions de plantes, de l'eau chargée de mucilages, de gommes, &c. mais si l'on veut, d'après l'ancien usage, dissiper par la cuite l'eau chargée d'extrait, de mucilage, &c. ces substances restent en masses distinctes parmi les matieres huileuses ; elles ne contractent avec elles aucune espece d'union, & séparées de leur véhicule, de leur menstrue, de l'eau, elles n'ont absolument aucune vertu dans l'application extérieure.
Au reste, il paroît que les liqueurs aqueuses introduites dans les linimens n'ont d'autre propriété, que de les rendre plus légers, plus rares, plus neigeux ; car d'ailleurs leur vertu médicinale réelle paroît appartenir entierement aux matieres huileuses. Voyez HUILE & ONGUENT.
On fait entrer aussi assez souvent dans les linimens & les onguens, diverses poudres, telles que celles des diverses chaux de plomb, de pierre calaminaire, de verd-de-gris, des terres bolaires, des gommes-résines, & même de quelques matieres végétales ligneuses, de semences farineuses, &c. toutes ces poudres qui sont ou absolument insolubles par les matieres graisseuses, ou qui s'y dissolvent mal dans les circonstances de la préparation des linimens & des onguens, non-seulement nuisent à la perfection pharmaceutique de ces compositions ; mais même sont dans la plûpart des ingrédiens sans vertu, ou pour le moins dont l'activité est châtrée par l'excipient graisseux. (b)
|
| LINKIO | S. m. (Botan. exotiq.) plante aquatique de la Chine. Son fruit est blanc & a le goût de la châtaigne, mais il est trois ou quatre fois plus gros, d'une figure pyramidale & triangulaire ; il est revêtu d'une écorce verte, épaisse vers le sommet, & qui noircit en séchant. La plante qui le porte, croît dans les eaux marécageuses ; elle a les feuilles fort minces, & elle les répand de toutes parts, sur la surface de l'eau. Les fruits viennent dans l'eau même ; c'est du moins ce qu'en dit Hoffman dans son dictionnaire universel latin ; celui de Trévoux, a fait de ce lexicographe, un auteur anonyme qui a écrit de la Chine. (D.J.)
|
| LINON | S. m. (Comm.) espece de toile de lin blanchi, claire, déliée & très-fine, qui se manufacture en Flandres ; il y a du linon uni, rayé & moucheté. L'un a 3/4 de large & quatorze aunes à la piece, ou 2/3 de large & douze à treize aunes à la piece. Le rayé & le moucheté est de 3/4 de large sur quatorze aunes à la piece. On en fait des garnitures de tête, des mouchoirs de col, des toilettes, &c. on les envoye des manufactures en petits paquets quarrés d'une piece & demie chacun, couverts de papier brun, lissé & enfermé dans des caissettes de bois dont les planches sont chevillées.
|
| LINOS | S. m. (Littér.) espece de chanson triste ou de lamentation, en usage chez les anciens grecs.
Voici ce qu'en dit Hérodote, liv. II. en parlant des Egyptiens. " Ils ont, dit-il, plusieurs autres usages remarquables, & en particulier celui de la chanson linos, qui est célebre en Phénicie, en Chypre & ailleurs, où elle a différens noms, suivant la différence des peuples. On convient que c'est la même chanson que les Grecs chantent sous le nom de linos ; & si je suis surpris de plusieurs autres singularités d'Egypte, je le suis sur-tout du linos, ne sachant d'où il a pris le nom qu'il porte. Il paroît qu'on a chanté cette chanson dans tous les tems ; au reste, le linos s'appelle chez les Egyptiens maneros. Ils prétendent que Maneros étoit le fils unique de leur premier roi ; & que leur ayant été enlevé par une mort prématurée, ils honorerent sa mémoire par cette espece de chanson lugubre, qui ne doit l'origine qu'à eux seuls ". Le texte d'Hérodote donne l'idée d'une chanson funebre. Sophocle parle de la chanson elinos dans le même sens ; cependant le linos & l'elinos étoient une chanson pour marquer non-seulement le deuil & la tristesse, mais encore la joie suivant l'autorité d'Euripide, cité par Athénée, liv. XIV. chap. iij. Pollux donne encore une autre idée de cette chanson, quand il dit que le linos & le lityerse étoient des chansons propres aux fossoyeurs & aux gens de la campagne. Comme Hérodote, Euripide & Pollux ont vécu à quelques siecles de distance les uns des autres, il est à croire que le linos fut sujet à des changemens qui en firent une chanson différente suivant la différence des tems. Sophocle, in Ajace ; Pollux, liv. I. c. j. Dissert. de M. de la Nauze sur les chansons des anciens. Mém. de l'ac. des Belles-Lettres, tome IX. pag. 358.
|
| LINOSE | (Géog.) île de la mer Méditerranée, sur la côte d'Afrique, à 5 lieues N. E. de Lampedouse, presque vis-à-vis de Mahomette en Barbarie. Sanut pense que c'est l'Ethusa de Ptolémée. Elle a environ 5 lieues de tour, & pas un seul endroit commode, où les vaisseaux puissent aborder. Long. 31. 6. lat. 34. (D.J.)
|
| LINOTE | S. f. linaria vulgaris, (Hist. nat. Ornitholog.) cet oiseau pese une once ; il a environ six pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrêmité de la queue, & dix pouces d'envergeure ; le bec est long d'un demi-pouce, fort noir par-dessus & blanc par-dessous. La tête a des teintes de couleur cendrée & de brun, & le dos est mêlé de brun & de roux. Le milieu de chaque plume est brun, & les bords sont cendrés dans les plumes de la tête, & roux dans celles du dos. La poitrine est blanchâtre ; les plumes du bas-ventre, & celles qui sont autour de l'anus sont jaunâtres : le ventre est blanc, & le cou & l'endroit du jabot, sont de couleur roussâtre avec des taches brunes. Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aîle ; elles sont noires ; elles ont la poitrine blanchâtre. Les bords extérieurs des neuf premieres plumes sont blancs ; les petites plumes qui recouvrent l'aîle sont rousses, & celles qui recouvrent l'aîleron sont noires. La queue est un peu fourchue, & composée de douze plumes. Les deux plumes extérieures ont deux pouces trois lignes de longueur, & celles du milieu n'ont que deux pouces ; celles-ci ont les bords roux, & toutes les autres les ont blancs. Cet oiseau aime beaucoup les semences de lin ; c'est pourquoi on l'a appellé linaria, linote. Son chant est très-agréable. Il se nourrit de graines de panis, de millet & de chénevi, &c. Avant que de manger ces semences, il en ôte l'écorce avec son bec, pour ne manger que le dedans. Mais le chénevi engraisse tellement ces oiseaux qu'ils en meurent, ou qu'ils en perdent au-moins leur vivacité, & alors ils cessent de chanter. La linote niche sur des arbres qui ne sont pas élevés ; elle fait trois ou quatre oeufs. Willughb. Ornit.
Il y a deux sortes de linotes rouges ; une grande & une petite. La grande linote rouge est plus petite que la linote ; elle a le sommet de la tête rouge, & la poitrine teinte de cette même couleur ; la petite linote rouge a le devant de la tête d'un beau-rouge. Raii synop. avium. Voyez OISEAU.
|
| LINSOIRS | S. m. (Charpente) sont des pieces de bois qui servent à porter le pié des chevrons à l'endroit des lucarnes des édifices, & aux passages des cheminées. Voyez nos Planches de Charpente & leur explication.
|
| LINTEAUX | S. m. pl. (Charp.) sont des pieces de bois qui forment le haut des portes & des croisées qui sont assemblées dans les poteaux des croisées & des portes. Voyez nos Pl. de Charpente.
LINTEAU, s. m. (Serrurerie) bout de fer placé au haut des portes, des grilles, où les tourillons des portes entrent.
Linteau se dit aussi en Serrurerie comme en Menuiserie, de la barre de fer que l'on met aux portes & croisées, au lieu de linteau de bois.
|
| LINTERNE | en latin Linternum, ou Liternum, (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie dans la Campanie, à l'embouchure du Clanis (le Clanio ou l'Agno), & auprès d'un lac ou marais que Stace appelle Linterna palus. La position de ce marais a engagé Silius Italicus à nommer la ville stagnosum Linternum.
Linterne étoit une colonie romaine qui fut augmentée sous Auguste. C'est-là que Scipion l'Afriquain, piqué de l'ingratitude de ses compatriotes, se retira, & qu'il passa le reste de ses jours dans l'étude, & dans la conversation des gens de lettres. Tous les Scipions les ont aimées, & ont été vertueux. Celui-ci, le premier des Romains qu'on honora du nom de la nation qu'il avoit soumise, mourut dans la petite bicoque de Linterne, après avoir subjugué l'Afrique, défait en Espagne quatre des plus grands généraux Carthaginois, pris Syphax roi de Numidie, vaincu Annibal, rendu Carthage tributaire de Rome, & forcé Antiochus à passer au-delà du mont Taurus.
On grava sur la tombe de cet homme immortel ces paroles remarquables, qu'il prononçoit lui-même quelquefois : Ingrata patria, nequidem habebis ossa mea.
Tous les auteurs qui ont parlé de Linterne, nous disent qu'après sa destruction par les Vandales en 455, on érigea sur le tombeau du grand Scipion la tour qu'on y voit encore ; & comme il n'étoit resté de l'inscription que le seul mot patria, cette tour fut appellée torre di patria. Le lac voisin, autrefois Literna, ou Linterna palus, se nomme aussi Lago di patria ; en un mot, on a donné le nom de Patria à la bourgade, à la tour, au lac, & même à la riviere qui est marquée dans plusieurs cartes, Rio Clanio, overo Patria. Voyez PATRIA.
Linterne a été épiscopale avant que d'être entierement ruinée. On en apperçoit quelques masures sur le golfe de Gaëte, entre Pouzzoles & l'embouchure du Volturno, environ à trois lieues de l'une & de l'autre, près de la tour di patria. (D.J.)
|
| LINTHÉES | S. f. (Comm.) étoffe de soie qui se fabrique à Nanquin.
|
| LINTZ | en latin moderne Lentia, (Géog.) ville forte d'Allemagne, capitale de la haute Autriche, située dans une belle plaine sur le Danube, à 12 milles S. E. de Passau, 36 N. E. de Munich, 30 O. de Vienne. Long. suivant Képler & Cassini, 32 deg. 46 min. 15 sec. lat. 48. 16. (D.J.)
LINTZ, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans le haut électorat de Cologne, sur le Rhin, à 5 milles N. O. de Coblentz, S. O. de Cologne. Long. 24. 56. lat. 50. 31. (D.J.)
|
| LINUISE | S. f. (Agriculture) c'est ainsi qu'on appelle la graine du lin qu'on destine à ensemencer une liniere.
|
| LINURGUS | S. m. (Hist. nat.) pierre fabuleuse dont on ne nous apprend rien, sinon qu'on la trouvoit dans le fleuve Acheloüs. Les anciens l'appelloient aussi lapis lineus : on l'enveloppoit dans un linge, & lorsqu'elle devenoit blanche, on se promettoit un bon succès dans ses amours. Voyez Boece de Boot.
|
| LIOMEN | ou LUMNE, s. m. (Hist. nat.) oiseau aquatique de la grosseur d'une oie, qui se montre en été sur les mers du nord qui environnent les îles de Féroé ; il ressemble beaucoup à l'oiseau que les habitans de ces îles nomment imbrim. Il vole très-difficilement à cause de la petitesse de ses aîles ; ce qui fait que lorsqu'il apperçoit quelqu'un, sa seule ressource est de se coucher à terre & de se tapir, lorsqu'il est hors de l'eau. Il ne laisse pas de s'aider de ses aîles lorsque le vent souffle. Il fait son nid sur de petites éminences qui se trouvent au bord des rivieres, & il ne discontinue pas de couver ses oeufs, même lorsque les eaux croîssent au point de couvrir son nid. Voyez acta hafniensia, année 1671 & 72, observ. 49. Cet oiseau est le mergus maximus farrensis de Clusius. Linnaeus le nomme colymbus pedibus palmatis indivisis.
|
| LION | S. m. leo, (Hist. nat. Zoolog.) animal quadrupede si fort & si courageux, qu'on l'a appellé le roi des animaux. Il a la tête grosse, le muffle allongé & la face entourée d'un poil très-long : le cou, le garrot & les épaules, &c. sont couverts d'un poil aussi long qui forme une belle criniere sur la partie antérieure du corps, tandis qu'il n'y a qu'un poil court & ras sur le reste du corps, excepté la queue qui est terminée par un bouquet de longs poils. La lionne n'a point de criniere ; son muffle est encore plus allongé que celui du lion, & ses ongles sont plus petits. La criniere du lion est de couleur mêlée de brun & de fauve foncé ; le poil ras a des teintes de fauve, de blanchâtre & de brun sur quelques parties. Le poil de la lionne a aussi une couleur fauve plus ou moins foncée, avec des teintes de noir & même des taches de cette couleur sur la levre inférieure près des coins de la bouche sur le bord de cette levre & des paupieres, à l'endroit des sourcils, sur la face extérieure des oreilles & au bout de la queue.
Il y a des lions en Afrique, en Asie & en Amérique ; mais ceux de l'Afrique sont les plus grands & les plus féroces, cependant on remarque que les lions du mont Atlas n'approchent point de ceux du Sénégal & de la Gambra pour la hardiesse & la grosseur. Les lions aiment les pays chauds, & sont sensibles au froid. Ces animaux jettent leur urine en arriere, mais ils ne s'accouplent pas à reculons, comme on l'a prétendu. La lionne porte quatre lionceaux, & quelquefois plus. On les apprivoise aisément ; il y en a qui deviennent aussi doux & aussi caressans que des chiens, mais il faut toujours se défier de leur férocité naturelle. Il est très-faux que le lion s'épouvante au chant d'un coq, mais le feu l'effraie ; on en allume pour le faire fuir. La démarche ordinaire de cet animal est lente & grave ; lorsqu'il poursuit sa proie, il court avec une grande vîtesse ; il est hardi & intrépide ; quel que soit le nombre de ses adversaires, il attaque tout ce qui se présente si la faim le presse ; la résistance augmente sa fureur : mais s'il n'est pas affamé, il n'attaque pas ceux qu'il rencontre ; lorsqu'ils se détournent & se couchent par terre en silence, le lion continue son chemin comme s'il n'avoit vu personne. On prétend que cet animal ne boit qu'une fois en trois ou quatre jours, mais qu'il boit beaucoup à la fois. Hist. nat. des animaux par MM. de Nobleville & Salerne, tome V.
LION, (Mat. medic.) & dans le lion aussi, on a cherché des remedes. Le sang, la graisse, le cerveau, le poumon, le foie, le fiel, la fiente, sont donnés pour médicamenteux par les anciens Pharmacologistes. Les modernes ne croient plus aux vertus particulieres attribuées à ces drogues, & ils n'en font absolument aucun usage. (b)
LION, (Littérat.) cet animal étoit consacré à Vulcain dans quelques pays, à cause de son tempérament tout de feu. On portoit une effigie du lion dans les sacrifices de Cybele, parce que ses prêtres avoient, dit-on, le secret d'apprivoiser ces animaux. Les poëtes l'assurent, & les médailles ont confirmé les idées des poëtes, en représentant le char de cette déesse attelé de deux lions. Celui qu'Hercule tua sur le mont Theumessus en Béotie, fut placé dans le ciel par Junon. Ce signe, composé d'un grand nombre d'étoiles, & entr'autres de celle qu'on nomme le coeur du lion, le roitelet, regulus, tient le cinquieme rang dans le zodiaque. Le soleil entre dans ce signe le 19 Juillet ; d'où vient que Martial dit, liv. X. épigr. 62.
Albae leone flammeo calent luces,
Tostamque fervens Julius coquit messem.
Voyez LION, constellation. (D.J.)
LION, (Hist. nat. Ictiolog.) Rondelet donne ce nom, d'après Athénée & Pline, à un crustacée qui ressemble aux crabes par les bras, & aux langoustes par le reste du corps. Il a été nommé lion, parce qu'il est velu, & qu'il a une couleur semblable à celle du lion. Voyez Rond. hist. des poissons, liv. XVIII.
LION MARIN, (Hist. nat. des anim.) gros animal amphibie, qui vit sur terre & dans l'eau.
On le trouve sur les bords de la mer du Sud, & particulierement dans l'île déserte de Juan Fernandez, où on peut en tuer quantité. Comme il est extrêmement singulier, & que le lord amiral Anson n'a pas dédaigné de le décrire dans son voyage autour du monde, le lecteur sera bien-aise de le connoître d'après le récit d'un homme si célebre.
Les lions marins, qui ont acquis leur crue, peuvent avoir depuis douze jusqu'à vingt piés de long, & depuis huit jusqu'à quinze de circonférence. La plus grande partie de cette corpulence vient d'une graisse mollasse, qu'on voit flotter sous la pression des muscles au moindre mouvement que l'animal fait pour se remuer. On trouve plus d'un pié de profondeur dans quelques endroits de son corps, avant que de parvenir à la chair & aux os. En un mot, l'abondance de cette graisse est si considérable dans les plus gros de ces animaux, qu'elle rend jusqu'à cent vingt-six galons d'huile, c'est-à-dire environ neuf cent quarante livres.
Malgré cette graisse, ces sortes d'animaux sont fort sanguins ; car quand on leur fait de profondes blessures dans plusieurs endroits du corps, il en jaillit tout de suite autant de fontaines de sang. Mais pour déterminer quelque chose de plus précis à ce sujet, j'ajoute que des gens de l'amiral Anson ayant tué un lion marin à coups de fusil, l'égorgerent par curiosité, & en tirerent deux barriques pleines de sang.
La peau de ces animaux est de l'épaisseur d'un pouce, couverte extérieurement d'un poil court, de couleur tannée-claire. Leur queue & leurs nageoires qui leur servent de piés quand ils sont à terre, sont noirâtres. Les extrémités de leurs nageoires ne ressemblent pas mal à des doigts joints ensemble par une membrane ; cependant cette membrane ne s'étend pas jusqu'au bout des doigts, qui sont chacun garnis d'un ongle.
Outre la grosseur qui les distingue des veaux marins, ils en different encore en plusieurs choses, surtout les mâles, qui ont une espece de trompe de la longueur de cinq ou six pouces, & qui pend du bout de la mâchoire supérieure ; cette partie ne se trouve pas dans les femelles, & elles sont d'ailleurs beaucoup plus petites que les mâles.
Ces animaux passent ensemble l'été dans la mer, & l'hiver sur terre ; c'est alors qu'ils travaillent à leur accouplement, & que les femelles mettent bas avant que de retourner à la mer. Leur portée est de deux petits à la fois ; ces petits tetent, & ont en naissant la grandeur d'un veau marin parvenu à son dernier période de croissance.
Pendant que les lions marins sont sur terre, ils vivent de l'herbe qui abonde aux bords des eaux courantes ; & le tems qu'ils ne paissent pas, ils l'emploient à dormir dans la fange. Ils mettent de leurs camarades autour de l'endroit où ils dorment ; & dès qu'on approche seulement de la horde, ces sentinelles ne manquent pas de leur donner l'allarme par des cris fort différens, selon le besoin ; tantôt ils grognent sourdement comme des cochons, & tantôt ils hennissent comme les chevaux les plus vigoureux.
Quand ils sont en chaleur, ils se battent quelquefois pour la possession des femelles jusqu'à l'entier épuisement de leurs forces. On peut juger de l'acharnement de leurs combats par les cicatrices dont le corps de quelques-uns de ces animaux est tout couvert.
Leur chair n'est pas moins bonne à manger que celle du boeuf, & leur langue est bien plus délicate. Il est facile de les tuer, parce qu'ils marchent aussi lourdement que lentement, à cause de l'excès de leur graisse. Cependant il faut se garder de la fureur des meres : un des matelots du lord Anson fut la triste victime de son manque de précaution ; il venoit de tuer un lionceau marin pour l'équipage ; & l'écorchoit tout de suite, lorsque la mere se rua sur lui, le renversa par terre, & lui fit une morsure à la tête, dont il mourut peu de jours après. (D.J.)
LION, (Astron.) est le cinquieme des douze signes du zodiaque. Voyez ETOILE, LIGNE & CONSTELLATION.
Les étoiles de la constellation du lion sont dans le catalogue de Ptolémée au nombre de 32, & dans celui de Tycho au nombre de 37. Le catalogue anglois en compte 94.
LION, (Marine) c'étoit autrefois l'ornement le plus commun qu'on mettoit à la pointe de l'éperon ; les Hollandois le mettent encore ordinairement, d'autant qu'il y a un lion dans les armes de l'état. Les autres nations y mettent présentement des sirenes ou autres figures humaines : le terme général étoit anciennement bestion.
La grandeur de ces figures de l'éperon est assez arbitraire ; cependant les Hollandois suivent cette proportion : savoir, pour un vaisseau de 134 piés de long, de l'étrave à l'étambord, ils donnent au lion 9 piés de long, 19 pouces d'épaisseur, hormis par derriere où il n'a qu'un pié. La tête fait saillie de 14 pouces en avant de la pointe de l'éperon, & s'éleve de 2 piés 7 pouces au-dessus du bout de l'aiguille. (Z)
LION, (Blason) le lion a différentes épithetes dans le Blason. Il est ordinairement appellé rampant & ravissant ; & quand sa langue, ses ongles, & une couronne qu'on lui met sur la tête, ne sont pas du même émail que le reste de son corps, on dit qu'il est armé, couronné & lampassé. On dit aussi lion issant & lion naissant. Le premier est celui qui ne montre que la tête, le cou, les bouts des jambes, & les extrémités de la queue contre l'écu ; & l'autre est celui qui ne faisant voir que le train de devant, la tête & les deux piés, semble sortir du champ entre la face & le chef. On appelle lion brochant sur le tout, celui qui étant posé sur le champ de l'écu, chargé déja d'un autre blason, en couvre une partie. Le lion mort né, est un lion sans dents & sans langue ; & le lion diffamé, celui qui n'a point de queue. Lion dragoné, se dit d'un animal qui a le derriere du serpent, & le devant du lion ; & lion léopardé, d'un lion passant, qui montre toute la tête comme fait le léopard.
LION d'or, (Monnoies) ancienne monnoie de France. Les premiers lions d'or furent fabriqués sous Philippe de Valois en 1338, & succéderent aux écus d'or. Ils furent ainsi nommés à cause du lion qui est sous les piés du Roi de France. Si le roi d'Angleterre est désigné par ce lion, on n'a jamais fait de monnoie plus insultante, & par conséquent plus odieuse. Ces lions d'or de Philippe de Valois valoient cinquante sols en 1488.
On fabriqua de nouveaux lions d'or sous François I. Cette derniere monnoie d'or avoit pour légende, sit nomen Domini benedictum, & pour figure, un lion. Elle pesoit trois deniers cinq grains, & valoit cinquante-trois sols neuf deniers. (D.J.)
|
| LIONCEAUX | (Blason) terme dont on se sert au lieu de lion, lorsque l'écu en porte plus de deux, & qu'on n'emploie guere sans cela.
|
| LIONNÉ | adj. en terme de Blason, se dit des léopards rampans. Léopard de Bresse, d'or, au léopard lionné de gueules.
|
| LIONS | (Géogr.) en latin moderne, Leonium, petite ville de France dans la haute Normandie, entre le Vexin normand & le pays de Bray, dans une forêt dite la forêt de Lions, sur le penchant d'un coteau, à quatre lieues de Gournay, & six à sept de Rouen. Long. 19. 10. lat. 46. 25.
Benserade (Isaac de), nâquit à Lions en 1612. Sa famille & son véritable nom ne paroissent pas trop connus. Il vint jeune à la cour, & s'y donna pour parent du cardinal de Richelieu, ce qui pouvoit bien être. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il en eut une pension, & qu'il trouva le secret d'en augmenter la somme sous le cardinal Mazarin, jusqu'à douze mille livres de ce tems-là, ce qui seroit vingtquatre mille livres du nôtre. Il dut principalement sa réputation aux vers qu'il composa pour les ballets du Roi, & fut reçû de l'academie françoise en 1674 ; mais ses métamorphoses d'Ovide en rondeaux furent l'écueil de sa gloire. Comme on lui donnoit beaucoup d'esprit, on a beaucoup vanté ses bons mots ; cependant si nous en jugeons par quelques-uns de ceux qu'on nous a conservés, nous avons lieu de penser que Benserade n'étoit pas meilleur plaisant que bon poëte. Il mourut presque octogénaire en 1690, d'une saignée qu'on lui fit pour le préparer à l'opération de la taille. Le chirurgien lui piqua l'artere ; dirai-je dans cette conjoncture, heureusement ou malheureusement ? (D.J.)
|
| LIOUBE | S. m. (Marine) c'est une entaille que l'on fait pour enter un bout de mât sur la partie qui est restée debout, lorsque le mât a été rompu par un gros tems.
|
| LIPARA | (Géogr. anc.) la plus grande des îles appellées Lipara, Lipareorum, ou Liparensium insulae, autrement dites les îles Eolies, ou Vulcaniennes. On les nomma , Liparae, du roi Liparus, à qui Eole succéda. La ville capitale prit aussi le surnom de l'isle. Les Siciliens les appellent l'une & l'autre Lipari. Voyez LIPARI.
|
| LIPARE | PIERRE DE, (Hist. nat.) pierre fort estimée des anciens, & à laquelle, suivant leur coûtume, ils attribuoient beaucoup de vertus ridicules. On la tiroit de Lipara, l'une des îles Eoliennes. On dit qu'elle étoit de la grosseur d'une noisette, d'une couleur grise, & très-facile à écraser entre les doigts. Plusieurs naturalistes croient que c'étoit une pierre-ponce.
|
| LIPARI | (Géogr.) par les anciens, Liparae, île de la mer Méditerranée, au nord de la Sicile, dont elle est comme une annexe. C'est la plus grande des îles de Lipari, auxquelles elle a donné son nom. Son circuit peut être d'environ dix-huit milles ; l'air y est sain & tempéré. Elle abonde en grains, en figues, en raisins & en poisson. Elle fournit aussi du bitume, du soufre, de l'alun, & a plusieurs sources d'eaux chaudes. Il ne faut pas s'en étonner ; elle a eu des volcans, & c'est peut-être de là qu'est venu le nom d'îles Vulcaniennes. Elles ont toujours suivi la destinée de la Sicile. La capitale dont nous allons dire un mot, s'appelle aussi Lipari. (D.J.)
LIPARI, (Géogr.) ville capitale de l'île de même nom, avec un évêché suffragant de Messine. Elle est bien ancienne, s'il est vrai qu'elle fut bâtie avant le siege de Troie, & qu'Ulysse y vint voir Eole, successeur de Liparus, fondateur de cette ville.
Les Lipariens, au rapport de Diodore de Sicile, étoient une colonie des Cnidiens, nation greque, originaire de la Carie ; ils fonderent d'abord en Sicile une ville, qu'ils nommerent Motya, & puis s'établirent à Lipara. Dans la suite des tems les Carthaginois s'emparerent de Lipara, sous la conduite de Himilcon, & lui imposerent un tribut de cent talens. Lorsque les Romains furent vainqueurs des Carthaginois, ils leur firent perdre la souveraineté de Lipara, qui selon les apparences, devint colonie romaine, car Pline, liv. III. chap. ix. en parle en ces termes : Lipara cum civium Romanorum oppido.
En 1544 Barberousse ruina de fond en comble l'ancienne ville de Lipara, située sur un rocher escarpé, & que la mer baignoit en partie. Il emmena captifs en Turquie, plusieurs milliers d'habitans du pays ; mais Charles-Quint répara cette ville de son mieux, & en fit une place forte. Elle est située à environ quarante milles de la côte septentrionale de la Sicile. Long. 33. lat. 38. 35. (D.J.)
|
| LIPARIS | S. m. (Hist. nat. Icht.) c'est-à-dire, poisson gras, & en effet c'est un poisson qui a beaucoup de graisse. Rondelet rapporte que l'ayant gardé quelque tems, il l'avoit trouvé fondu en huile. Il compare la tête de ce poisson à celle d'un lapin. Sa bouche est petite ; il n'a point de dents ; ses écailles sont petites. Il a un large trait qui s'étend le long du corps depuis la tête jusqu'à la queue ; deux nageoires près des ouies, deux au-dessous, une entre l'anus & la queue, & enfin une sixieme le long du dos ; la queue est fourchue. Rond. Hist. des poissons de mer, liv. IX.
LIPARIS, (Géogr. anc.) riviere de Cilicie ; selon Pline, liv. V. chap. xxvij. elle couloit auprès de Soloë, petite ville de cette province ; & ceux qui s'y baignoient étoient oints, comme si c'eût été avec de l'huile, dit Vitruve. Le mot Liparis a assez de rapport avec , gras, luisant, qui vient de , graisse. (D.J.)
|
| LIPIS | PIERRE DE, (Hist. nat.) nom d'une pierre qui se trouve en Amérique dans le Potosi, près de la ville de Lipis. Elle est intérieurement d'un bleu de saphir avec un peu de transparence. Elle est très-dure, & d'un goût si acerbe, qu'elle ulcere la langue, si on l'en approche. On la pulvérise, & alors elle ressemble à de l'indigo, excepté que sa couleur est plus claire. C'est un violent astringent ; on en mêle dans des emplâtres. Il y a lieu de croire que cette pierre doit sa couleur à une pyrite vitriolique & cuivreuse, qui s'est décomposée, & que c'est du vitriol que viennent ses propriétés. Voyez de Laet, de lapidibus & gemmis.
|
| LIPOME | S. m. terme de Chirurgie ; loupe graisseuse, ou tumeur formée par la graisse épaissie dans les cellules de la membrane adipeuse. Il en vient par-tout ; on en voit sur-tout de monstrueuses entre les épaules. On voyoit il y a quelques années à Paris, un homme avec une tumeur graisseuse, qui s'étendoit depuis le col jusqu'au bas du dos. On dit qu'un coup de poing entre les deux épaules a été la cause premiere de cette congestion de sucs, sous le faix de laquelle cet homme a plié pendant plusieurs années. Voyez LOUPE.
Lipome est un mot qui vient du grec , formé de , adeps, graisse. (Y)
|
| LIPOPSYCHIE | S. f. (Medec.) état de défaillance où le pouls manque, & où la chaleur naturelle commence à abandonner le corps. Ce terme dérive de , j'abandonne, & , la vie. C'est un mot entierement synonyme à lipothymie. Voyez LIPOTHYMIE & SYNCOPE. (D.J.)
|
| LIPOTHYMIE | S. f. (Medec.) ce nom est composé des deux mots grecs, , je quitte, & , esprit, courage ; ainsi littéralement lipothymie signifie un délaissement d'esprit, un découragement. On regarde la lipothymie comme le premier degré de syncope ; une espece d'évanouissement léger, où les fonctions vitales sont un peu diminuées, l'exercice des sens simplement suspendu, avec un commencement de pâleur & de refroidissement. On a remarqué que cependant alors les malades conservoient la faculté de penser & de se ressouvenir. On dissipe ordinairement cet état par quelque odeur un peu forte, suave, ou desagréable, ou par l'aspersion de l'eau froide sur le visage ; si on n'y remédie pas promtement, il devient une syncope parfaite ; les causes en sont les mêmes que celles de l'évanouissement, avec cette seule différence qu'elles sont un peu moins actives ; & comme dans tout le reste la lipothymie n'en differe que par degrés, nous renvoyons à cet article. Voyez EVANOUISSEMENT. (M)
|
| LIPOU | S. m. (Hist. de la Chine) le lipou, dit le pere Lecomte, est l'un des grands tribunaux souverains de l'empire de la Chine. Il a inspection sur tous les mandarins, & peut leur donner ou leur ôter leurs emplois. Il préside à l'observation & au maintien des anciennes coûtumes. Il regle tout ce qui regarde la religion, les sciences, les arts & les affaires étrangeres. Voyez LI-POU. (D.J.)
|
| LIPPA | (Géogr.) Lippa, ville de Hongrie, prise & reprise plusieurs fois par les Turcs sur les Impériaux ; mais enfin les Turcs s'en étant rendus maîtres en 1691, l'abandonnerent en 1695, après en avoir démoli les fortifications. Elle est au bord de la riviere sur une montagne, à quatre lieues N. E. de Témeswar, trente N. E. de Belgrade. Long. 40. 35. lat. 45. 50. (D.J.)
|
| LIPPE | (Géog.) comté & petit état d'Allemagne sur la riviere de même nom en Westphalie, entre les évêchés de Paderborn & de Munster, le duché de Westphalie, les comtés de Ravensperg & de Pirmont. Lippstadt en est la capitale.
Ludolphe Kuster, un des premiers Grammairiens de ce siecle, étoit du comté de la Lippe. Il fit ses seules délices de l'étude des mots grecs & latins, & n'eut jamais d'autre goût. On prétend qu'ayant un jour ouvert les pensées de Bayle sur les cometes, " Ce n'est-là, dit-il, en le jettant sur la table, qu'un livre de raisonnement, non sic itur ad astra ". Aussi ne courut-il la carriere de la célébrité que par les travaux pénibles des répertoires de la langue greque & latine.
Nous lui devons la meilleure & la plus belle édition de Suidas, qui parut à Cambridge en 1705, en 3 vol. in-fol. On sait que Suidas vivoit il y a cinq ou 600 ans ; son livre est une espece de dictionnaire universel, historique & grammatical, dont les articles sont pour la plupart, des extraits ou des fragmens d'autres anciens qui ne se trouvent quelquefois que là ; mais Suidas ne cite pas toujours les auteurs qu'il copie ; plus souvent il les copie mal : quelquefois il confond les personnes & les événemens ; quelquefois il conte différemment le même fait, ou attribue à différentes personnes les actions d'une seule. Avant Kuster, ce lexique de Suidas étoit donc très-défectueux. Il y a peut-être laissé encore bien des erreurs ; mais enfin, il l'a mis au jour sur la collection des plus anciens manuscrits. Il a réformé la traduction de Portus ; il a corrigé ou rétabli huit à dix mille mots dans le texte ; il a rapporté à leurs sources quantité de passages, dont les auteurs originaux n'étoient pas indiqués. Il s'occupa jour & nuit de cette besogne pendant quatre ans, avec tant d'attache que s'étant une fois réveillé au bruit du tonnerre, il ne songea dans sa frayeur qu'à sauver son cher Suidas, avec tout l'empressement que peut avoir un pere pour sauver son fils unique.
M. Kuster donna l'Aristophane en 1710, en 3 vol. in-fol. & son édition supérieure à toutes, n'entre en comparaison avec aucune des précédentes. Sophocle, le plus ancien & le plus élevé des tragiques grecs qui nous restent, étoit avant l'édition de Kuster, l'un des plus défigurés, & qui demandoit le plus les soins d'un habile critique.
En 1712, il mit au jour une nouvelle édition du testament grec de Mill, ce célebre professeur d'Oxfort qui avoit employé plus de 30 ans à cet ouvrage, que tant de gens attaquerent de toutes parts.
M. Kuster mourut à Paris en 1717, âgé de 46 ans, étant alors occupé à préparer une nouvelle édition d'Hésychius, lexicographe plus difficile en un sens, & beaucoup plus utile à certains égards que Suidas, parce qu'Hésychius est plein de mots singuliers, qui ne se trouvent point ailleurs, & dont la signification n'est souvent expliquée que par un certain nombre de synonymes de la même langue, qui en supposent une connoissance parfaite. Le travail de Kuster sur Hésychius, ne s'est trouvé poussé au-moins à demeure que jusqu'à la lettre . Je supprime les autres ouvrages de cet habile humaniste, sans croire néanmoins m'être trop étendu sur ceux qu'il a mis au jour ; car tous nos lecteurs ne connoissent pas assez Suidas, Hésychius, Mill, Aristophane & Sophocle ; mais voyez l'éloge de Kuster par M. de Boze. (D.J.)
LIPPE, (Géog. anc. & mod.) riviere d'Allemagne dans la Westphalie ; Tacite la nomme Luppia, Pomponius Méla Lupia, Dion & Strabon ; & dans les annales de France, on l'appelle Lippa & Lippia. Elle a sa source au pié du château & bourg de Lippspring, nom même qui l'indique, & à un mille de Paderborn dans l'évêché de ce nom. Strabon a cru qu'elle se perdoit dans la mer, avec l'Ems & le Wéser, ce qui est une grande erreur ; elle se perd dans le Rhin, au-dessus & auprès de Wésel.
C'est aux bords de la Lippe que mourut Drusus, frere cadet de Tibere, après avoir reçu le consulat à la tête de ses troupes en 734, à l'âge de 30 ans, dans son camp appellé depuis, par la raison de sa perte, le camp détestable, castra scelerata.
On eut tort toutefois de s'en prendre au camp, puisque la mort du fils de Livie fut causée par une chûte de cheval qui s'abattit sous lui, & lui rompit une jambe. Il avoit soumis les Sicambres, les Usipètes, les Frisiens, les Chérusques & les Cattes, & s'étoit avancé jusqu'à l'Elbe. Il joignit le Rhin & l'Yssel par un canal qui subsiste encore aujourd'hui. Enfin, ses expéditions germaniques lui mériterent le surnom de Germanicus, qui devint héréditaire à sa postérité. Ses belles qualités le firent extrêmement chérir d'Auguste, qui dans son testament l'appelloit avec Caïus & Lucius pour lui succéder. Rome lui dressa des statues, & on éleva en son honneur des arcs de triomphes & des mausolées jusques sur les bords du Rhin. (D.J.)
|
| LIPPITUDE | lippitudo, (Méd. & Chirur. Ocul.) est un mot employé par Celse pour signifier une maladie des yeux, autrement nommée ophthalmie. Voyez OPHTHALMIE.
LIPPITUDE, chez les auteurs modernes signifie la maladie appellée vulgairement chassie, qui consiste dans l'écoulement d'une humeur épaisse, visqueuse & âcre qui suinte des bords des paupieres, les colle l'une à l'autre, les enflamme & souvent les ulcere. Voyez SCLEROPHTHALMIE.
L'application des compresses trempées dans la décoction des racines d'althea est fort bonne pour humecter & lubrifier les paupieres & le globe de l'oeil dans la lippitude ou chassie. (Y)
|
| LIPPSTADT | Lippia, (Géog.) ville d'Allemagne dans la Westphalie, capitale du comté de la Lippe, autrefois libre, & impériale, à présent sujette en partie à ses comtes & en partie au roi de Prusse, électeur de Brandebourg. Il est vraisemblable que c'est une ville nouvelle, fondée dans le xij. siecle, quoique quelques-uns la prennent pour la Luppia de Ptolémée. Elle est dans un marais mal-sain sur la Lippe, à 7 lieues S. O. de Paderborn, 13 S. E. de Munster. Long. 26. 2. lat. 51. 43. (D.J.)
|
| LIPTOTE | S. f. (Rhétor.) c'est la figure que l'on appelle autrement de diminution, parce qu'elle augmente & renforce la pensée, lorsqu'elle semble la diminuer par l'expression. Cette figure est de toutes les langues & de tous les pays. Les orateurs & les poëtes l'emploient souvent avec grace. Non sordidus autor naturae, verique, désigne dans Horace un admirable auteur sur la Physique & sur la Morale. Neque tu choreas sperne, puer, veut dire, aimez, goûtez à votre âge les danses & les ris. Quid prodest quod me ipsum non spernis, Aminta, signifie dans Virgile : votre tendre amour, Amyntas, m'est encore un surcroît de peines. Cette figure est si commune en françois, que je n'ai pas besoin d'en citer des exemples ; nous disons d'un buveur qu'il ne hait pas le vin, pour dire qu'il ne peut pas résister à ce goût, &c. (D.J.)
|
| LIPYRIE | S. f. (Médec.) espece de fievre continue ou rémittente, accompagnée de l'ardeur interne des entrailles & d'un grand froid extérieur.
Causes de cette fievre. Toute acrimonie particuliere irritante, logée dans un des visceres, & agissant sur les filets nerveux de cette partie, peut allumer la fievre lipyrie, & produire une sensation interne de chaleur brûlante, tandis que les vaisseaux des muscles resserrés par des spasmes, privent les parties externes du cours du sang, & y causent un sentiment de froid insupportable ; ainsi l'inflammation des intestins, du foie, de la vésicule du fiel empêchant la sécrétion ou le cours de la bile ; cette bile devenue plus âcre par le séjour, excitera bientôt la fievre nommée lipyrie.
Symptomes. Le malade est inquiet, agité, privé du sommeil, tourmenté d'angoisses, de dégoûts, de nausées, se plaignant sans cesse d'une chaleur interne & brûlante, en même tems que du froid aux extrêmités. S'il survient alors naturellement des déjections de bile, le malade en reçoit son soulagement ou sa guérison.
Méthode curative. Il faut employer les antiphlogistiques mêlés aux savonneux, donnés tiédes, fréquemment & en petites doses ; on y joindra des clysteres semblables : on appliquera des fomentations à la partie souffrante ; on ranimera doucement la circulation languissante par quelques antiseptiques cardiaques & par de légeres frictions aux extrêmités. (D.J.)
|
| LIQUATION | eliquatio, s. f. (Métallur.) c'est ainsi qu'on nomme dans les fonderies une opération par laquelle on sépare du cuivre la portion d'argent qu'il peut contenir ; cette portion d'argent se trouve dans le cuivre, parce que souvent les mines de cuivre sont mêlées avec des particules de mines d'argent. L'opération de la liquation est une des plus importantes dans la Métallurgie : elle exige beaucoup d'expérience & d'habileté dans ceux qui la pratiquent. Pour la faire on commence par joindre avec le cuivre noir une certaine quantité de plomb ou de matiere contenant du plomb, telle qu'est la litharge : ce plomb entrant en fusion s'unit avec l'argent, avec qui il a plus d'affinité que l'argent n'en a avec le cuivre ; & après que le plomb s'est chargé de la portion d'argent, il l'entraîne avec lui, & le cuivre reste sous une forme poreuse & spongieuse : alors il est dégagé pour la plus grande partie de l'argent qu'il contenoit.
L'opération par laquelle on joint du plomb avec le cuivre noir, se nomme rafraîchir, voyez cet article ; elle se fait en joignant du plomb avec le cuivre noir encore rouge qui, au sortir du fourneau, a été reçu dans la casse ou dans le bassin destiné à cet usage : par ce moyen on forme des especes de gâteaux ou de pains composés de cuivre & de plomb, que l'on nomme pains ou pieces de rafraîchissement.
Ou bien au lieu de joindre du plomb au cuivre noir de la maniere qu'il vient d'être indiqué, on fond avec lui de la litharge, qui est une vraie chaux de plomb, ou de la cendrée de la grande coupelle, qui est imbibée de chaux de plomb. Par le contact des charbons qui sont dans le fourneau, ces substances reprennent leur forme métallique, elles redeviennent du plomb, & ce métal s'unit avec le cuivre noir ; & le tout étant fondu découle dans le bassin, & forme ce qu'on nomme des pains ou pieces de rafraîchissement.
On porte ces pains sur le fourneau de liquation qui a été suffisamment décrit à l'article CUIVRE, pag. 544, où l'on trouvera aussi l'explication de la Planche qui le représente. On les place verticalement sur ce fourneau, en laissant un intervalle entre chaque pain pour pouvoir mettre du charbon entr'eux, & l'on met un morceau de fer entre deux pour qu'ils se soutiennent droits : alors on allume le feu, & le plomb découle des pains ou pieces qui sont posés sur le fourneau ; ils deviennent poreux & spongieux par les trous qu'y laisse l'argent en se dégageant : pour lors on les appelle pains ou pieces de liquation. On les fait passer par une nouvelle opération qu'on appelle ressuage, voyez cet article. Quant au plomb qui a découlé après s'être chargé de l'argent, on le nomme plomb d'oeuvre, & on en sépare l'argent à la coupelle.
Dans cette opération on a encore ce qu'on appelle des épines de liquation : ce sont de petites masses anguleuses & hérissées de pointes qui contiennent de la litharge, du cuivre, du plomb & de l'argent ; l'on fait repasser ces épines par le fourneau de fusion dans une autre occasion.
Avant que de recourir à l'opération de la liquation, il faut connoître la quantité d'argent que contient le cuivre, & s'être assuré par des essais si elle est assez considérable pour qu'on puisse la retirer avec profit. C'est sur cette quantité d'argent qu'il faudra aussi se régler pour savoir la quantité de plomb qu'il conviendra de joindre au cuivre noir. Par exemple, on joint 250 livres de plomb sur 75 livres de cuivre noir qui contient peu d'argent ; si le cuivre noir étoit riche & contenoit neuf ou dix onces d'argent, il faudroit, sur 75 livres de cuivre, mettre 375 livres de plomb.
Il est plus avantageux de se servir de bois & de fagots pour la liquation, que de charbon : c'est une découverte qui est dûe à Orschall, qui a fait un traité en faveur de cette méthode. Voyez l'art. de la fonderie d'Orschall.
|
| LIQUEFIER | LIQUEFACTION, (Gramm.) c'est rendre fluide par l'action du feu ou par quelque autre dissolvant.
|
| LIQUENTIA | (Géogr. anc.) riviere d'Italie au pays de la Vénétie, selon Pline, liv. III. chap. xviij. qui dit qu'elle a sa source dans les monts voisins d'Opitergium, Oderzo. Le nom moderne est Livenza, voyez LIVENZA. (D.J.)
|
| LIQUEUR | S. f. (Hydr.) Il y en a de grasses & de maigres : les maigres sont l'eau, le vin & autres ; les grasses sont l'huile, la gomme, la poix, &c.
De tous les corps liquides on ne considere que l'eau dans l'hydraulique & dans l'hydrostatique, ou du-moins on y considere principalement l'équilibre & le mouvement des eaux : on renvoie les autres liqueurs à la physique expérimentale. (K)
LIQUEURS spiritueuses, (Chimie & Diete) Elles sont appellées plus communément liqueurs fortes, ou simplement liqueurs.
Ces liqueurs sont composées d'un esprit ardent, d'eau, de sucre, & d'un parfum ou substance aromatique qui doit flatter en même tems l'odorat & le goût.
Les liqueurs les plus communes se préparent avec les esprits ardens & phlegmatiques, connus sous le nom vulgaire d'eau de-vie : celles-là ne demandent point qu'on y emploie d'autre eau que ce phlegme surabondant qui met l'esprit ardent dans l'état d'eau-de-vie, voyez ESPRIT-DE-VIN à l'article VIN. Mais comme toutes les eaux-de-vie & même la bonne eau-de-vie de France, qui est la plus parfaite de toutes, ont en général un goût de feu & une certaine âcreté qui les rendent désagréables, & que cette mauvaise qualité leur est enlevée absolument par la nouvelle distillation qui les réduit en esprit-de-vin, les bonnes liqueurs, les liqueurs fines sont toujours préparées avec l'esprit-de-vin tempéré par l'addition de deux parties, c'est-à-dire du double de son poids d'eau commune. L'emploi de l'esprit-de-vin au lieu de l'eau-de-vie, donne d'ailleurs la faculté de préparer des liqueurs plus ou moins fortes, en variant la proportion de l'esprit-de-vin & de l'eau.
Le parfum se prend dans presque toutes les matieres végétales odorantes ; les écorces des fruits éminemment chargés d'huile essentielle, tels que ceux de la famille des oranges, citrons, bergamottes, cédras, &c. la plus grande partie des épiceries, comme gérofle, cannelle, macis, vanille, &c. les racines & semences aromatiques, d'anis, de fenouil, d'angélique, &c. les fleurs aromatiques, d'orange, d'oeillet, &c. les sucs de plusieurs fruits bien parfumés, comme d'abricots, de framboises, de cerises, &c.
Lorsque ce parfum réside dans quelque substance seche, comme cela se trouve dans tous les sujets dont nous venons de parler, excepté les sucs des fruits, on l'en extrait ou par le moyen de la distillation, ou par celui de l'infusion. C'est ordinairement l'esprit-de-vin destiné à la composition de la liqueur qu'on emploie à cette extraction : on le charge d'avance du parfum qu'on se propose d'introduire dans la liqueur, soit en distillant au bain-marie de l'eau-de-vie ou de l'esprit-de-vin avec une ou plusieurs substances aromatiques, ce qui produit des esprits ardens aromatiques, voyez ESPRIT, soit en faisant infuser ou tirant la teinture de ces substances aromatiques. Voyez INFUSION & TEINTURE.
Les liqueurs les plus délicates, les plus parfaites & en même tems les plus élégantes, se préparent par la voie de la distillation ; & le vrai point de perfection de cette opération consiste à charger l'esprit-de-vin autant qu'il est possible, sans nuire à l'agrément, de partie aromatique proprement dite, sans qu'il se charge en même tems d'huile essentielle : car cette huile essentielle donne toûjours de l'âcreté à la liqueur, & trouble sa transparence. Au lieu qu'une liqueur qui est préparée avec un esprit ardent aromatique qui n'est point du tout huileux, & du beau sucre, est transparente & sans couleur, comme l'eau la plus claire : telle est la bonne eau de cannelle d'Angleterre ou des îles. Les esprits ardens distillés sur les matieres très-huileuses, comme le zest de cédra ou de citron, sont presque toûjours huileux, du moins est-il très-difficile de les obtenir absolument exempts d'huile. L'eau qu'on est obligé de leur mêler dans la préparation de la liqueur, les blanchit donc, & d'autant plus qu'on emploie une plus grande quantité d'eau ; car les esprits ardens huileux supportent sans blanchir le mêlange d'une certaine quantité d'eau presque parties égales, lorsqu'ils ne sont que peu chargés d'huile. C'est pour ces raisons que la liqueur assez connue sous le nom de cédra, est ou louche ou très-forte : car ce n'est pas toujours par bisarrerie ou par fantaisie que telle liqueur se fait plus forte qu'une autre, tandis qu'il semble que toutes pourroient varier en force par le changement arbitraire de la proportion d'eau : souvent ces variations ne sont point au pouvoir des artistes, dumoins des artistes ordinaires, qui sont obligés de réparer par ce vice de proportion un vice de préparation. Une autre ressource contre ce même vice, l'huileux des esprits ardens aromatiques, c'est la coloration : l'usage de colorer les liqueurs n'a d'autre origine que la nécessité d'en masquer l'état trouble, louche : ensorte que cette partie de l'art qu'on a tant travaillé à perfectionner depuis, qui a tant plu, ne procure au fond qu'une espece de fard qui a eu même fortune que celui dont s'enduisent nos femmes, c'est-à-dire, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes, qu'employé originairement à masquer des défauts, il a enfin déguisé le chef d'oeuvre de l'art dans les liqueurs, la transparence sans couleur, comme il dérobe à nos yeux, sur le visage des femmes, le plus précieux don de la nature, la fraîcheur & le coloris de la jeunesse & de la santé.
Quant à l'infusion ou teinture, on obtient nécessairement par cette voie, outre le parfum, les substances solubles par l'esprit-de-vin, qui se trouvent dans la matiere infusée, & qui donnent toujours de la couleur & quelqu'âcreté, au-moins de l'amertume ; l'esprit-de-vin ne touche que très-peu à l'huile essentielle des substances entieres auxquelles on l'applique, lors même qu'elles sont très-huileuses, par exemple aux fleurs d'orange ; mais si c'est à des substances dont une partie des cellules qui contiennent cette huile ayent été brisées, par exemple, du zest de citron, un esprit-de-vin digéré sur une pareille matiere, peut à peine être employé à préparer une liqueur supportable. Aussi cette voie de l'infusion est-elle peu usitée & très-imparfaite. Le ratafiat à la fleur d'orange est ainsi préparé, principalement dans la vûe médicinale de faire passer dans la liqueur le principe de l'amertume de ces fleurs, qui est regardé comme un très-bon stomachique.
On peut extraire aussi le parfum des substances seches par le moyen de l'eau, & employer encore ici la distillation ou l'infusion. Les eaux distillées ordinaires, voyez EAUX DISTILLEES, employées en tout ou en partie au lieu d'eau commune, rempliroient la premiere vûe ; mais elles ne contiennent pas communément un parfum assez fort, assez concentré, assez pénétrant, pour percer à-travers l'esprit-de-vin & le sucre. Il n'y a guere que l'eau de fleur d'orange & l'eau de cannelle appellée orgée, voyez EAUX DISTILLEES, qui puissent y être employées. On prépare à Paris, sous le nom d'eau divine, une liqueur fort connue & fort agréable, dont le parfum unique ou au-moins dominant, est de l'eau de fleur d'orange. On a un exemple de parfum extrait, par une infusion à l'eau, dans une forte infusion de fleurs d'oeillet rouge qu'on peut employer à préparer un ratafiat d'oeillet.
On peut encore employer l'eau & l'esprit-de-vin ensemble, c'est-à-dire de l'eau-de-vie, à extraire les parfums par une voie d'infusion. On a par ce moyen des teintures moins huileuses ; mais comme nous l'avons observé plus haut, avec de l'eau-de-vie, on n'a jamais que des liqueurs communes, grossieres.
Enfin on fait infuser quelquefois la matiere du parfum dans une liqueur, d'ailleurs entierement faite, c'est-à-dire dans le mêlange, à proportion convenable d'esprit-de-vin, d'eau & de sucre. On prépare, par exemple, un très-bon ratafiat d'oeillet, ou plus proprement de gérofle, en faisant infuser quelques clous de gérofle dans un pareil mêlange. On fait infuser des noyaux de cerises dans le ratafiat de cerise, d'ailleurs tout fait.
Une troisieme maniere d'introduire le parfum dans les liqueurs, c'est de l'y porter avec le sucre, soit sous forme d'oleosaccharum, soit sous forme de sirop. Les liqueurs parfumées par le premier moyen sont toujours louches & âcres ; elles ont éminemment les défauts que nous avons attribués plus haut à celles qui sont préparées avec des esprits ardens, aromatiques, huileux. Le sirop parfumé employé à la préparation des liqueurs, en est un bon ingrédient : on prépare une liqueur très-simple & très-bonne, en mêlant du bon sirop de coing, à des proportions convenables d'esprit-de-vin & d'eau.
Le simple mêlange des sucs doux & parfumés de plusieurs fruits, comme abricots, peches, framboises, cerises, muscats, coings, &c. aux autres principes des liqueurs, fournissent enfin la derniere & plus simple voie de porter le parfum dans ces compositions. Sur quoi il faut observer que, comme ces sucs sont très-aqueux, & plus ou moins sucrés, ils tiennent lieu de toute eau, & sont employés en la même proportion ; & qu'ils tiennent aussi lieu d'une partie plus ou moins considérable de sucre. On prépare en Languedoc, où les cerises mûrissent parfaitement & sont très-sucrées, un ratafiat avec les sucs de ces fruits, & sans sucre, qui est fort agréable & assez doux.
La proportion ordinaire du sucre, dans les liqueurs qui ne contiennent aucune autre matiere douce, est de trois à quatre onces pour chaque livre de liqueur aqueo-spiritueuse. Dans les liqueurs très-sucrées qu'on appelle communément grasses, à cause de leur consistance épaisse & onctueuse, qui dépend uniquement du sucre ; il y est porté jusqu'à la dose de cinq & même de six onces par livres de liqueur.
Le mêlange pour la composition d'une liqueur étant fait, & le sucre entierement fondu, on la filtre au papier gris, & même plusieurs fois de suite. Cette opération non-seulement sépare toutes les matieres absolument indissoutes, telles que quelques ordures, & particules terreuses communément mêlées au plus beau sucre, &c. mais même une partie de cette huile essentielle à-demi-dissoute, qui constitue l'état louche dont nous avons parlé plus haut : ensorte que ce louche n'est proprement un defaut, que lorsqu'il resiste au filtre, comme il le fait communément du moins en partie.
Le grand art des liqueurs consiste à trouver le point précis de concentration d'un parfum unique employé dans une liqueur, & la combinaison la plus agréable de divers parfums. Les notions majeures que nous avons données sur leur essence & sur leurs especes, & même les regles fondamentales de leur préparation que nous avons exposées, ne sauroient former des artistes, du-moins des artistes consommés, des Sonini & des le Lievre. C'est aussi uniquement au lecteur qui veut savoir ce qu'est cet art, & préparer pour son usage quelques liqueurs simples, & non à celui qui voudroit en faire métier, que nous l'avons destiné ; l'article suivant contient plus de détails.
Les liqueurs ne sont dans leur état de perfection que lorsqu'elles sont vieilles. Les différens ingrédiens ne sont pas mariés, unis dans les nouvelles. Le spiritueux y perce trop, y est trop sec, trop nud. Une combinaison plus intime est l'ouvrage de cette digestion spontanée que suppose la liquidité ; & il est utile de la favoriser, d'augmenter le mouvement de liquidité, en tenant les liqueurs (comme on en use dans les pays chauds pour les vins doux, & même nos vins acidules généreux de Bordeaux, de Roussillon, de Languedoc, &c.) dans des lieux chauds, au grenier en été, dans des étuves en hiver.
Les liqueurs spiritueuses dont nous venons de parler, c'est-à-dire, les esprits ardens, aqueux, sucrés, & parfumés, ont toutes les qualités médecinales, absolues, bonnes ou mauvaises, des esprits ardens, dont elles constituent une espece distinguée seulement par le degré de concentration, c'est-à-dire, de plus ou moins grande aquosité. Car le sucre n'est point un correctif réel de l'esprit ardent qui joint au contraire dans son mêlange avec le corps doux toute son énergie, & qui dans les liqueurs n'est véritablement affoibli que par l'eau. Or, comme les esprits ardens ne se prennent pour l'ordinaire intérieurement que sous forme d'eau-de-vie, c'est-à-dire, à peu-près aussi aqueux que l'esprit ardent des liqueurs ; il est évident que non-seulement les qualités absolues de l'esprit ardent pur, & de l'esprit ardent des liqueurs sont les mêmes ; mais aussi que le degré de forces, de spirituosité de ces liqueurs, & de ces esprits ardens potables, & communément fins, est assez égal. Le parfum châtre, encore moins que le sucre, l'activité de l'esprit-de-vin. On pourroit plus vraisemblablement soupçonner qu'il l'augmente au contraire, ou du-moins la seconde. Car la substance aromatique, proprement dite, est réellement échauffante, irritante, augmentant le mouvement des humeurs ; mais elle est ordinairement en trop petite quantité dans les liqueurs pour produire un effet sensible. Celles qui laissent un sentiment durable & importun de chaleur & de corrosion dans l'estomac, le gosier, la bouche, & quelquefois même la peau, & les voies urinaires, ne doivent point cet effet à leur parfum, mais à de l'huile essentielle, que nous avons déja dit en être un ingrédient desagréable, & qui en est encore, comme l'on voit, un ingrédient pernicieux. A ce dernier effet près (qui ne doit pas être mis sur le compte des liqueurs, puisque les bonnes qui ne doivent point contenir le principe auquel il est dû, ne sauroient le produire), on peut donc assûrer que les liqueurs considérées du côté de leur effet médecinal, ont absolument, & même à-peu-près quant à l'énergie ou degré, les mêmes vertus bonnes ou mauvaises, que les simples esprits ardens. Voyez ESPRIT DE VIN, à l'article VIN.
Il est bien vrai que les liqueurs sont des especes de vins doux artificiels ; mais l'art n'imite en ceci la nature que fort grossierement. Il ne parvient point à marier les principes spiritueux, au sucre, à l'eau, comme il l'étoit dans le vin, à de l'eau, à du tartre, à une partie extractive ou colorante, qui châtroient réellement son activité. En un mot l'esprit ardent, une fois retiré du vin, ne se combine de nouveau par aucun art connu, ne se tempere, ne s'adoucit comme il l'étoit dans le vin ; les liqueurs contiennent de l'esprit-de-vin très-nud. On prépare certaines liqueurs spiritueuses, qui sont plus particulierement destinées à l'usage de la médecine, qui sont des remedes, & qui ont plus ou moins de rapport à celles dont nous venons de parler, lesquelles sont principalement destinées à l'usage de la table : les premieres sont connues sous le nom d'élixir. Voyez ELIXIR.
LIQUEUR DE CAILLOU, (Chimie) liquor silicum. Voyez la fin de l'article CAILLOU.
LIQUEUR DE CORNE DE CERF SUCCINEE, (Chimie, & Mat. méd.) on nomme ainsi un sel neutre resous, ou existant sous forme liquide, formé par l'union de l'alkali volatil de corne de cerf, au sel volatil acide de succin. Cette préparation ne demande aucune manoeuvre particuliere ; pour l'avoir cependant aussi élégante qu'il est possible, il est bon d'employer ces deux sels convenablement rectifiés.
Le sel contenu dans cette liqueur est un sel ammoniacal, huileux ou savonneux, c'est-à-dire enduit ou pénétré d'huile de corne de cerf, & d'huile de succin, que les sels respectifs ont retenu avec eux, lors même qu'ils ont été rectifiés.
C'est un remede moderne qu'on célebre principalement comme anti-spasmodique, & desobstruant, dans les maladies nerveuses des deux sexes, & principalement pour les femmes, dans les passions hystériques, dans les suppressions des regles, &c. (b)
LIQUEUR DE CRYSTAL, (Chimie) c'est proprement la même chose que la liqueur de caillou. Voyez la fin de l'article CAILLOU. Car il y a une analogie parfaite quant à la composition intérieure ou chimique entre le caillou & le vrai crystal de roche, le crystal vitrifiable. Voyez CRYSTAL. (b)
LIQUEUR ETHEREE de Frobenius, (Chimie.) Voyez ÉTHER.
LIQUEUR FUMANTE, ou ESPRIT FUMANT de Libavius, (Chimie.) On connoît sous ce nom le beurre d'étain plus ou moins liquide. Cette liqueur tire son nom du chimiste qui l'a fait connoître le premier, & de sa propriété singuliere de répandre continuellement des fumées blanches. On peut la préparer ou en distillant ensemble une partie d'étain & trois parties de sublimé corrosif, ou bien, selon le procédé de Stahl, en distillant ensemble parties égales de sublimé corrosif, & d'un amalgame préparé avec quatre parties d'étain, & cinq parties de mercure. On distille l'un & l'autre mêlange dans une cornue de verre, à laquelle on adapte un récipient de verre qu'il est bon de tenir plongé dans l'eau froide.
La liqueur fumante de Libavius attire puissamment l'humidité de l'air, très-vraisemblablement parce que l'acide marin surabondant qu'elle contient, y est dans un état de concentration peut-être absolue, du-moins très-considérable. On explique très-bien par cette propriété l'éruption abondante des vapeurs très-sensibles, qu'on peut même appeller grossieres, dans cet ordre de phénomenes, qui s'en détachent sans cesse. Ces vapeurs sont composées de l'acide qui s'évapore, & d'une quantité considérable d'eau de l'athmosphere, qu'il attire, & à laquelle il s'unit. Ce phénomene nous paroît avoir beaucoup plus d'analogie avec la fausse précipitation, celle de la dissolution de mercure par l'acide marin par exemple, qu'avec l'effervescence, auquel le très-estimable auteur des notes sur la chimie de Lemery, le rapporte.
La liqueur fumante de Libavius précipite l'or de sa dissolution dans l'eau régale sous la forme d'une poudre de couleur de pourpre, qui étant employée dans les verres colorés, dans les émaux, les couvertes des porcelaines, &c. y produit cette magnifique couleur.
Mais la propriété la plus piquante pour la curiosité du chimiste dogmatique, c'est celle que M. Rouelle le cadet y a découverte tout récemment, savoir, d'être propre à la production d'un éther. Car 1°. cette découverte satisfait à un problème chimique qui exerçoit depuis long-tems les artistes, sans le moindre succès ; & elle est plus précieuse encore, comme confirmant un point très-important de doctrine chimique, savoir le dogme de la surabondance des acides dans les sels métalliques, & de leur état éminent de concentration sous cette forme. (b)
LIQUEUR, ou huile d'étain, (Chimie) c'est le nom vulgaire de la dissolution d'étain par l'eau régale. Voyez ÉTAIN, (Hist. nat. Minér. & Métal.)
LIQUEUR, ou huile de mars, (Chimie, & Mat. méd.) Voyez à l'article MARTIAUX, (Remedes.)
LIQUEUR, ou eau mercurielle, (Chimie, & Mat. méd.) Voyez à l'article MERCURE, (Pharmac. & Mat. méd.)
LIQUEUR, ou huile de mercure, (Chimie.) Voyez à l'article MERCURE, (Pharmac. & Mat. méd.)
LIQUEUR MINERALE ANODYNE d'Hoffman, (Chim. & mat. méd.) on ne sait pas positivement quelle est la liqueur que le célebre Frideric Hoffman employoit sous le nom de la liqueur minérale anodyne : mais on sait parfaitement qu'il en tiroit le principe essentiel, ou les principes essentiels des produits de la distillation de l'esprit-de-vin avec l'acide vitriolique, qu'il a le premier renouvellé.
Selon la description qu'Hoffman a laissée de son procédé, obs. phys. chim. lib. II. obs. xiij. il est clair qu'il n'a point obtenu d'éther, mais seulement ce qu'il appelle avec quelques anciens chimistes, un esprit doux de vitriol, qui n'est autre chose que de l'esprit-de-vin très-aromatique, empreint d'une légere odeur d'éther, dûe sans doute à une petite portion de cette substance, qu'on n'en sauroit pourtant séparer par les moyens connus, savoir, la rectification & la précipitation par l'eau. Hoffman a obtenu secondement un esprit sulphureux, volatil, dont il ne s'est pas occupé ; & une bonne quantité d'huile éthérée, plus pesante que l'eau, qu'il appelle desideratissimum sulphur vitrioli ; anodynum in liquidâ formâ ; & verum oleum vitrioli dulce.
C'est ce dernier produit, connu aussi parmi les chimistes très-modernes, sous le nom d'huile du vin, qu'Hoffman célebre uniquement ; c'est de ce principe qu'il dit : ejus virtutes in medendo mihi sunt notissimae, & eas ego non satis depraedicare possum.
On convient aussi généralement que l'huile douce de vitriol entre dans la composition de la liqueur minérale anodyne d'Hoffman, & même qu'elle en fait l'ingrédient principal. Il est à présumer encore que cette liqueur est une dissolution à saturation, d'huile douce de vitriol, ou du vin, dans un menstrue convenable. Ce menstrue convenable relativement à l'usage, est évidemment de l'esprit-de-vin. Reste donc à savoir seulement si Hoffman prenoit, & si on doit prendre les deux premiers produits de la distillation de l'esprit de vin avec l'acide vitriolique, qui ne sont l'un & l'autre, selon cet auteur, que de l'esprit-de-vin, dont la premiere portion est simplement fragrans, & la seconde fragrantior ; ou bien du bon esprit-de-vin rectifié ordinaire.
M. Baron pense qu'Hoffman a expliqué assez clairement qu'il suivoit la derniere méthode, dans ce passage de son observation phys. chim. déja citée : Hoc oleum (sc. vitrioli dulce), aromaticum, recens, exquisitè solvitur in spiritu vini rectificatissimo, ipsique saporem, odorem, & virtutem confert anodynam ac sedativam in omnibus doloribus & spasmis utilissimam. Il est vraisemblable en effet que cette dissolution de l'huile douce de vitriol, dans le simple esprit-de-vin rectifié, est la liqueur minérale anodyne d'Hoffman : mais il l'est presqu'autant au moins, qu'Hoffman préféroit les deux premiers produits de sa distillation, ou son esprit doux de vitriol, puisqu'il le regardoit comme de l'esprit-de-vin, mais comme de l'esprit-de-vin déja pourvû de quelques qualités analogues à celles du principe dont il vouloit le saouler.
Mais c'est-là une question de peu de conséquence : il importe davantage de savoir si on doit préparer aujourd'hui la liqueur minérale anodyne, avec l'esprit-de-vin rectifié ordinaire, ou avec les deux portions différemment aromatisées d'esprit-de-vin qui sont les deux premiers produits de la distillation de six, quatre, & même deux parties d'esprit-de-vin, avec une partie de bon acide vitriolique ; il est clair qu'il faut n'y employer que l'esprit-de-vin ordinaire, parce qu'il ne faut plus exécuter l'opération qui fournit ces deux produits ; & il ne faut plus exécuter cette opération, parce qu'elle est inutile, dumoins très-imparfaite, puisqu'un de ses principaux objets étant la production de l'éther (voyez ÉTHER Frobenii), & cet objet étant manqué dans l'opération qui donne les deux produits dont nous parlons, ce n'est pas la peine de les préparer ex professo, ou pour eux-mêmes. Il n'en est pas moins vrai, comme nous l'avons avancé à la fin de l'art. ÉTHER Frobenii, que la liqueur minérale anodyne d'Hoffman n'est dans presque toutes les boutiques que les premiers produits de la distillation manquée de l'éther, ordinairement sans addition, & quelquefois chargés de quelques gouttes d'huile douce de vitriol.
Fr. Hoffman assure d'après des expériences très-réitérées pendant le cours d'une longue pratique, que sa liqueur minérale anodyne étoit un remede souverain dans toutes les maladies convulsives, & qu'elle calmoit très-efficacement les grandes douleurs. On la donne depuis vingt jusqu'à quarante gouttes dans une liqueur appropriée. On employe dans les mêmes vûes, mais à moindre dose, l'éther de Frobenius, qui est même préférable, comme plus efficace, à la liqueur minérale anodyne. Voyez ÉTHER Frobenii. (b)
LIQUEUR de nitre fixe ou fixé, (Chimie.) Voyez à l'article NITRE.
LIQUEUR de sel de tartre, (Chimie.) Voyez SEL DE TARTRE, au mot TARTRE.
|
| LIQUIDAMBAR | S. m. (Hist. nat. des drog. exot.) liquidambarum, off. C'est, dit M. Geoffroy, un suc résineux, liquide, gras, d'une consistance semblable à la térébenthine, d'un jaune rougeâtre, d'un goût âcre, aromatique, d'une odeur pénétrante, qui approche du styrax & de l'ambre.
On l'apportoit autrefois de la nouvelle Espagne, de la Virginie, & d'autres provinces de l'Amérique méridionale. Quelquefois on apportoit en même tems une huile roussâtre plus ténue & plus limpide que le liquidambar.
L'arbre qui donne la résine ambrée, s'appelle liquidambari arbor, sive styracifera, aceris folio, fructu tribuloïde, id est, pericarpio orbiculari, ex plurimis apicibus coagmentato, semen recondens, dans Pluk. Phyt. tab. 42. Xochiocotzo Quahuitt, seu arbor liquidambari indici, Hernand. 56. Styrax aceris folio, Raii, hist. 2. 1848. Arbor virginiana, aceris folio, vel potiùs platanus virginiana, styracem fundens, Breyn. Prod. 2. 1799. Acer virginianum, odoratum, Herm. Catal. Hort. Lugd. Batav. 641.
C'est un arbre fort ample, beau, grand, branchu, & touffu ; ses racines s'étendent de tous côtés ; son tronc est droit ; son écorce est en partie roussâtre, en partie verte, & odorante ; ses feuilles sont semblables à celles de l'érable, partagées au-moins en trois pointes blanchâtres d'un côté, d'un verd un peu foncé de l'autre, dentelées à leur circonférence, & larges de trois pouces ; ses fleurs viennent en bouquets ; ses fruits sont sphériques, épineux comme ceux du plane, composés de plusieurs capsules jaunâtres, saillantes, & terminées en pointe : dans ces capsules sont renfermées des graines oblongues, & arrondies.
Il découle de l'écorce de cet arbre, soit naturellement, soit par l'incision que l'on y fait, le suc résineux, odorant, & pénétrant, qu'on nomme liquidambar. On séparoit autrefois de ce même suc récent, & mis dans un lieu convenable, une liqueur qui s'appelloit huile de liquidambar. Quelques-uns coupoient par petits morceaux les rameaux & l'écorce de cet arbre, dont ils retiroient une huile qui nageoit sur l'eau, & qu'ils vendoient pour le vrai liquidambar. On mettoit aussi l'écorce de cet arbre coupée par petits morceaux avec la résine, pour lui conserver une odeur plus douce & plus durable dans les fumigations. Enfin, on consumoit autrefois beaucoup de liquidambar, pour donner une bonne odeur aux peaux & aux gants.
Mais présentement à peine connoissons-nous de nom ce parfum, nous sommes devenus si délicats, que toutes les odeurs nous font mal à la tête, & causent aux dames des affections hystériques. On ne trouveroit peut-être pas une once de vrai liquidambar dans Paris. (D.J.)
|
| LIQUIDATION | S. f. (Jurisprud. & Com.) est la fixation qui se fait à une certaine somme ou quantité d'une chose dont la valeur ou la quantité n'étoit pas déterminée. Par exemple, lorsqu'il est dû plusieurs années de cens & rentes en grain ou en argent, on en fait la liquidation en fixant la quantité de grain qui est dûe, ou en les évaluant à une certaine somme d'argent.
La liquidation des fruits naturels dont la restitution est ordonnée, se fait sur les mercuriales ou registres des gros fruits. Voyez FRUITS & MERCURIALES. Voyez aussi LIQUIDE & LIQUIDER. (A)
|
| LIQUIDE | adj. f. (Gram.) on appelle articulations & consonnes liquides, les deux linguales l & r. Voyez LINGUALES.
LIQUIDE, adj. pris subst. (Phys.) corps qui a les propriétés de la fluidité, & outre cela la qualité particuliere d'humecter ou mouiller les autres corps qui y sont plongés. Cette qualité lui vient de certaine configuration de ses parties qui le rend propre à adhérer facilement à la surface des corps qui lui sont contigus. Voyez FLUIDE, HUMIDE, UIDITEDITE.
M. Mariotte au commencement de son traité du mouvement des eaux, donne une idée peu différente du corps liquide. Selon lui liquide, est ce qui étant en quantité suffisante, coule & s'étend audessous de l'air, jusqu'à ce que sa surface se soit mise de niveau ; & comme l'air & la flamme n'ont pas cette propriété, M. Mariotte ajoute que ce ne sont point des corps liquides, mais des corps fluides. Au lieu que l'eau, le mercure, l'huile, & les autres liqueurs, sont des corps fluides & liquides. Tout liquide est fluide, mais tout fluide n'est pas liquide ; la liquidité est une espece de fluidité.
Les liquides, selon plusieurs physiciens, sont dans un mouvement continuel. Le mouvement de leurs parties n'est pas visible, parce que ces parties sont trop petites pour être apperçues ; mais il n'est pas moins réel. Entre plusieurs effets qui le prouvent, selon ces philosophes, un des principaux est la dissolution & la corruption des corps durs causée par les liquides. On ne voit, par exemple, aucun mouvement dans de l'eau-forte qu'on a laissé reposer dans un verre ; cependant si l'on y plonge une piece de cuivre, il se fera d'abord une effervescence dans la liqueur : le cuivre sera rongé visiblement tout-autour de sa surface, & enfin il disparoîtra en laissant l'eau-forte chargée par-tout & uniformément de ses parties devenues imperceptibles, & teintes d'un bleu tirant sur le verd de mer. Ce que les eaux fortes sont à l'égard des métaux, d'autres liquides le font à l'égard d'autres matieres ; chacun d'eux est dissolvant par rapport à certains corps, & plus ou moins, selon la figure, l'agitation, & la subtilité de ses parties. Or il est clair que la dissolution suppose le mouvement, ou n'est autre chose que l'effet du mouvement. Ce n'est pas le cuivre qui se dissout de lui-même ; il ne donne pas aussi à la liqueur l'agitation qu'il n'a pas ; le repos de ses parties, & le repos des parties du liquide joints ensemble ; ne produiront pas un mouvement. Il faut donc que les parties du liquide soient véritablement agitées, & qu'elles se meuvent en tous sens, puisqu'elles dissolvent de tous côtés & en tous sens des corps sur lesquels elles agissent. Quoiqu'il y ait des corps tels que la flamme, dont les parties sont extrêmement agitées de bas en haut, ou du centre vers la circonférence par un mouvement de vibration ou de ressort, ils ne sauroient néanmoins être appellés liquides, & ce ne sont que des fluides, parce que le mouvement en tous sens, le poids, & peut-être d'autres circonstances qui pourroient déterminer leurs surfaces au niveau, leur manquent.
Un liquide se change en fluide par l'amas de ses parcelles lorsqu'elles se détachent de la masse totale, comme on voit qu'il arrive à l'eau qui se résout en vapeurs ; car les brouillards & les nuages sont des corps ou des amas fluides, quoique formés de l'assemblage de parcelles liquides ; de même un fluide proprement dit, peut devenir liquide, si l'on insere dans les intervalles des parties qui le composent, quelque matiere qui les agite en tous sens, & les détermine à se ranger de niveau vers la surface supérieure.
Les parties intégrantes des liquides sont solides, mais plus ou moins, disent les Cartésiens, selon que la matiere subtile les comprime davantage, ou par la liberté & la vîtesse avec laquelle elle se meut entr'elles, ou par la quantité & la qualité des surfaces qui joignent entr'eux les élémens ou parties encore plus petites, qui composent les premieres. Ces parties intégrantes sont comme environnées de toute part de la matiere subtile ; elles y nagent, y glissent, & suivent en tous sens les mouvemens qu'elle leur imprime, soit que le liquide se trouve dans l'air, soit qu'il se trouve dans la machine pneumatique. C'est le plus ou le moins de cette matiere enfermée dans un liquide, selon qu'elle a plus ou moins d'agitation & de ressort, qui fait principalement, selon ces philosophes, le plus ou le moins de liquidité : mais le plus ou le moins d'agitation de cette matiere dépend de la grosseur, de la figure, de la nature des surfaces planes ou convexes, ou concaves, polies ou raboteuses, & de la densité des parties intégrantes du liquide. Si dix personnes autour d'une table peuvent y être rangées de 3628800 manieres différentes, ou faire 3628800 changemens d'ordre, on doit juger, ajoutent les Cartésiens, quelle prodigieuse quantité de liquides différens pourront produire toutes les combinaisons & toutes les variétés des circonstances dont on vient de parler.
On demande comment se peut-il que les parties intégrantes des liquides étant continuellement agitées par la matiere subtile, elle ne les dissipe pas en un moment ; soit, par exemple, un verre à demi-plein d'eau, on voit bien que cette eau est retenue vers les côtés & au-dessous, par les parois du verre ; mais qu'est-ce qui la retient au-dessus ? Si l'on dit que le poids de l'athmosphere ou la colonne d'air, qui appuie sur la surface de cette eau, la retient en partie ; le même liquide qui se conserve dans l'air, ne se conservant pas moins dans la machine pneumatique, après qu'on en a pompé l'air, il faut avoir recours à une autre cause. D'où vient encore la viscosité qu'on remarque dans tous les liquides plus ou moins : cette disposition que les gouttes qu'on en détache ont à se rejoindre, & cette legere résistance qu'elles apportent à leur séparation ? De plus, il n'y a point d'apparence que la matiere subtile enfermée dans les interstices d'un liquide, non plus que les parties qui le composent, se meuve avec la même vîtesse que la matiere subtile extérieure ; de même à-peu-près que les vents qui pénetrent jusques dans le milieu d'une forêt, s'y trouvent considérablement affoiblis, les feuilles & tout ce qu'ils y rencontrent y étant beaucoup moins agitées qu'en rase campagne. Or comment se conserve l'équilibre dans ces différens degrés de vîtesse, des parties intégrantes d'un liquide, de la matiere subtile du dedans, & de la matiere subtile du dehors ?
Voici les réponses que l'on peut faire à ces questions selon les Cartésiens. 1°. Les parties d'un liquide ne sont pas exemptes de pesanteur, & elles en ont de même que tous les autres corps, à raison de leur masse & de leur matiere propre ; cette pesanteur est une des puissances qui les assujettit dans le vase où elles sont contenues. 2°. Il ne faut pas croire que la matiere subtile environne les parties intégrantes d'un liquide, de maniere qu'elles ne se touchent jamais entr'elles, & ne glissent jamais les unes sur les autres, selon qu'elles ont des surfaces plus ou moins polies, & qu'elles sont mûes avec plus ou moins de vîtesse. Il est très-probable au contraire que les parties intégrantes des liquides, telles que l'eau, l'huile & le mercure ne se meuvent guere autrement. Or ces parties présentent d'autant moins de surface à la matiere subtile intérieure, qu'elles se touchent par plus d'endroits ; & celles qui se trouvent vers les extrêmités lui en présentent encore moins que les autres. Elles en présentent donc davantage à la matiere subtile extérieure, & comme cette matiere a plus de liberté, & se meut avec plus de vîtesse que l'intérieure, il est clair qu'elle doit avoir plus de force pour repousser les parties du liquide vers la masse totale, que la matiere subtile intérieure n'en a pour les séparer. Ainsi le liquide demeurera dans le vaisseau qui le contient, & de plus il aura quelque viscosité, ou resistera un peu à la division. Pour les liquides fort spiritueux, dont les parties intégrantes sont apparemment presque toutes noyées dans la matiere subtile, sans se toucher entr'elles que rarement, & par de très-petites surfaces, ils sont en même tems & l'exception & la preuve de ce que nous venons de dire, puisqu'ils s'exhalent & se dissipent bientôt d'eux-mêmes, si l'on ne bouche exactement le vaisseau qui les renferme. 3°. Enfin pour comprendre comment les parties des liquides se meuvent avec la matiere subtile qu'ils contiennent, & comment l'équilibre se conserve entr'elles, cette matiere & la matiere subtile extérieure, il faut observer, que quoique chaque partie intégrante de certains liquides soit peut-être un million de fois plus petite que le plus petit objet qu'on puisse appercevoir avec un excellent microscope, il y a apparence que les plus grosses molécules de la matiere subtile sont encore un million de fois, si l'on veut, plus petites que ces parties ; l'imagination se perd dans cette extrême petitesse, mais c'est assez que l'esprit en apperçoive la possibilité dans l'idée de la matiere, & qu'il en conclue la nécessité par plusieurs faits incontestables. Or, cent de ces molécules qui viennent, par exemple, heurter en même tems, selon une même direction & avec une égale vîtesse, la partie intégrante d'un liquide un million de fois plus grosse que chacune d'elles, ne lui communiquent pourtant que peu de leur vîtesse ; parce que leur cent petites masses sont contenues dix mille fois dans la grosse masse, & qu'il faut pour y distribuer, par exemple, un degré de vîtesse, qu'elles fassent autant d'effort contr'elle, que pour en communiquer dix mille degrés à cent de leurs semblables ; car cent de masse multiplié par dix mille de vîtesse, & 1 de vîtesse multiplié par un million de masse, produisent également de part & d'autre un million de mouvemens. Mais ces cent molécules de matieres subtiles sont bientôt suivies de cent autres, & ainsi de suite, peut-être de cent millions ; & comme celles qui viennent les dernieres sur la partie du liquide, lui trouvent déjà une certaine quantité de mouvemens, que les premieres lui ont communiqué, elles l'accélerent toujours de plus en plus, & à la fin elles lui donneroient autant de vîtesse qu'elles en ont elles-mêmes, si la matiere subtile pouvoit toujours couler sur cette partie avec la même liberté, & selon la même direction. Mais la matiere subtile se mouvant en divers sens dans les liquides, & la vîtesse que plusieurs millions de ces molécules peuvent avoir donné à une partie intégrante du liquide, par une application continue & successive de cent en cent, vers un certain côté, étant bientôt détruite ou retardée par plusieurs millions d'autres qui viennent choquer la même partie selon des directions différentes ou contraires ; il est évident que cette partie intégrante du liquide n'aura jamais le tems de parvenir à leur degré d'agitation, & qu'ainsi la supériorité de vîtesse demeurera toujours à la matiere subtile. Cependant il n'est pas possible que cette vîtesse ne soit fort diminuée par-là, & ne se trouve bientôt au-dessous de ce qu'elle est dans la matiere subtile du dehors, qui rencontre bien moins d'obstacles à ces divers mouvemens, obstacles d'autant plus considérables, que la densité du liquide est plus grande, que ses parties intégrantes sont plus grosses, qu'elles ont plus de surface, & que ces surfaces sont moins glissantes. Mais ce que la matiere subtile perd de vîtesse entre les interstices d'un liquide, est compensé par une plus grande tension du ressort de ces molécules, lequel augmente sa force, à mesure qu'il est plus comprimé ; & c'est par-là que l'équilibre se conserve entre les parties intégrantes du liquide, la matiere subtile intérieure, & la matiere subtile du dehors. C'est par l'action & la réaction continuelles & réciproques entre les parties du liquide, & la matiere subtile qu'il contient, & entre ce tout & la matiere subtile extérieure, que les vîtesses, les compressions & les masses multipliées de part & d'autre, donneront toujours un produit égal de force ou de mouvement : ce mouvement & cet équilibre subsisteront tant que le liquide perséverera dans son état de liquidité.
On voit donc que les parties intégrantes d'un liquide sont ce qui s'y meut avec le moins de vîtesse, ensuite c'est la matiere subtile qui coule entr'elles, & qui est plus agitée qu'elles ; & enfin vient la matiere subtile extérieure, dont l'agitation passe celle de tout le reste, & de la vîtesse de laquelle on peut se faire une idée par les effets qu'elle produit dans la poudre à canon & dans le tonnerre.
Ceci est tiré de la Dissertation sur la glace par M. de Mairan, imprimée dans le Traité des vertus médicinales de l'eau commune, Paris, 1730. tome II. pag. 523 & suiv. Article de M. FORMEY.
Nous n'avons pas besoin de dire que tout ceci est purement hypothétique & conjectural, & que nous le rapportons seulement, suivant le plan de notre ouvrage, comme une des principales opinions des Physiciens sur la cause & les propriétés de la liquidité. Car nous n'ignorons pas que ce mouvement prétendu intestin des particules des fluides, est attaqué fortement par d'autres physiciens. Voyez FLUIDE & FLUIDITE.
LIQUIDE, (Jurisprud.) se dit d'une chose qui est claire, & dont la quantité ou la valeur est déterminée ; une créance peut être certaine sans être liquide. Par exemple, un ouvrier qui a fait des ouvrages, est sans contredit créancier du prix ; mais s'il n'y a pas eu de marché fait à une certaine somme, ou que la quantité des ouvrages ne soit pas constatée, sa créance n'est pas liquide, jusqu'à-ce qu'il y ait eu un toisé, ou état des ouvrages & une estimation.
On entend aussi quelquefois par liquide ce qui est actuellement exigible ; c'est pourquoi, quand on dit que la compensation n'a lieu que de liquide à liquide, on entend non-seulement qu'elle ne peut se faire qu'avec des sommes ou quantités fixes & déterminées, mais aussi qu'il faut que les choses soient exigibles, au tems où l'on veut en faire la compensation. Voyez COMPENSATION. (A)
|
| LIQUIDER | v. act. (Comm.) fixer à une somme liquide & certaine des prétentions contentieuses.
Liquider des intérêts, c'est calculer à quoi montent les intérêts d'une somme, à proportion du denier & du tems pour lequel ils sont dûs.
Liquider ses affaires, c'est y mettre de l'ordre en payant ses dettes passives, en sollicitant le payement des actives, ou en retirant les fonds qu'on a, & qui sont dispersés dans différentes affaires & entreprises de commerce. Diction. de Com.
|
| LIQUIDITÉ | (Chimie) mode & degré de raréfaction. Voyez l'article RAREFACTION & RARESCIBILITE, Chimie.
La liquidité est un phénomene proprement physique, puisqu'il est du nombre de ceux qui appartiennent à l'aggrégation, qui sont des affections de l'aggrégé comme tel (voyez à l'article CHIMIE, p. 411. col. 2. & suiv.) ; mais il est aussi de l'ordre de ceux sur lesquels les notions chimiques répandent le plus grand jour, comme nous l'avons déja observé en général, & du phénomene dont il est ici question, en particulier à l'article CHIMIE p. 415. col. 10. Pour nous en tenir à notre objet présent, à la lumiere répandue sur la théorie de la liquidité par la contemplation des phénomenes chimiques ; c'est des événemens ordinaires de la dissolution chimique opérée dans le sein des liquides, que j'ai déduit l'identité de la simple liquidité & de l'ébullition, & par conséquent l'établissement de l'agitation tumultueuse des parties du liquide, des tourbillons, des courans, &c. qui représente l'essence de la liquidité d'une maniere rigoureusement démontrable. Voyez MENSTRUE, Chimie, & l'article CHIMIE, aux endroits déja cités.
Mais la considération vraiment chimique de la liquidité, est celle d'après laquelle Beccher l'a distinguée en liquidité mercurielle, liquidité aqueuse & liquidité ignée. Ce célebre chimiste appelle liquidité mercurielle, celle qui fait couler le mercure vulgaire, & qu'il croit pouvoir être procurée à toutes les substances métalliques, d'après sa prétention favorite sur la mercurification. Voyez MERCURIFICATION.
La liquidité aqueuse est selon lui, celle qui est propre à l'eau commune, à certains sels, & même à l'huile. Il la spécifie principalement par la propriété qu'ont les liquides de cette classe, de mouiller les mains ou d'être humides, en prenant ce dernier mot dans son sens vulgaire.
Enfin, il appelle liquidité ignée, celle que peuvent acquérir les corps fixes, & chimiquement homogènes par l'action d'un feu violent, ou comme les Chimistes s'expriment encore, celle qui met les corps dans l'état de fusion proprement dite. Voyez FUSION, Chimie.
Quelque prix qu'attachent les vrais chimistes aux notions transcendantes, aux vûes profondes, aux germes féconds de connoissances fondamentales que fournissent les ouvrages de Beccher, & notamment la partie de sa physique souterraine, où il traite de ces trois liquidités, voyez Physic. subter. lib. I. sect. 5. c. iij. il faut convenir cependant qu'il étale dans ce morceau plus de prétentions que de faits, plus de subtilités que de vérités, & qu'il y montre plus de sagacité, de génie, de verve, que d'exactitude.
Je crois qu'on doit substituer à cette distinction, trop peu déterminée & trop peu utile dans la pratique, la distinction suivante qui me paroît précise, réelle & utile.
Je crois donc que la liquidité doit être distinguée en liquidité primitive, immédiate ou propre, & liquidité sécondaire, médiate ou empruntée.
La liquidité primitive est celle qui est immédiatement produite par la chaleur, dont tous les corps homogènes & fixes sont susceptibles, & qui n'est autre chose qu'un degré de raréfaction, ou que ce phénomène physique, dont nous avons parlé au commencement de cet article (voyez l'article RAREFACTION & RARESCIBILITE, Chimie), n'importe quel degré de chaleur soit nécessaire pour la produire dans les différentes especes de corps ; qu'elle ait lieu sous le moindre degré de chaleur connue, comme dans le mercure qui reste coulant sous la température exprimée par le soixante & dixieme degré audessous du terme de la congélation du thermometre de Reaumur, qui est ce moindre degré de chaleur, ou l'extrême degré du froid que les hommes ont observé jusqu'à présent (voyez à l'article FROID, Physique, p. 317. col. 1. la table des plus grands degrés de froids observés, &c.), ou bien que comme certaines huiles, celle d'amande douce, par exemple, le froid extrême, c'est-à-dire la moindre chaleur de nos climats suffise pour la rendre liquide ; ou que comme l'eau commune, l'alternative de l'état concret & de l'état de liquidité, arrive communément sous nos yeux ; soit enfin qu'une forte chaleur artificielle soit nécessaire pour la produire, comme dans les substances métalliques, les sels fixes, &c. ou même que l'aptitude à la liquidité soit si foible dans certains corps, qu'ils en ayent passé pour infusibles, & qu'on n'ait découvert la nullité de cette prétendue propriété, qu'en leur faisant essuyer un degré de feu jusqu'alors inconnu, & dont l'effet fluidifiant auquel rien ne résiste, est rapporté à l'article MIROIR ARDENT, voyez cet article. Car de même qu'un grand nombre de corps, tels que toutes les pierres & terres pures, avoient été regardées comme infusibles, avant qu'on eût découvert cet extrême degré de feu ; il y a très-grande apparence que le mercure n'a été trouvé jusqu'à présent inconcrescible, que parce qu'on n'a pu l'observer sous un assez foible degré de chaleur ; & que si l'on pouvoit aborder un jour des plages plus froides que celles où on est parvenu, ou l'exposer à un degré de froid artificiel plus fort que celui qu'on a produit jusqu'à présent, le mercure essuyeroit enfin le même sort que l'esprit-de-vin, long-tems cru inconcrescible, & dont la liquidité trouva son terme fatal à un degré de chaleur encore bien supérieur au moindre degré connu. On peut poursuivre la même analogie jusque sur l'air. Il est très-vraisemblable qu'il est des degrés possibles de froid, qui le convertiroient premierement en liqueur, & secondement en glace ou corps solide. Voyez l'article FROID, Physique, à l'endroit déja cité.
La liquidité empruntée est celle qui est procurée aux corps concrets sous une certaine température, par l'action d'un autre corps qui est liquide sous la même température, c'est-à-dire, par un menstrue à un corps soluble. Voyez MENSTRUE.
C'est ainsi que les corps qui ne pourroient couler par leur propre constitution qu'à l'aide d'un extrême degré de chaleur, comme la chaux, par exemple, peuvent partager la liquidité d'un corps qui n'a besoin pour être liquide, que d'être échauffé par la température ordinaire de notre athmosphere ; le vinaigre par exemple.
Tous les liquides aqueux composés & chimiquement homogenes, tels que tous les esprits acides & alkalis, les esprits fermentés, les sucs animaux & végétaux, & même sans en excepter les huiles, selon l'idée de Beccher, ne coulent que par la liquidité qu'ils empruntent de l'eau ; car il est évident, en exceptant cependant les huiles de l'extrême évidence, que c'est l'eau qui fait la vraie base de toutes ces liqueurs, & que les différens principes étrangers qui l'impregnent ne jouissent que de la liquidité qu'ils lui empruntent. Il est connu que plusieurs de ces principes, les alkalis, par exemple, & peut-être l'acide vitriolique (voyez sous le mot VITRIOL) sont naturellement concrets au degré de chaleur qui les fait couler lorsqu'ils sont réduits en liqueur, c'est-à-dire dissous dans l'eau. On se représente facilement cet état de liquidité empruntée dans les corps où l'eau se manifeste par sa liquidité spontanée, c'est-à-dire dûe à la chaleur naturelle de l'athmosphere ; mais on ne s'apperçoit pas si aisément que ce phénomene est le même dans certains corps concrets auxquels on procure la liquidité par une chaleur artificielle, très-inférieure à celle qui seroit nécessaire pour procurer à ce corps une fluidité immédiate. Certains sels, par exemple, comme le nître & le vitriol de mer crystallisés, coulent sur le feu à une chaleur legere & avant que de rougir, & on peut même facilement porter cet état jusqu'à l'ébullition : mais c'est-là une liquidité empruntée ; ils la doivent à l'eau qu'ils retiennent dans leurs crystaux, & que les Chimistes appellent eau de crystallisation. Ils ne sont susceptibles par eux-mêmes que de la liquidité ignée, & même, à proprement parler, le vitriol qui coule si aisément au moyen de la liquidité qu'il emprunte de son eau de crystallisation, est véritablement infusible sans elle, puisqu'il n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'il se décompose au grand feu plutôt que de couler. Quant au nitre, lorsqu'il est calciné, c'est-à-dire privé de son eau de crystallisation, il est encore fusible, mais il demande pour être liquefié, pour couler d'une liquidité propre & primitive, un degré de chaleur bien supérieur à celui qui le fait couler de la liquidité empruntée ; il ne coule par lui-même qu'en rougissant, en prenant le véritable état d'ignition. Voyez IGNITION.
C'est par la considération de l'influence de l'eau dans la production de tant de liquidités empruntées, que les Chimistes l'ont regardée comme le liquide par excellence. (b)
|
| LIRE | v. act. (Gramm.) c'est trouver les sons de la voix attachés à chaque caractere & à chaque combinaison des caracteres ou de l'écriture ou de la musique ; car on dit lire l'écriture & lire la musique. Voyez l'art. LECTURE. Il se prend au physique & au moral, & l'on dit lire le grec, l'arabe, l'hébreu, le françois, & lire dans le coeur des hommes. Voyez à l'article LECTURE les autres acceptions de ce mot.
Lire, chez les ouvriers en étoffes de soie, en gase, c'est déterminer sur le semple les cordes qui doivent être tirées pour former sur l'étoffe ou la gase le dessein donné. Voyez l'article SOIERIE.
LIRE sur le plomb, (Imprimerie) c'est lire sur l'oeil du caractere le contenu d'une page ou d'une forme. Il est de la prudence d'un Compositeur de relire sa ligne sur le plomb lorsqu'elle est formée dans son composteur, avant de la justifier & de la mettre dans la galée.
|
| LIRIS | (Géogr.) c'est le nom latin de la riviere du royaume de Naples, que les Italiens nomment Garigliano. Voyez GARILLAN.
|
| LIRON | (Géogr.) petite riviere de France en Languedoc ; elle a sa source dans les montagnes, au couchant de Gazouls, & se perd dans l'Orb à Beziers. (D.J.)
|
| LIS | lilium, s. m. (Hist. nat. Botan.) genre de plante dont la fleur forme une espece de cloche. Elle est composée de six pétales plus ou moins rabattues en dehors ; il y a au milieu un pistil qui devient dans la suite un fruit oblong ordinairement triangulaire & divisé en trois loges. Il renferme des semences bordées d'une aîle & posées en double rang les unes sur les autres. Ajoutez aux caracteres de ce genre la racine bulbeuse & composée de plusieurs écailles charnues qui sont attachées à un axe. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIS-ASFODELE, lilio asphodelus, genre de plante à fleur liliacée monopétale ; la partie inférieure de cette fleur a la forme d'un tuyau, la partie supérieure est divisée en six parties. Il fort du fond de la fleur un pistil qui devient dans la suite un fruit presqu'ovoïde, qui a cependant trois côtes longitudinales ; il est divisé en trois loges & rempli de semences arrondies. Ajoutez à ces caracteres que les racines ressemblent à des navets. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIS BLANC, (Botan.) c'est la plus commune des 46 especes de Tournefort du genre de plante qu'on nomme lis. Cette espece mérite donc une description particuliere. Les Botanistes nomment le lis blanc lilium album vulgare, J. Bauh. 2. 685. Tournefort, I. R. H. 369. lilium album, flore erecto, C. B. P. 76.
Sa racine est bulbeuse, composée de plusieurs écailles charnues, unies ensemble, attachées à un pivot, & ayant en dessous quelques fibres. Sa tige est unique, cylindrique, droite, haute d'une coudée & demie, garnie depuis le bas jusqu'au sommet de feuilles sans queues, oblongues, un peu larges, charnues, lisses, luisantes, d'un verd-clair, plus petites & plus étroites insensiblement vers le haut, & d'une odeur qui approche du mouton bouilli quand on les frotte entre les doigts. Ses fleurs ne se développent pas toutes ensemble ; elles sont nombreuses & rangées en épi à l'extrémité de la tige sur une hampe : elles sont belles, blanches, odorantes, composées de six pétales épais, recourbés en dehors, & représentant en quelque maniere une cloche ou une corbeille ; leur centre est occupé par un pistil longuet à trois sillons, d'un blanc verdâtre & de six étamines de même couleur, surmontées de sommets jaunâtres. Le pistil se change en un fruit oblong, triangulaire, partagé en trois lobes remplis de graines roussâtres, bordées d'un feuillet membraneux, posées les unes sur les autres à double rang.
Les feuilles, les tiges & les oignons de cette plante sont remplis d'un suc gluant & visqueux : on la cultive dans nos jardins pour servir d'ornement, à cause de sa beauté & de sa bonne odeur. On dit qu'elle vient d'elle-même en Syrie.
Ses fleurs & ses oignons sont d'usage en Medecine ; le sel ammoniacal qu'ils possedent, joint à une médiocre portion d'huile, forme ce mucilage bienfaisant d'où les oignons tirent leur vertu pour amollir un abcès, le conduire en maturité & à suppuration. On les recommande dans les brûlures, étant cuits sous la cendre, pilés & mêlés avec de l'huile d'olive ou des noix fraîches. (D.J.)
LIS DE SAINT BRUNO, liliastrum, genre de plante à fleur liliacée, composée de six pétales, & ressemblant à la fleur du lis pour la forme. Il sort du milieu de la fleur un pistil qui devient dans la suite un fruit oblong : ce fruit s'ouvre en trois parties qui sont divisées en trois loges & remplies de semences anguleuses. Ajoutez aux caracteres de ce genre que les racines en sont en forme de navets, & qu'elles sortent toutes d'un même tronc. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIS-JACINTHE, lilio hiacinthus, genre de plante à fleur liliacée, composée de six pétales, & ressemblant à la fleur de la jacinthe ; ce pistil devient dans la suite un fruit terminé en pointe, arrondi dans le reste de son étendue, & ayant pour l'ordinaire trois côtes longitudinales. Il est divisé en trois loges, & rempli de semences presque rondes. Ajoutez à ces caracteres que la racine est composée d'écailles comme la racine du lis. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIS-NARCISSE, lilio-narcissus, genre de plante à fleur liliacée, composée de six pétales disposés comme ceux du lis : le calice, qui est l'embrion, devient un fruit ressemblant pour la forme à celui du narcisse. Ajoutez à ces caracteres que le lis-narcisse differe du lis en ce que sa racine est bulbeuse & composée de plusieurs tuniques, & qu'il differe aussi du narcisse en ce que sa fleur a plusieurs pétales. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LIS DES VALLEES, (Botan.) genre de plante que les Botanistes nomment lilium convallium, & qu'ils caractérisent ainsi. L'extrêmité du pédicule s'insere dans une fleur monopétale en cloche pendante en épi, & divisée au sommet en six segmens. L'ovaire croît sur la sommité du pédicule au-dedans de la fleur, & dégénere en une baie molle, sphérique, pleine de petites semences rondes, fortement unies les unes aux autres.
Observons d'abord que le nom de lis est bien mal donné à ce genre de plante, qui n'a point de rapport aux lis : observons ensuite que le petit lis des vallées, lilium convallium minus de Bauhin, n'appartient point à ce genre de plante, car c'est une espece de smilax.
M. de Tournefort compte sept especes véritables de lis des vallées, dont la principale est le lis des vallées blanc, lilium convallium album, que nous appellons communément muguet. Quelquefois sa fleur est incarnate, & quelquefois double, panachée. Voyez la description de cette plante au mot MUGUET. (D.J.)
LIS DES VALLEES, (Mat. med.) Voyez MUGUET.
LIS ou LIS BLANC, (Chimie, Pharmacie, & Mat. med.) La partie aromatique de la fleur des lis n'en est point séparable par la distillation ; l'eau qu'on en retire par ce moyen n'a qu'une odeur desagréable d'herbe, & une très-grande pente à graisser. Voyez EAUX DISTILLEES. L'eau de lis que l'on trouve au rang des remedes dans toutes les pharmacopées, & qui est fort vantée, comme anodine, adoucissante, &c. doit donc être bannie des usages de la Medecine.
L'huile connue dans les dispensaires sous les noms d'oleum lirinum, crinimum & susinum, qu'on prépare en faisant infuser les fleurs des lis dans de l'huile d'olive, est chargée de la partie aromatique des lis, mais ne contient pas la moindre portion du mucilage qui constitue leur partie vraiment médicamenteuse. L'huile de lis n'est donc autre chose que de l'huile d'olive chargée d'un parfum leger, peu capable d'altérer les vertus qui lui sont propres, & par conséquent un remede qui n'augmente pas la somme des secours pharmaceutiques. Voyez HUILE.
Les fleurs de lis cuites dans l'eau & réduites en pulpe, sont employées utilement dans les cataplasmes émolliens & calmans ; mais l'on emploie beaucoup plus communément les oignons de cette plante préparés de la même maniere ; ces oignons sont un des ingrédiens les plus ordinaires des cataplasmes dont on se sert dans les tumeurs inflammatoires qu'on veut conduire à suppuration ; souvent même ce n'est qu'un oignon de lis cuit sous la cendre qu'on applique dans ces affections extérieures. Ce remede réussit presque toujours : ses fréquens succès en ont fait un médicament domestique dont personne n'ignore les usages. (b)
LIS DE PIERRE, lilium lapideum ; (Hist. nat.) nom donné par quelques naturalistes à une pierre sur laquelle on voit en relief un corps qui ressemble à un lis. M. Klein croit que c'est une espece d'étoile de mer dont l'analogue vivant est étranger à nos mers ; il l'appelle entrochus ramosus. Il trouve que par la figure il a du rapport avec l'étoile de mer de Magellan. Quelques auteurs croient que cette pierre est la même que l'encrinos ou l'encrinite dont Agricola donne la description, aussi-bien que Lachmund dans son Oryctographia Hildesheimensis. Voyez l'article ENCRINITE. Cependant Scheuchzer appelle pierre de lis un fragment de corne d'ammon, sur la surface ou l'écorce de laquelle on voyoit comme imprimées des fleurs de lis semblables à celles qui sont dans les armes de France. Mais il paroît que c'est l'encrinos qui doit à juste titre rester en possession du nom de pierre de lis ou de lis de pierre. (-)
LIS, ou NOTRE DAME DU LIS, (Hist. mod.) ordre militaire institué par Garcias IV. roi de Navarre, à l'occasion d'une image de la sainte Vierge, trouvée miraculeusement dans un lis, & qui guérit ce prince d'une maladie dangereuse. En reconnoissance de ces deux événemens, il fonda en 1048 l'ordre de Notre-Dame du Lis, qu'il composa de trente-huit chevaliers nobles, qui faisoient voeu de s'opposer aux Mores, & s'en réserva la grande-maîtrise à lui & à ses successeurs. Ceux qui étoient honorés du collier, portoient sur la poitrine un lis d'argent en broderie, & aux fêtes ou cérémonies de l'ordre une chaîne d'or entrelacée de plusieurs M M gothiques, d'où pendoit un lis d'or émaillé de blanc, sortant d'une terrasse de sinople, & surmonté d'une grande M, qui est la lettre initiale du nom de Marie. Favin, hist. de Navarre.
LIS, (Hist. mod.) nom d'un ordre de chevalerie institué en 1546 par le pape Paul III. qui chargea les chevaliers de défendre le patrimoine de saint Pierre, contre les entreprises de ses ennemis, comme il avoit établi pour le même but, ceux de saint Georges dans la Romagne, & de Lorette dans la Marche d'Ancone, quoique Favin rapporte l'origine de celui-ci à Sixte V. & le fasse de quarante-un ans postérieur à la création qu'en fit Paul III. selon d'autres auteurs.
Les chevaliers du lis étoient d'abord au nombre de cinquante, qu'on appelloit aussi participans, parce qu'ils avoient fait au pape un présent de 25000 écus, & on leur avoit assigné sur le patrimoine de saint Pierre, un revenu de trois mille écus, outre plusieurs privileges dont ils furent décorés. La marque de l'ordre est une médaille d'or que les chevaliers portent sur la poitrine ; on y voit d'un côté l'image de Notre-Dame du Chesne, ainsi nommée d'une église fameuse à Viterbe, & de l'autre un lis bleu céleste sur un fond d'or, avec ces mots : Pauli III. Pontific. Max. Munus. Paul IV. confirma cet ordre en 1556, & lui donna le pas sur tous les autres. Les chevaliers qui le composent portent le dais sous lequel marche le pape dans les cérémonies lorsqu'il n'y a point d'ambassadeurs de princes pour faire cette fonction. Le nombre de ces chevaliers fut augmenté la même année jusqu'à trois cent cinquante. Bonanni, catalog. equestr. ordin.
LIS D'ARGENT, (Monnoie) monnoie de France, qu'on commença à fabriquer ainsi que les lis d'or, en Janvier 1656. Les lis d'argent, dit le Blanc, pag. 387, étoient à onze deniers douze grains d'argent fin, de trente pieces & demie au marc, de six deniers cinq grains trébuchant de poids chacune, ayant cours pour vingt sols, les demi-lis pour dix sols, & les quarts de lis pour cinq sols. (D.J.)
LIS D'OR, (Monnoie) piece d'or marquée au revers du pavillon de France. Ce fut une nouvelle espece de monnoie, dont la fabrication commença en Janvier 1656, & ne dura guere. Le lis d'or, dit le Blanc, pag. 387, pese 3 deniers 3 grains & demi. Ils sont au titre de vingt-trois carats un quart, à la taille de soixante & demi au marc, pesant trois deniers trois grains & demi trébuchant la piece, & ont cours pour sept livres. Voilà une évaluation faite en homme du métier, qui nous mettroit en état de fixer avec la derniere exactitude, s'il en étoit besoin, la valeur du lis d'or, vis-à-vis de toutes les monnoies de nos jours. Voyez MONNOIE. (D.J.)
LIS, fleur de (Blason.) Voyez FLEUR-DE-LIS, & lisez que ces fleurs ont été réduites à trois, sous Charles V. & non pas sous Charles VII. Je persiste à regarder la conjecture de Chifflet comme plus hasardée que solide ; mais il est vraisemblable, que ce qui fut long-tems une imagination de peintres, devint les armoiries de France. D'anciennes couronnes des rois des Lombards, dont on voit des estampes fideles dans Muratori, sont surmontées d'un ornement semblable, & qui n'est autre chose, que le fer d'une lance lié avec deux autres fers recourbés. Quoiqu'il en soit, cet objet futile ne valoit pas la peine d'exercer la plume de Sainte-Marthe, de Ducange, de du Tillet & du P. Mabillon. Je ne parle pas de Chifflet, de la Roque, des PP. Tristan de Saint-Amand, Ferrand, Ménestrier & Rousselet, jésuites. Ces derniers écrivains ne pouvoient guere se nourrir d'objets intéressans. (D.J.)
LIS, s. m. (Ourdissage) c'est la même chose que les gardes du rot, ou les grosses dents qui sont aux extrêmités du peigne.
LIS, la (Géogr.) en latin Legia, riviere des pays-bas françois. Elle prend sa source à Lisbourg en Artois, & se jette dans l'Escaut à Gand. On voit que le nom de cette riviere, joint à ceux de l'Escaut, de la Meuse, du Rhin & de la Moselle, dans les vers des poëtes françois, lors des conquêtes de Louis XIV. en Flandres, ils lui disent sans cesse, d'une maniere ou d'autre, également éloignées de la vérité :
Et la Meuse, le Rhin, la Moselle & la Lis,
Admirant vos exploits, tendent les bras aux lis. (D.J.)
|
| LISATZ | S. m. (Comm.) toiles qui viennent des Indes, de Perse & de la Mecque. Il y en a de plusieurs qualités. Elles ont deux pics un quart de large, ou cinq pans & demi de Marseille.
|
| LISBONNE | (Géog.) capitale du Portugal, sur le Tage, à quatre lieues de l'Océan, trente-quatre S. O. de Coïmbre, soixante N. O. de Séville, cent six S. O. de Madrid.
Elle est 12d. 57'. 45''. plus orientale que Paris ; lat. 38d. 45'. 25''. selon les observations de M. Couplet, faites sur les lieux en 1698, & rapportées dans les mémoires de l'académie des Sciences, année 1700, pag. 175.
Long. 10. 49. par les observations de Jacobey, rapportées dans les Transactions philosophiques, & approuvées par M. Delisle, dans les mémoires de l'académie royale des Sciences.
Long. selon M. Cassini, 9d. 6'. 30''. lat. 38d. 43'. & selon M. Couplet, 38d. 45'. 25''.
Long. orientale selon M. le Monnier, 8d. 30'. lat. 38d. 42'. 20''.
M. Bradley a établi 9d. 7'. 30''. ou O. H. 36'. 30''. pour différence de longitude entre Londres & Lisbonne. Voyez les Transactions philosophiques, n°. 394.
Cette ville est le séjour ordinaire du roi & de la cour, le siége du premier parlement du royaume, qu'on nomme relaçao, avec un archevêché, dont l'archevêque prend le titre de patriarche, une université, une douanne, dont la ferme est un des plus grands revenus du prince, & un port sur le Tage d'environ quatre lieues de long, estimé le meilleur & le plus célebre de l'Europe, quoiqu'exposé quelquefois à de violens ouragans.
On a vû cette ville briller en amphithéâtre, par sa situation sur sept montagnes, d'où l'on découvre le Tage dans toute son étendue, la campagne & la mer. On vantoit, il n'y a pas six ans, la solidité des forts de Lisbonne & de son château, la beauté de ses places & de ses édifices publics, de ses églises, de ses palais, & sur-tout de celui du roi. Enfin on la regardoit avec raison, comme une des principales villes de l'Europe, & le centre d'un commerce prodigieux. Toutes ces belles choses ont été effacées du livre de vie, par une révolution également promte & inopinée.
" Lisbonne étoit ; elle n'est plus ", dit une lettre qui nous apprit qu'un tremblement de terre arrivé le premier Novembre 1755, en avoit fait une seconde Héraclée ; mais puisqu'on espere aujourd'hui de la tirer de ses ruines, & même de lui rendre sa premiere splendeur, nous laisserons un moment le rideau sur l'affreuse perspective qui l'avoit détruite, pour dire un mot de son ancienneté & des diverses révolutions qu'elle a souffertes, jusqu'à la derniere catastrophe, dont on vient d'indiquer l'époque trop mémorable.
Quoique vivement touché de ses malheurs, je ne puis porter son ancienneté au siecle d'Ulysse, ni croire que ce héros, après la destruction de Troie, en ait jetté les fondemens ; desorte que dès-lors, elle fut appellée Ulyssipone, ou Ulyssipo. Outre que selon toute apparence, Ulysse n'est jamais sorti de la Méditerranée, le vrai nom de cette ville étoit Olyssipo, comme il paroît par l'inscription suivante, qui y a été trouvée. Imp. Caes. M. Julio. Philipp. Fel. Aug. Pontif. Man. Trib. Pot. II. P. P. Cons. III. Fel. Jul. Olissipo. Cette inscription confirme que Lisbonne, après avoir reçû une colonie romaine, prit le nom de Felicitas Julia ; & c'est assez pour justifier son ancienneté.
Elle a été plusieurs fois attaquée, conquise & reconquise par divers peuples. D. Ordogno III. qui régnoit dans le dixieme siecle, s'en rendit maître, & la rasa. Elle fut à peine rebâtie, que les Maures s'en emparerent. D. Henri la reprit au commencement du douzieme siecle, & bientôt après elle retomba sous la puissance des Sarrasins. C'étoit le tems des croisades ; D. Alphonse en obtint une pour la retirer des mains des infideles. On vit en 1145, une flotte nombreuse montée par des Flamands, des Anglois & des Allemands, entrer dans le Tage, attaquer les Maures, & leur enlever Lisbonne. Dès que le comte de Portugal se trouva possesseur de cette ville, il la peupla de chrétiens, & en fit sa capitale, au lieu de Coïmbre, qui l'avoit été jusqu'alors. Un étranger nommé Gilbert, fut sacré son premier évêque. Henri, roi de Castille, la soumit à sa couronne en 1373. Elle rentra dans la suite sous le pouvoir des Portugais, & y demeura jusqu'à ce que le duc d'Albe, vainqueur de D. P. d'Achuna, la rangea sous la domination espagnole. Enfin par la révolution de 1640, le duc de Bragance fut proclamé dans Lisbonne roi de Portugal, & prit le nom de Jean IV.
Ses successeurs s'y sont maintenus jusqu'à ce jour. Charmés de la douceur de son climat, & pour ainsi dire de son printems continuel, qui produit des fleurs au milieu de l'hiver, ils ont aggrandi cette capitale de leurs états, l'ont élevée sur sept collines, & l'ont étendue jusqu'au bord du Tage. Elle renfermoit dans son enceinte un grand nombre d'édifices superbes, plusieurs places publiques, un château qui la commandoit, un arsenal bien fourni d'artillerie, un vaste édifice pour la douanne, quarante églises paroissiales, sans compter celles des monasteres, plusieurs hôpitaux magnifiques, & environ trente mille maisons, qui ont cédé à d'affreux tremblemens de terre, dont le récit fait frissonner les nations même, qui sont le plus à l'abri de leurs ravages.
Le matin du premier Novembre 1755, à neuf heures quarante-cinq minutes, a été l'époque de ce tragique phénomene, qui inspire des raisonnemens aux esprits curieux, & des larmes aux ames sensibles. Je laisse aux Physiciens leurs conjectures, & aux historiens du Pays, le droit qui leur appartient de peindre tant de désastres. Quaeque ipsa miserrima vidi, & quorum pars magna fui, écrivoit une dame étrangere, le 4 Novembre, dans une lettre datée du milieu des champs, qu'elle avoit choisis pour refuge à cinq milles de l'endroit où étoit Lisbonne trois jours auparavant.
Le petit nombre de maisons de cette grande ville, qui échapperent aux diverses secousses de tremblemens de terre de l'année 1755 & 1756, ont été dévorées par les flammes, ou pillées par les brigands. Le centre de Lisbonne en particulier, a été ravagé d'une maniere inexprimable. Tous les principaux magasins ont été culbutés ou réduits en cendres ; le feu y a consumé en marchandises, dont une grande partie appartenoit aux Anglois, pour plus de quarante millions de creuzades. Le dommage des églises, palais & maisons, a monté au-delà de cent cinquante millions de la même monnoie, & l'on estimoit le nombre des personnes qui ont péri sous les ruines de cette capitale, ou dans son incendie, entre 15 à 20000 ames.
Toutes les puissances ont témoigné par des lettres à S. M. T. F. la douleur qu'elles ressentoient de ce triste événement ; le roi d'Angleterre plus intimement lié d'amitié, & par les intérêts de son commerce, y envoya, pour le soulagement des malheureux, des vaisseaux chargés d'or & de provisions, qui arriverent dans le Tage au commencement de Janv. 1756, & ses bienfaits furent remis au roi de Portugal. Ils consistoient en trente mille livres sterling en or, vingt mille livres sterling en pieces de huit, six mille barrils de viande salée, quatre mille barrils de beurre, mille sacs de biscuit, douze cent barrils de ris, dix mille quintaux de farine, dix mille quintaux de blé, outre une quantité considérable de chapeaux, de bas & de souliers. De si puissans secours, distribués avec autant d'économie que d'équité, sauverent la vie des habitans de Lisbonne, réparerent leurs forces épuisées, & leur inspirerent le courage de relever leurs murailles, leurs maisons & leurs églises.
Terminons cet article intéressant de Lisbonne par dire un mot d'Abarbanel, de Govea, de Lobo, & sur-tout du Camoens, dont cette ville est la patrie.
Le rabbin Isaac Abarbanel s'est distingué dans ses commentaires sur l'ancien Testament, par la simplicité qui y regne, par son attachement judicieux au sens littéral du texte, par sa douceur & sa charité pour les chrétiens, dont il avoit été persécuté. Il mourut à Venise en 1508, âgé de soixante-onze ans.
Antoine de Govea passe pour le meilleur jurisconsulte du Portugal ; son traité de jurisdictione, est de tous ses ouvrages celui qu'on estime le plus. Il est mort en 1565.
Le P. Jérôme Lobo, jésuite, finit ses jours en 1678, âgé de quatre-vingt-cinq ans, après en avoir passé trente en Ethiopie. Nous lui devons la meilleure relation qu'on ait de l'Abyssinie ; elle a été traduite dans notre langue par M. l'abbé le Grand, & imprimée à Paris en 1728, in-4 °.
Mais le célebre Camoens a fait un honneur immortel à sa patrie, par son poëme épique de la Luziade. On connoît sa vie & ses malheurs. Né à Lisbonne en 1524 ou environ, il prit le parti des armes, & perdit un oeil dans un combat contre les Maures. Il passa aux Indes en 1553, déplut au viceroi par ses discours, & fut exilé. Il partit de Goa, & se réfugia dans un coin de terre déserte, sur les frontieres de la Chine. C'est là qu'il composa son poëme ; le sujet est la découverte d'un nouveau pays, dont il avoit été témoin lui-même. Si l'on n'approuve pas l'érudition déplacée qu'il prodigue dans ce poëme vis-à-vis des Sauvages ; si l'on condamne le mêlange qu'il y fait des fables du paganisme, avec les vérités du Christianisme, du-moins ne peut-on s'empêcher d'admirer la fécondité de son imagination, la richesse de ses descriptions, la variété & le coloris de ses images.
On dit qu'il pensa perdre ce fruit de son génie en allant à Macao ; son vaisseau fit naufrage pendant le cours de la navigation ; alors le Camoens, à l'imitation de César, eut la présence d'esprit de conserver son manuscrit, en le tenant d'une main au-dessus de l'eau, tandis qu'il nageoit de l'autre. De retour à Lisbonne en 1569, il y passa dix ans malheureux, & finit sa vie dans un hôpital en 1579. Tel a été le sort du Virgile des Portugais. (D.J.)
|
| LISCA-BIANCA | (Géog.) la plus petite des îles de Lipari au nord de la Sicile. Strabon la nomme , sinistra, parce que ceux qui alloient de Lipari en Sicile, la laissoient à la gauche ; il ajoute que de son tems, elle étoit comme abandonnée : Lisca-Bianca n'a point changé en mieux, au contraire ce n'est plus qu'un rocher entierement desert. (D.J.)
|
| LISÉRÉ | S. m. (Brodeur) c'est le travail qui s'exécute sur une étoffe, en suivant le contour des fleurs & du dessein avec un fil ou un cordonnet d'or, d'argent ou de soie.
|
| LISERON | convolvulus, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale campaniforme dont les bords sont ordinairement renversés en dehors ; il sort du calice un pistil qui est attaché comme un clou à la partie inférieure de la fleur, & qui devient un fruit arrondi, membraneux & enveloppé le plus souvent du calice : ce fruit est divisé en trois loges dans quelques especes de ce genre ; & il n'a qu'une seule cavité dans d'autres ; il renferme des semences ordinairement anguleuses. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Ce genre de plante qu'on vient de caractériser, s'appelle en Botanique convolvulus, & c'est un genre de plante bien étendu, puisque toutes les parties du monde s'accordent à en fournir quantité d'especes. Tournefort en compte 56, & je compte qu'il s'en faut de beaucoup qu'il les ait épuisées ; mais la seule description du grand liseron commun à fleurs blanches peut suffire au plan de cet ouvrage. C'est le convolvulus major, albus, des Bauhins, de Parkinson, de Ray, de Tournefort, &c. On l'appelle en anglois the great white bind-weed.
Sa racine est longue, menue, blanche, garnie de fibres à chaque noeud, vivace, d'un goût un peu âcre. Elle pousse des tiges longues, grêles, tortues, sarmenteuses, entrelacées ensemble, cannelées, qui s'élevent fort haut en grimpant, & se lient par leurs vrilles autour des arbres & arbrisseaux voisins. Ses feuilles sont larges, évidées en forme de coeur, plus grandes, plus molles & plus douces au toucher que celles du lierre, pointues, lisses, vertes, attachées à de longues queues. Ses fleurs ont la figure d'une cloche, & sont blanches comme neige, agréables à la vue, portées sur un assez long pédicule qui sort des aisselles des feuilles ; elles sont soutenues par un calice ovale, divisé en cinq parties avec autant d'étamines à sommet applati. Quand ces fleurs sont tombées, il leur succede des fruits presque ronds, gros comme de petites cerises, membraneux, enveloppés de calice. Ces fruits contiennent deux semences anguleuses ou pointues, de couleur de suie ou d'un noir tirant sur le rougeâtre.
Cette plante fleurit en été, & sa semence mûrit en automne. Elle rend un suc laiteux comme les autres especes du même genre. Sa racine est purgative, ce qui lui a fait donner par Hoffman, le nom de scammonée d'Allemagne, pays où elle abonde, mais elle vient presque par-tout, dans les haies, dans les brossailles, dans les lieux secs, dans les lieux humides, & principalement dans les lieux cultivés. C'est une des mauvaises herbes, & des plus funestes aux jardiniers curieux ; car s'attachant par ses racines à toutes les plantes qu'elle rencontre, elle les entortille, les mange, & s'éleve par-dessus. Le meilleur remede pour la détruire est de la couper souvent par la tête, parce qu'elle répand alors beaucoup de lait qui la saigne jusqu'à la mort, disent les jardiniers. (D.J.)
LISERON-EPINEUX, (Botan.) Voyez l'article de cette plante sous le nom botanique SMILAX ; car il faut éviter les équivoques, & il seroit tout simple de penser que le liseron-épineux est une des especes de liseron, au lieu que c'est un genre de plante tout différent. (D.J.)
|
| LISEUSE | S. f. nom que l'on donne dans les fabriques d'étoffe de soie, à la personne qui lit les desseins.
On appelle liseuse celle qui leve les desseins & les transpose corde par corde sur le semple, c'est dans cette occasion que l'on se sert des embarbes.
|
| LISIBLE | adj. (Ecrivain) est usité dans l'écriture. Un caractere ouvert dont les traits sont assez ronds, les lettres également écartées les unes des autres, les mots, les lignes ; enfin, un caractere lisible, est celui que tout le monde peut lire aisément.
|
| LISIERE | S. f. (Gramm. & Ourdissage) c'est le bord d'une étoffe ou en laine ou en soie, qui est toujours d'un tissu plus fort & plus serré, & communément d'une autre couleur que l'étoffe. Voyez les articles MANUFACTURE EN LAINE & EN SOIE.
Il se dit aussi de deux cordons larges & plats qu'on attache aux corps des enfans, par derriere, à la hauteur des épaules, à l'aide desquels on les soutient & on leur apprend à marcher.
Ce dernier se prend aussi au figuré, & l'on dit d'un homme subjugué par un autre, qu'il en est mené à la lisiere.
On dit la lisiere d'une contrée, la lisiere d'une forêt.
LISIERE EN SAILLIE, (Fortific.) on appelle ainsi, dans la Fortification, une espece de chemin de 10 ou 12 piés de large qu'on laisse dans les places revêtues seulement de gazons, entre le pié du côté extérieur du rempart & le bord du fossé, & qui sert à empêcher que les terres du rempart ne s'éboulent dans le fossé ; on l'appelle communément berme & relais, Voyez BERME.
|
| LISIEUX | (Géog.) ancienne & jolie ville de France dans la haute Normandie, au Lieuwin, avec titre de comté, & un évêché suffragant de Rouen.
Lisieux se nomme en latin civitas Lexoviorum, Lixoviorum, Lexovium, Lixovium, Liciacensis civitas. Elle a tiré son nom, suivant l'abbé de Longuerue, des peuples Lexovii ou Lexobii. Sous les rois de France, elle fut la capitale d'un pays, qui est nommé dans les capitulaires, Lisvinus, Livinus, comitatus Lisvinus, le comté de Lisieux. Ce comté a été donné à l'évêque, qui, par-là, est devenu seigneur temporel de la ville. Il reconnoît, pour son premier évêque, Litarde, qui assista au concile d'Orléans l'an 511. Son évêché, l'un des plus considérables de la province, vaut 50 mille livres de rentes, & son palais épiscopal est une belle maison. Il y a à Lisieux une grande fabrique de toiles, de frocs & de pinchinas.
Cette ville est entre Seez & Verdun, en partie sur une côte, en partie dans une belle vallée, au confluent de l'Arbec & du Gasse qui, après s'être joints, prennent le nom de Touques. La position de Lisieux est à 3 lieues de Pont-l'évêque, à 18 S. O. de Rouen, 10 E. de Caen, 5 de la mer, 40 N. O. de Paris. Long. selon Lieutaud, 15 d. 40'. 30''. lat. 49. 11.
Vattier (Pierre) est, que je sache, le seul homme de lettres dont Lisieux soit la patrie ; après être devenu médecin, & conseiller de Gaston, duc d'Orléans, il abandonna la Médecine pour cultiver la langue arabe. Nous lui devons la traduction françoise de Timur, & celle des califes mahométans d'Elmacinus, qui parut à Paris en 1657. (D.J.)
|
| LISME | S. f. (Commerce) espece de tribu que les François du Bastion de France payent aux Algériens & aux Maures du pays, suivant les anciennes capitulations, pour avoir la liberté de la pêche du corail & du commerce au Bastion, à la Calle, au cap de Rose, à Bonne & à Colle. Dictionn. de commerce.
|
| LISMORE | (Géog.) petite ville d'Irlande, dans la province de Munster, au comté de Waterford ; elle envoie deux députés au parlement ; sa situation est sur la riviere de Blackwater, à 5 milles S. de Tallagh, & 13 O. de Dungarvan. Long. 10. 9. lat. 52. 1.
Quoique Lismore tombe en décadence, sur-tout depuis que le siege de son évêché a été réuni à celui de Waterford, cependant elle se ressouvient toujours d'avoir produit dans le dernier siecle un citoyen célebre, l'illustre Robert Boyle, que Charles II. le roi Jacques, & le roi Guillaume considérerent également. Il est si connu par ses travaux & ses importantes découvertes en Physique, que je suis dispensé des détails. Je dirai seulement qu'il mourut en 1691, à l'âge de 65 ans. On a donné à Londres, en 1744, une magnifique édition de ses oeuvres en 5 vol. in-folio. (D.J.)
|
| LISONZO | LE, (Géog.) riviere d'Italie dans l'état de la république de Venise, & au Frioul. Elle a sa source dans les Alpes & dans la haute Carinthie, & finit par se jetter dans le golfe de Venise, entre le golphe de Trieste à l'orient, & les lagunes de Marano à l'occident. (D.J.)
|
| LISS | ou ISSA, (Géog.) petite île du golfe de Venise, sur la côte de Dalmatie, appartenante aux Vénitiens. Quoiqu'elle soit une des plus petites îles qui se trouvent sur la côte de Dalmatie, elle ne laisse pas d'être célebre dans l'histoire ancienne. Jules César, Comm. liv. IV. De bello civili, & Tite-Live, Décad. 4. liv. I. nous disent qu'elle avoit donné à la république Romaine un secours de vingt vaisseaux armés contre Philippe, roi de Macédoine. Elle ne pourroit donner aujourd'hui à la république de Venise, que quelques tonneaux d'excellent vin, des sardines & des anchois, que l'on pêche en assez grande abondance sur ses côtes. Long. 34. 35. lat. 43. 22.
LISSA, (Géog.) petite ville de la grande Pologne au palatinat de Posnanie, sur les frontieres de Silésie, proche de Glogau. Long. 33. 47. lat. 51. 39. (D.J.)
|
| LISSE | S. f. (Gram. & art. méchan.) ce mot a des acceptions fort diverses. Voyez les articles suivans.
Chez les ouvriers qui ourdissent, ce sont des fils disposés sur des tringles de bois, qui embrassent les fils de chaîne & qui les font lever & baisser à discrétion.
Chez les ouvriers en papiers, en cartons & autres, ce sont des instrumens qu'on applique fortement sur l'ouvrage, & qui en effacent les plis.
LISSES, (Marine) Voyez CEINTES ou PRECEINTES.
Les lisses sont de longues pieces de bois que l'on met en divers endroits sur le bout des membres des côtés d'un vaisseau. Elles portent divers noms, suivant l'endroit du vaisseau où elles sont placées.
Lisse de vibord, c'est une préceinte un peu plus petite que les autres, qui tient le vaisseau tout autour par les hauts. Voyez P. IV. (Marine) fig. 1. N°. 167. & 168. Premiere lisse & seconde lisse de vibord. Voyez aussi Pl. V. fig. 1. ces pieces sous les mêmes nombres.
Lisse de plat-bord, c'est celle qui termine les oeuvres mortes entre les deux premieres rabattues, on continue cette lisse de long en long avec des moulures pour y donner la grace ; elle a de largeur un pouce moins que la cinquieme préceinte, elle en est éloignée d'une distance égale à cette largeur & on la trace parallelement à cette cinquieme préceinte. Sa largeur dans un vaisseau de 70 canons est de 9 pouces. Il arrive quelquefois que le dessous de la lisse du plat-bord se trouve plus ou moins élevé de quelques pouces que la ligne du gaillard, mais ordinairement ces deux lignes se confondent. La lisse de plat-bord doit être éloignée de la cinquieme préceinte de la largeur environ de cette même lisse, c'est-à-dire, que le remplissage entre la cinquieme préceinte & la lisse de plat-bord, differe très-peu de la largeur de cette lisse.
Lisse d'hourdy s'appelle aussi la grande barre d'arcasse, c'est une longue piece de bois qui est placée à l'arriere, & elle peut être regardée comme un ban qui passe derriere l'étambot, & sur lequel sont attachés les estains. Si on considere les estains comme une portion de cercle, elle en fait la corde & l'étambot la fleche, le tout ensemble s'appelle l'arcasse. Pour connoitre la position de la lisse d'hourdy vûe différemment, voyez Pl. III. Marine, fig. 1. la poupe d'un vaisseau du premier rang, la lisse d'hourdy est cotée B, & la poupe d'un vaisseau, Pl. IV. fig. 1. N°. 9.
La lisse d'hourdy a deux courbures, une dans le sens horisontal, l'autre dans le vertical, c'est ce qu'on appelle son arc, sa tenture ou son bouge.
Pour déterminer sur l'étambot la hauteur où doit être placée la lisse d'hourdy, il faut additionner le creux, le relevement du pont à l'arriere, avec la hauteur du feuillet des bords de la sainte-barbe, qui est la même chose que celle des seuillets de la premiere batterie.
La longueur de la lisse d'hourdy est fort arbitraire ; beaucoup de constructeurs la font des deux tiers de la plus grande largeur du vaisseau, & pour sa largeur, son épaisseur & son bouge, ils prennent autant de pouces qu'elle a de piés de longueur.
Il y a des constructeurs qui prennent 6 lignes par pié de la longueur de la lisse d'hourdy pour en avoir l'arc ou le bouge ; d'autres lui donnent autant de bouge qu'elle a d'épaisseur. Il ne convient pas d'établir une regle générale pour tous les vaisseaux de différentes grandeurs, cette lisse devant être proportionnellement plus longue pour les gros vaisseaux que pour les petits. Nous allons donner plusieurs exemples, qui mettront en état de fixer la longueur de la lisse d'hourdy pour toutes sortes de vaisseaux.
Pour un vaisseau de 110 canons, de 47 piés 6 pouces de largeur, on prend les deux tiers de la largeur totale du vaisseau, & 3 lignes de plus par pié.
Pour un vaisseau de 102 canons, on prend les deux tiers de la largeur & 8 pouces de plus.
Pour un vaisseau de 82 canons, les deux tiers de la largeur.
Pour un vaisseau de 74 canons, 7 pouc. 9. lignes par pié de la largeur.
Pour un vaisseau de 62 canons, 7 pouc. 8 lignes par pié de la largeur.
Pour un vaisseau de 56 canons, 7 pouc. 7 lignes 3 points par pié de la largeur.
Pour un vaisseau de 50 canons, 7 pouc. 6 lign. & demie par pié de la largeur.
Pour un vaisseau de 46 canons, 7 pouc. 6 lign. par pié de la largeur.
Pour un vaisseau de 32 canons, 7 pouc. 5 lign. & demie par pié de la largeur.
Pour une frégate de 22 canons, 7. pouc. 4 lign.
Pour une corvette de 12 canons, 7 pouces par pié de la largeur.
Ceci est tiré des Elémens de l'architecture navale de M. du Hamel.
Il y en a qui, sans tant de précaution, donnent de longueur à la lisse d'hourdy pour les vaisseaux du premier rang & du deuxieme, les deux tiers de la largeur, & pour les autres vaisseaux un pié de moins.
Il est bon de remarquer que plus on augmente la longueur de la lisse d'hourdy, plus les vaisseaux ont de largeur à l'arriere, & plus on gagne d'emplacement pour le logement des officiers, plus encore on a de facilité dans le cas du combat pour placer de la mousqueterie. Mais cet élargissement du vaisseau présente une surface au vent, qui est toujours desavantageuse quand on court au plus près ; néanmoins on peut négliger le petit avantage qu'il y auroit à raccourcir la lisse d'hourdy relativement à la marche au plus près, pour donner aux officiers plus de commodité, parce qu'il n'y a pas à beaucoup près autant d'inconvénient à augmenter la largeur que l'élévation des oeuvres mortes.
Lisses de gabarits, on donne ce nom à la beloire, aux lattes, & en général à toutes les pieces qui sont employées pour former les gabarits ou les façons d'un vaisseau.
Lisses de porte-haubans, ce sont de longues pieces de bois plates que l'on fait régner le long des porte-haubans, & qui servent à tenir dans leur place les chaînes de haubans. (Z)
LISSE, chez les Cartonniers, c'est un instrument à l'aide duquel on polit le carton quand il est collé & séché. On se sert pour cela d'une pierre à lisser, d'une pierre de lisse, & d'une perche à lisser, semblables à celles qui servent aux Cartiers pour lisser les cartes. Voyez les articles CARTIER & CARTONNIER, & les Planches de ces arts.
LISSE, terme de Corroyeur, est un instrument dont ces ouvriers se servent pour lisser & polir leurs cuirs de couleur, après qu'ils ont reçu leur dernier lustre.
La lisse est un morceau de verre fait en forme d'une bouteille, solide, dont le col est assez long & gros pour servir de poignée, & dont la panse a quatre ou cinq pouces de diametre & deux pouces de hauteur. Voyez la Planche du Corroyeur.
Lisser, c'est se servir de la lisse pour polir & donner plus d'éclat au lustre des cuirs de couleur.
LISSES, terme de Gazier, ce sont des perles d'émail percées par le milieu, & à-travers desquelles passent les fils de la chaîne. Chaque métier a deux têtes de lisses, & chaque tête de lisses porte mille perles, si la gaze doit avoir une demi-aune de largeur. Mais si elle doit être plus ou moins large, il faut augmenter ou diminuer le nombre des perles à raison de 500 perles pour chaque quart d'aune qu'on veut donner de plus ou de moins à la gaze. Voyez GAZE.
LISSES, tête de, (terme de Gazier) qui signifie le haut des lisses dont se servent ces artisans à l'endroit où elles sont arrêtées sur les lisserons. Voyez LISSES & GAZE.
LISSE, terme de Marbreur, ou plutôt instrument dont ils se servent pour polir le papier marbré & le rendre luisant. C'est, à proprement parler, une pierre ou caillou fort uni que l'on conduit à la main en l'appuyant fortement sur le papier, ou bien que l'on enchâsse dans un outil de bois à deux manches, appellé boîte à lisse. Voy. les Planches du Marbreur, où l'on a représenté un ouvrier qui lisse une feuille de papier.
LISSE, (Maréchall.) est la même chose que chanfrein blanc : on dit qu'un cheval a une lisse en tête. Voyez CHANFREIN.
LISSE, terme de Riviere, c'est la piece courante qui couronne à hauteur d'appui le garde-fou d'un pont de bois.
LISSES, (Rub.) instrument servant à passer les chaînes. (Voyez PASSER EN LISSES.) Elles sont de fil bis de Flandres, voici leur fabrique ; on tend d'abord une menue ficelle fixée en L, ou à-l'entour de la chevillette qui en est proche ; l'autre bout portant seulement & librement sur l'autre bout de la piece D, est tenu tendu par le poids de la pierre M ; c'est cette ficelle qui formera la tête de la lisse ; le bout de fil de Flandres qui est contenu sur le rochet N, est attaché à cette ficelle, au moyen de plusieurs noeuds ; en passant N dans les tours de ce fil, en I du côté A pour revenir en B, ce fil ainsi arrêté est passé simple sur la traverse K par la main droite, & reçu par la gauche en dessous le lissoir ; cette main le rend à la droite qui le passe à-l'entour de la ficelle L, en commençant ce passage par-dessus, & faisant passer N à-travers une boucle formée par le même fil, ce qui forme un noeud coulant qui s'approche du premier fait, & cela à chaque tour que fera N ; les différens tours que l'on va continuer de même formeront la moitié de la lisse ; il faut observer que l'on met un petit bâton que l'on voit en G G, qui s'applique & est tenu contre cette traverse dès le premier tour de fil que l'on fait sur lui ; des différens tours de fil que l'on va faire, l'un passera sur ce bâton, & l'autre dessous, toujours alternativement, ce qui rendra ces tours d'inégale longueur ; on fera voir pourquoi cette inégalité : ceci fait autant de fois que l'on veut & que la lisse peut l'exiger, le bout de fil arrêté comme au commencement ; voilà la moitié de la lisse faite, qui après cela est ôtée de dessus le lissoir pour y être remise d'abord, après avoir écarté les traverses en distance convenable & double pour faire l'autre partie ; pour cela, la partie faite remise sur la traverse en K K, où se place une autre personne, ordinairement un enfant qui est assez capable pour cela ; cet enfant présente à l'ouvriere toujours placée en I I, chacun des tours de la partie faite ; l'ouvriere reçoit ce tour ouvert avec les doigts de la main gauche, qui lui est présenté par la droite de l'enfant, qui tient la totalité avec la gauche, observant de ne présenter que celui qu'il faut, & suivant l'ordre dans lequel les tours ont été placés sur la ficelle ; l'ouvriere passe le rochet N à-travers ce tour, comme on le voit en X Y, puis elle le tourne à-l'entour de la ficelle L, comme quand elle a fait la premiere partie expliquée plus haut ; ces différens tours lui sont aussi présentés l'un après l'autre par-dessous le lissoir pour continuer la même opération, qui de la part de l'enfant se nomme tendre ; on entend par ce qui a été dit en haut, qu'il est tendu tantôt un tour plus long, plus un peu plus court, parce qu'ils ont tous cette figure, & cela alternativement, & c'est ce qui formera la diverse hauteur des bouclettes que l'on voit en H I, l'usage en est expliqué à l'article PASSER EN LISSE ; il faut laisser la ficelle sur laquelle la lisse est montée, excéder par chacune des quatre extrémités de la longueur de 8 ou 10 pouces, ce qui servira à l'enlisseronner. Voyez LISSERONS. A l'égard des lisses à maillons qui sont fabriquées de la même maniere, excepté qu'elles sont de menues ficelles au lieu de fil, voici ce qu'il y a de particulier : tous les maillons sont enfilés dans la ficelle par la partie A, & toutes les fois que l'ouvriere forme un tour, elle laisse un de ces maillons en-dessus ; & lorsqu'il s'agit de former la seconde partie, à chaque tour qu'elle fait, il faut que le bout de cette ficelle ne soit pas pour lors sur le rochet N, puisqu'il faut que le tout passe successivement par le trou B du maillon pour être arrêté à chaque tour, comme il a été expliqué en parlant des lisses ; les hautes lisses qui sont de ficelle, comme celles des lisses à maillon, n'ont d'autre différence de celles-là, qu'en ce que la fonction des deux parties se fait également, c'est-à-dire, sur la même ligne ; conséquemment les bouclettes se trouvent paralleles, comme on le voit dans la fig. A A, B B, à l'endroit marqué C C, juste au milieu de la haute lisse, ici représentée (mais dont il faut réformer le lisseron qui est trop grossier). Pour revenir à l'inégalité des différentes mailles de la lisse expliquée plus haut, il faut entendre que les soies de la chaîne qui y seront passées, y sont placées ainsi, en commençant par le premier brin ; ayant choisi les deux mailles qu'il faut, on passe le brin de soie ou fil de chaîne dans ces deux mailles, d'abord sur la bouclette de l'une, puis sous celle de l'autre ; desorte que ces deux mailles font l'effet du maillon qui est de tenir la soie contrainte de ne pas céder, soit en haussant, soit en baissant, que suivant le tirage operé par les marches. Le contraire arrive dans les hautes lisses, auxquelles il faut des bouclettes sur le même niveau : les rames qui y sont passées ne devant que hausser à mesure que la haute lisse qui les contient levera, doivent y être toutes passées sur & jamais sous la bouclette, par conséquent il ne faut qu'une maille pour une rame ; mais les soies de la chaîne devant hausser & baisser, doivent nécessairement être passées chaque brin dans deux mailles de la lisse, pour être susceptibles de ce double mouvement.
LISSES, Hautes, Voyez LISSES : les hautes lisses enlisseronnées sont au nombre de vingt-quatre & quelquefois davantage ; elles sont suspendues dans le châtelet, elles portent jusqu'à deux cent mailles chacune ; desorte, que si l'on ne vouloit passer qu'une seule rame dans chaque maille, les hautes lisses en porteroient 4800, elles peuvent cependant en porter davantage au moyen de l'emprunt. Voyez EMPRUNT. Elles servent par le secours des retours à faire hausser les rames qu'elles contiennent, passées suivant l'ordre du patron, pour operer la levée de chaîne nécessaire au passage de la navette.
LISSES, (Manufact. en soie) ce sont des boucles de fil entrelacées, dans lesquelles on passe les fils de la chaîne pour les faire lever ou baisser ; il y en a de diverses sortes.
Les lisses à grand colisse servent à passer les fils de poil dans les étoffes riches. Elles sont composées d'une maille haute & d'une maille basse alternativement, de façon que le colisse a environ 3 pouces de longueur. L'action de ces lisses est de faire baisser ou hausser le fil, selon que l'ouvriere l'exige.
Les lisses à petit-colisse, sont à petites boucles, arrêtées par un noeud ; elles ne servent qu'aux étoffes unies. On donne le même nom à celles dont la maille est alternativement, l'une sur une ligne plus basse que l'autre, afin que les fils disposés sur une hauteur inégale, ne se frottent pas, comme il arriveroit s'ils étoient sur une même ligne.
Les lisses de rabat, ce sont celles sous la maille desquelles les fils sont passés pour les faire baisser.
Les lisses de liage, ce sont celles sous lesquelles les fils qui doivent lier la dorure dans les étoffes sans poil, sont passés pour les faire baisser.
LISSE BASSE, (Tapissier) espece de tissu ou tapisserie de soie ou de laine, quelquefois rehaussée d'or & d'argent, où sont représentées diverses figures de personnages, d'animaux, de paysages ou autres semblables choses, suivant la fantaisie de l'ouvrier, ou le goût de ceux qui les lui commandent.
La basse-lisse est ainsi nommée, par opposition à une autre espece de tapisserie qu'on nomme haute-lisse ; non point de la différence de l'ouvrage, qui est proprement le même, mais de la différence de la situation des métiers sur lesquels on les travaille ; celui de la basse-lisse étant posé à plat & parallelement à l'horison, & celui de la haute-lisse étant dressé perpendiculairement & tout debout.
Les ouvriers appellent quelquefois basse-marche, ce que le public ne connoît que sous le nom de basse-lisse ; & ce nom de manufacture lui est donné, à cause des deux marches que celui qui les fabrique a sous les piés, pour faire hausser & baisser les lisses, ainsi qu'on l'expliquera dans la suite, en expliquant la maniere d'y travailler. Voyez HAUTE-LISSE.
Fabrique de basse-lisse. Le métier sur lequel se travaille la basse-lisse est assez semblable à celui des tisserans. Les principales pieces sont les roines, les ensubles ou rouleaux, la camperche, le cloud, le wich, les tréteaux ou soutiens, & les arcs-boutans. Il y en a encore quelqu'autres, mais qui ne composent pas le métier, & qui servent seulement à y fabriquer l'ouvrage, comme sont les sautriaux, les marches, les lames, les lisses, &c.
Les roines sont deux fortes pieces de bois, qui forment les deux côtés du chassis ou métier & qui portent les ensubles pour donner plus de force à ces roines ; elles sont non-seulement soutenues pardessous avec d'autres fortes pieces de bois en forme de tréteaux, mais afin de les mieux affermir, elles sont encore arcboutées au plancher, chacune avec une espece de soliveau, qui les empêche d'avoir aucun mouvement, bien qu'il y ait quelquefois jusqu'à quatre ou cinq ouvriers appuyés sur l'ensuble de devant qui y travaillent à la fois. Ce sont ces deux soliveaux qu'on appelle les arcs-boutans.
Aux deux extrémités des roines sont les deux rouleaux ou ensubles, chacune avec ses deux tourillons & son wich. Pour tourner les rouleaux, on se sert du clou, c'est-à-dire, d'une grosse cheville de fer longue environ de trois piés.
Le wich des rouleaux est un long morceau, ou plutôt une perche de bois arrondie au tour, de plus de deux pouces de diametre, à peu près de toute la longueur de chaque ensuble ; une rainure qui est creusée tout le long de l'un & l'autre rouleau, enferme le wich qui la remplit entierement, & qui y est affermi & arrêté de distance en distance par des chevilles de bois. C'est à ces deux wichs que sont arrêtées les deux extrémités de chaîne, que l'on roule sur celui des rouleaux qui est opposé au basselissier ; l'autre sur lequel il s'appuie en travaillant, sert à rouler l'ouvrage à mesure qu'il s'avance.
La camperche est une barre de bois, qui passe transversalement d'une roine à l'autre, presqu'au milieu du métier, & qui soutient les sautriaux, qui sont de petits morceaux de bois à peu près de la forme de ce qu'on appelle le fleau dans une balance. C'est à ces sautriaux que sont attachés les cordes qui portent les lames avec lesquelles l'ouvrier, par le moyen des deux marches qui sont sous le métier, & sur lesquelles il a les piés, donne du mouvement aux lisses, & fait alternativement hausser & baisser les fils de la chaîne. Voyez LAMES, LISSE.
Le dessein ou tableau que les Basselissiers veulent imiter, est placé au-dessous de la chaîne, où il est soutenu de distance en distance par trois cordes transversales, ou même plus s'il en est besoin : les extrémités de chacune aboutissent, & sont attachées des deux côtés aux roines, à une mentonniere qui en fait partie. Ce sont ces cordes qui font approcher le dessein contre la chaîne.
Le métier étant monté, deux instrumens servent à y travailler ; l'un est le peigne, ce qu'en terme de basse-lisse on nomme la flûte.
La flûte tient lieu dans cette fabrique de la navette des Tisserans. Elle est faite d'un bois dur & poli, de trois ou quatre lignes d'épaisseur par les bouts, & d'un peu moins par le milieu. Sa longueur est de 3 ou 4 pouces. Les deux extrémités sont aiguisées en pointe, afin de passer plus aisément entre les fils de la chaîne. C'est sur la flûte que sont dévidées les laines & les autres matieres qu'on veut employer à la tapisserie.
A l'égard du peigne, qui a ordinairement des dents des deux côtés, il est ou de buis ou d'ivoire. Son épaisseur dans le milieu est d'un pouce, qui va en diminuant des deux côtés jusqu'à l'extrémité des dents : sa longueur est de six ou sept pouces. Il sert à serrer les fils de la treme les uns contre les autres à mesure que l'ouvrier les a passés & placés avec la flûte entre ceux de la chaîne.
Lorsque le basselissier veut travailler (ce qui doit s'entendre aussi de plusieurs ouvriers, si la largeur de la piece permet qu'il y en ait plusieurs qui travaillent à la fois), il se met au-devant du métier, assis sur un banc de bois, le ventre appuyé sur l'ensuble, un coussin ou oreiller entre deux ; & en cette posture, séparant avec le doigt les fils de la chaîne, afin de voir le dessein, & prenant la flûte chargée de la couleur convenable, il la passe entre ces fils, après les avoir haussés ou baissés par le moyen des lames & des lisses, qui font mouvoir les marches sur lesquelles il a les piés ; ensuite pour serrer la laine ou la soie qu'il a placée, il la frappe avec le peigne, à chaque passée qu'il fait. On appelle passée, l'allée & le venir de la flûte entre les fils de la chaîne.
Il est bon d'observer que chaque ouvrier ne fait qu'une lame séparée en deux demi-lames, l'une devant, l'autre derriere. Chaque demi-lame qui a ordinairement sept seiziemes d'aune, mesure de Paris, est composée de plus ou moins de lisses, suivant la finesse de l'ouvrage.
Ce qu'il y a d'admirable dans le travail de la basse-lisse, & qui lui est commun avec la haute lisse, c'est qu'il se fait du côté de l'envers ; ensorte que l'ouvrier ne peut voir sa tapisserie du côté de l'endroit, qu'après que la piece est finie & levée de dessus le métier. Voyez HAUTELISSE. Dict. de Trévoux.
LISSE-HAUTE, espece de tapisserie de soie & de laine, rehaussée d'or & d'argent, qui représente de grands & petits personnages, ou des paysages avec toutes sortes d'animaux. La haute-lisse est ainsi appellée de la disposition des lisses, ou plutôt de la chaîne qui sert à la travailler, & qui est tendue perpendiculairement de haut en bas ; ce qui la distingue de la basse-lisse, dont la chaîne est mise sur un métier placé horisontalement. Voyez BASSE-LISSE.
L'invention de la haute & basse- lisse semble venir du Levant ; & le nom de sarrasinois qu'on leur donnoit autrefois en France, aussi-bien qu'aux Tapissiers qui se mêloient de la fabriquer, ou plutôt de la rentraire & raccommoder, ne laisse guere lieu d'en douter. Les Anglois & les Flamands y ont-ils peut-être les premiers excellé, & en ont-ils apporté l'art au retour des croisades & des guerres contre les Sarrasins.
Quoi qu'il en soit, il est certain que ce sont ces deux nations, & particulierement les Anglois, qui ont donné la perfection à ces riches ouvrages ; ce qui doit les faire regarder, sinon comme les premiers inventeurs, du moins comme les restaurateurs d'un art si admirable, & qui sait donner une espece de vie aux laines & aux soies dans des tableaux, qui certainement ne cedent guere à ceux des plus grands peintres, sur lesquels on travaille la haute & basse-lisse.
Les François ont commencé plus tard que les autres à établir chez eux des manufactures de ces sortes de tapisseries ; & ce n'est guere que sur la fin du regne de Henri IV, qu'on a vu sortir des mains des ouvriers de France des ouvrages de haute & basse-lisse, qui aient quelque beauté.
L'établissement qui se fit d'abord à Paris dans le fauxbourg S. Marcel, en 1607, par édit de ce prince du mois de Janvier de la même année, perdit trop tôt son protecteur pour se perfectionner ; & s'il ne tomba pas tout-à-fait dans sa naissance & par la mort de ce monarque, il eut du moins bien de la peine à se soutenir ; quoique les sieurs Comaus & de la Planche, qui en étoient les directeurs, fussent très-habiles dans ces sortes de manufactures, & qu'il leur eût été accordé & à leurs ouvriers de grands priviléges, tant par l'édit de leur établissement, que par plusieurs déclarations données en conséquence.
Le regne de Louis XIV. vit renaître ces premiers projets sous l'intendance de M. Colbert. Dès l'an 1664, ce ministre fit expédier des lettres-patentes au sieur Hinard, pour l'établissement d'une manufacture royale de tapisseries de haute & basse-lisse en la ville de Beauvais en Picardie ; & en 1667, fut établie par lettres-patentes la manufacture royale des Gobelins, où ont été fabriquées depuis ces excellentes tapisseries de haute-lisse, qui ne cedent à aucune des plus belles d'Angleterre & de Flandres pour les desseins, & qui les égalent presque pour la beauté de l'ouvrage, & pour la force & la sûreté des teintures des soies & des laines avec lesquelles elles sont travaillées. Voyez GOBELINS.
Outre la manufacture des Gobelins & celle de Beauvais, qui subsistent toûjours, il y a deux autres manufactures françoises de haute & basse-lisse, l'une à Aubusson en Auvergne, & l'autre à Felletin dans la haute Marche. Ce sont les tapisseries qui se fabriquent dans ces deux lieux, qu'on nomme ordinairement tapisseries d'Auvergne. Felletin fait mieux les verdures, & Aubusson les personnages. Beauvais fait l'un & l'autre beaucoup mieux qu'en Auvergne : ces manufactures emploient aussi l'or & l'argent dans leurs tapisseries.
Ces quatre manufactures françoises avoient été établies également pour la haute & basse-lisse ; mais il y a déja long-tems qu'on ne fabrique plus ni en Auvergne, ni en Picardie, que de la basse-lisse ; & ce n'est qu'à l'hôtel royal des Gobelins où le travail de la haute & basse-lisse s'est conservé.
On ne fait aussi que des basses-lisses en Flandres ; mais il faut avouer qu'elles sont pour la plûpart d'une grande beauté, & plus grandes que celles de France, si l'on en excepte celles des Gobelins.
Les hauteurs les plus ordinaires des hautes & basses-lisses sont deux aunes, deux aunes un quart, deux aunes & demie, deux aunes deux tiers, deux aunes trois quarts, trois aunes, trois aunes un quart, & trois aunes & demie, le tout mesure de Paris. Il s'en fait cependant quelques-unes de plus hautes, mais elles sont pour les maisons royales ou de commande.
En Auvergne, sur-tout à Aubusson, il s'en fait au-dessous de deux aunes ; & il y en a d'une aune trois quarts, & d'une aune & demie.
Toutes ces tapisseries, quand elles ne sont pas des plus hauts prix, se vendent à l'aune courante : les belles s'estiment par tentures.
Fabrique de la haute-lisse. Le métier sur lequel on travaille la haute-lisse est dressé perpendiculairement : quatre principales pieces le composent, deux longs madriers ou pieces de bois, & deux gros rouleaux ou ensubles.
Les madriers qui se nomment coterets ou cotterelles, sont mis tous droits : les rouleaux sont placés transversalement, l'un au haut des coterets, & l'autre au bas ; ce dernier à un pié & demi de distance du plancher ou environ. Tous les deux ont des tourillons qui entrent dans des trous convenables à leur grosseur qui sont aux extrémités des coterets.
Les barres avec lesquelles on les tourne se nomment des tentoys ; celle d'en-haut le grand tentoy, & celle d'en-bas le petit tentoy.
Dans chacun des rouleaux est ménagée une rainure d'un bout à l'autre, capable de contenir un long morceau de bois rond, qu'on y peut arrêter & affermir avec des fiches de bois ou de fer. Ce morceau de bois, qui a presque toute la longueur des rouleaux, s'appelle un verdillon, & sert à attacher les bouts de la chaîne. Sur le rouleau d'en-haut est roulée cette chaîne, qui est faite d'une espece de laine torse ; & sur le rouleau d'en-bas se roule l'ouvrage à mesure qu'il s'avance.
Tout du long des coterets qui sont des planches ou madriers de 14 ou 15 pouces de large, de 3 ou 4 d'épaisseur, & de 7 ou 8 piés de hauteur, sont des trous percés de distance en distance du côté que l'ouvrage se travaille, dans lesquels se mettent des morceaux ou grosses chevilles de fer qui ont un crochet aussi de fer à un des bouts. Ces morceaux de fer qu'on nomme des hardilliers, & qui servent à soutenir la perche de lisse, sont percés aussi de plusieurs trous, dans lesquels en passant une cheville qui approche ou éloigne la perche, on peut bander ou lâcher les lisses, suivant le besoin qu'on en a.
La perche de lisse, qui est d'environ trois pouces de diametre, & de toute la longueur du métier, est nommée ainsi, parce qu'elle enfile les lisses qui font croiser les fils de la chaîne. Elle fait à-peu-près dans le métier de haute-lisse, ce que font les marches dans celui des Tisserands.
Les lisses sont de petites cordelettes attachées à chaque fil de la chaîne avec une espece de noeud coulant aussi de ficelle, qui forme une espece de maille ou d'anneau : elles servent à tenir la chaîne ouverte pour y pouvoir passer les broches qui sont chargées des soies, des laines, ou autres matieres qui entrent dans la fabrique de la haute-lisse.
Enfin, il y a quantité de petits bâtons, ordinairement de bois de saule, de diverses longueurs, mais tous d'un pouce de diametre, que le hautelissier tient auprès de lui dans des corbeilles pour s'en servir à croiser les fils de la chaîne, en les passant à-travers, d'où ils sont nommés bâtons de croisure ; & afin que les fils ainsi croisés se maintiennent toûjours dans un arrangement convenable, on entrelace aussi entre les fils, mais au-dessus du bâton de croisure, une ficelle à laquelle les ouvriers donnent le nom de fleche.
Lorsque le métier est dressé & la chaîne tendue, la premiere chose que doit faire le hautelissier, c'est de tracer sur les fils de cette chaîne les principaux traits du dessein qu'il vent qui soit représenté dans sa piece de tapisserie ; ce qui se fait en appliquant du côté qui doit servir d'envers, des cartons conformes au tableau qu'il copie, & puis en suivant leurs contours avec de la pierre noire sur les fils du côté de l'endroit, ensorte que les traits paroissent également & devant & derriere ; & afin qu'on puisse dessiner plus sûrement & plus correctement, on soutient les cartons avec une longue & large table de bois.
A l'égard du tableau ou dessein original sur lequel l'ouvrage doit s'achever, il est suspendu au dos du hautelissier, & roulé sur une longue perche de laquelle on en déroule autant qu'il est nécessaire, & à mesure que la piece s'avance.
Outre toutes les pieces du métier dont on vient de parler, qui le composent, ou qui y sont pour la plûpart attachées, il faut trois principaux outils ou instrumens pour placer les laines ou soies, les arranger & les serrer dans les fils de la chaîne. Les outils sont une broche, un peigne, & une aiguille de fer.
La broche est faite de bois dur, comme de buis ou autre semblable espece : elle est de sept à huit pouces de longueur, de huit lignes environ de grosseur & de figure ronde, finissant en pointe avec un petit manche. C'est sur cet instrument qui sert comme de navette, que sont dévidées les soies, les laines, ou l'or & l'argent que l'ouvrier doit employer.
Le peigne est aussi de bois, de huit à neuf pouces de longueur & d'un pouce d'épaisseur du côté du dos, allant ordinairement en diminuant jusqu'à l'extrêmité des dents, qui ont plus ou moins de distance les unes des autres, suivant le plus ou le moins de finesse de l'ouvrage.
Enfin l'aiguille de fer, qu'on appelle aiguille à presser, a la forme des aiguilles ordinaires, mais plus grosse & plus longue. Elle sert à presser les laines & les soies, lorsqu'il y a quelque contour qui ne va pas bien : le fil de laine, de soie, d'or ou d'argent, dont se couvre la chaîne des tapisseries, & que dans les manufactures d'étoffes on appelle treme, se nomme assure parmi les hautelissiers françois.
Toutes choses étant préparées pour l'ouvrage, & l'ouvrier le voulant commencer, il se place à l'envers de la piece, le dos tourné à son dessein ; de sorte qu'il travaille, pour ainsi dire, à l'aveugle, ne voyant rien de ce qu'il fait, & étant obligé de se déplacer, & de venir au-devant du métier, quand il veut en voir l'endroit & en examiner les défauts pour les corriger avec l'aiguille à presser.
Avant de placer ses soies ou ses laines, le hautelissier se tourne & regarde son dessein ; ensuite dequoi ayant pris une broche chargée de la couleur convenable, il la place entre les fils de la chaîne qu'il fait croiser avec les doigts par le moyen des lisses attachées à la perche ; ce qu'il recommence chaque fois qu'il change de couleur. La soie ou la laine étant placée, il la bat avec le peigne ; & lorsqu'il en a mis plusieurs rangées les unes sur les autres, il va voir l'effet qu'elles font pour en réformer les contours avec l'aiguille à presser, s'il en est besoin.
Quand les pieces sont larges, plusieurs ouvriers y peuvent travailler à la fois : à mesure qu'elles s'avancent, on roule sur l'ensuble d'en-bas ce qui est fait, & on déroule de dessus celle d'en-haut autant qu'il faut de la chaîne pour continuer de travailler ; c'est à quoi servent le grand & petit tentoy. On en fait à proportion autant du dessein que les ouvriers ont derriere eux. Voyez nos Pl. de Tapiss. & leur expl.
L'ouvrage de la haute-lisse est bien plus long à faire que celui de la basse-lisse, qui se fait presque deux fois aussi vîte. La différence qu'il y a entre ces deux tapisseries, consiste en ce qu'à la basse-lisse il y a un filet rouge, large d'environ une ligne qui est mis de chaque côté du haut en-bas, & que ce filet n'est point à la haute-lisse. Dict. du Com. & Chambers.
LISSE, (Tapissier) les Tapissiers de haute- lisse & de basse-lisse, les Sergiers, les Rubaniers, ceux qui fabriquent des brocards, & quelques autres ouvriers, nomment lisse, ce qu'on appelle chaîne dans les métiers de Tisserands & des autres fabriquans de draps & d'étoffes, c'est-à-dire les fils étendus de long sur le métier, & roulés sur les ensubles, à-travers desquels passent ceux de la treme. Voyez CHAINE.
Haute- lisse, c'est celle dont la lisse ou chaîne est dressée debout & perpendiculairement devant l'ouvrier qui travaille ; la basse- lisse étant montée sur un métier posé parallelement à l'horison, c'est-à-dire, comme le métier d'un tissérand. Voyez HAUTE-LISSE & BASSE-LISSE.
LISSES. Les Haute-lissiers appellent ainsi de petites ficelles ou cordelettes attachées à chaque fil de la chaîne de la haute lisse avec une espece de noeud coulant en forme de maille ou d'anneau aussi de ficelle. Elles servent à tenir la chaîne ouverte, & on les baisse ou on les leve par le moyen de ce qu'on appelle la perche de lisse, où elles sont toutes enfilées. Voyez HAUTE-LISSE.
LISSE HAUTE, (Tapissier) ce sont des étoffes dont la chaîne est purement de soie & la treme de laine, ou qui sont toutes de soie, comme les serges de Rome, les dauphines, les étamines, les férandines & burats, les droguets de soie. On leur donne le nom d'haute-lisse dans la sayetterie d'Amiens.
|
| LISSÉ | adj. (Jardinage) il se dit d'un fruit qui a l'écorce toute unie, tel que le marron, la châtaigne dépouillés de leur premiere cosse.
LISSE, grand lissé, c'est, parmi les Confiseurs, du sucre cuit assez pour former un filet assez fort pour ne point se rompre en ouvrant les deux doigts qu'on y a trempés, & pour prendre ainsi une assez grande étendue.
Lissé, petit, c'est quand le sucre fait entre les deux doigts un filet imperceptible & très-aisé à être rompu pour peu qu'on écarte les doigts.
|
| LISSER | v. act. c'est passer ou polir à la lisse. Voyez l'article LISSE.
LISSER, perche à, terme de Cartier, c'est une perche de bois suspendue au plancher par un anneau de fer, & qui par l'autre bout descend sur l'établi du lisseur. Cette perche a à son extrêmité une entaille dans laquelle on fait entrer la boîte à lisser garnie de sa pierre. Voyez les Planches du Cartier, où l'on a représenté la partie inférieure de la perche avec son entaille, qui reçoit la boîte à lisser.
LISSER, pierre à lisser, instrument de Cartier ; c'est une pierre noire fort dure & bien polie, avec laquelle on frotte sur les feuilles des cartes pour les lisser, c'est-à-dire les rendre douces, polies & luisantes. On se sert aussi pour le même effet d'un lingot de verre.
|
| LISSERONS | S. m. ouvrage d'ourdisserie, ce sont de petits liteaux de bois plat & très-mince sur quoi se tendent les lisses, qui ne sont, comme on l'a dit à leur article, qu'arrangés sur de la petite ficelle dont on laisse passer les bouts des quatre extrêmités de la lisse de la longueur de huit à dix pouces, pour servir à les enlisseronner par le moyen de plusieurs tours que l'on fait autour du lisseron, & que l'on arrête dans les échancrures qu'il porte à ses bouts ; par conséquent il faut deux lisserons pour chaque lisse. Les lisserons pour les hautes lisses sont plus longs & plus forts à proportion de la grandeur de la hautes lisse.
|
| LISSETTES | S. f. (Ourdissage) Il n'y a d'autre différence des lissettes aux lisses, sinon que la lissette n'est pas ordinairement enlisseronnée : dans ce cas, comme elle n'est pas aussi considérable à beaucoup près qu'une lisse, & qu'il y en a très-fréquemment une grande quantité, on les attache seulement par le bout d'en haut à la queue des rames, & elles sont terminées par le bout d'en bas par un fuseau de plomb ou de fer qui les oblige de descendre lorsque l'ouvrier quitte la marche qui les avoit fait lever : elles ont d'ailleurs le même usage que les lisses dont on vient de parler.
LISSETTES à luisant & à chaînette pour les franges & galons à chaînettes, (Ruban.) Elles sont composées de petites ficelles haut & bas, au centre desquelles il y a des maillons de cuivre qui tiennent ici lieu de bouclettes, dont on a parlé à l'article LISSES. C'est à-travers ces maillons que l'on passe les soies de la chaîne qui forment les luisans & chaînettes sur les têtes des franges & galons. Ces lissettes, que l'on voit dans nos Pl. de Passementerie, & dont il sera parlé aux expl. de ces Pl. sont au nombre de deux pour les franges, & attachées chacune par en haut aux deux bouts d'une ficelle dont les deux bouts viennent se joindre à elles après avoir passé sur la poulie du bandage qui ici est derriere : cette même ficelle vient aussi passer sur deux des poulies du porte-lisses, d'où les deux bouts viennent se terminer à ces deux lissettes par en bas ; elles sont tirées par deux tirans attachés aux marches : ces tirans ont chacun un noeud juste à l'endroit de la lame percée ; ces noeuds empêchent les lissettes d'être entraînées par le bandage. Il y a trois marches, une pour le pié gauche, & deux pour le pié droit ; celle du pié gauche fait baisser une lisse, & l'une des deux du pié droit fait baisser l'autre lisse & en même tems une de ces deux lissettes, au moyen de deux tirans qui sont attachés à cette marche ; quand celle-ci a fait son office, l'ouvrier marche du pié gauche, puis du pié droit la seconde marche de ce pié, qui comme sa premiere baisse la lisse & l'autre lissette, cette marche portant comme la premiere de ce pié droit deux tirans. Pour plus de clarté, il faut entendre que toujours la marche du pié droit fait agir une lisse de fond ; & l'une de celles du pié gauche, en faisant agir l'autre lisse du fond, fait aussi agir une des deux lissettes, qui fait le sujet de cet article, & de même de la seconde marche de ce même pié droit. Quand l'une des deux marches du pié droit agit, elle entraîneroit l'autre si elle ne se trouvoit arrêtée par le noeud dont on a parlé, sans compter que le bandage tirant naturellement à lui, l'emporteroit ; mais l'obstacle de ce noeud empêchant que cela n'arrive, forme en même tems un point d'appui pour faire agir la marche qui travaille actuellement : un autre noeud se trouvant à l'autre tirant de la seconde marche de ce pié droit, devient lui-même point d'appui de celle-ci, & cela alternativement : desorte que la poulie du bandage n'a d'autre mouvement que d'un demi-tour à droite & à gauche, selon qu'elle est mûe par l'une ou l'autre marche du pié droit.
|
| LISSIER | HAUT ET BAS, ouvrier qui travaille à la haute & à la basse lisse. On le dit aussi du marchand qui en vend. Voyez HAUTE-LISSE & BASSE-LISSE.
|
| LISSOIR | se dit dans l'Artillerie d'un assemblage de plusieurs tonneaux attachés ensemble, dans lesquels on met la poudre destinée pour la chasse, & qui tournant par le moyen d'un moulin, la remuent de maniere qu'elle devient lustrée, plus ronde, & d'un grain plus égal que la poudre de guerre.
LISSOIR de devant, terme de Charron. C'est un morceau de bois long de quatre à cinq piés, de l'épaisseur d'un pié, qui sert à supporter le train de devant. Voyez les Pl. du Sellier.
Lissoir de derriere ; c'est une piece de bois de la largeur environ d'un pié, sur deux piés d'épaisseur & cinq piés de longueur, dont la face de dessous est creusée pour y faire entrer l'essieu des grandes roues. A la face en-dehors sont attachés presque à chaque bout les crics qui portent les suspentes ; & à la face d'en haut, un peu à côté des crics, sont placées les mortaises pour enchâsser les moutons. Voyez les Pl. du Sellier.
LISSOIR, outil de Gaînier en gros ouvrage. C'est une planche de cuivre de la largeur de six pouces ; quarrée par en bas & ronde par en haut, qui sert aux Gaîniers en gros ouvrages pour passer par-dessus les peaux dont ils se servent pour couvrir les caisses qu'ils font, pour les unir & empêcher que la colle ne soit plus d'un côté que de l'autre. Voyez les Planches du Gaînier.
|
| LISSUS | (Géog. anc.) Ce nom, dans la géographie des anciens, désigne, 1°. une ville d'Illyrie en Dalmatie, sur les frontieres de la Macédoine, avec une citadelle qu'on appelloit acrolissus. Pline ajoûte que c'étoit une colonie de citoyens romains, à cent mille pas d'Epidaure.
2°. Lissus étoit un lieu de l'île de Crete, sur la côte méridionale, au couchant de Tarba.
3°. Lissus étoit cette riviere de Thrace qui fut tarie par l'armée de Xerxès, à laquelle elle ne put suffire. Elle couloit entre les villes de Mésembria & de Stryma.
|
| LISTA | (Géog. anc.) ancienne ville d'Italie dans le pays des Aborigènes, dont elle étoit la capitale, située à une lieue au-delà de Matiera. Les Sabins s'en rendirent les maîtres & la garderent. Nous ne connoissons aucun lieu qui y réponde précisément. (D.J.)
|
| LISTAOS | S. m. (Commerce) toiles rayées de blanc & de bleu qui se fabriquent en Allemagne ; elles passent de Hambourg en Espagne, & d'Espagne aux Indes occidentales.
|
| LISTE | S. f. (Grammaire & Commerce) mémoire ou catalogue qui contient les noms, les qualités, & quelquefois les demeures de plusieurs personnes.
Il n'y a guere à Paris de compagnies de judicature, de finance, d'académies, de corps, de communautés, qui ne fassent de tems en tems imprimer de ces sortes de listes : elles sont sur-tout d'un usage très-ordinaire & même universel dans les six corps des marchands & dans les communautés des arts & métiers de la ville & faubourgs de Paris.
Ce sont les gardes, jurés & syndics qui ont soin de l'impression de ces listes : les maîtres y sont rangés suivant l'ordre de leur réception ; dans un rang à part sont mis les anciens qui ont passé par les charges, & au bas ceux qui y sont actuellement. On y comprend aussi les veuves qui jouissent des franchises des corps & communautés dont étoient leurs défunts maris. Dictionnaire de Commerce.
Liste signifie aussi en Hollande ce qu'on nomme en France un tarif ou pancarte, c'est-à-dire un état par ordre alphabétique de toutes les marchandises ou denrées qui sont sujettes au payement des droits d'entrée, de sortie & autres, avec la quotité du droit qui est dû pour chacune de ces marchandises. Voyez TARIF.
Les principales listes de Hollande sont celles du 8 Mars 1555, 29 Juin 1674 & celles du 4 Mars & 9 Avril 1685.
La derniere liste ou tarif que les états généraux ont dressée dans leur assemblée pour être observée à la place des anciennes dont nous venons de parler, est datée de la Haye le 31 Juillet 1725, mais elle n'a commencé à être exécutée qu'au premier Novembre suivant.
Cette liste est précédée des résolutions ou ordonnances des états & d'un placard, qui en fixent & reglent l'exécution en deux cent cinquante quatre articles. On peut voir toutes ces pieces dans le Dictionnaire de Commerce, sous les articles Liste, Résolution & Placard. Dictionnaire de Commerce.
LISTE CIVILE, (Hist. d'Angleterre) nom qu'on donne en Angleterre à la somme que le parlement alloue au roi pour l'entretien de sa maison, autres dépenses & charges de la couronne. Les monarques de la Grande-Bretagne ont eu jusqu'au roi Guillaume 600 mille livres sterling ; le parlement en accorda 700 mille à ce prince en 1698. Aujourd'hui la liste civile est portée à près d'un million sterling. (D.J.)
|
| LISTON | S. m. (Blason) petite bande en forme de ruban, qu'on mêle ordinairement avec les ornemens de l'écu, & sur laquelle on place quelquefois la devise.
|
| LIT | S. m. (Gram.) meuble où l'on prend le repos pendant la nuit ; il est composé du chalit ou bois, de la paillasse, des matelats, du lit-de-plume, du traversin, des draps, des couvertures, du dossier, du ciel, des pentes, des rideaux, des bonnes-graces, de la courte-pointe, du couvre-pié, &c.
LIT, (Jurisp.) se prend en droit pour le mariage ; on dit les enfans du premier, du second lit, &c. Lit se prend aussi quelquefois pour cohabitation ; c'est pourquoi la séparation des corps est appellée dans les canons separatio à toro. Voyez MARIAGE & SEPARATION. (A)
LIT DE JUSTICE, (Jurisp.) ce terme pris dans le sens littéral signifie le trône où le roi est assis lorsqu'il siége solemnellement en son parlement.
Anciennement lorsque les parlemens ou assemblées de la nation se tenoient en pleine campagne, le roi y siégeoit sur un trône d'or, comme il est dit dans Sigebert & Aimoin ; mais depuis que le parlement a tenu ses séances dans l'intérieur d'un palais, on a substitué à ce trône d'or un dais & des coussins ; & comme dans l'ancien langage un siége couvert d'un dais se nommoit un lit, on a appellé lit de justice le trône où le roi siége au parlement ; cinq coussins forment le siége de ce lit ; le roi est assis sur l'un ; un autre tient lieu de dossier ; deux autres servent comme de bras, & soutiennent les coudes du monarque ; le cinquieme est sous ses piés. Charles V. renouvella cet ornement ; dans la suite Louis XII. le fit refaire à neuf, & l'on croit que c'est encore le même qui subsiste présentement.
On entend aussi par lit de justice une séance solemnelle du roi au parlement, pour y délibérer sur les affaires importantes de son état.
Toute séance du roi en son parlement, n'étoit pas qualifiée de lit de justice ; car anciennement les rois honoroient souvent le parlement de leur présence, sans y venir avec l'appareil d'un lit de justice : ils assistoient au plaidoyer & au conseil ; cela fut fréquent sous Philippes-le-Bel & ses trois fils, & depuis sous Charles V. Charles VI & Louis XII.
On ne qualifie donc de lit de justice que les séances solemnelles où le roi est assis dans son lit de justice ; & ces assemblées ne se tiennent, comme on l'a dit, que pour des affaires d'état.
Anciennement le lit de justice étoit aussi qualifié de trône royal, comme on le peut voir dans du Tillet : présentement on ne se sert plus que du terme de lit de justice, pour désigner le siége où le roi est assis dans ces séances solemnelles, & aussi pour désigner la séance même.
Les lits de justice ont succédé à ces anciennes assemblées générales qui se tenoient autrefois au mois de Mars, & depuis au mois de Mai, & que l'on nommoit champ de Mars ou de Mai, & qui furent dans la suite nommées placités généraux, cours plenieres, plein parlement, grand conseil.
M. Talon, dans un discours qu'il fit en un lit de justice tenu en 1649, dit que ces séances n'avoient commencé qu'en 1369, lorsqu'il fut question d'y faire le procès à Edouard, prince de Galles, fils du roi d'Angleterre ; que ces séances étoient alors desirées des peuples, parce que les rois n'y venoient que pour délibérer avec leur parlement de quelques affaires importantes à leur état, soit qu'il fût question de déclarer la guerre aux ennemis de la couronne, soit qu'il fût à-propos de conclure la paix pour le soulagement des peuples.
Je trouve néanmoins qu'il est déja parlé du lit de justice du roi, dans une ordonnance de Philippes-le Long, du 17 Novembre 1318. Cette ordonnance veut d'abord que, le jour que le roi viendra à Paris, pour ouir les causes qu'il aura réservées, le parlement cessera toutes autres affaires.
Un autre article porte que, quand le roi viendra au parlement, le parc sera tout uni, & qu'on laissera vuide toute la place qui est devant son siege, afin qu'il puisse parler secrétement à ceux qu'il appellera.
Enfin il est dit que personne ne partira de son siege, & ne viendra s'asseoir de lez le lit du roi ; les chambellans exceptés, & que nul ne vienne se conseiller à lui, s'il ne l'appelle.
La même chose est rappellée dans un réglement fait par le parlement en 1344.
Le 21 Mai 1375, le roi Charles V. assista au parlement, à l'enregistrement de l'édit du mois d'Août précédent, sur la majorité des rois de France : il est dit que cette loi fut publiée au parlement du roi, en sa présence, de par lui, tenant sa justice en sondit parlement, en sa magnificence ou majesté royale : l'on trouve différens arrêts où la présence du roi est énoncée à-peu-près dans les mêmes termes. A ce lit de justice assisterent le dauphin, fils aîné du roi, le duc d'Anjou, frere du roi, le patriarche d'Alexandrie, 4 archevêques, 7 évêques, 6 abbés, le recteur & plusieurs membres de l'université de Paris, le chancelier de France, 4 princes du sang, plusieurs comtes & seigneurs, le prevôt des marchands, & les échevins de la ville de Paris, plusieurs autres gens sages & notables, & une grande affluence de peuple.
Il y eut un semblable lit de justice tenu par Charles VI. en 1386, & un autre en 1392, lequel, dans l'arrêt d'enregistrement, est appellé lectum justitiae.
Du Tillet fait mention d'un autre lit de justice tenu le 10 Avril 1396, pour la grace de messire Pierre de Craon, où étoient les princes du sang, messire Pierre de Navarre, le fils du duc de Bourbonnois, le comte de la Marche, le connétable, le chancelier, le sire d'Albret, les deux maréchaux, l'amiral, plusieurs autres seigneurs, l'archevêque de Lyon, les évêques de Laon, de Noyon, de Paris, & de Poitiers ; les présidens du parlement, les maîtres des requêtes, messieurs des enquêtes, & les gens du roi.
L'ordonnance du même prince, du 26 Décembre 1407, portant que quand le roi décédera avant que son fils aîné soit majeur, le royaume ne sera point gouverné par un régent, mais au nom du nouveau roi, par un conseil dans lequel les affaires seroient décidées à la pluralité des voix, fut lue publiquement & à haute voix, en la grand'chambre, où étoit dressé le lit de justice, présens le roi de Sicile, les ducs de Guienne, de Berry, de Bourbonnois & de Baviere ; les comtes de Mortaing, de Nevers, d'Alençon, de Clermont, de Vendôme, de Saint-Pol, de Tancanille, & plusieurs autres comtes, barons, & seigneurs du sang royal & autres, le connétable, plusieurs archevêques & évêques, grand nombre d'abbés & autres gens d'église, le grand-maître d'hôtel, le premier & les autres présidens du parlement, le premier & plusieurs autres chambellans, grande quantité de chevaliers & autres nobles, de conseillers tant du grand-conseil & du parlement, que de la chambre des comptes, des requêtes de l'hôtel, des enquêtes & requêtes du palais, des aides, du trésor & autres officiers & gens de justice, & d'autres notables personnages en grande multitude.
Juvenal des Ursins, dans son histoire de Charles VI. en parlant de cette cérémonie, dit qu'il y eut une maniere de lit de justice, &c. C'est apparemment à cause que le roi étoit fort infirme d'esprit, qu'il regardoit ce lit de justice comme n'en ayant que la forme & non l'autorité.
Il y en eut un autre en 1413, sous la faction du duc de Bourgogne, & ce fut alors que la voie d'autorité commença d'être introduite dans ces sortes de séances où les suffrages étoient auparavant libres ; cependant le 5 Septembre de la même année il y eut un autre lit de justice, où l'on déclara nul tout ce qui avoit été fait dans le précédent, comme fait sans autorité dûe, & forme gardée, sans aviser & lire les lettres au roi & en son conseil, ni être avisé par la cour de parlement.
On tint un lit de justice en 1458, à Vendôme, pour le procès de M. d'Alençon.
François I. tint souvent son lit de justice : il y en eut jusqu'à 4 dans une année, savoir, les 24, 26, 27 Juillet, & 16 Décembre 1527.
Dans le dernier siecle il y en eut un le 18 Mai 1643, pour la régence ; un en 1654, pour le procès de M. le prince ; un en 1663, pour la réception de plusieurs pairs ; il y en eut encore d'autres, pour des édits bursaux.
Ceux qui ont été tenus sous ce regne, sont des années 1715, 1718, 1723, 1725, 1730, 1732, & 1756.
Lorsque le roi vient au parlement, le grand maître vient avertir lorsqu'il est à la Sainte-Chapelle, & quatre présidens-à-mortier, avec six conseillers laïcs, & deux clercs, vont le recevoir, & saluer au nom de la compagnie ; ils le conduisent en la grand'chambre, les présidens marchent à ses côtés, des conseillers derriere lui, le premier huissier entre les deux huissiers-massiers du roi.
Le dais & lit de justice du roi est placé dans l'angle de la grand'chambre ; sur les hauts siéges, à la droite du roi, sont les princes du sang, les pairs laïcs ; au bout du dernier banc se met le gouverneur de Paris.
A sa gauche aux hauts sieges sont les pairs ecclésiastiques, & les maréchaux de France venus avec le roi.
Aux piés du roi est le grand-chambellan.
A droite sur un tabouret, au bas des degrés du siége royal, le grand écuyer de France, portant au col l'épée de parement du roi.
A gauche sur un banc, au dessous des pairs ecclésiastiques, sont les quatre capitaines des gardes du corps du roi, & le commandant des cent-suisses de la garde.
Plus bas, sur le petit degré par lequel on descend dans le parquet, est assis le prevôt de Paris, tenant un bâton blanc en sa main.
En une chaire à bras couverte de l'extrêmité du tapis de velours violet semé de fleurs-de-lis, servant de drap de pié au roi, au lieu où est le greffier en chef aux audiences publiques, se met présentement M. le chancelier lorsqu'il arrive avec le roi, ou à son défaut M. le garde des sceaux.
Sur le banc ordinaire des présidens à mortier, lorsqu'ils sont au conseil, sont le premier président & les autres présidens à mortier revêtus de leur épitoge. Avant François I. M. le chancelier se plaçoit aussi sur ce banc au-dessus du premier président ; il s'y place même encore, lorsqu'il arrive avant le roi, & jusqu'à son arrivée qu'il va se mettre aux piés du trône. On tient que ce fut le chancelier du Prat qui introduisit pour lui cette distinction de siéger seul, il le fit en 1527 ; cependant en cette même année, & encore en 1536, on retrouve le chancelier sur le banc des présidens.
Sur les trois bancs ordinaires, couverts de fleurs-de-lis, formant l'enceinte du parquet, & sur le banc du premier & du second barreau du côté de la cheminée, sont les conseillers d'honneur, les quatre maîtres des requêtes en robe rouge, les conseillers de la grand'chambre, les présidens des enquêtes & requêtes, tous en robe rouge, de même que les autres conseillers au parlement.
Dans le parquet, sur deux tabourets, au-devant de la chaire de M. le chancelier, sont le grand maître & le maître des cérémonies.
Dans le même parquet, à genoux devant le roi, deux huissiers-massiers du roi, tenant leurs masses d'argent doré, & six hérauts d'armes.
A droite sur deux bancs couverts de tapis de fleurs-de-lis, les conseillers d'état, & les maîtres des requêtes venus avec M. le chancelier, en robe de satin noir.
Sur un banc en entrant dans le parquet, sont les quatre secrétaires d'état.
Sur trois autres bancs à gauche dans le parquet, vis-à-vis les conseillers d'état, sont les chevaliers & officiers de l'ordre du Saint-Esprit, les gouverneurs & lieutenans généraux de provinces, & les baillis d'épée que le roi amene à sa suite.
Sur un siége à-part, le bailli du palais.
A côté de la forme où sont les secrétaires d'état, le greffier en chef revêtu de son épitoge, un bureau devant lui couvert des fleurs-de-lys, à sa gauche l'un des principaux commis au greffe de la cour, servant en la grand'chambre, en robe noire, un bureau devant lui.
Sur une forme derriere eux, les quatre secrétaires de la cour.
Sur une autre forme derriere les secrétaires d'état, le grand prevôt de l'hôtel, le premier écuyer du roi, & quelques autres principaux officiers de la maison du roi.
Le premier huissier est en robe rouge, assis en sa chaire à l'entrée du parquet.
En leurs places ordinaires, les chambres assemblées au bout du premier barreau, jusqu'à la lanterne du côté de la cheminée ; avec les conseillers de la grand'chambre, & les présidens des enquêtes & requêtes, sont les trois avocats du roi, & le procureur général placé après le premier d'entr'eux.
Dans le surplus des barreaux, des deux côtés, & sur quatre bancs que l'on ajoute derriere le dernier barreau du côté de la cheminée, se mettent les conseillers des enquêtes & requêtes, qui sont tous en robe rouge.
Lorsque le roi est assis & couvert, le chancelier commande par son ordre, que l'on prenne séance ; ensuite le roi ayant ôté & remis son chapeau, prend la parole.
Anciennement le roi proposoit souvent lui-même les matieres sur lesquelles il s'agissoit de délibérer. Henri III. le faisoit presque toujours ; mais plus ordinairement le roi ne dit que quelques mots, & c'est le chancelier, ou, à son défaut, le garde des sceaux, lorsqu'il y en a un, qui propose.
Lorsque le roi a cessé de parler, le chancelier monte vers lui, s'agenouille pour recevoir ses ordres ; puis étant descendu, remis en sa place, assis & couvert, & après avoir dit que le roi permet que l'on se couvre, il fait un discours sur ce qui fait l'objet de la séance, & invite les gens du roi à prendre les conclusions qu'ils croiront convenables pour l'intérêt du roi & le bien de l'état.
Le premier président, tous les présidens & conseillers mettent un genouil en terre, & le chancelier leur ayant dit, le roi ordonne que vous vous leviez, ils se levent & restent debout & découverts ; le premier président parle ; & son discours fini, le chancelier monte vers le roi, prend ses ordres le genouil en terre ; & descendu & remis en sa place, il dit que l'intention du roi est que l'on fasse la lecture des lettres dont il s'agit ; puis s'adressant au greffier en chef, ou au secrétaire de la cour qui, en son absence, fait ses fonctions, il lui ordonne de lire les pieces ; ce que le greffier fait étant debout & découvert.
La lecture finie, les gens du roi se mettent à genoux, M. le chancelier leur dit que le roi leur ordonne de se lever ; ils se levent, & restent debout & découverts, le premier avocat général porte la parole, & requiert selon l'exigence des cas.
Ensuite M. le chancelier remonte vers le roi & le genouil en terre, prend ses ordres, ou, comme on disoit autrefois, son avis, & va aux opinions à messieurs les princes & aux pairs laïcs ; puis revient passer devant le roi, & lui fait une profonde révérence, & va aux opinions aux pairs ecclésiastiques & maréchaux de France.
Puis descendant dans le parquet, il prend les opinions de messieurs les présidens (autrefois il prenoit leur avis après celui du roi ;) ensuite il va à ceux qui sont sur les bancs & formes du parquet, & qui ont voix délibérative en la cour & dans les barreaux laïcs, & prend l'avis des conseillers des enquêtes & requêtes.
Chacun opine à voix basse, à moins d'avoir obtenu du roi la permission de parler à haute voix.
Enfin, après avoir remonté vers le roi & étant redescendu, remis en sa place, assis & couvert, il prononce : le roi en son lit de justice a ordonné & ordonne qu'il sera procédé à l'enregistrement des lettres sur lesquelles on a délibéré ; & à la fin de l'arrêt il est dit, fait en Parlement le roi y séant en son lit de justice.
Anciennement le chancelier prenoit deux fois les opinions : il les demandoit d'abord de sa place, & chacun opinoit à haute voix ; c'est pourquoi lorsque le conseil s'ouvroit, il ne demeuroit en la chambre que ceux qui avoient droit d'y opiner ; on en faisoit sortir tous les autres, & les prélats eux-mêmes, quoiqu'ils eussent accompagné le roi, ils ne rentroient que lors de la prononciation de l'arrêt ; cela se pratiquoit encore sous François I. & sous Henri II. comme on le voit par les registres de 1514, 1516, 1521, 1527. On croit que c'est du tems d'Henri II. que l'on a cessé d'opiner à haute voix ; cela s'est pourtant encore pratiqué trois fois sous Louis XIV. savoir en 1643, en 1654 & 1663.
Présentement, comme on opine à voix basse, ceux qui ont quelque chose de particulier à dire, le disent tout haut.
Après la résolution prise, on ouvroit les portes de la grand'chambre au public, pour entendre la prononciation de l'arrêt. C'est ainsi que l'on en usa en 1610 & en 1643, & même encore en 1725. Après l'ouverture des portes, le greffier faisoit une nouvelle lecture des lettres qu'il s'agissoit d'enregistrer ; les gens du roi donnoient de nouveau leurs conclusions, qu'ils faisoient précéder d'un discours destiné à instruire le public des motifs qui avoient déterminé ; ensuite le chancelier reprenoit les avis pour la forme, mais à voix basse, allant de rang en rang, comme on le fait à l'audience au parlement lorsqu'il s'agit de prononcer un délibéré, & ensuite il prononçoit l'arrêt.
Présentement, soit qu'on ouvre les portes, ou que l'on opine à huit clos, M. le chancelier ne va aux opinions qu'une seule fois.
La séance finie, le roi sort dans le même ordre qu'il est entré. On a vu des lits de justice tenus au château des Tuileries, tels que ceux du 26 Août 1718, d'autres tenus à Versailles, comme ceux des 3 Septembre 1732, & 21 Août 1756. Il y en eut un en 1720 au grand conseil, où les princes & les pairs assisterent. Nos rois ont aussi tenu quelquefois leur lit de justice dans d'autres parlemens ; François I. tint le sien à Rouen en 1517, il y fut accompagné du chancelier du Prat & de quelques officiers de sa cour. Charles IX. y en tint aussi un, pour déclarer sa majorité.
Sur les lits de justice, voyez le traité de la majorité des rois ; les mémoires de M. Talon, tome III. p. 329. son discours au roi en 1648, & ceux qui furent faits par les premiers présidens & avocats généraux aux lits de justice tenus en 1586, 1610, 1715, & les derniers procès-verbaux. (A)
LIT des Romains, (Hist. rom.) lectus cubicularis, Cic. couche sur laquelle ils se reposoient ou dormoient. Elle passa du premier degré d'austérité au plus haut point de luxe ; nous en allons parcourir l'histoire en deux mots.
Tant que les Romains conserverent leur genre de vie dur & austere, ils couchoient simplement sur la paille, ou sur des feuilles d'arbres séches, & n'avoient pour couverture que quelques peaux de bêtes, qui leur servoient aussi de matelats. Dans les beaux jours de la république, ils s'écartoient peu de cette simplicité ; & pour ne pas dormir sous de riches lambris, leur sommeil n'en étoit ni moins profond, ni moins plein de délices. Mais bientôt l'exemple des peuples qu'ils soumirent, joint à l'opulence qu'ils commencerent à goûter, les porta à se procurer les commodités de la vie, & consécutivement les raffinemens de la mollesse. A la paille, aux feuilles d'arbres séches, aux peaux de bêtes, aux couvertures faites de leurs toisons, succéderent des matelats de la laine de Milet, & des lits de plumes du duvet le plus fin. Non-contens de bois de lits d'ébene, de cedre & de citronnier, ils les firent enrichir de marqueterie, ou de figures en relief. Enfin ils en eurent d'ivoire & d'argent massif, avec des couvertures fines, teintes de pourpre, & rehaussées d'or.
Au reste, leurs lits, tels que les marbres antiques nous les représentent, étoient faits à-peu-près comme nos lits de repos, mais avec un dos qui régnoit le long d'un côté, & qui de l'autre s'étendoit aux piés & à la tête, n'étant ouverts que par-devant. Ces lits n'avoient point d'impériale, ni de rideaux, & ils étoient si élevés, qu'on n'y pouvoit monter sans quelque espece de gradins.
LIT DE TABLE, lectus triclinaris, (Littér.) lit sur lequel les anciens se mettoient pour prendre leur repas dans les salles à manger.
Ils ne s'asseyoient pas comme nous pour manger, ils se couchoient sur des lits plus ou moins semblables à nos lits de salle, dont l'usage peut nous être resté de l'antiquité. Leur corps étoit élevé sur le coude gauche, afin d'avoir la liberté de manger de la main droite, & leur dos étoit soutenu par derriere avec des traversins, quand ils vouloient se reposer.
Cependant la maniere dont les Romains étoient à table, n'a pas toujours été la même dans tous les tems, mais elle a toujours paru digne de la curiosité des gens de lettres, &, si je l'ose dire, je me suis mis du nombre.
Avant la seconde guerre punique, les Romains s'asseyoient sur de simples bancs de bois, à l'exemple des héros d'Homere, ou, pour parler comme Varron, à l'exemple des Crétois & des Lacédémoniens ; car, dans toute l'Asie, on mangeoit couché sur des lits.
Scipion l'Africain fut la premiere cause innocente du changement qui se fit à cet égard. Il avoit apporté de Carthage de ces petits lits, qu'on a long-tems appellés punicani, afriquains. Ces lits étoient fort bas, d'un bois assez commun, rembourrés seulement de paille ou de foin, & couverts de peaux de chevre ou de mouton.
Un tourneur ou menuisier de Rome, nommé Archias, les imita, & les fit un peu plus propres ; ils prirent le nom de lits archiaques. Comme ils tenoient peu de place, les gens d'une condition médiocre n'en avoient encore point d'autres sous le siecle d'Auguste. Horace lui-même s'en servoit à son petit couvert ; je le prouve par le premier vers de l'épître v. du liv. VII. car c'est ainsi qu'il faut lire ce vers :
Si potes Archiacis conviva recumbere lectis.
" Si vous voulez bien, mon cher Torquatus, accepter un repas frugal, où nous serons couchés sur des lits bourgeois ".
Il est certain qu'il y avoit peu de différence pour la délicatesse entre les lits africains, apportés à Rome par Scipion, & les anciens bancs dont on se servoit auparavant. Mais l'usage de se baigner chez soi, qui s'établissoit dans ce tems-là & qui affoiblit insensiblement le corps, fit que les hommes au sortir du bain se jettoient volontiers sur des lits pour se reposer, & qu'ils trouverent commode de ne pas quitter ces lits pour manger. Ensuite la mode vint que celui qui prioit à souper, fit la galanterie du bain à ses conviés ; c'est pourquoi on observoit en bâtissant les maisons de placer la salle des bains proche de celle où l'on mangeoit.
D'un autre côté, la coutume de manger couchés sur des lits prit faveur par l'établissement de dresser pour les dieux des lits dans leurs temples aux jours de leur fête & du festin public qui l'accompagnoit ; la remarque est de Tite-Live, Décad. liv. I. ch. j. Il n'y avoit presque que la fête d'Hercule où l'on ne mettoit point de lits autour de ses tables, mais seulement des sieges, suivant l'ancien usage : ce qui fait dire à Virgile, quand il en parle, haec sacris sedes epulis. Tous les autres dieux furent traités plus délicatement. On peut voir encore aujourd'hui la figure des lits dressés dans leurs temples sur des bas-reliefs & des médailles antiques. Il y en a deux représentations dans Spanheim, l'une pour la déesse Salus, qui donne à manger à un serpent ; l'autre, au revers d'une médaille de la jeune Faustine.
Comme les dames romaines, à la différence des dames grecques, mangeoient avec les hommes, elles ne crurent pas d'abord qu'il fût de la modestie d'être couchées à table, elles se tinrent assises sur les lits tant que dura la république ; mais elles perdirent avec les moeurs la gloire de cette constance, & depuis les premiers césars, jusques vers l'an 320 de l'ere chrétienne, elles adopterent & suivirent sans scrupule la coutume des hommes.
Pour ce qui regarde les jeunes gens qui n'avoient point encore la robe virile, on les retint plus longtems sous l'ancienne discipline. Lorsqu'on les admettoit à table, ils y étoient assis sur le bord du lit de leurs plus proches parens. Jamais, dit Suétone, les jeunes césars, Caius & Lucius, ne mangerent à la table d'Auguste, qu'ils ne fussent assis in imo loco, au bas bout.
La belle maniere de traiter chez les Romains, étoit de n'avoir que trois lits autour d'une table, un côté demeurant vuide pour le service. Un de ces trois lits étoit au milieu, & les deux autres à chaque bout ; d'où vint le nom de triclinium, donné également à la table & à la salle à manger.
Il n'y avoit guere de place sur les plus grands lits, que pour quatre personnes ; les Romains n'aimoient pas être plus de douze à une même table, & le nombre qui leur plaisoit davantage, étoit le nombre impair de trois, de sept ou de neuf : leurs lits ordinaires ne contenoient que trois personnes. Le maître de la maison se plaçoit sur le lit à droite au bout de la table, d'où voyant l'arrangement du service, il pouvoit plus facilement donner des ordres à ses domestiques ; il reservoit une place au-dessus de lui pour un des conviés, & une au-dessous pour sa femme ou quelque parent.
Le lit le plus honorable étoit celui du milieu ; ensuite venoit celui du bout à gauche : celui du bout à droite étoit censé le moindre. L'ordre pour la premiere place sur chaque lit, requéroit de n'avoir personne au-dessus de soi ; & la place la plus distinguée étoit la derniere sur le lit du milieu : on l'appelloit la place consulaire, parce qu'effectivement on la donnoit toujours à un consul quand il alloit manger chez quelque ami. L'avantage de cette place consistoit à être la plus libre pour sortir du repas, & la plus accessible à ceux qui surviendroient pour lui parler d'affaire ; car les Romains, quoiqu'à table, ne se départoient jamais de remplir les fonctions de leurs charges.
Horace, dans une de ses satyres, l. II. sat. 8, nous instruit qu'on mettoit la table sous un dais quand on traitoit un grand seigneur, comme Mécene ; & Macrobe décrivant un repas des pontifes, dit, pour en exprimer la magnificence, qu'il n'y avoit que dix conviés, & que cependant on mangeoit dans deux salles. C'étoit par le même principe de magnificence, qu'il y avoit une salle à cent lits, dans la célebre fête d'Antiochus Epiphanès, décrite par Elien.
La somptuosité particuliere des lits de table consistoit 1°. dans l'ébene, le cedre, l'ivoire, l'or, l'argent, & autres matieres précieuses dont ils étoient faits ou enrichis ; 2°. dans les superbes couvertures de diverses couleurs, brodées d'or & de pourpre ; 3°. enfin dans les trépiés d'or & d'argent.
Pline, l. XXXIII. c. xj. remarque qu'il n'étoit pas extraordinaire sous Auguste, de voir les lits de table entierement couverts de lames d'argent, garnis des matelats les plus mollets, & des courtepointes les plus riches. Du tems de Seneque, ils étoient communément revêtus de lames d'or, d'argent ou d'électrum, métal d'or allié avec l'argent. Cette mode passa de l'Orient à Rome, comme il paroît par la pompe triomphale de Lucullus, dont Plutarque nous a laissé la description.
Aulugelle se plaignant du luxe des Romains en lits d'or, d'argent, & de pourpre, ajoûte qu'ils donnoient aux hommes dans leurs festins, des lits plus magnifiques qu'aux dieux mêmes ; cependant un docteur de l'Eglise, en parlant des lits des dieux, dit : dii vestri tricliniis coelestibus, atque in chalcidicis aureis coenitant. En effet, un auteur grec fait mention d'un lit des dieux, qui étoit tout d'or dans l'île de Pandere. Que devoit-ce être des lits des hommes, s'ils les surpassoient encore !
Ciaconius qui a épuisé ce sujet dans sa dissertation de triclinio, vous en instruira. Il vous apprendra le degré de somptuosité où l'on porta la diversité de ces lits, suivant les saisons ; car il y en avoit d'été & d'hiver. Il vous indiquera la matiere de ces divers lits, le choix des étoffes & de la pourpre ; enfin leur perfection en broderie. Pour moi j'aime mieux ne vous citer que ce seul vers d'Ovide, qui peint l'ancienne pauvreté romaine : " Les lits de nos peres n'étoient garnis que d'herbes & de feuilles, il n'appartenoit qu'aux riches de les garnir de peaux, "
Qui pelles poterat addere, dives erat.
La mode donna à ces lits depuis deux piés jusqu'à quatre piés de hauteur ; elle en changea perpétuellement la forme & les contours. On en fit en long, en ovale, en forme de croissant ; & ensuite on les releva un peu sur le bout qui étoit proche de la table, afin qu'on fût appuyé plus commodément en mangeant. On les fit aussi plus ou moins grands, nonseulement pour être à son aise, mais encore afin que chaque lit pût tenir au besoin, sans se gêner, quatre ou cinq personnes ; d'où vient qu'Horace dit, Sat. jv. l. I. v. 86 : " Vous voyez souvent quatre personnes sur chacun des trois lits qui entourent une table ".
Saepè tribus lectis videas caenare quaternos.
Plutarque nous apprend que César après ses triomphes, traita le peuple romain à vingt-deux mille tables à trois lits. Comme il est vraisemblable que le peuple ne se fit point de scrupule de se presser pour un ami, & de se mettre quelquefois quatre, il en résulte qu'il y avoit au-moins deux cent mille personnes à ces vingt mille tables, aux dépens de César : lisez au mot LARGESSE ce que j'ai dit de l'argent qu'il avoit employé pour se faire des créatures.
Puisque dans les repas publics on faisoit manger le peuple romain sur des lits, l'on ne doit pas s'étonner de voir cet usage établi en Italie sous le regne de Néron, jusque parmi les laboureurs : Columelle leur en fait le reproche, & ne le leur permet qu'aux jours de fêtes.
Quant aux tables autour desquelles les lits étoient rangés, c'est assez d'observer ici, que de la plus grande simplicité, on les porta en peu de tems à la plus grande richesse. Les convives y venoient prendre place à la sortie du bain, revêtus d'une robe qui ne servoit qu'aux repas, & qu'on appelloit vestis coenatoria, vestis convivalis. C'étoit encore le maître de la maison qui fournissoit aux conviés ces robes de festins qu'ils quittoient après le repas.
Nous avons des estampes qui nous représentent ces robes, ces tables, ces lits, & la maniere dont les Romains étoient assis dessus pour manger, mais je ne sais si, dans plusieurs de ces estampes, l'imagination des artistes n'a pas suppléé aux monumens : du-moins il s'y trouve bien des choses difficiles à concilier. Il vaut donc mieux s'en tenir aux seules idées qu'on peut s'en former par la lecture des auteurs contemporains, & par la vûe de quelques bas-reliefs, qui nous en ont conservé des représentations incomplete s.
Dans l'un de ces bas-reliefs on voit une femme à table, couchée sur un des lits, & un homme près d'elle, qui se prépare à s'y placer quand on lui aura ôté ses souliers : on sait que la propreté vouloit qu'on les ôtât dans cette occasion. La femme paroît couchée un peu de côté, & appuyée sur le coude gauche, ayant pour tout habillement une tunique sans manche, avec une draperie qui l'enveloppe au-dessus de la ceinture jusqu'en bas. Elle a pour coëffure une espece de bourse où sont ses cheveux, & qui se ferme autour de la tête.
La Planche XIV. du tome I. des peintures antiques d'Herculanum, représente aussi la fin d'un souper domestique de deux personnes seulement, assises sur un même lit. La table est ronde ; il y a dessus trois vases & quelques fleurs, & le plancher en est tout couvert. Je crains que cette estampe ne soit l'unique parmi les richesses d'Herculanum, puisque les éditeurs ne nous en ont point annoncé d'autres pour les tomes suivans. S'il y en avoit par hasard, elles me fourniroient un supplément à cet article. (D.J.)
LIT NUPTIAL, lectus genialis, (Antiq. rom.) Lit préparé par les mains de l'Hymen. C'étoit un lit qu'on dressoit exprès chez les Romains pour la nouvelle mariée, dans la salle située à l'entrée de la maison, & qui étoit décorée des images des ancêtres de l'époux. Le lit nuptial étoit toujours placé dans cette salle, parce que c'étoit le lieu où la nouvelle épouse devoit dans la suite se tenir ordinairement pour filer & faire des étoffes.
On avoit un grand respect pour ce lit ; on le gardoit toujours pendant la vie de la femme, pour laquelle il avoit été dressé ; & si le mari se remarioit, il devoit en faire tendre un autre. C'est pourquoi Cicéron traita en orateur, de crime atroce, l'action de la mere de Cluentius, qui devenue éperduement éprise de son gendre, l'épousa, & se fit tendre le même lit nuptial, qu'elle avoit dressé deux ans auparavant pour sa propre fille, & dont elle la chassa.
Properce appelle le lit de nôces, adversum lectum, parce qu'on le mettoit vis-à-vis de la porte. Il s'appelloit genialis, parce qu'on le consacroit au génie, le dieu de la nature, & celui-là même qui présidoit à la naissance des hommes. (D.J.)
LITS, (Chimie) en parlant des minéraux & des fossiles, signifie certains strata ou certaines couches de matieres arrangées les unes sur les autres. Voyez COUCHE, VEINE, STRATIFIER, CEMENT.
LIT, (Hydraul.) on dit un lit de pierre, de marne, de craie, de glaise. Ce terme explique parfaitement leur situation horisontale, & leur peu d'épaisseur : on dit encore le lit d'une riviere, d'un canal, d'un reservoir, pour parler de son plafond. (K)
LIT DE MAREE, (Marine) endroit de la mer où il y a un courant assez rapide.
Lit du vent, nom qu'on donne aux lignes ou directions par lesquelles le vent souffle.
LIT, en Architecture, se dit de la situation naturelle d'une pierre dans la carriere.
On appelle lit tendre, celui de dessus, & lit dur, celui de dessous.
Les lits de pierre sont appellés par Vitruve, cubicula.
Lit de voussoir & de claveau, c'en est le côté caché dans les joints.
Lit en joint, c'est lorsqu'une pierre, au lieu d'être posée sur son lit, est posée sur son champ, & que le lit forme un joint à plomb. Voyez DELIT.
Lit de pont de bois ; c'en est le plancher, composé de poutrelles, & de travons avec son ponchis.
Lit de canal ou de reservoir ; c'en est le fond de sable, de glaise, de pavé, ou de ciment & de caillou.
LIT, (Coupe des pierres) par analogie au lit sur lequel on se couche, se dit 1°. de la situation naturelle de la pierre dans la carriere, qui est telle, que presque toujours les feuillets de la pierre sont paralleles à l'horison d'où ils ont pris le nom de lits ; 2°. de la surface sur laquelle on pose une pierre. La surface qui reçoit une autre pierre, laquelle regarde toujours vers le ciel supérieur, s'appelle lit de dessus. La surface par laquelle une pierre s'appuie sur une autre, & qui regarde toujours la terre ou le ciel inférieur, s'appelle lit de dessous. Lorsque les surfaces sont inclinées à l'horison, comme dans les voussoirs ou claveaux, on les appelle lits en joint. Voyez JOINT.
LIT, en terme de Cirier ; c'est un matelat couvert de drap & d'une couverte, entre lesquels on met les cierges jettés refroidir ou étuver, pour les rendre plus maniables.
LIT, (Jardinage) on dit un lit de terre, un lit de fumier ; c'est une certaine largeur, une épaisseur de terre ou de fumier, entremêlés l'un dans l'autre, ou bien c'est un lit de sable, un lit de fruits, tels que ceux que l'on pratique dans les manequins, pour conserver les glands & les chataignes pendant l'hiver.
Dans les fouilles des terres, on trouve encore différens lits, un lit de tuf, un lit de craie, de marne, de sable, de crayon, de caillou, de coquilles appellés coquillart, de glaise & autres.
LIT, MALLE, MUEE, ou BOUILLON DE POISSON, (Pêche) c'est ainsi que les pêcheurs de l'amirauté des sables d'Olone, appellent les troupes de poissons qui viennent ranger la côte dans certaines saisons.
LIT SOUS PLINTHE, terme de Sculpture. Le sculpteur dit faire un lit sous plinthe, pour exprimer le premier trait de scie qu'il fait donner à l'un des bouts d'un bloc de marbre, pour en former l'assise, base ou plinthe. Voyez PLINTHE.
|
| LITA | (Géog.) petite ville de la Turquie européenne, dans la Macédoine, avec un évêché suffragant de Salonique, à 7 lieues du golfe de ce nom. Long. 40. 47. lat. 40. 41. (D.J.)
|
| LITANIES | S. f. (Théologie) terme de Liturgie. On appelle litanies dans l'Eglise les processions & les prieres qu'on fait pour appaiser la colere de Dieu, pour détourner quelque calamité dont on est menacé, & pour remercier Dieu des bienfaits qu'on reçoit de sa bonté.
Ce mot vient du grec , supplication. Le P. Pezron voit plus loin ; & comme il a prétendu, que litare est pris du lit des Celtes, qui veut dire solemnité, il tireroit aussi apparemment les ou des Grecs du lit des Celtes.
Les auteurs ecclésiastiques & l'ordre romain appellent litanie les personnes qui composent la procession & qui y assistent.
Ducange dit que ce mot signifioit anciennement procession. Voyez PROCESSION.
Simon de Thessalonique dit, que la sortie de l'église dans la litanie, marque la chûte & le péché d'Adam qui fut chassé du paradis terrestre ; & que le retour à l'Eglise, marque le retour d'une ame à Dieu par la pénitence.
A l'occasion d'une peste qui ravageoit Rome l'an 590, saint Grégoire, pape, indiqua une litanie ou procession à sept bandes, qui devoient marcher au point du jour le mercredi suivant, sortant de diverses églises pour se rendre toutes à sainte Marie Majeure. La premiere troupe étoit composée du clergé ; la seconde des abbés avec leurs moines ; la troisieme des abbesses avec leurs religieuses ; la quatrieme des enfans ; la cinquieme des hommes laïques ; la sixieme des veuves ; la septieme des femmes mariées. On croit que de cette procession générale est venue celle de saint Marc, qu'on appelle encore la grande litanie.
Litanies, est aujourd'hui une formule de prieres qu'on chante dans l'église à l'honneur des saints, ou de quelque mystere. Elle contient certains éloges ou attributs, à la fin de chacun desquels on leur fait une invocation en mêmes termes.
|
| LITANTHRAX | S. m. (Hist. nat.) nom donné par les anciens naturalistes au charbon de terre & au jais. Voyez ces deux articles.
|
| LITCHFIELDS | Litchfeldia, (Géog.) ville d'Angleterre en Staffordshire, avec titre de comté, & un évêché suffragant de Cantorberi. Elle envoie deux députés au parlement. On voit près de Litchfields quelques restes de murs de l'ancien Etocetum, demeure des Carnavens, ou de l'ancien Litchfields même. Quoi qu'il en soit, cette ville est à 20 milles O. de Stafford, & à 94 N. O. de Londres. Long. 15. 50. lat. 52. 40.
Litchfields a donné le jour à deux hommes célebres qui étoient contemporains, Addisson & Ashmole.
Addisson (Joseph) un des beaux esprits d'Angleterre, a fait des ouvrages où regnent l'érudition, le bon goût, la finesse & la délicatesse d'un homme de cour. Sa tragédie de Caton est un chef-d'oeuvre pour la diction & pour la beauté des vers ; comme Caton étoit le premier des Romains, c'est aussi le plus beau personnage qui soit sur aucun théâtre. Le poëme d'Addisson sur la campagne des Anglois en 1704, est très-estimé ; celui qu'il fit à l'honneur du roi Guillaume, lui valut une pension de 300 livres sterlings. Il se démit en 1717 de sa place de secrétaire d'état, & mourut deux ans après, à l'âge de 47 ans. Il fut enterré dans l'abbaye de Westminster avec les beaux génies, les rois & les héros.
Ashmole (Elie) se distingua par ses connoissances dans les médailles, la Chimie & les Mathématiques. C'est de lui que le Musaeum Ashmolaeanum bâti à Oxford, a tiré son nom, parce qu'il a gratifié cette université de sa belle collection de médailles, de sa bibliotheque, de ses instrumens chimiques, & d'un grand nombre d'autres choses rares & curieuses. (D.J.)
|
| LITE | (Hist. nat.) nom générique que les habitans de l'île de Madagascar donnent à différentes especes de gommes ou de résines, produites par les arbres de leur pays. Lite-menta, n'est autre chose que le benjoin ; lite-rame, est la gomme-résine appellée plus ordinairement tacamahaca ; lite fimpi, est une résine odorante produite par un arbre appellé fimpi ; lite-enfouraha, est une gomme-résine verte, d'une odeur très-aromatique ; lite-mintsi, est une résine noire & liquide ; mais elle se durcit avec le tems : elle est produite par un arbre qui ressemble à l'acacia ; les femmes s'en servent pour se farder ; elle est très-propre à guérir les plaies. Lite-bistic, c'est une résine blanche qui se trouve attachée aux branches des arbres, où elle est portée par des fourmis. Lithura ou litin-barencoco, est une substance de la nature du sang-de-dragon ; litin-panne, est une gomme ou résine jaune & très-aromatique ; litin-haronga, est une autre résine jaune, produite par des arbres dont les abeilles du pays font le meilleur miel.
|
| LITEAU | S. m. (Menuis. & Charp.) c'est une petite tringle de bois, ainsi appellée ou de sa disposition ou de son usage, ou parce qu'elle est couchée sur une autre qui lui sert de lit, ou parce que d'autres reposent sur elle.
LITEAU, terme de Tisserand, se dit des raies bleues qui traversent les toiles d'une lisiere à une autre. Il n'y a que les pieces de toiles destinées à faire des serviettes & des nappes qui aient des liteaux ; & ces liteaux sont placés de distance en distance, de maniere que les nappes & les serviettes doivent en avoir un à chaque bout quand elles sont coupées.
LITEAU, terme de chasse : on appelle liteau le lieu où se couche & se repose le loup pendant le jour.
|
| LITEMANGHITS | S. m. (Commerce) c'est la gomme que les droguistes appellent alouchi ; on dit qu'elle coule du tronc du canelier.
|
| LITER | v. act. (Drap.) c'est coudre ou attacher avec du gros fil ou de la menue ficelle, des petites cordes de la grosseur du bout du doigt, le long de la piece entre l'étoffe & la lisiere, afin que la partie qui en a été couverte ne puisse prendre teinture, & qu'elle garde son fond ou pié. On reconnoît à cela la bonne teinture. Il est défendu aux teinturiers de teindre en écarlate, violette, verd-brun, verd-gai, si les draps ne sont lités. Voyez les réglem. de manuf.
LITER, terme de pêche, c'est mettre le poisson par lit dans les tonnes.
|
| LITÉS | (Mythol.) ; c'étoient, selon Homere, les Prieres, filles de Jupiter, & rien n'est plus ingénieux que l'allégorie sous laquelle il les dépeint. Ces déesses, dit-il, sont âgées, boiteuses, tiennent toujours les yeux baissés, & paroissent toujours rampantes & toujours humiliées ; elles marchent après l'Injure ; car l'Injure altiere, pleine de confiance en ses propres forces, les devance d'un pié leger, parcourt la terre, & la ravage insolemment. Les humbles Prieres la suivent pour guérir les maux qu'elle a causés. Celui qui les respecte & qui les chérit, en reçoit les plus grands bienfaits ; elles l'écoutent à leur tour dans ses besoins, & portent, avec efficace, ses voeux & ses supplications aux piés du trône de Jupiter.
On sait que du mot grec , lité, est venu dans l'église le terme de litanies, & celui de litare, faire un sacrifice agréable à la divinité. (D.J.)
|
| LITHARGE | S. f. (Pharmac. & Mat. méd.) on emploie indifféremment en Pharmacie celle qui est appellée litharge d'or, & celle qui est appellée litharge d'argent.
Cette matiere se purifie & se divise pour les usages pharmaceutiques en la reparant ou la pulvérisant à l'eau. Voyez PREPARATION Pharmac. & PULVERISATION, Chimie & Pharmac.
La litharge est de toutes les préparations de plomb la plus employée en Médecine pour l'usage extérieur : elle est sur-tout un ingrédient très-ordinaire des emplâtres. Elle fait la base ou constitue le corps d'un grand nombre. Voyez EMPLATRE.
Elle entre aussi dans la composition de plusieurs onguens ; le plus simple, le mieux entendu, celui où la litharge est véritablement dominante, & jouissant de ses propriétés ; celui en même tems qui est le plus usité, c'est le nutritum vulgaire. Voyez NUTRITUM.
Elle entre encore dans l'onguent dessicatif rouge, dans l'égyptiac, dans l'onguent de la mere, l'onguent des apôtres, &c. dans un grand nombre d'emplâtres, dans la pierre médicamenteuse, &c.
La litharge, est ainsi que les autres préparations de plomb, dessicative, répercussive & réfrigérante. Voyez PLOMB.
On peut employer la litharge, & on l'emploie même fort communément à préparer le vinaigre & le sel de saturne, dont nous parlerons au mot PLOMB. (b)
|
| LITHIASE | S. f. , litiasis, est un des noms de la maladie appellée plus communément la pierre ou le calcul. Voyez PIERRE & CALCUL.
|
| LITHIASI | ou LITHIASIS, est aussi une maladie des paupieres qui consiste dans des petites tumeurs dures & pétrifiées, engendrées sur leur bord. On les nomme autrement gravelles ; elles sont causées par une lymphe épaissie, endurcie & convertie en petites pierres ou sables dans quelques grains glanduleux ou plutôt dans quelques vaisseaux lymphatiques ; ce qui les rend enkistées. On fait facilement l'extraction de ces pierres avec une petite incision sur le kiste, jusqu'au corps étranger qu'on fait ensuite sauter avec une petite curete. La bonne Chirurgie prescrit que l'incision soit faite à la paupiere inférieure suivant sa longueur, c'est-à-dire d'un angle à l'autre pour suivre la direction des fibres du muscle orbiculaire. Au contraire les incisions intérieures qui se pratiquent à la paupiere supérieure, doivent se faire de haut en bas, de crainte de couper transversalement les fibres de l'aponevrose du muscle releveur de cette paupiere.
Lorsqu'on a quelques incisions à faire à l'intérieur des paupieres, il faut les renverser. Voyez SPECULUM OCULI. (Y)
|
| LITHOBIBLIA | (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs aux pierres sur lesquelles on trouve des empreintes de feuilles ; ces sortes de pierres sont très-communes, sur-tout dans le voisinage des mines de charbon de terre. Voyez PIERRES EMPREINTES. On les nomme aussi lithophylla. Quelques-uns entendent par-là non-seulement les empreintes des feuilles, mais les feuilles elles-mêmes pétrifiées ; elles sont très-rares, si même il en existe : cependant Wallerius parle de feuilles de roseau pétrifiées.
|
| LITHOBOLIES | S. f. (Littér.) fêtes qui se célébroient à Epidaure, à Egine & à Troëzène, en mémoire de Lamie & d'Auxésie, deux jeunes filles de l'île de Crête, que quelques habitans de Troëzène lapiderent dans une sédition. On ordonna, dit Pausanias, que pour appaiser leurs manes, on célébreroit tous les ans dans Troëzène une fête en leur honneur, & cette fête fut appellée lithobolies, ; ce mot vient de , pierre, & , je jette. (D.J.)
|
| LITHOCOLLE | S. f. (Gramm. & Architect.) espece de ciment dont on se sert pour attacher les pierres précieuses au manche, lorsqu'on se propose de les tailler sur la meule. Il se fait de vieille brique & de poix-résine ; pour le diamant, on use de plomb fondu, on l'y enchâsse avant que ce métal soit tout-à-fait refroidi. Au lieu de vieilles briques & de poix-résine, on emploie la poudre de marbre & la colle-forte, si l'on se propose d'avoir un mortier. Si l'on a une pierre éclatée à réunir, on ajoute au mortier précédent du blanc d'oeuf & de la poix.
|
| LITHOGRAPHIE | S. f. (Gram. Hist. nat.) C'est la description des pierres.
|
| LITHOLOGIE | S. f. (Hist. nat. Miner.) On nomme ainsi la partie de l'Histoire naturelle du regne mineral qui a pour objet l'examen des différentes especes de pierres, de leurs propriétés, & des caracteres qui les distinguent. Voyez PIERRES.
|
| LITHOMANCIE | S. f. (Divinat.) divination par les pierres, comme le porte ce nom tiré du grec, & composé de , pierre, & de , divination.
On n'a que quelques conjectures incertaines sur cette espece de divination. Dans le poëme des pierres attribué à Orphée, il est fait mention d'une qu'Apollon donna à Helenus le troyen. Cette pierre, dit le poëte, s'appelle siderités, & a le don de la parole ; elle est un peu raboteuse, dure, pesante, noire, & a des rides qui s'étendent circulairement sur sa surface. Quand Helenus vouloit employer la vertu de cette pierre, il s'abstenoit pendant 21 jours du lit conjugal, des bains publics, & de la viande des animaux ; ensuite il faisoit plusieurs sacrifices, il lavoit la pierre dans une fontaine, l'enveloppoit pieusement, & la portoit dans son sein. Après cette préparation qui rendoit la pierre animée, pour l'exciter à parler, il la prenoit à la main, & faisoit semblant de la vouloir jetter. Alors elle jettoit un cri semblable à celui d'un enfant qui desire le lait de sa nourrice. Helenus profitant de ce moment, interrogeoit la pierre sur ce qu'il vouloit savoir, & en recevoit des réponses certaines : c'est sur ces réponses qu'il prédit la ruine de Troie sa patrie.
Dans ce qui nous reste des prétendus oracles de Zoroastre, il est mention d'une pierre que Pline nomme astroite, qu'il faut offrir en sacrifice, dit Zoroastre, lorsqu'on verra un demon terrestre s'approcher. Delrio & Psellus appellent cette pierre mizouris, minzouris, & minsuris, & ajoutent qu'elle avoit la vertu d'évoquer les génies & d'en tirer les réponses qu'on souhaitoit ; mais les poëmes d'Orphée & de Zoroastre sont des ouvrages supposés : cherchons donc dans des sources plus certaines des traces de la lithomancie.
On en trouve dans l'Ecriture au livre du Lévitique, chap. xxvj. vers. 1. où Moïse défend aux Israélites d'ériger des pierres pour objet de leur culte. La vulgate porte insignem lapidem, quelques-uns croyent qu'il faut in signum lapidem, & que c'est une faute des copistes, car la version des septante porte , c'est-à-dire à la lettre, lapidem signum : ce qu'on peut aussi entendre de la défense que Moïse fit aux Israélites d'adorer les pierres. Mais il y a apparence que les Chananéens & les Phéniciens consultoient les pierres comme des oracles ; & ces pierres ainsi divinisées, sont connues dans toute l'antiquité sous le nom de boetiles ou pierres animées qui rendoient des oracles. Voyez BOETILES. Mém. de l'acad. des Inscript. tom. VI. pag. 514. 525. & 531. Delrio, Disquisit. magic. lib. IV. cap. xj. quaest. vij. sect. 1. pag. 555. On rapporte encore à la lithomancie la superstition de ceux qui pensent que la pierre précieuse qu'on nomme amethiste, a la vertu de faire connoître à ceux qui la portent, les événemens futurs par les songes.
|
| LITHOMARGA | (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs à une espece de craie ou de marne, que Wallerius regarde comme formée par la décomposition de la stalactite : elle est pierreuse.
|
| LITHONTRIPTIQUE | adj. (Thérapeut.) médicament qui a la vertu de briser les pierres renfermées en différentes cavités du corps humain, & spécialement dans la vessie urinaire. Voyez PIERRE, CHIMIE & THERAPEUTIQUE. (b)
LITHONTRIPTIQUE, de Tulpius, (Mat. medic.) nom d'un fameux diurétique imaginé par Tulpius docteur en médecine, & bourg-mestre d'Amsterdam. C'est un mêlange de mouches cantharides & de graine du petit cardamome ; mais quoique ce remede ait été donné quelquefois avec un grand succès dans les maux de reins & dans la gravelle, il requiert beaucoup de lumieres & de prudence, de la part des médecins qui tenteroient de l'employer. Voici, suivant M. Homberg (Mém. de l'acad. des Scienc. ann. 1709.) la préparation de ce remede, que Tulpius ne divulguoit pas, de peur qu'on n'en fît usage à contre-tems.
Prenez une dragme de cantharides sans les aîles, & une dragme du petit cardamome (cardamomi minoris) sans les gousses ; pulverisez-les ; versez ensuite dessus une once d'esprit de vin rectifié, & demi-once d'esprit de tartre ; laissez-les en infusion froide pendant cinq ou six jours, en les remuant de tems en tems. Il ne faut pas boucher exactement la phiole, car elle se casseroit par la fermentation perpétuelle qui s'y fait. La dose est depuis quatre jusqu'à quinze ou vingt gouttes dans un véhicule convenable, comme dans deux onces d'eau distillée de quelque plante apéritive, une heure après avoir avalé un bouillon, l'on prendroit ce remede trois ou quatre jours de suite, en observant un bon régime.
Le singulier de cette mixture de Tulpius, c'est qu'elle ne cesse point de fermenter durant plusieurs années. Si on bouche un peu fortement la phiole qui la contient, elle éclate en morceaux ; si on la bouche foiblement, elle fait sauter le bouchon avec explosion.
M. Homberg a éprouvé que cette liqueur a toujours travaillé pendant plus de deux ans, & qu'elle ne s'est jamais clarifiée parfaitement, même après l'avoir séparée par inclination de dessus ses féces.
Le sel d'urine ou l'alkali volatil qui se trouve dans les cantharides, est vraisemblablement si fort enveloppé des matieres huileuses & des autres parties de cet insecte, que l'acide quoique mineral ne peut l'atteindre qu'à la longue, & qu'il se fait pendant tout ce tems-là une ébullition continuelle. La même chose arrive à peu près de l'esprit de nitre avec la cochenille & avec la chair seche de viperes ; mais les substances liquides animales, comme l'urine ou la liqueur de la vésicule du fiel, font avec les mêmes acides des ébullitions très-promtes & très-peu durables. (D.J.)
|
| LITHOPHAGE | S. m. (Hist. nat. Insectolog.) petit ver qui s'engendre dans la pierre, & qui y vit en la rongeant. Il y en a de plusieurs especes : on en a trouvé de vivans & de morts entre les lits de la pierre la plus dure. D'autres ont une petite coquille fort tendre, de couleur verdâtre & cendrée : on apperçoit les traces du lithophage dans l'ardoise où il s'est creusé un chemin, lorsqu'elle étoit encore molle.
|
| LITHOPHOSPHORE | S. m. (Hist. nat.) nom donné par quelques naturalistes à une espece de spath qui après avoir été calciné doucement dans le feu, a comme bien d'autres pierres, la propriété de luire dans l'obscurité. La pierre de Bologne est une pierre de la même nature. Le lithophosphorus suhlensis ou de Suhla, dans le comté d'Henneberg en Thuringe, est un spath violet ou pourpre. Ces sortes de pierres sont calcaires ; ainsi, si on les calcinoit trop fortement, elles se changeroient en chaux, & ne seroient plus phosphoriques. Voyez PHOSPHORE.
|
| LITHOPHYTE | S. m. (Hist. nat.) lithophyton, production d'insecte de mer que l'on a regardée presque jusqu'à présent comme une plante, & qui porte encore le nom de plante marine. Il est vrai que les lithophytes ressemblent beaucoup aux plantes ; ils ont une tige, des branches, des rameaux, &c. Si on les coupe transversalement, on voit à l'intérieur des couches concentriques, une écorce, &c. Cependant les lithophytes appartiennent au regne animal ; ils sont produits par des insectes, comme les gâteaux de cire sont l'ouvrage des abeilles : au lieu de racines, ils ont une base adhérente à un rocher, à un caillou, à une coquille, ou à tout autre corps solide qui se rencontre à l'endroit où les insectes commencent leur édifice : ils l'élevent peu à peu & le ramifient. Les lithophytes sont recouverts d'une écorce molle & poreuse : chaque pore est l'ouverture d'une cellule dans laquelle reside un insecte. Cette écorce est de différentes couleurs dans diverses especes de lithophytes : il y en a de blancs, de jaunes, de rougeâtres, de pourprés, &c. M. Tournefort en rapporte vingt-huit especes dans ses institutions botaniques. Après avoir enlevé l'écorce du lithophyte, on trouve une substance qui a rapport à celle de la corne, lorsqu'elle est bien polie & d'un beau noir, on lui donne improprement le nom de corail noir. Il y a des lithophytes qui forment une sorte de rézeau. Voyez PANACHE DE MER, ANTE MARINERINE.
|
| LITHOPTERIS | S. f. (Hist. nat.) nom donné par Lhuid à des fougeres dont on trouve les empreintes sur des pierres tirées du sein de la terre, telles que celles qui accompagnent les mines de charbon de terre de S. Chaumont & d'autres endroits.
|
| LITHOSTREON | S. m. (Hist. nat.) Quelques auteurs entendent par ce mot les huitres ou ostracites qui se trouvent dans le sein de la terre.
|
| LITHOSTROTION | S. m. (Hist. nat.) On nomme ainsi une espece de corail qui se trouve dans le sein de la terre : il est composé de plusieurs colonnes ou articulations menues, qui sont ou cylindriques ou prismatiques, qui se joignent exactement les unes aux autres, & au sommet desquelles on remarque la forme d'une étoile.
|
| LITHOSTROTOS | S. m. (Littér.) Ce mot est grec ; , en latin Lithostrotum, c'est-à-dire, pavé de pierres ; mais les petits pavés porterent ce nom par excellence chez les anciens. Ils entendoient proprement par lithostrota, des pavés tant de marqueterie simple, que de mosaïque, faits de coupures de divers marbres qui se joignoient & s'enchâssoient ensemble dans le ciment. On formoit avec ce petit carrelage, toutes sortes de compartimens différens en couleurs, en grandeur, & en figures. Lithostrota, dit Grapaldus, è parvulis crustis marmoreis, quasi pavimenta lapidibus strata. C'est de ces sortes de pavés dont parle Varron, de re rust. lib. III. en écrivant à un de ses amis, quam villam haberes ope tectorio ac pavimentis nobilibus lithostratis spectandam, parum putasses esse, ni quoque parietes essent illis ornati.
Tel étoit le pavé du tribunal de Pilate, c'est-à-dire, du lieu où il tenoit le siege de judicature, dont il est fait mention dans S. Jean, chap. xix. . 13. " Pilate, dit l'évangéliste, les entendant parler de la sorte, amena Jesus dehors, & prit séance dans son tribunal, au lieu qu'on appelle en grec lithostrotos, & en hébreu gabbata ". Je conserve ici le mot lithostrotos avec plusieurs traducteurs, le pere Amelotte, M. Simon, la version de Mons, & autres ; & je crois qu'ils ont raison.
Les lithostrota ou pavés de marqueterie & de mosaïque succéderent aux pavés peints, inventés par les Grecs, & en firent perdre l'usage. C'est Pline, lib. XXXVI. cap. xxv. qui nous l'apprend en ces termes : Pavimenta originem apud Graecos habent, elaborata arte, picturae ratione, donec lithostrota eam expulere.
Ils commencerent à Rome sous Sylla, qui fit faire un de ces nouveaux pavés de pieces de rapport, dans le temple de la Fortune, à Préneste, environ 170 ans avant J. C. Les Juifs imiterent cette mode ; car outre le tribunal de Pilate, la salle de leur sanhédrin étoit pavée de cette maniere, comme on peut le voir dans Selden, lib. II. cap. xv. de Syned. Hebraeorum.
Lithostrotos est composé de , pierre & , un pavé, en latin stratum. (D.J.)
|
| LITHOTOME | S. m. (Instrument de Chirurgie) espece de bistouri avec lequel on fait une incision pour tirer la pierre de la vessie. Ce mot est grec, , composé de , lapis, pierre, & de , incisio, incision, du verbe , seco, j'incise. Les réformateurs des termes pensent qu'il seroit plus à propos d'appeller ce bistouri cystitome, de , vessie, ou uretro cystitome ; mais l'usage a prévalu.
Il y a plusieurs especes de lithotomes ; celui qui a été jusqu'ici le plus en usage, ressemble assez à une lancette. On y considere une lame & une châsse composée de deux pieces d'écaille : la lame est tranchante des deux côtés, de la longueur d'un pouce jusqu'à la pointe. On y remarque quatre émoutures, deux de chaque côté qui forment dans le milieu une vive-arrête, ce qui conserve beaucoup de force aux tranchans qui doivent être fort fins. Le talon de cette lame est terminé par une queue garnie à son extrêmité d'une petite lentille, pour arrêter & assujettir la lame dans le manche quand l'instrument est ouvert.
La pointe de ce lithotome a été sujette à plusieurs variations, suivant les différentes manieres de railler. Collot, qui se contentoit de faire une incision à l'urethre parallele à celle de la peau, se servoit d'un lithotome rond & mousse, Pl. VIII. fig. 6. Ceux qui ont pratiqué depuis, ayant senti la nécessité d'allonger l'incision de l'urethre du côté du col de la vessie, ont donné une pointe au lithotome, qu'ils ont nommée en langue de carpe, ibidem Pl. VIII. fig. 5. La largeur de cette pointe ne permettoit pas de porter l'incision assez avant, pour couper le bulbe de l'urethre sans intéresser l'intestin rectum : on l'a encore diminuée. Ibid. fig. 4.
Le but de ces réformes étoit de pouvoir allonger sans inconvénient l'incision de l'urethre en dessous ; & comme la pointe du lithotome ne doit point sortir de la cannelure de la sonde conductrice, le chirurgien est obligé de beaucoup baisser le poignet & de relever l'extrêmité des doigts. M. Ledran a cru que ce mouvement seroit moins gênant, & qu'on tiendroit avec plus de facilité la pointe du lithotome dans cette cannelure, si le tranchant supérieur décrivoit une ligne droite. Voyez ibidem, Pl. VIII. fig. 7.
La lame de ces différens lithotomes doit être assujettie sur la châsse par une bandelette de linge fin. Pour éviter cette préparation, l'on a construit des lithotomes dont la lame est fixée dans le manche : tels sont les lithotomes de M. Cheselden, Pl. VIII. fig. 1. & 3, & le lithotome, Pl. IX. fig. 8. M. Ledran a imaginé un petit couteau, Pl. IX. fig. 10, pour couper la prostate & le col de la vessie, après l'introduction du gorgeret dans la vessie. Les deux instrumens entre lesquels ce couteau est représenté sont des gorgerets de l'invention de M. Ledran. Voyez GORGERET.
La fig. 3 de cette même Planche IX. montre le lithotome de M. Foubert, pour sa méthode particuliere de tailler, tel qu'il l'a décrit dans le premier tome des mémoires de l'académie royale de Chirurgie. Il en a depuis imaginé un autre qu'il croit plus avantageux : nous l'avons fait graver, Pl. XXII. fig. premiere.
Un homme qui s'est annoncé anonymement, en disant qu'il n'étoit pas de l'art & qu'il n'y avoit aucune prétention, a imaginé il y a quelques années un lithotome caché, dont les premieres épreuves ont été faites sur le vivant par feu M. de la Roche, chirurgien de Paris. L'auteur encouragé par quelques succès, s'est fait lithotomiste, & n'a pas toujours eu à se féliciter de n'avoir pas laissé son instrument en d'autres mains ; l'académie royale de Chirurgie a porté sur ce lithothome un jugement impartial, inséré dans le troisieme volume de ses mémoires. Nous avons fait graver l'instrument, Pl. XXXVI. fig. 4 : en voici la description.
La lame tranchante a quatre pouces & demi de long, A. Cette lame a une gaîne B, dont la soie passe dans toute la longueur d'un manche de bois C, qui peut tourner sur elle : ce manche est à six pans ; chaque surface est à une distance inégale de l'axe de l'instrument D. Au moyen d'un ressort à bascule E, dont l'extrêmité inférieure entre dans des engrainures sur la virole du manche, on fixe la surface qu'on juge à propos sous la queue de la lame tranchante F, de façon qu'on peut à volonté faire sortir la lame de sa gaîne de 5, de 7, de 9, de 11, de 13 ou de 15 degrés. Des chiffres gravés sur chaque surface, indiquent le degré d'ouverture qu'elles permettent.
Pour se servir de cet instrument, on mer le malade en situation, voyez LIENS. On fait sur une sonde cannelée l'incision comme au grand appareil : l'opérateur porte alors l'extrêmité de la gaîne du lithotome caché dans la cannelure de la sonde ; il en tient le manche avec la main gauche, puis en faisant glisser le bec du lithotome le long de la cannelure sous l'os pubis, il introduit son instrument dans la vessie, & en retire la sonde qui n'est plus d'aucune utilité. Il faut reconnoître la pierre ; & suivant le volume dont on la juge, on regle, par le manche de l'instrument, la grandeur de l'incision dont on croit avoir besoin. Ces choses étant ainsi disposées, on porte le dos de la gaîne du lithotome sous l'arcade du pubis : on ouvre l'instrument, & on le retire tout ouvert jusqu'au dehors, en conduisant le tranchant de la lame suivant la direction de l'incision extérieure. Les parties sont coupées bien net ; l'introduction des tenettes se fait facilement, & l'on acheve l'opération par l'extraction de la pierre.
Voilà ce que l'auteur dit de sa maniere d'opérer, à laquelle il attribue de grands avantages. Il juge avec raison que la plus grande perfection de l'opération de la taille consiste à débrider entierement & nettement le trajet par où il faut extraire la pierre, & il prétend que l'ouverture de son instrument, qu'il croit pouvoir proportionner au volume différent des pierres, fait, avec toute la précision possible, le degré convenable d'incision, ensorte qu'elle n'a point les inconvéniens du déchirement & de la contusion, dont les suites peuvent être si funestes dans l'opération du grand appareil, & qu'elle est aussi moins douloureuse, puisqu'on peut tirer le corps étranger sans violence par la voie libre qu'on a ouverte.
Le grand appareil est certainement une méthode très-imparfaite, comme nous le démontrons au mot TAILLE : il a de très-grands inconvéniens, même par la maniere dont se fait la coupe extérieure, que l'auteur du lithotome caché a retenu. Il se propose d'obtenir, par l'incision que fait ce nouvel instrument, les avantages de la taille latérale dans laquelle, en ouvrant une voie libre à la pierre, on évite autant qu'il est possible la contusion de ces parties délicates, qui sont nécessairement déchirées & meurtries dans le grand appareil. C'est principalement du bourrelet que la prostate forme au col de la vessie, que dépend la plus grande difficulté de l'extraction de la pierre dans l'opération du grand appareil. Dès qu'on a incisé la prostate, il n'y a plus d'obstacle : la plaie forme un triangle dont la base est aux tégumens, & la pointe au col de la vessie. Voyons d'après ces principes, admis par l'auteur même du lithotome caché, si cet instrument a les avantages qu'il lui suppose.
Nous adoptons volontiers qu'il faut ouvrir une voie aisée aux pierres, pourvu qu'on n'entende pas que l'incision doive se faire sans égard aux parties qui peuvent être intéressées sans danger, & à celles qu'il est à propos de ménager. L'Anatomie doit être constamment le flambeau de la Chirurgie & le guide de ses opérations. La plus grande incision doit être bornée intérieurement à la section de la prostate, & s'étendre jusqu'au corps de la vessie exclusivement. C'est un dogme très-dangereux que de recommander vaguement une plus grande incision à l'extérieur pour les grosses pierres que pour celles d'un volume moyen. Il faut compter sur la souplesse des parties ; & dès qu'on convient qu'il n'y a que le corps de la prostate qui resiste, ce n'est que la prostate qu'il faut attaquer. Les incisions graduées du lithotome caché ont fait illusion à son auteur, & séduit ceux qui n'envisagent les objets que d'une vûe superficielle ; mais la raison & l'expérience en démontrent également le danger à ceux qui jugent d'après un examen réfléchi. Le lithotome ouvert à cinq degrés peut fendre entierement la prostate, & donner le même résultat que la taille latérale ; pourquoi donc se serviroit on de cet instrument à un plus grand degré d'ouverture ; ce ne sera pas pour faire une plus grande coupe extérieure : car il seroit absurde d'ouvrir une grande lame tranchante dans l'intérieur de la vessie, pour couper les tégumens & les parties qui sont en deçà de son col. S'il s'agit uniquement de couper la prostate, on le fait avec bien de la sureté par le dehors, en glissant un instrument tranchant, tel que le lithotome de Cheselden, le long de la cannelure de la sonde. Le nouveau lithotome ne doit couper que la prostate, & nous avons vu qu'il le pouvoit faire au n°. 5. Quel est donc le but qu'on se propose en ouvrant cet instrument jusqu'au n°. 13 ou au n°. 15 ? Ce ne peut être que dans la vûe de couper des parties plus éloignées, ou d'entamer plus profondément celles qui le seroient moins par un moindre degré d'ouverture de la lame du lithotome. Mais l'incision portée plus haut que le col de la vessie, sera dangereuse & tout-à-fait inutile pour l'extraction de la pierre ; si on entame plus profondément, on coupera les vésicules séminales & le rectum, & des vaisseaux dont l'hémorrhagie fera périr les malades. Voilà les dangers de cette pratique : la raison les fait sentir : des épreuves réitérées sur les cadavres nous les ont fait appercevoir ; & les opérations sur le vivant ne les ont que trop confirmées. En appréciant ainsi la valeur des choses, sans considérer le prix que le hasard & l'opinion ont pu y mettre, nous servons l'humanité, bien sûrs d'ailleurs que les personnes les plus prévenues aujourd'hui nous sauroient quelque jour mauvais gré de la complaisance que nous aurions eu de nous être trop prêtés à leur préoccupation.
L'avantage qui a le plus frappé dans le nouvel instrument, c'est l'invariabilité de son effet : on assure que le lithotome ouvert au degré qu'on juge convenable, fait avec précision & certitude la section, de même qu'un compas fait sûrement le cercle qui doit résulter de l'ouverture donnée de ses branches, soit qu'une main habile le conduise ou qu'une maladroite le dirige. De-là on a conclu que le nouveau lithotome pouvoit être mis avec confiance entre les mains de toute sorte de chirurgiens de différens degrés de génie & d'adresse, que tous feront uniformément la même opération sans crainte de manquer de précision ; qu'elle sera aussi parfaitement exécutée par l'homme qui a le moins d'expérience, que par le lithotomiste le plus consommé. Ce sont les propres expressions de ceux qui ont loué le nouveau lithotome ; mais ont-ils assez réfléchi à la comparaison qu'ils en ont faite avec un compas ? L'une des pointes du compas est fixe, & l'endroit sur lequel elle porte sera invariablement le centre du cercle que l'autre branche doit tracer. Il n'en est pas de même de la main d'un chirurgien, laquelle n'ayant pas de point fixe dans cette opération, peut, par une inclinaison du poignet si legere qu'on ne pourroit s'en appercevoir, faire beaucoup de mal avec une lame tranchante qui a quatre pouces & demi de long. Pour établir l'invariabilité de la précision qu'on dit résulter de l'usage de cet instrument, il faudroit que les mêmes parties fussent toujours coupées par le même écartement de la lame ; mais la lame portée plus ou moins profondément dans la vessie, fait varier la coupe au point que nous avons vû dans quelques cas l'incision moins grande au n°. 15 & au n°. 13, que dans d'autres tailles, avec les nos. 7 & 9. De plus, l'espace plus ou moins grand de l'intérieur de la vessie & la disposition variée de cet organe & des parties circonvoisines, font que l'instrument dans la même direction n'a point les mêmes rapports avec les parties sur lesquelles il doit agir. La lame tranchante ouverte au n°. 9, par exemple, pourra ne pas blesser une vessie spacieuse ; & qui peut douter qu'à ce même numéro elle ne doive faire une plaie très-dangereuse sur une vessie étroite & raccourcie ? Cependant l'ouverture de l'instrument ne se mesure pas sur le plus ou le moins de capacité de la vessie : c'est le volume de la pierre qui est la regle de l'écartement qu'on donne à la lame tranchante ; & malheureusement ce sont ordinairement dans des vessies étroites que se trouvent les plus grosses pierres. Enfin, pour revenir à la comparaison si défectueuse d'un compas & du lithotome, en traçant un cercle, c'est le compas lui-même qui fixe & assujettit la main ; & dans le cas de la lithotomie, c'est la main qui conduit l'instrument. Le troisieme volume des mémoires de l'académie royale de Chirurgie rapporte les expériences qui ont servi à porter ce jugement du nouveau lithotome.
La lithotomie des femmes a fait l'objet de recherches particulieres qui m'ont conduit à une nouvelle méthode de leur faire l'opération : j'en parlerai au mot TAILLE. Je vais donner ici la description de mon lithotome, ou instrument spécialement destiné à ma méthode, qui consiste à ouvrir l'urethre par deux sections latérales.
Il a deux parties, dont l'une est le bistouri ou lithotome, voyez Pl. XV. fig. 7, & l'autre un étui ou chape dans laquelle l'instrument tranchant est caché, ibidem, fig. 2. 5. & 6.
Le bistouri est composé d'une lame & d'une queue ou soie : la lame est longue de deux pouces & demi : les côtés sont bien tranchans, & la pointe mousse. Sa largeur est différente, suivant les différens sujets : elle est de dix lignes pour les plus grands, & de six pour les enfans. La queue ou soie a quatre pouces & demi de long, en y comprenant la piece de pouce faite en coeur ou en treffle : la tige de cette queue a une crête dans toute sa longueur à sa face supérieure.
La seconde partie de l'instrument que j'ai nommée la chape, est faite de deux pieces jumelles qui jointes ensemble forment une caisse de la même configuration que la lame du bistouri ; cette chape est vûe de profil, fig. 6. Chacune des pieces qui la composent est terminée par un bec de deux pouces & demi de long, & s'unit en un bouton olivaire pour former conjointement une sonde ou cannule ouverte latéralement pour le passage de l'instrument tranchant, fig. 4. A l'extrêmité opposée la chape fournit, avec le concours des deux pieces, un allongement quadrangulaire long de douze à quatorze lignes, dans lequel passe la soie du lithotome ; il y a une rainure en dedans de la partie supérieure pour loger la crête de la tige du lithotome, & un petit ressort au-dessous de l'avance qui tient à la plaque inférieure, pour gêner un peu cette tige, afin qu'elle ne glisse pas d'elle-même, & que le lithotome soit contenu lors même qu'on ne la soutient pas, lorsque l'incision est faite & qu'on porte les tenettes dans la vessie.
Chaque piece de la chape a encore des particularités qui la distinguent. La piece supérieure a extérieurement sur son milieu une crête pour servir de conducteur aux tenettes ; la piece supérieure, fig. 5, a dans son milieu un anneau auquel est soudé une piece de pouce, & l'on voit sur ses côtés les têtes de vis qui unissent les deux lames de la chape. Cet instrument est d'argent, & la lame d'acier. Nous expliquerons ses avantages à l'article TAILLE, opération de Chirurgie. (Y)
|
| LITHOTOMIE | S. f. terme de Chirurgie, opération par laquelle on tire la pierre de la vessie. Voyez l'étymologie de ce terme au mot LITHOTOME, & le détail des différentes manieres de pratiquer la lithotomie au mot TAILLE, opération de Chirurgie. (Y)
|
| LITHOXYLON | S. m. (Hist. nat.) nom donné par plusieurs naturalistes au bois pétrifié.
|
| LITHROS | (Géog. anc.) montagne de la petite Arménie, selon Strabon, liv. XII. pag. 556. Ortelius en fait une ville, faute d'avoir entendu le passage de cet ancien géographe. (D.J.)
|
| LITHUANIE | (Géog.) les Allemands nomment la Lithuanie, Lithaw ; quelques écrivains du moyen âge l'appellent en latin, Lithavia, Litavia, & les habitans, Lithavi ou Litavi. Ils ont remplacé les anciens Gélons, qui faisoient partie des Scythes.
C'est un grand pays de l'Europe, autrefois indépendant, & présentement uni à la république & à la couronne de Pologne, avec titre de grand duché.
Il a environ 150 lieues de long, & 100 lieues de large ; il est borné au nord par la Livonie, la Courlande, & partie de l'empire Russien ; à l'orient par le même empire ; au sud-est & au midi par la Russie polonoise ; au couchant par les palatinats de Lublin & de Poldaquie, le royaume de Prusse, & la mer Baltique.
Hartnoch nous a donné en latin la description de ce pays si long-tems inconnu ; mais son ancienne histoire est ensevelie dans la plus profonde obscurité.
Nous savons seulement en général que les ducs de Russie subjuguerent la Lithuanie dans les siecles barbares, & l'obligerent à lui payer un tribut qui consistoit en faisceaux d'herbes, en feuilles d'arbres, & en une petite quantité de chaussures faites d'écorces de tilleul. Ce tribut parut rude aux Lithuaniens, apparemment par la maniere dure dont on le levoit ; car il n'étoit pas difficile à payer. Quoi qu'il en soit, leur chef Erdivil prit les armes, secoua le joug, se rendit maître d'une partie de la Russie en 1217, & exigea des Russes le même tribut que la Lithuanie leur payoit précédemment.
Ringeld, un des successeurs d'Erdivil, ayant poussé ses conquêtes dans la Prusse, dans la Mazovie, & dans la Pologne, prit le titre de grand duc de Lithuanie. Mendog qui succéda à Ringeld, marcha sur ses traces ; mais à la fin les pillages continuels qu'il faisoit sur ses voisins, attirerent leur haine, & les chevaliers Teutoniques profitant des circonstances favorables, l'attaquerent si vivement, que Mendog pour sauver ses propres états, se déclara chrétien, & se mit avec son duché sous la protection d'Innocent IV. qui tenoit alors le siége de Rome.
Ce pontife, qui venoit de déclarer de sa propre autorité, Haquin roi de Norwége, en le faisant enfant légitime, de bâtard qu'il étoit, n'hésita pas de protéger Mendog, & voulant imiter en quelque maniere la grandeur de l'ancien sénat romain, il le créa roi de Lithuanie, mais roi relevant de Rome. " Nous recevons, dit-il, dans sa bulle du 15 Juillet 1251, ce nouveau royaume de Lithuanie, au droit & à la propriété de Saint Pierre, vous prenant sous notre protection, vous, votre femme, & vos enfans ".
Cependant la Lithuanie ne fut point encore un royaume, malgré l'érection du pape. Mendog même abandonna bientôt le Christianisme, & reprit la Courlande sur les chevaliers Teutoniques affoiblis. Les successeurs de Mendog maintinrent ses conquêtes, & les étendirent.
L'un d'eux, Jagellon s'étant rendu redoutable à la Pologne, & craignant les vicissitudes de la fortune, offrit aux Polonois de recevoir le baptême, & d'unir à ce royaume le duché de Lithuanie, en épousant la reine Hedwige. Les Polonois accepterent ses offres ; Jagellon fut baptisé à Cracovie le 12 Février 1386. Il prit le nom d'Uladislas, épousa Hedwige, & fut proclamé roi de Pologne : par ce moyen la Lithuanie fut unie à la Pologne, & le Paganisme qui avoit regné jusqu'au tems de Jagellon en Lithuanie, peut-être plus superstitieusement que chez aucun peuple du monde, s'abolit insensiblement, & prit une teinture de Christianisme. Jagellon gagna par son exemple, par sa conduite, & par sa libéralité, un grand nombre de ses sujets à la foi chrétienne ; il faisoit présent d'un habit gris à chaque personne qui se convertissoit.
Enfin, sous Casimir III. fils de Jagellon, les Polonois convinrent qu'ils ne feroient plus qu'un même peuple avec les Lithuaniens ; que le roi seroit élu en Pologne ; que les Lithuaniens auroient séance & suffrage à la diete ; que la monnoie seroit la même ; que chaque nation suivroit ses anciennes coutumes, & que les charges de la cour & du duché de Lithuanie subsisteroient perpétuellement, ce qui se pratique encore aujourd'hui. Tel est en deux mots tout ce qu'on sait de l'histoire de la Lithuanie.
On peut diviser ce pays en Lithuanie ancienne, & en Lithuanie moderne. La Lithuanie ancienne comprenoit la Lithuanie proprement dite, la Wolhinie, la Samogitie, la Poldakie, & partie de la Russie.
La Lithuanie moderne comprend neuf palatinats, savoir les palatinats de Vilna, de Troki, de Minski, de Novogrodeck, de Brestia, de Kiovie, de Mscislau, de Vitepsk, & de Poloczk.
La Lithuanie porte le titre de grand duché, parce qu'elle a dans son étendue plusieurs duchés particuliers, très anciens, & dont la plûpart ont été les partages des cadets des grands ducs.
On y parle la langue Esclavonne, mais fort corrompue ; cependant les nobles & les habitans des villes parlent polonois ; & c'est dans cette langue que les prédicateurs font leurs sermons.
Le duché de Lithuanie est un pays uni, coupé de lacs & de grandes rivieres très-poissonneuses, dont quelques-unes vont descendre dans la mer Noire, & les autres dans la mer Baltique. Les lacs sont formés par la fonte des neiges, l'eau coule dans des lieux creux, & y demeure. Les principaux fleuves sont le Dnieper, autrement dit le Borysthène, & le Vilia ; l'un & l'autre prennent leurs sources dans la Lithuanie. La Dwine la traverse, & la Niemen qui s'y forme de plusieurs rivieres, va se perdre dans le golfe de Courlande ; les forêts abondent en gibier & en venaison.
Le trafic du pays consiste en blé, en miel, en cire, en peaux de zibelines, de panthères, de castors, d'ours, & de loups, que les étrangers viennent chercher sur les lieux.
Les lithuaniens ont une maniere de labourer, qui leur est commun avec les habitans de la Russie blanche ; ils coupent dans l'été des rameaux d'arbres & de buissons ; ils étendent ce bois sur la terre, & couchent par-dessus de la paille, pour le couvrir pendant l'hiver ; l'été suivant ils y mettent le feu ; ils sement sur la cendre & sur les charbons, & aussitôt ils passent la charrue par-dessus. C'est ainsi qu'ils engraissent leurs terres, tous les six ou huit ans, ce qui leur procure d'abondantes recoltes.
Il paroît de ce détail que le duché de Lithuanie doit être regardé comme un pays qui peut fournir toutes les choses nécessaires à la vie ; mais cet avantage n'est que pour les nobles ; les paysans y sont encore plus malheureux qu'en Pologne ; leur état est pire que celui des esclaves de nos colonies ; ils ne mangent que du pain noir comme la terre qu'ils sement, ne boivent que d'une biere détestable, ou du médon, breuvage de miel cuit avec de l'eau, portent des chaussures d'écorces de tilleul, & n'ont rien en propriété. Un seigneur qui tue quelqu'un de ces malheureux, en est quitte pour une légere amende. La moitié de l'Europe est encore barbare : il n'y a pas long-tems que la coutume de vendre les hommes subsistoit en Lithuanie ; on en voyoit qui nés libres, vendoient leurs enfans pour soulager leur misere, ou se vendoient eux-mêmes, pour pouvoir subsister. (D.J.)
|
| LITHUS | S. m. (Hist. nat.) nom que les anciens ont quelquefois donné à l'aimant, qu'ils appelloient pierre par excellence.
|
| LITIERE | S. f. (Littér. rom.) en latin basterna & lectica. C'étoit chez les Romains comme parmi nous, une espece de corps de carrosse, suspendu sur des brancards. Entrons dans quelques détails.
Les Romains avoient deux sortes de voitures portatives, dont les formes étoient différentes, & qui étoient différemment portées ; savoir, l'une par des mulets, on l'appelloit basterna, & l'autre par des hommes, on la nommoit lectica.
La basterne ou la litiere proprement nommée selon nos usages, a été parfaitement décrite dans une ancienne épigramme que voici :
Aurea matronas claudit basterna pudicas,
Quae radians latum gestat utrumque latus.
Hanc geminus portat duplici sub robore burdo,
Provehit, & modicè pendula septa gradu.
Provisum est cautè, ne per loca publica pergens
Fucetur visis, casta marita viris.
" Une litiere dorée & vitrée des deux côtés, enferme les dames de qualité. Elle est soutenue sur un brancard par deux mulets qui portent à petits pas cette espece de cabinet suspendu : la précaution est fort bonne, pour empêcher que les femmes mariées ne soient subornées par les hommes qui passent ".
Isidore, dans ses Origines, lib. XX. cap. xij. & d'autres auteurs, parlent aussi de cette litiere fermée, qui ne servoit que pour les femmes.
L'autre espece de litiere appellée lectica, étoit communément ouverte, quoiqu'il y en eût de fermées ; les hommes s'en servoient d'ordinaire, & des esclaves la portoient, comme c'est la coutume parmi les Asiatiques pour les palanquins. Il y en avoit de plus ou moins magnifiques, selon la qualité, le rang, ou le goût dominant du luxe. Dion Cassius nous apprend que sous Claude ces sortes de litieres vinrent à la mode pour les dames ; on les faisoit alors plus petites qu'auparavant, & toutes découvertes. De-là vient que Pline appelloit les litieres couvertes, des chambres de voyageurs.
On y employoit plus ou moins de porteurs, deux, quatre, six, huit. La litiere, lectica, portée par quatre esclaves, s'appelloit tétraphore, tetraphorum ; la litiere portée par six, s'appelloit exaphore, exaphorum ; & la litiere portée par huit, se nommoit octophore, octophorum.
On en usoit non seulement en ville, mais en voyage, comme on peut le voir dans Plutarque, au sujet de Cicéron, qui commanda à ses domestiques de s'arrêter, & de poser la litiere, lorsqu'Hérennius qui le cherchoit avec ses soldats, par ordre de Marc-Antoine, pour lui ôter la vie, étoit prêt de l'atteindre : alors Cicéron tendit le cou hors de sa litiere, regardant fixément ses meurtriers, tandis que ses domestiques désolés se couvroient le visage : ainsi périt l'orateur de Rome, le 8 Décembre 710, âgé de près de 64 ans.
Il semble résulter de ce détail, que nos litieres portées par des mulets ou par des chevaux, répondent à la basterne, & que nos chaises vitrées, portées par des hommes, se rapportent en quelque maniere à la lectica des Romains.
Mais il est bon de remarquer que le mot lectica avoit encore d'autres significations analogues à celui de litiere. 1°. Il désignoit de grandes chaises de chambre, vitrées de toutes parts, où les femmes se tenoient, travailloient, & parloient à tous ceux qui avoient à faire à elles : j'ai vu quelque chose d'approchant dans des cafés à Londres. Auguste avoit une de ces chaises, où il s'établissoit souvent après souper, pour travailler ; Suétone l'appelle lecticulam lucubratoriam.
La sella étoit moins élevée que la lectica, & ne pouvoit contenir qu'une personne assise.
2°. Lectica signifioit encore le cercueil dans lequel on portoit les morts au bucher. On les plaçoit sur ce brancard, habillés d'une maniere convenable à leur sexe & à leur rang : on en trouvera la preuve dans Denys d'Halicarnasse, dans Cornelius Nepos & autres historiens. Voyez aussi Kirchman, de funeribus Romanorum.
Il est vraisemblable que lectica est dérivé de lectus, un lit, parce qu'il y avoit dans la litiere un coussin & un matelas comme à un lit.
L'invention de cette voiture portative par des hommes ou par des bêtes, venoit des rois de Bithynie ; mais l'usage de ces voitures prit une telle faveur à Rome, que sous Tibere, les esclaves se faisoient porter en litiere par d'autres esclaves inférieurs. Enfin, cette mode s'abolit sous Alexandre Sévere, pour faire place à celle des chars, qui s'introduisit jusques chez les gens du menu peuple de Rome, à qui l'empereur permit de décorer leurs chars, & de les argenter à leur fantaisie.
Je finis d'autant mieux que le lecteur peut se dédommager de mes omissions par le traité de Scheffer, de re vehiculari in-4°. & celui d'Arstorphius, de lectis & lecticis in-12. (D.J.)
LITIERE, (Maréch.) paille dénuée de grain, qu'on met sous les chevaux pour qu'ils se couchent dessus à l'écurie. Faire la litiere, c'est mettre de la litiere neuve, ou remuer la vieille avec des fourches, pour que le cheval soit couché plus mollement.
|
| LITIERS | ou LITIERSÉS, s. m. (Littér.) sorte de chanson en usage parmi les Grecs, & sur-tout affectée aux moissonneurs : elle fut ainsi nommée de Lytiersés, fils naturel de Midas, & roi de Celènes en Phrygie.
Pollux dit que le lytierse étoit une chanson de deuil qu'on chantoit autour de l'aire & des gerbes, pour consoler Midas de la mort de son fils, qui, selon quelques-uns, avoit été tué par Hercule. Cette chanson n'étoit donc pas une chanson grecque dans son origine. Aussi Pollux la met-il au rang des chansons étrangeres ; & il ajoute qu'elle étoit particuliere aux Phrygiens, qui avoient reçu de Lytiersés l'art de l'Agriculture. Le scholiaste de Théocrite assure que de son tems les moissonneurs de Phrygie chantoient encore les éloges de Lytiersés, comme d'un excellent moissonneur.
Si le lytierse a été dans son origine une chanson étrangere aux Grecs, qui rouloit sur les éloges d'un prince phrygien, on doit reconnoître que les moissonneurs de la Grece n'adopterent que le nom de la chanson, & qu'il y eut toujours une grande différence entre le lytierse phrygien & le lytierse grec. Ce dernier ne parloit guere ni de Lytiersés, ni de Midas, à en juger par l'idille X de Théocrite, où le poëte introduit un moissonneur, qui après avoir dit, voyez ce que c'est que la chanson du divin Lytiersés, la rapporte partagée en sept couplets, qui ne s'adressent qu'aux moissonneurs, à ceux qui battent le grain, & au laboureur qui emploie les ouvriers. Au reste cette chanson de Lytiersés passa en proverbe en Grece, pour signifier une chanson qu'on chantoit à contrecoeur & par force. Pollux, lib. IV. c. vij. Erasm. adag. chil. iij. cent. 4. adag. 75. diss. de M. de la Nause, sur les chansons anciennes. Mém. de l'acad. des Belles-Lettres, tome IX. pag. 349. & suiv.
|
| LITIGANT | adj. (Jurisprud.) est celui qui conteste en justice. On dit les parties litigantes, & on appelle collitigans ceux qui sont unis d'intérêt, & qui plaident conjointement. (A)
|
| LITIGE | S. m. (Jurisprud.) signifie procès : on dit qu'un bien est en litige, lorsqu'il y a contestation à ce sujet.
Ce terme est usité sur-tout en matiere bénéficiale, pour exprimer la contestation qui est pendante entre deux contendans, pour raison d'un même bénéfice ; quand l'un des deux vient à décéder pendant le litige, on adjuge à l'autre la possession du bénéfice. (A)
|
| LITIGIEUX | adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est en litige, comme un héritage, un office, un bénéfice ; & on appelle droits litigieux, tous droits & actions qui ne sont pas liquides, & qui souffrent quelque difficulté. Voyez DROITS LITIGIEUX. (A)
|
| LITISPENDANCE | S. f. (Jurisprud.) c'est quand il y a procès pendant & indécis avec quelqu'un.
La litispendance est un moyen d'évocation, c'est-à-dire que quand on est déja en procès avec quelqu'un dans une jurisdiction, on peut évoquer une demande qui est formée devant un autre juge, si cette demande est connexe avec le premier procès.
Pour que la litispendance puisse autoriser l'évocation, il faut que ce soit entre les mêmes personnes, pour le même objet, & en vertu de la même cause.
Les déclinatoires proposés pour cause de litispendance, doivent être jugés sommairement à l'audience, suivant l'article 3. du tit. 6. de l'ordonnance de 1667. (A)
|
| LITOMANCIE | S. f. (Divinat.) espece de divination ainsi nommé de , ce qui rend un son clair & aigre, & de , divination. Elle consistoit à pousser l'un contre l'autre plusieurs anneaux, dont le son plus ou moins clair ou aigu, manifestoit, disoit-on, la volonté des dieux, & formoit un présage bon ou mauvais pour l'avenir.
|
| LITORNE | S. f. turdus pilaris, (Hist. nat. Ornitholog.) espece de grive, qui est un peu plus grande que la grive simplement dite. Voyez GRIVE. Elle a la tête, le cou, & le croupion de couleur cendrée, & le dos de couleur rousse obscure. Il y a de chaque côté de la tête une tache noire, qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'oeil. Raii synop. avium. Voyez OISEAU.
|
| LITOTE | subst. f. ou diminutions en Rhétorique, (Littér.) Harris & Chambers disent que c'est un trope par lequel on dit moins qu'on ne pense ; comme lorsqu'on dit à quelqu'un à qui l'on a droit de commander : Je vous prie de faire telle ou telle chose. Le mot je vous prie, emporte une idée d'empire & d'autorité qu'il n'a pas naturellement. Voyez DIMINUTIONS. Harris cite un autre exemple, mais qui n'est pas intelligible.
Mais M. du Marsais, qui a examiné très-philosophiquement la matiere des figures, dit que " c'est un trope par lequel on se sert de mots, qui, à la lettre, paroissent affoiblir une pensée dont on sait bien que les idées accessoires feront sentir toute la force : on dit le moins par modestie ou par égard ; mais on sait bien que ce moins réveillera l'idée du plus. Quand Chimène dit à Rodrigue (Cid, acte III. sc. 4.) Va, je ne te hais point, elle lui fait entendre bien plus que ces mots là ne signifient dans leur sens propre. Il en est de même de ces façons de parler : je ne puis vous louer, c'est-à-dire, je blâme votre conduite ; je ne méprise pas vos présens, signifie que j'en fais beaucoup de cas... On appelle aussi cette figure exténuation ; elle est opposée à l'hyperbole ".
Ce que j'ai remarqué sur l'ironie (voyez IRONIE) me paroît encore vrai ici. Si les tropes, selon M. du Marsais même, qui pense en cela comme tous les Rhéteurs & les Grammairiens, (part. I. art. jx) sont des figures par lesquelles on fait prendre à un mot une signification, qui n'est pas précisément la signification propre de ce mot ; je ne vois pas qu'il y ait aucun trope, ni dans les exemples qu'on vient de voir, ni dans ceux qu'il cite encore : il n'est pas un sot, il n'est pas un poltron ; Pythagore n'est pas un auteur méprisable ; je ne suis pas si difforme. Chaque mot y conserve sa signification propre ; & la seule chose qu'il y ait de remarquable dans ces locutions, c'est qu'elles ne disent pas tout ce que l'on pense, mais les circonstances l'indiquent si bien, qu'on est sûr d'être entendu. C'est donc en effet une figure de pensées, plutôt qu'une figure de mots, plutôt qu'un trope.
Le P. Lami, de l'Oratoire, dit dans sa rhétorique (liv. II. ch. iij.), que l'on peut rapporter à cette figure les manieres extraordinaires de représenter la bassesse d'une chose, comme quand on lit dans Isaïe, (xl. 12.) Quis mensus est pugillo aquas, & caelos palma ponderavit ? Quis apprendit tribus digitis molem terrae, & libravit in pondere montes, & colles in statera ? Et plus bas lorsqu'il parle de la grandeur de Dieu (22) : Qui sedet super gyrum terrae, & habitatores ejus sunt quasi locustae ; qui extendit sicut nihilum caelos, & expandit eos sicut tabernaculum ad inhabitandum. J'avoue que je ne vois rien ici qui indique une pensée mise au-dessous de sa valeur, de propos délibéré, & par modestie ou par égard ; si elle y est au-dessous de la vérité, c'est que la vérité dans cette matiere est d'une hauteur inaccessible à nos foibles regards.
|
| LITRE | S. f. ou ceinture funebre, (Jurisprud.) est un lé de velours noir, sur lequel on pose les écussons des armes des princes & autres seigneurs lors de leurs obseques.
On entend aussi par le terme de litre une bande noire, peinte en forme de lé de velours sur les murs d'une église en dedans & en dehors, sur laquelle on peint les armoiries des patrons & des seigneurs hauts-justiciers après leur décès.
Le terme de litre vient du latin litura, à cause que l'on noircit la muraille de l'église.
On l'appelle aussi ceinture funebre, parce qu'elle ne s'appose qu'après le décès des personnes qui sont en droit d'en avoir.
Le droit de litre est un des principaux droits honorifiques, ou grands honneurs de l'église, & en conséquence il n'appartient qu'aux patrons & aux seigneurs hauts-justiciers du lieu où l'église est bâtie.
L'usage des litres n'a commencé que depuis que les armoiries sont devenues héréditaires. Il a d'abord été introduit en l'honneur des patrons seulement ; & a été ensuite étendu aux seigneurs hauts-justiciers.
Le patron a droit de litre, quoiqu'il n'ait ni le fief, ni la justice sur le terrein où est l'église, parce que le seigneur en lui permettant de faire bâtir une église en son territoire, est censé avoir consenti que le patron eût les premiers honneurs, à moins qu'il ne se les soit expressément reservés. Le patron ecclésiastique ne peut pas mettre ses armes de famille sur sa litre, il doit y mettre celles de son église.
Le seigneur haut-justicier a aussi droit de litre à ses armes. La coutume de Tours, article 60, & celle de Lodunois c. v. art. ij. en contiennent une disposition expresse. Dans l'église la litre du patron est au-dessus de la sienne ; au-dehors de l'église, c'est celle du seigneur qui est au-dessus de celle du patron.
Les moyens & bas-justiciers n'ont point de litre, à moins qu'ils ne soient fondés en titre ou possession immémoriale.
Le droit de litre est tantôt personnel & tantôt réel. Il est personnel à l'égard du patron ou fondateur, & comme tel il passe à l'aîné de la famille ; mais quand le patronage est attaché à une glebe, le droit de litre suit la glebe comme le patronage. Quant au haut-justicier, il n'a jamais le droit de litre qu'à cause de sa haute-justice.
Pour avoir droit de litre comme seigneur haut-justicier, il faut être propriétaire, c'est pourquoi les usufruitiers, les douairieres & les seigneurs engagistes, n'ont pas ce droit.
La largeur ordinaire de la litre est d'un pié & demi, ou deux piés au plus. Maréchal, en son traité des droits honorifiques, dit qu'il n'y a que les princes pour lesquels on en peut mettre de plus larges, telles que de deux piés & demi : les écussons d'armoiries sont ordinairement éloignés de 12 piés les uns des autres.
Le fondateur d'une chapelle bâtie dans une aîle d'une église, dont un autre est patron ou seigneur haut-justicier, ne peut avoir de litre que dans l'intérieur de sa chapelle, & non dans le choeur, ni dans la nef, ni au-dehors de l'église. Le patron du corps de l'église peut même étendre sa litre jusques dans la chapelle fondée par un autre, & faire poser sa litre au-dessus de celle du fondateur de la chapelle. Ducange, verbo LITRA, & voyez la gloss. du Droit françois au mot litre. De Roye, de jurib. honotific. l. I. c. ij. & iij. Chopin, de doman. l. III. tit. 19. n. 16. Bacquet, traité des dr. de just. c. xx. n. 26. Maréchal, des droits honorifi. c. v. Dolive, quest. l. II. c. xj. (A)
|
| LITRON | S. m. (Mesur.) petite mesure françoise, ronde, ordinairement de bois, dont on se sert pour mesurer les choses seches, comme grains, graines, pois, feves, & autres légumes ; sel, farine, chataignes, &c. Elle contient la seizieme partie d'un boisseau de Paris.
Suivant l'ordonnance de 1670, le litron de Paris doit avoir trois pouces & demi de haut, sur trois pouces dix lignes de diametre. Le demi- litron qui est la plus petite des mesures françoises, seches, manuelles & mesurables, excepté pour le sel, doit avoir deux pouces dix lignes de haut, sur trois pouces & une ligne de diametre. De la Mare, traité de la pol. l. V. c. iij. & Savary. (D.J.)
|
| LITTÉRAL | adj. (Gram.) pris à la lettre, ou dans l'exactitude rigoureuse de l'expression. Ainsi, l'écriture a un sens littéral, & un sens allégorique : un ordre a un sens littéral, ou un sens figuré.
|
| LITTÉRAL | adj. (Matth.) les Mathématiciens modernes font un très-grand usage du calcul littéral, qui n'est autre chose que l'Algebre : on lui a donné ce nom, parce qu'on y fait usage des lettres de l'alphabet, pour le distinguer du calcul numérique, où l'on n'emploie que des chiffres. Voyez ALGEBRE, ARITHMETIQUE, CALCUL. (E)
|
| LITTÉRATURE | S. f. (Sciences, Belles-Lettres, Antiq.) terme général, qui désigne l'érudition, la connoissance des Belles-Lettres & des matieres qui y ont rapport. Voyez le mot LETTRES, où en faisant leur éloge on a démontré leur intime union avec les Sciences proprement dites.
Il s'agit ici d'indiquer les causes de la décadence de la Littérature, dont le goût tombe tous les jours davantage, du moins dans notre nation, & assurément nous ne nous flattons pas d'y apporter aucun remede.
Le tems est arrivé dans ce pays, où l'on ne tient pas le moindre compte d'un savant, qui pour éclaircir, ou pour corriger des passages difficiles d'auteurs de l'antiquité, un point de chronologie, une question intéressante de Géographie ou de Grammaire, fait usage de son érudition. On la traite de pédanterie, & l'on trouve par-là le véritable moyen de rebuter tous les jeunes gens qui auroient du zele & des talens pour réussir dans l'étude des humanités. Comme il n'y a point d'injure plus offensante que d'être qualifié de pédant, on se garde bien de prendre la peine d'acquérir beaucoup de littérature pour être ensuite exposé au dernier ridicule.
Il ne faut pas douter que l'une des principales raisons qui ont fait tomber les Belles-Lettres, ne consiste en ce que plusieurs beaux-esprits prétendus ou véritables, ont introduit la coutume de condamner, comme une science de collége, les citations de passages grecs & latins, & toutes les remarques d'érudition. Ils ont été assez injustes pour envelopper dans leurs railleries, les écrivains qui avoient le plus de politesse & de connoissance de la science du monde. Qui oseroit donc après cela aspirer à la gloire de savant, en se parant à propos de ses lectures, de sa critique & de son érudition ?
Si l'on s'étoit contenté de condamner les Hérilles, ceux qui citent sans nécessité les Platons & les Aristotes, les Hippocrates & les Varrons, pour prouver une pensée commune à toutes les sectes & à tous les peuples policés, on n'auroit pas découragé tant de personnes estimables ; mais avec des airs dédaigneux, on a relégué hors du beau monde, & dans la poussiere des classes, quiconque osoit témoigner qu'il avoit fait des recueils, & qu'il s'étoit nourri des auteurs de la Grece & de Rome.
L'effet de cette censure méprisante a été d'autant plus grand, qu'elle s'est couverte du prétexte spécieux de dire, qu'il faut travailler à polir l'esprit, & à former le jugement, & non pas à entasser dans sa mémoire ce que les autres ont dit & ont pensé.
Plus cette maxime a paru véritable, plus elle a flatté les esprits paresseux, & les a porté à tourner en ridicule la Littérature & le savoir ; tranchons le mot, le principal motif de telles gens, n'est que d'avilir le bien d'autrui, afin d'augmenter le prix du leur. Incapables de travailler à s'instruire, ils ont blamé ou méprisé les savans qu'ils ne pouvoient imiter ; & par ce moyen, ils ont répandu dans la république des lettres, un goût frivole, qui ne tend qu'à la plonger dans l'ignorance & la barbarie.
Cependant malgré la critique amere des bouffons ignorans, nous osons assurer que les lettres peuvent seules polir l'esprit, perfectionner le goût, & prêter des graces aux Sciences. Il faut même pour être profond dans la Littérature, abandonner les auteurs qui n'ont fait que l'effleurer & puiser dans les sources de l'antiquité, la connoissance de la religion, de la politique, du gouvernement, des lois, des moeurs, des coutumes, des cérémonies, des jeux, des fêtes, des sacrifices & des spectacles de la Grece & de Rome. Nous pouvons appliquer à ceux qui seront curieux de cette vaste & agréable érudition, ce que Plaute dit plaisamment dans le prologue des Ménechmes : " La scène est à Epidamne, ville de Macédoine ; allez-y, Messieurs, & demeurez-y tant que la piece durera ". (D.J.)
|
| LITTUS | (Géog. anc.) ce mot latin qui veut dire rivage, côté de la mer, étant joint à quelque épithète, a été donné par les anciens comme nom propre à certains lieux. Ainsi dans Ptolémée, Littus Caesiae, étoit une ville de Corse ; Littus magnum, une ville de Taprobane, &c. (D.J.)
LITTUS, PLAGIA, PORTUS, STATIO, POSITIO, COTO, REFUGIUM, GRADUS, (Géog. marit. des Rom.) : il y a dans tous ces mots de la navigation des Romains, des différences qu'il importe d'expliquer, non-seulement pour l'intelligence des auteurs, mais encore parce que l'itinéraire maritime d'Antonin est disposé par littora, plagia, portus, stationes, positiones, cotones, refugia, & gradus.
Je commence par le mot littus, rivage, terme qui a la plus grande étendue, & qui comprend tous les autres ; car, à parler proprement, littus est la lisiere, le bord de la terre habitable qui touche les mers, comme ripa, la rive, signifie la lisiere qui borde les fleuves de part & d'autre. Il est vrai cependant qu'en navigation, ce mot général a une signification spéciale. En effet, il se prend dans les bons auteurs pour tout endroit où les bâtimens peuvent aborder à terre, & y rester à l'ancre avec quelque sureté ; & pour lors, ce mot désigne ce que nous appellons une rade.
Plagia, plage, se confond assez ordinairement avec littus & statio, comme Surita le remarque ; mais aussi souvent les rades & plages, plagia, sont des parties du rivage, fortifiées par des ouvrages de maçonnerie pour en rendre l'accès plus sûr & plus facile. On appelloit ces sortes de fortifications ou remparemens, aggeres, nom commun à toute levée de terre, excédant en hauteur la surface du terrein.
Il se trouve aussi des rades ou stations, stationes, très-sûres, & qui sont l'ouvrage seul de la nature. Telle est celle que Virgile dépeint dans ses Géorgiques, liv. II.
.... Est specus ingens
Exesi latere in montes quo plurima vento
Cogitur, inque sinus scindit sese unda reductos,
Deprensis olim statio tutissima nautis.
Portus signifie tous ports faits par nature ou par art, ou désignés par la nature, & achevés par artifice.
Cotones sont les ports sûrs faits uniquement de main d'hommes ; Cotones, dit Festus ; appellantur portus in mari tutiores, arte & manu facti ; tel étoit le port de Carthage en Afrique, que Scipion attaqua. Portum, dit Appius, quem cotonem appellant, ineunte vere aggressus est Scipio ; tel étoit encore le port de Pouzzole près de Naples, au rapport de Strabon.
Stationes, les stations, tiennent le milieu entre les plages & les ports, plagia & portus ; ce sont des lieux faits, soit naturellement, soit artificiellement, où les navires se tiennent plus sûrement que dans de simples plages ; mais moins sûrement que dans les ports. Surita nous le fait entendre en disant : Stationes, sunt quae portuum tutam mansionem non assequuntur, & tamen littoribus praestant : tel étoit dans l'île de Lesbos le havre dont parle Virgile en ces termes :
Nunc tantum sinus, & statio male fida carinis.
Positiones, les positions, désignent la même chose que les stations ; positiones pro stationibus indifferenter usurpantur, dit un des commentateurs de l'itinéraire d'Antonin.
Refugium semble désigner en général tout rivage où l'on peut aborder : cependant, il paroît signifier spécialement un havre, où les navires qui y abordent peuvent rester avec assurance. Ego arbitror, dit Surita, voce refugii, stationes designare, quâ fida navibus mansio designatur.
Gradus, degré, signifie quelquefois une espece de pont sur le bord de la mer, ou sur le rivage des grands fleuves, faits exprès comme par degrés pour monter de terre dans le vaisseau, ou du vaisseau descendre sur terre avec plus de facilité. C'est la définition de Surita. J'ajoute, que les Romains donnerent plus communément le nom de gradus aux ports qui étoient à l'embouchure des rivieres, & où l'on avoit pratiqué des degrés. Enfin, ils nommerent gradus, les embouchures du Rhône. Ammian Marcellin nous l'apprend en décrivant le cours de ce fleuve : Rhodanus, dit-il, inter valles quas ei natura praescripsit, spumens gallico mari concorporatur ; per patulum sinum, quem vocant, ad gradus, ab Arelate 18. fermè lapide disparatum ; " le Rhône coulant entre des vallées que la nature lui a prescrites, se jette tout écumant dans la mer gauloise, par une ouverture qu'on nomme aux degrez, environ à 18 milles de la ville d'Arles ". Voyez GRADUS. (D.J.)
|
| LITUBIUM | (Géog.) ancien lieu de l'Italie dans la Ligurie, selon Tite-Live, liv. XXXII. C'est présentement Ritorbio, village du Milanez dans le Pavesan. (D.J.)
|
| LITUITE | S. f. (Hist. nat.) nom donné par les naturalistes à une pierre formée ou moulée dans une coquille, que l'on nomme lituus ou le bâton pastoral ; elle est d'une figure conique, garnie de cloisons ou de concamérations ; elle est droite dans une grande partie de sa longueur, & ensuite elle se courbe & va en spirale comme la crosse d'un évêque. Wallérius la nomme orthoceratitos.
N. B. L'article suivant qui est corrigé de la main de M. de Voltaire, est d'un ministre de Lausanne.
|
| LITURGIE | S. f. (Théolog.) c'est un mot grec, , il signifie une oeuvre, un ministere public ; il est composé de , pro , publicus, & , opus, manus officium, particulierement consacré au service des autels ; il n'est plus employé aujourd'hui que pour désigner le culte & l'office divin, soit en général toutes les cérémonies qui s'y rapportent.
Suivant cette idée, on peut conclure qu'il y a eu des liturgies depuis que l'homme a reconnu une divinité, & senti la nécessité de lui rendre des hommages publics & particuliers : quelle fut la liturgie d'Adam ? c'est ce qu'il ne seroit pas facile de décider ; il paroît seulement par le récit de Moïse, que le culte de notre premier pere fut plutôt le fruit de la crainte, que celui de la gratitude ou de l'esperance. Gen. chap. iij. v. 10.
Ses fils offroient des sacrifices, s'ils suivoient la même liturgie, on peut conclure que celle de Caïn n'avoit pas cette droiture d'intention qui devoit en faire tout le mérite, qui seule étoit nécessaire dans ces premiers âges de la religion ; au lieu que dans la suite les objets & la vénération religieuse, multipliés & mis par la révélation divine au-dessus de l'intelligence humaine, il n'a pas moins fallu qu'une vertu particuliere pour les croire ; cette vertu connue sous le nom de foi, est sans doute ce qui donne toute l'efficace à une liturgie : il paroît que le successeur d'Abel fut l'auteur d'une liturgie ; car sous lui, dit Moïse, on commença d'invoquer le nom de l'Eternel, Gen. ch. iv. v. 26. Cette liturgie se conserva dans sa postérité jusques à Abraham, sans doute par le soin qu'Enoch, septieme chef de famille depuis Adam, avoit pris de la rédiger par écrit, dans l'ancien livre de ce patriarche que saint Jude cite, v. 14. 16, & que les Abyssins se vantent encore d'avoir dans leur langue.
Mais sous Abraham la liturgie prit une face toute différente ; la circoncision fut instituée comme un signe d'alliance entre Dieu & l'homme. L'Eternel exigea du pere des croyans les sacrifices les plus extraordinaires, les diverses visions, les visites assez fréquentes des messagers célestes, dont lui & sa famille furent honorés, sont autant de choses si peu rapprochées des relations que nous soutenons aujourd'hui avec la divinité, que nous ne pouvons avoir que des idées fort confuses de l'espece de liturgie dont ils faisoient usage.
Quelle fut la liturgie des Hébreux en égypte ? c'est ce qu'il n'est pas facile de décider. Adorateurs du vrai Dieu, mais trop aisément conduits aux diverses pratiques religieuses d'un peuple qui ne sembloit occupé que du soin de multiplier les objets de son adoration, voulant avoir comme leurs hôtes des dieux qui marchassent devant eux ; leur liturgie dut se ressentir de tous ces contrastes, & présentoit sans doute quelque chose de monstrueux.
Moïse profita du séjour au desert pour rectifier & fixer le culte des Hébreux, cherchant à occuper par un culte onéreux & assujettissant, un peuple porté à tous vents de doctrine : cette liturgie respectable fut munie du sceau de la divinité ; elle devint aussi intéressante par des allusions continuelles aux divers objets d'espérances flatteuses dont le coeur du peuple juif étoit en quelque sorte enivré.
Sous un roi poëte & musicien, la liturgie des Hébreux releva ses solemnités religieuses par une musique que l'ignorance entiere où nous sommes de leur mérite, ne nous permet pas même de deviner ; les maîtres chantres de David exécuterent d'abord ces hymnes sacrées, ces pseaumes, ces Te Deum, dont la lecture prescrite par les liturgies, fit dans la suite une des principales parties du culte.
Salomon bâtit le temple de Jérusalem, la liturgie devint immense : elle régloit un culte des plus fastueux, & des plus propres à satisfaire un peuple qui trouvoit dans la multitude de ses ordonnances & de ses rites, dans la pompe de ses sacrifices, dans le nombre, & dans les divers ordres des ministres de la religion, l'image des cultes idolâtres qu'il regrettoit sans cesse, & auxquels il revenoit toujours avec plaisir.
Jéroboam proposa sans doute au peuple d'Israël une nouvelle liturgie pour le culte des dieux de Bethel & de Dan, mais ne seroit-ce pas lui faire trop d'honneur que de la supposer plus raisonnable que les idoles qui en furent l'objet ?
Dans l'un & l'autre royaume, le culte religieux souffrit des altérations inconcevables, & qui durent apporter les plus grands changemens aux liturgies générales & particulieres.
Jamais les Juifs ne furent plus éloignés de l'idolâtrie que dans le tems que Jésus-Christ vint au monde, & jamais les dogmes & la morale n'avoient été plus corrompus ; les Saducéens dont les erreurs se renouvellent aujourd'hui, & trouvent tant de defenseurs, étoient une secte en crédit à Jérusalem, & jamais la liturgie n'avoit été plus exactement observée ; celui qui nioit l'immortalité de l'ame, les anges, la résurrection, une vie à venir, ne perdoit rien de l'estime publique chez un peuple qui crioit au blasphème pour la petite infraction à la loi cérémonielle, & qui lapidoit impitoyablement un artisan, pere de famille, qui auroit travaillé un jour de sabbat pour fournir à la subsistance de ses enfans ; pour peu qu'on connoisse l'histoire de l'esprit humain, on ne doit pas s'étonner de ces contrastes & de ces inconséquences.
Jesus Christ, l'auteur d'une religion toute divine, n'a rien écrit ; mais on peut recueillir de ses discours une liturgie également simple & édifiante, il condamne les longues prieres & les vaines redites ; il veut le recueillement, & le seul formulaire de priere qu'il laisse & qu'il prescrit à ses disciples est également simple & édifiant, il institue des cérémonies religieuses ; leur extrême simplicité donne beaucoup à la réflexion, & très-peu à l'extérieur & au faste.
L'institution du baptême au nom des trois Personnes fut embrassée par des sectateurs de Platon, devenus chrétiens ; ils y trouvoient les sentimens de leur maître sur la divinité, puisqu'il distinguoit la nature en trois, le Pere, l'entendement du Pere, qu'il nomme aussi le germe de Dieu, ou l'ouvrier du monde, & l'ame qui contient toutes choses ; ce que Chalcidius rend par le Dieu souverain, l'esprit ou la providence, & l'ame du monde, ou le second esprit ; ou, comme l'exprime Numenius, cet autre célebre académicien, celui qui projette, celui qui commande, & celui qui exécute. Ordinans, jubens, insinuans.
La liturgie de l'institution de la sainte cène est aussi dans l'Evangile d'une simplicité tout-à-fait édifiante ; on eût évité, en la suivant à la lettre & dans l'esprit de son auteur, bien des disputes & des schismes qui ont eu leur source dans la fureur des disciples, à vouloir aller toujours plus loin que leur maître.
On ne doit point passer sous silence la liturgie pour l'élection de saint Matthias, Act. ch. j. v. 24. 25.
Elle est des plus simples & des plus précises ; on s'est écarté de cette simplicité dans les élections, à mesure qu'on s'éloignoit de la premiere source des graces & de l'inspiration divine.
Les apôtres & leurs successeurs immédiats avoient beaucoup de foi & de piété dans les actes de leur culte, & dans la célébration de leurs mysteres ; mais il y avoit peu de prieres & peu de cérémonies extérieures ; leur liturgie en langue vulgaire, simple, peu étendue, étoit gravée dans la mémoire de tous les néophites. Mais lorsque les objets de la foi se développerent davantage, qu'on voulut attaquer des interprétations nécessaires par les ressources de l'éloquence, du faste & de la pompe, chacun y mit du sien ; on ne sut bientôt plus à quoi s'en tenir dans plusieurs églises ; on se vit obligé de régler & de rédiger par écrit les prieres publiques, la maniere de célébrer les mysteres, & sur-tout l'Eucharistie. Alors les liturgies furent très-volumineuses, la plûpart marquées au coin des erreurs ou des opinions régnantes dans l'Eglise, ou chez les divers docteurs qui les avoient compilées ; ainsi les liturgies chrétiennes qui devoient être très-uniformes, furent extrêmement différentes pour le tour, les expressions, & sur-tout les divers rites & pratiques religieuses, différence sensible en particulier sur le point essentiel, à savoir la célébration de l'Eucharistie.
L'extrême grossiereté des Grecs, ou plutôt le manque de politique de leurs patriarches, qui n'ont pas su, comme nos papes, conserver en Orient le droit de chef visible de l'Eglise, & s'affranchir de bonne heure de l'autorité des empereurs, qui prétendoient régler & le culte & les cérémonies religieuses ; cette grossiereté, ce manque de politique, dis-je, leur ont laissé ignorer le dogme important de la transubstantiation, & toutes les pratiques religieuses qui en sont la suite, leur liturgie est restée, à cet égard, dans l'état de cette primitive simplicité, méprisable aujourd'hui à ceux qu'éclaire une foi plus étendue, & fortifiée par d'incompréhensibles mysteres. Ils ne croyoient point la présence réelle, & communioient bonnement sous les deux especes. Quelques Grecs modernes ont profité des lumieres de l'Eglise latine ; mais esclaves de leurs anciens usages, ils ont voulu associer leurs idées aux nôtres, & leur liturgie offre sur l'article important de l'Eucharistie une bigarrure peu édifiante.
D'anciens Grecs, qui sont aujourd'hui les Rasciens & les Valaques, communioient avec un petit enfant de pâte, dont chacun des communians prenoit un membre, ou une petite partie ; cet usage bizarre s'est conservé jusqu'à nos jours dans quelques églises de Transylvanie sur les confins de la Pologne ; il y a des églises en Rascie, où l'on célebre l'Eucharistie avec un gâteau sur lequel est peint ou représenté l'Agneau paschal ; en général, dans toute l'église grecque, l'Eucharistie se fait, more majorum, à la suite d'une agape ou repas sacré. La haute église d'Angleterre, appellée l'église anglicane, a conservé dans l'Eucharistie bien des usages de l'église latine ; le saint Sacrement posé sur un autel, le communiant vient le recevoir à genoux. En Hollande, les communians s'asseyent autour d'une table dressée dans l'ancien choeur de leurs temples, le ministre placé au milieu bénit & rompt le pain, il remplit & bénit aussi la coupe, il fait passer le plat où sont les morceaux de pain rompu à droite, la coupe à gauche ; & dès que les assistans ont participé à l'un & à l'autre des symboles, il leur fait une petite exhortation, & les bénit ; une seconde table se forme, & ainsi de suite.
En Suisse, & dans la plûpart des églises protestantes d'Allemagne, on va en procession auprès de la table, on reçoit debout la communion ; le pasteur, en distribuant le pain & le vin, dit à chacun des communians un passage de l'Ecriture sainte ; la cérémonie finie, le pasteur remonte en chaire, fait une priere d'action de graces ; après le chant du cantique de Siméon, il bénit l'assemblée & la congédie.
Les collégians de Rinsburg ne communient qu'une fois l'année ; ils font précéder le Sacrement d'un pain, ou d'une oblation générale, qu'ils appellent le baptême & la mort de Christ : ils font un repas entrecoupé de prieres courtes & fréquentes, & le terminent par l'Eucharistie ou fraction du pain, avec toute la simplicité des premiers tems de l'Eglise.
Les Quakers, les Piétistes, les Anabaptistes, les Méthodistes, les Moraves ont tous des pratiques & des usages différens dans la célébration de l'Eucharistie ; les derniers en particulier ne croient leur communion efficace, qu'autant qu'ils entrent par la foi dans le trou mystique du Sauveur, & qu'ils vont s'abreuver à cette eau miraculeuse, à ce sang divin qui sortit de son côté percé d'une lance, qui est pour eux cette source d'une eau vive, jaillissante en vie éternelle, qui prévient pour jamais la soif, & dont Jesus-Christ parloit à l'obligeante Samaritaine. Les liturgies de ces diverses sectes reglent ces pratiques extérieures, & établissent aussi les sentimens de l'Eglise sur un sacrement, dont l'essence est un des points fondamentaux de la foi chrétienne.
Depuis le xij. siecle, l'Eglise catholique ne communie que sous une espece avec du pain azyme : dans ce pain seul & dans chaque partie de ce pain on trouve le corps & le sang de Jesus-Christ ; & quoique les bons & les méchans le reçoivent également, il n'y a que les justes qui reçoivent le fruit & les graces qui y sont attachées.
Luther & ses sectateurs soutiennent que la substance du pain & du vin restent avec le corps & le sang de Jesus-Christ. Zwingle & ceux qui suivent sa doctrine, pensent que l'Eucharistie n'est que la figure du corps & du sang du Sauveur, à laquelle on donnoit le nom des choses dont le pain & le vin sont la figure. Calvin cherchant à spiritualiser encore plus les choses, dit que l'Eucharistie renferme seulement la vertu du corps & du sang de Jesus-Christ. Pour dire le vrai, il y a peu de système & de philosophie dans ces diverses opinions ; c'est qu'on a voulu chercher beaucoup de mysteres dans des pratiques religieuses très-simples dans leur origine, & dont l'esprit facile à saisir étoit cependant moins proposé à notre intelligence qu'à notre foi.
Quoique ces diverses opinions soient assez obscurement énoncées dans les liturgies, leurs auteurs ont cependant cherché comme à l'envi à accréditer leurs ouvrages, en les mettant sous les noms respectables des évangelistes, des apôtres, ou des premiers peres de l'Eglise.
1°. Ainsi la liturgie de saint Jacques, l'une des plus anciennes, ne sauroit être de cet apôtre, puisque les termes consacrés dans le culte, l'ordre des prieres & les cérémonies qu'elle regle, ne conviennent absolument point aux tems apostoliques, & n'ont été introduites dans l'Eglise que très-long-tems après. 2°. La liturgie de S. Pierre, compilation de celle des Grecs & de celle des Latins, porte avec elle des preuves qu'elle ne fut jamais composée par cet apôtre. 3°. La messe des Ethiopiens, appellée la liturgie de saint Matthieu, est visiblement supposée, puisque l'auteur y parle des évangélistes, il veut qu'on les invoque ; & l'attribuer à saint Matthieu, c'est lui prêter un manque de modestie peu assorti à son caractere. D'ailleurs les prieres pour les papes, pour les rois, pour les patriarches, pour les archevêques, ce qui y est dit des conciles de Nicée, Constantinople, Ephese, &c. sont autant de preuves qu'elle n'a de saint Matthieu que le nom. On peut dire la même chose de telles sous les noms de saint Marc, de saint Barnabé, de saint Clément, de saint Denis l'aréopagite, &c.
L'Eglise latine a sa liturgie, qui a eu son commencement, ses progrès, ses augmentations, & qui n'est point parvenue à sa perfection, sans subir bien des changemens, suivant la nécessité des tems & la prudence des pontifes.
L'Eglise grecque a quatre liturgies, celle de saint Jacques, de saint Marc, de saint Jean-Chrysostôme & de saint Basile, mais les deux dernieres sont celles dont elle fait le plus généralement usage ; celle de saint Jacques ne se lisant qu'à Jérusalem & à Antioche, & celle de saint Marc dans le district d'Alexandrie.
Il est étonnant que Leo Allatius, le cardinal Bellarmin, & après lui le cardinal Bona, ayent pû assurer que les liturgies de saint Marc & de saint Jacques soient réellement de ces apôtres, que celle de saint Jacques est l'origine de toutes les liturgies, & qu'elle a été changée & augmentée dans la suite, comme il arrive à tous les livres ecclésiastiques.
Penser de la sorte, c'est se refuser aux regles d'une saine critique, & ne faire nulle attention à d'anciennes autorités, qui ne doivent laisser aucun doute sur la question : ainsi Théod. Balsamon, ce patriarche grec d'Antioche, que l'empereur Isaac Lange sut si bien leurrer en se servant de lui pour procurer à Dosithée le patriarchat de Constantinople, dont il l'avoit flatté en secret ; ce Balsamon, dis-je, requis par lettres de dire son sentiment, si les liturgies qu'on avoit sous les noms de saint Marc & de saint Jacques, étoient véritablement d'eux, répondit : " Que ni l'Ecriture-sainte, ni aucun concile n'avoit attribué à saint Marc la liturgie qui portoit son nom ; qu'il n'y avoit que le 32. canon du concile de Trullo qui attribuât à saint Jacques la liturgie qui étoit sous son nom, mais que le 85 canon des apôtres, le 59 canon du concile de Laodicée dans le dénombrement qu'ils ont fait des livres de l'Ecriture-sainte composés par les apôtres, & dont on devoit se servir dans l'Eglise, ne faisoient aucune mention des liturgies de saint Jacques & de saint Marc ".
Les Arméniens, les Cophtes, les Ethiopiens ont aussi leurs diverses liturgies, écrites dans leurs langues, ou traduites de l'arabe.
Les chrétiens de Syrie comptent plus de quarante liturgies syriaques, sous divers noms d'apôtres, d'évangélistes, ou de premiers peres de l'Eglise ; les Maronites ont fait imprimer à Rome, en 1592, un Missel qui contient douze liturgies différentes.
Les Nestoriens ont aussi leur liturgie en langue syriaque, de laquelle se servent aujourd'hui les chrétiens des Indes, qu'on appelle de saint Thomas ; il est étonnant que ceux qui ont attribué ce christianisme indien, ou plutôt ce nestorianisme à saint Thomas l'apôtre, ne lui ayent pas attribué aussi la liturgie. Mais la vérité est que saint Thomas n'établit ni la liturgie, ni la religion sur la côte de Coromandel ; on sait aujourd'hui que ce fut un marchand de Syrie, nommé Marc-Thomas, qui s'étant habitué dans cette province au vj. siecle, y porta sa religion nestorienne ; & lorsque dans les derniers tems nous allames trafiquer avec ces anciens chrétiens, nous trouvames qu'ils n'y connoissoient ni la transubstantiation, ni le culte des images, ni le purgatoire, ni les sept sacremens.
On voit dans le cabinet d'un curieux en Hollande un manuscrit sur une espece de peau de poisson, qui est un ancien Missel d'Islande, dans un jargon dont il n'y a que les terminaisons qui soient latines, on y lit les noms de saint Olaüs & Hermogaré, c'est une liturgie très-informe, l'office des exorcistes en contient près des trois quarts, tant la philosophie avoit de part à ces sortes d'ouvrages.
Les Protestans ont aussi leurs liturgies en langue vulgaire ; ils les prétendent fort épurées & plus conformes que toutes les autres à la simplicité évangélique, mais il ne faut que les lire pour y trouver l'esprit de parti parmi beaucoup de bonnes choses & des pratiques très-édifiantes ; d'ailleurs les dogmes favoris de leurs réformateurs, la prédestination, l'élection, la grace, l'éternité des peines, la satisfaction, &c. répandent plus ou moins dans leurs liturgies une certaine obscurité, quelque chose de dur dans les expressions, de forcé dans les allusions aux passages de l'Ecriture-sainte ; ce qui, sans éclairer la foi, diminue toujours jusques à un certain point cette onction religieuse, qui nourrit & soutient la piété.
Enfin quelques-unes de leurs liturgies particulieres pechent par les fondemens qu'elles prennent pour les cérémonies les plus respectables ; comme, par exemple, quelques liturgies fondent le baptême sur la bénédiction des enfans par le Seigneur Jesus ; action du Sauveur qui n'a nul rapport avec l'institution de ce sacrement.
Chaque église, ou plutôt chaque état protestant, a sa liturgie particuliere. Dans plusieurs pays les magistrats civils ont mis la main à l'encensoir, & ont fait & rédigé par écrit les liturgies ; se contentant de consulter pour la forme les ecclésiastiques ; peut-être n'est-ce pas un si grand mal.
La meilleure liturgie protestante est l'anglicane, autrement celle de la haute église d'Angleterre, la dévotion du peuple y est excitée par les petites litanies, & les divers passages de l'Ecriture-sainte qu'il répete fréquemment.
Il est dans le christianisme une secte considérable, dont on peut dire que le principe fondamental est de ne point avoir de liturgie, & d'attendre dans leurs assemblées religieuses ce que l'esprit leur ordonne de dire, & l'esprit est rarement muet pour ceux qui ont la fureur de parler.
Les liturgies ont une intime relation avec les livres symboliques, entant qu'ils font regles de foi & de culte ; mais ils trouveront leur place à l'article SYMBOLE.
Est-ce à la foudroyante musique des chantres de Josué autour de Jérico, à la douce harmonie de la harpe de David, à la bruyante ou fastueuse musique des chantres du temple de Salomon, ou au pieux chant du cantique que Jesus-Christ & ses apôtres entonnerent après la premiere institution de la pâque chrétienne, que nous sommes redevables de nos choeurs, des hymnes, pseaumes & cantiques spirituels, qui, dans toutes les communions chrétiennes, font & ont toujours fait une partie considérable du culte public réglé par nos liturgies ; c'est sans doute ce qui mériteroit de devenir l'objet des recherches de nos commentateurs, autant & plus que ce tas de futilités dont leurs savans & inutiles ouvrages sont remplis.
Au reste, la musique, ou plutôt le chant a été chez tous les peuples le langage de la dévotion.
Pacis opus docuit, jussit que silentibus omnes
Inter sacra tubas, non inter bella sonare.
Calph. eclog.
C'est encore aujourd'hui en chantant que les Sauvages de l'Amérique honorent leurs divinités. Toutes les fêtes, les mysteres des dieux de l'antiquité païenne se célébroient au milieu des acclamations publiques, du pieux frédonnement des prêtres & des bruyantes chansons des dévots. Chansons dont le sujet & les paroles faisoient avec les rites & les diverses cérémonies de leurs sacrifices toutes leurs liturgies ; à l'exacte observation desquelles ils étoient, comme on le sait, très-scrupuleusement attachés.
Jean-Gaspard Suicer, savant grec, fait une remarque qui merite qu'on y fasse attention dans son trésor de la langue grecque au mot , qui munus aliquod publicum obiit, minister publicus, sed peculiariter usurpatur de bello ; en effet, ce mot dans Isocrates signifie un héraut d'armes, & sans doute que étoit ou sa commission, ou la harangue qu'il prononçoit dans les déclarations de guerre ; dans cette supposition toute naturelle, il faut convenir que les liturgies ont assez bien soutenu leur primitive destination, puisqu'elles ont causé je ne sais combien de guerres sanglantes, d'autant plus cruelles que leur source étoit sacrée. Que de sang n'ont pas fait répandre les doutes sur ces questions importantes dont les premieres notions parurent dans les liturgies ! La consubstantiabilité du verbe, les deux volontés de Jesus-Christ, la célebre question, si le saint Esprit procede du Pere ou du Fils ?
Mais, pour parler d'évenemens plus rapprochés de notre siecle, ne fut-ce pas une question de liturgie qui abattit, en 1619, la tête du respectable vieillard Barneweldt ? Et trente ans après, l'infortuné roi d'Angleterre Charles I. ne dut-il point la perte ignominieuse & de sa couronne & de sa vie, à l'imprudence qu'il avoit eue quelques années auparavant, d'envoyer en Ecosse la liturgie anglicane, & d'avoir voulu obliger les presbytériens écossois à recevoir un formulaire de prieres différent de celui qu'ils suivoient.
Conclusion. Les liturgies nécessaires sont les plus courtes, & les plus simples sont les meilleures ; mais sur un article aussi délicat, la prudence veut qu'on sache respecter souvent l'usage de la multitude quelque informe qu'il soit, d'autant plus que celui à qui on s'adresse entend le langage du coeur, & qu'on peut, in pettò, réformer ce qui paroît mériter de l'être.
|
| LITUUS | S. m. (Littér.) bâton augural recourbé par le bout comme une crosse, & plus gros dans cette courbure qu'ailleurs.
Romulus, dont la politique demandoit de savoir se rendre les dieux favorables, créa trois augures, institua le lituus pour marque de leur dignité, & le porta lui-même, comme chef du collège, & comme très-versé dans l'art des présages : depuis lors, les augures tinrent toujours en main le lituus, lorsqu'ils prenoient les auspices sur le vol des oiseaux ; c'est par cette raison qu'ils ne sont jamais représentés sans le bâton augural, & qu'on le trouve communément sur les médailles, joint aux autres ornemens pontificaux.
Comme les augures étoient en grande considération dans les premiers tems de la république, le bâton augural étoit gardé dans le capitole avec beaucoup de soin ; on ne le perdit qu'à la prise de Rome par les Gaulois, mais on le retrouva, dit Ciceron, dans une chapelle des Saliens sur le mont-Palatin.
Les Romains donnerent aussi le nom de lituus à un instrument de guerre courbé à la maniere du bâton augural, dont on sonnoit à peu près comme on sonne aujourd'hui de la trompette ; il donnoit un son aigu, & servoit pour la cavalerie. (D.J.)
|
| LIVADIA | (Géog.) ville de la Turquie Européenne, en Livadie. Les anciens l'ont connue sous le nom de Lebadia, Lebadea, & il y subsiste encore des inscriptions dans lesquelles on lit . Elle est partagée par une riviere que Wheeler nomme Hercyna, qui sort par quelques passages de l'Hélicon, & qui se rend dans le lac de Livadie. Cette ville est habitée par des Turcs, qui y ont des mosquées, & des Grecs qui y ont des églises. Son trafic consiste en laine, en blé & en ris. Elle est située à 23 lieues N. O. d'Athènes, & 25 S. E. de Lépante. Long. 41. 4. lat. 38. 40. (D.J.)
|
| LIVADIE LA | (Géog.) ce mot pris dans un sens étendu, signifie tout le pays que les anciens entendoient par la Grece propre, ou Hellas ; mais la Livadie proprement dite, n'est que la partie méridionale de la Livadie prise dans le sens le plus étendu, & comprend ce que les anciens appelloient la Phocide, la Doride & la Locride. Elle a au levant le duché d'Athènes & la Stramulipa, & est entre ces deux pays, la Macédoine, la basse Albanie, & le golphe de Lépante ; la ville de Livadia donne son nom à cette contrée. (D.J.)
LIVADIE, lac de, (Géog.) lac de Grece, connu des anciens sous le nom de Copays, ou plutôt sous autant de noms qu'il y avoit de villes voisines ; car on l'appelloit aussi Haliartios, de la ville d'Haliarte, qui étoit sur le rivage occidental ; Pausanias le nomme Cephissis, parce que le fleuve Cephisse le traversoit. Aelien l'appelle le marais d'Onchestos, à cause d'une ville de ce nom, qui étoit au midi du lac. Son nom moderne est chez les Grecs d'aujourd'hui Limnitis Livadias, le marais de Livadie, & plus particulierement Lago di Topoglia.
Il reçoit plusieurs petites rivieres qui arrosent cette belle plaine, laquelle a environ une quinzaine de lieues de tour, & abonde en blé & en pâturages. Aussi étoit-ce autrefois un des quartiers les plus peuplés de la Béotie.
Mais l'eau de cet étang s'enfle quelquefois si fort, par les pluies & les neiges fondues, qu'elle inonde la vallée jusqu'à plusieurs lieues d'étendue. Elle s'engouffre ordinairement sous la montagne voisine de l'Euripe, entre Négrepont & Talanda, & va se jetter dans la mer de l'autre côté de la montagne. Les Grecs modernes appellent ce lieu Tabathra ; voy. Spon & Wheeler. (D.J.)
|
| LIVARDE | S. f. terme de Corderie, est une corde d'étoupe autour de laquelle on tortille le fil pour lui faire perdre le tortillement, & le rendre plus uni. Voyez l'art. CORDERIE.
|
| LIVECHE | S. f. (Hist. nat. Bot.) Ligustrum, genre de plante à fleur, en rose & en umbelle, composée de plusieurs pétales disposés en rond, & soutenus par le calice qui devient un fruit composé de deux semences oblongues, plates d'un côté, convexes & cannelées de l'autre. Tournefort Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Tournefort compte huit especes de ce genre de plante umbellifere ; la plus commune cultivée dans les jardins de médecine, est le ligusticum vulgare, foliis apii ; en anglois, common lovage ; en françois, liveche à feuilles d'ache ; nous allons la décrire.
Sa racine est charnue, épaisse, durable, noirâtre en-dehors, blanche en-dedans. Ses tiges sont ordinairement nombreuses, épaisses, creuses, cannelées, partagées quelquefois en plusieurs rameaux. Ses feuilles sont longues d'un pié & plus, découpées en plusieurs lobes, dont les dernieres divisions approchent en quelque maniere de celles de l'ache de marais, mais sont bien plus grandes, dentelées profondément à leur bord, fort lisses, luisantes, d'un verd foncé, & d'une odeur forte. Les rameaux & les sommets des tiges portent de grands parasols de fleurs en rose, composés de cinq pétales, jaunes le plus souvent, placés en rond & soutenus sur un calice. Ce calice se change ensuite en un fruit, composé de deux graines, oblongues, plus grosses que celles d'ache, convexes, cannelées d'un côté, applaties de l'autre, & de couleur obscure. Toute cette plante, sur-tout sa graine, répand une odeur forte, aromatique & de drogue. (D.J.)
LIVECHE, (Mat. méd.) ou ACHE DE MONTAGNE, levisticum. La racine & la semence de liveche sont regardés comme alexipharmaques, carminatives, diurétiques & utérines. C'est principalement par cette derniere propriété, que les auteurs l'ont recommandée ; ils ont dit qu'elle faisoit paroître les vuidanges, qu'elle chassoit le placenta & le foetus mort. La dose de la racine en poudre est d'un gros jusqu'à deux, & celle de la graine, depuis un scrupule jusqu'à un gros.
Le suc des feuilles fraîches de liveche pris à la dose de deux ou trois onces, est regardé par quelques auteurs, comme un spécifique dans les mêmes cas, aussi-bien que contre la suppression des regles.
Les différentes parties de la liveche entrent dans quelques préparations pharmaceutiques. (b)
|
| LIVENZA LA | (Géog.) en latin, Liquentia, riviere d'Italie, dans l'état de la république de Venise. Elle a sa source aux confins du Bellunèze, & se jette dans le golfe de Venise, à 20 milles de cette ville, au levant d'été. (D.J.)
|
| LIVIDE | adj. LIVIDITé, s. f. (Gramm.) Couleur de la peau, lorsqu'on a été frappé d'un coup violent : elle a quelquefois la même couleur par un vice intérieur. Les chairs qui tendent à la gangrene, deviennent livides. La lividité du visage marque la mauvaise santé.
|
| LIVIERE | (Géog.) en latin Livoria, lieu de France, en Languedoc, auprès de Narbonne. On y voit trois abîmes d'eau assez profonds & fort poissonneux : les habitans les appellent oëlialas, en latin oculi Livoriae. Il nous manque une explication physique de ces trois especes de gouffres. (D.J.)
|
| LIVONIE | LA (Géog.) province de l'empire russien, avec titre de duché, sur la mer Baltique, qui la borne au couchant, & sur le golfe de Finlande, qui la borne au nord.
Cette province peut avoir environ cent milles germaniques de longueur, en la prenant depuis les frontieres de la Prusse jusqu'à Riga, & quarante milles dans sa plus grande largeur, sans y comprendre les îles.
On peut lire, sur l'histoire & la division de ce pays, Matthias Strubiez, Livoniae descriptio, Hartknoch, & Albert Wynk Kojalowiez, historia Lithuaniae.
On ne vint à pénétrer en Livonie que vers l'an 1158 : des marchands de Lubec s'y rendirent pour y commercer, & par occasion ils annoncerent l'évangile à ces peuples barbares.
Le grand-maître de l'ordre teutonique y établit ensuite un maître particulier, & la Livonie demeura plus de trois cent ans sous la puissance de l'ordre. En 1513, Guillaume de Plettenberg, maître particulier du pays, secoua le joug de son ordre, & devint lui-même souverain de la Livonie.
Bientôt après, Yvan grand duc de Moscovie, ravagea le pays, & s'empara de plusieurs places : alors Kettler grand maître de l'ordre de Livonie, se voyant hors d'état de résister aux Moscovites, appella Sigismond à son secours en 1557, & la Livonie lui fut cédée.
Au milieu de ces troubles, la ville de Revel se mit sous la protection d'Eric roi de Suede : ce qui forma deux partis dans la province, & des guerres qui ont si long-tems duré entre la Moscovie, la Suede & la Pologne. Enfin, le gain de la bataille de Pultawa valut à Pierre le grand la conquête de cette province, & le traité de Nieustad lui en assura la possession.
La Livonie comprend la Courlande, la Semigalle, l'île d'Oësel, l'archevêché de Riga, l'évêché de Derpt, & les terres du grand maître de l'ordre teutonique. Riga en est la capitale : ses autres villes & forteresses principales sont, Windau, Goldingen en Courlande, Mittau, Semigalle, Sonneburg dans l'île d'Oësel, Pernau, Revel, Derpt, Nerva, &c.
On cueille tant de froment en Livonie, que cette province est comme le grenier de Lubec, d'Amsterdam, de Danemark, & de Suede : elle abonde en pâturages & en bétail. Les lacs & les rivieres fournissent beaucoup de poisson. Les forêts nourrissent quantité de bêtes fauves : on y trouve des bisons, des élans, des martes, & des ours ; les liévres y sont blancs pendant l'hiver, & cendrés en été. Les paysans y sont toute l'année serfs & misérables ; les nobles durs, grossiers, & tenant encore de la barbarie. (D.J.)
LIVONIE, terre de, (Hist. nat.) espece de terre bolaire dont on fait usage dans les pharmacies d'Allemagne. Il y en a de jaune & de rouge : la premiere est fort douce au toucher, & fond, pour ainsi dire, dans la bouche. La seconde est d'un rouge pâle ; elle est moins pure que la précédente ; son goût est styptique & astringent. Ces terres ne sont point solubles dans les acides. Les Espagnols, les Portugais & les Italiens en font usage. Elle vient sous la forme d'une terre sigillée, & est en petits gâteaux qui portent l'empreinte d'un cachet qui représente une église & deux clés en sautoir. Hill, hist. nat. des fossiles. Cette terre se trouve en Livonie, & paroît avoir beaucoup de rapport avec la terre lemnienne.
|
| LIVOURNE | (Géog.) en latin moderne Ligurnum, en anglois Leghorn, ville d'Italie des états du grand-duc de Toscane dans le Pisan, avec une enceinte fortifiée, une citadelle, & un des plus fameux ports de la Méditerranée.
La franchise de son commerce y attire un très-grand abord d'étrangers ; on ne visite jamais les marchandises qui y entrent ; on y paye des droits très-modiques qui se levent par balles, de quelque grosseur qu'elles soient, & quelle qu'en soit la valeur.
La justice s'y rend promtement, régulierement, & impartialement aux négocians. Toute secte & religion y jouit également d'un profond repos ; les Grecs, les Arméniens y ont leurs églises. Les Juifs qui y possedent une belle synagogue & des écoles publiques, regardent Livourne comme une nouvelle terre promise. La seule monnoie du grand duc annonce pleine liberté & protection. Ses écus appellés livourniens, présentent d'un côté le buste du prince, de l'autre le port de Livourne, & une vûe de la ville, avec ces deux mots qui disent tant de choses : Et patet, & favet.
C'est ainsi que Livourne s'est élevée en peu de tems, & est devenue tout ensemble une ville considérable, riche, très-peuplée, agréable par sa propreté, & par de larges rues tirées au cordeau : elle dépend pour le spirituel de l'archevêché de Pise.
Ce n'étoit dans le seizieme siecle qu'un mauvais village au milieu d'un marais infect ; mais Côme I. grand-duc de Toscane, a fait de ce village une des plus florissantes villes de la Méditerranée, au grand regret des Génois, qui crurent le tromper en lui demandant pour cette bicoque, Sarsane ville épiscopale qu'il voulut bien leur ceder en échange, quoiqu'elle lui donnât une entrée dans leur pays : mais il connoissoit la bonté du port de Livourne, & les avantages qu'un gouvernement éclairé en pouvoit tirer pour le commerce de l'Italie. Il commença d'abord l'enceinte de la ville qu'il vouloit fonder, & bâtit un double môle.
Il faut cependant que les navigateurs se guident par le portulan de M. Michelot, sur les précautions à prendre pour le mouillage & l'entrée, tant du port que du môle de Livourne.
Cette ville patrie de Donato Rosetti, qui professoit les Mathématiques à Pise dans le dernier siecle, est située sur la Méditerranée, à 4 lieues S. de Pise, 18. S. O. de Florence, 8. S. O. de Lucques, 58. N.O. de Rome. Long. selon Cassini, 27. 53. 30. lat. 43. 33. 2. & selon Harris, long. 30. 16. 15. lat. 45. 18. (D.J.)
|
| LIVRAISON | S. f. (Jurisprud.) est la tradition d'une chose dont on met en possession celui à qui on la livre.
Mais ce terme ne s'applique communément qu'aux choses qui se doivent livrer par poids ou par mesure : pour les autres choses mobiliaires & pour les immeubles, on dit ordinairement tradition.
La vente des choses qui doivent se livrer par poids & par mesure, n'est point parfaite jusqu'à la livraison ; tellement que le bénéfice & la perte qui surviennent aux marchandises avant la livraison, ne concernent que le vendeur & non l'acheteur. Voyez ci-après TRADITION. (A)
|
| LIVRE | S. m. (Litter.) écrit composé par quelque personne intelligente sur quelque point de science, pour l'instruction & l'amusement du lecteur. On peut encore définir un livre, une composition d'un homme de lettres, faite pour communiquer au public & à la postérité quelque chose qu'il a inventée, vûe, expérimentée, & recueillie, & qui doit être d'une étendue assez considérable pour faire un volume. Voyez VOLUME.
En ce sens, un livre est distingué par la longueur d'un imprimé ou d'une feuille volante, & d'un tome ou d'un volume comme le tout est de sa partie ; par exemple, l'histoire de Grece de Temple Stanyan, est un fort bon livre, divisé en trois petits volumes.
Isidore met cette distinction entre liber & codex, que le premier marque particulierement un ouvrage séparé, faisant seul un tout à part, & que le second signifie une collection de livres ou d'écrits. Isid. orig. lib. VI. cap. xiij. Mais Scipion Maffei prétend que codex signifie un livre de forme quarrée, & liber un livre en forme de registre. Voyez Maffei, histor. diplom. lib. II. bibliot. italiq. tom. II. p. 244. Voyez aussi Saalbach, de lib. veter. parag. 4. Reimm. idea system. ant. litter. pag. 230.
Selon les anciens, un livre différoit d'une lettre non seulement par sa grosseur, mais encore parce que la lettre étoit pliée, & le livre seulement roulé. Voyez Pitisc. L. ant. tom. II. pag. 84. voc. libri. Il y a cependant divers livres anciens qui existent encore sous le nom de lettres : tel est l'art poétique d'Horace. Voyez éPITRE, LETTRE.
On dit un vieux, un nouveau livre, un livre grec, uu livre latin ; composer, lire, publier, mettre au jour, critiquer un livre ; le titre, la dédicace, la préface, le corps, l'index ou la table des matieres, l'errata d'un livre. Voyez PREFACE, TITRE, &c.
Collationner un livre, c'est examiner s'il est correct, si l'on n'en a pas oublié ou transposé les feuillets, s'il est conforme au manuscrit ou à l'original sur lequel il a été imprimé.
Les relieurs disent, plier ou brocher, coudre, battre, mettre en presse, couvrir, dorer, lettrer un livre. Voyez RELIURE.
Une collection considérable de livres pourroit s'appeller improprement une librairie : on la nomme mieux bibliotheque. Voyez LIBRAIRIE & BIBLIOTHEQUE. Un inventaire de livres fait à dessein d'indiquer au lecteur un livre en quelque genre que ce soit s'appelle un catalogue. Voyez CATALOGUE.
Cicéron appelle M. Caton hellus librorum, un dévoreur de livres. Gaza regardoit les livres de Plutarque, & Hermol. Barbaro ceux de Pline comme les meilleurs de tous les livres. Gentsken, hist. philos. pag. 130. Harduin. praefat. ad Plin.
Barthol. de libr. legend. dissert. III. pag. 66. a fait un traité sur les meilleurs livres des auteurs : selon lui, le meilleur livre de Tertullien est son traité de pallio : de S. Augustin, la cité de Dieu : d'Hippocrate, coacae praenotiones : de Cicéron, le traité de officiis : d'Aristote, de animalibus : de Galien, de usu partium : de Virgile le sixieme livre de l'Enéïde : d'Horace, la premiere & la septieme de ses épîtres : de Catulle, Coma Berenices : de Juvenal, la sixieme satyre : de Plaute, l'Epidicus : de Théocrite, la vingt-septieme Idylle : de Paracelse, chirurgia : de Séverinus, de abcessibus : de Budé, les Commentaires sur la langue grecque : de Joseph Scaliger, de emendatione temporum : de Bellarmin, de scriptoribus ecclesiasticis : de Saumaise, exercitationes Plinianae : de Vossius, institutiones oratoriae : d'Heinsius, aristharcus sacer : de Casaubon, exercitationes in Baronium.
Il est bon toutefois d'observer que ces sortes de jugemens, qu'un auteur porte de tous les autres, sont souvent sujets à caution & à reforme. Rien n'est plus ordinaire que d'apprécier le mérite de certains ouvrages, qu'on n'a pas seulement lûs, ou qu'on préconise sur la foi d'autrui.
Il est néanmoins nécessaire de connoître par soi-même, autant qu'on le peut, le meilleur livre en chaque genre de Littérature : par exemple, la meilleure Logique, le meilleur Dictionnaire, la meilleure Physique, le meilleur Commentaire sur la Bible, la meilleure Concordance des évangelistes, le meilleur Traité de la religion chrétienne, &c. par ce moyen on peut se former une bibliotheque composée des meilleurs livres en chaque genre. On peut, par exemple, consulter pour cet effet le livre de Pople, intitulé, censura celebrium auctorum, où les ouvrages des plus considérables écrivains & des meilleurs auteurs en tout genre sont exposés : connoissance qui conduit à en faire un bon choix. Mais pour juger de la qualité d'un livre, il faut selon quelques-uns, en considérer l'auteur, la date, les éditions, les traductions, les commentaires, les épitomes qu'on en a faits, le succès, les éloges qu'il a mérités, les critiques qu'on en a faites, les condamnations ou la suppression dont on l'a flétri, les adversaires ou les défenseurs qu'il a eus, les continuateurs, &c.
L'histoire d'un livre renferme ce que le livre contient, & c'est ce qu'on appelle ordinairement extrait ou analyse, comme font les journalistes ; ou ses accessoires, ce qui regarde les littérateurs & les bibliothécaires. Voyez JOURNAL.
Le corps d'un livre consiste dans les matieres qui y sont traitées ; & c'est la partie de l'auteur : entre ces matieres il y a un sujet principal à l'égard duquel tout le reste est seulement accessoire.
Les incidens accessoires d'un livre sont le titre, l'épître dédicatoire, la préface, les sommaires, la table des matieres, qui sont la partie de l'éditeur ; à l'exception du titre, de la premiere page ou du frontispice, qui dépend quelquefois du libraire. Voyez TITRE.
Les sentimens doivent entrer dans la composition d'un livre, & en être le principal fondement : la méthode ou l'ordre des matieres doivent y régner ; & enfin, le style qui consiste dans le choix & l'arrangement des mots, est comme le coloris qui doit être répandu sur le tout. Voyez SENTIMENT, STYLE, METHODE.
On attribue aux Allemands l'invention des histoires littéraires, comme les journaux, les catalogues, & autres ouvrages, où l'on rend compte des livres nouveaux ; & un auteur de cette nation (Jean-Albert Fabricius) dit modestement que ses compatriotes sont en ce genre supérieurs à toutes les autres nations. Voyez ce qu'on doit penser de cette prétention au mot JOURNAL. Cet auteur a donné l'histoire des livres grecs & latins : Wolfius celle des livres hébreux : Boëcler celle des principaux livres de chaque science : Struvius celle des livres d'Histoire, de Lois & de Philosophie : l'abbé Fabricius celle des livres de sa propre bibliotheque : Lambecius celle des livres de la bibliotheque de Vienne : Lelong celle des livres de l'écriture : Maittaire celle des livres imprimés avant 1550. Voyez Reimm. Bibl. acroam. in praefat. parag. 1 pag. 3 : Bos. ad. not. script. eccles. cap. iv. parag. xiij. pag. 124 & seq. Mais à cette foule d'auteurs, sans parler de la Croix-du-Maine, de Duverdier, de Fauchet, de Colomiez, & de nos anciens bibliothécaires, ne pouvons-nous pas opposer MM. Baillet, Dupin, dom Cellier, les auteurs du Journal des savans, les journalistes de Trévoux, l'abbé Desfontaines, & tant d'autres, que nous pourrions revendiquer, comme Bayle, Bernard, Basnage, &c ?
Brûler un livre : sorte de punition & de flétrissure fort en usage parmi les Romains : on en commettoit le soin aux triumvirs, quelquefois aux préteurs ou aux édiles. Un certain Labienus, que son génie tourné à la satyre fit surnommer Rabienus, fut, dit-on, le premier contre les ouvrages duquel on sévit de la sorte. Ses ennemis obtinrent un senatûs-consulte, par lequel il fut ordonné que tous les ouvrages qu'avoit composé cet auteur pendant plusieurs années, seroient recherchés pour être brûlés : chose étrange & nouvelle, s'écrie Séneque, sévir contre les Sciences ! Res nova & insueta, supplicium de studiis sumi ! exclamation au reste froide & puérile ; puisqu'en ces occasions ce n'est pas contre les Sciences, mais contre l'abus des Sciences que sévit l'autorité publique. On ajoute que Cassius Servius ami de Labienus, entendant prononcer cet arrêt, dit qu'il falloit aussi le brûler, lui qui avoit gravé ces livres dans sa mémoire : nunc me vivum comburi oportet, qui illos didici ; & que Labienus ne pouvant survivre à ses ouvrages, s'enferma dans le tombeau de ses ancêtres, & y mourut de langueur. Voyez Tacit. in Agric. cap. ij. n. j. Val. Max. lib. I. cap. j. n. xij. Tacit. Annal. lib. IV. c. xxxv. n. iv. Seneq. Controv. in praefat. parag. 5. Rhodig. antiq. Lect. cap. xiij. lib. II. Salm. ad Pancirol. tom. I. tit. xxij. pag. 68. Pitiscus, Lex. antiq. tom. II. pag. 84. On trouve plusieurs autres preuves de cet usage de condamner les livres au feu dans Reimm. Idea system. ant. litter. pag. 389. & suiv.
A l'égard de la matiere des livres, on croit que d'abord on grava les caracteres sur de la pierre ; témoins les tables de la loi données à Moïse, qu'on regarde comme le plus ancien livre dont il soit fait mention : ensuite on les traça sur des feuilles de palmier, sur l'écorce intérieure & extérieure du tilleul, sur celle de la plante d'Egypte nommée papyrus. On se servit encore de tablettes minces enduites de cire, sur lesquelles on traçoit les caracteres avec un stilet ou poinçon, ou de peaux, sur-tout de celles des boucs & des moutons dont on fit ensuite le parchemin. Le plomb, la toile, la soie, la corne, & enfin le papier, furent successivement les matieres sur lesquelles on écrivit. V. Calmet, dissert. I. sur la Gen. Comment. t. I. diction. de la Bible, t. I. p. 316. Dupin Libr. Dissert. IV. pag. 70. hist. de l'acad. des Inscript. Bibliot. eccles. tom. XIX. p. 381. Bartholin, de legend. t. III. p. 103. Schwartz, de ornam. Libr. Dissert. I. Reimm. Idea syst. antiq. Litter. pag. 235. & 286. & suiv. Montfaucon, Paleogr. lib. II. cap. viij. p. 180. & suiv. Guiland. papir. memb. 3. Voyez l'article PAPIER.
Les parties des végétaux furent long-tems la matiere dont on faisoit les livres, & c'est même de ces végétaux que sont pris la plûpart des noms & des termes qui concernent les livres, comme le nom grec : les noms latins folium, tabulae, liber, d'où nous avons tiré feuillet, tablette, livre, & le mot anglois book. On peut ajoûter que cette coûtume est encore suivie par quelques peuples du nord, tels que les Tartares Kalmouks, chez lesquels les Russiens trouverent en 1721 une bibliotheque dont les livres étoient d'une forme extraordinaire. Ils étoient extrêmement longs & n'avoient presque point de largeur. Les feuillets étoient fort épais, composés d'une espece de coton ou d'écorces d'arbres, enduits d'un double vernis, & dont l'écriture étoit blanche sur un fond noir. Mém. de l'acad. des Bell. Lettr. tom. V. pag. 5 & 6.
Les premiers livres étoient en forme de bloc & de tables dont il est fait mention dans l'écriture sous le nom de sepher, qui a été traduit par les Septante , tables quarrées. Il semble que le livre de l'alliance, celui de la loi, le livre des malédictions, & celui du divorce ayent eu cette forme. Voyez les Commentaires de Calmet sur la Bible.
Quand les anciens avoient des matieres un peu longues à traiter, ils se servoient plus commodément de feuilles ou de peaux cousues les unes au bout des autres, qu'on nommoit rouleaux, appellés pour cela par les Latins volumina, & par les Grecs , coûtume que les anciens Juifs, les Grecs, les Romains, les Perses, & même les Indiens ont suivie, & qui a continué quelques siecles après la naissance de Jesus-Christ.
La forme des livres est présentement quarrée, composée de feuillets séparés ; les anciens faisoient peu d'usage de cette forme, ils ne l'ignoroient pourtant pas. Elle avoit été inventée par Attale, roi de Pergame, à qui l'on attribue aussi l'invention du parchemin. Les plus anciens manuscrits que nous connoissions sont tous de cette forme quarrée, & le P. Montfaucon assure que de tous les manuscrits grecs qu'il a vûs, il n'en a trouvé que deux qui fussent en forme de rouleau. Paleograp. graec. lib. I. cap. iv. p. 26. Reimm. idea system. antiq. litter. pag. 227. Item pag. 242. Schwartz, de ornam. lib. Dissert. II. Voyez l'article RELIURE.
Ces rouleaux ou volumes étoient composés de plusieurs feuilles attachées les unes aux autres & roulées autour d'un bâton qu'on nommoit umbilicus, qui servoit comme de centre à la colonne ou cylindre que formoit le rouleau. Le côté extérieur des feuilles s'appelloit frons, les extrêmités du bâton se nommoient cornua, & étoient ordinairement décorés de petits morceaux d'argent, d'ivoire, même d'or & de pierres précieuses ; le mot étoit écrit sur le côté extérieur. Quand le volume étoit déployé, il pouvoit avoir une verge & demie de large sur quatre ou cinq de long. Voyez Salmuth ad Pancirol. part. I. tit. XLII. pag. 153. & suiv. Wale. parerg. acad. pag. 72. Pitisc. lex. ant. tom. II. pag. 48. Barth. advers. l. XXII. c. 28. & suiv. Idem pag. 251. auxquels on peut ajoûter plusieurs autres auteurs qui ont écrit sur la forme & les ornemens des anciens livres rapportés dans Fabricius, Bibl. antiq. cap. xix. §. 7. pag. 607.
A la forme des livres appartient aussi l'arrangement de leur partie intérieure, ou l'ordre & la disposition des points ou matieres, & des lettres en lignes & en pages, avec des marges & d'autres dépendances. Cet ordre a varié ; d'abord les lettres étoient seulement séparées en lignes, elles le furent ensuite en mots séparés, qui furent distribués par points & alinea, en périodes, sections, paragraphes, chapitres, & autres divisions. En quelques pays, comme parmi les orientaux, les lignes vont de droite à gauche ; parmi les peuples de l'occident & du nord, elles vont de gauche à droite. D'autres, comme les Grecs, du moins en certaines occasions, écrivoient la premiere ligne de gauche à droite, la seconde de droite à gauche, & ainsi alternativement. Dans d'autres pays les lignes sont couchées de haut en bas à côté les unes des autres, comme chez les Chinois. Dans certains livres les pages sont entieres & uniformes, dans d'autres elles sont divisées par colonnes ; dans quelques-uns elles sont divisées en texte & en notes, soit marginales, soit rejettées au bas de la page. Ordinairement elles portent au bas quelques lettres alphabétiques qui servent à marquer le nombre des feuilles, pour connoître si le livre est entier. On charge quelquefois les pages de sommaires ou de notes : on y ajoûte aussi des ornemens, des lettres initiales, rouges, dorées, ou figurées ; des frontispices, des vignettes, des cartes, des estampes, &c. A la fin de chaque livre on met fin ou finis ; anciennement on y mettoit un appellé coronis, & toutes les feuilles du livre étoient lavées d'huile de cèdre, ou parfumées d'écorce de citron, pour préserver les livres de la corruption. On trouve aussi certaines formules au commencement ou à la fin des livres, comme parmi les Juifs, esto fortis, que l'on trouve à la fin de l'exode, du Lévitique, des nombres, d'Ezéchiel, par lesquels on exhorte le lecteur (disent quelques-uns) à lire les livres suivans. Quelquefois on trouvoit à la fin des malédictions contre ceux qui falsifieroient le contenu du livre, & celle de l'apocalypse en fournit un exemple. Les Mahométans placent le nom de Dieu au commencement de tous leurs livres, afin d'attirer sur eux la protection de l'être suprême, dont ils croyent qu'il suffit d'écrire ou de prononcer le nom pour s'attirer du succès dans ses entreprises. Par la même raison plusieurs lois des anciens empereurs commençoient par cette formule, In nomine Dei. V. Barthol. de libr. legend. Dissert. V. pag. 106. & suiv. Montfaucon Paleogr. lib. I. c. xl. Reimm. Idea system. antiq. litter. p. 227. Schwartz de ornam. libror. Dissert. II. Reimm. Id. system. pag. 251. Fabricius Bibl. graec. lib. X. c. v. p. 74. Revel. c. xxij. Alkoran, sect. III. pag. 59. Barthol. lib. cit pag. 117.
A la sin de chaque livre les Juifs ajoûtoient le nombre de versets qui y étoient contenus, & à la fin du Pentateuque le nombre des sections, afin qu'il pût être transmis dans son entier à la postérité ; les Massoretes & les Mahométans ont encore fait plus. Les premiers ont marqué le nombre des mots, des lettres, des versets & des chapitres de l'ancien Testament, & les autres en ont usé de même à l'égard de l'alcoran.
Les dénominations des livres sont différentes, selon leur usage & leur autorité. On peut les distinguer en livres humains, c'est-à-dire, qui sont composés par des hommes, & livres divins, qui ont été dictés par la Divinité même. On appelle aussi cette derniere sorte de livres, livres sacrés ou inspirés. Voyez REVELATION, INSPIRATION.
Les Mahométans comptent cent quatre livres divins, dictés ou donnés par Dieu lui-même à ses prophetes, savoir dix à Adam, cinquante à Seth, trente à Enoch, dix à Abraham, un à Moïse, savoir le Pentateuque tel qu'il étoit avant que les Juifs & les Chrétiens l'eussent corrompu ; un à Jesus-Christ, & c'est l'Evangile ; à David un, qui comprend les Pseaumes ; & un à Mahomet, savoir l'alcoran : quiconque parmi eux rejette ces livres soit en tout soit en partie, même un verset ou un mot, est regardé comme infidele. Ils comptent pour marque de la divinité d'un livre, quand Dieu parle lui-même & non quand d'autres parlent de Dieu à la troisieme personne, comme cela se rencontre dans nos livres de l'ancien & du nouveau Testament, qu'ils rejettent comme des compositions purement humaines, ou du moins fort altérées. Voyez Reland de relig. Mohammed. lib. I. c. iv. pag. 21. & suiv. Idem ibid. lib. II. §. 26. pag. 231.
Livres sibyllins ; c'étoient des livres composés par de prétendues prophétesses du paganisme, appellées Sibylles, lesquels étoient déposés à Rome dans le capitole, sous la garde des duumvirs. Voy. Lomeier, de Bibl. c. xiij. pag. 377. Voyez aussi SIBYLLE.
Livres canoniques ; ce sont ceux qui sont reçus par l'Eglise, comme faisant partie de l'Ecriture sainte : tels sont les livres de l'ancien & du nouveau Testament. Voyez CANON, BIBLE.
Livres apocryphes ; ce sont ceux qui sont exclus du rang des canoniques, ou faussement attribués à certains auteurs. Voyez APOCRYPHE.
Livres authentiques ; l'on appelle ainsi ceux qui sont véritablement des auteurs auxquels on les attribue, ou qui sont décisifs & d'autorité ; tels sont parmi les livres de Droit le code, le digeste. Voyez Bacon,de aug. Scient. lib. VIII. c. iij. Works, t. I. pag. 257.
Livres auxiliaires ; sont ceux qui quoique moins essentiels en eux-mêmes, servent à en composer ou à en expliquer d'autres, comme dans l'étude des lois, les livres des instituts, les formules, les maximes, &c.
Livres élémentaires ; on appelle ainsi ceux qui contiennent les premiers & les plus simples principes des sciences, tels sont les rudimens, les méthodes, les grammaires, &c. par où on les distingue des livres d'un ordre supérieur, qui tendent à aider ou à éclairer ceux qui ont des sciences une teinture plus forte. Voyez les mém. de Trévoux, ann. 1734, pag. 804.
Livres de bibliotheque ; on nomme ainsi des livres qu'on ne lit point de suite, mais qu'on consulte au besoin, comme les dictionnaires, les commentaires, &c.
Livres exotériques ; nom que les savans donnent à quelques ouvrages destinés à l'usage des lecteurs ordinaires ou du peuple.
Livres acroamatiques ; ce sont ceux qui traitent de matieres sublimes ou cachées, qui sont seulement à la portée des savans ou de ceux qui veulent approfondir les sciences. Voyez Reimm. Idea system. ant. litter. pag. 136.
Livres défendus ; on appelle ainsi ceux qui sont prohibés & condamnés par les évêques, comme contenant des hérésies ou des maximes contraires aux bonnes moeurs. V. Bingham, orig. eccles. lib. XVI. cap. xj. part. 11. Pasc. de Var. mod. mor. trad. c. iij. p. 250. & 298. Dictionn. univers. de Trev. tom. III. pag. 1507. Pfaff. Introd. hist. theolog. tom. II. p. 65. Heuman, Via ad hist. litt. cap. iv. parag. 63. p. 162. Voyez INDEX.
Livres publics, libri publici ; ce sont les actes des tems passés & des transactions gardées par autorité publique. Voyez le Dictionn. de Trevoux t. I. p. 1509. Voyez aussi ACTES.
Livres d'église ; ce sont ceux dont on se sert dans les offices publics de la religion, comme sont le pontifical, l'antiphonier, le graduel, le lectionnaire, le pseautier, le livre d'évangile, le missel, l'ordinal, le rituel, le processional, le cérémonial, le bréviaire ; & dans l'église grecque, le monologue, l'euchologue, le tropologue, &c. Il y a aussi un livre de paix qu'on porte à baiser au clergé pendant la messe : c'est ordinairement le livre des évangiles.
Livres de-plein-chant ; sont ceux qui contiennent les pseaumes, les antiennes, les répons & autres prieres que l'on chante & qui sont notées.
Livres de liturgie ; ce sont ceux qui contiennent, non toutes les liturgies de l'église grecque, mais seulement les quatre qui sont présentement en usage, savoir les liturgies de S. Basile, de S. Chrysostome, celle des Présanctifiés, , & celle de saint Jacques, qui n'a lieu que dans l'église de Jérusalem, & seulement une fois l'année. Voyez Pfaff. Introd. histor. theolog. lib. IV. parag. 8. tom. III. pag. 287. Dictionn. univ. de Trev. tom. III. pag. 1597.
Les livres d'église en Angleterre qui étoient en usage dès le milieu du x. siecle, étoient selon qu'ils sont nommés dans les canons d'Elsric, la Bible, le Pseautier, les Epitres, l'Evangile, le livre de Messe, le livre de plein-chant, autrement Antiphonier, le Manuel, le Calendrier, le Martyrologe, le Pénitentiel, & le livre des Leçons. Voyez Johns, lois ecclés. ann. 957. parag. 21.
Les livres d'église chez les Juifs, sont le livre de la Loi, l'Hagiographe, les Prophetes, &c. Le premier de ces livres s'appelle aussi le livre de Moïse, parce que ce législateur l'a composé, & le livre de l'Alliance, parce qu'il contient l'alliance de Dieu avec les Juifs. Dans un sens plus absolu, le livre de la Loi signifie l'original ou l'autographe qui fut trouvé dans le trésor du temple sous le regne de Josias.
On peut distinguer les livres selon leur dessein ou le sujet qu'ils traitent, en historiques, qui racontent les faits ou de la nature ou de l'humanité, & en dogmatiques, qui exposent une doctrine ou des vérités générales. D'autres sont mêlés de dogmes & de faits ; on peut les nommer historico-dogmatiques. D'autres recherchent simplement des vérités, ou tout au plus indiquent les raisons par lesquelles ces vérités peuvent être prouvées comme la Géométrie de Mallet. On peut les ranger sous la même classe ; mais on donnera le titre de scientifico-dogmatiques, aux ouvrages qui non-seulement enseignent une science, mais encore qui la démontrent comme les élémens d'Euclide. Voyez Volf, Philos. prat. sect. III. cap. j. parag. 7. pag. 750.
Livres pontificaux, libri pontificales, ; c'étoient parmi les Romains les livres de Numa qui étoient gardés par le grand-prêtre, & dans lesquels étoient décrites les cérémonies des fêtes, des sacrifices, les prieres, & tout ce qui avoit rapport à la religion. On les appelloit aussi indigitamenta, parce qu'ils servoient, pour ainsi dire, à désigner les dieux dont ils contenoient les noms, aussi-bien que les formules & les invocations usitées en diverses occasions. Voyez Lomeier, de Bibl. c. vj. pag. 107. Pitisci, L. Ant. tom. II. pag. 85. voc. libri.
Livres rituels, libri rituales ; c'étoient ceux qui enseignoient la maniere de bâtir & de consacrer les villes, les temples & les autels, les cérémonies des consécrations des murs, des portes principales, des familles, des tribus, des camps. Voyez Lomeier, loc. cit. cap. vj. Pitisc. ubi suprà.
Livres des augures, libri augurales, appellés par Ciceron reconditi : c'étoient ceux qui contenoient la science de prévoir l'avenir par le vol & le chant des oiseaux. Voyez Ciceron, orat. pro domo suâ ad pontif. Servius, sur le V. liv. de l'Enéid. v. 738. Lomeier, lib. cit. lib. VI. pag. 109. Voyez aussi AUGURE.
Livres des aruspices, libri haruspicini ; c'étoient ceux qui contenoient les mysteres & la science de deviner par l'inspection des entrailles des victimes. Voyez Lomeier, loc. cit. voyez ARUSPICE.
Livres achérontiques ; c'étoient ceux dans lesquels étoient contenues les cérémonies de l'acheron ; on les nommoit aussi libri etrusci, parce qu'on en faisoit auteur Tagés l'Etrurien, quoique d'autres les attribuassent à Jupiter même. Quelques-uns croient que ces livres étoient les mêmes que ceux qu'on nommoit libri fatales, & d'autres les confondent avec ceux des aruspices. Voyez Servius, sur le V. liv. de l'Enéid. v. 398. Lomeier, de Bibl. c. vj. pag. 152. Lindenbrog. ad Censorin. cap. xiv.
Livres fulminans, libri fulgurantes ; c'étoient ceux qui traitoient du tonnerre, des éclairs, & de l'interprétation qu'on devoit donner à ces météores. Tels étoient ceux qu'on attribuoit à Bigoïs, nymphe d'Etrurie, & qui étoient conservés dans le temple d'Apollon. Voyez Servius sur le VI. liv. de l'Enéid. v. 73. Lomeier, Ibid. pag. 3.
Livres fatals, libri fatales, qu'on pourroit appeller autrement livres des destins. C'étoient ceux dans lesquels on supposoit que l'âge ou le terme de la vie des hommes étoit écrit selon la discipline des Etruriens. Les Romains consultoient ces livres dans les calamités publiques, & on y recherchoit la maniere d'expiation propre à appaiser les dieux. Voyez Censorin. de die natal. c. xiv. Lomeier, cap. vj. pag. 112. & Pitiscus, pag. 85.
Livres noirs ; ce sont ceux qui traitent de la magie. On donne aussi ce nom à plusieurs autres livres, soit par rapport à la couleur dont ils sont couverts, soit par rapport aux choses funestes qu'ils contiennent. On en appelle aussi d'autres livres rouges, ou papiers rouges, c'est-à-dire livres de jugement & de condamnation. Voyez JUGEMENT.
Bons livres ; ce sont communément les livres de dévotion & de piété, comme les soliloques, les méditations, les prieres. Voyez Shaftsbury, tom. I. caract. pag. 165. & tome III. pag. 327.
Un bon livre, selon le langage des Libraires, est un livre qui se vend bien ; selon les curieux, c'est un livre rare ; & selon un homme de bon sens, c'est un livre instructif. Une des cinq principales choses que Rabbi Akiba recommanda à son fils fut, s'il étudioit en Droit, de l'apprendre dans un bon livre, de peur qu'il ne fût obligé d'oublier ce qu'il auroit appris. Voyez Crenius, de furib. Librar. Voyez aussi au commencement de cet article le choix qu'on doit faire des livres.
Livres spirituels : on appelle ainsi ceux qui traitent plus particulierement de la vie spirituelle, pieuse, & chrétienne, & de ses exercices, comme l'oraison mentale, la contemplation, &c. Tels sont les livres de S. Jean Climaque, de S. François de Sales, de sainte Thérese, de Thomas a Kempis, de Grenade, &c. Voyez MYSTIQUE.
Livres profanes ; ce sont ceux qui traitent de toute autre matiere que de la Religion. Voyez PROFANE.
Par rapport à leurs auteurs, on peut distinguer les livres en anonymes, c'est-à-dire qui sont sans nom d'auteur, Voyez ANONYME ; & en cryptonimes, dont le nom des auteurs est caché sous un anagramme, &c. pseudonymes, qui portent faussement le nom d'un auteur ; posthumes, qui sont publiés après la mort de l'auteur ; vrais, c'est-à-dire, qui sont réellement écrits par ceux qui s'en disent auteurs, & qui demeurent dans le même état où ils les ont publiés ; faux ou supposés, c'est-à-dire, ceux que l'on croit composés par d'autres que par leurs auteurs ; falsifiés, ceux qui depuis qu'ils ont été faits sont corrompus par des additions ou des insertions fausses. Voyez Pasch. de variis mod. moral. trad. lib. III. pag. 187. Heuman, via ad histor. litter. cap. vj. parag. 4 pag. 334.
Par rapport à leurs qualités, les livres peuvent être distingués en
Livres clairs & détaillés, qui sont ceux du genre dogmatique, où les auteurs définissent exactement tous leurs termes, & emploient ces définitions dans tout le cours de leurs ouvrages.
Livres obscurs, c'est-à-dire, dont tous les mots sont trop génériques, & qui ne sont point définis ; ensorte qu'ils ne portent aucune idée claire & précise dans l'esprit du lecteur.
Livres prolixes, qui contiennent des choses étrangeres & inutiles au dessein que l'auteur paroît s'être proposé ; comme si dans un traité d'arpentage un auteur donnoit tout Euclide.
Livres utiles, qui traitent des choses nécessaires ou aux connoissances humaines, ou à la conduite des moeurs.
Livres complets, qui contiennent tout ce qui regarde le sujet traité. Relativement complets, c'est-à-dire, qui renferment tout ce qui étoit connu sur le sujet traité pendant un certain tems ; ou si un livre est écrit dans une vûe particuliere, on peut dire de lui qu'il étoit complet, s'il contient justement ce qui est nécessaire peut atteindre à son but. Au contraire on appelle incomplets, les livres qui manquent de cet ornement. Voyez Wolf. Log. parag. 815. pag. 818. 20. & 25. &c.
On peut encore donner une division de livres, d'après la matiere dont ils sont composés, & les distinguer en
Livres en papier qui sont écrits sur du papier fait de toile ou de coton, ou sur le papyrus des Egyptiens ; mais il en reste peu d'écrits de cette derniere maniere. Voyez Montfaucon, Paleograph. graec. lib. I. c. ij. pag. 14. Voyez aussi PAPIER.
Livres en parchemin, libri in membranâ, ou membranae, qui sont écrits sur des peaux d'animaux, & principalement de moutons. Voyez PARCHEMIN.
Livres en toile, libri lintei, qui chez les Romains étoient écrits sur des blocs ou des tables couvertes d'une toile. Tels étoient les livres des sibylles, & plusieurs lois, les lettres des princes, les traités, les annales. Voyez Plin. hist. natur. lib. XIII. cap. xij. Dempster, ad Rosin. lib. III. ch. xxiv. Lomeier, de bibl. cap. vj. pag. 166.
Livres en cuir, libri in corio, dont fait mention Ulpien, lit. 52. ff. de leg. 3. Guilandus prétend que ce sont les mêmes que ceux qui étoient écrits sur de l'écorce, différente de celle dont on se servoit ordinairement, & qui étoit de tilleul. Scaliger pense plus probablement que ces livres étoient composés de feuilles faites d'une certaine peau, ou de certaines parties de peaux de bêtes, différentes de celles dont on se servoit ordinairement, & qui étoient les peaux ou les parties de la peau du dos des moutons. Guiland. papir. membr. 3. n. 5. Salmuth, ad Pancirol. p. II. tit. XIII. pag. 252. Scaliger, ad Guiland. p. 17. Pitisc. L. Ant. tom. II. pag. 84. voc. libri.
Livres en bois, tablettes, libri in schedis : ces livres étoient écrits sur des planches de bois ou des tablettes polies avec le rabot, & ils étoient en usage chez les Romains. Voyez Pitisc. loco citato.
Livres en cire, libri in ceris, dont parle Pline : les auteurs ne sont pas d'accord sur la maniere dont étoient faits ces livres. Hermol. Barbaro croit que ces mots in ceris sont corrompus, & qu'il faut lire in schedis, & il se fonde sur l'autorité d'un ancien manuscrit. D'autres rejettent cette correction, & se fondent sur ce qu'on sait que les Romains couvroient quelquefois leurs planches ou schedae, d'une legere couche de cire, afin de faire plus aisément des ratures ou des corrections, avantage que n'avoient point les livres in schedis, & conséquemment ceux-ci étoient moins propres aux ouvrages qui demandoient de l'élégance & du soin, que les livres en cire, qui sont aussi appellés libri cerae, ou cerei. Voyez Pitisc. ubi suprà.
Livres en ivoire, libri elephantini ; ces livres, selon Turnebe, étoient écrits sur des bandes ou des feuilles d'ivoire. Voyez Salmuth, ad Pancirol. p. II. tit. xiij. pag. 255. Guiland. papyr. membr. 2°. n °. 48. selon Scaliger, ad Guiland. pag. 16. ces livres étoient faits d'intestins d'éléphans. Selon d'autres, c'étoient les livres dans lesquels étoient inscrits les actes du sénat, que les empereurs faisoient conserver. Selon d'autres, c'étoient certaines collections volumineuses en 35 volumes qui contenoient les noms de tous les citoyens des trente-cinq tribus romaines. Fabricius, descript. urb. c. vj. Donat, de urb. rom. lib. II. c. xxiij. Pitisci L. Ant. loc. cit pag. 84. & suiv.
Par rapport à leur manufacture, ou au commerce qu'on en fait, on peut distinguer les livres en
Manuscrits qui sont écrits soit de la main de l'auteur, & on les appelle autographes, soit de celle des bibliothécaires & des copistes. Voyez MANUSCRITS, BIBLIOTHECAIRE.
Imprimés, qui sont travaillés sous une presse d'imprimeur & avec des caracteres d'imprimerie. Voyez IMPRIMERIE.
Livres en blanc, qui ne sont ni liés ni cousus : livres in-folio, dans lesquels une feuille n'est pliée qu'une fois, & forme deux feuillets ou quatre pages ; in-quarto, où la feuille fait quatre feuillets : in-octavo, où elle en fait huit ; in-douze, où elle en fait douze ; in-seize, où elle en fait seize, & in-24. où elle en fait vingt-quatre.
Par rapport aux circonstances ou aux accidens des livres, on peut les diviser en
Livres perdus, qui sont ceux qui ont péri par l'injure du tems, ou par la malice & par le faux zele des hommes. Tels sont plusieurs livres, même de l'Ecriture qui avoient été composés par Salomon, & d'autres livres des Prophetes. Voyez Fabric. cod. pseudepig. veter. testam. tom. II. pag. 171. Joseph. Hypotim. liv. V. c xx. apud Fabric. lib. cit. p. 247.
Livres promis, ceux que des auteurs ont fait attendre, & n'ont jamais donné au public. Janson ab Almeloveen a donné un catalogue des livres promis, mais qui n'ont jamais paru. Voyez Struv. introd. ad notit. rei litter. c. viij. part. XXI. p. 754.
Livres imaginaires, ce sont ceux qui n'ont jamais existé : tel est le livre de tribus impostoribus, dont quelques-uns ont fait tant de bruit, & que d'autres ont supposé existant, auxquels on peut ajouter divers titres de livres imaginaires, dont il est parlé dans M. Baillet & dans d'autres auteurs. Loescher a publié un grand nombre de plans ou de projets de livres, dont plusieurs pourroient être utiles & bien faits, s'ils étoient exécutés d'après ces plans, s'il est possible de faire quelque chose de bien d'après les idées d'un autre, ce qu'on n'a pas encore vû. Voyez Pasch. de var. mod. moral. trad. c. iij. pag. 283. Baillet, des satyres personnelles, Loesch. arcan. litter. projets littéraires. Journal littér. tome I. p. 470.
Livres d'ana & d'anti. Voyez ANA & ANTI.
Le but ou le dessein des livres sont différens, selon la nature des ouvrages : les uns sont faits pour montrer l'origine des choses ou pour exposer de nouvelles découvertes ; d'autres pour fixer & établir quelque vérité, ou pour pousser une science à un plus haut degré ; d'autres pour dégager les esprits des idées fausses, & pour fixer plus précisément les idées des choses ; d'autres pour expliquer les noms & les mots dont se servent différentes nations ou qui étoient en usage en différens âges ou parmi différentes sectes ; d'autres ont pour but d'éclaircir, de constater la vérité des faits, des événemens, & d'y montrer les voies & les ordres de la providence ; d'autres n'embrassent que quelques-unes de ces parties, d'autres en réunissent la plûpart & quelquefois toutes. Voyez Loesch. de Caus. ling. hebr. in praefat.
Les usages des livres ne sont ni moins nombreux ni moins variés : c'est par eux que nous acquérons des connoissances : ils sont les dépositaires des lois, de la mémoire, des évenemens, des usages, moeurs, coutumes, &c. le véhicule de toutes les Sciences ; la religion même leur doit en partie son établissement & sa conservation. Sans eux, dit Bartholin, " Deus jam silet, Justitia quiescit, torpet Medicina, Philosophia manca est, litterae mutae, omnia tenebris involuta cimmeriis. " De lib. legend. dissert. I. p. 5.
Les éloges qu'on a donnés aux livres sont infinis : on les représente comme l'asyle de la vérité, qui souvent est bannie des conversations ; comme des conseillers toujours prêts à nous instruire chez nous & quand nous voulons, & toujours desintéressés. Ils suppléent au défaut des maîtres, & quelquefois au manque de génie ou d'invention, & élevent quelquefois ceux qui n'ont que de la mémoire au-dessus des personnes d'un esprit plus vif & plus brillant. Un auteur qui écrivoit fort élégamment, quoique dans un siecle barbare, leur donne toutes ces louanges. Voyez Lucas de Penna, apud Morhof. Polyhist. liv. I. ch. iij. p. 27. Liber, dit-il, est lumen cordis, speculum corporis, virtutum magister, vitiorum depulsor, corona prudentum, comes itineris, domesticus amicus, congerro jacentis, collega & consiliarius praesidentis, myrothecium eloquentiae, hortus plenus fructibus, pratum floribus distinctum, memoriae penus, vita recordationis. Vocatus properat, jussus festinat, semper praesto est, nunquam non morigerus, rogatus confestim respondet, arcana revelat, obscura illustrat, ambigua certiorat, perplexa resolvit, contra adversam fortunam defensor, secundae moderator, opes adauget, jacturam propulsat, &c.
Peut-être leur plus grande gloire vient-elle de s'être attiré l'affection des plus grands hommes dans tous les âges. Cicéron dit de M. Caton : Marcum Catonem vidi in bibliotecâ sedentem multis circumfusum stoïcorum libris. Erat enim, ut scis, in eo inexhausta aviditas legendi, ne satiari poterat. Quippe qui, nec reprehensionem vulgi inanem reformidans, in ipsâ curiâ soleret legere saepe dum senatus cogeretur, nihil operae reipublicae detrahens. De finibus lib. III. n °. 2. Pline l'ancien, l'empereur Julien, & d'autres dont il seroit trop long de rapporter ici les noms fameux, étoient aussi fort passionnés pour la lecture : ce dernier a perpétué son amour pour les livres, par quelques épigrammes grecques qu'il a fait en leur honneur. Richard Bury, évêque de Durham, & grand chancelier d'Angleterre, a fait un traité sur l'amour des livres. Voyez Pline, epist. 7. lib. III. Philobiblion sive de amore librorum. Fabricii, bibl. lat. med. aevi, tom. I. p. 832 & suiv. Morhof. Polyhist. liv. I. ch. xvij. pag. 190. Salmuth ad Pancirol. lib. I. tit. 22. p. 67. Barthol. de lib. legend. dissert. I. p. 1. & suiv.
Les mauvais effets qu'on peut imputer aux livres, c'est qu'ils employent trop de notre tems & de notre attention, qu'ils engagent notre esprit à des choses qui ne tournent nullement à l'utilité publique, & qu'ils nous inspirent de la répugnance pour les actions & le train ordinaire de la vie civile ; qu'ils rendent paresseux & empêchent de faire usage des talens que l'on peut avoir pour acquérir par soi-même certaines connoissances, en nous fournissant à tous momens des choses inventées par les autres ; qu'ils étouffent nos propres lumieres, en nous faisant voir par d'autres que par nous-mêmes ; outre que les caracteres mauvais peuvent y puiser tous les moyens d'infecter le monde d'irréligion, de superstition, de corruption dans les moeurs, dont on est toujours beaucoup plus avide que des leçons de sagesse & de vertu. On peut ajouter encore bien des choses contre l'inutilité des livres ; les erreurs, les fables, les folies dont ils sont remplis, leur multitude excessive, le peu de certitude qu'on en tire, sont telles, qu'il paroît plus aisé de découvrir la vérité dans la nature & la raison des choses, que dans l'incertitude & les contradictions des livres. D'ailleurs les livres ont fait négliger les autres moyens de parvenir à la connoissance des choses, comme les observations, les expériences, &c. sans lesquelles les sciences naturelles ne peuvent être cultivées avec succès. Dans les Mathématiques, par exemple, les livres ont tellement abattu l'exercice de l'invention, que la plûpart des Mathématiciens se contentent de résoudre un problème par ce qu'en ont dit les autres, & non par eux-mêmes, s'écartant ainsi du but principal de leur science, puisque ce qui est contenu dans les livres de Mathématiques n'est seulement que l'histoire des Mathématiques, & non l'art ou la science de résoudre des questions, chose qu'on doit apprendre de la nature & de la réflexion, & qu'on ne peut acquérir facilement par la simple lecture.
A l'égard de la maniere d'écrire ou de composer des livres, il y a aussi peu de regles fixes & universelles que pour l'art de parler, quoique le premier soit plus difficile que l'autre ; car un lecteur n'est pas si aisé à surprendre ou à éblouir qu'un auditeur, les défauts d'un ouvrage ne lui échappent pas avec la même rapidité que ceux d'une conversation. Cependant un cardinal de grande réputation réduit à très-peu de points les regles de l'art d'écrire ; mais ces regles sont-elles aussi aisées à pratiquer qu'à prescrire ? Il faut, dit-il, qu'un auteur considere à qui il écrit, ce qu'il écrit, & comment & pourquoi il écrit. Voyez August. Valer. de caut. in edend. libr. Pour bien écrire & pour composer un bon livre, il faut choisir un sujet intéressant, y réfléchir long-tems & profondément ; éviter d'étaler des sentimens ou des choses déja dites, ne point s'écarter de son sujet, & ne faire que peu ou point de digressions ; ne citer que par nécessité pour appuyer une vérité, ou pour embellir son sujet par une remarque utile ou neuve & extraordinaire ; se garder de citer, par exemple, un ancien philosophe pour lui faire dire des choses que le dernier des hommes auroit dit tout aussi bien que lui, & ne point faire le prédicateur, à moins que le sujet ne regarde la chaire. Voyez la nouv. républ. des Lettres, tome XXXIX. p. 427.
Les qualités principales que l'on exige d'un livre, sont, selon Salden, la solidité, la clarté & la concision. On peut donner à un ouvrage la premiere de ces qualités, en le gardant quelque tems avant que de le donner au public, le corrigeant & le revoyant avec le conseil de ses amis. Pour y répandre la clarté, il faut disposer ses idées dans un ordre convenable, & les rendre par des expressions naturelles. Enfin on le rendra concis, en écartant avec soin tout ce qui n'appartient pas directement au sujet. Mais quels sont les auteurs qui observent exactement toutes ces regles, qui les remplissent avec succès ?
Vix totidem quot
Thebarum portae vel divitis ostia Nili.
Ce n'est pas dans ce nombre qu'il faut ranger ces écrivains qui donnent au public des six ou huit livres par an, & cela pendant le cours de dix ou douze années, comme Lintenpius, professeur à Copenhague, qui a donné un catalogue de 72 livres qu'il composa en douze ans ; savoir six volumes de Théologie, onze d'histoire ecclésiastique, trois de Philosophie, quatorze sur divers sujets, & trente-huit de Littérature. Voyez Lintenpius relat. incend. Berg. apud nov. litter. Lubec. ann. 1704, p. 247. On n'y comprendra pas non plus ces auteurs volumineux qui comptent leurs livres par vingtaines, par centaines, tel qu'étoit le P. Macedo, de l'ordre de saint François, qui a écrit de lui-même qu'il avoit composé 44 volumes, 53 panégyriques, 60 (suivant l'anglois) speeches latins, 105 épitaphes, 500 élégies, 110 odes, 212 épîtres dédicatoires, 500 épîtres familieres, poëmata epica juxta bis mille sexcenta : on doit supposer que par-là il entend 2600 petits poëmes en vers héroïques ou hexametres, & enfin 150 mille vers. Voyez Noris, miles macedo. Journ. des Savans, tome XLVII. p. 179.
Il seroit également inutile de mettre au nombre des écrivains qui liment leurs productions, ces auteurs enfans qui ont publié des livres dès qu'ils ont été en âge de parler, comme le jeune duc du Maine, dont les ouvrages furent mis au jour lorsqu'il n'avoit encore que sept ans, sous le titre d'oeuvres diverses d'un auteur de sept ans, Paris, in-quarto 1685. Voyez le journ. des Sav. tom. XIII. p. 7. Daniel Heinsius publia ses notes sur Silius Italicus, si jeune qu'il les intitula ses hochets, crepundia siliana, Lugd. Batav. ann. 1600. On dit de Caramuel qu'il écrivit sur la sphere avant que d'être assez âgé pour aller à l'école ; & ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il s'aida du traité de la sphere de Sacrobosco, avant que d'entendre un mot de latin. Voyez les enfans célebres de M. Baillet, n °. 81. p. 300. A quoi l'on peut ajouter ce que Placcius raconte de lui-même, qu'il commença à faire ses collections étant encore sous le gouvernement de sa nourrice, & n'ayant d'autres secours que le livre des prieres de cette bonne-femme. Placc. de ant. excerpt. p. 190.
M. Cornet avoit coutume de dire que pour écrire un livre il falloit être très-fou ou très-sage. Vigneul Marville. Dictionn. univ. de Trév. tome III. p. 1509. au mot livre. Parmi le grand nombre des auteurs, il y en a sans doute beaucoup de l'une & de l'autre espece ; il semble cependant que le plus grand nombre n'est ni de l'une ni de l'autre.
On s'est bien éloigné de la maniere de penser des anciens, qui apportoient une attention extrême à tout ce qui regarde la composition d'un livre ; ils en avoient une si haute idée, qu'ils comparoient les livres à des trésors, thesauros oportet esse, non libros. Il leur sembloit que le travail, l'assiduité, l'exactitude d'un auteur n'étoient point encore des passeports suffisans pour faire paroître un livre : une vûe générale, quoiqu'attentive sur l'ouvrage, ne suffisoit point à leur gré. Ils considéroient encore chaque expression, chaque sentiment, les tournoient sur différens points de vûe, n'admettoient aucun mot qui ne fût exact : ensorte qu'ils apprenoient au lecteur, dans une heure employée comme il faut, ce qui leur avoit peut-être coûté dix ans de soins & de travail. Tels sont les livres qu'Horace regarde comme dignes d'être arrosés d'huile de cedre, linenda cedro, c'est-à-dire dignes d'être conservés pour l'instruction de la postérité. Les choses ont bien changé de face : des gens qui n'ont rien à dire, ou qu'à répéter des choses inutiles ou déja dites mille fois, pour composer un livre ont recours à divers artifices ou stratagèmes : on commence par jetter sur le papier un dessein mal digéré, auquel on fait revenir tout ce qu'on sait & qu'on sait mal, traits vieux ou nouveaux, communs ou extraordinaires, bons ou mauvais, intéressans ou froids & indifférens, sans ordre & sans choix, n'ayant d'autre attention, comme le rhéteur Albutius, que de dire tout ce que l'on peut sur un sujet, & non ce que l'on doit. Curabant, dit Bartholin, cum Albutio rhetore, de omni causâ scribere, non quae debeant sed quae poterant. Voyez Salmuth ad Pancirol. p. 1. tit. XLII. p. 144. Guiland. de papyr. memb. 24. Reimm. idea system. ant. litter. p. 296. Bartholi, de l'huomo di litt. p. 11. p. 318.
Un auteur moderne a pensé qu'en traitant un sujet, il étoit quelquefois permis de saisir les occasions de détailler toutes les autres connoissances qu'on peut avoir, & les ramener à son dessein. Par exemple, un auteur qui écrit sur la goutte, comme a fait M. Aignan, peut insérer dans son ouvrage la nature des autres maladies & leurs remedes, y entremêler un système de medecine, des maximes de théologie & des regles de morale. Celui qui écrit sur l'art de bâtir, imitera Caramuel, qui ne s'est pas renfermé dans ce qui concerne uniquement l'Architecture, mais qui a traité en même tems de plusieurs matieres de Théologie, de Mathématiques, de Géographie, d'Histoire, de Grammaire, &c. Ensorte que si nous ajoutons foi à l'auteur d'une piece insérée dans les oeuvres de Caramuel, si Dieu permettoit que toutes les sciences du monde vinssent à être perdues, on pourroit les retrouver dans ce seul livre. Mais, en bonne foi, est-ce là faire ce qu'on appelle des livres ? Voyez Aignan, Traité de la goutte, Paris 1707. Journal des Savans, tome XXXIX. p. 421. & suiv. Architect. civil recta y obliqua. Consid. nel temp. de Jerusal. trois vol. in-fol. Vegev. 1678. Journal des Savans, tome X. pag. 348. Nouv. républ. des Lettres, tome I. p. 103.
Quelquefois les auteurs débutent par un préambule ennuyeux & absolument étranger au sujet, ou communément par une digression qui donne lieu à une seconde, & toutes deux écartent tellement l'esprit du sujet qu'on le perd de vûe : ensuite on nous accable de preuves pour une chose qui n'en a pas besoin : on forme des objections auxquelles personne n'eût pu penser ; & pour y répondre on est souvent forcé de faire une dissertation en forme, à laquelle on donne un titre particulier ; & pour allonger davantage, on y joint le plan d'un ouvrage qu'on doit faire, & dans lequel on promet de traiter plus amplement le sujet dont il s'agit, & qu'on n'a pas même effleuré. Quelquefois cependant on dispute en forme, on entasse raisonnemens sur raisonnemens, conséquences sur conséquences, & l'on a soin d'annoncer que ce sont des démonstrations géométriques ; mais quelquefois l'auteur le pense & le dit tout seul : ensuite on arrive à une chaîne de conséquences auxquelles on ne s'attendoit pas ; & après dix ou douze corollaires dans lesquels les contradictions ne sont point épargnées, on est fort étonné de trouver pour conclusion une proportion ou entierement inconnue ou si éloignée qu'on l'avoit entierement perdue de vûe, ou enfin qui n'a nul rapport au sujet. La matiere d'un pareil livre est vraisemblablement une bagatelle, par exemple, l'usage de la particule Et, ou la prononciation de l'êta grec, ou la louange de l'âne, du porc, de l'ombre, de la folie ou de la paresse, ou l'art de boire, d'aimer, de s'habiller, ou l'usage des éperons, des souliers, des gants, &c.
Supposons, par exemple, un livre sur les gants, & voyons comment un pareil auteur dispose son ouvrage. Si nous considérons sa méthode, nous verrons qu'il commence à la maniere des lullistes, & qu'il débute par le nom & l'étymologie du mot gant, qu'il donne non-seulement dans la langue où il écrit, mais encore dans toutes celles qu'il sait ou même qu'il ignore, soit orientales, soit occidentales, mortes ou vivantes, dont il a des dictionnaires ; il accompagne chacun de ces mots de leur étymologie respective, & quelquefois de leurs composés & de leurs dérivés, citant pour preuve d'une érudition plus profonde les dictionnaires dont il s'est aidé, sans oublier le chapitre ou le mot & la page. Du nom il passe à la chose avec un travail & une exactitude considérables, n'oubliant aucun des lieux communs, comme la matiere, la forme, l'usage, l'abus, les accessoires, les conjonctifs, les disjonctifs, &c. des gants. Sur chacun de ces points il ne se contentera pas du nouveau, du singulier, de l'extraordinaire ; il épuisera son sujet, & dira tout ce qu'il est possible d'en dire. Il nous apprendra, par exemple, que les gants préservent les mains du froid, & prononcera que si l'on expose ses mains au soleil sans gants, on s'expose à les avoir perdues de taches de rousseur ; que sans gants on gagne des engelures en hiver ; que des mains crevassées par les engelures sont desagréables à la vûe, ou que ces crevasses causent de la douleur. Voyez Nicolaï, disquisitio de chirotecarum usu & abusu. Giess. 1702. Nouv. républ. des Lettr. Août 1702. page 158 & suiv. Cependant cet ouvrage part d'un auteur de mérite, & qui n'est point singulier dans sa maniere d'écrire : ne peut-on pas dire que tous les auteurs tombent dans ce défaut, aussi-bien que M. Nicolaï, les uns plus, les autres moins ?
La forme ou la méthode d'un livre dépend de l'esprit & du dessein de l'auteur, qui lui applique quelquefois des comparaisons singulieres. L'un suppose que son livre est un chandelier à plusieurs branches, dont chaque chapitre est une bobeche. Voyez Wolf Bibl. hebr. tom. III. p. 987. L'autre le compare à une porte brisée qui s'ouvre à deux battans pour introduire le lecteur dans une dichotomie. R. Schabsaï, labra dormientium apud Wolf. lib. cit. in praef. p. 12.
Waltherus regarde son livre, officina biblica, comme une boutique ; en conséquence, il divise & arrange ses matériaux sur plusieurs tablettes, & considere le lecteur comme un chaland. Un autre compare le sien à un arbre qui a un tronc, des branches, des fleurs, & des fruits. Les vingt-quatre lettres de l'alphabet formant les branches, les différens mots tenant lieu de fleurs, & cent-vingt discours qui sont insérés dans ce livre en étant comme le fruit. Cassian. à S. Elia, arbor opinionum omnium moralium quae ex trunco pullulant, tot ramis quot sunt litterae alphabeti, cujus flores sunt verba, fructus sunt 120 conciones, &c. Venet. 1688. fol. Voyez giorn. di Parma ann. 1688. pag. 60.
Nous n'avons rien d'assuré sur la premiere origine des livres. De tous ceux qui existent, les livres de Moïse sont incontestablement les plus anciens, mais Scipion Sgambati & plusieurs autres soupçonnent que ces mêmes livres ne sont pas les plus anciens de tous ceux qui ont existé, & qu'avant le déluge il y en a eu plusieurs d'écrits par Adam, Seth, Enos, Caïnan, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé & sa femme, Cham, Japhet & sa femme, outre d'autres qu'on croit avoir été écrits par les démons ou par les anges. On a même des ouvrages probablement supposés sous tous ces noms, dont quelques modernes ont rempli les bibliotheques, & qui passent pour des réveries d'auteurs ignorans, ou imposteurs, ou mal-intentionnés. Voyez les Mém. de l'Acad. des bell. Lettr. tom. VI. pag. 32. tom. VIII. pag. 18. Sgambat. archiv. veter. testam. Fabricius cod. pseudepig. veter. testam. passim. Heuman, via ad hist. litt. c. iij. parag. III. pag. 29.
Le livre d'Enoch est même cité dans l'épître de S. Jude, vers. 14. & 15. sur quoi quelques-uns se fondent pour prouver la réalité des livres avant le déluge. Mais le livre que cite cet apôtre est regardé par les auteurs anciens & modernes, comme un livre imaginaire, ou du moins apocryphe. Voyez Saalbach. sched. de libr. vet. parag. 42. Reimm. idea syst. ant. litter. pag. 233.
Les Poëmes d'Homere sont de tous les livres profanes, les plus anciens qui soient passés jusqu'à nous. Et on les regardoit comme tels dès le tems de Sextus Empiricus, Voyez Fabric. bibl. graec. lib. I. c. j. part. I. tom. I. pag. 1. quoique les auteurs grecs fassent mention d'environ soixante-dix livres antérieurs à ceux d'Homere, comme les livres d'Hermès, d'Orphée, de Daphné, d'Horus, de Linus, de Musée, de Palamede, de Zoroastre, &c. mais il ne nous reste pas le moindre fragment de la plûpart de ces livres, ou ce qu'on nous donne pour tel est généralement regardé comme supposé. Le P. Hardouin a porté ses prétentions plus loin, en avançant que tous les anciens livres, tant grecs que latins, excepté pourtant Ciceron, Pline, les géorgiques de Virgile, les satyres & les épîtres d'Horace, Hérodote & Homère, avoient été supposés dans le treizieme siecle par une société de savans, sous la direction d'un certain Severus Archontius. Harduini de numm. herodiad. in prolus. Act. erud. Lips. ann. 1710. pag. 170.
On remarque que les plus anciens livres des Grecs sont en vers ; Hérodote est le plus ancien de leurs auteurs qui ait écrit en prose, & il étoit de quatre cent ans postérieur à Homere. Le même usage se remarque presque chez toutes les autres nations, & donne pour ainsi parler, le droit d'aînesse à la poésie sur la prose, au moins dans les monumens publics. Voyez Struv. geogr. lib. I. Heuman lib. cit. parag. 20. pag. 50. parag. 21. pag. 52. Voyez aussi l'article POESIE.
On s'est beaucoup plaint de la multitude prodigieuse des livres, qui est parvenue à un tel degré, que non-seulement il est impossible de les lire tous, mais même d'en savoir le nombre & d'en connoître les titres. Salomon se plaignoit il y a trois mille ans de ce qu'on composoit sans fin des livres ; les savans modernes ne sont ni plus retenus, ni moins féconds que ceux de son tems. Il est plus facile, dit un des premiers, d'épuiser l'océan que le nombre prodigieux de livres, & de compter les grains de sable, que les volumes qui existent. On ne pourroit pas lire tous les livres, dit un autre, quand même on auroit la conformation que Mahomet donne aux habitans de son paradis, où chaque homme aura 70000 têtes, chaque tête 70000 bouches, dans chaque bouche 70000 langues, qui parleront toutes 70000 langages différens. Mais comment ce nombre s'augmente-t-il ? Quand nous considérons la multitude de mains qui sont employées à écrire, la quantité de copistes répandus dans l'orient, occupés à transcrire, le nombre presqu'infini de presses qui roulent dans l'occident ; il semble étonnant que le monde puisse suffire à contenir ce que produisent tant de causes. L'Angleterre est encore plus remplie de livres qu'aucun autre pays, puisqu' outre ses propres productions, elle s'est enrichie depuis quelques années de celles des pays voisins. Les Italiens & les François se plaignent, que leurs meilleurs livres sont enlevés par les étrangers. Il semble, disent-ils, que c'est le destin des provinces qui composoient l'ancien empire romain, que d'être en proie aux nations du nord. Anciennement elles conquéroient un pays & s'en emparoient ; présentement elles ne vexent point les habitans, ne ravagent point les terres, mais elles en emportent les sciences. Commigrant ad nos quotidiè callidi homines, pecuniâ instructissimi, & praeclaram illam musarum supellectilem, optima volumina nobis abripiunt ; artes etiam ac disciplinas paulatim abducturi aliò, nisi studio & diligentiâ resistatis. Voyez Barthol. de libr. legend. dissertat. 5. pag. 7. Heuman, via ad histor. litter. c. vj. parag. 43. pag. 338. Facciol. orat. 1. mem. de Trev. ann. 1730. pag. 1793.
Les livres élémentaires semblent être ceux qui se sont le moins multipliés, puisqu'une bonne grammaire ou un dictionnaire, ou des institutions en quelque genre que ce soit, sont rarement suivis d'un double dans un ou même plusieurs siecles. Mais on a observé qu'en France seulement, dans le cours de trente ans, il a paru cinquante nouveaux livres d'élémens de Géométrie, plusieurs traités d'Algebre, d'Arithmétique, d'Arpentage, & dans l'espace de quinze années on a mis au jour plus de cent grammaires, tant françoises que latines, des dictionnaires, des abrégés, des méthodes, &c. à proportion. Mais tous ces livres sont remplis des mêmes idées, des mêmes découvertes, des mêmes vérités, des mêmes faussetés. Mém. de Trév. année 1734. page 804.
Heureusement on n'est pas obligé de lire tout ce qui paroît. Graces à Dieu, le plan de Caramuel qui se proposoit d'écrire environ cent volumes in-folio, & d'employer le pouvoir spirituel & temporel des princes, pour obliger leurs sujets à les lire, n'a pas réussi. Ringelberg avoit aussi formé le dessein d'écrire environ mille volumes différens. Voyez M. Baillet, enfans célébres, sect. 12. jug. des sav. tom. V. part. I. pag. 373. & il y a toute apparence, que s'il eût vécu assez long-tems pour composer tant de livres, il les eût donnés au public. Il auroit presqu'égalé Hermès Trismégiste, qui, selon Jamblique, écrivit trente-six mille cinq cent vingt-cinq livres : supposé la vérité du fait, les anciens auroient eu infiniment plus de raison que les modernes, de se plaindre de la multitude des livres.
Au reste de tous ceux qui existent, combien peu méritent d'être sérieusement étudiés ? Les uns ne peuvent servir qu'occasionnellement, les autres qu'à amuser les lecteurs. Par exemple, un mathématicien est obligé de savoir ce qui est contenu dans les livres de Mathématique ; mais une connoissance générale lui suffit, & il peut l'acquérir aisément en parcourant les principaux auteurs, afin de pouvoir les citer au besoin ; car il y a beaucoup de choses qui se conservent mieux par le secours des livres, que par celui de la mémoire. Telles sont les observations astronomiques, les tables, les regles, les théoremes, &c. qui, quoiqu'on en ait eu connoissance, ne s'impriment pas dans le cerveau, comme un trait d'histoire ou une belle pensée. Car moins nous chargeons la mémoire de choses, & plus l'esprit est libre & capable d'invention. Voyez Cartes. Epist. à Hogel. apud Hook, phil. collect. n °. 5. p. 144. & suiv.
Ainsi un petit nombre de livres choisis est suffisant. Quelques-uns en bornent la quantité au seul livre de la bible, comme contenant toutes les sciences. Et les Turcs se réduisent à l'alcoran. Cardan croit que trois livres suffisent à une personne qui ne fait profession d'aucune science, savoir, une vie des saints & des autres hommes vertueux, un livre de poésie pour amuser l'esprit, & un troisieme qui traite des régles de la vie civile. D'autres ont proposé de se borner à deux livres pour toute étude ; savoir l'écriture, qui nous apprend ce que c'est que Dieu, & le livre de la création, c'est-à-dire, cet univers qui nous découvre son pouvoir. Mais toutes ces régles, à force de vouloir retrancher tous les livres superflus, donnent dans une autre extrêmité, & en retranchent aussi de nécessaires. Il s'agit donc dans le grand nombre de choisir les meilleurs, & parce que l'homme est naturellement avide de savoir, ce qui paroît superflu en ce genre peut à bien des égards avoir son utilité. Les livres par leur multiplicité nous forcent en quelque sorte à les lire, ou nous y engagent pour peu que nous y ayons de penchant. Un ancien pere remarque que nous pouvons retirer cet avantage de la quantité des livres écrits sur le même sujet : que souvent ce qu'un lecteur ne saisit pas vivement dans l'un, il peut l'entendre mieux dans un autre. Tout ce qui est écrit, ajoute-t-il, n'est pas également à la portée de tout le monde, peut-être ceux qui liront mes ouvrages comprendront mieux la matiere que j'y traite, qu'ils n'auroient fait dans d'autres livres sur le même sujet. Il est donc nécessaire qu'une même chose soit traitée par différens écrivains, & de différentes manieres ; quoiqu'on parte des mêmes principes, que la solution des difficultés soit juste, cependant ce sont différens chemins qui menent à la connoissance de la vérité. Ajoutons à cela, que la multitude des livres est le seul moyen d'en empêcher la perte ou l'entiere destruction. C'est cette multiplicité qui les a préservés des injures du tems, de la rage des tyrans, du fanatisme des persécuteurs, des ravages des barbares, & qui en a fait passer au moins une partie jusqu'à nous, à-travers les longs intervalles de l'ignorance & de l'obscurité.
Solaque non norunt haec monumenta mori.
Voyez Bacon,de augment. Scient. lib. I. t. III. pag. 49. S. Augustin. de Trinit. lib. I. c. iij. Barthol. de lib. legend. dissertat. I. pag. 8. & suiv.
A l'égard du choix & du jugement que l'on doit faire d'un livre, les auteurs ne s'accordent pas sur les qualités nécessaires pour constituer la bonté d'un livre. Quelques-uns exigent seulement d'un auteur qu'il ait du bon sens, & qu'il traite son sujet d'une maniere convenable. D'autres, comme Salden, desirent dans un ouvrage la solidité, la clarté & la concision ; d'autres l'intelligence & l'exactitude. La plûpart des critiques assurent qu'un livre doit avoir toutes les perfections dont l'esprit humain est capable : en ce cas y auroit-il rien de plus rare qu'un bon livre ? Les plus raisonnables cependant conviennent qu'un livre est bon quand il n'a que peu de défauts : optimus ille qui minimis urgetur vitiis ; ou du-moins dans lequel les choses bonnes ou intéressantes excedent notablement les mauvaises ou les inutiles. De même un livre ne peut point être appellé mauvais, quand il s'y rencontre du bon à-peu-près également autant que d'autres choses. Voyez Baillet, jug. des scav. t. I. part. I. c. vj. p. 19. & suiv. Honoré, reflex. sur les regles de crit. dissert. 1.
Depuis la décadence de la langue latine, les auteurs semblent être moins curieux de bien écrire que d'écrire de bonnes choses ; desorte qu'un livre est communément regardé comme bon, s'il parvient heureusement au but que l'auteur s'étoit proposé, quelques fautes qu'il y ait d'ailleurs. Ainsi un livre peut être bon, quoique le style en soit mauvais ; par conséquent un historien bien informé, vrai & judicieux ; un philosophe qui raisonne juste & sur des principes sûrs ; un théologien orthodoxe, & qui ne s'écarte ni de l'Ecriture, ni des maximes de l'Eglise primitive, doivent être regardés comme de bons auteurs, quoique peut-être on trouve dans leurs écrits des défauts dans des matieres peu essentielles, des négligences, même des défauts de style. Voyez Baillet, jug. des sav. t. I. c. vij. p. 24. & suiv.
Ainsi plusieurs livres peuvent être considérés comme bons & utiles, sous ces diverses manieres de les envisager, desorte que le choix semble être difficile, non pas tant par rapport aux livres qu'on doit choisir, que par rapport à ceux qu'il faut rejetter. Pline l'ancien avoit coutume de dire qu'il n'y avoit point de livre quelque mauvais qu'il fût, qui ne renfermât quelque chose de bon : nullum librum tam malum esse, qui non aliquâ ex parte prosit. Mais cette bonté a des degrés, & dans certains livres elle est si médiocre qu'il est difficile de s'en ressentir ; elle est ou cachée si profondément, ou tellement étouffée par les mauvaises choses, qu'elle ne vaut pas la peine d'être recherchée. Virgile disoit qu'il tiroit de l'or du fumier d'Ennius ; mais tout le monde n'a pas le même talent, ni la même dextérité. Voyez Hook, collect. n. 5. pag. 127 & 135. Pline, epist. 5. l. III. Reimman, bibl. acroam. in praesat. parag. 7. pag. 8. & suiv. Sacchin, de ration. lib. legend. c. iij. pag. 10 & suiv.
Ceux-là semblent mieux atteindre à ce but, qui recommandent un petit nombre des meilleurs livres, & qui conseillent de lire beaucoup, mais non pas beaucoup de choses ; multum legere, non multa. Cependant après cet avis, la même question revient toujours comment faire ce choix ? Pline, epist. 9. l. VII.
Ceux qui ont établi des regles pour juger des livres, nous conseillent d'en observer le titre, le nom de l'auteur, de l'éditeur, le nom des éditions, les lieux & les années où elles ont paru, ce qui dans les livres anciens est souvent marqué à la fin, le nom de l'imprimeur, sur-tout si c'en est un célebre. Ensuite il faut examiner la préface & le dessein de l'auteur ; la cause ou l'occasion qui le détermine à écrire ; quel est son pays, car chaque nation a son génie particulier. Barth. diss. 4. pag. 19. Baillet, c. vij. p. 228 & suiv. Les personnes par l'ordre desquelles l'ouvrage a été composé, ce qu'on apprend quelquefois par l'épître dédicatoire. Il faut tâcher de savoir quelle étoit la vie de l'auteur, sa profession, son rang ; si quelque chose de remarquable a accompagné son éducation, ses études, sa maniere de vivre ; s'il étoit en commerce de lettres avec d'autres savans ; quels éloges on lui a donné (ce qui se trouve ordinairement au commencement du livre). On doit encore s'informer si son ouvrage a été critiqué par quelque écrivain judicieux. Si le dessein de l'ouvrage n'est pas exposé dans la préface, on doit passer à l'ordre & à la disposition du livre ; remarquer les points que l'auteur a traités ; observer si le sentiment & les choses qu'il expose sont solides ou futiles, nobles ou vulgaires, fausses ou puisées dans le vrai. On doit pareillement examiner si l'auteur suit une route déja frayée, ou s'il s'ouvre des chemins nouveaux, inconnus ; s'il établit des principes jusqu'alors ignorés ; si sa maniere d'écrire est une dichotomie ; si elle est conforme aux regles générales du style, ou particulier & propre à la matiere qu'il traite. Struv. introd. ad notit. rei litter. c. v. parag. 2. p. 338. & suiv.
Mais on ne peut juger que d'un très petit nombre de livres par la lecture, vû d'une part la multitude immense des livres, & de l'autre l'extrême briéveté de la vie. D'ailleurs il est trop tard pour juger d'un livre d'attendre qu'on l'ait lu d'un bout à l'autre. Quel tems ne s'exposeroit-on pas à perdre par cette patience ? Il paroît donc nécessaire d'avoir d'autres indices, pour juger d'un livre même sans l'avoir lu en entier. Baillet, Stollius & plusieurs autres, ont donné à cet égard des regles, qui n'étant que des présomptions & conséquemment sujettes à l'erreur, ne sont néanmoins pas absolument à mépriser. Les journalistes de Trévoux disent que la méthode la plus courte de juger d'un livre, c'est de le lire quand on est au fait de la matiere, ou de s'en rapporter aux connoisseurs. Heuman dit à-peu-près la même chose, quand il assure que la marque de la bonté d'un livre, est l'estime que lui accordent ceux qui possedent le sujet dont il traite, sur-tout s'ils ne sont ni gagés pour le préconiser, ni ligués avec l'auteur, ni intéressés par la conformité de religion ou d'opinions systématiques. Budd. de criteriis boni libri passim. Wate, hist. critic. ling. lat. c. viij. pag. 320. Mém. de Trev. ann. 1752. art. 17. Heuman, comp. dup. litter. c. vj. part. 11. pag. 280 & suiv.
Disons quelque chose de plus précis. Les marques plus particulieres de la bonté d'un livre, sont
1°. Si l'on sait que l'auteur excelle dans la partie absolument nécessaire pour bien traiter tel ou tel sujet qu'il a choisi, ou s'il a déja publié quelqu'ouvrage estimé dans le même genre. Ainsi l'on peut conclure que Jules-César entendoit mieux le métier de la guerre que P. Ramus ; que Caton, Palladius & Columelle savoient mieux l'Agriculture qu'Aristote, & que Ciceron se connoissoit en éloquence tout autrement que Varron. Ajoûtez qu'il ne suffit pas qu'un auteur soit versé dans un art, qu'il faut encore qu'il possede toutes les branches de ce même art. Il y a des gens par exemple, qui excellent dans le droit civil, & qui ignorent parfaitement le Droit public. Saumaise, à en juger par ses exercitations sur Pline, est un excellent critique, & paroit très-inférieur à Milton dans son livre intitulé defensio regia.
2°. Si le livre roule sur une matiere qui demande une grande lecture, on doit présumer que l'ouvrage est bon, pourvû que l'auteur ait eu les secours nécessaires, quoiqu'on doive s'attendre à être accablé de citations, sur-tout, dit Struvius, si l'auteur est jurisconsulte.
3°. Un livre, à la composition duquel un auteur a donné beaucoup de tems, ne peut manquer d'être bon. Villalpand, par exemple, employa quarante ans à faire son commentaire sur Ezéchiel ; Baronius en mit trente à ses annales ; Gousset n'en fut pas moins à écrire ses commentaires sur l'hébreu, & Paul Emile son histoire. Vaugelas & Lamy en donnerent autant, l'un à sa traduction de Quinte-Curce, l'autre à son traité du temple. Em. Thesaurus fut quarante ans à travailler son livre intitulé idea argutae dictionis, aussi-bien que le Jésuite Carra, à son poëme appellé colombus. Cependant ceux qui consacrent un tems si considérable à un même sujet, sont rarement méthodiques & soutenus, outre qu'ils sont sujets à s'affoiblir & à devenir froids ; car l'esprit humain ne peut pas être tendu si long-tems sur le même sujet sans se fatiguer, & l'ouvrage doit naturellement s'en ressentir. Aussi a-t-on remarqué que dans les masses volumineuses, le commencement est chaud, le milieu tiede, & la fin froide : apud vastorum voluminum autores, principia fervent, medium tepet, ultima frigent. Il faut donc faire provision de matériaux excellens, quand on veut traiter un sujet qui demande un tems si considérable. C'est ce qu'observent les écrivains espagnols, que cette exactitude distingue de leurs voisins. Le public se trempe rarement dans les jugemens qu'il porte sur les auteurs, à qui leurs productions ont coûté tant d'années, comme il arriva à Chapelain qui mit trente ans à composer son poëme de la Pucelle, ce qui lui attira cette épigramme de Montmaur.
Illa Capellani dudum expectata puella
Post tanta in lucem tempora prodit anus.
Quelques-uns, il est vrai, ont poussé le scrupule à un excès misérable, comme Paul Manuce, qui employoit trois ou quatre mois à écrire une épître, & Isocrate qui mit trois olympiades à composer un panégyrique. Quel emploi ou plutôt quel abus du tems !
4°. Les livres qui traitent de doctrine, & sont composés par des auteurs impartiaux & desintéressés, sont meilleurs que les ouvrages faits par des écrivains attachés à une secte particuliere.
5°. Il faut considérer l'âge de l'auteur. Les livres qui demandent beaucoup de soin, sont ordinairement mieux faits par de jeunes gens que par des personnes avancées en âge. On remarque plus de feu dans les premiers ouvrages de Luther, que dans ceux qu'il a donné sur la fin de sa vie. Les forces s'énervent avec l'âge ; les embarras d'esprit augmentent ; quand on a déja vécu un certain tems, on se confie trop à son jugement, on néglige de faire les recherches nécessaires.
6°. On doit avoir égard à l'état & à la condition de l'auteur. Ainsi l'on peut regarder comme bonne une histoire dont les faits sont écrits par un homme qui en a été témoin oculaire, ou employé aux affaires publiques ; ou qui a eu communication des actes publics ou autres monumens authentiques, ou qui a écrit d'après des mémoires sûrs & vrais, ou qui est impartial, & qui n'a été ni aux gages des grands, ni honoré, c'est-à-dire corrompu par les bienfaits des princes. Ainsi Salluste & Cicéron étoient très-capables de bien écrire l'histoire de la conjuration de Catilina, ce fameux évenement s'étant passé sous leurs yeux. De même Davila, Comines, Guichardin, Clarendon, &c. qui étoient présens à ceux qu'ils décrivent. Xénophon, qui fut employé dans les affaires publiques à Sparte, est un guide sûr pour tout ce qui concerne cette république. Amelot de la Houssaye, qui a vécu longtems à Venise, a été très-capable de nous découvrir les secrets de la politique de cet état. Cambden a écrit les annales de son tems. M. de Thou avoit des correspondances avec les meilleurs écrivains de chaque pays. Puffendorf & Rapin Toyras ont eu communication des archives publiques. Ainsi dans la Théologie morale & pratique on doit considérer davantage ceux qui sont chargés des fonctions pastorales & de la direction des consciences, que les auteurs purement spéculatifs & sans expérience. Dans les matieres de Littérature, on doit présumer en faveur des écrivains qui ont eu la direction de quelque bibliotheque.
7°. Il faut faire attention au tems & au siecle où vivoit l'auteur, chaque âge, dit Barclai, ayant son génie particulier. Voyez Barthol. de lib. legend. dissert. pag. 45. Struv. lib. cit. c. v. parag. 3. pag. 390. Budd. dissert. de crit. boni libri, parag. 7. p. 7. Heuman. comp. reip. litter. p. 152. Struv. lib. cit. parag. 4. pag. 393. Miscell. Lips. tom. 3. pag. 287. Struv. lib. cit. par. 5. pag. 396. & suiv. Baillet, ch. x. pag. & ch. ix. pag. 378. Id. c. 1. pag. 121 & suiv. Barthol. dissert. 2. pag. 3. Struv. parag. 6. pag. 46. & parag. 15. pag. 404 & 430. Heuman. Via ad histor. litter. c. vij. parag. 7. pag. 356.
Quelques-uns croient qu'on doit juger d'un livre d'après sa grosseur & son volume, suivant la regle du grammairien Callimaque ; que plus un livre est gros, & plus il est rempli de mauvaises choses, . Voyez Barthol. lib. cit. Dissert. 3. pag. 62 & suiv. & qu'une seule feuille des livres des sibylles étoit préférable aux vastes annales de Volusius. Cependant Pline est d'une opinion contraire, & qui souvent se trouve véritable ; savoir, qu'un bon livre est d'autant meilleur qu'il est plus gros, bonus liber melior est quisque, quo major. Plin. epist. 20. lib. I. Martial nous enseigne un remede fort aisé contre l'immensité d'un livre, c'est d'en lire peu.
Si nimius videar, serâque coronide longus
Esse liber, legito pauca, libellus ero.
Ainsi la briéveté d'un livre est une présomption de sa bonté. Il faut qu'un auteur soit ou bien ignorant, ou bien stérile, pour ne pouvoir pas produire une feuille, ni dire quelque chose de curieux, ni écrire si peu de lignes d'une maniere intéressante. Mais il faut bien d'autres qualités pour se soutenir également, soit dans les choses, soit dans le style, dans le cours d'un gros volume : aussi dans ceux de cette derniere espece un auteur est sujet à s'affoiblir, à sommeiller, à dire des choses vagues ou inutiles. Dans combien de livres rencontre-t-on d'abord un préambule assommant, & une longue file de mots superflus avant que d'en venir au sujet ? Ensuite, & dans le cours de l'ouvrage, que de longueurs & de choses uniquement placées pour le grossir ! C'est ce qui se rencontre plus rarement dans un ouvrage court où l'auteur doit entrer d'abord en matiere, traiter chaque partie vivement, & attacher également le lecteur par la nouveauté des idées, & par l'énergie ou les graces du style ; au lieu que les meilleurs auteurs mêmes qui composent de gros volumes, évitent rarement les détails inutiles, & qu'il est comme impossible de n'y pas rencontrer des expressions hazardées, des observations & des pensées rebattues & communes. Voy. le Spectateur d'Adisson, n. 124.
Voyez ce qui concerne les livres dans les auteurs qui ont écrit sur l'histoire littéraire, les bibliotheques, les Sciences, les Arts, &c. sur-tout dans Salden. Christ. Liberius, id est Guil. Saldenus, , sive de libr. scrib. & leg. Hutrecht 1681 in-12 & Amsterdam 1688 in-8°. Struvius, introd. ad hist. litter. c. v. parag. 21. pag. 454. Barthol. de lib. legend. 1671. in-8°. & Francof. 1711. in-12. Hodannus, dissert. de lib. leg. Hanov. 1705. in-8°. Sacchinus, de ratione libros cum profectu legendi. Lips. 1711. Baillet, jugement des Savans sur les principaux ouvrages des auteurs, tome I. Buddeus, de criteriis boni libri. Jenae 1714. Saalbach, schediasma, de lib. veterum, griphis. 1705. in-4°. Fabricius, bibl. ant. c. xix. part. VII. p. 607. Reimman, idea system. antiq. litter. pag. 229 & suiv. Gab. Putherbeus, de tollendis & expurgandis malis libris, Paris. 1549. in-8°. Struvius, lib. cit. c. viij. p. 694 & suiv. Théophil. Raynaud, cromata de bonis & malis libris, Lyon 1683. in-4°. Morhof, poly-histor. litter. l. I. c. xxxvj. n. 28. p. 117. Schufner, dissert. acad. de multitud. libror. Jenae, 1702 in-4°. Lauffer, dissert. advers. nimiam libr. multitud. Voyez aussi le journal des savans, tome XV, pag. 572. chr. got. Schwartz, de or. lib. apud veter. Lips. 1705 & 1707. Reimm. idea system. ant. litter. p. 335. Crenius, de libr. scriptor. optimis & utilis. Lugd. Batav. 1704. in-8°, dont on a donné un extrait dans les acta erudit. Lips. ann. 1704. p. 526 & suiv. On peut aussi consulter divers autres auteurs qui ont écrit sur la même matiere.
Censeur de livres. Voyez CENSEUR.
Privileges de livres. Voyez PRIVILEGE.
Le mot livres signifie particulierement une division ou section de volume. Voyez SECTION. Ainsi l'on dit le livre de la genese, le premier livre des rois, les cinq livres de Moïse qui sont autant de parties de l'ancien testament. Le premier, le second, le vingtieme, le trentieme livre de l'histoire de M. de Thou. Le digeste contient cinquante livres, & le code en renferme douze. On divise ordinairement un livre en chapitres, & quelquefois en sections ou en paragraphes. Les écrivains exacts citent les chapitres & les livres. On se sert aussi du mot livre, pour exprimer un catalogue qui renferme le nom de plusieurs personnes. Tels étoient parmi les anciens les livres des censeurs, libri censorii. C'étoient des tables ou registres qui contenoient les noms des citoyens dont on avoit fait le dénombrement, & particulierement sous Auguste. Tertullien nous apprend que dans ce livre censorial d'Auguste, on trouvoit le nom de Jesus-Christ. Voyez Tertull. contr. marcion. lib. IV. cap. vij. de censu Augusti quem testem fidelissimum dominicae nativitatis romana archiva custodiunt. Voyez aussi Lomeier de bibliot. p. 104. Pitisc. l. ant. tom. 2. p. 84. & le mot DENOMBREMENT.
LIVRE, en terme de Commerce, signifie les différens registres dans lesquels les marchands tiennent leurs comptes. Voyez COMPTE. On dit, les livres d'un tel négociant sont en bon ordre. Effectivement les commerçans ne pourroient savoir l'état de leurs affaires, s'ils ne tenoient de pareils livres, & d'ailleurs ils y sont obligés par les lois. Mais ils en font plus ou moins d'usage, à proportion du détail plus ou moins grand de leur débit, ou selon la diverse exactitude que demande leur commerce. Voyez Savari, Dict. de Commerc. tom. II. p. 569. au mot LIVRE.
Les anciens avoient aussi leurs livres de comptes, témoin le codex accepti & expensi, dont il est si souvent fait mention dans les écrivains romains ; & leurs livres patrimoniaux, libri patrimoniorum, qui contenoient le détail de leurs rentes, terres, esclaves, troupeaux, du produit qu'ils en retiroient, des mises & frais que tout cela exigeoit.
Quant aux livres de compte des négocians, pour mieux concevoir la maniere de tenir ce livre, il faut observer que quand une partie a un grand nombre d'articles, il faut en avoir un état séparé & distinct du grand livre. Il faut que cet état séparé soit conforme en tout à celui du grand livre, tant pour les dettes que pour les créances ; que tous les articles portés sur l'un, soient portés sur l'autre, & dans les mêmes termes ; & continuer par la suite, jusqu'à-ce que le compte soit soldé ; de porter toutes les semaines les nouveaux articles du petit état sur le grand livre, observant de dater tous les articles. Cette attention est nécessaire pour parvenir au balancé du compte total. Au moyen de quoi on trouve tous les articles concernant la même partie ; attendu qu'ils se trouvent tous portés de suite sur le grand livre, dont il est d'usage d'employer toujours le même folio au même compte, & de ne point passer au second, que ce premier ne soit rempli. Voyez Savar. liv. cit. p. 571. & seq. Malc. c. ij. sect. ij. p. 54.
Le livre d'envoi est celui qu'on tient séparément, pour éviter les ratures fréquentes qu'il faudroit faire sur le journal, si on y portoit confusément tous les articles reçus, envoyés ou vendus. Ce registre particulier fait aussi qu'on trouve plus aisément qu'on ne feroit dans le grand livre. Or les envois qu'on porte sur ce registre, sont de marchandises achetées & envoyées pour le compte d'un autre, de marchandises vendues par commission, de marchandises envoyées pour être vendues pour notre compte, de marchandises vendues en société, dont nous avons la direction, ou dont d'autres l'ont.
Ce livre contient article par article, dans l'ordre qu'ils ont été fournis, un état de toutes les marchandises qu'un marchand embarque ou pour son compte, ou en qualité de commissionnaire pour celui d'un autre, conforme au connoissement, & de tous les frais faits jusqu'à l'embarquement.
En ce cas, le livre d'envoi n'est qu'une copie de ce qui est écrit sur le grand livre. Après avoir daté ou énoncé l'envoi de cette maniere : embarqué sur tel vaisseau, partant pour tel endroit, les marchandises suivantes, consignées à N. pour notre compte ou par mon ordre, à N. ou bien on le commence par ces mots : envoi des marchandises embarquées, &c. Voyez Malc. loco suprà citato, cap. ij. sect. iij. p. 62.
Le livre d'un facteur ou courtier est celui sur lequel il tient un état des marchandises qu'il a reçues d'autres personnes pour les vendre, & de l'emploi qu'il en a fait. Ce livre doit être chiffré & distingué par folio, comme le grand livre. A gauche est écrit dans un style énonciatif, simple, un état des marchandises reçues, & des charges & conditions ; & à droite, celui de la vente & de l'emploi desdites marchandises ; ensorte que ceci n'est qu'une copie du compte d'emploi des marchandises porté au grand livre. Si le marchand fait peu de commissions, il peut se passer d'avoir un livre exprès pour cette partie. Voyez Malc. loc. cit. p. 63. Savar. p. 575.
Livre de comptes courans, contient comme le grand livre, un état des dettes tant actives que passives, & sert pour régler avec ses correspondans, avant de porter la clôture de leurs comptes sur le grand livre. C'est proprement un duplicata des comptes courans, qu'on garde pour y avoir recours dans le besoin.
Livre d'acceptations est celui sur lequel sont enregistrées toutes les lettres de change dont on a été prévenu par des lettres d'avis de la part de ses correspondans, à l'effet de savoir lorsqu'il se présentera des lettres de change, si l'on a des ordres pour les accepter ou non. Quand on prend le parti de ne point accepter une lettre de change, on met à côté de l'article où elle est couchée, un P, qui veut dire protestée ; si au contraire on l'accepte, on met à côté de l'article un A, ajoutant la date du jour de l'acceptation ; & lorsqu'on a transporté cet article sur le livre des dettes, on l'efface sur celui-ci.
Livre de remise, est celui sur lequel on enregistre les lettres de change qu'on envoie à ses correspondans, pour en tirer le montant. Si elles ont été protestées faute d'acceptation, & qu'elles soient revenues à celui qui les avoit envoyées, on en fait mention à côté de chaque article, en ajoutant un P en marge, & la date du jour qu'elles sont revenues. Dans la suite on les raye.
Les livres d'acceptation & de remise ont tant de rapport l'un à l'autre, que bien des marchands n'en font qu'un des deux qu'ils chargent en dettes & en remises, mettant les acceptations du côté des dettes, & les remises du côté des créances.
Livre de dépense, est un état des petites dépenses & achats pour les usages domestiques, dont on fait le total à la fin de chaque mois, pour le porter sur un livre consacré à cet usage. Voyez Savary, p. 577.
Ce livre joint aux différens livres particuliers de commerce, sert à marquer la perte ou le profit qu'on a fait. Il faut placer seuls les articles considérables ; mais pour les petits articles de dépense journaliere, on peut n'en mettre que les montans, quoique dans le fond chacun détaille plus ou moins les articles selon qu'il lui plaît. Ce qu'il faut seulement observer ici, qu'à mesure que les articles de ce livre sont soldés, il faut les porter sur un registre particulier, & ce qui en résulte de profit ou de perte sur le grand livre. Voyez Malc. loc. cit. p. 54.
Livre des marchandises. Ce livre est nécessaire pour savoir ce qui est entré dans le magasin, ce qui en est sorti, & ce qui y est encore. A gauche on détaille la quantité, la qualité, & le nombre ou la marque de chacune des marchandises qui y est entrée ; & à droite, vis-à-vis de chaque article, ce qui en est sorti de chacun, de cette maniere :
Livre par mois. Ce livre est chiffré par folio, comme le grand livre, & partagé en plusieurs espaces, en tête de chacun desquels est le nom d'un des mois de l'année, en suivant l'ordre naturel, laissant pour chaque mois autant d'espace que vous jugerez nécessaire. A gauche vous mettrez les payemens qui vous doivent être faits dans le mois, & à droite, ceux que vous avez à faire. Vous réserverez à gauche de chaque page une colonne où vous écrirez le jour du payement, & ensuite le nom du débiteur ou créancier, & vous mettrez la somme dans les colonnes à argent. Voyez Malc. p. 64.
Livre de vaisseaux. On en tient un particulier pour chaque vaisseau, qui contient un état des dettes & des créances. Dans la colonne des dettes on met l'avitaillement, l'équipement du vaisseau, & les gages des matelots. Du côté des créances, tout ce que le vaisseau a produit par le fret ou autrement. Ensuite après avoir fait un total de l'une & de l'autre, pour balancer le compte de chaque vaisseau, on le porte sur le journal.
Livre des ouvriers, est un livre que tiennent les directeurs de manufactures qui ont un grand nombre d'ouvrages dans les mains. On y tient un état de dettes & créances pour chaque ouvrier. Sous la colonne des dettes on met les matieres qu'on lui a fournies, & sous celle des créances, les ouvrages qu'il a rendus.
Livre de cargaison, ou plus communément livre de bord, est celui qui est tenu par le secrétaire ou commis du vaisseau, & qui contient un état de toutes les marchandises que porte le vaisseau, pour transporter, vendre ou échanger ; le tout conforme à ce qui est porté sur les lettres de cargaison. Voyez Savar. D. Comm. suppl. p. 965. au mot LIVRE.
Livre de banque. Ce livre est nécessaire dans les villes où il y a banque, comme Venise, Amsterdam, Hambourg, & Londres. On y tient un état des sommes qui ont été payées à la banque, ou de celles qu'on en a reçues.
Livre, sans y ajouter rien de plus, signifie ordinairement le grand livre, quelquefois le journal. C'est en ce sens qu'il faut le prendre, lorsqu'on dit : J'ai porté cette somme sur mon livre ; je vous donnerai un extrait de mon livre, &c. Voyez Savary, Dict. de comm. tom. II. p. 569. au mot LIVRE.
On appelle en Angleterre, livre de tarif, un livre qui se garde au parlement, dans lequel on voit sur quel pié les différentes marchandises doivent être taxées à la douanne. Celui qui a force de loi, a été fait l'an 12 de Charles II. & est souscrit par messire Harbottle Grimstone, pour lors président de la chambre des communes. Il y en a cependant un second qu'on ne laisse pas de suivre dans l'usage, quoiqu'il ne soit pas expressément contenu dans le premier, souscrit l'an 11 du regne de Georges I. par le chevalier Spencer Compton, pour lors président de la chambre des communes.
LIVRES, (Commerce) au pluriel s'entend en termes de commerce, de tous les registres sur lesquels les négocians, marchands & banquiers écrivent par ordre, soit en gros, soit en détail, toutes les affaires de leur négoce, & même leurs affaires domestiques qui y ont rapport.
Les marchands ne peuvent absolument se passer de ces livres ; & en France, ils sont obligés par les ordonnances d'en avoir, mais ils en ont besoin de plus ou de moins, selon la qualité du négoce & la quantité des affaires qu'ils font, ou selon la maniere dont ils veulent tenir leurs livres. On les tient ou en parties doubles, ou en parties simples. Presque tous les auteurs conviennent que ce sont les Italiens, & particuliérement les Vénitiens, les Génois & les Florentins qui ont enseignés aux autres nations la maniere de tenir les livres en parties doubles.
Pour tenir les livres en parties simples, ce qui ne convient guere qu'à des merciers ou de petits marchands qui n'ont guere d'affaires ; il suffit d'un journal & d'un grand livre, pour écrire les articles de suite, & à mesure que les affaires fournissent. Mais pour les gros négocians qui tiennent leurs livres à parties doubles, il leur en faut plusieurs, dont nous allons rapporter le nombre, & expliquer l'usage.
Les trois principaux livres pour les parties doubles, sont le mémorial, que l'on nomme aussi brouillon & quelquefois brouillard, le journal, & le grand livre, qu'on appelle autrement livre d'extrait ou livre de raison.
Outre ces trois livres, dont un négociant ne peut se passer, il y en a encore jusqu'à treize autres, qu'on nomme livres d'aides ou livres auxiliaires, dont on ne se sert qu'à proportion des affaires qu'on fait, ou selon le commerce dont on se mêle. Ces treize livres sont :
Le livre de caisse & de bordereaux.
Le livre des échéances, qu'on nomme aussi livre des mois, livre des notes ou d'annotations, ou des payemens ou quelquefois carnet.
Le livre des numeros.
Le livre des factures.
Le livre des comptes courans.
Le livre des commissions, ordres, ou avis.
Le livre des acceptations ou des traites.
Le livre des remises.
Le livre des dépenses.
Le livre des copies de lettres.
Le livre des ports-de-lettres.
Le livre des vaisseaux.
Le livre des ouvriers.
A ces treize qui pourtant peuvent suffire, on peut en ajouter d'autres, suivant la nature du commerce ou la multiplicité des affaires.
LIVRE MEMORIAL. Ce livre est ainsi nommé, à cause qu'il sert de mémoire ; on l'appelle aussi livre brouillon ou livre brouillard, parce que toutes les affaires du négoce s'y trouvent comme mêlées confusément, & pour ainsi dire, mêlées ensemble. Le livre mémorial est le premier de tous, & celui duquel se tire ensuite tout ce qui compose les autres, aussi ne peut-on le tenir avec trop d'exactitude & de netteté, sur-tout parce qu'on y a recours dans les contestations qui peuvent survenir pour cause de commerce.
Le livre mémorial peut se tenir en deux manieres : la premiere, en écrivant simplement les affaires à mesure qu'elles se font, comme acheté d'un tel, vendu à un tel, payé à un tel, prêté telle somme, &c. La seconde maniere de le tenir, est en débitant & créditant tout-d'un-coup chaque article : on estime celle-ci la meilleure, parce que formant d'abord une espece de journal, elle épargne la peine d'en faire un autre.
Quelques-uns, pour plus d'exactitude, divisent le livre mémorial en quatre autres, qui sont le livre d'achat, le livre de vente, le livre de caisse & le livre de notes. Des négocians qui suivent cet ordre, les uns portent d'abord les articles de ces quatre livres sur le grand livre, sans faire de journal ; & les autres, en mettant ces quatre livres au net, en font leur journal, dont ils portent ensuite les articles sur le grand livre.
LIVRE JOURNAL. Le nom de ce livre fait assez entendre qu'on y écrit jour par jour toutes les affaires, à mesure qu'elles se font.
Chaque article qu'on porte sur ce livre, doit être composé de sept parties, qui sont la date, le débiteur, le créancier, la somme, la quantité & qualité, l'action ou comment payable, & le prix.
Ordinairement ce livre est un registre in-folio de cinq à six mains de papier, numeroté & reglé d'une ligne du côté de la marge, & de trois de l'autre pour y tirer les sommes.
C'est du livre journal dont l'ordonnance du mois de Mars 1673 entend parler, lorsqu'elle prescrit au tit. III. art. 1. 3. & 5. que les négocians & marchands, tant en gros qu'en détail, ayent un livre qui contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives & passives, &c. & c'est aussi faute de tenir ce livre & de le représenter, que les négocians, lors des faillites, peuvent être réputés banqueroutiers frauduleux, & en conséquence poursuivis extraordinairement, & condamnés aux peines portées au tit. XI. art. 11. & 12. de la même ordonnance.
Modele d'un article du livre journal.
LIVRE GRAND. Ce livre, outre ce nom qui lui vient de ce qu'il est le plus grand de tous les livres dont se servent les négocians, en a encore deux autres, savoir livre d'extrait & livre de raison. On l'appelle livre d'extrait, à cause qu'on y porte tous les articles extraits du livre journal ; & livre de raison, parce qu'il rend raison à celui qui le tient de toutes ses affaires.
Sa forme est d'un très-gros volume in-folio, composé de plusieurs mains plus ou moins de papier très-fort, très-large & très-grand ; chaque page se regle à six lignes, deux du côté de la marge, & quatre du côté des sommes.
C'est sur ce livre qu'on forme tous les comptes en débit & crédit, dont on trouve les sujets par le livre journal. Pour former chaque compte, il faut se servir de deux pages qui, au folio où l'on veut le mettre, se trouvent opposées l'une à l'autre. La page à gauche sert pour le débit, & la page à droite pour le crédit : le débit se marque par le mot doit, que l'on met après le nom du débiteur, & le crédit par le mot avoir.
Chaque article doit être composé de cinq parties ou membres, qui sont : 1°. la date : 2°. celui à qui on débite le compte, ou par qui on le crédite : 3°. le sujet, c'est-à-dire pourquoi on le débite, ou crédite : 4°. le folio de rencontre ; & enfin 5°. la somme ou le montant de l'article.
Deux exemples, l'un d'un article de débit, l'autre d'un article de crédit, feront mieux connoître la forme & l'usage de ce livre.
Exemple d'un article en débit.
Exemple d'un article en crédit.
Pour faciliter l'usage du grand livre, on fait aussi un livre d'alphabet, que l'on nomme aussi table, index & repertoire. Cette table se forme d'autant de feuillets de papier qu'il y a de lettres dans l'alphabet commun, c'est-à-dire vingt-quatre, sur l'extrêmité de chaque feuillet découpé en diminuant, on met en gros caracteres une des lettres dans leur ordre naturel, & sur chaque feuillet ainsi marqué l'on écrit, soit la premiere lettre du nom, soit celle du surnom des personnes avec qui l'on a compte ouvert, avec le folio du grand livre où le compte est débité & crédité, desorte que l'on trouve avec beaucoup de facilité les endroits du grand livre dont on a besoin.
Cet alphabet n'est guere nécessaire que pour les gros marchands ; car, pour ceux qui ne font qu'un négoce médiocre, une simple table sur les deux premiers feuillets du grand livre leur suffit. Ce qui doit aussi s'observer dans tous les autres livres dont on se sert dans le commerce.
LIVRE DE CAISSE ET DE BORDEREAUX. C'est le premier & le plus important des treize livres, qu'on nomme livres d'aide, ou livres auxiliaires. On l'appelle livre de caisse, parce qu'il contient en débit & crédit tout ce qui entre d'argent dans la caisse d'un négociant, & tout ce qui en sort ; & livre de bordereaux, à cause que les especes de monnoie qui sont entrées dans la caisse, ou qui en sont sorties, y sont détaillées par bordereaux. Voyez BORDEREAU.
Sur ce livre que le marchand tient ou par lui même, ou par un caissier ou commis, s'écrivent toutes les sommes qui se reçoivent & se payent journellement ; la recette du côté du débit, en marquant de qui on a reçu, pour quoi, pour qui, & en quelles especes, & la dépense du côté du crédit, en faisant aussi mention des especes, des raisons du payement, & de ceux pour qui & à qui on l'a fait.
Le titre de ce livre se met en la maniere qui suit. Tous les autres livres, en changeant seulement le nom, ont aussi leur titre de même.
Livre de Caisse & de Bordereaux.
Les articles du débit & crédit se forment suivant les modeles ci-après.
Article en débit qui doit être à la page à gauche.
Article en crédit qui doit être vis-à-vis de celui ci-dessus, à la page à droite.
LIVRE DES ECHEANCES, que l'on nomme aussi livre des mois ou payemens, carnet ou bilan, & quelquefois livre d'annotation ou de notes.
C'est un livre dans lequel on écrit le jour de l'échéance de toutes les sommes que l'on a à payer ou à recevoir, soit par lettres de change, billets, marchandises, ou autrement, afin qu'en comparant les recettes & les payemens, on puisse pourvoir à tems aux fonds pour les payemens, en faisant recevoir les billets & les lettres échues, ou en prenant d'ailleurs ses précautions de bonne heure. Deux modeles suffiront pour faire comprendre toute la forme & tout l'usage de ce livre : il faut seulement observer qu'il se dresse de la même maniere que le grand livre, c'est-à-dire sur deux pages qui sont opposées l'une à l'autre ; que ce qui est à recevoir se met à la page à gauche, & ce qui est à payer s'écrit à la page à droite.
Modele de la page à gauche, pour ce qui est à recevoir.
Modele de la page à droite, pour ce qui est à payer.
LIVRE DES NUMEROS. Ce livre se tient pour connoître facilement toutes les marchandises qui entrent dans un magasin, qui en sortent ou qui y restent. Sa forme est ordinairement longue & étroite comme d'une demi-feuille de papier pliée en deux dans sa longueur : chaque page est divisée par des lignes transversales & paralleles, éloignées les unes des autres d'environ un pouce, & réglées de deux autres lignes de haut en-bas, l'une à la marge & l'autre du côté des sommes.
Pour chaque intervalle des quarrés longs que forment ces lignes, on écrit dans la page à gauche le volume des marchandises ; c'est-à-dire, si c'est une balle, une caisse ou un tonneau, ou leur qualité, comme poivre, gérofle, miel, savon, &c. & leur poids ou leur quantité ; & vis-à-vis du côté de la marge, les numeros qui sont marqués sur les balles, caisses ou tonneaux qu'on a reçus dans le magasin.
A la page droite, on suit le même ordre pour la décharge des marchandises qui sortent du magasin, en mettant vis-à-vis de chaque article de la gauche d'abord à la marge la date des jours que les marchandises sont sorties du magasin, & dans le quarré long le nom de ceux à qui elles ont été vendues ou envoyées. En voici deux modeles, l'un de la page gauche, l'autre de la page à droite.
LIVRE DES FACTURES. On tient ce livre pour ne pas embarrasser le livre journal de quantité de factures, qui sont inévitables en dressant les comptes ou factures de diverses marchandises reçues, envoyées ou vendues, où l'on est obligé d'entrer dans un grand détail. Les factures qu'on doit porter sur ce livre, sont les factures des marchandises que l'on achete, & que l'on envoie pour le compte d'autrui.
Celle des marchandises que l'on vend par commission.
Les factures des marchandises que l'on envoie en quelque lieu pour être vendues pour notre compte.
Celles des marchandises qui sont en société, dont nous avons la direction.
Les factures des marchandises qui sont en société, dont d'autres ont la direction.
Enfin, tous les comptes qu'on ne termine pas sur le champ, & qu'on ne veut pas ouvrir sur le grand livre.
LIVRE DES COMPTES COURANS. Ce livre se tient en débit & crédit de même que le grand livre. Il sert à dresser les comptes qui sont envoyés aux correspondans pour les régler de concert avec eux, avant que de les solder sur le grand livre ; & c'est proprement un double des comptes courans qu'on garde pour y avoir recours en cas de multiplicité.
LIVRE DES COMMISSIONS, ordres ou avis. On écrit sur ce livre toutes les commissions, ordres ou avis que l'on reçoit de ses correspondans.
Les marges de ce livre doivent être très-larges pour y pouvoir mettre vis-à-vis de chaque article les notes nécessaires concernant leur exécution. Quelques-uns se contentent de rayer les articles quand ils ont été exécutés.
LIVRE DES ACCEPTATIONS ou DES TRAITES. Ce livre est destiné à enregistrer toutes les lettres de change que les correspondans marquent par leurs lettres missives ou d'avis qu'ils ont tirées sur nous, & cet enregistrement se fait afin que l'on puisse être en état de connoître à la présentation des lettres, si l'on a ordre de les accepter ou non. Si on les accepte, on met sur le livre des acceptations, à côté de l'article, un A qui veut dire accepté ; si au contraire on ne les accepte pas, on met un A & un P, qui signifie à protester. Voyez ACCEPTATION & PROTEST.
LIVRE DES REMISES. C'est un livre qui sert à enregistrer toutes les lettres de change à mesure que les correspondans les remettent pour en exiger le payement. Si elles sont protestées faute d'acceptation, & renvoyées à ceux qui en ont fait les remises, il en faut faire mention à côté des articles, en mettant un P en marge & la date du jour qu'elles ont été renvoyées, puis les barrer ; mais si ces lettres sont acceptées, on met un A à côté des articles & la date des acceptations, si elles sont à quelques jours de vue.
LIVRE DE DEPENSE. C'est le livre où se mettent en détail toutes les menues dépenses qu'on sait, soit pour son ménage, soit pour son commerce, & dont au bout de chaque mois on fait un total, pour en former un article sur le mémorial ou journal.
LIVRE DES COPIES DE LETTRES. Ce livre sert à conserver des copies de toutes les lettres d'affaires qu'on écrit à ses correspondans, afin de pouvoir savoir avec exactitude, & lorsqu'on en a besoin, ce qu'on leur a écrit, & les ordres qu'on leur a donnés.
LIVRES DE PORTS DE LETTRES. C'est un petit registre long & étroit, sur lequel on ouvre des comptes particuliers à chacun de ses correspondans pour les ports de lettres qu'on a payés pour eux, & que l'on solde ensuite quand on le juge à propos, afin d'en porter le total à leur débit.
LIVRE DES VAISSEAUX. Ce livre se tient en débit & crédit, en donnant un compte à chaque vaisseau. Dans le débit se mettent les frais d'avitaillement, mises hors, gages, &c. & dans le crédit tout ce que le vaisseau a produit, soit pour fret, soit autrement, & ensuite le total de l'un & de l'autre se porte sur le journal en débitant & créditant le vaisseau.
LIVRE DES OUVRIERS. Ce livre est particulierement en usage chez les marchands qui font fabriquer des étoffes & autres marchandises. Il se tient en débit & en crédit pour chaque ouvrier qu'on fait travailler. Dans le débit, on met les matieres qu'on leur donne à fabriquer, & dans le crédit, les ouvrages qu'ils rapportent après les avoir fabriquées.
Outre tous ces livres, il y a des villes, comme Venise, Hambourg, Amsterdam, dont les marchands, à cause des banques publiques qui y sont ouvertes, ont encore besoin d'un livre de banque, qui se tient en débit & en crédit, & sur lequel ils mettent les sommes que leur paye ou que leur doit la banque ; & c'est par ce secours qu'il leur est facile en très-peu de tems de savoir en quel état ils sont avec la banque, c'est-à-dire quel fonds ils peuvent y avoir.
Tous ces livres ou écritures se tiennent presque de la même maniere pour le fond dans les principales villes de commerce de l'Europe, mais non pas par rapport aux monnoies, chacun se réglant à cet égard sur celles qui ont cours dans les états où il se trouve établi.
En France, les livres de marchands & banquiers se tiennent par livres, sols & deniers tournois, la livre valant vingt sols, & le sol douze deniers
En Hollande, Flandre, Zélande & Brabant, ils se tiennent par livres, sols & deniers de gros, que l'on somme par vingt & par douze, parce que la livre vaut vingt sols, & le sol douze deniers.
On les tient encore dans ces mêmes pays par florins, patars & penings, que l'on somme par vingt & par seize, à cause que le florin vaut vingt patars, & le patar seize penings. La livre de gros vaut six florins, & le sol de gros vaut six patars, ensorte que le florin vaut quarante deniers de gros, & le patar deux deniers de gros.
A Bergame les livres des banquiers, marchands, &c. se tiennent par livres, sols & deniers, qui se somment par vingt & par douze, parce que la livre vaut vingt sols, & le sol douze deniers, que l'on réduit ensuite en ducats de sept livres de Bergame.
A Boulogne en Italie, ils se tiennent de même par livres, sols & deniers, que l'on somme de même, & dont on fait la réduction en écus de quatre-vingt-cinq sols de Boulogne.
A Dantzic & dans toute la Pologne, ils se tiennent par richedales, gros ou grochs & deniers, qu'on somme par quatre-vingt-dix & par douze, parce que la richedale vaut quatre-vingt-dix gros, & le gros douze deniers.
On les tient aussi dans les mêmes pays par florins, gros & deniers, qui se somment par soixante & par douze, le florin valant soixante gros, & le gros douze deniers. Ils s'y tiennent encore par livres, gros & deniers, que l'on somme par trente & par douze, attendu que la livre vaut trente gros, & le gros douze deniers.
A Francfort, à Nuremberg, & presque dans toute l'Allemagne, ils se tiennent par florins, creutzer & penings ou phenings courans, que l'on somme par soixante & par huit, parce que le florin vaut soixante creutzers, & le creutzer huit penings.
On les tient encore à Francfort par florins de change, qui se somment par soixante & cinq & par huit, parce que le florin vaut soixante-cinq creutzers, & le creutzer huit penings.
A Gènes, ils se tiennent par livres, sols & deniers, qui se somment comme en France, & qui se réduisent ensuite en piastres de quatre-vingt-seize sols.
A Hambourg, on les tient par marcs, sols & deniers lubs, que l'on somme par seize & par douze, le marc valant seize sols, & le sol douze deniers lubs. On les y tient encore de la même maniere qu'en Hollande.
A Lisbonne, ils se tiennent par raies, qui se distinguent par des virgules de centaine en centaine de droite à gauche, que l'on réduit en mille raies, dont chacune de ces mille font une demi-pistole d'Espagne.
A Florence en écus, sols & deniers d'or, l'écu valant sept livres dix sols, & le sol douze deniers.
A Livourne, on les tient par livres, sols & deniers, que l'on somme par vingt & par douze, la livre y valant vingt sols, & le sol douze deniers, qu'on réduit en piastres de six livres.
En Angleterre, Ecosse & Irlande, la maniere de tenir les livres est par livres, sols & deniers sterlings, qu'on somme par vingt & par douze, la livre valant vingt sols, & le sol douze deniers sterlings.
A Madrid, à Cadix, à Séville & dans toute l'Espagne, ils se tiennent par maravedis, dont les 375 font le ducat, qui se distinguent par des virgules de gauche à droite, ou par réaux de plate & pieces de huit, dont trente-quatre maravedis font la réale, & huit réaux valent une piece de huit, ou piastre, ou réale de deux cent soixante & douze maravedis.
A Messine, à Palerme & dans toute la Sicile, on tient les livres par onces, tarins, grains & picolis, que l'on somme par trente, par vingt & par six, parce que trente tarins font une once, vingt grains un tarin, & six picolis font un grain.
A Milan, ils se tiennent par livres, sols & deniers, qu'on somme par vingt & par douze, la livre valant vingt sols, & le sol douze deniers.
A Rome, on les tient par livres, sols & deniers d'or d'estampe, que l'on somme par vingt & par douze, parce que la livre vaut vingt sols, & le sol douze deniers d'estampe.
A Venise, par ducats & gros de banque, dont les vingt-quatre gros font un ducat, ce qui se pratique particulierement pour la banque. On les y tient aussi par livres, sols & deniers de gros, qui se somment par vingt & par douze, parce que vingt sols font la livre, & douze gros le sol. Il faut remarquer que de cette seconde maniere la livre de gros vaut dix ducats. Dans la même ville, on tient encore les livres par ducats courans, qui different de vingt pour cent des ducats de banque.
A Augsbourg, en talers & en creutzers ; le taler de quatrevingt dix creutzers, & le creutzer de huit penings.
A Bolzam comme à Augsbourg, & encore en florins & en creutzers, le florin de soixante creutzers.
A Naumbourg, en richedales, gros & fenins, la richedale de vingt-quatre gros, le gros de douze fenins.
A Genève, en livres, sols & deniers, & aussi en florins. En Savoie comme à Genève.
A Raconis, en florins & en gros.
En Suisse, en florins, creutzers & penings.
A Ancone, en écus, sols, & deniers, l'écu valant vingt sols & le sol douze deniers.
A Luques, en livres, sols & deniers : on les y tient aussi en écus de 7 livres 10 sols.
A Nove, en écus, sols & deniers d'or de marc, l'écu d'or de marc valant vingt sols.
A Malte, en tarins, carlins & grains ; ils s'y tiennent encore en sequins ou, comme parlent les Maltois, en dieli-tarini.
Dans les échelles du Levant & dans tous les états du grand-seigneur, en piastres, abouquels & en aspres.
En Hongrie, en hongres & demi-hongres d'or.
A Strasbourg, en florins, creutzers & penings monnoie d'Alsace.
A Berlin & dans une partie des états du roi de Prusse, en richedales, en grochs & aussi en florins.
En Suede, en dalles d'argent & en dalles de cuivre.
En Danemark, en richedales, en ors & en schellings.
Enfin en Moscovie, en roubles, en altins & en grifs ou grives. Voyez toutes ces différentes monnoies, leur valeur & leur rapport avec les nôtres, ou sous leur titre particulier, ou à l'article MONNOIE.
LIVRE DE BORD, ce sont les registres que les capitaines ou les maîtres des vaisseaux marchands doivent tenir ou faire tenir par leur écrivain, sur lesquels ils sont obligés d'enregistrer le chargement de leurs vaisseaux, c'est-à-dire la quantité, la qualité, la destination & autres circonstances des marchandises qui composent leur cargaison.
Ces livres, avec les connoissemens, chartes parties & autres semblables papiers & expéditions, sont ce qu'on appelle les écritures d'un navire marchand, que les capitaines ou maîtres des vaisseaux sont tenus, par l'ordonnance de Février 1687, de communiquer aux commis du bureau le plus prochain du lieu où ils ont relâché, pour y justifier de la destination de leurs marchandises. Voyez CONNOISSEMENT ; CHARTE-PARTIE, ÉCRITURES.
LIVRE DE SOUBORD, terme de commerce de mer, c'est un des livres que tient l'écrivain d'un navire marchand, dans lequel il enregistre toutes les marchandises qui composent le chargement du bâtiment, soit pour le simple fret, soit pour être vendues ou troquées à mesure que la vente s'en fait dans les lieux de leur destination, ou qu'on les délivre à leur adresse : le tout suivant ce qu'il est spécifié dans le connoissement du capitaine ou du maître de navire.
L'ordre de ce livre est de mettre à part toutes les marchandises qui doivent être vendues, chacune suivant les endroits où la traite s'en doit faire, & pareillement à part toutes celles qu'on ne prend qu'à fret, aussi chacunes suivant les personnes & les lieux à qui elles sont adressées.
Il y a ordinairement à chaque page de ce livre deux colonnes à gauche & trois à droite. Dans la premiere à gauche on met la marque du ballot ou de la caisse, & dans la seconde, son numéro : vis-à-vis, on écrit le lieu où se doit faire la traite, avec les marchandises qui y sont contenues, en observant la même chose pour celles qu'on a à fret : ensuite on porte dans les trois colonnes qui sont à droite les sommes qui ont été reçues, soit pour la vente, soit pour le fret.
On observe pour l'ordinaire de mettre les premieres celles qui sont pour la traite, & ensuite celles qui sont pour le fret. Un exemple de quelques articles d'un livre de soubord fera encore mieux connoître la maniere de le tenir.
Modele d'un livre de soubord. Livre de soubord des marchandises chargées à la Rochelle le 6 Mars 1724, dans la frégate l'hirondelle, capitaine le sieur Coral, pour, Dieu aidant, les mener & délivrer aux lieux & personnes de leur destination.
Les livres de soubord ne sont proprement regardés que comme des écritures particulieres, & ne peuvent avoir la même autorité que les connoissemens, chartes-parties, factures, & autres semblables écritures pour justifier du chargement d'un vaisseau, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt du conseil d'état du roi du 21 Février 1693. Dictionnaire de Commerce, tome III. p. 167 & suiv.
LIVRE NUMERAIRE, (Monn. Comm.) monnoie fictive de compte reçue chez plusieurs peuples de l'Europe, pour la facilité du calcul & du Commerce.
Les Juifs & les Grecs ont eu, comme nos nations modernes, des monnoies imaginaires, lesquelles ne sont, à proprement parler, que des noms collectifs qui comprennent sous eux un certain nombre de monnoies réelles : c'est ainsi qu'ils se sont servis de la mine & du talent. Les Romains ont inventé le sesterce, & les François se servent de la livre, en quoi ils ont été imités par les Anglois & les Hollandois. Notre livre de compte est composée de vingt sols, qui se divisent chacun par douze deniers, mais nous n'avons point d'espece qui soit précisément de cette valeur.
Je n'ignore pas qu'il y a eu des monnoies d'or & d'argent réelles, qui ont valu justement une livre ou vingt sols, comme les francs d'or des rois Jean I. & de Charles V. ainsi que les francs d'argent de Henri III. mais ce n'a été que par hasard que ces monnoies ont été de la valeur d'une livre : car dans la suite leur prix est augmenté considérablement, ce qui n'arrive point à la livre numéraire ou fictive : elle ne change jamais de valeur. Depuis le tems de Charlemagne, c'est-à-dire depuis 780 ou environ que nous nous en servons, elle a toujours valu vingt sols & le sol douze deniers ; le prix au contraire de toutes les autres monnoies réelles ne change que trop souvent.
Il est donc vrai de dire que la livre de compte est une monnoie imaginaire, puisque nous n'avons jamais eu d'espece qui ait toujours valu constamment vingt sols ni douze deniers. Cependant si nous remontons au tems où l'on a commencé en France à compter par livres, nous trouverons que cette monnoie imaginaire doit son origine à une chose réelle.
Il faut savoir à ce sujet que pendant la premiere & la seconde race de nos rois, on ne se servoit point pour peser l'or & l'argent du poids de marc composé de huit onces, mais de la livre romaine qui en pesoit douze. Pepin ordonna qu'on tailleroit vingt-deux sols dans cette livre de poids d'argent : ce métal étant devenu plus abondant en France par les conquêtes de Charlemagne, ce prince fit faire des sols d'argent plus pesans, & on n'en tailla plus que vingt dans une livre d'argent, c'est-à-dire qu'alors vingt sols pesoient une livre de douze onces, & ce sol se divisoit comme le nôtre en douze deniers.
Depuis Charlemagne jusqu'à Philippe I. les sols ont été d'argent, & les vingt pesoient presque toujours une livre de douze onces ou approchant : desorte qu'alors le sol d'argent pesoit 345 grains. Ainsi pendant environ deux siecles, les monnoies de France resterent sur le pié ou Charlemagne les avoit mises ; petit à petit nos rois dans leurs besoins tantôt chargerent les sols d'alliage, & tantôt en diminuerent le poids : néanmoins on ne laissa pas de se servir toujours du terme de livre pour exprimer une somme de vingt sols, quoiqu'ils ne pesassent plus à beaucoup près une livre d'argent, ou qu'ils fussent chargés d'alliage. En un mot, par un changement qui est presque la honte des gouvernemens de l'Europe, ce sol qui étoit autrefois ce qu'est à-peu-près un écu d'argent, n'est plus en France qu'une legere piece de cuivre, avec un douzieme d'argent ; & la livre, qui est le signe représentatif de douze onces d'argent, n'est plus que le signe représentatif de vingt de nos sols de cuivre. Le denier qui étoit la deux cent quarantieme partie d'une livre d'argent, n'est plus que le tiers de cette vile monnoie qu'on appelle un liard. Le marc d'argent, qui sous Philippe Auguste valoit cinquante sols, vaut aujourd'hui près de cinquante livres. La même chose est arrivée au prix du marc d'or.
Si donc une ville de France devoit à une autre 120 livres de rente, c'est-à-dire 1440 onces d'argent du tems de Charlemagne, elle s'acquiteroit présentement de sa dette (supposé que cette maniere de s'acquiter ne fît pas un procès) en payant ce que nous appellons un gros écu ou un écu de six livres, qui pese une once d'argent.
La livre numéraire des Anglois & des Hollandois, a moins varié. Une livre sterling d'Angleterre vaut 22 livres de France ; & une livre de gros chez les Hollandois vaut environ 12 livres de France. Ainsi les Hollandois se sont moins écartés que les François de la loi primitive, & les Anglois encore moins.
M. de Voltaire a bien raison d'observer que toutes les fois que l'Histoire nous parle de monnoie sous le nom de livres, nous devons examiner ce que valoit la livre au tems & dans le pays dont on parle, & la comparer à la valeur de la nôtre.
Nous devons avoir la même attention en lisant l'histoire grecque & romaine, & ne pas copier nos auteurs qui, pour exprimer en monnoie de France les talens, les mines, les sesterces, se servent toujours de l'évaluation que quelques savans ont faite avant la mort de M. Colbert. " Mais le marc de huit onces qui valoit alors 26 livres & 10 sols, vaut aujourd'hui 49 livres 10 sols, ce qui fait une différence de près du double : cette différence, qui a été quelquefois beaucoup plus grande, pourra augmenter ou être réduite. Il faut songer à ces variations, sans quoi on auroit une idée très-fausse des forces des anciens états, de leur commerce, de la paie de leurs troupes, & de toute leur économie ". (D.J.)
LIVRE ROMAINE, libra, (Poids & Mesure) poids d'usage chez les Romains.
Ses parties étoient l'once, qui en faisoit la douzieme partie ; le sextans, qui pesoit deux onces, étoit la sixieme partie de la livre ; le quadrans en pesoit trois, & en étoit le quart : le triens en pesoit quatre, & en étoit le tiers ; le quincunx en pesoit cinq ; le semis six, & faisoit une demi-livre, le septunx en pesoit sept, le bes huit ; le dodrans neuf, le dextans dix, le deunx onze ; enfin l'as pesoit douze onces ou une livre.
On ne dispute point sur le sens de tous ces mots latins ; mais ce dont on n'est point assuré, c'est de la valeur de la livre romaine. Les uns y ont compté cent deniers ou cent drachmes, d'autres quatre-vingt-seize, & d'autres enfin quatre-vingt-quatre. Voilà les trois chefs auxquels on peut rapporter les principales évaluations que nos savans ont faites de la livre romaine.
Budé, dans son traité de cette livre romaine (de asse), est le premier qui a cru qu'elle pesoit cent drachmes. Cet habile homme ne manqua pas de graves autorités pour appuyer son sentiment ; & comme les deniers qu'il pesa se trouverent la plûpart du poids d'un gros, il conclut que la livre qu'il cherchoit étoit égale à douze onces & demie de la livre de Paris ; mais son hypothèse n'a point eu de progrès, parce qu'elle s'est trouvée fondée sur des observations ou peu exactes, ou manifestement contraires à la vérité.
Agricola renversa cette opinion de fond en comble, en prouvant qu'au lieu de cent drachmes il n'en falloit compter que 96 à la livre, ce qu'il établit par une foule d'autorités précises, auprès desquelles celles que Budé avoit produites ne purent se soutenir. Tout le monde sentit que la commodité d'employer un nombre entier, peu éloigné du nombre vrai, avoit fait négliger aux écrivains allégués par ce savant, une exactitude qui ne leur avoit pas paru nécessaire.
Après la chûte du système de Budé, les deux autres ont régné successivement dans l'empire littéraire. Pendant près d'un siecle, presque tout le monde a supposé la livre romaine du poids de 96 drachmes ; enfin on s'est persuadé qu'il n'y avoit que 84 deniers dans cette livre, & c'est l'hypothèse la plus commune aujourd'hui.
La premiere preuve qu'on en donne, c'est que Pline & Scribonius Largus ont assuré que la livre romaine étoit composée de 84 deniers. Celse a dit aussi qu'il y avoit 7 deniers à l'once, & l'on apprend de Galien que la même chose avoit été avancée par d'anciens medecins, dont il avoit vû les ouvrages. La seconde preuve est qu'on s'est assuré de ce que le conge, mesure d'un demi-pié cubique, pouvoit contenir d'eau. Ce vaisseau qui contenoit à ce qu'on croit 10 livres ou 120 onces romaines d'eau ou de vin, ne contient que 108 ou 109 onces de la livre de Paris : ainsi l'once de Paris est bien plus forte que celle de Rome n'a pu être, & cela sera vrai si vous ne comptez à la livre romaine que 84 deniers ; mais vous serez obligé de supposer tout le contraire, si vous donnez 96 deniers à cette livre, & 8 deniers à chacune de ses 12 onces ; car les deniers qu'on doit employer ici, & qui ont été frappés au tems de la république, pesent chacun 74 ou 75 grains, c'est-à-dire deux ou trois grains de plus que nous n'en comptons pour un gros.
M. Eisenschmid qui publia en 1708 un traité des poids & des mesures des anciens, est peut-être celui qui a mis ces preuves dans un plus grand jour ; car après avoir déterminé la valeur de l'once romaine à 423 grains de Paris, conformément à l'expérience faite à Rome par M. Auzout pour connoitre le poids d'eau que contenoit le conge, il a montré qu'en conséquence il étoit absolument nécessaire de ne compter que 7 deniers consulaires pour une once, puisque chacun de ces deniers étoit du poids de 74 à 75 grains ; & comme il auroit été un peu dur de contredire ce grand nombre d'anciens qui ont écrit qu'il y avoit 8 drachmes ou 8 deniers à l'once, il a remarqué que depuis Néron jusqu'à Septime Severe, le denier affoibli d'un huitieme ne pesa plus que 63 grains qui, multipliés par 8, en donnent 520 : de sorte qu'alors on a pu & même on a dû dire, comme on a fait, qu'il y avoit 96 deniers à la livre romaine.
Une autre observation non moins importante du même auteur, c'est qu'encore que tous les anciens aient supposé que la drachme attique & le denier romain étoient du même poids, il y a néanmoins toujours eu une différence assez considérable entre ces deux monnoies, puisque la drachme attique avoit un peu plus de 83 grains.
Cependant M. de la Barre, qui présente lui-même cette hypothèse dans toute la force qu'elle peut avoir, la combat savamment dans les mémoires des Inscriptions, & soutient que la livre romaine étoit composée de 96 deniers, & son once de 8 deniers.
1°. Parce que le conge, qui rempli d'eau contient environ 109 onces de la livre de Paris, ne contenoit en poids romains que 100 onces de vin, ce qui montre que l'once romaine étoit plus forte que la nôtre. Or il y a 8 gros à notre once, & le gros est de trois grains plus foible que n'étoit le denier romain.
2°. Parce que divers auteurs, qui vivoient avant qu'on eût affoibli à Rome les deniers d'un huitieme, ont assuré en termes exprès qu'il y en avoit 96 à la livre, & qu'ils n'en ont dit que ce que tout le monde en disoit de leur tems.
3°. Parce qu'il y en a d'autres qui ont évalué le talent en livres, après avoir comparé le poids des deniers avec celui des drachmes, & que leur évaluation se trouve vraie en donnant 96 deniers à la livre.
Il faut pourtant convenir que les autorités qu'on rapporte pour donner 84 deniers à la livre romaine au lieu de 96, sont très-fortes. Pline dit positivement que la livre avoit 84 deniers ; mais on peut répondre avec M. de la Barre, qu'il parloit de ce qu'on en délivroit à la monnoie pour une livre ; car les officiers des monnoies n'étoient pas tenus de donner une livre pesant de deniers pour une livre de matiere : il s'en falloit un huitieme, dont sans doute une partie tournoit au profit de l'état, & l'autre au profit des monnoyeurs. De plus, Pline vivoit dans un tems où l'on affoiblit les deniers d'un huitieme, & cependant il marque 8 deniers pour une once, comme on faisoit avant lui, & comme font tous nos auteurs quand ils parlent de nos monnoies.
Pour moi voici mon raisonnement sur cette matiere : je le tire des faits mêmes, qu'aucune opinion ne peut contester.
Le poids des deniers a varié chez les Romains : le poids de leurs drachmes n'a pas toujours été uniforme à celui de leurs deniers, quoique ces deux mots soient synonymes dans les auteurs : les drachmes ni les deniers n'ont pas toujours été de poids. Tel des anciens a compté sept deniers à l'once, tel autre sept deniers & demi, & tel autre huit. Plusieurs d'entr'eux ont souvent confondu dans leurs ouvrages la livre poids & la livre mesure sans nous en avertir, attendu qu'ils parloient des choses connues de leur tems, & qu'il ne s'agissoit pas d'expliquer aux Boizards à venir. Toutes ces raisons contribuent donc à nous confondre sur l'évaluation des monnoies romaines, parce qu'on ne peut établir aucun système que sur des autorités qui se contredisent. Voilà pourquoi parmi nos savans les uns comptent 100 deniers, d'autres 96, & d'autres 84 à la livre romaine.
Enfin, non-seulement les deniers, les drachmes, les onces, en un mot toutes les parties de la livre en or, en argent & en cuivre, qu'ils ont pris pour base de leurs évaluations en les pesant, n'ont pas toujours eu le même poids sous la république, ni depuis Néron jusqu'à Septime Severe ; mais dans les pieces mêmes contemporaines & du même consulat, il est arrivé que par l'user ou autres causes, les unes d'un même tems pesent plus & les autres moins. Après cela croyez que vous trouverez fixement ce que la livre romaine contenoit de deniers, & allez ensuite déterminer la valeur de cette livre en la comparant avec la livre de Paris. Hélas, nous ne perdons nos plus beaux jours, faute de judiciaire, qu'à de pénibles & de vaines recherches ! (D.J.)
LIVRE, (Comm.) c'est un poids d'un certain rapport, qui sert fort souvent d'étalon, ou de modele d'évaluation pour déterminer les pesanteurs ou la quantité des corps. Voyez POIDS.
En Angleterre on a deux différentes livres ; le pound-troy, c'est-à-dire, un poids à 12 onces la livre, & le pound-avoir du poids ou la livre avoir du poids.
Le pound troy ou la livre troy consiste en 12 onces, chaque once de 20 deniers pesant, & chaque denier de 24 grains pesant ; desorte que 480 grains font une once ; & 5760 grains une livre. Voyez ONCE, &c.
On fait usage de ce poids pour peser l'argent, l'or, les pierres précieuses, toutes sortes de grains, &c.
Les apoticaires s'en servent aussi ; mais la division en est différente. Chez eux 24 grains font un scrupule, trois scrupules une dragme, 8 dragmes une once, & 12 onces une livre. Voyez SCRUPULE, &c.
Le pound avoir du poids ou la livre avoir du poids pese 16 onces ; mais alors l'once avoir du poids est plus petite de 42 grains que l'once troy ; ce qui fait à peu près la douzieme partie du tout ; desorte que l'once avoir du poids ne contient que 438 grains, & l'once troy 480.
Leur différence est à peu près celle de 73 à 80, c'est-à-dire, que 73 onces troy font 80 onces avoir du poids, 112 avoir du poids font un cent pesant ou un quintal. Voyez QUINTAL.
On pese avec ce poids toutes les grandes & grosses marchandises, la viande, le beurre, le fromage, le chanvre, le plomb, l'acier, &c.
Une livre avoir du poids vaut 14 onces 5/8 d'une livre de Paris ; desorte que cent des premieres livres n'en font que 91 des secondes.
La livre de France contient 16 onces ; mais une livre de France vaut une livre une once 3/8 d'une livre avoir du poids ; tellement que 100 livres de Paris font 109 livres avoir du poids.
On divise la livre de Paris de deux manieres : la premiere division se fait en deux marcs, le marc en 8 onces, l'once en 8 gros, le gros en 3 deniers, le denier en 24 grains pesant chacun un grain de froment : ainsi la livre a 9216 grains.
La seconde division de la livre se fait en deux demi- livres, la demi- livre en deux quarts, le quart en deux onces, l'once en deux demi-onces, &c.
On se sert ordinairement de la premiere division, c'est-à-dire, de la division en marcs, &c. pour peser l'or, l'argent & d'autres marchandises précieuses, & l'on fait usage de la seconde pour celles d'une moindre valeur.
A Lyon, la livre est de 14 onces. Cent livres de Paris font 116 livres de Lyon. A Venise, la livre vaut 8 onces 3/4 de la livre de France, &c.
Quant aux différentes livres des différentes villes & pays, leur proportion, leur réduction, leur division : voici ce qu'en a recueilli de plus intéressant M. Savary dans son Dictionnaire de commerce.
A Amsterdam, à Strasbourg & à Besançon, la livre est égale à celle de Paris. A Genève, la livre est de 18 onces, les 100 livres de Genève font à Paris 112 livres 1/2, & les 110 livres de Paris n'en font à Genève que 89. La livre d'Anvers est à Paris 14 onces 1/8, & une livre de Paris est à Anvers une livre 2 onces & 1/8 ; de maniere que cent livres d'Anvers font à Paris 88 livres, & que 100 livres de Paris font à Anvers 113 livres 1/2. La livre de Milan est à Paris neuf onces 3/8 ; ainsi 100 livres de Milan font à Paris 65 livres, & 100 livres de Paris font à Milan 169 livres 1/2. Une livre de Messine est à Paris neuf onces 3/4, & une livre de Paris est à Messine une livre 10 onces 1/4, desorte que 100 livres de Messine font à Paris 61 livres, & que 100 livres de Paris font à Messine 163 livres 3/4. La livre de Boulogne, de Turin, de Modene, de Raconis, de Reggio est à Paris 10 onces 1/2, & une livre de Paris est à Boulogne, &c. une livre 8 onces 1/4 ; de maniere que 100 livres de Boulogne, &c. font à Paris 66 livres, & que 100 livres de Paris font à Boulogne, &c. 151 livres 1/2. Une livre de Naples & de Bergame est à Paris 8 onces 3/4, & une livre de Paris est à Naples & à Bergame une livre 11 onces 1/8 ; ensorte que 100 livres de Naples & de Bergame ne font à Paris que 59 livres, & que 100 livres de Paris font à Naples & à Bergame 169 livres 1/2. La livre de Valence & de Saragosse est à Paris 10 onces, & la livre de Paris est à Valence & à Saragosse une livre 9 onces 3/8 ; de façon que 100 livres de Valence & de Saragosse font à Paris 63 livres, & que 100 livres de Paris font à Valence & à Saragosse 158 livres 1/2. Une livre de Gènes & de Tortose est à Paris 9 onces 7/8, & la livre de Paris est à Gènes & à Tortose une livre 9 onces 3/4 ; de maniere que 100 livres de Gènes & de Tortose font à Paris 62 livres, & 100 livres de Paris font à Gènes & à Tortose 161 livres 1/4. La livre de Francfort, de Nuremberg, de Bâle, de Berne est à Paris une livre 1/4, & celle de Paris est à Francfort, &c. 15 onces 5/8 ; ainsi 100 livres de Francfort, &c. font à Paris 102 livres, & 110 livres de Paris font à Francfort, &c. 98 livres. Cent livres de Lisbonne font à Paris 87 livres 8 onces un peu plus, & 100 livres de Paris font à Lisbonne 114 livres 8 onces un peu moins ; ensorte que sur ce pié une livre de Lisbonne doit être à Paris 14 onces, & une livre de Paris doit être à Lisbonne une livre 2 onces.
La livre varie ainsi dans la plûpart des grandes villes de l'Europe, & dans le Levant : on en peut voir l'évaluation dans le Dictionn. de comm.
LIVRE signifie aussi une monnoie imaginaire dont on fait usage dans les comptes, qui contient plus ou moins suivant ses différens surnoms & les différens pays où l'on s'en sert. Voyez MONNOIE.
Ainsi l'on dit en Angleterre une livre sterling ; en France une livre tournois & parisis ; en Hollande & en Flandre une livre ou une livre de gros, &c.
Ce mot vient de ce que l'ancienne livre sterling, quoiqu'elle ne contint que 240 sols comme celle d'à-present ; néanmoins chaque sol valant 5 sols d'Angleterre, la livre d'argent pesoit une livre-troy. Voyez SOU.
La livre-sterling ou la livre d'Angleterre contient 20 schillings, le schilling 12 sols, le sol 4 liards. Voyez CHELING, SOL, &c. Voyez aussi MONNOIE.
On avoit anciennement trois moyens de payer une livre d'argent à l'échiquier. 1°. Le payement d'une livre de numero qui faisoit justement le nombre de 20 chelings. 2°. Ad scalum, qui faisoit 6 d. plus que 20 chelings. 3°. Ad pensam, ce qui donnoit juste le poids de 12 onces.
La livre de France ou la livre tournois contient 20 sols ou chelins, & le sol 12 deniers aussi tournois ; ce qui étoit la valeur d'une ancienne monnoie de France appellée franc, terme qui est encore synonyme, ou qui signifie la même chose que le mot livre. Voyez FRANC.
La livre ou la livre tournois contient pareillement 20 sols ou chelings, le sol 12 deniers ou sols parisis. Chaque sol parisis vaut 15 deniers tournois ; de sorte qu'une livre parisis vaut 25 sols tournois. Voyez LIVRE.
La livre ou la livre de gros d'Hollande se divise en 20 chelings de gros, le cheling en 12 sols de gros. La livre de gros vaut 6 florins, le florin évalué à 24 sols tournois, supposant le change sur le pié de 100 sols de gros pour un écu de France de 3 livres tournois ; de sorte que la livre de gros revient à 10 chelings & 11 sols & 1 liard sterling. La livre de gros de Flandre & de Brabant a la même division que celle d'Hollande, & contient comme elle 6 florins ; mais le florin vaut 25 sols tournois ; de sorte que la livre de Flandre vaut 7 livres 10 sols tournois, ou 11 chelings 3 deniers sterling ; en supposant le change à 96 deniers de gros pour un an de livres tournois, ce qui est le pair du change : car lorsqu'il augmente ou qu'il diminue, la livre de gros hausse ou baisse suivant l'augmentation ou la diminution du change. Dictionn. de Commerce. Voyez CHANGE.
Les marchands, les facteurs, les banquiers, &c. se servent de caracteres ou de lettres initiales, pour exprimer les différentes sortes de livres de compte, comme L ou L St livres sterling. L G livres de gros, & L ou lt livres tournois.
En Hollande une tonne d'or est estimée 100000 livres. Un million de livres est le tiers d'un million d'écus. On dit que des créanciers sont payés au marc la livre, lorsqu'ils sont colloqués à proportion de ce qui leur est dû, sur des effets mobiliaires, ce qu'on nomme par contribution ; ou lorsqu'en matiere hypothécaire ils sont en concurrence ou égalité de privilege, & qu'il y a manque de fonds, ou encore lorsqu'en matiere de banqueroute & de déconfiture, il faut qu'ils supportent & partagent la perte totale, chacun en particulier aussi à proportion de son dû. En termes de commerce de mer, on dit livre à livre, au lieu de dire au sol la livre. Dictionn. de Comm.
|
| LIVRÉE | S. f. (Hist. mod.) couleur pour laquelle on a eu du goût, & qu'on a choisie par préférence pour distinguer ses gens de ceux des autres, & parlà se faire reconnoître soi-même des autres. Voyez COULEURS.
Les livrées se prennent ordinairement de fantaisie, & continuent ensuite dans les familles par succession. Les anciens chevaliers se distinguoient les uns des autres, dans leurs tournois, en portant les livrées de leurs maîtresses. Ce fut de-là que les personnes de qualité prirent l'usage de faire porter leur livrée à leurs domestiques ; il est probable aussi que la différence des émaux & des métaux dans le blason, a introduit la diversité des couleurs, & même certaines figures relatives aux pieces des armoiries dans les livrées, comme on peut le remarquer dans les livrées de la maison de Rohan, dont les galons sont semés de macles qui sont une des pieces de l'écusson de cette maison. Le P. Menestrier dans son traité des carrousels, a beaucoup parlé du mêlange des couleurs dans les livrées. Dion rapporte que Oenomaüs fut le premier qui imagina de faire porter des couleurs vertes & bleues aux troupes qui devoient représenter dans le cirque des combats de terre & de mer. Voyez PARTI & FACTIONS.
Les personnes importantes dans l'état donnoient autrefois des livrées à gens qui n'étoient point leurs domestiques, pour les engager pendant une année à les servir dans leurs querelles. Cet abus fut réformé en Angleterre par les premiers statuts d'Henry IV. & il ne fut permis à personne, de quelque condition qu'elle fût, de donner des livrées qu'à ses domestiques ou à son conseil.
En France, à l'exception du roi, des princes & des grands seigneurs qui ont leurs livrées particulieres & affectées à leurs domestiques, les livrées sont arbitraires, chacun peut en composer à sa fantaisie, & les faire porter à ses gens : aussi y voit-on des hommes nouveaux donner à leurs domestiques des livrées plus superbes que celles des grands.
LIVREE, (Ruban.) est tout galon uni & façonné, ou à figures, qui sert à border les habits de domestique. La livrée du roi passe sans contredit pour la plus belle & la plus noble de toutes les livrées ; celle de la reine est la même, excepté que tout ce qui est cramoisi dans celle du roi, est bleu dans celle de la reine ; il y a un nombre infini de livrées dont la plûpart sont affectées à certaines familles ; ainsi on dit livrée d'Orléans, livrée de Conti, &c.
|
| LIVRER | DONNER, METTRE entre les mains de quelqu'un, en sa possession, en son pouvoir, une chose qu'on lui a vendue, dont on lui fait présent, ou qui lui appartient.
Ce terme est également usité parmi les marchands & parmi les artisans. Les premiers disent qu'ils ont livré tant de pieces de drap pour l'habillement des troupes, tant d'aulnes de damas pour un ameublement. Les autres qu'ils ont livré leur besogne, des chenets, une serrure, une commode, &c. Dictionn. de Comm.
LIVRER, terme de chasse, on dit livrer le cerf aux chiens, c'est mettre les chiens après.
|
| LIVRET | LIVRET
LIVRET, s. m. (Batteur & Tireur d'or) petit livre où les ouvriers renferment leur or après qu'il est préparé.
|
| LIVRON | (Géog.) en latin Libero ou Liberonium ; petite ville de France, en Dauphiné, sur une hauteur dans un lieu important à cause de sa situation, mais entierement dépeuplé, depuis que les murailles de la ville ont été détruites. Elle est à une petite lieue du Rhône, & la Drome cotoye la colline sur laquelle elle est située. Henri III. en arrivant de Pologne en France, voulut avec quelques troupes qu'on lui avoit amenées, renverser des villes, qu'il auroit pû gagner & s'attacher par la douceur : il dut s'appercevoir quand il tenta d'entrer à main armée dans la petite ville de Livron, qu'il n'avoit pas pris le bon parti ; on cria du haut des murs aux troupes qu'il conduisoit : " approchez assassins, venez massacreurs, vous ne nous trouverez pas endormis comme l'amiral ". Long. 22. 40. lat. 44. 47.
|
| LIXA | (Géog. anc.) & LIXOS, dans Pline, liv. V. ch. j. ville de la Mauritanie Tingitane, qui devint colonie romaine sous Claudius. Elle étoit arrosée par la riviere Lix, nommée Linx par Etienne le géographe, Lixus, Lixos par Pline, par Strabon. La ville Lixa, & le Lix qui y couloit, sont à présent la ville & la riviere de Larache. Voyez LARACHE. (D.J.)
|
| LIXIVIATION | S. f. (Chimie) on appelle ainsi en Chimie l'espece de séparation qu'on opere, en appliquant de l'eau à un corps pulvérulant, composé d'un mêlange de terre & de sel, & retirant ensuite cette eau chargée de ce dernier principe.
On exécute la lixiviation de diverses manieres : l'on verse sur le corps à lessiver, une quantité d'eau suffisante pour le surnager d'environ deux doigts, on le remue ensuite en tout sens pendant un certain tems, on le laisse éclaircir par le repos, & enfin l'on verse la lessive par inclination : ou bien on place le corps à lessiver sur un filtre (Voyez FILTRE), & on verse dessus à diverses reprises, une quantité suffisante d'eau. C'est de cette derniere façon que se fait la lixiviation de platras & de terres nitreuses dans la fabrique du salpètre. Voyez SALPETRE, celle du sable imprégné de sel marin dans les salines des côtes de Normandie. Voyez SALINE, &c.
On fait la lixiviation à chaud ou à froid ; on emploie toujours de l'eau chaude si le corps à lessiver ne contient qu'une espece de sel, ou deux sels à peu près également solubles ; car les menstrues se chargeant, comme on sait, plus facilement des corps à dissoudre, lorsque leur action est favorisée par la chaleur, la lixiviation est plus promte & plus parfaite par ce moyen : mais si le corps à lessiver contient des sels d'une solubilité spécifique fort différente, & qu'on se propose de ne retirer que le moins soluble, c'est un bon moyen d'y réussir que d'employer l'eau froide, & de ne la laisser séjourner que peu de tems sur les matieres. On procede de cette derniere maniere à la lixiviation de la potasse ou de la soude, dont on veut retirer des alkalis destinés à être purifiés pour les usages de la Chimie. On applique au contraire l'eau bouillante aux cendres des plantes, dont on veut retirer les sels pour l'usage de la Médecine. Voyez LIXIVIEL sel.
L'édulcoration chimique est proprement une espece de lixiviation. Voyez EDULCORATION Chim. (b).
|
| LIXIVIEL | (Chimie) nom qu'on donne au sel retiré des cendres des végétaux par la lixiviation. Voyez SEL LIXIVIEL. (b)
|
| LIZIER | S. (Géog.) sanctus Lycerius, & dans les tems reculés Austria ; ancienne ville de France en Guienne, capitale du Cousérans, qui est un évêché suffragant d'Ausch. Elle a pris son nom de S. Lizier, un de ses évêques, qui mourut en 752. Le diocèse a seulement quatre-vingt-deux paroisses, & vaut 18000 liv. de rentes à son prélat. Ce n'est que dans le douzieme siecle, que les évêques de cette ville ont quitté le nom d'évêque d'Austrie. S. Lizier est sur le Salat, à 7 lieues de Pamiers, à 20 S. E. d'Ausch, 175 S. O. de Paris. Long. 18. 48. lat. 43. 1. (D.J.)
|
| LLACTA-CAMAYU | S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nommoit chez les Péruviens du tems des Incas, un officier dont la fonction étoit de monter sur une petite tour, afin d'annoncer au peuple assemblé la partie du travail à laquelle il devoit s'occuper le jour suivant. Ce travail avoit pour objet l'agriculture, les ouvrages publics, la culture des terres du soleil, de celles des veuves & des orphelins, de celles des laboureurs, & enfin de celles de l'empereur.
|
| LLAMA | S. m. (Hist. nat. des anim. d'Amériq.) les Espagnols mouillent la premiere syllabe de tous les mots qu'ils écrivent par deux ll. Animal à quatre piés du Pérou : il est ainsi nommé par les Indiens du lieu. Les Espagnols appellent les llamas, carneros de tierra, moutons du pays ; ce ne sont pourtant pas des moutons.
Ces animaux ont environ quatre à cinq piés & demi de haut ; leur tête est petite à proportion du corps, & tient en quelque chose de celle du cheval & de celle du mouton. Leur levre supérieure est fendue au milieu, comme celle des lievres. Ils ont le col long, courbé en bas comme les chameaux à la naissance du corps, & ils leur ressembleroient assez bien à cet égard, s'ils avoient une bosse sur le dos. Leur pié est fendu comme celui des moutons ; ils ont au dessus du pié un éperon, dont ils se servent pour s'accrocher dans les rochers. Leur corps est couvert de laine, qui rend une odeur forte & même desagréable ; elle est longue, blanche, grise & rousse par taches, assez belle, quoiqu'on la dise inférieure à celle de vigogne. Les Indiens en font une espece de fil, qu'ils teignent avec le suc de certaines plantes, mais ce n'est pas son seul usage.
Avant que les Espagnols eussent conquis le Pérou, les llamas y étoient les seuls animaux dont on se servoit pour porter les fardeaux ; à présent ils partagent cette fatigue avec les chevaux, les ânes & les mules. On les emploie quelquefois dans les minieres pour porter le minerai au moulin, & plus fréquemment encore pour porter le guana, ou fiente des oiseaux, qui fait en partie les richesses d'Arica, & de plusieurs autres lieux qui sont sur la côte. Les llamas en portent jusqu'à cent livres pesant dans une espece de besace, que les Espagnols appellent sforcas. Dès qu'on les a chargés, ils marchent de bonne grace, la tête levée & d'un pas réglé, que les coups ne peuvent hâter ; quand on les bat pour y parvenir, ils se couchent à terre, ou prennent la fuite, & grimpent jusqu'au haut des précipices dans des endroits inaccessibles.
Ils ne coutent rien pour l'entretien, car il ne faut à ces animaux, ni fer, ni bride, ni bâts. Il n'est pas besoin d'avoine pour les nourrir ; on n'a d'autre soin à prendre que de les décharger le soir, lorsqu'on arrive au lieu où on doit coucher ; ils vont paître dans la campagne, on les ramene le matin au lieu où on les a déchargés, on leur remet leur sforcas, & ils continuent volontiers leur route, qui est chaque jour d'environ quatre lieues d'Amérique.
On peut voir la représentation de cet animal dans la relation de la mer du sud de Frézier ; le P. Feuillée reconnoît qu'elle est très-fidele. (D.J.)
|
| LLAUTU | S. m. (Hist. mod.) c'étoit le nom que les Péruviens donnoient à une bandelette d'un doigt de largeur, attachée des deux côtés sur les tempes par un ruban rouge, qui servoit de diadème aux Incas ou monarques du Pérou.
|
| LLERENA | (Géog.) ville d'Espagne dans l'Andalousie, sur ses frontieres, au midi de la Guadiana. M. Baudrand qui estropie trop souvent les noms, appelle cette ville Ellerena. Elle fut bâtie en 1241, par les maîtres de l'ordre de S. Jacques, & déclarée cité en 1640 par Philippe IV. Les chevaliers en sont seigneurs, & y entretiennent un êvêque de leur ordre, relevant immédiatement du saint siege. Cette ville est située à 18 lieues S. E. de Mérida, & 20 N. E. de Séville dans une belle plaine, abondante en tout ce qui peut contribuer aux douceurs de la vie ; mais le tribunal de l'inquisition établi dans cette ville, ne concourt pas à sa félicité. Long. 12. 45. lat. 38. 8.
|
| LLITHI | S. m. (Bot. exot.) arbre qui vient en plein vent au Chili, & en plusieurs endroits de l'Amérique. Je n'en connois que la description du P. Feuillée, qui est très-incomplete , puisqu'elle ne dit rien de la fleur, du fruit & des graines : son tronc à quatre ou cinq piés de circonférence ; son bois est blanc, fort dur, & devient rouge en se séchant ; son écorce est verdâtre, & donne en la coupant une eau de la même couleur. Ses branches sont chargées de feuilles alternes, longues d'un grand pouce & un peu moins larges, lisses, verd-gai, ovales, & assez semblables à celles de la lauréole. L'eau qui découle de cet arbre en le coupant, est d'une qualité caustique & vénéneuse, faisant enfler les parties du corps humain sur lesquelles elle tombe ; mais le bois de l'arbre seroit admirable pour la construction des navires, car il devient encore plus dur dans l'eau ; les naturels du pays en font divers ustensiles domestiques. (D.J.)
|
| LLIVIA | (Géog.) ville d'Espagne dans la Catalogne, au comté de Cerdagne ; elle est très-ancienne ; mais ce n'est point la Lilia, Lylia, Lybia d'Antonin, ou l'Oliba de Ptolémée. Llivia seroit plutôt l'ancienne Julia Lybica du peuple Cerrectani, au pié des Pyrénées, sur les frontieres de France. Julia Lybica est donnée pour ville unique des Cerretains, & Llivia a été la capitale de la Cerdagne ; mais son ancien lustre a passé, & ses murailles même ne subsistent plus. Elle est fur la Sègre, à 1 lieue de Puicerda, 2 de Mont-Louis, & 15 de Perpignan. Long. 19. 39. lat. 42. 31. (D.J.)
|
| LO | S. Fanum S. Laudi, (Géog.) petite ville de France, en basse Normandie, au diocese de Coutances, chef-lieu d'une élection dans la généralité de Caen. Quelques écrivains prétendent qu'elle est ancienne, & que son premier nom étoit Briovera, composé des deux mots, bria ou briva, un pont, & Vera, la riviere de Vire. Mais il paroît plus vraisemblable, qu'elle doit son origine & son premier nom à une église bâtie sous l'invocation de S. Lo, S.Laudus, ou Laudo, évêque de Coutances, né dans le château du lieu, & qui vivoit sous le regne des enfans de Clovis ; il y a de nos jours à S. Lo, une manufacture de serges, de raz, & d'empeignes de souliers, qui en prennent le nom. Cette ville est sur la Vire, dans un terrein fertile, à 6 lieues de Coutances, 58 N. E. de Paris. Long. 16. 32. lat. 49. 7.
L'abbé Joachim le Grand, éleve du P. le Cointe, naquit à S. Lo en 1653. Il fut secrétaire d'ambassade en Espagne & en Portugal ; ses ouvrages historiques sont curieux & profonds. Il en a composé quelques-uns par ordre du ministere. On lui doit une excellente traduction françoise de la Relation de l'Abyssinie du Pere Lobo, jésuite. Il l'a enrichie de lettres, de mémoires, & de dissertations curieuses. Il avoit déjà donné, long-tems auparavant, une traduction de l'histoire de l'île de Ceylan, du capitaine Ribeyro, avec des additions. Il mourut en 1733, âgé de 80 ans. Voyez le P. Niceron, Mém. des hommes illustres, tom. XXVI. (D.J.)
|
| LO | LOO, LOHE, (Géog.) ces mots demandent à être expliqués, parce qu'ils se rencontrent souvent dans ce dictionnaire en fait de géographie. Lazius prétend que dans le haut allemand, lo, loo, ou lohe veut dire la flamme, & qu'on appelle dans cette langue les comtes d'Hohenlo, ou d'Hohenloo, ou d'Hohenloh, ceux qu'on nomme en latin, comites de altâ flammâ ; dans la basse Allemagne, lo, ou loo signifient un lieu élevé, situé près des eaux & des marais ; c'est en ce sens qu'on les prend dans les mots de Loen, Looven, Venlo, Stadt-Loen, &c. Il y a plusieurs noms dans les Pays-bas formés de cette maniere, comme Tongerloo, Calloo, Westerloo, enfin loo signifie quelquefois un lieu ombragé & boisé. (D.J.)
|
| LOANDA | (Géog.) petite île d'Afrique, sur la côte du royaume d'Angola, vis-à-vis de la ville de S. Paul de Loanda. C'est sur ces bords que l'on recueille ces petites coquilles appellées zimbis, qui servent de monnoie courante avec les Negres ; mais le droit de recueillir ces sortes de coquillages n'appartient qu'au roi de Portugal, car il fait une partie de ses domaines. Outre cet avantage, cette île en procure un autre, celui de fournir la ville d'eau douce. Les Portugais ont ici plusieurs habitations, des jardins où l'on éleve des palmiers, & des fours à chaux qui sont construits de coquilles d'huitres (D.J.)
LOANDA, S. Paul de, (Géog.) ville d'Afrique, capitale du royaume d'Angola, dans la basse Guinée, avec un bon port, une forteresse, & un évêché suffragant de Lisbonne. On y compte un millier de maisons d'Européens, un plus grand nombre encore de maisons de Negres, qui sont les naturels du pays, & quantité d'esclaves. On y trafique par échange, & l'on y mange du pain de manioc. Les zimbis servent de petite monnoie, & les Negres tiennent lieu de la grosse monnoie dans le trafic. Long. 31. lat. méridionale, 8. 45. (D.J.)
|
| LOANGO | ou LOWANGO, (Géog.) royaume d'Afrique dans la basse Guinée, sur la côte de l'Océan éthiopique. Il commence au cap Sainte-Catherine, par les 2 degrés de latitude méridionale, & finit par les 5 degrés de la même latitude, ce qui lui donne 3 degrés ou 75 lieues des côtes nord & sud. Son étendue est & ouest dans les terres est d'environ 100 lieues. Il est séparé du royaume de Congo par le Zaire, la capitale s'appelle Loango.
Les habitans de cette contrée sont noirs, & plongés dans l'idolâtrie ; les hommes portent aux bras de larges bracelets de cuivre : ils ont autour du corps un morceau de drap, ou de peau d'animal, qui leur pend comme un tablier ; ils sont nuds depuis la ceinture en haut, mettent sur la tête des bonnets d'herbes, piqués avec une plume dessus, & une queue de bufle sur l'épaule, ou dans la main, pour chasser les mouches.
Les femmes ont des jupons ou lavougus de paille, qui couvrent ce qui distingue leur sexe, & ne les entrouvrent qu'à moitié, le reste de leur corps est nud par le haut & par le bas. Elles s'oignent d'huile de palmier & de bois rouge mis en poudre ; elles portent toûjours sous le bras une petite natte, pour s'asseoir dessus par-tout où elles vont.
Ce sont elles qui gagnent la vie de leurs maris, comme font toutes les autres femmes de la côte d'Afrique ; elles cultivent la terre, sement, moissonnent, servent leurs hommes à table, & n'ont pas l'honneur de manger avec eux.
Ils vivent les uns & les autres de poisson, & de viande à demi corrompue. Ils boivent de l'eau ou du vin de palmier, qu'ils tirent des arbres.
Le roi est despotique, & ce seroit un crime digne de mort d'oser le regarder boire ; c'est pour cela qu'avant que sa majesté boive, on sonne une clochette, & tous les assistans baissent le visage contre terre ; quand sa majesté a bû, on sonne encore la même clochette, & chacun se releve ; d'ailleurs, le roi mange rarement en présence de ses sujets, & même ce n'est que les jours de fêtes qu'il se montre en public.
Les revenus de l'état sont en cuivre, en dents d'éléphans, en habits d'herbes qu'on nomme lavougus, & dont le monarque a des magasins ; mais les principales richesses consistent en bétail, & en esclaves des deux sexes.
Ce pays nourrit des éléphans, quantité de bufles, de boeufs, de cerfs, de biches, de pourceaux, de volaille. Il abonde en tigres, en léopards, en civettes, & autres bêtes qui fournissent de belles fourrures.
On y voit des singes à queue, que Van-den-Broeck a pris pour des hommes sauvages.
Les funérailles du peuple de Loango se font assez singulierement ; ils placent le mort sur une espece de bucher, dans la posture d'un homme assis, le couvrent d'un habit d'herbes, allument du feu tout autour, & après avoir entierement desseché le cadavre, ils le portent en terre avec pompe.
Dans ce royaume, les fils du roi ne sont pas les héritiers de la couronne, ce sont ceux de sa soeur ou de l'aîné de ses soeurs. Il a tant de femmes & d'enfans, qu'il y auroit toûjours des guerres entr'eux si la succession pouvoit les regarder. (D.J.)
LOANGO, (Géog.) capitale du royaume de ce nom ; le roi y réside avec sa cour & son serrail ; l'enclos de sa demeure ou de son palais, est d'une palissade de branches de palmiers, & forme un quarré d'une très-grande étendue ; on y trouve les maisons de ses femmes & de ses concubines ; on reconnoît les unes & les autres à des brasselets d'ivoire, & elles sont étroitement gardées. Les bâtimens des autres habitans sont sur le modele de celui du roi ; ils ne se touchent pas, & sont bordés & entourés de bananas, de palmiers, & de bankoves. Loango est environ à deux lieues de la côte de l'Océan éthiopique. Long. 29. 15. lat. mérid. 4. 30. (D.J.)
LOANGO, baie de, (Géog.) elle se reconnoît aisément par les hautes montagnes rouges qui sont du côté de la mer, car il n'y en a point d'autres semblables sur la côte. Cette baie passe pour être bonne ; cependant à son entrée, vers l'extrêmité septentrionale, il se trouve un banc qui court depuis la pointe, près d'une demi lieue, le long de la côte. Voyez sur cette baie Van-den-Broeck, Voyage de la Comp. des Indes orient. tom. IV. p. 318. (D.J.)
|
| LOANGO-MONGO | (Géog.) contrée d'Afrique dans la basse Ethiopie, contiguë à la province de Loangiri, ou Lovangiri. Cette contrée, dont on ignore les bornes orientales, est pleine de palmiers qui y produisent de l'huile en abondance. (D.J.)
|
| LOBAW | (Géog.) Lobavia, petite place de la Prusse polonoise, qui donne son nom au canton circonvoisin. Lobaw est à 13 milles S. de Culm. Long. 37. 3. lat. 52. 38.
|
| LOBE | , s. m. chez les Anatomistes, se dit de chacune des deux portions qui composent le poumon. Voyez POUMON.
Cette séparation en lobes sert à la dilatation du poumon ; par leur moyen il reçoit une plus grande quantité d'air, d'où il arrive qu'il n'est pas trop pressé lorsque le dos est courbé. C'est pour cela que les animaux, qui sont toujours panchés vers la terre, ont le poumon composé de plus de lobes que l'homme ; & même leur foie est partagé en plusieurs lobes, au lieu que celui de l'homme est un corps continu. Voyez nos Planches d'Anatomie, & leur expl. Voyez aussi FOIE.
Chacune des portions latérales du cerveau est distinguée en deux extrêmités, une antérieure & une postérieure qu'on appelle lobes du cerveau, entre lesquels il y a inférieurement une grosse protubérance à laquelle on donne le même nom ; desorte que chaque portion latérale a trois lobes, un antérieur, un moyen & un postérieur.
Les lobes antérieurs sont appuyés sur les parties de l'os frontal, qui contribue à la formation des orbites & des sinus frontaux, c'est-à-dire aux endroits qu'on appelle communément fosses antérieures de la base du crâne. Les lobes postérieurs sont posés sur la tente du cervelet, & les lobes moyens logés dans les fosses latérales ou moyennes de la base du crâne. Voyez ORBITE, FRONTAL, &c.
Le lobe antérieur & le lobe moyen sont séparés par un sillon très-profond & fort étroit qu'on appelle fissure de Sylvius ou simplement la grande fissure du cerveau. Voyez CERVEAU.
LOBE se dit aussi du bout de l'oreille, qui est plus gras & plus charnu qu'aucune autre partie de l'oreille. Voyez OREILLE.
Du Laurent dit que le mot de lobe dans ce dernier sens, vient du grec , couvrir de honte ou être confus, parce qu'on prétend que cette partie rougit dans les personnes qui ont de la honte.
LOBE s'emploie aussi en parlant des fruits & des grains.
C'est ainsi que la féve est composée de deux portions appellées lobes, qui sont enveloppées de la peau extérieure. Tous les autres grains, même les plus petits, sont partagés, ainsi que la féve, en deux lobes ou portions égales, comme le docteur Grew l'a fait voir dans son anatomie des plantes. Voyez FRUIT.
LOBES d'une graine, (Jardinage) une graine semée se partage ordinairement en deux lobes qui composent son corps même, & qui reçoivent chacune à travers la membrane appellée secondine, un des filets de la graine, lequel se divise en deux filamens, dont l'un se distribue dans toute l'étendue du lobe, & l'autre s'en va dans la radicule & dans la plume. Ces lobes ensuite grossissent & sortent de la terre pour former les feuilles qui ne sont autre chose que les lobes même étendus, sortis de la terre & changés en feuilles.
|
| LOBETUM | (Géog. anc.) ville de l'Espagne Tarragonoise, selon Ptolémée, liv. II. ch. vj, c'est présentement Albaracin. (D.J.)
|
| LOBRÉGAT | LE, (Géog.) nom commun à deux rivieres d'Espagne en Catalogne ; la premiere, en latin Rubricatus, tire sa source des montagnes, sur la frontiere de la Cerdagne, & se rend dans la Méditerranée, à deux lieues de Barcelone au couchant ; la seconde coule dans l'Ampurdan, & se jette dans le golfe de Lyon auprès de la ville de Roses : c'est le Clodianus des anciens. (D.J.)
|
| LOBULE | lobellus, en Anatomie, est un petit lobe. Voyez LOBE.
Chaque lobe du poumon est divisé en plusieurs lobes plus petits, ou lobules, qui sont attachés de chaque côté aux plus grosses branches de la trachée artere. Chaque lobule est composé d'un grand nombre de petites vesicules rondes, qui toutes communiquent ensemble. C'est dans ces vesicules que l'air entre par la trachée-artere dans le tems de l'inspiration ; & il en sort dans le tems de l'expiration. Voyez nos Pl. d'Anat. &c. Voyez aussi POUMON, TRACHEE-ARTERE, &c.
|
| LOCAL | ALE, adj. problème local, en Mathématique, est un problème dont la construction se rapporte à un lieu géométrique. Voyez LIEU. Ce mot de problème local n'est plus guere en usage.
Le problème local est ou simple, lorsqu'il a pour lieu des lignes droites, c'est-à-dire lorsqu'il se résoud par l'intersection de deux droites ; ou plan, lorsqu'il peut se résoudre par les intersections de cercles & de droites ; ou solide, lorsqu'il ne peut se résoudre que par des intersections de sections coniques ou entr'elles, ou avec des cercles ; ou bien enfin, il est sur-solide, ou plus que solide, lorsque sa solution demande la description d'une ligne d'un ordre plus élevé que le second. Chambers. (O)
LOCAL, (Jurisprud.) se dit de ce qui concerne spécialement un lieu : on appelle coutume locale, celle qui est particuliere à une seule ville, à une seigneurie. Voyez COUTUME.
On appelle le local, ce qui concerne la disposition des lieux. (A)
|
| LOCARNO | (Géog.) en latin moderne Locarnum, les Allemands l'appellent Luggaris, ville commerçante de Suisse, capitale d'un bailliage de même nom, sur le lac Majeur, lago Maggiore, près de la riviere de Magia. Le bailliage de Locarno contient trente-trois paroisses, & est composé de vallées fertiles, arrosées de rivieres. Il se partage pour la police en quatre communautés. Le gouvernement civil est aristo-démocratique, composé de nobles, d'anciens bourgeois & du peuple. La ville de Locarno est située au pié d'une montagne au centre du pays, qui abonde en pâturages, en vins, en fruits, à 18 lieues N. de Novare, 17 N. O. de Milan. Long. 26. 16. lat. 46. 6.
Je ne connois d'hommes de lettres nés à Locarno, que Thadée Dunus, médecin, qui fleurissoit dans le xvj. siecle. Il s'acquit dans ce siecle une grande réputation par ses ouvrages ; on les a imprimés plusieurs fois à Zurich, où il s'étoit retiré à cause de la religion. (D.J.)
|
| LOCATAIRE | S. m. (Jurisprud.) est celui qui tient quelque chose à loyer, comme une maison ou autre héritage, ou même quelque chose mobiliaire.
Dans tous baux à loyer ou à ferme, le locataire est appellé preneur ; mais dans le discours ordinaire, le locataire d'une ferme est plus communément appellé fermier.
Pour les regles des fermes & des louages, Voyez FERME, LOUAGE, LOYER. (A)
|
| LOCATION | S. f. (Jurisprud.) signifie l'acte par lequel l'un donne quelque chose à titre de louage, & l'autre le prend à ce même titre, ce qui s'appelle conduction. Ces termes location & conduction sont relatifs. Voyez aux Institutes le titre de locatione & conductione, & ci-après LOUAGE & LOYER. (A)
|
| LOCCHEM | Lochemum, (Géog.) ville des Pays-bas Hollandois dans la Gueldres, au comté de Zutphen sur la Berckel, à 3 lieues de Zutphen. Les François la prirent en 1672, & l'abandonnerent en 1674, après en avoir rasé les fortifications. Long. 23. 58. lat. 52. 13. (D.J.)
|
| LOCHE | S. f. (Hist. nat. Ichthyolog.) poisson rond. Rondelet en distingue quatre sortes ; la premiere cobites fluviatilis, est la loche franche, ainsi nommée, parce qu'elle n'a point d'aiguillons, & qu'elle est plus tendre & plus saine que les autres ; on la trouve dans les ruisseaux & sur les bords des rivieres ; elle est de la longueur du doigt ; elle a le bec allongé ; le corps est jaunâtre, marqué de taches noires, rond & charnu. Il y a deux nageoires auprès des ouies, deux au ventre, une au-delà de l'anus, & une sur le dos.
La seconde espece de loche, cobites aculeata, differe de la premiere en ce qu'elle est plus grande & plus large ; son corps est rond & non pas applati. Il y a un aiguillon au couvercle des ouies.
La troisieme espece, cobites barbatula, loche ou lochette, est aussi appellée motelle. Voyez MOUTEILLE. Ces trois especes se trouvent dans l'eau douce.
La quatrieme, aphia cobites, se trouve dans les étangs de mer ; elle ne differe du goujon qu'en ce qu'elle est plus petite ; elle differe aussi de la loche de riviere, en ce qu'elle est plus courte & plus grosse. Voyez Rondelet, Hist. des poissons.
|
| LOCHER | (Maréch.) fer qui loche, se dit en parlant d'un fer de cheval qui branle & qui est prêt à se détacher tout-à-fait.
LOCHER, en terme de Raffinerie, c'est détacher le pain de la forme en le secouant sans l'en tirer. Sans cela on risqueroit de casser les têtes en plamotant. Voyez PLAMOTER.
|
| LOCHES | (Géog.) en latin Luccae, petite ville de France en Touraine, remarquable par ses mouvances. Elle est sur l'Indre, à 8 lieues S. d'Amboise, 10 S. E. de Tours, 55 S. O. de Paris. Long. 18 d. 39'. 22''. lat. 47 d. 7'. 37''.
C'est dans le choeur de l'église collégiale de Notre-Dame de Loches qu'est le tombeau d'Agnès Sorel, la belle Agnès que Charles VII. n'eut pas plutôt vû, qu'il en devint éperduement amoureux. La tombe de sa maîtresse est de marbre noir, & deux anges tiennent l'oreiller sur lequel repose sa tête. On lit autour de ce tombeau cette épitaphe : " Cy gist noble demoiselle Agnès Seurelle, en son vivant dame de bauté, Rochesserie, Issodun, Vernon sur Seine, piteuse envers tous, donnant largement de ses biens aux églises & aux pauvres, laquelle trépassa le neuvieme jour de Février 1449 ". Charles VII. l'adora pendant sa vie, jusqu'à quitter, pour l'amour d'elle, tout le soin du gouvernement. Ce prince lui survécut douze ans, & n'eut point de part aux prodiges de son regne, la fortune seule les produisit en dépit de son indifférence pour les affaires publiques. (D.J.)
|
| LOCHIA | (Géog. anc.) , promontoire d'Egypte auprès de Pharos, selon Strabon, liv. XVII. p. 795. Ortelius pense que c'est aujourd'hui Castelleto. (D.J.)
|
| LOCHQUHABIR | Leucopibia, (Géog.) province maritime de l'Ecosse septentrionale. Elle abonde en pâturage, en lacs & rivieres, qui fournissent beaucoup de poisson. La capitale est Inverlochi.
|
| LOCHTOA | (Géog.) riviere de Finlande dans la Bothnie orientale. Elle a sa source dans une grande chaîne de montagnes, qui séparent la Cajanie de la Thavastie, & va se perdre dans le golfe de Bothnie. (D.J.)
|
| LOCKE | PHILOSOPHIE DE, (Hist. de la Philosoph. moder.) Jean Locke naquit à Wrington, à sept ou huit milles de Bristol, le 29 Août 1631 : son pere servit dans l'armée des parlementaires au tems des guerres civiles ; il prit soin de l'éducation de son fils, malgré le tumulte des armes. Après les premieres etudes, il l'envoya à l'université d'Oxford, où il fit peu de progrès. Les exercices de collége lui parurent frivoles ; & cet excellent esprit n'eût peut-être jamais rien produit, si le hasard, en lui présentant quelques ouvrages de Descartes, ne lui eût montré qu'il y avoit une doctrine plus satisfaisante que celle dont on l'avoit occupé ; & que son dégoût, qu'il prenoit pour incapacité naturelle, n'étoit qu'un mépris secret de ses maîtres. Il passa de l'étude du Cartésianisme à celle de la Médecine, c'est-à-dire, qu'il prit des connoissances d'Anatomie, d'Histoire naturelle & de Chimie, & qu'il considéra l'homme sous une infinité de points de vûe intéressans. Il n'appartient qu'à celui qui a pratiqué la Médecine pendant long-tems d'écrire de la Métaphysique ; c'est lui seul qui a vû les phénomènes, la machine tranquille ou furieuse, foible ou vigoureuse, saine ou brisée, délirante ou réglée, successivement imbécille, éclairée, stupide, bruyante, muette, léthargique, agissante, vivante & morte. Il voyagea en Allemagne & dans la Prusse. Il examina ce que la passion & l'intérêt peuvent sur les caracteres. De retour à Oxford, il suivit le cours de ses études dans la retraite & l'obscurité. C'est ainsi qu'on devient savant & qu'on reste pauvre : Locke le savoit & ne s'en soucioit guère. Le chevalier Ashley, si connu dans la suite sous le nom de Shaftsbury, s'attacha le philosophe, moins encore par les pensions dont il le gratifia, que par de l'estime, de la confiance & de l'amitié. On acquiert un homme du mérite de Locke, mais on ne l'achete pas. C'est ce que les riches, qui font de leur or la mesure de tout, ignorent, excepté peut-être en Angleterre. Il est rare qu'un lord ait eu à se plaindre de l'ingratitude d'un savant. Nous voulons être aimés : Locke le fut de milord Ashley, du duc de Buckingham, de milord Halifax ; moins jaloux de leurs titres que de leurs lumieres, ils étoient vains d'être son égal. Il accompagna le comte de Northumberland & son épouse en France & en Italie. Il fit l'éducation du fils de milord Ashley : les parens de ce jeune seigneur lui laisserent le soin de marier son éleve. Croit-on que le philosophe ne fut pas plus sensible à cette marque de considération, qu'il ne l'eût été au don d'une bourse d'or ? Il avoit alors trente-cinq ans. Il avoit connu que les pas qu'on feroit dans la recherche de la vérité seroient toûjours incertains, tant que l'instrument ne seroit pas mieux connu, & il forma le projet de son essai sur l'entendement humain. Depuis, sa fortune souffrit différentes révolutions ; il perdit successivement plusieurs emplois auxquels la bienveillance de ses protecteurs l'avoit élevé. Il fut attaqué d'éthisie ; il quitta son pays ; il vint en France où il fut accueilli par les personnes les plus distinguées. Attaché à milord Ashley, il partagea sa faveur & ses disgraces. De retour à Londres, il n'y demeura pas longtems. Il fut obligé d'aller chercher de la sécurité en Hollande, où il acheva son grand ouvrage. Les hommes puissans sont bien inconséquens ; ils persécutent ceux qui sont par leurs talens la gloire des nations qu'ils gouvernent, & ils craignent leur désertion. Le roi d'Angleterre offensé de la retraite de Locke, fit rayer son nom des registres du collége d'Oxford. Dans la suite, des amis qui le regrettoient solliciterent son pardon ; mais Locke rejetta avec fierté une grace qui l'auroit accusé d'un crime qu'il n'avoit pas commis. Le roi indigné le fit demander aux états généraux, avec quatre-vingt-quatre personnes que le mécontentement de l'administration avoit attachées au duc de Montmouth dans une entreprise rebelle. Locke ne fut point livré ; il faisoit peu de cas du duc de Montmouth ; ses desseins lui paroissoient aussi périlleux que mal concertés. Il se sépara du duc, & se réfugia d'Amsterdam à Utrecht & d'Utrecht à Cleves, où il vécut quelque tems caché. Cependant les troubles de l'état cesserent, son innocence fut reconnue ; on le rappella, on lui rendit les honneurs académiques dont on l'avoit injustement privé ; on lui offrit des postes importans. Il rentra dans sa patrie sur la même flotte qui y conduisoit la princesse d'Orange ; il ne tint qu'à lui d'être envoyé en différentes cours de l'Europe, mais son goût pour le repos & la méditation le détacha des affaires publiques, & il mit la derniere main à son traité de l'entendement humain, qui parut pour la premiere fois en 1697. Ce fut alors que le gouvernement rougit de l'indigence & de l'obscurité de Locke ; on le contraignit d'entrer dans la commission établie pour l'intérêt du commerce, des colonies & des plantations. Sa santé qui s'affoiblissoit ne lui permit pas de vaquer longtems à cette importante fonction ; il s'en dépouilla, sans rien retenir des honoraires qui y étoient attachés, & se retira à vingt-cinq milles de Londres, dans une terre du comte de Marsham. Il avoit publié un petit ouvrage sur le gouvernement civil, de imperio civili ; il y exposoit l'injustice & les inconvéniens du despotisme & de la tyrannie. Il composa à la campagne son traité de l'éducation des enfans, sa lettre sur la tolérance, son écrit sur les monnoies, & l'ouvrage singulier intitulé le christianisme raisonnable, où il bannit tous les mysteres de la religion & des auteurs sacrés, restitue la raison dans ses droits, & ouvre la porte de la vie éternelle à ceux qui auront cru en J. C. réformateur, & pratiqué la loi naturelle. Cet ouvrage lui suscita des haines & des disputes, & le dégoûta du travail : d'ailleurs sa santé s'affoiblissoit. Il se livra donc tout-à-fait au repos & à la lecture de l'écriture sainte. Il avoit éprouvé que l'approche de l'été le ranimoit. Cette saison ayant cessé de produire en lui cet effet, il en conjectura la fin de sa vie, & sa conjecture ne fut que trop vraie. Ses jambes s'enflerent ; il annonça lui-même sa mort à ceux qui l'environnoient. Les malades en qui les forces défaillent avec rapidité, pressentent, par ce qu'ils en ont perdu dans un certain tems, jusqu'où ils peuvent aller avec ce qui leur en reste, & ne se trompent guere dans leur calcul. Locke mourut en 1704, le 8 Novembre, dans son fauteuil, maître de ses pensées, comme un homme qui s'éveille & qui s'assoupit par intervalles jusqu'au moment où il cesse de se réveiller ; c'est-à-dire que son dernier jour fut l'image de toute notre vie.
Il étoit fin sans être faux, plaisant sans amertume, ami de l'ordre, ennemi de la dispute, consultant volontiers les autres, les conseillant à son tour, s'accommodant aux esprits & aux caracteres, trouvant par-tout l'occasion de s'éclairer ou d'instruire, curieux de tout ce qui appartient aux arts, promt à s'irriter & à s'appaiser, honnête homme, & moins calviniste que socinien.
Il renouvella l'ancien axiome, il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait été auparavant dans la sensation, & il en conclut qu'il n'y avoit aucun principe de spéculation, aucune idée de morale innée.
D'où il auroit pû tirer une autre conséquence très-utile ; c'est que toute idée doit se resoudre en derniere décomposition en une représentation sensible, & que puisque tout ce qui est dans notre entendement est venu par la voie de la sensation, tout ce qui sort de notre entendement est chimérique, ou doit en retournant par le même chemin trouver hors de nous un objet sensible pour s'y rattacher.
De-là une grande regle en philosophie, c'est que toute expression qui ne trouve pas hors notre esprit un objet sensible auquel elle puisse se rattacher, est vuide de sens.
Il me paroît avoir pris souvent pour des idées des choses qui n'en sont pas, & qui n'en peuvent être d'après son principe ; tel est, par exemple, le froid, le chaud, le plaisir, la douleur, la mémoire, la pensée, la réfléxion, le sommeil, la volonté, &c. ce sont des états que nous avons éprouvés, & pour lesquels nous avons inventé des signes, mais dont nous n'avons nulle idée, quand nous ne les éprouvons plus. Je demande à un homme ce qu'il entend par plaisir, quand il ne jouit pas, & par douleur, quand il ne souffre pas. Je avoue, pour moi, que j'ai beau m'examiner, que je n'apperçois en moi que des mots de réclame pour rechercher certains objets ou pour les éviter. Rien de plus. C'est un grand malheur qu'il n'en soit pas autrement ; car si le mot plaisir prononcé ou médité réveilloit en nous quelque sensation, quelque idée, & si ce n'étoit pas un son pur, nous serions heureux autant & aussi souvent qu'il nous plairoit.
Malgré tout ce que Locke & d'autres ont écrit sur les idées & sur les signes de nos idées, je crois la matiere toute nouvelle & la source intacte d'une infinité de vérités, dont la connoissance simplifiera beaucoup la machine, qu'on appelle esprit, & compliquera prodigieusement la science qu'on appelle grammaire. La logique vraie peut se réduire à un très-petit nombre de pages ; mais plus cette étude sera courte, plus celle des mots sera longue.
Après avoir sérieusement réfléchi, on trouvera peut-être, 1°. que ce que nous appellons liaison d'idées dans notre entendement, n'est que la mémoire de la coexistence des phénomenes dans la nature ; & que ce que nous appellons dans notre entendement conséquence, n'est autre chose qu'un souvenir de l'enchaînement ou de la succession des effets dans la nature.
2°. Que toutes les opérations de l'entendement se réduisent ou à la mémoire des signes ou sons, ou à l'imagination ou mémoire des formes & figures.
Mais ce n'est pas assez pour être heureux, que de jouir d'un bon esprit, il faut encore avoir le corps sain. Voilà ce qui détermina Locke à composer son traité de l'éducation, après avoir publié celui de l'entendement.
Locke prend l'enfant quand il est né. Il me semble qu'il auroit dû remonter un peu plus haut. Quoi donc ? n'y auroit-il point de regles à prescrire pour la production d'un homme ? Celui qui veut que l'arbre de son jardin prospere, choisit la saison, prépare le sol, & prend un grand nombre de précautions, dont la plûpart me semblent applicables à un être de la nature beaucoup plus important que l'arbre. Je veux que le pere & la mere soient sains, qu'ils soient contens, qu'ils ayent de la sérénité, & que le moment où ils se disposent à donner l'existence à un enfant soit celui où ils se sentent le plus satisfaits de la leur. Si l'on remplit d'amertume la journée d'une femme enceinte, croit-on que ce soit sans conséquences pour la plante molle qui germe & s'accroît dans son sein ? lorsque vous aurez planté dans vôtre verger un jeune arbrisseau, allez le secouer avec violence seulement une fois par jour, & vous verrez ce qui en arrivera. Qu'une femme enceinte soit donc un objet sacré pour son époux & pour ses voisins.
Lorsqu'elle aura mis au jour son fruit, ne le couvrez ni trop ni trop peu. Accoutumez-le à marcher tête nue, rendez-le insensible au froid des piés. Nourrissez-le d'alimens simples & communs. Allongez sa vie en abrégeant son sommeil. Multipliez son existence, en appliquant son attention & ses sens à tout. Armez-le contre le hasard, en le rendant insensible aux contre-tems ; armez-le contre le préjugé, en ne le soumettant jamais qu'à l'autorité de la raison ; si vous fortifiez en lui l'idée générale de l'ordre, il aimera le bien ; si vous fortifiez en lui l'idée générale de honte, il craindra le mal. Il aura l'ame élevée, si vous attachez ses premiers regards sur de grandes choses. Accoutumez-le au spectacle de la nature, si vous voulez qu'il ait le goût simple & grand ; parce que la nature est toujours grande & simple. Malheur aux enfans qui n'auront jamais vû couler les larmes de leurs parens au récit d'une action généreuse ; malheur aux enfans qui n'auront jamais vû couler les larmes de leurs parens sur la misere des autres. La fable dit que Deucalion & Pyrrha repeuplerent le monde en jettant des pierres derriere eux. Il reste dans l'ame la plus sensible, une molécule qui tient de sa premiere origine, & qu'il faut travailler à reconnoitre & à amollir.
Locke avoit dit dans son essai sur l'entendement humain, qu'il ne voyoit aucune impossibilité à ce que la matiere pensât. Des hommes pusillanimes s'effrayeront de cette assertion. Et qu'importe que la matiere pense ou non ? Qu'est-ce que cela fait à la justice ou à l'injustice, à l'immortalité, & à toutes les vérités du systême, soit politique, soit religieux ?
Quand la sensibilité seroit le germe premier de la pensée, quand elle seroit une propriété générale de la matiere ; quand inégalement distribuée entre toutes les productions de la nature, elle s'exerceroit avec plus ou moins d'énergie selon la variété de l'organisation, quelle conséquence fâcheuse en pourroit-on tirer ? aucune. L'homme seroit toujours ce qu'il est, jugé par le bon & le mauvais usage de ses facultés.
|
| LOCMAN | (Marine) voyez LAMANEUR.
|
| LOCONUM | LOCONUM
Trois cent Grecs retranchés au pas des Thermopyles,
Rendirent en ce jour ses efforts inutiles ;
Et les Athéniens aimerent mieux cent fois
Abandonner leurs murs que de suivre ses lois.
(D.J.)
|
| LOCORITUM | (Géogr. anc.) ancienne ville de la grande Germanie, selon Pline, l. II. c. xj. Pierre Apien conjecture que c'est aujourd'hui Forcheim-sur-le-Meyn.
|
| LOCRA | (Géogr. anc.) riviere de l'île de Corse, qui, selon Ptolémée, l. III. c. ij. a son embouchure sur la côte occidentale. Léandre croit que c'est le Talabo de nos jours.
|
| LOCRENAN | S. m. (Com.) grosse toile de chanvre écru qui se fabrique à Locrenan en Bretagne ; elle a 30 aunes de long, sur 2/3 de large ; on l'emploie en voiles pour barques petites & grandes, & chaloupes.
|
| LOCRE | ou LOCRIENS, (Géogr. anc.) peuples de la Grece propre, dans la Locride. Voyez LOCRIDE.
|
| LOCRI | (Géog. anc.) ville de la grande Grece, au midi de sa partie occidentale, auprès du promontoire Zephirium, en tirant vers le nord. Le nom du peuple étoit le même, Locri ou Locrenses. Tite-Live emploie l'un & l'autre. Le territoire & le pays étoit appellé par les Grecs , Locride, & le promontoire , le promontoire de la Locride.
|
| LOCRID | ou LOCRIS, (Géogr. anc.) contrée de l'Achaïe ; le Parnasse, selon Strabon, la partageoit en deux parties.
Cellarius, Géog. antiq. l. II. c. xiij. dit que celle qui se trouvoit en-deçà de ce mont, étoit habitée par les Locres ozoles, Locri ozolae, & bornée par l'Etolie & la Phocide : la partie au-delà du Parnasse s'étendoit vers le détroit des Thermopyles le long de la côte de l'Euripe, vis-à-vis de l'Eubée.
Les Locres qui habitoient au-delà du Parnasse étoient divisés en deux peuples ; savoir, les Locres opuntiens, qui demeuroient le long de la mer d'Eubée, & les Locres épicnemidiens qui avoient pris leur nom du mont Cnémise, & habitoient les terres qui étoient entre cette montagne & le golfe Méliague.
Ces trois sortes de Locres ou de Locriens avoient chacune leur capitale ; celle des Locres ozoles étoit Amphysse ; celle des Locres opuntiens étoit Opus, d'où ils tiroient leur nom ; & celle des Locres épicnemidiens étoit Cnémide, ainsi nommée de la montagne au pié de laquelle cette ville étoit bâtie.
Ptolémée vous indiquera les autres villes qu'il attribue à chacun de ces peuples. On peut aussi consulter le P. Briet, quoique sa division soit différente de celle de Ptolémée.
Je remarquerai seulement au sujet des Locres ozoles, qu'on les trouve aussi nommés par les anciens Zephirii, c'est-à-dire occidentaux, parce que leur pays s'étendoit à l'occident de la Locride. Il commençoit à Naupactus, aujourd'hui Lepante, & finissoit aux confins de la Phocide. Nous ignorons quel peuple étoient les Locres dont parle Virgile, Aeneide l. XI. v. 265. & qu'il place sur le rivage de la Lybie : Lybico ve habitantes littore Locros ; c'étoit peut-être des Locres ozoles qui furent jettés par la tempête sur cette côte. (D.J.)
|
| LOCULAMENTUM | (Littér.) ce mot désignoit chez les Romains un étui à mettre des livres ; car les anciens n'ayant pas l'usage de l'Imprimerie, ni de la Reliure, écrivoient leurs ouvrages sur des écorces d'arbres, sur du parchemin, sur du papyrus d'Egypte ; &, après les avoir roulés, ils les fermoient avec des bossettes d'ivoire ou de métal, & les mettoient dans des étuis, dans des compartimens ou niches faites exprès pour les conserver, & c'est ce qu'ils appelloient loculamentum. (D.J.)
|
| LOCUTIUS | (Mythol.) le dieu de la parole chez les Romains ; c'est le même que Tite-Live, l. V. c. l. appelle Aïus Locutius ; il faut lire l'article AIUS LOCUTIUS, je n'ai rien à y ajouter.
|
| LODESAN | LE, (Géogr.) petit pays d'Italie, au duché de Milan, le long de la riviere de l'Adda. Il prend ce nom de Lodi sa capitale, & appartient à la maison d'Autriche, ainsi que le reste du Milanois.
|
| LODEVE | (Géogr.) ancienne ville de France au bas Languedoc, avec un évêché suffragant de Narbonne, érigé par le pape Jean XXII. en 1316. Le nom latin Lodeva est Luteva & Forum Neronis ; je le prouve, parce que Pline, l. III. c. iv. en nomme les habitans Lutevani, qui est Foroneronienses ; le même auteur ajoute que c'étoit une ville latine, sans doute à cause de la colonie, à l'occasion de laquelle on l'avoit surnommée Forum Neronis. Elle a eu ses vicomtes, ainsi que les autres villes du Languedoc ; voyez Catel, Hist. du Languedoc, l. II. c. vij. p. 296. & Had. Valesius, Notit. Gall. p. 274. Quoique située dans un pays sec & stérile, ses seules manufactures de draps & de chapeaux la font fleurir. Elle est sur la Lergue, au pié des Cévennes, à 9 lieues de Beziers, 15 de Nismes, 17 de Narbonne, 11 N. E. de Montpellier, 150 S. E. de Paris. Long. 21. lat. 43. 47.
Lodeve a l'honneur d'avoir donné naissance à deux cardinaux, Guillaume de Mandagot, & André-Hercule de Fleury.
Le premier, mort à Avignon en 1321, fut successivement archidiacre de Nismes, prévôt de Toulouse, archevêque d'Embrun, d'Aix, & enfin cardinal & evêque de Palestrine. Il avoit fait un traité d'élection des prélats, qu'on a imprimé à Cologne en 1573.
M. le cardinal de Fleury, mort à Issy près de Paris en 1743, presque nonagénaire, a été connu de tout le monde. Ce fut, dit M. de Voltaire, un homme des plus aimables, & de la société la plus délicieuse, jusqu'à l'âge de 73 ans ; & quand à cet âge il eut pris en main le gouvernement de l'état, il fut regardé comme un des plus sages. Il conserva jusqu'à près de 90 ans une tête saine, libre & capable d'affaires. Depuis 1726 jusqu'à 1742, tout lui réussit. Il prouva que les esprits doux & concilians sont faits pour gouverner les autres. Il fut simple & économe en tout, sans jamais se démentir. La distinction de la modestie fut son partage ; & s'il y a eu quelque ministre heureux sur la terre, c'étoit sans doute le cardinal de Fleury. (D.J.)
|
| LODI | (Géogr. anc. & mod.) ancienne ville d'Italie, en Lombardie, au Milanois, dans le Pavesan, sur le Silaro. Les anciens l'ont connu sous le nom de Laus Pompeia. Pompée prit soin de la réparer, & elle devint une ville riche & florissante ; son opulence excita la jalousie des Milanois ; ils formerent le dessein de la détruire, & l'exécuterent. Ce lieu n'est plus qu'un village sur le chemin de Pavie ; on l'appelle Lodi Vecchio, & l'on y a trouvé des médailles, des inscriptions & d'autres marques de son antiquité.
Cinquante ans après la destruction de cette ville, l'empereur Fréderic Barberousse la fit rétablir, non pas cependant dans le terrein qu'elle occupoit autrefois, mais à trois milles de-là, sur l'Adda ; elle se maintint libre assez longtems, mais finalement elle se soumit aux ducs de Milan, & devint la capitale du Lodesan. Othon & Acerbo Morena ont fait l'histoire de Lodi, rerum Laudensium. Felix Osio l'a rendue publique, & Leibnitz l'a insérée dans son recueil des écrivains de Brunswick.
Cette ville est dans un sol agréable, fertile, arrosé d'eau, & abondant en toutes choses, à 25 milles S. E. de Milan & de Pavie, 7 S. O. de Creme, 18 N. O. de Plaisance. Long. 27. 1. latit. 45. 18.
Maphée Vigius, né à Lodi en 1407, passa pour le plus grand poëte latin, que l'on eût vu depuis plusieurs siecles. Il se fit une éminente réputation par son XIII. livre de l'Enéide de Virgile, qui n'est au fond qu'une entreprise ridicule. Son poëme sur les friponneries des paysans est beaucoup mieux conçu. On trouve dans le Naudaeana bien des particularités fort indifférentes aujourd'hui sur cet auteur. (D.J.)
|
| LODIE | ou LOUDIER, subst. m. (Com.) grosse couverture piquée & remplie de laine en ploc entre deux étoffes ou toiles.
|
| LODS & VENTES | (Jurisprud.) sont le droit que l'on paye au seigneur féodal ou censier pour la vente qui est faite d'un héritage mouvant de lui, soit en fief ou en censive.
Dans les pays de droit écrit, les droits que le contrat de vente occasionne, sont appellés lods, tant pour les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la vente des fiefs en produit ; il en est de même dans la coûtume d'Anjou, on y appelle lods les droits de transaction dûs, tant pour le fief que pour les rotures.
Dans la plûpart des autres coutumes, les lods & ventes ne sont dûs que pour les rotures, & non pour les fiefs.
Le terme de lods, que l'on écrivoit aussi anciennement los, loz & laods, est françois.
Les uns tirent son origine du mot leud, qui, en langage thiais, c'est-à-dire teutonique ou germanique, signifie sujet & vassal, desorte que droit de lods signifieroit le droit que le sujet ou nouvel acquéreur doit au seigneur féodal.
De ce terme leud paroît dérivé celui de leuda, qui signifie toute sorte de redevance ou prestation, & principalement celle qui se paye au seigneur du lieu pour la permission d'exposer des marchandises en vente. En certains lieux on a dit lauda pour leuda, & quelques auteurs ont pensé que ce droit de laude avoit été ainsi nommé, parce qu'il se paye pour laudandâ venditione ; & il ne seroit pas bien extraordinaire que de lauda on eût sait laudes & laudimia, qui sont les différentes dénominations latines, dont on se sert pour exprimer les lods dûs au seigneur pour la vente d'un héritage roturier, & en françois laods, comme on l'écrivoit anciennement.
On trouve aussi qu'anciennement leuda ou leudum signifioit composition ; il est vrai que ce terme n'étoit d'abord usité que pour exprimer l'amende que l'on payoit pour un homicide, mais il paroît que dans la suite leudum, leuda ou lauda furent pris pour toute sorte de prestation ou tribut, comme on l'a dit d'abord.
D'autres, comme Alciat, prétendent que les lods, laudimia, ont été ainsi nommés à laudando id est nominando autore ; car l'acheteur est tenu de déclarer dans un certain tems au seigneur le nom de celui dont il a acquis.
D'autres encore tiennent que le terme de lods, pris pour le droit qui se paye au seigneur en cas de vente d'un héritage roturier, vient de los ou lods, qui, dans l'ancien langage, signifioit gré, volonté, consentement, on disoit alors loër pour allouer, approuver, agréer, accorder ; on trouve souvent en effet dans les anciens titres & cartulaires ces mots de lode ou laude, consilio & assensu, pour laudatione ; pro laudationibus aut revestimentis, laudavimus & approbavimus. L'ancienne chronique de saint Denis, vol. I. chap. vij. dit, sans son gré & sans son lods.
C'est aussi dans ce même sens que le terme de lods ou los est pris dans les anciennes coûtumes, telle que l'ancienne coûtume de Champagne & Brie, établie par le comte Thibaut en Décembre 1224, art. 4. li dires li doit loër, ne li doit mie contredire, &c. Celle de Toulouse rédigée en 1285, part. IV. tit. de feudis, dit laudaverit vel concesserit ; celle de Valois, art. 14. dit los & choix ; & dans quelques coûtumes, les lods & ventes, lodes, sont appellés honneurs, issues, accordement, parce que le seigneur censier, en les recevant, loue ou alloue, approuve, agrée & accorde la vente, & investit l'acquéreur de l'héritage par lui acquis, en reconnoissance de quoi les lods lui sont payés.
Ainsi il faut écrire lods, & non pas lots, comme quelques-uns le font mal-à-propos.
Pour ce qui est du mot de ventes, que l'on joint assez ordinairement avec celui de lods, il n'est pourtant pas toujours synonyme ; car, dans plusieurs coûtumes, comme Troyes & Sens, les lods sont dûs par l'acquéreur, & les ventes par le vendeur. C'est pourquoi, dans les anciens titres, on lit lodes ou laudes, & vendas : les ventes sont dûes par les vendeurs, pour la permission de vendre ; & les lods, par l'acquéreur, pour être reconnu propriétaire par le seigneur.
On disoit anciennement venditio, dans la même signification que la laude ou louade, leuda, pour exprimer le droit qui se payoit au seigneur pour toute sorte de ventes.
La coûtume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y a que lods ou ventes seulement.
Celle de Paris ne se sert que du terme de ventes, & néanmoins dans l'usage on y confond les lods & ventes, & l'on joint ordinairement ces deux termes ensemble, comme ne signifiant qu'un même droit qui est dû par le nouvel acquéreur.
L'usage des lods & ventes ne peut être plus ancien que celui des baux à cens, qui a produit la distinction des héritages roturiers d'avec les fiefs, & a donné occasion de percevoir des lods & ventes aux mutations par vente des héritages roturiers ; on ne trouve même guere d'actes où il soit parlé de lods & ventes avant le xij. siecle.
Les lods & ventes, ou lods simplement, sont dûs pour les mutations par vente ou par contrat équipolent à vente.
Ils se perçoivent à proportion du prix porté par le contrat ; si le seigneur trouve ce prix trop foible, il peut user du retrait féodal, si c'est un fief ; ou du retrait censuel, si c'est une roture, & que le retrait censuel ait lieu dans le pays.
La coûtume d'Auvergne donne au seigneur le droit de sujet, c'est-à-dire de faire surenchérir l'héritage.
Il est aussi dû des lods en cas d'échange, suivant les édits & déclarations qui ont assimilé les échanges aux ventes.
Le decret volontaire ou forcé, le contrat de bail à rente rachetable, la vente à faculté de rémeré, le contrat appellé datio in solutum, & la donation à titre onéreux, produisent des lods & ventes.
Mais il n'en est pas dû pour une vente à vie, ni pour un bail emphytéotique, à moins qu'il n'y ait eu des deniers donnés pour entrée.
Il n'en est pas dû non plus pour la résolution du contrat de vente, lorsqu'elle est faite pour une cause inhérente au contrat même, mais seulement lorsque le contrat est résolu volontairement pour une cause postérieure au contrat.
Les privilégiés qui sont exempts des droits seigneuriaux en général dans la mouvance du roi, sont conséquemment aussi exempts des lods & ventes.
La quotité des lods & ventes est différente, selon les coûtumes.
Dans celles d'Anjou & Maine, le droit de ventes est de 20 deniers tournois pour livre, sinon en quelques contrées où il y a ventes & issues, qui sont de 3 s. 4 d. pour livre.
Quelques coûtumes, comme Lagny, disent que les lods & ventes sont de 3 s. 4 d. & se payent par le vendeur ; & quand il est dit, francs deniers, l'acquéreur doit les venteroles, qui sont de 20 deniers tournois par livre.
A Paris & dans plusieurs autres coûtumes, les lods & ventes sont de 12 deniers ; dans d'autres coûtumes, ils sont plus ou moins forts.
Dans le pays de Droit écrit, les lods sont communément du sixieme plus ou moins, ce qui dépend des titres & de l'usage, il y a des cas où il n'est dû qu'un milod. Voyez MILOD.
Les commentateurs des coûtumes ont la plûpart traité des lods & ventes sur le titre des fiefs & censives.
M. Guyot, tome III. de ses traités ou dissertations sur les matieres féodales, a fait un traité particulier du quint & des lods & ventes. Voyez CENSIVE, FIEF & MUTATION, SEIGNEUR, ROTURE. (A)
|
| LOEWENSTEIN | Lovesteniensis comitatus, (Géog.) petit comté d'Allemagne en Franconie, long de quatre lieues sur deux de large, & n'ayant rien de remarquable.
Il n'en est pas de même du château de Loewenstein en Hollande, situé à la pointe de l'île de Bomenel, entre la Meuse & le Wahal, vis-à-vis de Workum. Ce château réservé de nos jours pour les prisonniers d'état, est bien autrement cher aux habitans des Provinces-Unies, pour avoir été le premier lieu qui affranchit les peuples belgiques du joug tyrannique espagnol. Un nommé Henri Ruyter, nom heureux aux Hollandois, homme plein de bravoure, fit en 1571, une des actions les plus hardies, dont il soit parlé dans l'histoire. Il osa le premier, & lui quatrieme, lever l'étendard de la liberté contre toute la puissance du duc d'Albe. Il surprit ce château de Loewenstein, y entra en habit de cordelier, avec ses trois compagnons, égorgea la garnison, & se rendit maître de la place. Le duc d'Albe envoya des troupes qui le canonnerent, & fondirent dedans par la breche. Ruyter n'espérant aucune capitulation, se jette dans le magasin des poudres ; là tenant d'une main le sabre dont il étoit armé, épuisé & percé de coups, il mit de l'autre main le feu aux poudres, & fit sauter avec lui la plus grande partie de ses ennemis. Cet exploit releva singulierement le courage des confédérés. Dèslors on ne vit plus de leur part que des armées en campagne, des flottes sur mer, des villes attaquées & emportées d'assaut. Ce fut un feu qui courut toute la Flandres. La Zélande, la Gueldres, l'Ovérissel, la Frise occidentale, embrasserent le parti de la Hollande ; & l'entiere défection de la tyrannie d'Espagne s'acheva l'année suivante. (D.J.)
|
| LOF | S. m. (Marine) c'est la moitié du vaisseau considéré par une ligne qui le diviseroit également de proue à poupe, laissant une moitié à stribord du grand mât, & l'autre moitié à bas bord ; & celle qui se trouve au vent s'appelle lof. Ce terme a différentes significations, suivant qu'il est joint à d'autres, dont voici les principales :
Au lof, commandement d'aller au plus près du vent.
Bouter le lof, c'est mettre les voiles en écharpe pour prendre le vent.
Etre au lof, c'est être sur le vent, s'y maintenir. Dans la Méditerranée on dit être au lof, quand on parle du côté du vaisseau qui est vers la mer, & être à rive, lorsqu'on est du côté qui regarde la terre.
Tenir le lof, c'est serrer le vent, prendre le vent de côté.
Lof signifie encore le point d'une basse voile qui est vers le vent : ainsi lever le grand lof, c'est lever le lof de la grande voile.
Lof au lof, commandement de mettre le vaisseau de telle sorte qu'il le fasse venir vers le lof, c'est-à-dire vers le vent.
Lof pour lof, commandement de virer vent arriere, en mettant au vent un côté du vaisseau pour l'autre.
|
| LOFNA | (Mythologie) c'est ainsi que les anciens Goths appelloient une déesse, dont la fonction étoit de reconcilier les époux & les amans les plus desunis.
|
| LOG | S. m. (Mes. juive) mesure des liquides chez les Hébreux, qui contenoit un caph & un tiers, c'est-à-dire cinq sixiemes d'une pinte d'Angleterre.
Il est fait mention du log au II. liv. des Rois, vj. 25, comme d'une mesure de tous liquides. Dans le Lévitique, chap. xiv. v. 12, ce mot signifie particulierement la mesure d'huile, que les Lépreux étoient obligés d'offrir au temple après leur guérison.
Suivant les écrivains juifs, le log faisoit la quatrieme partie d'un caph, la douzieme d'un hin, la soixante-douzieme d'un bath, ou épha, & la sept cent vingtieme d'un choron ou chomer. Cet article, pour le dire en passant, contient plus d'erreurs que de lignes dans le dictionnaire de Trévoux. Voyez l'appréciation du log, au mot MESURE. (D.J.)
|
| LOGARITHME | S. m. (Arithmét.) nombre d'une progression arithmétique, lequel répond à un autre nombre dans une progression géométrique.
Pour faire comprendre la nature des logarithmes, d'une maniere bien claire & bien distincte, prenons les deux especes de progression qui ont donné naissance à ces nombres ; savoir, la progression géométrique, & la progression arithmétique : supposons donc que les termes de l'une soient directement posés sous les termes de l'autre ; comme on le voit dans l'exemple suivant,
1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
en ce cas, les nombres de la progression inférieure, qui est arithmétique, sont ce que l'on appelle les logarithmes des termes de la progression géométrique qui est en-dessus ; c'est-à-dire que 0 est le logarithme de 1, 1 est le logarithme de 2, 2 est le logarithme de 4, & ainsi de suite.
Ces logarithmes ont été inventés pour rendre le calcul plus expéditif, comme on le verra plus bas.
Le mot logarithme est formé des mots grecs , raison, & , nombre ; c'est-à-dire raison de nombres.
Afin que l'on entende maintenant la doctrine & l'usage des logarithmes, il faut se rendre bien attentif aux propositions suivantes.
Proposition premiere. En supposant que le logarithme de l'unité soit 0, le logarithme du produit de deux nombres quelconques, tels que 4 & 8, sera toujours égal à la somme 5 des logarithmes des deux racines ou produisans ; ce qui est évident par les deux progressions que l'on a citées, car ajoutant 2 à 3, on a la somme 5, qui est le logarithme du produit 32, ce qui doit arriver effectivement, car puisque 4 x 8 = 32, l'on aura cette proportion géométrique : 1. 4 : : 8. 32, dont les logarithmes doivent une proportion arithmétique, ainsi l'on aura l 1. l. 4 : l 8. l 32 (la lettre l signifie le logarithme du nombre qu'elle précede) ; mais on sait que dans une proportion arithmétique, la somme des extrêmes est égale à la somme des moyens ; ainsi l 1 + l 32 = l 4 + l 8 ; or le logarithme de 1 ou l 1 = 0 (par la supp.) ; donc l 32 = l 4 + l 8. C. Q. F. D.
Proposition seconde. Le logarithme du quotient 16 du nombre 64 divisé par 4, est égal à la différence qu'il y a entre le logarithme de 64 & le logarithme de 4 ; c'est-à-dire que l 16 = l 64 - l 4 ; car par la supposition 64/4 = 16 ; donc en multipliant par 4, 64 x 1 = 16 x 4, ainsi 1. 4 : : 16. 64 ; donc l 1 + l 64 = l 4 + l 16. Or l 1 = 0 ; par conséquent l 64 = l 4 + l 16 ; donc enfin l 64 - l 4 = l 16. C. Q. F. D.
Proposition troisieme. Le logarithme d'un nombre n'est que la moitié du logarithme de son quarré. Démonstration ; prenez 8, quarrez le, vous aurez 64. Il faut donc prouver que l 8 = l 64/2 : par la supposition 8 x 8 = 64 x 1 ; donc 1. 8 : : 8. 64 ; ainsi l 1. l 8 : l 8. l 64 ; donc l 1 + l 64 = l 8 + l 8 = 2 l 8, or l 1 = 0 ; donc l 64 = 2 l 8, & par conséquent en divisant l'un & l'autre nombre par 2, on aura l 64/2 = l 8. C. Q. F. D.
Proposition quatrieme. Le logarithme d'un nombre n'est que le tiers du logarithme de son cube. Démonstration ; prenez le nombre 2 & faites son cube 8, je dis que l 2 = l 8/3, car puisque 4 x 2 = 8 x 1, on aura 1. 4 : : 2. 8 ; donc l 1. l 4 : l 2. l 8 ; or par la démonstration précédente, 4 étant le quarré de 2, l 4 = 2 l 2 ; donc l 1. 2 l 2 : l 2. l 8 ; par conséquent l 1 + l 8 = 2 l 2 + l 2 = 3 l 2, & comme l 1 = 0, on aura l 8 = 3 l 2 ; donc l 8/3 = l 2. C. Q. F. D.
Les propriétés que nous venons de démontrer, ont servi de fondement à la construction des tables des logarithmes, moyennant lesquelles on fait par l'addition & la soustraction, les opérations que l'on seroit obligé sans leur secours, d'exécuter avec la multiplication, la division & l'extraction des racines, comme on va le faire voir en reprenant les deux progressions précédentes :
1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. &c.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &c.
Voulez-vous multiplier 4 par 16, cherchez les logarithmes 2. 4. qui répondent à ces nombres, faites-en la somme 6, elle est le logarithme de leur produit 64.
Cherchez donc dans la table le nombre qui répond au logarithme 6, vous trouverez 64, qui est effectivement le produit de 4 par 16.
S'il s'agissoit de diviser 128 par 8, on chercheroit les logarithmes 7, 3. De ces nombres on ôteroit 3 de 7, le reste 4 seroit le logarithme de leur quotient, auquel répond le nombre 16.
Si on cherche la racine quarrée de 64, on n'a qu'à prendre la moitié de son logarithme 6, c'est 3 auquel répond 8 ; ainsi 8 est la racine quarrée de 64.
Il n'est pas plus difficile de trouver la racine cubique de 64, prenez le tiers de son logarithme 6, vous aurez 2, auquel répond 4.
Ainsi 4 est la racine cubique de 64. On feroit donc avec une extrême facilité, les opérations les plus laborieuses du calcul, si l'on avoit les logarithmes d'une grande quantité de nombres ; & c'est a quoi l'on a tâché de parvenir dans la construction des tables des logarithmes.
La découverte des logarithmes est dûe au baron Neper, écossois, mort en 1618. Il faut avouer cependant que Stifelius, arithméticien allemand, avoit remarqué avant lui la propriété fondamentale des logarithmes ; savoir que le logarithme du produit de deux nombres est égal à la somme de leurs logarithmes. Mais cette proposition resta stérile entre ses mains, & il n'en tira aucun usage pour abreger les opérations, ce qui fait l'essentiel de la découverte de Neper. Kepler dit aussi que Juste-Byrge, astronome du landgrave de Hesse, avoit imaginé les logarithmes ; mais de l'aveu de Kepler même, l'ouvrage où Byrge en parloit, n'a jamais paru.
Neper publia en 1614, sa découverte dans un livre intitulé mirifici logarithmorum canonis descriptio. Les logarithmes des nombres qu'il donne dans cet ouvrage, different de ceux que nous employons aujourd'hui dans nos tables ; car dans les nôtres le logarithme de 10 est l'unité, ou ce qui est la même chose, 1,000000 ; & dans celles de Neper, le logarithme de 10 est 2,3025850. Nous verrons au mot LOGARITHMIQUE, la raison de cette différence. Mais cette supposition lui paroissant peu commode, il indiqua lui-même des tables de logarithmes, telles que nous les avons aujourd'hui. Elles furent construites après sa mort par Henri Briggs, dans son ouvrage intitulé Arithmetica logarithmica. Adrien Ulacq, mathématicien des Pays-bas, perfectionna le travail de Briggs ; & plusieurs autres ont travaillé depuis sur cette matiere. Les tables de logarithmes, qui ont aujourd'hui le plus de réputation pour l'étendue & l'exactitude, sont celles de Gardiner, in-4°. Celles de M. Deparcieux, de l'académie des Sciences, méritent aussi d'être citées. Voyez l'histoire des Mathématiques de M. Montucla, tom. II. part. IV. liv. I.
Théorie des logarithmes. Soit proposé de trouver le logarithme d'un nombre quelconque, & de construire un canon ou une table pour les logarithmes naturels. 1°. Comme 1, 10, 100, 1000, 10000, &c. constituent une progression géométrique, leurs logarithmes peuvent donc être pris dans une progression arithmétique à volonté ; or pour pouvoir exprimer par des fractions décimales les logarithmes de tous les nombres intermédiaires, nous prendrons la progression 0. 0000000, 1. 0000000, 2. 0000000, 3. 0000000, 4 0000000, &c. de maniere que le premier de ces nombres ou zero, soit le logarithme de 1, que le second soit le logarithme de 10, le troisieme celui de 100, & ainsi de suite. Voyez DECIMAL. 2°. Il est évident qu'on ne pourra point trouver des logarithmes exacts pour les nombres qui ne sont point compris dans la série géométrique ci-dessus, 1, 10, 100, &c. mais on pourra en avoir de si approchans de la vérité, que dans l'usage ils seront aussi bons que s'ils étoient exacts. Pour rendre ceci sensible, supposons qu'on demande le logarithme du nombre 9 ; j'introduirai entre 1. 0000000 & 10. 0000000, un moyen proportionnel géométrique, & cherchant entre leurs logarithmes 0. 00000000 & 1. 00000000, un moyen proportionnel arithmétique, celui-ci sera évidemment le logarithme de l'autre, c'est-à-dire d'un nombre qui surpassera 3 d'un peu plus que 1622777/100000000, & par conséquent qui sera encore fort éloigne de 9. Je chercherai donc entre 3 1622777/100000000 & 10, un autre moyen proportionnel géométrique, qui approchera par conséquent plus de 9 que le premier ; & entre 10 & ce nouveau moyen proportionnel, j'en chercherai encore un troisieme, & ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en trouve deux consécutifs, dont l'un soit immédiatement au-dessus, & l'autre immédiatement au-dessous de 9, & cherchant un moyen proportionnel entre ces deux nombres là, & puis encore un autre entre celui-là & celui des deux derniers qui aura 9 entre lui & le précédent, on parviendra enfin à un moyen proportionnel qui sera égal 9 0 0000000/1 0000000, lequel n'étant pas éloigné de 9 d'une dix millionieme partie d'unité, son logarithme peut, sans aucune erreur sensible, être pris pour le logarithme de 9 même. Je reviens donc à mes moyens proportionnels géométriques, & prenant l'un après l'autre, le logarithme de chacun d'eux par l'introduction d'autant de moyens proportionnels arithmétiques, je trouve enfin que 0. 9542425 est le logarithme du dernier moyen proportionnel géométrique ; & j'en conclus que ce nombre peut être pris sans erreur sensible, pour le logarithme de 9, ou qu'il en approche extrêmement.
3°. Si on trouve de même des moyens proportionnels entre 1. 0000000 & 3. 1622777, que nous avons vû plus haut être le moyen proportionnel entre 1. 0000000 & 10. 0000000, & qu'on cherche en même tems le logarithme de chacun d'eux, on parviendra à la fin à un logarithme très-approchant de celui de 2, & ainsi des autres. 4°. Il n'est cependant pas nécessaire de prendre tant de peine pour trouver les logarithmes de tous les nombres, puisque les nombres, qui sont le produit de deux nombres, ont pour logarithmes la somme des logarithmes de leurs produisans ; & réciproquement, si l'on a le logarithme du produit de deux nombres, & celui de l'un de ses produisans, on aura facilement le logarithme de l'autre produisant ; de même ayant le logarithme d'un quarré, d'un cube, &c. on a celui de sa racine, ainsi qu'on l'a démontré dans les propositions précédentes ; par conséquent, si l'on prend la moitié du logarithme de 9 trouvé ci-dessus, l'on aura le logarithme de 3, savoir 0. 4771212.
Dans les logarithmes, les nombres qui précedent le point expriment des entiers ; & ceux qui sont après le point expriment le numérateur d'une fraction, dont le dénominateur est l'unité, suivie d'autant de zéros que le numérateur a de figures. L'on donne à ces entiers le nom de caractéristiques, ou d'exposans, parce qu'ils marquent, en leur ajoutant 1, combien de caracteres doit avoit le nombre auquel le logarithme correspond ; ainsi 0 à la tête d'un logarithme, ou placé dans le logarithme avant le point, signifie que le nombre correspondant ne doit avoir que le seul caractere des unités, qu'une seule figure, parce que ajoutant 1 à 0 caractéristique, on aura le nombre 1, qui marque le nombre de figures qu'a le nombre auquel se rapporte le logarithme ; 1 caractéristique signifie que le nombre correspondant au logarithme, contient non-seulement des unités, mais encore des dixaines, & non pas des centaines ; qu'en un mot, il contient deux figures, & qu'il a sa place entre dix & cent, & ainsi des autres exposans ou caractéristiques. Il s'ensuit donc que tous les nombres, lesquels quoique différens, ont néanmoins autant de caracteres ou de figures les uns que les autres ; par exemple, les nombres compris entre 1 & 10, entre 10 & 100, entre 100 & 1000, &c. doivent avoit des logarithmes dont la caractéristique soit la même, mais qui different par les chiffres placés à droite du point.
Si le nombre n'est nombre qu'improprement, mais qu'il soit en effet une fraction décimale exprimée numériquement, ce qui arrivera lorsqu'il n'aura de caractere réel qu'après le point, alors il devra évidemment avoir un logarithme négatif, & de plus la caractéristique de ce logarithme négatif marquera combien il y aura de 0 dans le nombre avant sa premiere figure réelle à gauche, y compris le 0, qui est toujours censé se trouver avant le point, ainsi le logarithme de la fraction décimale 0. 256 est 1. 40824 ; celui de la fraction décimale 0. 0256 est 2. 40824, &c.
Tout cela est une suite de la définition des logarithmes ; car puisque les nombres entiers 1, 10. 100, &c. ont pour logarithme 0, 1, 2, &c. les fractions 1/10, 1/100, &c. qui forment une progression géométrique avec les entiers 1, 10, 100, &c. doivent avoir pour logarithmes les nombres négatifs, 1, 2, &c. qui forment une progression arithmétique avec les nombres 0, 1, 2, &c. donc &c.
Soit proposé maintenant de trouver le logarithme d'un nombre plus grand que ceux qui sont dans les tables, mais moindre que 10000000. Retranchez au nombre proposé ses quatre premieres figures vers la gauche, cherchez dans les tables le logarithme de ces quatre premieres figures, ajoutez à la caractéristique de ce logarithme autant d'unités qu'il est resté de figures à droite dans le nombre proposé. Soustrayez ensuite le logarithme trouvé de celui qui le suit immédiatement dans les tables, & faites après cela cette proportion, comme la différence des nombres qui correspondent à ces deux logarithmes consécutifs est à la différence des logarithmes eux-mêmes, ainsi ce qui reste à droite dans le nombre proposé est à un quatrieme terme, que nous pourrons nommer la différence logarithmique ; en effet, si vous l'ajoutez au logarithme d'abord trouvé, vous pourrez sans erreur sensible, prendre la somme pour le logarithme cherché. Si l'on demandoit par exemple, le logarithme du nombre 92375, je commencerai par en retrancher les quatre premieres figures à gauche, savoir 9237, & je prendrois dans les tables les logar. 3. 9655309 du nombre qu'elles forment à elles seules, dont j'augmenterois la caractéristique 3 d'une unité, ce qui me donneroit 4. 9655309, auquel il ne s'agiroit plus que d'ajouter la différence logarithmique convenable : or pour la trouver, je prendrois dans les tables le logarithme du nombre immédiatement au-dessus
pour la valeur du logarithme cherché. La raison de cette opération est que les différences des trois nombres a, b, c, lorsque ces différences sont fort petites, sont entr'elles, à très-peu près, comme les différences de leurs logarithmes. Voyez LOGARITHMIQUE.
Si le nombre proposé étoit une fraction ou un entier plus une fraction, il faudroit d'abord réduire le tout à une seule fraction, & chercher séparément le logarithme du numérateur & celui du dénominateur par la méthode qu'on vient de donner, ensuite on retrancheroit les deux logarithmes l'un de l'autre, & on auroit le logarithme de la fraction proposée.
Soit proposé de plus de trouver le nombre correspondant à un logarithme plus grand qu'aucun de ceux qui sont dans les tables. Soustrayez d'abord du logarithme donné le logarithme de 10, ou celui de 100, ou celui de 1000, ou celui de 10000, le premier en un mot, de cette espece qui donnera un restant d'un nombre de caracteres, tels qu'il s'en trouve dans les tables. Trouvez le nombre correspondant à ce restant considéré lui-même comme logarithme, & multipliez ce nombre trouvé par 100, par 1000, ou par 10000, &c. le produit sera le nombre cherché.
auquel correspond dans les tables le nombre 4285 71/100. la fraction cherchée sera donc 428571/1000000. On appercevra la raison de cette regle, en observant que toutes fractions étant le quotient de son numérateur par son dénominateur, l'unité doit être à la fraction comme le dénominateur est au numérateur ; mais comme l'unité est à la fraction qui doit correspondre au logarithme négatif donné, ainsi 10000 est au nombre correspondant au logarithme restant ; donc si l'on prend 10000 pour dénominateur, & le nombre correspondant pour numérateur, on aura la fraction requise.
Soit enfin proposé de trouver un quatrieme proportionnel à trois nombres donnés. Vous ajouterez le logarithme du second à celui du troisieme, & de la somme que cette addition vous aura fournie, vous ôterez le logarithme du premier, le restant sera le logarithme du quatrieme nombre cherché. Par exemple, soit donné les nombres 4, 68 & 3.
qui doit être le logarithme du nombre cherché ; & comme le nombre correspondant dans les tables est 51, j'en conclus que 51 est le nombre cherché lui-même.
Ce problème est du plus grand usage dans la Trigonométrie. Voyez TRIANGLE & TRIGONOMETRIE.
Tous ces problèmes sur les logarithmes se déduisent évidemment de la théorie des logarithmes donnée ci-dessus, & ils peuvent se démontrer aussi par la théorie de la logarithmique qu'on trouvera à son article.
Nous terminerons celui-ci par une question qui a été fort agitée entre MM. Léibnitz & Bernoulli. Les logarithmes des quantités négatives sont-ils réels ou imaginaires ? M. Léibnitz tenoit pour le second, M. Bernoulli pour le premier. On peut voir les lettres qu'ils s'écrivoient à ce sujet ; elles sont imprimées dans le commercium epistolicum de ces deux grands hommes, publié en 1745 à Lausanne. J'eus autrefois (en 1747 & 1748) une controverse par lettres avec le célebre M. Euler sur le même sujet ; il soutenoit l'opinion de M. Léibnitz, & moi celle de M. Bernoulli. Cette controverse a occasionné un savant mémoire de M. Euler, imprimé dans le volume de l'académie de Berlin pour l'année 1749. Depuis ce tems, M. de Foncenex a traité la même matiere dans le premier volume des mémoires de l'académie de Turin, & se déclare pour le sentiment de M. Euler qu'il appuie de nouvelles preuves. J'ai composé sur ce sujet un écrit dans lequel je me déclare au contraire pour l'opinion de M. Bernoulli. Comme cet écrit aura probablement vu le jour avant la publication du présent article, je ne l'insererai point ici, & je me contenterai d'y renvoyer mes lecteurs, ainsi qu'aux écrits dont j'ai parlé ; ils y trouveront toutes les raisons qu'on peut apporter pour & contre les logarithmes imaginaires des quantités négatives. Je me bornerai à dire ici, 1°. Que si on prend entre deux nombres réels & positifs, par exemple 1 & 2, une moyenne proportionnelle, cette moyenne proportionnelle sera aussi-bien - 2 que + 2, & qu'ainsi le logarithme de - 2 & celui de 2 seront le même, savoir log. 2/2. 2°. Que si dans l'équation y = c x & le logarithmique (Voyez LOGARITHMIQUE & EXPONENTIEL) on fait x = 1/2, on aura y = c 1/2 = ± c, & qu'ainsi le logarithmique aura des ordonnées négatives & positives, en tel nombre qu'on voudra à l'infini ; d'où il s'ensuit que les logarithmes de ces ordonnées seront les mêmes, c'est-à dire des quantités réelles. 3°. A ces raisons ajoutez celle qui se tire de la quadrature de l'hyperbole entre ses asymptotes, que Bernoulli a donnée le premier, & que j'ai fortifiée par de nouvelles preuves ; ajoutez enfin beaucoup d'autres raisons que l'on peut lire dans mon mémoire, ainsi que mes réponses aux objections de MM. Euler & de Foncenex, & on sera, je crois, convaincu que les logarithmes des nombres négatifs peuvent être réels. Je dis peuvent être, & non pas sont ; c'est qu'en effet on peut prendre tel système de logarithmes qui rendra imaginaires les logarithmes des nombres négatifs. Par exemple, M. Euler prouve très-bien que si on exprime les logarithmes par des arcs de cercle imaginaires, le logarithme de - 1 sera imaginaire ; mais au fond tout système de logarithmes est arbitraire en soi ; tout dépend de la premiere supposition qu'on a faite. On dit, par exemple, que le logarithme de l'unité est = 0, & que les logarithmes des fractions sont négatifs. Tout cela n'est qu'une supposition ; car on pourroit prendre une telle progression arithmétique que le logarithme de l'unité ne fût pas égal à 0, & que les logarithmes des fractions fussent des quantités réelles & positives. Il y a bien lieu de craindre que toute cette dispute sur les logarithmes imaginaires, ne soit qu'une dispute de mots, & n'ait été si agitée que faute de s'entendre. Ce n'est pas le premier exemple de dispute de mots en Géométrie. Voyez CONTINGENCE & FORCES VIVES.
MM. Gregori, Mercator, Newton, Halley, Cotes, Taylor, &c. ont donné différentes méthodes pour la construction des tables des logarithmes, que l'on peut voir dans les Transactions philosophiques. Voyez sur-tout un mémoire de M. Halley dans les Transact. philos. de 1695. n°. 216. Sans entrer ici dans ce détail, nous donnerons une méthode assez simple pour calculer les logarithmes.
Nous supposerons d'abord (voyez l'article LOGARITHMIQUE) que la soutangente de la logarithmique soit égale a l'ordonnée que l'on prend pour l'unité, nous prendrons une ordonnée 1 - u qui soit plus petite que l'unité, & nous aurons, en nommant l'abscisse d x, l'équation d x = - , comme il résulte de l'article cité ; d'où il s'ensuit encore que x est égal au logarith. de 1 - u, & qu'ainsi le logarithme de 1 - u est égal à l'intégrale de - . Or faisant la division suivant les regles ordinaires, ou supposant , = , on trouve (voyez DIVISION, BINOME, EXPOSANT, SERIE, SUITE, &c.) que - (d u) /(1 - u) = - d u - u d u - u2 d u - u d u, &c. dont l'intégrale est - u - u2/2 - u3/3 - u4/4, &c. à l'infini ; & cette série est convergente, parce que les numérateurs & les dénominateurs vont toujours en diminuant, car u est plus petit que l'unité. Voyez FRACTION. On aura donc, en prenant un certain nombre de termes de cette suite, la valeur approchée du logarithme de 1 - u ; or connoissant le logarithme de la fraction 1 - u, on connoîtra le logarithme du nombre entier qui est troisieme proportionnel à cette fraction & à l'unité ; car ce logarithme est le même, mais pris avec un signe positif. Par exemple, si on veut avoir le logarithme du nombre 10, on cherchera celui de la fraction 1/10 = 1 - 9/10, ainsi u = 19/10. Donc le logarithme de 19/10 est - 9/10 - 81/200 - 729/3000 &c. & ainsi de suite ; & cette quantité prise avec le signe +, est le logarithme de 10.
Tout cela est vrai dans l'hypothese que la soutangente de la logarithmique soit = 1 ; mais si on vouloit que le logarithme de 10 fût 1, par exemple, au lieu d'être égal à la série précédente, alors tous les logarithmes des autres nombres devroient être multipliés par le rapport de l'unité à cette série. Voyez LOGARITHMIQUE. (O)
|
| LOGARITHMIQUE | S. f. (Géométrie) courbe qui tire ce nom de ses propriétés & de ses usages dans la construction des logarithmes & dans l'explication de leur théorie.
Si l'on divise la ligne droite A X (Pl. d'Analyse, fig. 37.) en un nombre égal de parties, & que par les points A, P, p, de division, on tire des lignes toutes paralleles entr'elles & continuellement proportionnelles, les extrêmités N, M, m, &c. de ces dernieres lignes, formeront la ligne courbe appellée logarithmique, desorte que les abscisses A P, A p, sont ici les logarithmes des ordonnées P M, p m, &c. puisque ces abscisses sont en progression arithmétique pendant que les ordonnées sont en progression géométrique. Donc si A P = x, A p = u, P M = y, p m = z, & qu'on nomme l y & l z les logarithmes de y & de z, on aura x = l y, u = l z, & par conséquent x/u = .
Propriétés de la logarithmique. Dans une courbe quelconque, si on nomme s la soutangente, on a - = - . Voyez SOUTANGENTE. Or dans la logarithmique, si on prend d x constant, c'est-à-dire les abscisses en progression arithmétique, dont la différence soit d x, les ordonnées seront en progression géométrique, & par conséquent les différences de ces ordonnées (voyez PROGRESSION GEOMETRIQUE) seront entr'elles comme les ordonnées ; donc (d y)/y sera constant, d'où sera constant ; donc puisque (hyp.) d x est constant, s le sera aussi ; donc la soutangente de la logarithmique est constante ; j'appelle cette soutangente a.
2°. Si on fait a = 1, on aura d x = ; dont l'intégrale est x = log. y ; & si on suppose un nombre c, tel que son logarithme, soit = 1, on aura x log. c = log. y, & par conséquent log. c x = log. y & y = c x. Voy. LOGARITHME. C'est-là ce qu'on appelle repasser des logarithmes aux nombres, c'est-à-dire d'une équation logarithmique x = l y, à une équation finie exponentielle y = c x. Voyez EXPONENTIEL.
3°. Nous avons expliqué au mot EXPONENTIEL ce que signifie cette équation y = c x appliquée à la logarithmique. En général, si dans une même logarithmique on prend quatre ordonnées qui soient en proportion géométrique ; l'abscisse renfermée entre les deux premieres sera égale à l'abscisse renfermée entre les deux autres, & le rapport de cette abscisse à la soutangente sera la logarithme du rapport des deux ordonnées. C'est une suite de l'équation = qui donne x/a = log. (y/b), en supposant que y = b, lorsque x = 0.
4°. Si on prend pour l'unité dans la logarithmique l'ordonnée qui est égale à la soutangente, on trouvera que l'abscisse qui répond au nombre 10 (c'est-à-dire à l'ordonnée qui seroit égale à dix fois celle qu'on a prise pour l'unité) on trouvera, dis-je, que cette abscisse ou le logarithme de 10 est égal à 2, 30258509 (voyez LOGARITHME), c'est-à-dire que cette abscisse est à la soutangente comme 230258509 est à 100000000 ; c'est sur ce fondement que Képler avoit construit ses tables de logarithmes, & pris 2, 3025850 pour le logarithme de 10.
5°. Mais si on place autrement l'origine de la logarithmique, & de maniere que l'ordonnée 1 ne soit plus égale à la soutangente, & que l'abscisse comprise entre les ordonnées 1 & 10 soit égale à 1 ; ce qui se peut toujours supposer, puisqu'on peut placer l'origine des x où l'on voudra, alors le logarithme de 10 sera 1, ou 1, 0000000, &c. & la soutangente sera telle que l'on aura 2, 3025850 à l'unité, comme 1, 0000000 est à la valeur de la soutangente, qui sera par conséquent dans ce cas-ci 1 | 0000000/2 | 3025850 ou 0, 43429488. C'est sur cette supposition que sont calculés les logarithmes de Briggs, qui sont ceux des tables ordinaires.
6°. Dans deux logarithmiques différentes, si on prend des ordonnées proportionnelles, les abscisses correspondantes seront entr'elles comme les soutangentes. C'est encore une suite de l'équation = .
7°. Si dans une même logarithmique on prend trois ordonnées très proches, les différences de ces ordonnées seront entr'elles à très-peu-près comme les différences des abscisses. Car soient y, y', y'', les trois ordonnées, & d x, d x' les abscisses, on aura = à très-peu près ; & de meme = à très-peu près. Donc puisque y & y' different très-peu l'une de l'autre, on aura à très-peu près d x : d x': : y'- y : y''- y'.
8°. Comme une progression géométrique s'étend à l'infini des deux côtés de son premier terme, il est évident que la logarithmique s'étend à l'infini le long de son axe A X au-dessus & au-dessous du point A. Il est de plus évident que A X est l'asymptote de la logarithmique. Voyez ASYMPTOTE. Car comme une progression géométrique va toujours en décroissant, sans néanmoins arriver jamais à zéro, il s'ensuit que l'ordonnée P m va toûjours en décroissant, sans jamais être absolument nulle. Donc, &c.
Sur la quadrature de la logarithmique, voyez QUADRATURE.
LOGARITHMIQUE SPIRALE, ou SPIRALE LOGARITHMIQUE, est une courbe dont voici la construction. Divisez un quart de cercle en un nombre quelconque de parties égales, aux points N, n, n, &c. (Pl. d'anal. fig. 22.) & retranchez des rayons C N, C n, C n, des parties continuellement proportionnelles C M, C m, C m, les points M, m, m, &c. formeront la logarithmique spirale. Par conséquent les arcs A N, A n, &c. sont les logarithmes des ordonnées ou rayons C M, C m, &c. pris sur les rayons du cercle, & en partant de son centre, qui dans cette courbe peut être considéré comme pole. On peut donc regarder la logarithmique spirale comme une logarithmique ordinaire dont l'axe a été roulé le long d'un cercle A N, & dont les ordonnées ont été arrangées de maniere qu'elles concourent au centre C, & qu'elles se trouvent prises sur les rayons C N prolongés.
Cette courbe a plusieurs propriétés singulieres découvertes par M. Jacques Bernoulli son inventeur. 1°. Elle fait une infinité de tours autour de son centre C, sans jamais y arriver ; ce qu'il est facile de démontrer : car les rayons C M, C m, C m, &c. de cette courbe forment une progression géométrique dont aucun terme ne sauroit être zéro, & par conséquent la distance de la spirale à son centre C, ne peut jamais être zéro. 2°. Les angles C M m, C m m des rayons C M, C m avec la courbe, sont par-tout égaux. Car nommant C M, y, & N n, d x, on aura = , puisque les arcs A N sont les logarithmes des y. Voyez ci-dessus LOGARITHMIQUE. Or décrivant du rayon C M un arc que l'on nommera d z, on aura = , en faisant A C = r ; donc d x = ; donc = . Donc d y = ; donc l'angle C M m est constant. 3°. La développée de cette courbe, ses caustiques par refraction & par réflexion, &c. sont d'autres logarithmes spirales : c'est pour cette raison que M. Jaques Bernoulli ordonna qu'on mît sur son tombeau une logarithmique spirale avec cette inscription, eadem mutata resurgo. Voyez l'analyse des infiniment petits, par M. de l'Hôpital. Voyez aussi DEVELOPPEE & CAUSTIQUE. (O)
LOGARITHMIQUE, pris adjectivement, (Géom.) se dit de ce qui a rapport aux logarithmes. Voyez LOGARITHME, LOGISTIQUE.
C'est ainsi que nous disons l'Arithmétique logarithmique, pour dire le calcul des logarithmes, ou le calcul par le moyen des tables des logarithmes.
|
| LOGATE | (Cuisine) gigot de mouton à la logate, est un gigot qu'on a bien battu, qu'on a lardé avec moyen lard, fariné & passé par la poële, avec du lard ou du sain doux, après avoir ôté la peau & la chair du manche, & l'avoir coupé. Lorsqu'il paroît assez doux, on l'empote avec une cuillerée de bouillon, assaisonné de sel, poivre, clou, & un bouquet. On l'étoupe ensuite avec un couvercle bien fermé, on le garnit de farine délayée, & on le fait cuire ainsi à petit feu.
|
| LOGE | S. f. en Architecture : les Italiens appellent ainsi une galerie ou portique formé d'arcades sans fermeture mobile, comme il y en a de voutées dans les palais du Vatican & de Montecavallo, & à Sofite dans celui de la chancellerie à Rome. Ils donnent encore ce nom à une espece de donjon ou belveder, au dessus du comble d'une maison.
On appelle aussi loge, une petite chambre au rez-de-chaussée, sous l'entrée d'une grande maison destinée pour le logement d'un portier ou d'un suisse.
On donne encore ce nom à de petites salles basses sûrement fermées dans une ménagerie, où l'on tient séparément des animaux rares, comme à la ménagerie de Versailles : latin, cavea.
Loge de comédie ; ce sont de petits cabinets ouverts pardevant avec appui, rangés au pourtour d'une salle de théatre, & séparés les uns des autres par des cloisons à jour, & décorés par-dehors avec sculpture, peinture, & dorure.
Il y a ordinairement trois rangs l'un sur l'autre.
LOGE, (Commerce) on appelle à Lyon, à Marseille, &c. loge du change, loge des Marchands, un certain lieu dans les places ou bourses où les marchands se trouvent à certaines heures du jour pour traiter des affaires de leur négoce.
Loge, que l'on appelle plus ordinairement comptoir, signifie aussi un bureau général établi en quelques villes des Indes pour chaque nation de l'Europe.
Loge est encore le nom qu'on donne aux boutiques qui sont occupées par les Marchands dans les foires. Dictionnaire de Commerce
LOGE, (Mar.) c'est le nom qu'on donne aux logemens de quelques officiers inférieurs dans un vaisseau : on dit loge de l'aumônier, loge du maître canonnier.
LOGE, (Jardin.) veut dire cellule où se logent les pepins des fruits, cavités ordinairement séparées par des cloisons : le melon a des loges qui tiennent sa semence renfermée.
|
| LOGEMENS | S. m. (Gram.) lieu d'une maison qu'on habite ; une maison est distribuée en différens logemens.
LOGEMENT, dans l'Art militaire, exprime quelquefois le campement de l'armée. Voyez CAMP.
Faire le logement, c'est aussi regler avec les officiers municipaux des villes, les différentes maisons de bourgeois où l'on doit mettre le soldat pour loger.
L'officier major, porteur de la route de sa Majesté, & chargé d'aller faire le logement en arrivant dans la ville & autre lieu où il n'y aura pas d'état major, doit aller chez le maire ou chef de la maison de ville, pour qu'il fasse faire le logement, conformément à l'extrait de la derniere revûe, qu'il faut lui communiquer. M. de Bombelles, service journalier de l'infanterie.
LOGEMENS du camp des Romains, (Art milit.) les militaires curieux seront bien aises d'en trouver ici la disposition ; les connoissances que j'en puis donner, sont le fruit de la lecture de Polybe, & du livre intitulé, le parfait capitaine. On doit ce petit & savant ouvrage à M. le duc de Rohan, colonel général des Suisses & Grisons, mort dans le canton de Berne en 1638, des blessures qu'il reçut à Rhinfeld, & enterré à Genève dans une chapelle du temple de S. Pierre. Il fut pendant tout le cours de sa vie le chef des Protestans en France, & leur rendit de grands services, soit par ses négociations, soit à la tête des armées. La maison de Rohan étoit autrefois zélée calviniste ; elle donne à présent des cardinaux au royaume : je viens à mon sujet, dont je ne m'écarterai plus.
On sait que les Romains furent long-tems à ne pas mieux posséder l'arrangement d'un camp, que le reste de la science militaire. Ils n'observerent à cet égard de regle & de méthode, que depuis qu'ils eurent vû le camp de Pyrrhus. Alors ils en connurent si bien l'avantage, que non-seulement ils en suivirent le modele, mais ils le porterent encore à un plus haut point de perfection ; & voici comme ils s'y prirent.
D'abord que l'armée marchant sur trois lignes arrivoit à l'endroit où l'on avoit tracé le camp, deux des lignes restoient rangées en bataille, pendant que la troisieme s'occupoit à faire les retranchemens. Ces retranchemens consistoient en un fossé de cinq piés de large, & de trois de profondeur, dont on rejettoit la terre du côté du camp, pour en former une espece de rempart, qu'on accommodoit avec des gasons & des palissades, lorsqu'il s'agissoit de n'y rester qu'une ou deux nuits.
Si l'on vouloit séjourner plus long-tems, on faisoit un fossé d'onze à douze piés de large, & profond à proportion, derriere lequel on élevoit un rempart fait de terre avec des fascines, revêtu de gasons. Ce rempart étoit flanqué de tours d'espace en espace, distantes de quatre-vingt piés, & accompagnées de parapets garnis de créneaux, de même que les murailles d'une ville. Les soldats accoutumés à ce travail, l'exécutoient sans quitter leurs armes. Nous apprenons de Tacite, liv. XXXI, que l'ordonnance étoit si sévere à ce sujet, que le général Corbulon, qui commandoit sur le Rhin, sous le regne de l'empereur Claudius, condamna à mort deux soldats, pour avoir travaillé aux retranchemens du camp, l'un sans épée, & l'autre n'ayant qu'un poignard.
On plaçoit le logement du consul, du préteur, ou du général, au lieu le plus favorable pour voir tout le camp, & au milieu d'une place quarrée ; les tentes destinées aux soldats de sa garde, étoient tendues aux quatre coins de cette place : on l'appelloit le prétoire, & c'étoit-là qu'il rendoit la justice. Attenant le logement du général, se trouvoit celui de ceux que le sénat envoyoit pour lui servir de conseil ; usage observé souvent du tems de la république ; c'étoient ordinairement des sénateurs, sur l'expérience desquels on pouvoit compter : on posoit pour les honorer deux sentinelles devant leurs tentes. Les logemens des lieutenans du consul étoient vraisemblablement dans le même endroit ; sur le même alignement, & à la proximité du général, étoit le questoire avec le logement du questeur, qui outre la caisse dont il étoit dépositaire, avoit la charge des armes, des machines de guerre, des vivres, & des habillemens. Son logement étoit gardé par des sentinelles, ainsi que les places des armes, des machines, des vivres, & des habits.
On élevoit toûjours dans la principale place du camp une espece de tribunal de terre ou de gason, où le général montoit, lorsqu'avant quelque expédition considérable, il lui convenoit d'en informer l'armée, de l'y préparer, & de l'encourager par un discours public. C'est une particularité que nous tenons de Plutarque, dans ses vies de Sylla, de César, & de Pompée.
Tous les quartiers du camp étoient partagés en rues tirées au cordeau, en pavillons des tribuns, des préfets, & en logemens pour les quatre corps de troupes qui composoient une légion, je veux dire les VELITES, HASTAIRES, PRINCES, & TRIAIRES. Voyez ces mots.
Mais les logemens de ces quatre corps étoient compris sous le nom des trois derniers corps, parce qu'on divisoit & qu'on incorporoit les vélites dans les trois autres corps ; & cela se pratiquoit de la maniere suivante.
Il s'agit maintenant d'entrer dans le détail des logemens du camp, de la distribution du terrein, & de la quantité qu'on en donnoit à chacun.
Les Romains donnoient dix piés de terre en quarré pour loger deux soldats ; ainsi dix cohortes de hastaires, qui ne faisoient que mille six cent quatre-vingt soldats, les vélites compris dans ce nombre, étoient logés au large, & il leur restoit encore de la place pour leur bagage.
Le même espace de terrein se donnoit aux princes, parce qu'ils étoient en pareil nombre ; moitié moins de terrein se distribuoit aux triaires, parce qu'ils étoient la moitié moins en nombre.
A la cavalerie on donnoit pour trente chevaux cent piés de terre en quarré, & pour les cent turmes, cent piés de large, & mille piés de long.
On donnoit à l'infanterie des alliés, pareil espace qu'aux légions romaines ; mais parce que le consul prenoit la cinquieme partie des légions des alliés, on retranchoit aussi dans l'endroit du camp qui leur étoit assigné, la cinquieme partie du terrein qu'on leur fournissoit ailleurs.
Quant à la cavalerie des alliés, elle étoit toûjours double de celle des Romains ; mais comme le général en prenoit le tiers pour loger autour de lui, il n'en restoit dans les logemens ordinaires qu'un quart de plus que celle des Romains ; & parce que l'espace de terrein étoit plus que suffisant, on ne l'augmentoit point. Cet espace de terrein contenoit, comme je l'ai dit, cent piés de large, & mille piés de long pour cent turmes.
Ces logemens de toutes les troupes étoient séparés par cinq rues, de cinquante piés de large chacune, & coupées par la moitié par une rue nommée Quintaine, de même longueur que les autres.
Polybe ne dit rien des portes du camp, de leur nom, & de leur position. Il y avoit quatre portes, parce que le camp faisoit un quarré ; la porte du prétoire, la porte décumene, la porte quintaine, & la porte principale.
A la tête des logemens du camp, il y avoit une rue de cent piés de large ; après cette rue, étoient les logemens des douze tribuns vis-à-vis des deux légions romaines, & les logemens des douze préfets, vis-à-vis deux légions alliées : on donnoit à chacun de ces logemens cinquante piés en quarré.
Ensuite venoit le logement du consul, nommé le prétoire, qui contenoit deux cent piés en quarré, & qui étoit posé au haut du milieu de la largeur du camp.
A gauche & à droite du logement du consul, il y avoit deux places, l'une celle du questeur, & l'autre celle du marché. Tout autour étoient logés les quatre cent chevaux & les seize cent trente hommes de pié, que le consul tiroit des deux légions des alliés. Les volontaires se trouvoient aussi logés dans cette enceinte, & de plus, il y avoit toûjours des logemens reservés pour les extraordinaires d'infanterie & de cavalerie qui pouvoient survenir.
On laissoit tout-autour des logemens du camp un espace de deux cent piés ; au bout de cet espace, on faisoit le retranchement, dont le fossé étoit plus ou moins large ou profond, & le rempart plus bas ou plus haut, selon l'appréhension que l'on avoit de l'ennemi.
Enfin, il faut remarquer que l'infanterie logeoit toujours le plus près des retranchemens, étant faite pour les défendre, & pour couvrir la cavalerie. Mais le plan donné par M. de Rohan d'un camp des Romains, rendra ce détail beaucoup plus palpable.
Campement d'une armée romaine composée de 16800 hommes de pié, & de 1800 chevaux, contenant en quarré 2016 piés & un tiers de pié.
|
| LOGH | (Géog.) c'est ainsi que l'on appelle un lac en Ecosse, où il s'en trouve en assez grand nombre. Voici le nom des plus remarquables ; logh-Arkeg, logh-Assyn, logh-Dinart, logh-Kennerim, logh-Leffan, logh-Levin, logh-Logh, logh-Lomond, logh-Loyol, logh-Meaty, logh-Navern, logh-Ness, logh-Rennach, logh-Sinn, & logh-Tay. Quelques-uns de ces lacs sont des golphes que la mer a formés insensiblement. Les cartes françoises disent, le lac de Sinn, le lac de Tay, &c. mais les cartes étrangeres conservent les noms consacrés dans chaque pays, & cette méthode est préférable. (D.J.)
|
| LOGIA | (Géog. anc.) riviere d'Hibernie, selon Ptolémée, liv. II. chap. ij. c'est-à-dire de l'Irlande ; Cambden croit que c'est Logh-Foyle, espece de golphe dans la province d'Ulster, au comté de Londonderi, qui se décharge dans l'Océan chalcédonien. (D.J.)
|
| LOGIQUE | S. f. (Philol.) la logique est l'art de penser juste, ou de faire un usage convenable de nos facultés rationnelles, en définissant, en divisant, & en raisonnant. Ce mot est dérivé de , terme grec, qui rendu en latin est la même chose que sermo, & en françois que discours ; parce que la pensée n'est autre chose qu'une espece de discours intérieur & mental, dans lequel l'esprit converse avec lui-même.
La logique se nomme souvent dialectique, & quelquefois aussi l'art canonique, comme étant un canon ou une regle pour nous diriger dans nos raisonnemens.
Comme pour penser juste il est nécessaire de bien appercevoir, de bien juger, de bien discourir, & de lier méthodiquement ses idées ; il suit de-là que l'appréhension ou perception, le jugement, le discours & la méthode deviennent les quatre articles fondamentaux de cet art. C'est de nos réflexions sur ces quatre opérations de l'esprit que se forme la logique.
Le lord Bacon tire la division de la logique en quatre parties, des quatre fins qu'on s'y propose ; car un homme raisonne, ou pour trouver ce qu'il cherche, ou pour raisonner de ce qu'il a trouvé, ou pour retenir ce qu'il a jugé, ou pour enseigner aux autres ce qu'il a retenu : de-là naissent autant de branches de l'art de raisonner, savoir l'art de la recherche ou de l'invention, l'art de l'examen ou du jugement, l'art de retenir ou de la mémoire, l'art de l'élocution ou de s'énoncer.
Comme on a fait un grand abus de la logique, elle est tombée maintenant dans une espece de discrédit. Les écoles l'ont tant surchargée de termes & de phrases barbares, elles l'ont tellement noyée dans de seches & de vaines subtilités, qu'elle semble un art, qui a plutôt pour but d'exercer l'esprit dans des querelles & des disputes, que de l'aider à penser juste. Il est vrai que dans son origine c'étoit plutôt l'art de pointiller que celui de raisonner ; les Grecs parmi lesquels elle a commencé étant une nation qui se piquoit d'avoir le talent de parler dans le moment, & de savoir soutenir les deux faces d'un même sentiment ; de-là leurs dialecticiens, pour avoir toujours des armes au besoin, inventerent je ne sais quel assemblage de mots & de termes, propres à la contention & à la dispute, plutôt que des regles & des raisons qui pussent y être d'un usage réel.
La logique n'étoit alors qu'un art de mots, qui n'avoient souvent aucun sens, mais qui étoient merveilleusement propres à cacher l'ignorance, au-lieu de perfectionner le jugement, à se jouer de la raison plutôt qu'à la fortifier, & à défigurer la vérité plutôt qu'à l'éclaircir. On prétend que les fondemens en ont été jettés par Zénon d'Elée, qui fleurissoit vers l'an 400 avant Notre-Seigneur. Les Péripatéticiens & les Stoïciens avoient prodigieusement bâti sur ses fondemens, mais leur édifice énorme n'avoit que très-peu de solidité. Diogene Laerce donne dans la vie de Zénon un abrégé de la dialectique stoïcienne, où il y a bien des chimeres & des subtilités inutiles à la perfection du raisonnement. On sait ce que se proposoient les anciens Sophistes, c'étoit de ne jamais demeurer court, & de soutenir le pour & le contre avec une égale facilité sur toutes sortes de sujets. Ils trouverent donc dans la dialectique des ressources immenses pour ce beau talent, & ils l'approprierent toute à cet usage. Cet héritage ne demeura pas en friche entre les mains de ces scholastiques, qui enchérirent sur le ridicule de leurs anciens prédécesseurs. Universaux, catégories, & autres doctes bagatelles firent l'essence de la logique & l'objet de toutes les méditations & de toutes les disputes. Voilà l'état de la logique depuis son origine jusqu'au siecle passé, & voilà ce qui l'avoit fait tomber dans un décri dont bien des gens ont encore de la peine à revenir. Et véritablement il faut avouer que la maniere dont on traite encore aujourd'hui la logique dans les écoles, ne contribue pas peu à fortifier le mépris que beaucoup de personnes ont toûjours pour cette science.
En effet, soit que ce soit un vieux respect qui parle encore pour les anciens, ou quelque autre chimere de cette façon, ce qu'il y a de certain, c'est que les pointilleries de l'ancienne école regnent toûjours dans les nôtres, & qu'on y traite la Philosophie comme si l'on prenoit à tâche de la rendre ridicule, & d'en dégoûter sans ressource. Qu'on ouvre les cahiers qui se dictent dans les universités, n'y trouverons-nous pas toutes ces impertinentes questions ?
Savoir si la Philosophie, prise d'une façon collective, ou d'une façon distributive, loge dans l'entendement ou dans la volonté.
Savoir si l'être est univoque à l'égard de la substance de l'accident.
Savoir si Adam a eu la philosophie habituelle.
Savoir si la logique enseignante spéciale est distinguée de la logique pratique habituelle.
Savoir si les degrés métaphysiques dans l'individu sont distingués réellement, ou s'ils ne le sont que virtuellement & d'une raison raisonnée.
Si la relation du pere à son fils se termine à ce fils considéré absolument, ou à ce fils considéré relativement.
Si l'on peut prouver qu'il y ait autour de nous des corps réellement existans.
Si la matiere seconde, ou l'élément sensible, est dans un état mixte.
Si dans la corruption du mixte il y a résolution jusqu'à la matiere premiere.
Si toute vertu se trouve causalement ou formellement placée dans le milieu, entre un acte mauvais par excès, & un acte mauvais par défaut.
Si le nombre des vices est parallele ou double de celui des vertus.
Si la fin meut selon son être réel, ou selon son être intentionnel.
Si syngatégoriquement parlant le concret & l'abstrait se... Je vous fais grace d'une infinité d'autres questions qui ne sont pas moins ridicules, sur lesquelles on exerce l'esprit des jeunes gens. On veut les justifier, en disant que l'exercice en est très-utile, & qu'il subtilise l'esprit. Je le veux ; mais si toutes ces questions, qui sont si fort éloignées de nos besoins, donnent quelque pénétration & quelque étendue à l'esprit qui les cultive, ce n'est point du tout parce qu'on lui donne des regles de raisonnement, mais uniquement parce qu'on lui procure de l'exercice : & exercice pour exercice, la vie étant si courte, ne vaudroit-il pas mieux exercer tout d'abord l'esprit, la précision & tous les talens sur des questions de service, & sur des matieres d'expérience ? Il n'est personne qui ne sente que ces matieres conviennent à tous les états ; que les jeunes esprits les saisiront avec feu, parce qu'elles sont intelligibles ; & qu'il sera trop tard de les vouloir apprendre quand on sera tout occupé des besoins plus pressans de l'état particulier qu'on aura embrassé.
On ne peut pardonner à l'école son jargon inintelligible, & tout cet amas de questions frivoles & puériles, dont elle amuse ses éleves, sur-tout depuis que des hommes heureusement inspirés, & secondés d'un génie vif & pénétrant, ont travaillé à la perfectionner, à l'épurer & à lui faire parler un langage plus vrai & plus intéressant.
Descartes, le vrai restaurateur du raisonnement, est le premier qui a amené une nouvelle méthode de raisonner, beaucoup plus estimable que sa Philosophie même, dont une bonne partie se trouve fausse ou fort incertaine, selon les propres regles qu'il nous a apprises. C'est à lui qu'on est redevable de cette précision & de cette justesse, qui regne nonseulement dans nos bons ouvrages de physique & de métaphysique, mais dans ceux de religion, de morale, de critique. En général les principes & la méthode de Descartes ont été d'une grande utilité, par l'analyse qu'ils nous ont accoûtumés de faire plus exactement des mots & des idées, afin d'entrer plus surement dans la route de la vérité.
La méthode de Descartes a donné naissance à la logique, dite l'art de penser. Cet ouvrage conserve toûjours sa réputation. Le tems qui détruit tout ne fait qu'affermir de plus en plus l'estime qu'on en fait. Il est estimable sur-tout par le soin qu'on a pris de le dégager de plusieurs questions frivoles. Les matieres qui avoient de l'utilité parmi les Logiciens au tems qu'elle fut faite, y sont traitées dans un langage plus intelligible qu'elles ne l'avoient été ailleurs en françois. Elles y sont exposées plus utilement, par l'application qu'on y fait des regles, à diverses choses dont l'occasion se présente fréquemment, soit dans l'usage des sciences, ou dans le commerce de la vie civile : au lieu que les logiques ordinaires ne faisoient presque nulle application des regles à des usages qui intéressent le commun des honnêtes gens. Beaucoup d'exemples qu'on y apporte sont bien choisis ; ce qui sert à exciter l'attention de l'esprit, & à conserver le souvenir des regles. On y a mis en oeuvre beaucoup de pensées de Descartes, en faveur de ceux qui ne les auroient pas aisément ramassées dans ce philosophe.
Depuis l'art de penser, il a paru quantité d'excellens ouvrages dans ce genre. Les deux ouvrages si distingués, de M. Locke sur l'entendement humain, & du P. Malebranche sur la recherche de la verité, renferment bien des choses qui tendent à perfectionner la logique.
M. Locke est le premier qui ait entrepris de démêler les opérations de l'esprit humain, immédiatement d'après la nature, sans se laisser conduire à des opinions appuyées plutôt sur des systèmes que sur des réalités ; en quoi sa Philosophie semble être par rapport à celles de Descartes & de Malebranche, ce qu'est l'histoire par rapport aux romans. Il examine chaque sujet par les idées les plus simples, pour en tirer peu à peu des vérités intéressantes. Il fait sentir la fausseté de divers principes de Descartes par une analyse des idées qui avoient fait prendre le change. Il distingue ingénieusement l'idée de l'esprit d'avec l'idée du jugement : l'esprit assemble promtement des idées qui ont quelque rapport, pour en faire des peintures qui plaisent ; le jugement trouve jusqu'à la moindre différence entre des idées qui ont d'ailleurs la plus grande ressemblance ; on peut avoir beaucoup d'esprit & peu de jugement. Au sujet des idées simples, M. Locke observe judicieusement que sur ce point, les hommes different peu de sentiment ; mais qu'ils different dans les mots auxquels chacun demeure attaché. On peut dire en général de cet auteur, qu'il montre une inclination pour la vérité, qui fait aimer la route qu'il prend pour y parvenir.
Pour le pere Malebranche, sa réputation a été si éclatante dans le monde philosophique, qu'il paroît inutile de marquer en quoi il a été le plus distingué parmi les Philosophes. Il n'a été d'abord qu'un pur cartésien ; mais il a donné un jour si brillant à la doctrine de Descartes, que le disciple l'a plus répandue par la vivacité de son imagination & par le charme de ses expressions, que le maître n'avoit fait par la suite de ses raisonnemens & par l'invention de ses divers systèmes.
Le grand talent du pere Malebranche est de tirer d'une opinion tout ce qu'on peut en imaginer d'imposant pour les conséquences, & d'en montrer tellement les principes de profil, que du côté qu'il les laisse voir, il est impossible de ne s'y pas rendre.
Ceux qui ne suivent pas aveuglément ce philosophe, prétendent qu'il ne faut que l'arrêter au premier pas ; que c'est la meilleure & la plus courte maniere de le réfuter, & de voir clairement ce qu'on doit penser de ses principes. Ils les réduisent particulierement à cinq ou six, à quoi il faut faire attention ; car si on les lui passe une fois, on sera obligé de faire avec lui plus de chemin qu'on n'auroit voulu. Il montre dans tout leur jour, les difficultés de l'opinion qu'il réfute ; & à l'aide du mépris qu'il en inspire, il propose la sienne par l'endroit le plus plausible ; puis, sans d'autre façon, il la suppose comme incontestable, sans avoir ou sans faire semblant de voir ce qu'on y peut & ce qu'on y doit opposer.
Outre ces ouvrages, nous avons bon nombre de logiques en forme. Les plus considérables sont celle de M. Leclerc, & celle de M. de Crouzas. La premiere a une grande prérogative sur plusieurs autres ; c'est que renfermant autant de choses utiles, elle est beaucoup plus courte. L'auteur y fait appercevoir l'inutilité d'un grand nombre de regles ordinaires de logique ; il ne laisse pas de les rapporter & de les expliquer assez nettement. Ayant formé son plan d'après le livre de M. Locke, de intellectu humano, à qui il avoue, en lui dédiant son ouvrage, qu'il n'a fait qu'un abregé du sien ; il a parlé de la nature & de la formation des idées d'une maniere plus juste & plus plausible que l'on n'avoit fait dans les logiques précédentes. Il a choisi ce qui se rencontre de meilleur dans la logique dite l'art de penser. Il tire des exemples de sujets intéressans. Empruntant des ouvrages que je viens de nommer, ce qui est de meilleur dans le sien, il ne dit rien qui serve à découvrir les méprises qui y sont échappées. Il seroit à souhaiter qu'il n'eût pas suivi M. Locke dans ses obscurités, & dans des réflexions aussi écartées du sentiment commun, que des principes de la morale.
Le dessein que se propose M. de Crouzas dans son livre, est considérable. Il y prétend rassembler les principes, les maximes, les observations qui peuvent contribuer à donner à l'esprit plus d'étendue, de force, de facilité, pour comprendre la vérité, la découvrir, la communiquer, &c. Ce dessein un peu vaste pour une simple logique, traite ainsi des sujets les plus importans de la Métaphysique. L'auteur a voulu recueillir sur les diverses opérations de l'esprit, les opinions des divers philosophes de ce tems. Il n'y a guere que le livre de M. Locke, auquel M. de Crouzas n'ait pas fait une attention qui en auroit valu la peine. Il y a un grand nombre d'endroits qui donnent entrée à des réflexions subtiles & judicieuses. Plusieurs réflexions n'y sont pas assez développées, les sujets ne paroissent ni si amenés par ce qui précede, ni assez soutenus par ce qui suit. L'élocution quelquefois négligée diminue de l'extrême clarté que demandent des matieres abstraites. Cet ouvrage a pris diverses formes & divers accroissemens sous la main de l'auteur. Tous les éloges de M. de Fontenelle, qui y sont fondus, ne contribuent pas peu à l'embellir & à y jetter de la variété. L'édition de 1712, deux vol. in -12. est la meilleure pour les étudians, parce que c'est la plus dégagée, & que les autres sont comme noyées dans les ornemens.
Tels sont les jugemens que le pere Buffier a portés de toutes ces différentes logiques. Ses principes du raisonnement sont une excellente logique. Il a surtout parfaitement bien démêlé la vérité logique d'avec celle qui est propre aux autres sciences. Il y a du neuf & de l'original dans tous les écrits de ce pere, qui a embrassé une espece d'encyclopédie, que comprend l'ouvrage in-folio intitulé cours des sciences. L'agrément du style rend amusant ce livre, quoiqu'il contienne véritablement l'exercice des sciences les plus épineuses. Il a trouvé le moyen de changer leurs épines en fleurs, & ce qu'elles ont de fatiguant en ce qui peut divertir l'imagination. On ne peut rien ajoûter à la précision & à l'enchaînement des raisonnemens & des objections, dont il remplit chacun des sujets qu'il traite. La maniere facile & peut-être égayée dont il expose les choses, répand beaucoup de clarté sur les matieres les plus abstraites.
M. Wolf a ramené les principes & les regles de la logique à la démonstration. Nous n'avons rien de plus exact sur cette science que la grande logique latine de ce philosophe, dont voici le titre : philosophia rationalis, sive logica methodo scientificâ pertractata, & ad usum scientiarum atque vitae aptata. Praemittitur discursus praeliminaris de philosophia in genere.
Il a paru depuis peu un livre intitulé, essai sur l'origine des connoissances humaines. M. l'abbé de Condillac en est l'auteur. C'est le système de M. Locke, mais extrêmement perfectionné. On ne peut lui reprocher, comme à M. Leclerc, d'être un copiste servile de l'auteur anglois. La précision françoise a retranché toutes les longueurs, les répétitions & le desordre qui regnent dans l'ouvrage anglois ; & la clarté, compagne ordinaire de la précision, a répandu une lumiere vive & éclatante sur les tours obscurs & embarrassés de l'original. L'auteur se propose, à l'imitation de M. Locke, l'étude de l'esprit humain, non pour en découvrir la nature, mais pour en connoître les opérations. Il observe avec quel art elles se combinent, & comment nous devons les conduire, afin d'acquérir toute l'intelligence dont nous sommes capables. Remontant à l'origine des idées, il en développe la génération, les suit jusqu'aux limites que la nature leur a prescrites, & fixe par-là l'étendue & les bornes de nos connoissances. La liaison des idées, soit avec les signes, soit entre elles, est la base & le fondement de son système. A la faveur de ce principe si simple en lui-même & si fécond en même tems dans ses conséquences, il montre quelle est la source de nos connoissances, quels en sont les matériaux, comment ils sont mis en oeuvre, quels instrumens on y emploie, & quelle est la maniere dont il faut s'en servir. Ce principe n'est ni une proposition vague, ni une maxime abstraite, ni une supposition gratuite ; mais une expérience constante, dont toutes les conséquences sont confirmées par de nouvelles expériences. Pour exécuter son dessein, il prend les choses d'aussi haut qu'il lui est possible. D'un côté, il remonte à la perception, parce que c'est la premiere opération qu'on peut remarquer dans l'ame ; & il fait voir comment & dans quel ordre, elle produit toutes celles dont nous pouvons acquérir l'exercice. D'un autre côté, il commence au langage d'action. Il explique comment il a produit tous les arts qui sont propres à exprimer nos pensées ; l'art des gestes, la danse, la parole, la déclamation, l'art de la noter, celui des pantomimes, la musique, la poésie, l'éloquence, l'écriture, & les différens caracteres des langues. Cette histoire du langage sert à montrer les circonstances où les signes ont été imaginés ; elle en fait connoître le vrai sens, apprend à en prévenir les abus, & ne laisse aucun doute sur l'origine des idées. Enfin après avoir développé les progrès des opérations de l'ame & ceux du langage, il indique par quels moyens on peut éviter l'erreur, & montre les routes qu'on doit suivre, soit pour faire des découvertes, soit pour instruire les autres de celles qu'on a faites. Selon cet auteur, les sensations & les opérations de notre ame sont les matériaux de toutes nos connoissances ; mais c'est la réflexion qui les met en oeuvre, en cherchant par des combinaisons les rapports qu'ils renferment. Des gestes, des sons, des chiffres, des lettres, sont les instrumens dont elle se sert, quelque étrangers qu'ils soient à nos idées, pour nous élever aux connoissances les plus sublimes. Cette liaison nécessaire des signes avec nos idées, que Bacon a soupçonnée, & que Locke a entrevue, il l'a parfaitement approfondie. M. Locke s'est imaginé qu'aussitôt que l'ame reçoit des idées par les sens, elle peut à son gré les répéter, les composer, les unir ensemble avec une variété infinie, & en faire toutes sortes de notions complexes. Mais il est constant que dans l'enfance nous avons éprouvé des sensations, longtems avant que d'en savoir tirer des idées. Ainsi, l'ame n'ayant pas dès le premier instant l'exercice de toutes ses opérations, il étoit essentiel, pour mieux développer les ressorts de l'entendement humain, de montrer comment elle acquiert cet exercice, & quel en est le progrès. M. Locke, comme je viens de le dire, n'a fait que l'entrevoir ; & il ne paroît pas que personne lui en ait fait le reproche, ou ait essayé de suppléer à cette partie de son ouvrage. Enfin, pour conclure ce que j'ai à dire sur cet ouvrage, j'ajouterai que son principal mérite est d'être bien fondu, & d'être travaillé avec cet esprit d'analyse, cette liaison d'idées, qu'on y propose comme le principe le plus simple, le plus lumineux & le plus fécond, auquel l'esprit humain devoit tous ses progrès dans le tems même qu'il n'en remarquoit pas l'influence.
Quelque diverses formes qu'ait pris la logique entre tant de différentes mains qui y ont touché, toutes conviennent cependant qu'elle n'est qu'une méthode pour nous faire découvrir le vrai & nous faire éviter le faux à quelque sujet qu'on la puisse appliquer : c'est pour cela qu'elle est appellée l'organe de la vérité, la clé des Sciences, & le guide des connoissances humaines. Or il paroît qu'elle remplira parfaitement ces fonctions, pourvû qu'elle dirige bien nos jugemens : & telle est, ce me semble, son unique fin.
Car si je possede l'art de juger sainement de tous les sujets sur lesquels ma raison peut s'exercer, certainement dès-là même j'aurai la logique universelle. Quand avec cela on pourroit se figurer qu'il n'y eût plus au monde aucune regle pour diriger la premiere & la troisieme opération de l'esprit, c'est-à-dire la simple représentation des objets & la conclusion des syllogismes, ma logique n'y perdroit rien. On voit parlà, ou que la premiere & la troisieme opération ne sont essentiellement autres que le jugement, soit dans sa totalité, soit dans ses parties, ou du-moins que la premiere & la seconde opération tendent elles-mêmes au jugement, comme à leur derniere fin. Ainsi j'aurai droit de conclure que la derniere fin de la logique est de diriger nos jugemens & de nous apprendre à bien juger : ensorte que tout le reste à quoi elle peut se rapporter, doit uniquement se rapporter tout entier à ce but. Le jugement est donc la seule fin de la logique. Un grand nombre de philosophes se récrient contre ce sentiment, & prétendent que la logique a pour fin les quatre opérations de l'esprit ; mais pour faire voir combien ils s'abusent, il n'y a qu'à lever l'équivoque que produit le mot fin.
Quelques-uns se figurent d'abord la logique (& à proportion les autres arts ou sciences) comme une sorte d'intelligence absolue ou de divinité qui prescrit certaines lois à quoi il faut que l'univers s'assujettisse ; cependant cette prétendue divinité est une chimere. Qu'est-ce donc réellement que la logique ? rien autre chose qu'un amas de réflexions écrites ou non écrites, appellées regles, pour faciliter & diriger l'esprit à faire ses opérations aussi-bien qu'il en est capable : voilà au juste ce que c'est que la logique. Qu'est-ce que fin présentement ? c'est le but auquel un être intelligent se propose de parvenir.
Ceci supposé, demander si la logique a pour fin telles ou telles opérations de l'ame, c'est demander si un amas de réflexions écrites ou non écrites a pour fin telle ou telle chose. Quel sens peut avoir une proposition de cette nature ? Ce ne sont donc pas les réflexions mêmes ou leur amas qui peuvent avoir une fin, mais uniquement ceux qui font ou qui ont fait ces réfléxions, c'est-à-dire que ce n'est pas la logique qui a une fin ou qui en peut avoir une, mais uniquement les logiciens.
Je sais ce qu'on dit communément à ce sujet, qu'autre est la fin de la logique, & autre est la fin du logicien ; autre la fin de l'ouvrage, finis operis, & autre la fin de celui qui fait l'ouvrage ou de l'ouvrier, finis operantis. Je sais, dis-je, qu'on parle ainsi communément, mais je sais aussi que souvent ce langage ne signifie rien de ce qu'on imagine : car quelle fin, quel but, quelle intention peut se proposer un ouvrage ? Il ne se trouve donc aucun sens déterminé sous le mot de fin, finis, quand il s'attribue à des choses inanimées, & non aux personnes qui seules sont capables d'avoir & de se proposer une fin.
Quel est donc le vrai de ces mots finis operis ? c'est la fin que se proposent communément ceux qui s'appliquent à cette sorte d'ouvrage ; & la fin de l'ouvrier, finis operantis, est la fin particuliere que se proposeroit quelqu'un qui s'applique à la même sorte d'ouvrage : outre la fin commune que l'on s'y propose d'ordinaire en ce sens, on peut dire que la fin de la peinture est de représenter des objets corporels par le moyen des linéamens & des couleurs ; car telle est la fin commune de ceux qui travaillent à peindre : au lieu que la fin du peintre est une fin particuliere, outre cette fin commune, savoir de gagner de l'argent, ou d'acquérir de la réputation, ou simplement de se divertir. Mais en quelque sens qu'on le prenne, la fin de l'art est toujours celle que se propose, non pas l'art même, qui n'est qu'un amas de réflexions incapables de se proposer une fin, mais celle que se proposent en général ceux qui ont enseigné ou étudié cet art.
La chose étant exposée sous ce jour, que devient cette question, quelle est la fin de la logique ? Elle se résout à celle-ci : quelle est la fin que se sont proposée communément ceux qui ont donné des regles & fait cet amas de réflexions, qui s'appelle l'art ou la science de la logique ? Or cette question n'est plus qu'un point de fait avec lequel on trouvera qu'il y a autant de fins différentes de la logique, qu'il y a eu de différens logiciens.
La plûpart ayant donné des regles & dirigé leurs réflexions à la forme & à la pratique du syllogisme, la fin de la logique en ce sens sera la maniere de faire des syllogismes dans toutes les sortes de modes & de figures, dont on explique l'artifice dans les écoles ; mais une logique où les auteurs ont regardé comme peu important l'embarras des regles & des réflexions nécessaires pour faire des syllogismes en toutes sortes de modes & de figures, une logique de ce caractere, dis-je, n'a point du tout la fin de la logique ordinaire, parce que le logicien ne s'est point proposé cette fin.
Au reste il se trouvera néanmoins une fin commune à tous les logiciens, c'est d'atteindre toujours à la vérité interne, c'est-à-dire à une juste liaison d'idées pour former des jugemens vrais, d'une vérité interne, & non pas d'une vérité externe, que le commun des logiciens ont confondue avec la vérité interne : ce qui leur a fait aussi méconnoître quelle est ou quelle doit être la fin spéciale de la logique.
On demande aussi si la logique est une science : il est aisé de satisfaire à cette question. Elle mérite ce titre, si vous appellez science toute connoissance infaillible acquise avec les secours de certaines réflexions ou regles ; car ayant la connoissance de la logique, vous savez démêler infailliblement une conséquence vraie d'avec une fausse.
Mais est-elle un art ? question aussi aisée à résoudre que la précédente. Elle est l'un ou l'autre, suivant le sens que vous attachez au mot art. L'un veut seulement appeller art ce qui a pour objet quelque chose de matériel ; & l'autre veut appeller art toute disposition acquise qui nous fait faire certaines opérations spirituelles ou corporelles, par le moyen de certaines regles ou réflexions. Là-dessus il plaît aux logiciens de disputer si la logique est ou n'est pas un art ; & il ne leur plaît pas toujours d'avouer ni d'enseigner à leurs disciples que c'est une pure ou puérile question de nom.
On forme encore dans les écoles une autre question, savoir si la logique artificielle est nécessaire pour acquérir toutes les Sciences dans leur perfection. Pour répondre à cette question, il ne faut qu'examiner ce que c'est que la logique artificielle : or cette logique est un amas d'observations & de regles faites pour diriger les opérations de notre esprit ; & de-là elle n'est point absolument nécessaire : pourquoi ? parce que pour que notre esprit opere bien, il n'est pas nécessaire d'étudier comment il y réussit. C'est un instrument que Dieu a fait & qui est très-bien fait. Il est fort inutile de discuter métaphysiquement ce que c'est que notre entendement & de quelles pieces il est composé : c'est comme si l'on se mettoit à disséquer les pieces de la jambe humaine pour apprendre à marcher. Notre raison & notre jambe font très-bien leurs fonctions sans tant d'anatomies & de préambules ; il ne s'agit que de les exercer, sans leur demander plus qu'elles ne peuvent. D'ailleurs, si l'esprit ne pouvoit bien faire ses opérations sans les secours que fournit la logique artificielle, il ne pourroit être sûr si les regles qu'il a établies sont bien faites. Au reste, nous prouvons que les syllogismes ne sont rien moins que nécessaires pour découvrir la vérité. Voyez SYLLOGISMES.
La logique se divise en docente & utente ; la docente est la connoissance des regles & des préceptes de la logique, & la logique utente est l'application de ces mêmes regles. On peut appeller la premiere théorétique, & la seconde, pratique : elles ont besoin mutuellement l'une de l'autre. Les regles apprises & comprises s'effacent bientôt, si l'on ne s'exerce souvent à les appliquer, tout comme la danse ou le manege s'oublient aisément quand on discontinue ces exercices. Tel croit être logicien, parce qu'il a fait un cours de logique ; mais quand il faut venir au fait & à l'application, sa logique se trouve en défaut : pourquoi ? c'est parce qu'il avoit jetté une bonne semence, mais qu'il l'a mal cultivée.
Disons aussi que le succès de la logique artificielle dépend beaucoup de la logique naturelle : celle-ci varie & se trouve en différens degrés chez les hommes. Tel comme tel est naturellement plus agile ou plus fort que son camarade, de même tel est meilleur logicien, c'est-à-dire qu'il a plus d'ouverture d'esprit & de solidité de jugement.
L'expérience prouve qu'entre douze disciples qui étudieront la même science sous le même maître, il y aura toujours une gradation qui vient en partie du fonds, en partie de l'éducation : car la logique naturelle acquise a aussi ses degrés. Avec un même fonds on peut avoir eu ou moins d'attention à le cultiver, ou des circonstances moins favorables. Cette diversité de dispositions, tant naturelles qu'acquises qu'on apporte à l'étude de la logique artificielle, déterminent donc les progrès que l'on y fait.
|
| LOGIS | S. m. (Gramm.) c'est la maison entiere qu'on occupe. On a son logis dans tel quartier, & l'on a son logement en tel endroit de la maison.
|
| LOGISTE | S. m. (Antiq. grecq.) ; nom d'un magistrat très-distingué à Athènes, préposé pour recevoir les comptes de tous ceux qui sortoient de charge. Le sénat même de l'Aréopage, ainsi que les autres tribunaux, étoit obligé à une reddition de compte devant les logistes, & à ce qu'on croit tous les ans.
Les logistes répondoient assez bien à ceux qu'on nommoit à Rome recuperatores pecuniarum repetundarum ; mais ils ne répondent pas également à nos maîtres des comptes en France, puisque la jurisdiction & l'inspection de nos maîtres des comptes ne s'étend pas à toute magistrature, comme celle des logistes d'Athènes.
Il faut encore distinguer les logistes des euthynes, , quoique l'office de ces deux sortes de magistrats ait la plus grande affinité ; les uns & les autres étoient au nombre de dix, & l'emploi des uns & des autres rouloit entierement sur la reddition des comptes : mais les euthynes étoient en sous-ordre. On doit done les regarder comme les assesseurs des logistes : c'étoit eux qui recevoient les comptes, les examinoient, les dépouilloient, & en faisoient leur rapport aux logistes.
On élisoit les euthynes, on tiroit au sort les logistes. Si ces derniers trouvoient que le comptable étoit coupable de délit, son cas étoit évoqué au tribunal qui jugeoit les criminels. Enfin les logistes & les euthynes ne connoissoient que du fait des affaires pécuniaires, & renvoyoient la prononciation du jugement de droit aux autres tribunaux.
Logiste est dérivé de , compter ; nous en avons vû la raison. (D.J.)
|
| LOGISTIQUE | adj. (Géom.) pris substantivement, est le nom qu'on a donné d'abord à la logarithmique, & qui n'est presque plus en usage. Voyez LOGARITHMIQUE.
On appelle logarithme logistique d'un nombre quelconque donné de secondes, la différence entre le logarithme qu'on trouve dans les tables ordinaires du nombre 3600'' = 60'' x 60, = 60' = 1°, & celui du nombre de secondes proposé. On a introduit ces logarithmes pour prendre commodément les parties proportionnelles dans les tables astronomiques. Voyez-en le calcul & l'usage dans les Instit. astron. de M. le Monnier, p. 622-626. (O)
|
| LOGOGRAPHIE | S. f. (Gramm.) C'est la partie de l'Orthographe qui prescrit les regles convenables pour représenter la relation des mots à l'ensemble de chaque proposition, & la relation de chaque proposition à l'ensemble du discours. On peut voir au mot GRAMMAIRE l'origine de ce mot, l'objet & la division de cette partie ; & aux mots ORTHOGRAPHE & PONCTUATION, les principales regles qui en font l'essence.
|
| LOGOGRIPHE | S. m. (Littér.) espece de symbole ou d'énigme consistant principalement dans un mot qui en contient plusieurs autres, & qu'on propose à deviner, comme, par exemple, dans le mot Rome on trouve les mots orme, or, ré, note de musique, mer, voyez ENIGME. Ce mot est formé de , discours, & de , énigme, c'est-à-dire énigme sur un mot.
Le logogriphe consiste ordinairement en quelques allusions équivoques, ou en une décomposition des mots en des parties qui, prises séparément, signifient des choses différentes de celles que marque le mot. Il tient le milieu entre le rebus & l'énigme proprement dite.
Selon Kircher le logogriphe est une espece d'armes parlantes. Ainsi un Anglois qui s'appelleroit Léonard, & qui porteroit dans ses armes un lion, leo, & un pié de l'aspic, plante, qui en anglois s'appelle nar, feroit un logogriphe, selon cet auteur. Voyez Oedip. egypt.
Le même auteur définit ailleurs le logogriphe une énigme qui sous un seul nom ou mot porte à l'esprit différentes idées, par l'addition ou le retranchement de quelques parties : ce genre d'énigmes est très-connu des Arabes, parmi lesquels il y a des auteurs qui en ont traité expressément.
|
| LOGOMACHIE | S. f. (Littér.) est un mot qui vient du grec ; il signifie dispute de mots ; il est composé de verbum, & de , pugno ; je ne sais pourquoi ce mot ne se trouve ni dans Furetiere, ni dans Richelet. Ce mot se prend toujours dans un sens défavorable ; il est rare qu'il ne soit pas appliquable à l'un & l'autre parti ; pour l'ordinaire tel qui le donne le premier, est celui qui le mérite le mieux.
On ne peut qu'admirer l'esprit philosophique de S. Paul, cet illustre éleve de Gamaliel, qui déclamant contre toutes les frivoles questions qu'on agitoit de son tems dans les écoles d'un peuple grossier, & qui ne connut jamais les premieres notions d'une saine philosophie, parle des logomachies comme d'une maladie funeste, ep. Timoth. 6. v. 4, , maladie qui est devenue en quelque sorte épidémique, & qu'on peut envisager comme un apanage de l'humanité, puisque toute la sagesse de l'Orient, une philosophie fondée sur l'expérience, la revélation divine même n'ont pu en tarir le cours. Mais pourquoi, dira-t-on, ce mal fâcheux attaque-t-il sur-tout les gens de lettres, pourquoi de vaines disputes sur les choses les plus viles & les plus ridicules occupent-elles la majeure partie des ouvrages des savans ; c'est qu'il est peu de vrais savans, & beaucoup de gens qui veulent passer pour l'être.
Le mot de logomachies peut se prendre en trois divers sens. 1°. Une dispute en paroles ou injures ; 2°. une dispute de mots, & dans laquelle les disputans ne s'entendent pas ; 3°. une dispute sur des choses minimes & de nulle importance : Homere parle du premier sens lorsqu'il dit :
|
| LOGOTHETE | S. m. (Hist. mod.) nom tiré du grec , ratio, compte, & de , établir.
Le logothete étoit un officier de l'empire grec, & on en distinguoit deux ; l'un pour le palais, & l'autre pour l'eglise. Selon Codin, le logothete de l'église de Constantinople étoit chargé de mettre par écrit tout ce qui concernoit les affaires relatives à l'église, tant de la part des grands, que de celle du peuple. Il tenoit le sceau du patriarche, & l'apposoit à tous les écrits émanés de lui ou dressés par ses ordres.
Le même auteur dit que le grand logothete, c'est ainsi qu'on nommoit celui du palais impérial, mettoit en ordre les dépêches de l'empereur, & généralement tout ce qui avoit besoin du sceau & de la bulle d'or : c'étoit une espece de chancelier ; aussi Nicetas explique-t-il par ce dernier titre celui de logothete.
|
| LOGROGNO | ou LOGRONO, (Géog.) ancienne ville d'Espagne, dans la vieille Castille, sur les frontieres de la Navarre, dans un terrein abondant en fruits exquis, en olives, en blé, en chanvre, en vins, & en tout ce qui est nécessaire à la vie. Elle est sur l'Ebre, à 22 lieues N. E. de Burgos, 57 N. E. de Madrid. Quelques-uns la prennent pour la Juliobrica des anciens ; d'autres estiment que la Juliobrica de Pline est présentement Fuente d'Ivero. Sa long. 15. 32. lat. 42. 26.
Logrogno est la patrie de Rodriguez Arriaga, fameux jésuite espagnol, mort à Prague en 1667, âgé de 75 ans. Il a répandu beaucoup de subtilités scholastiques dans sa vaste théologie, qui contient huit volumes in-fol. & plus encore dans son cours latin de philosophie, imprimé à Anvers en 1632, & à Lyon en 1669 in fol. Semblable à ces guerriers qui dévastent le pays ennemi, sans pouvoir mettre leurs frontieres en état de résistance, il se montre bien plus habile à ruiner ce qu'il nie, qu'à prouver ce qu'il prétend établir. C'est dommage que cet homme subtil & pénétrant n'ait eu aucune connoissance des bons principes de la Théologie & de la Philosophie ; mais on est encore bien éloigné de s'en douter en Espagne ; hé, comment le jésuite Arriaga les auroit-il connus il y a cent ans ? (D.J.)
|
| LOGUDORO | ou LOGODORO, la province de, (Géog.) contrée septentrionale de l'île de Sardaigne, avec une petite ville de même nom, & quelques gros bourgs ; Sassari, Algheri, Sarda, Terranova, Castel, Arogonese, Boca, &c. (D.J.)
|
| LOGUER | en terme de Raffinerie, c'est l'action d'humecter les formes pour les bâtardes & les fondus, en frottant l'intérieur de ces formes avec un morceau de vieux linge imbibé d'eau. Voyez BATARDES, FORMES & FONDUS.
|
| LOGUETTE | S. f. terme de riviere, cordage de la grosseur d'une cincenelle, que l'on ajoute à un cable pour le tirage des bateaux.
|
| LOHARDE | la préfecture de, (Géog.) petit canton de Danemarck, dans le Sud-Jutland, appartenant en partie au roi de Danemarck, & en partie au duc de Holstein. (D.J.)
|
| LOHN | LA (Géog.) en latin Logana ou Loganus, riviere d'Allemagne, qui prend sa source dans la haute Hesse, & se jette dans le Rhin au-dessus de Coblentz. Elle donne son nom à ce petit canton d'Allemagne qu'on appelle le Lohn-gaw. (D.J.)
|
| LOI | S. f. (Droit naturel, moral, divin, & humain.) La loi en général est la raison humaine, entant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; & les lois politiques & civiles de chaque nation ne doivent être que les divers cas particuliers où s'applique cette raison humaine.
On peut définir la loi une regle prescrite par le souverain à ses sujets, soit pour leur imposer l'obligation de faire ; ou de ne pas faire certaines choses, sous la menace de quelque peine, soit pour leur laisser la liberté d'agir, ou de ne pas agir en d'autres choses comme ils le trouveront à propos, & leur assurer une pleine jouissance de leur droit à cet égard.
Les hommes, dit M. de Montesquieu, sont gouvernés par diverses sortes de lois. Ils sont gouvernés par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appellé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine, qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu ou dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens & sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles qui ont besoin d'un gouvernement particulier. Il y a donc différens ordres de lois, & la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, & à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
Les réflexions naissent en foule à ce sujet. Détachons-en quelques-unes des écrits profonds de ces beaux génies qui ont éclairé le monde par leurs travaux sur cette importante matiere.
La force d'obliger qu'ont les lois inférieures, découle de celle des lois supérieures. Ainsi dans les familles on ne peut rien prescrire de contraire aux lois de l'état dont elles font partie. Dans chaque état civil on ne peut rien ordonner de contraire aux lois qui obligent tous les peuples, telles que sont celles qui prescrivent de ne point prendre le bien d'autrui, de réparer le dommage qu'on a fait, de tenir sa parole, &c. & ces lois communes à toutes les nations, ne doivent renfermer rien de contraire au domaine suprème de Dieu sur ses créatures. Ainsi dès qu'il y a dans les lois inférieures des choses contraires aux lois supérieures, elles n'ont plus force de lois.
Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple qui s'attache au commerce, que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il en faut un plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse. Ainsi les lois doivent avoir un grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent leur subsistance.
Dans les gouvernemens despotiques, le despote est le prince, l'état & les lois. Dans les gouvernemens monarchiques il y a une loi ; & là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans les gouvernemens républicains, il est de la nature de leur constitution que les juges suivent la lettre de la loi ; il n'y a point de citoyen contre qui on puisse interprêter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. En Angleterre les jurés décident du fait, le juge prononce la peine que la loi inflige ; & pour cela il ne lui faut que des yeux.
Ceux qui ont dans leurs mains les lois pour gouverner les peuples, doivent toujours se laisser gouverner eux-mêmes par les lois. C'est la loi, & non pas l'homme qui doit régner. La loi, dit Plutarque, est la reine de tous les mortels & immortels. Le seul édit de 1499, donné par Louis XII. fait chérir sa mémoire de tous ceux qui rendent la justice dans ce royaume, & de tous ceux qui l'aiment. Il ordonne par cet édit mémorable " qu'on suive toujours la loi, malgré les ordres contraires à la loi, que l'importunité pourroit arracher du monarque ".
Le motif & l'effet des lois doit être la prospérité des citoyens. Elle résulte de l'intégrité des moeurs, du maintien de la police, de l'uniformité dans la distribution de la justice, de la force & de l'opulence de l'état, & les lois sont les nerfs d'une bonne administration. Quelqu'un ayant demandé à Anaxidame, roi de Lacédémone, qui avoit l'autorité dans Sparte, il répondit que c'étoient les lois ; il pouvoit ajouter avec les moeurs sur lesquels elles influent, & dont elles tirent leur force. En effet, chez les Spartiates, les lois & les moeurs intimement unies dans le coeur des citoyens n'y faisoient, pour ainsi dire, qu'un même corps. Mais ne nous flattons pas de voir Sparte renaître au sein du commerce & de l'amour du gain.
" La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone & les autres cités, dit Xénophon, consiste en ce qu'il a sur-tout fait, que les citoyens obéissent aux lois. Ils courent lorsque le magistrat les appelle : mais à Athènes, un homme riche seroit au desespoir que l'on pensât qu'il dépendît du magistrat ".
Il y a plus ; la premiere fonction des éphores de Lacédémone, en entrant en charge, étoit une proclamation publique, par laquelle ils enjoignoient aux citoyens, non pas d'observer les lois, mais de les aimer, afin que l'observation ne leur en fût point dure.
Rien ne doit être si cher aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, sages & heureux. Les lois seront précieuses au peuple, tant qu'il les regardera comme un rempart contre le despotisme, & comme la sauvegarde d'une juste liberté.
Parmi les lois, il y en a d'excellentes, de vicieuses & d'inutiles. Toute bonne loi doit être juste, facile à exécuter, particulierement propre au gouvernement, & au peuple qui la reçoit.
Toute loi équivoque est injuste, parce qu'elle frappe sans avertir. Toute loi qui n'est pas claire, nette, précise, est vicieuse.
Les lois doivent commencer directement par les termes de jussion. Les préambules qu'on y met ordinairement sont constamment superflus, quoiqu'ils ayent été inventés pour la justification du législateur, & pour la satisfaction du peuple. Si la loi est mauvaise, contraire au bien public, le législateur doit bien se garder de la donner ; si elle est nécessaire, essentielle, indispensable, il n'a pas besoin d'en faire l'apologie.
Les lois peuvent changer, mais leur style doit toujours être le même, c'est-à-dire simple, précis, ressentant toujours l'antiquité de leur origine comme un texte sacré & inaltérable.
Que les lois respirent toujours la candeur : faites pour prévenir ou pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir la plus grande innocence.
Des lois qui choqueroient les principes de la nature, de la morale ou de la religion, inspireroient de l'horreur. Dans la proscription du prince d'Orange, par Philippe II. ce prince promet à celui qui le tuera, ou à ses héritiers, vingt mille écus & la noblesse, & cela en parole de roi, & comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ! une telle action ordonnée comme serviteur de Dieu ! tout cela renverse également les idées de l'honneur, de la morale & de la religion.
Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette raison soit 1°. digne d'elle. Une loi romaine décide qu'un aveugle ne peut plaider, parce qu'il ne voit pas les ornemens de la magistrature. Il est pitoyable de donner une si mauvaise raison, quand il s'en présente tant de bonnes. 2°. Il faut que la raison alléguée soit vraie ; Charles IX. fut déclaré majeur à 14 ans commencés, parce que, dit le chancelier de l'Hôpital, les lois regardent l'année commencée, lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs ; mais le gouvernement des peuples n'est-il qu'un honneur ? 3°. Il faut, dans les lois, raisonner de la réalité à la réalité, & non de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. La loi des Lombards, l. II. tit. XXXVII. défend à une femme qui a pris l'habit de religieuse de se marier. " Car, dit cette loi, si un époux qui a engagé à lui une femme par un anneau, ne peut pas sans crime en épouser une autre ; à plus forte raison, l'épouse de Dieu ou de la sainte Vierge ".
Enfin dès que dans une loi on a fixé l'état des choses, il ne faut point y ajouter des expressions vagues. Dans une ordonnance criminelle de Louis XIV. après l'énumération des cas royaux, on ajoute : " Et ceux dont de tous tems les juges royaux ont décidé " : cette addition fait rentrer dans l'arbitraire que la loi venoit d'éviter.
Les lois ne font pas regle de droit. Les regles sont générales, les lois ne le sont pas : les regles dirigent, les lois commandent : la regle sert de boussole, & les lois de compas.
Il faut imposer au peuple à l'exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-mêmes, que les meilleures que ce peuple puisse comporter dans sa situation. Autrement il vaut mieux laisser subsister les désordres, que de prétendre y pourvoir par des lois qui ne seront point observées ; car, sans remédier au mal, c'est encore avilir les lois.
Il n'y a rien de si beau qu'un état où l'on a des lois convenables, & où on les observe par raison, par passion, comme on le fit à Rome dans les premiers tems de la république ; car pour lors il se joint à la sagesse du gouvernement toute la force que pourroit avoir une faction.
Il est vrai que les lois de Rome devinrent impuissantes à sa conservation ; mais c'est une chose ordinaire que de bonnes lois, qui ont fait qu'une petite république s'aggrandit, lui deviennent à charge lorsqu'elle s'est aggrandie, parce qu'elles n'étoient faites que pour opérer son aggrandissement.
Il y a bien de la différence entre les lois qui font qu'un peuple se rend maître des autres, & celles qui maintiennent sa puissance lorsqu'il l'a acquise.
Les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ne sont pas sensées, & ont encore cet inconvénient qu'elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire ; ainsi les lois ne doivent statuer que sur des choses essentielles.
Si les lois indifférentes ne sont pas bonnes, les inutiles le sont encore moins, parce qu'elles affoiblissent les lois nécessaires ; celles qu'on peut éluder, affoiblissent aussi la législation. Une loi doit avoir son effet, & il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particuliere.
Plusieurs lois paroissent les mêmes qui sont fort différentes. Par exemple, les lois grecques & romaines punissoient le receleur du vol comme le voleur ; la loi françoise en use ainsi. Celles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l'est point. Chez les Grecs & les Romains, le voleur étoit condamné à une peine pécuniaire, il falloit bien punir le receleur de la même peine ; car tout homme qui contribue, de quelque façon que ce soit, à un dommage, doit le réparer. Mais en France, la peine du vol étant capitale, on n'a pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol, peut en mille occasions le recevoir innocemment : celui qui vole est toujours coupable. Le receleur empêche à la vérité la conviction d'un crime déja commis, mais l'autre commet le crime ; tout est passif dans le receleur, il y a une action dans le voleur. Il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, & que son ame se roidisse plus long-tems contre les lois.
Comme elles ne peuvent prévoir ni marquer tous les cas, c'est à la raison de comparer les faits obmis avec les faits indiqués. Le bien public doit décider quand la loi se trouve muette ; la coûtume ne peut rien alors, parce qu'il est dangereux qu'on ne l'applique mal, & qu'on ne veuille la diriger, au lieu de la suivre.
Mais la coutume affermie par une chaîne & une succession d'exemples, supplée au défaut de la loi, tient sa place, a la même autorité, & devient une loi tacite ou de prescription.
Les cas qui dérogent au droit commun, doivent être exprimés par la loi ; cette exception est un hommage qui confirme son autorité ; mais rien ne lui porte atteinte, comme l'extension arbitraire & indéterminée d'un cas à l'autre. Il vaut mieux attendre une nouvelle loi pour un cas nouveau, que de franchir les bornes de l'exception déja faite.
C'est sur-tout dans les cas de rigueur qu'il faut être sobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette subtilité d'esprit qui va tirer des conséquences, est contraire aux sentimens de l'humanité & aux vûes du législateur.
Les lois occasionnées par l'altération des choses & des tems, doivent cesser avec les raisons qui les ont fait naître, loin de revivre dans les conjectures ressemblantes, parce qu'elles ne sont presque jamais les mêmes, & que toute comparaison est suspecte, dangereuse, capable d'égarer.
On établit des lois nouvelles, ou pour confirmer les anciennes, ou pour les réformer, ou pour les abolir. Toutes les additions ne sont que charger & embrouiller le corps des lois. Il vaudroit mieux, à l'exemple des Athéniens, recueillir de tems en tems les lois surannées, contradictoires, inutiles & abusives, pour épurer & diminuer le code de la nation.
Quand donc on dit que personne ne doit s'estimer plus prudent que la loi, c'est des lois vivantes qu'il s'agit, & non pas des lois endormies.
Il faut se hâter d'abroger les lois usées par le tems, de peur que le mépris des lois mortes ne retombe sur les lois vivantes, & que cette gangrene ne gagne tout le corps de droit.
Mais s'il est nécessaire de changer les lois, apportez-y tant de solemnités & de précautions, que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger.
Ne changez pas les usages & les manieres par les lois, ce seroit une tyrannie. Les choses indifférentes ne sont pas de leur ressort : il faut changer les usages & les manieres par d'autres usages & d'autres manieres. Si les lois gênoient en France les manieres, elles gêneroient peut-être les vertus. Laissez faire à ce peuple léger les choses frivoles sérieusement, & gaiement les choses sérieuses. Cependant les lois peuvent contribuer à former les moeurs, les manieres & le caractere d'une nation ; l'Angleterre en est un exemple.
Tout ce qui regarde les regles de la modestie, de la pudeur, de la décence, ne peut guere être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par les lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.
La multiplicité des lois prouve, toutes choses égales, la mauvaise constitution d'un gouvernement ; car, comme on ne les fait que pour réprimer les injustices & les desordres, il faut de nécessité que, dans l'état où il y a le plus de lois, il y ait aussi le plus de déréglement.
L'incertitude & l'inefficacité des lois procede de leur multiplicité, de leurs vices dans la composition, dans le style & dans la sanction, du partage des interprêtes, de la contradiction des jugemens, &c.
Les lois sont comme au pillage, entre les mains de ce cortege nombreux de jurisconsultes qui les commentent. La seule vûe de leurs compilations a de quoi terrasser l'esprit le plus infatigable. Leurs gloses & leurs subtilités sont les lacets de la chicane. Toutes les citations, si ce n'est celles de la loi, devroient être interdites au barreau. Ce ne sont que des hommes que l'on montre à d'autres hommes, & c'est par des raisons, & non par des autorités qu'il faut décider les cas douteux.
Il y a des lois rétroactives qui viennent au secours des lois antérieures, & qui en étendent l'effet sur les cas qu'elles n'avoient pas prévus. Il faut très-rarement de ces lois à deux fins, qui portent sur le passé & sur l'avenir.
Une loi rétroactive doit confirmer, & non pas réformer celle qui la précede ; la réforme cause toujours des mouvemens de trouble, au lieu que les lois en confirmation affermissent l'ordre & la tranquillité.
Dans un état où il n'y a point de lois fondamentales, la succession à l'empire ne sauroit être fixe, puisque le successeur est déclaré par le prince, par ses ministres, ou par une guerre civile ; que de désordres & de maux en résultent !
Les lois ont sagement établi des formalités dans l'administration de la justice, parce que ces formalités sont le palladium de la liberté. Mais le nombre des formalités pourroit être si grand, qu'il choqueroit le but des lois mêmes qui les auroient établies : alors les affaires n'auroient point de fin, la propriété des biens resteroit incertaine, on ruineroit les parties à force de les examiner. Il y a des pays en Europe, où les sujets sont dans ce cas-là.
Les princes ont donné de bonnes lois, mais quelquefois si mal-à-propos qu'elles n'ont produit que de fâcheux effets. Louis le Débonnaire révolta contre lui les évêques par des lois rigides qu'il leur prescrivit, & qui alloient au-delà du but qu'il devoit se proposer dans la conjoncture des tems.
Pour connoître, pour peindre le génie des nations & des rois, il faut éclairer leur histoire par leurs lois, & leurs lois par leur histoire. Les lois de Charlemagne montrent un prince qui comprend tout par son esprit de prévoyance, unit tout par la force de son génie. Par ses lois, les prétextes pour éluder les devoirs sont ôtés, les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Un pere de famille pourroit y apprendre à gouverner sa maison : il ordonnoit qu'on vendît les oeufs des basse-cours de son domaine, & les herbes inutiles de son jardin ; & l'on sait par l'histoire qu'il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses trésors de ces Huns qui avoient ravagé l'univers.
Dans toute société, c'est la force ou la loi qui domine. Tantôt la force se couvre de la loi, tantôt la loi s'appuie de la force. De là trois sortes d'injustices, la violence ouverte, celle qui marche à l'ombre de la loi, & celle qui naît de la rigueur de la loi.
Les passions & les préjugés des législateurs passent quelquefois au-travers de leurs lois, & s'y teignent ; quelquefois elles y restent & s'y incorporent.
Justinien s'avisa dans un tems de décadence de réformer la jurisprudence des siecles éclairés. Mais c'est dans des jours de lumieres qu'il convient de corriger les jours de ténebres.
Je finis malgré moi toutes ces réflexions qui portent sur les lois en général, mais je parlerai séparément des lois fondamentales, civiles, criminelles, divines, humaines, morales, naturelles, pénales, politiques, somptuaires, &c. & je tâcherai d'en développer en peu de mots la nature, le caractere, l'esprit & les principes. (D.J.)
LOI, proposition & sanction d'une, (Hist. rom.) c'est un point fort curieux dans l'histoire romaine que l'objet de l'établissement d'une loi. Nous avons donc lieu de penser que le lecteur sera bien-aise d'être instruit des formalités qui se pratiquoient dans cette occasion.
Celui qui avoit dessein, dans Rome, d'établir quelque loi, qu'il savoit être du goût des principaux de la république, la communiquoit au sénat, afin qu'elle acquît un nouveau poids par l'approbation de cet illustre corps. Si au contraire le porteur de la loi étoit attaché aux intérêts du peuple, il tâchoit de lui faire approuver la loi qu'il vouloit établir, sans en parler au senat. Il étoit cependant obligé d'en faire publiquement la lecture, avant que d'en demander la ratification, afin que chacun en eût connoissance. Après cela, si la loi regardoit les tribus, le tribun faisoit assembler le peuple dans la place ; & si elle regardoit les centuries, ce premier magistrat convoquoit l'assemblée des citoyens dans le champ de Mars. Là un crieur public répétoit mot-à-mot la loi qu'un scribe lui lisoit ; ensuite, si le tribun le permettoit, le porteur de la loi, un magistrat, & quelquefois même un simple particulier, autorisé par le magistrat, pouvoit haranguer le peuple pour l'engager à recevoir ou à rejetter la loi. Celui qui réussissoit à faire accepter la loi, en étoit appellé l'auteur.
Quand il s'agissoit d'une affaire de conséquence, on portoit une urne ou cassette, dans laquelle on renfermoit les noms des tribus ou des centuries, selon que les unes ou les autres étoient assemblées. On remuoit ensuite doucement la cassette, de peur qu'il n'en tombât quelque nom ; & quand ils étoient mêlés, on les tiroit au hazard ; pour lors, chaque tribu & chaque centurie prenoit le rang de son billet pour donner son suffrage. On le donna d'abord de vive voix ; mais ensuite il fut établi qu'on remettroit à chaque citoyen deux tablettes, dont l'une rejettoit la nouvelle loi en approuvant l'ancienne, & pour cela cette tablette étoit marquée de la lettre A, qui signifioit ancienne ; l'autre tablette portoit les deux lettres U. R. c'est-à-dire, soit fait comme vous le demandez, uti rogas.
Pour éloigner toute fraude, on distribuoit ces tablettes avec beaucoup d'attention. On élevoit alors dans la place où se tenoient les assemblées plusieurs petits théatres ; sur les premiers qui étoient les plus élevés, on posoit les cassettes où étoient renfermées les tablettes qu'on délivroit à ceux qui devoient donner leurs suffrages ; & sur les derniers étoient d'autres cassettes où l'on remettoit lesdites tablettes qui portoient le suffrage. De-là vint le proverbe, les jeunes gens chassent du théatre les sexagénaires, parce qu'après cet âge, on n'avoit plus de droit aux charges publiques.
On élevoit autant de théatres qu'il y avoit de tribus dans les assemblées des tribus, savoir 35 ; & dans les assemblées de centuries, autant qu'il y avoit de centuries, savoir 193.
Il faut maintenant indiquer la maniere de donner les suffrages. On prenoit les tablettes qui étoient à l'entrée du théatre, & après l'avoir traversé, on les remettoit dans la cassette qui étoit au bout. D'abord après que chaque centurie avoit remis ses tablettes, les gardes qui avoient marqué les suffrages par des points, les comptoient, afin d'annoncer finalement la pluralité des suffrages de la tribu ou de la centurie pour ou contre la loi proposée. Cette action de compter les tablettes en les marquant avec des points, a fait dire à Cicéron, comptez les points, & à Horace, celui-là a tous les points, c'est-à-dire, réussit, qui sait joindre l'utile à l'agréable : Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.
La loi qui étoit reçue par le plus grand nombre de suffrages, étoit gravée sur des tables de cuivre ; ensuite on la laissoit quelque tems exposée publiquement à la vue du peuple, ou bien on la portoit dans une des chambres du trésor public pour la conserver précieusement. (D.J.)
LOIS des Barbares, (Code des Barbares) on appelle lois des Barbares, les usages des Francs Saliens, Francs Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons & Lombards.
Tout le monde sait avec quelle sagacité M. de Montesquieu a développé l'esprit, le caractere & les principes de toutes ces lois, je n'en tirerai que quelques généralités.
Les Francs sortis de leur pays, firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Ripuaires s'étant jointe aux Saliens, conserva ses usages, & Théodoric, roi d'Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son royaume. Il est vraisemblable que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étoient aussi ses sujets. La loi des Frisons n'est pas antérieure à Charles Martel & à Pepin qui les soumirent. Charlemagne, qui le premier domina les Saxons, leur donna la loi que nous avons. Les Wisigoths, les Bourguignons & les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.
Il y a dans les lois Saliques & Ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens & des Frisons, une simplicité admirable, une rudesse originale, & un esprit qui n'avoit point été affoibli par un autre esprit. Elles changerent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, resterent dans la Germanie ; mais les lois des Bourguignons, des Lombards & des Wisigoths, perdirent beaucoup de leur caractere, parce que ces peuples qui se fixerent dans de nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.
Les Saxons qui vivoient sous l'empire des Francs, eurent une ame indomptable. On trouve dans leurs lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autres codes de lois des Barbares.
Les lois des Wisigoths furent toutes refondues par leurs rois, ou plutôt par le clergé, dont l'autorité étoit immense. Nous devons à ce code toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues du tribunal de l'inquisition d'aujourd'hui ; & les moines n'ont fait que copier contre les juifs des lois faites autrefois par les évêques du pays.
Du reste, les lois des Wisigoths sont puériles, gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vuides de sens, frivoles dans le fonds, & gigantesques dans le style. Celles de Gondebaud pour les Bourguignons, paroissent assez judicieuses ; celles de Rotharis & des autres princes Lombards, le sont encore plus.
Le caractere particulier des lois des Barbares, est qu'elles furent toutes personnelles, & point attachées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine ; & bien loin qu'on songeât, dans ces tems-là, à rendre uniforme les lois des peuples conquérans, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.
Cependant toutes ces lois personnelles des Barbares, vinrent à disparoître chez les François par des causes générales qui les firent cesser peu-à-peu. Ces lois étoient déja négligées à la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme on n'en entendit presque plus parler. Les fiefs étant devenus héréditaires, & les arriere-fiefs s'étant étendus, il s'introduisit de nouveaux usages, auxquels les lois des Barbares n'étoient plus applicables ; on leur substitua des coutumes.
Comme dans l'établissement de la monarchie, on avoit passé des coutumes & des usages à des lois écrites ; on revint quelques siecles après des lois écrites, à des usages & des coutumes non écrites.
La compilation de Justinien ayant ensuite paru, elle fut reçue comme loi dans les parties de la France qui se gouvernoient par le droit romain, & seulement comme raison dans celles qui se gouvernoient par les coutumes ; c'est pourquoi l'on rassembla quelques-unes de ces coutumes sous le regne de S. Louis & les regnes suivans ; mais sous Charles VII. & ses successeurs, on les rédigea par tout le royaume ; alors elles furent écrites, elles devinrent plus connues & prirent le sceau de l'autorité royale. Enfin, on en a formé de nouvelles rédactions plus complete s dans des tems qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, & dans des tems où l'on ne faisoit pas gloire d'ignorer ce qu'on doit savoir, & de savoir ce qu'on doit ignorer. (D.J.)
LOI, (Jurisprud.) signifie en général un commandement émané d'une autorité supérieure, auquel un inférieur est obligé d'obéir.
Les lois sont de plusieurs sortes, savoir divines ou humaines ; on les distingue aussi, la loi naturelle de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. Il y a encore bien d'autres divisions des lois.
La premiere de toutes les lois, est celle de nature ; les premiers hommes vivoient selon cette loi naturelle, qui n'est autre chose qu'un rayon de lumiere & un principe de la droite raison que Dieu a donné aux hommes pour se conduire, & qui leur fait appercevoir les regles communes de la justice & de l'équité.
L'ancienne loi ou la loi de Moïse, appellée aussi la vieille loi ou la loi des Juifs, est celle que Dieu donna à son peuple par la bouche de son prophete.
A celle-ci a succédé la loi de grace ou la loi chrétienne, la loi de l'évangile qui nous a été apportée par Jesus-Christ, & qui est la plus parfaite de toutes.
Pour ce qui est des lois humaines, il est probable que les premieres furent les lois domestiques que chaque pere de famille fit pour établir l'ordre dans sa maison ; ces lois ne laissoient pas d'être importantes, vu que dans les premiers tems, les familles formoient comme autant de peuples particuliers.
Lorsque les hommes commencerent à se rassembler dans des villes, ces lois privées se trouverent insuffisantes pour contenir une société plus nombreuse, il fallut une autorité plus forte que la puissance paternelle. De l'union de plusieurs villes & pays, il se forma divers états que l'on soumit au gouvernement d'une puissance soit monarchique, ou aristocratique, ou démocratique ; dès-lors ceux qui furent revêtus de la puissance souveraine donnerent des lois aux peuples qui leur étoient soumis, & créerent des magistrats pour les faire observer.
Toute loi est censée émanée du souverain ou autres personnes qui sont revêtues de la puissance publique ; mais comme ceux qui gouvernent ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes, ils chargent ordinairement de la rédaction des lois les plus habiles jurisconsultes, & lorsque ceux-ci en ont dressés le projet, la puissance publique y met le sceau de son autorité en les adoptant & faisant publier en son nom.
Chez les anciens, les sages & les philosophes furent les premiers auteurs des lois.
Moïse, le plus ancien de tous les législateurs, donna aux Juifs plusieurs sortes de lois ; outre celles qui lui furent dictées par la sagesse divine, & que l'on appelle les lois du Décalogue, parce qu'elles sont renfermées en dix commandemens ; il leur donna aussi des lois cérémonielles pour le culte divin, & des lois politiques pour le gouvernement civil.
Les premieres lois ne pourvurent qu'aux grands inconvéniens ; les lois civiles régloient le culte des dieux, le partage des terres, les mariages, les successions ; les lois criminelles n'étoient rigoureuses que pour les crimes que l'on redoutoit le plus ; & à mesure qu'il survint de nouveaux désordres, on tâcha d'y remédier par de nouvelles lois.
Ceux qui donnerent des lois aux nations voisines des juifs emprunterent beaucoup de choses dans les lois de Moïse.
En Egypte, les rois eux mêmes s'étoient soumis à certaines lois ; leur nourriture, leurs occupations étoient réglées, & ils ne pouvoient s'écarter de ces regles sans être sujets aux peines qu'elles prononçoient.
Osiris, roi d'Egypte, regla le culte des dieux, le partage des terres, la distinction des conditions. Il défendit d'user de prise de corps contre le débiteur, la rhétorique fut bannie des plaidoyers pour prévenir la séduction : les Egyptiens engageoient les cadavres de leurs peres, ils les donnoient à leurs créanciers en nantissement, & c'étoit une infamie à eux que de ne les pas dégager avant leur mort ; il y avoit même un tribunal où l'on jugeoit les hommes après leur mort, afin que la crainte d'une telle flétrissure portât les hommes à la vertu.
Amasis prononça la peine de mort contre le meurtrier volontaire, le parjure, le calomniateur, & contre ceux qui pouvant secourir un homme le laissoient assassiner.
En Crete, Minos établit la communauté des tables & des repas. Il voulut que les enfans fussent élevés ensemble, écarta l'oisiveté & le luxe, fit observer un grand respect pour la divinité & pour les maximes fondamentales de l'état.
Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone, institua aussi à l'imitation de Minos les tables communes & l'éducation publique de la jeunesse ; il consentit à l'établissement d'un sénat qui tempérât la puissance trop absolue des rois par une autorité au moins égale à la leur ; il bannit l'or & l'argent, & les arts superflus, & ordonna que les terres fussent partagées également entre tous les citoyens ; que les ilotes, espece d'esclaves, cultiveroient les terres, & que les Spartiates ne s'occuperoient qu'aux exercices qui les rendroient propres à la guerre.
Il permit la communauté des femmes, voulant par ce moyen peupler l'état, sans que le courage des hommes fût amolli par des engagemens trop tendres.
Lorsque les parens pouvoient prouver que leurs enfans étoient mal sains, il leur étoit permis de les tuer. Lycurgue pensoit qu'un homme incapable de porter les armes ne méritoit pas de vivre.
La jeunesse des deux sexes luttoit ensemble ; ils faisoient leurs exercices tous nuds en place publique.
On ne punissoit que les voleurs mal-adroits, afin de rendre les Spartiates vifs, subtils & défians.
Il étoit défendu aux étrangers de s'arrêter à Sparte, de crainte que leurs moeurs ne corrompissent celles que Lycurgue avoit introduites.
Dracon, premier législateur d'Athènes, fit des lois si rigoureuses, qu'on disoit qu'elles étoient écrites plutôt avec du sang, qu'avec de l'encre. Il punissoit de mort les plus petites fautes, & alla jusqu'à faire le procès aux choses inanimées ; une statue, par exemple, qui en tombant avoit écrasé quelqu'un, étoit bannie de la ville.
Mais, comme les pauvres souffroient beaucoup des véxations de leurs créanciers, Solon fut choisi pour reformer les abus & déchargea les débiteurs.
Il accorda aux citoyens la liberté de tester, permit aux femmes qui avoient des maris impuissans, d'en choisir d'autres parmi leurs parens.
Ses lois prononçoient des peines contre l'oisiveté, & déchargeoient ceux qui tuoient un adultere. Elles défendoient de confier la tutele d'un enfant à son plus proche héritier.
Celui qui avoit crevé l'oeil à un borgne étoit condamné à perdre les deux yeux.
Il étoit interdit aux débauchés de parler dans les assemblées publiques.
Solon ne fit point de lois contre le parricide, ce crime lui paroissoit inoui ; il craignit même en le défendant d'en donner l'idée.
Il voulut que ces lois fussent déposées dans l'aréopage.
Les lois d'Athènes passerent dans la suite à Rome : mais avant d'y avoir recours, Romulus, fondateur de l'empire romain, donna des lois à ses sujets ; il permit aussi au peuple assemblé de faire des lois qu'on appella plébiscites.
Toutes les lois faites par Romulus & par ses successeurs rois furent appellées lois royales, & renfermées dans un code appellé papyrien.
Les sénatus-consultes ou arrêts du sénat avoient aussi force de lois.
Vers la fin de l'an 300 de Rome, on envoya en Grece des députés pour choisir ce qu'il y auroit de meilleur dans les lois des différentes villes de ce pays, & en composer un corps de lois ; les décemvirs substitués aux consuls, rédigerent ces lois sur dix tables d'airain, auxquelles peu après ils en ajouterent deux autres ; c'est pourquoi ce corps de lois fut nommé la loi des douze tables, dont il ne nous reste plus que des fragmens.
Les préteurs & les édiles faisoient des édits qui avoient aussi force de lois.
Outre les droits de souveraineté dont Auguste fut gratifié par le peuple ; on lui donna le pouvoir de faire des lois, cette prérogative lui fut accordée par une loi nommée regia.
Auguste donna lui même à un certain nombre de jurisconsultes distingués le droit d'interpréter les lois & de donner des décisions, auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.
Théodose donna pareillement force de loi aux écrits de plusieurs anciens jurisconsultes.
Les lois romaines ont été toutes renfermées dans les livres de Justinien, qui sont le digeste & le code, les institutes, les novelles.
Les successeurs de Justinien ont aussi fait quelques lois, mais il y en a peu qui se soient conservées jusqu'à nous.
Les romains porterent leurs lois dans tous les pays dont ils avoient fait la conquête ; ce fut ainsi que les Gaules les reçurent.
Dans le cinquieme siecle, les peuples du nord inonderent une partie de l'europe, & introduisirent leurs lois chez les vaincus.
Les Gaules furent envahies par les Wisigoths, les Bourguignons & les Francs.
Clovis, fondateur de la monarchie françoise, laissa à ses sujets le choix des lois du vainqueur ou de celles du vaincu ; il publia la loi salique.
Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance appellée de son nom loi Gombette.
Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens, & celles des Allemands & des Bavarois.
Ces différentes lois ont été recueillies en un même volume appellé code des lois antiques.
Sous la seconde race de nos rois, les lois furent appellées capitulaires.
Sous la troisiéme race, on leur a donné le nom d'ordonnances, édits & déclarations.
Le pouvoir législatif n'appartient en France, qu'au roi seul. Ainsi, quand les cours déliberent sur l'enregistrement de quelque nouvelle loi, ce n'est pas par une autorité qui leur soit propre ; mais seulement en vertu d'un pouvoir émané du roi même, & des ordonnances qui leur permettent de vérifier s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire des remontrances, & quand le roi ne juge pas à propos d'y avoir égard, les cours procedent à l'enregistrement.
Les magistrats sont établis pour faire observer les lois, ils peuvent, sous le bon plaisir du roi, les interpréter, lorsqu'il s'agit de quelque cas qu'elles n'ont pas prévû ; mais il ne leur est pas permis de s'en écarter.
Les réglemens que les cours & autres tribunaux font sur les matieres de leur compétence ne sont point des lois proprement dites, ce ne sont que des explications qu'ils donnent pour l'exécution de lois ; & ces réglemens sont toujours censés faits sous le bon plaisir du roi, & en attendant qu'il lui plaise manifester sa volonté.
Les autres nations ont pareillement leurs lois particulieres. Voyez au mot CODE & au mot DROIT, &c.
Toutes les lois sont fondées sur deux principes, la raison & la religion : ces principes étoient inconnus aux payens, tellement que leurs plus grands législateurs s'en sont écartés en plusieurs points ; ainsi les Romains, qui ont fait beaucoup de bonnes lois, s'étoient donné comme les autres peuples, la licence d'ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs esclaves.
La religion peut être regardée comme l'assemblage de toutes les lois ; car outre qu'elle commande à l'homme la recherche du souverain bien, elle oblige les hommes à s'unir & à s'aimer, elle défend de faire aucun tort à autrui.
Les engagemens de la société sont de trois especes, les uns qui ont rapport au mariage, à la naissance des enfans & aux successions ; les autres qui regardent les conventions, d'autres enfin qui sont involontaires, tels que l'obligation de remplir les charges publiques. De-là les différentes lois qui concernent chacun de ces objets.
On trouve communément dans tous les pays trois sortes de lois ; savoir, celles qui tiennent à la politique, & qui reglent le gouvernement ; celles qui tiennent aux moeurs & qui punissent les criminels ; enfin les lois civiles, qui reglent les mariages, les successions, les tuteles, les contrats.
Toutes les lois divines & humaines, naturelles & positives de la religion & de la police, du droit des gens ou du droit civil, sont immuables ou arbitraires.
Les lois immuables ou naturelles, sont celles qui sont tellement essentielles pour l'ordre de la société, qu'on ne pourroit y rien changer sans blesser cet ordre si nécessaire ; telles sont les lois qui veulent que chacun soit soumis aux puissances, & qui défendent de faire tort à autrui.
Les lois arbitraires sont celles qui ont été faites, selon les tems & les circonstances, sur des matieres qui ne sont pas essentielles pour l'ordre de la société, celles-ci n'ont d'effet que pour l'avenir.
Un long usage acquiert force de loi, le non usage abolit aussi les lois ; les magistrats sont les interprétes des lois : pour en pénétrer le sens, il faut comparer les nouvelles aux anciennes, recourir aux lois des lieux voisins, juger du sens & de l'esprit d'une loi par toute sa teneur, s'attacher plutôt à l'esprit de la loi qu'aux termes, suppléer au défaut d'expression par l'esprit de la loi.
Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas non plus distinguer : néanmoins dans les matieres favorables, la loi peut être étendue d'un cas à un autre ; au lieu que dans les matieres de rigueur, on doit la renfermer dans son cas précis.
Voyez le titre du Digeste de legibus, le Traité des lois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terrasson, l'Esprit des lois de M. de Montesquieu.
On va expliquer dans les divisions suivantes, les différentes sortes de lois qui sont distinguées par un nom particulier. (A)
LOI ACILIA est une de celles qui furent faites contre le crime de concussion. Manius Acilius Glabrio en fut l'auteur, elle étoit très-sévere ; il en est parlé dans la seconde Verrine. Il y avoit déjà eu d'autres lois de pecuniis repetundis, ou repetundarum, c'est-à-dire contre le crime de concussion. Voyez LOI CALPURNIA. (A)
LOI AEBUTIA eut pour auteur un certain tribun nommé L. AEBUTIUS, lequel présenta au peuple cette loi, dont l'objet étoit d'abroger plusieurs formules inutiles qu'avoit établies la loi des douze tables, pour la recherche des choses volées. Elle essuya beaucoup de contradiction, & néanmoins fut adoptée, il en est parlé dans Aulu-Gelle. Voyez aussi Zazius. (A)
LOI AELIA FUSIA fut faite par Aelius & Fusius, tribuns du peuple, à l'occasion de ce qu'anciennement les tribuns du peuple, qui faisoient des lois dans les comices, n'étoient point astreints aux égards que la religion obligeoit d'avoir pour les auspices. Il fut donc ordonné par cette loi que tout magistrat qui porteroit une loi, seroit obligé de garder le droit des prieres & des auspices, & que chacun auroit la liberté de venir donner avis des présages sinistres qui se présenteroient, par exemple, si l'on entendoit le tonnerre ; desorte que quand le college des augures, un consul ou le préteur annonçoit quelque chose de semblable, l'assemblée du peuple devoit se séparer, & il ne lui étoit pas permis de rien entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut faite sous le consulat de Gabinius & de Pison, quelque tems avant la troisieme guerre punique, & qu'elle fut en vigueur pendant cent ans, ayant été abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention dans plusieurs de ses ouvrages. Voyez le Catalogue de Zazius. (A)
LOI AELIA SANCTIA. Voyez ci-après LOI AELIA SENTIA.
LOI AELIA SENTIA ou SEXTIA fut faite du tems d'Auguste par les consuls Aelius Sextius Catullus & C. Sentius Saturninus. Elle régloit plusieurs choses concernant les successions, & entr'autres, que chacun ne pouvoit avoir qu'un héritier nécessaire. Elle défendoit d'affranchir les esclaves par testament, ou de les instituer héritiers en fraude des créanciers ; mais que pour que l'on pût accuser le testament de fraude, il falloit qu'il y eût consilium & eventus. Elle avoit aussi réglé que les mineurs de 25 ans ne pourroient affranchir leurs esclaves qu'en présence du magistrat, en la forme appellée vindicta, c'est-à-dire celle qui se faisoit en donnant deux ou trois coups de baguette sur la tête de l'esclave, & que ces manumissions ne seroient autorisées qu'en connoissance de cause ; ce qui fut ainsi ordonné dans la crainte que les mineurs ne fussent séduits par les caresses de leurs esclaves. Mais Justinien corrigea ce dernier chapitre de la loi Aelia Sentia, du-moins quant aux dernieres volontés, ayant ordonné par ses institutes que le maître âgé de 17 ans, pourroit affranchir ses esclaves par testament ; ce qu'il fixa depuis par sa novelle 119 au même âge auquel il est permis de tester. Il étoit encore ordonné par cette loi, par rapport aux donations entre mari & femme, que si la chose n'avoit pas été livrée, & que le mari eût gardé le silence jusqu'à sa mort, la femme n'auroit pas la vendication de la chose après la mort de son mari ; mais seulement une exception, si elle ne possédoit pas. Cicéron dans ses Topiques nomme cette loi Aelia Sentia ; mais Charondas en ses notes sur Zazius, fait voir que ces deux lois étoient différentes. (A)
LOI AEMILIA étoit une loi somptuaire qui fut faite par M. Aemilius Scaurus, consul. Il en est parlé dans Pline, lib. VIII. const. 57. Son objet fut de réprimer le luxe de ceux qui faisoient venir à grands frais des coquillages & des oiseaux étrangers pour servir sur leur table. Voyez Zazius.
Il ne faut pas confondre cette loi avec le senatus-consulte Aemilien, qui déclaroit valables les donations faites entre mari & femme, lorsque le donateur avoit persévéré jusqu'à la mort. (A)
LOIS AGRAIRES ; leges agrariae. On a donné ce nom à plusieurs lois différentes qui ont eu pour objet de régler ce qui concerne les champs ou terres appellées en latin agri.
On pourroit mettre au nombre des lois agraires les lois des Juifs & des Egyptiens, qui regardoient la police des champs, & celle que Lycurgue fit pour le partage égal des terres entre tous les citoyens, afin de maintenir entr'eux une égalité qui fût la source de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici des lois qui furent nommées agraires.
La premiere loi appellée agraire fut proposée par Spurius Cassius Viscellinus, lors de son troisieme consulat. Cet homme, qui étoit d'une humeur remuante, voulant plaire aux plébéïens, demanda que les terres conquises fussent partagées entr'eux & les alliés de Rome. Le sénat eut la foiblesse d'accorder cette division aux plébéïens par la célebre loi ou decret agraire ; mais elle attira tant d'ennemis à celui qui en étoit l'auteur, que l'année suivante les questeurs Fabius Caeso & L. Valerius se porterent parties contre Cassius, qu'ils accuserent d'avoir aspiré à la royauté ; il fut cité, comme perturbateur du repos public, & précipité du mont Tarpéïen, l'an de Rome 270, ses biens vendus, sa maison détruite.
Cependant la loi agraire subsistoit toujours, mais le sénat en éludoit l'exécution ; les grands possédoient la majeure partie du domaine public & aussi des biens particuliers : le peuple reclamoit l'exécution de la loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinia, qui fut surnommée agraria. Elle fut faite par un riche plébéïen nommé C. Licinius Stolon, lequel ayant été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant favoriser le peuple contre les patriciens, proposa une loi tendante à obliger ces derniers de céder au peuple toutes les terres qu'ils auroient au-delà de 500 arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois & la création de plusieurs nouveaux magistrats, furent cause que cette affaire traîna pendant neuf années, mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patriciens.
Le premier article de cette loi portoit que l'une des deux places de consuls ne pourroit être remplie que par un plébéïen, & qu'on n'éliroit plus de tribuns militaires.
Les autres articles de cette loi, qui la firent surnommer agraria, parce qu'ils concernoient le partage des terres, ordonnoient qu'aucun citoyen ne pourroit posséder dorénavant plus de 500 arpens de terre, & qu'on distribueroit gratuitement, ou qu'on affermeroit à un très-bas prix, l'excédent de cette quantité à ceux d'entre les citoyens qui n'auroient pas de quoi vivre, & qu'on leur donneroit au-moins à chacun sept arpens.
Cette loi regloit aussi le nombre des bestiaux & des esclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir les terres qu'il auroit eu en partage, & l'on nomma trois commissaires pour tenir la main à l'exécution de cette loi.
Mais comme les auteurs des lois ne sont pas toujours ceux qui les observent le mieux, Licinius fut convaincu d'être possesseur de 1000 arpens de terre ; pour éluder la loi, il avoit donné la moitié de ces terres à son fils, qu'il fit pour cet effet émanciper ; mais cette émancipation fut réputée frauduleuse, & Licinius obligé de restituer à la république 500 arpens qui furent distribués à de pauvres citoyens. On le condamna même à payer l'amende de 10 mille sols d'or, qu'il avoit ordonnée : desorte qu'il porta le premier la peine qu'il avoit établie, & eut encore le chagrin de voir dès la même année abolir cette loi par la cabale des patriciens.
Le mauvais succès de la loi licinia agraria fut cause que pendant long-tems on ne parla plus du partage des terres, jusqu'à ce que C. Quintius Flaminius, tribun du peuple, quelques années avant la seconde guerre punique, proposa au peuple, en dépit du sénat, un projet de loi pour faire partager au peuple les terres des Gaules & du Picentin ; mais la loi ne fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de son dessein par son pere.
La loi sempronia agraria mit enfin à exécution l'ancien decret agraire de Cassius, & ordonna que les provinces conquises se tireroient au sort entre le sénat & le peuple ; & en conséquence le sénat envoyoit des proconsuls dans ses provinces pour les gouverner. Le peuple envoyoit dans les siennes des préteurs provinciaux, jusqu'à ce que Tibere ôta aux tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma à celle du peuple des recteurs & des préfets.
Le peuple desiroit toujours de voir rétablir la loi licinia, mais il s'écoula plus de 130 années sans aucune occasion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus, lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Rome 527, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour cet effet il fit déposer Octavius son collegue, lequel s'étoit rangé du parti des grands, au moyen de quoi la loi fut reçue d'une voix unanime : mais les patriciens en conçurent tant de ressentiment, qu'ils le firent périr dans une émotion populaire.
Caïus Gracchus, frere de Tibérius, ne laissa pas de solliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint enfin ; il signala son avénement en proposant de recevoir une troisieme fois la loi licinia, & fit si bien qu'elle fut encore reçue malgré les oppositions des patriciens ; mais il en coûta aussi la vie à Caïus Gracchus, par la faction des grands, qui ne pouvoient souffrir le rétablissement des lois agraires. Pour ôter jusqu'au souvenir des lois des Gracques, on fit périr tous ceux qui avoient été attachés à leur famille.
Après la mort des Gracques on fit une loi agraire, portant que chacun auroit la liberté de vendre les terres qu'il avoit eu en partage, ce qui avoit été défendu par Tibérius Gracchus.
Peu de tems après on en fit encore une autre qui défendit de partager à l'avenir les terres du domaine public, mais que ceux qui les possédoient les conserveroient en payant une redevance annuelle ; & que l'argent qui en proviendroit seroit distribué au peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce que chacun espéroit d'avoir sa part de ces revenus ; mais comme ils ne suffisoient pas pour une si grande multitude, l'attente du peuple fut vaine ; & environ dix ans après que Tibérius Gracchus avoit fait sa loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, en fit une autre par laquelle il déchargea les terres publiques de toute imposition, au moyen de quoi le peuple fut privé de la jouissance des terres & de la redevance.
Ciceron, lib. II. de ses offices, fait mention d'une autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple ; & Valere Maxime parle aussi d'une loi agraire faite par Sex. Titius, mais on ne sait point ce que portoient ces lois.
Cornelius Sylla fit pendant sa dictature une loi agraire, appellée de son nom cornelia : il fit distribuer beaucoup de terres aux soldats, lesquels augmentoient encore leurs possessions par les voies les plus iniques.
Le tribun Servilius fit ensuite une autre loi agraire qui tendoit à bouleverser tout l'état : il vouloit que l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres d'Italie, de Syrie, d'Asie, de Lybie, & des provinces que Pompée venoit de subjuguer, pour, de l'argent qui en proviendroit, acheter des terres pour le peuple, & lui assurer ainsi sa subsistance ; mais Cicéron par son éloquence fit si bien que cette loi fut rejettée.
Quelques années après le tribun Curion fit une autre loi agraire ou viaire, presque semblable à celle de Servilius.
Environ dans le même tems le tribun Flavius Canuleïus en fit une autre, dont Cicéron fait mention lib. I. ad Atticum. Voyez LOI FLAVIA.
Enfin Jules-César fit aussi par le conseil de Pompée une loi agraire, appellée de son nom julia, & que Cicéron appelle aussi campana, par laquelle il partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui étoient peres de trois enfans ; & afin que chacun pût conserver son héritage, il établit une amende contre ceux qui dérangeroient les bornes.
La loi troisieme au digeste de termino moto, fait mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva.
On trouve quelques fragmens des dernieres lois agraires dans les recueils d'inscriptions, & dans les anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à la fin de ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, de legibus senatus consultis. Voyez aussi le catalogue de Zazius.
Nous avons aussi en France plusieurs lois que l'on peut appeller lois agraires, parce qu'elles reglent la police des champs : telles sont celles qui concernent les paturages, le nombre des bestiaux, le tems de la récolte des foins & grains, & des vendanges, &c. Voyez le code rural. (A)
LOIS DES ALLEMANDS étoit la loi des peuples d'Alsace & du haut Palatinat. Elle fut formée des usages non écrits du pays, & rédigée par écrit par ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils de Clovis. Il fit en même tems rédiger la loi des Ripuariens & celle des Bavarois, tous peuples qui étoient soumis à son obéissance. Ce prince étoit alors à Châlons-sur-Marne ; il fit plusieurs corrections à ces lois, principalement pour ce qui n'étoit pas conforme au Christianisme. Elle fut encore reformée par Childebert, & ensuite par Clotaire, lequel y procéda avec ses princes ; savoir 33 évêques, 34 ducs, 72 comtes, & avec tout le peuple, ainsi que l'annonce le titre de cette loi. Agathias dit que sous l'empire de Justinien les Allemands, pour leur gouvernement politique, suivoient les lois faites par les rois de France.
Dagobert renouvella cette loi des Allemands & autres lois antiques, & les mit en leur perfection par le travail de quatre personnages illustres, Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe.
Voyez le code des lois antiques, le glossaire de Ducange, au mot lex ; l'histoire du Droit françois de M. de Fleury. (A)
LOI D'AMIENS, dans les anciens auteurs, signifie les coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des autres villes, comme loi de Tournay, loi de Vervins, loi de la Bastie, &c. (A)
LOI ANCIENNE, ou plutôt ANCIENNE LOI, qu'on appelle aussi la vieille loi, est la loi de Moïse. Voyez ci-après LOI DE MOÏSE. (A)
LOI DES ANGLES, ANGLIENS ou THURINGIENS, lex Angliorum, étoit la loi des anciens Angles, peuples de la Germanie qui habitoient le long de l'Elbe. Elle fut confirmée par Charlemagne. Voy. Le glossaire de Ducange, au mot lex. (A)
LOI DES ANGLOIS, lex Anglorum, peuples de la Grande-Bretagne, fut originairement établie par les anciens Angles, ou Anglo-Germains, ou Anglo-Saxons & Danois qui occuperent cette île. Il y eut trois sortes de lois des Anglois ; savoir celle des Saxons occidentaux, celle des Merciens, & celle des Danois.
Le premier prince que l'on connoisse pour avoir fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois, fut Ethelred, roi de Kent, qui commença à régner en 567, & établit la religion chrétienne ; mais ses lois furent très-concises & très-grossieres. Inas, roi des Saxons occidentaux, qui commença à régner en 712, publia aussi ses lois ; & Offa, roi des Merciens, qui régnoit en 758, publia ensuite les siennes. Enfin Aured, roi de la West Saxe ou des Saxons occidentaux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, ayant fait examiner les lois d'Ethelred, d'Inas & d'Offa, en forma une nouvelle, dans laquelle il conserva tout ce qu'il y avoit de convenable dans celles de ces différens princes, & retrancha le reste. C'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des premieres lois d'Angleterre ; il mourut l'an 900. Cette loi est celle qu'on appelle West-senelaga ; elle fut observée principalement dans les neuf provinces les plus septentrionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.
La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre, fit naître une autre loi appellée denelaga, c'est-à-dire loi danoise, qui étoit autrefois suivie par les 14 provinces orientales & septentrionales.
De ces différentes lois Edouard III. dit le confesseur, forma une loi appellée loi commune ou loi d'Edouard ; d'autres cependant l'attribuent à Edgard.
Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant ayant subjugué l'Angleterre, lui donna de nouvelles lois ; il confirma pourtant les anciennes lois, & principalement celle d'Edouard.
Henri I. roi d'Angleterre donna encore depuis à ce royaume de nouvelles lois.
Voyez Selden & Welocus en sa collection des lois d'Angleterre ; le glossaire de Ducange, au mot lex Anglorum & au mot DROIT DES ANGLOIS. (A)
LOI ANNAIRE, annaria. On donnoit quelquefois ce nom aux lois annales qui régloient l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature ; mais les anciens distinguoient la loi annaire de la loi annale, & entendoient par la premiere celle qui fixoit l'âge auquel on étoit exempt à l'avenir de remplir les charges publiques. Voyez Lampridius in Commodo.
LOIS ANNALES, ou comme qui diroit lois des années, étoient les lois qui furent faites à Rome pour régler l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature. Tite-Live, liv. X. decad. 4. dit que cette loi fut faite sur les instances d'un tribun du peuple. Ceux qui étoient de cette famille furent de-là surnommés annales. Ovide en parle aussi dans ses fastes, où il dit :
Finitaque certis
Legibus est aetas, unde petatur honos.
La premiere loi de ce nom fut la loi junia, surnommée annalis. Voyez LOI JUNIA.
Les autres lois qui furent faites dans la suite pour le même objet, furent pareillement nommées lois annales.
Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius Rusca fit aussi une loi annale.
Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des off. liv. I. ch. jv. n. 22. (A)
LOI ANNONAIRE est celle qui pourvoit à ce que les vivres n'enchérissent point, & qui rend sujets à accusation & punition publique ceux qui sont cause d'une telle cherté. Vid. Tit. ad leg. jul. de anno. ff. On a fait beaucoup de ces lois en France. Voyez Terrien sur l'ancienne coutume de Normandie, liv. IV. ch. xvj. (A)
LOI ANTIA étoit une loi somptuaire chez les Romains, ainsi appellée, parce qu'elle fut faite par Anitius Restio. Outre que cette loi régloit en général la dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou à celui qui aspiroit à la magistrature, d'aller manger indifféremment chez tout le monde, afin qu'ils ne fussent pas si familiers avec les autres, & que les magistrats ne pussent aller manger que chez certaines personnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejettée. Il est fait mention de cette loi par Cicéron dans le VII. liv. de ses épitr. famil. & dans le catalogue des lois antiques par Zazius. Gosson en parle aussi dans son commentaire sur la coutume d'Artois, article 12, où il dit que les magistrats doivent être leurs propres juges sur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il n'y a d'autre loi sur cette matiere que celle de la bienséance. (A)
LOIS ANTIQUES, sont les lois des Wisigoths ; un édit de Théodoric roi d'Italie ; les lois des Bourguignons ou Gombettes ; la loi salique & celle des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands ; celle des Bavarois, des Anglois, & des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile : elles ont été recueillies par Lindenbrog en douze livres, intitulés Codex legum antiquarum. Voyez CODE DES LOIS ANTIQUES, & ici l'art. de chacune de ces lois. (A)
LOI ANTONIA JUDICIARIA, c'étoit un projet de loi que le consul Marc-Antoine tâcha de faire passer après la mort de César, par laquelle il rejettoit dans la troisieme décurie qui étoit celle des questeurs ou financiers appellés tribuni aerarii, les centurions & les gens de la légion des Alandes. Cicéron en parle dans sa premiere Philippique, mais Antoine fut déclaré ennemi de la république avant que cette loi fut reçue.
Appien fait aussi Antoine auteur d'une loi dictatura, & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois qui avoit été appellé jusqu'alors Quintilis, seroit nommé Julius du nom de Jules-César qui étoit né dans ce mois. Voy. Zazius & l'Hist. de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)
LOI APERTE, ou LOI SIMPLE, ou SIMPLE LOI, qui sont synonymes, signifient en Normandie la maniere de juger les actions simples, par lesquelles on défend quelque chose, sans qu'il soit besoin des formalités requises pour les autres actions. Il est dit dans le chap. lxxxvij. de l'ancienne coûtume, que toute querelle de meuble au-dessous de dix sols est simple, ou terminée par simple loi ; & au-dessus, apparissant, ou terminée par loi apparissant. Voyez le Glossaire de M. de Lanion au mot LOI APPARISSANT, & ci-après LOI APPARENTE.
LOI APPARENTE ou APPAROISSANT, qui dans l'ancienne coûtume de Normandie est aussi appellée loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu'on obtient en chancellerie à l'effet de recouvrer la possession d'un héritage dont on est propriétaire, & que l'on a perdu.
Cette forme de revendication est particuliere à la coûtume de Normandie.
Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que trois choses concourent.
1°. Que le demandeur justifie de son droit de propriété, & qu'il a perdu la possession depuis moins de quarante ans.
2°. Que celui contre qui la demande est faite soit possesseur de l'héritage, qu'il n'ait aucun droit à la propriété.
3°. Que l'héritage contentieux soit désigné clairement dans les lettres par sa situation & par ses confins.
Pendant cette instance de revendication, le défendeur demeure toûjours en possession de l'héritage, mais si par l'événement il succombe, il est condamné à la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande en loi apparente.
Il y avoit dans l'ancienne coûtume plusieurs sortes de loi apparoissant, savoir l'enquête de droit & de coûtume, le duel ou bataille, & le reconnoissant ou enquête d'établissement. Voyez l'anc. coût. chap. lxxxvij. & le Glossaire de M. de Lauriere au mot, LOI APPARISSANT. Voyez Basnage sur les art. 60, 61 & 62 de la coût. de Normandie. (A)
LOI APULEIA, fut faite par le consul Apuleïus Saturninus, lequel voulant gratifier ce Marius dont le crédit égaloit l'ambition, ordonna que dans chaque colonie latine Marius pourroit faire trois citoyens romains ; mais cela n'eut point d'exécution. Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison pro Cornelio Balbo. Voyez aussi Zazius.
Il y eut une autre loi du même nom, surnommée lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à l'occasion d'un certain M. Norbanus, homme méchant & séditieux, lequel avoit condamné injustement Q. Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. Norbanus fut accusé du crime de lese-majesté pour avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui l'accusa, & Antoine qui le défendit. Ciceron parle de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)
LOI AQUILIA, étoit un plébiscite fait par l'instigation de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en l'année 382 de la fondation de Rome, & ensuite préteur de Sicile en 577. Quelques jurisconsultes ont cru qu'elle étoit d'Aquilius Gallus, inventeur de la stipulation aquilienne, mais celui-ci ne fut point tribun du peuple, & la loi aquilia est plus ancienne que lui.
Cette loi contenoit trois chapitres.
Le premier défendoit de tuer de dessein prémédité les esclaves & les animaux d'autrui.
On ne sait point certainement la teneur du second chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'étoit plus observé de son tems. On croit qu'il établissoit des peines contre ceux qui enlevoient aux autres l'utilité qu'ils pouvoient tirer de quelque chose, comme quand on offusquoit le jour de son voisin sans aucun droit ; d'autres croyent que ce chapitre traitoit de servo corrupto, & qu'il fut abrogé parce que le préteur décerna la peine du double contre celui qui seroit poursuivi pour l'action de servo corrupto ; au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux qui nioient le crime.
Le troisieme chapitre contenoit des dispositions contre ceux qui avoient blessé des esclaves ou des animaux d'autrui, & contre ceux qui avoient tué ou blessé des animaux, qui pecudum numero non erant, c'est-à-dire, de ces bêtes que l'on ne rassemble point par troupeaux.
Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pighius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144. & 145. (A)
LOI ARBITRAIRE ou MUABLE, est celle qui dépend de la volonté du législateur, qui auroit pû n'être pas faite ou l'être tout autrement, & qui étant faite peut être changée, ou même entierement abolie ; telles sont les lois qui concernent la disposition des biens, les offices, l'ordre judiciaire. Il y a au contraire des lois immuables & qui ne sont point arbitraires, ce sont celles qui ont pour fondement les regles de la justice & de l'équité. (A)
LOI ATERINA, que d'autres appellent aussi loi Tarpeïa, fut faite sous les consuls Tarpeïus Capitolinus & A. Aterinus Fontinalis ; elle fixoit les peines & amendes à un certain nombre de brebis ou de boeufs : mais comme tous les bestiaux ne sont pas de même prix, & que d'ailleurs leur valeur varie, il arrivoit de-là que la peine du même crime n'étoit pas toûjours égale ; c'est pourquoi la loi Aterina fixa dix deniers pour la valeur d'une brebis, & cent deniers pour un boeuf. Denis d'Halicarnasse remarque aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit auparavant qu'aux consuls. Voyez Zazius. (A)
LOI ATTILIA, fut ainsi nommée du préteur Attilius qui en fut l'auteur, elle concernoit les tuteles : la loi des douze tables avoit ordonné qu'un pere de famille pourroit par son testament nommer à ses enfans tel tuteur qu'il voudroit ; & que si un pere mouroit sans avoir testé, le plus proche parent seroit tuteur des enfans ; mais il arrivoit quelquefois que les enfans n'avoient point de parens proches, & que le pere n'avoit point fait de testament. Le préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix ; c'est ce que les jurisconsultes nommerent tuteurs Attiliens, parce qu'ils étoient nommés en vertu de la loi Attilia : comme cette loi ne s'observa d'abord qu'à Rome, on en fit dans la suite une autre appellée Julia Tibia, qui étendit la disposition de la loi Attilia dans toutes les provinces de l'empire. Voyez les institutes tit. de Attiliano tutore. (A)
LOI ATINIA, fut faite pour confirmer ce que la loi des douze tables avoit ordonné au sujet de la prescription, ou plutôt usucapion des choses volées, savoir, que ces sortes de choses ne pouvoient être prescrites à moins qu'elles ne revinssent entre les mains du légitime propriétaire. On ne sait pas au juste l'époque de cette loi. Cicéron observe seulement qu'elle fut faite dans des tems antérieurs à ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en ses Annales, tom. II. p. 255. pense qu'elle fut faite l'an de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tribun du peuple sous le consulat de Cornélius Cethegus, & de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vraisemblable : Cicéron en parle dans sa troisieme Verrine. Voyez aussi Zazius. (A)
LOI AURELIA, surnommée JUDICIARIA, fut faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, & qui étoit préteur ; ce fut à l'occasion des abus qui s'étoient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis dix ans le sénat se laissoit gagner par argent pour absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit le pouvoir de juger aux trois ordres, c'est-à-dire, des sénateurs, des chevaliers, & des tribuns du peuple romain, qui étoient eux-mêmes du corps des chevaliers romains. Cette loi fut observée pendant environ seize ans, jusqu'à ce que la loi Pompeia reglât d'une autre maniere la forme des jugemens. Voyez Velleius Paterculus, lib. II. & Zazius. (A)
LOI AURELIA DE TRIBUNIS, eut pour auteur C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Manlius Torquatus ; il fut dit par cette loi, que les tribuns du peuple pourroient parvenir aux autres magistratures dont ils avoient été exclus par une loi que Sylla fit pendant sa dictature. Voyez Appien, lib. I. Bell. civ. & Ascanius in Cornelianam leg. (A)
LOIS BARBARES, on entend sous ce nom les lois que les peuples du Nord apporterent dans les Gaules, & qui sont rassemblées dans le code des lois antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths ; la loi gombette ou des Bourguignons ; la loi salique ou des Francs ; celle des Ripuariens, celle des Allemands, celle des Bavarois ; les lois des Saxons, des Anglois, des Frisons, des Lombards ; elles ont été nommées barbares, non pas pour dire qu'elles soient cruelles ni grossieres, mais parce que c'étoient les lois de peuples qui étoient étrangers à l'égard des Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares. Voyez code des lois antiques, & les articles où il est parlé de chacune de ces lois en particulier. (A)
LOI DE BATAILLE, signifioit autrefois les regles que l'on observoit pour le duel lorsqu'il étoit autorisé & même permis. Il en est parlé dans l'ancienne coûtume de Normandie, chap. cxvij. cxx. & ailleurs. (A)
LOI DES BAVAROIS, lex Bajwariorum. La préface de cette loi nous apprend que Théodoric ou Thierry, roi d'Austrasie, étant à Châlons-sur-Marne, fit assembler les gens de son royaume les plus versés dans les sciences des anciennes lois, & que par son ordre ils réformerent & mirent par écrit la loi des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui étoient tous soumis à sa puissance ; il y fit les additions & retranchemens qui parurent nécessaires, & ce qui étoit reglé selon les moeurs des payens fut rendu conforme aux lois du christianisme ; & ce qu'une coûtume trop invétérée l'empêcha alors de changer, fut ensuite revu par Childebert & achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre cette loi en meilleur style par quatre personnages distingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe. La préface de cette derniere réformation porte, que cette loi est l'ouvrage du roi, de ses princes, & de tout le peuple chrétien qui compose le royaume des Mérovingiens. On a ajoûté depuis à ces lois un decret de Tassilon, duc de Baviere. Voyez l Hist. du Dr. fr. par M. l'Abbé Fleury. (A)
LOI DES BOURGUIGNONS. Voyez LOI GOMBETTE.
LOI BURSALE, est celle dont le principal objet est de procurer au souverain quelque finance pour fournir aux besoins de l'état. Ainsi toutes lois qui ordonnent quelque imposition, sont des lois bursales : on comprend même dans cette classe celles qui établissent quelque formalité pour les actes, lorsque la finance qui en revient au prince est le principal objet qui a fait établir ces formalités. Tels sont les édits & déclarations qui ont établi la formalité du papier & du parchemin timbré, & celle de l'insinuation laïque. Il y a quelques-unes de ces lois qui ne sont pas purement bursales, savoir celles qui en procurant au roi une finance, établissent une formalité qui est réellement utile pour assurer la vérité & la date des actes : tels sont les édits du contrôle tant pour les actes des notaires que pour les billets & promesses sous signature privée. Les lois purement bursales ne s'observent pas avec la même rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu'un nouveau propriétaire n'a pas fait insinuer son titre dans le tems porté par les édits & déclarations, le titre n'est pas pour cela nul ; l'acquéreur encourt seulement la peine du double ou du triple droit, & il dépend du fermier des insinuations d'admettre l'acquéreur à faire insinuer son contrat, & de lui faire remise du double ou triple droit. (A)
LOI CADUCAIRE, caducaria lex, surnommée aussi Julia, fut une loi d'Auguste, par laquelle il ordonna que les biens qui n'appartiendroient à personne, ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui auroient perdu le droit qu'ils pouvoient y avoir, seroient distribués au peuple.
On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par les guerres civiles. Telles étoient les lois portant que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, appartenoit au fisc, s'il ne se marioit dans le tems préfini par la loi.
Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'enfans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé par testament ou codicille : cela s'appelloit en droit poena orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par testament à des personnes qui décédoient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l'ouverture du testament, devenoit caduc, & appartenoit au fisc.
Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)
LOI CALPHURNIA ou CALPURNIA de ambitu, c'est-à-dire contre ceux qui briguoient les magistratures par des voies illicites. Elle fut faite par le tribun L. Calphurnius Piso. Voyez ce qui est dit de lui dans l'article suivant. Zazius fait mention de cette loi en son catalogue. (A)
Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la premiere loi faite contre le crime de concussion. C'étoit sous le consulat de L. Marcius Censorinus & M. Manilius, & du tems de la troisieme guerre punique : Cicéron en fait mention in Bruto, & dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)
LOI CAMPANA, ainsi appellée à campis, parce qu'elle concernoit les terres. C'est sous ce nom que Cicéron désigne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atticum. Voyez LOIS AGRAIRES & LOI JULIA AGRARIA. (A)
LOI CANONIQUE est une disposition qui fait partie du droit canonique romain, ou du droit ecclésiastique en général. Voyez DROIT CANONIQUE. (A)
LOI CANULEIA. C'étoit un plébiscite qui fut ainsi nommé de C. Canuleius tribun du peuple, qui le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux dernieres tables de la loi qu'ils rédigerent, avoient ordonné entr'autres choses, que les patriciens ne pouvoient s'allier aux plébeïens : ce qui porta les décemvirs à faire cette loi, fut qu'ils étoient eux-mêmes tous patriciens, & que suivant la coûtume ancienne aucun plébéïen ne pouvoit entrer dans le collége des augures, Romulus ayant réservé cet honneur aux seuls patriciens : d'où il seroit arrivé que, si l'on n'empêchoit pas les mesalliances des patriciens avec les plébéïens, le droit exclusif des patriciens pour la fonction d'augures auroit été troublé par une nouvelle race, que l'on n'auroit sû si l'on devoit regarder comme patricienne ou comme plébéïenne. Mais pour abolir cette loi qui excluoit les plébéïens, Canuleius proposa le plébiscite dont on vient de parler, portant que les patriciens & les plébéïens pourroient s'allier les uns aux autres indifféremment : car il ne paroissoit pas convenable que dans une ville libre, la plus grande partie des citoyens fussent regardés comme indignes que l'on prît alliance avec eux. Les patriciens s'opposerent fortement à cette loi, disant que c'étoit souiller leur sang ; que c'étoit confondre le droit des différentes races ; & que cela troubleroit les auspices publics & privés. Mais comme dans le même tems d'autres tribuns publierent aussi une loi, portant que l'un des deux consuls seroit choisi entre les plébéïens, les patriciens prévoyant que s'ils s'opposoient à la loi canuleia, ils seroient obligés de consentir à l'autre, ils aimerent mieux donner les mains à la premiere concernant les mariages. Cela se passa sous le consulat de M. Genutius & de P. Curiatus. Voyez Tit. Liv. lib. IV. & Zazius. (A)
LOI CARBONIENE. Carbonien défendoit de consacrer une maison, un autel sans la permission du peuple.
Il y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés aux villes alliées, pourvû qu'au tems où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poëta. (A)
LOI CASSIA. Il y a eu trois lois de ce nom.
La premiere est la loi cassia agraria, dont on a parlé ci-devant, à l'article des LOIS AGRAIRES.
La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par L. Cassius Longinus tribun du peuple, sous le consulat de C. Marius & de C. Flavius Fimbria. Cette loi dont le but étoit de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n'auroit plus entrée dans le sénat.
La troisieme loi cassia est une des lois appellées tabellaires, c'est-à-dire, qui régloient que l'on opineroit par écrit, au lieu de le faire de vive voix. Voyez LOIS TABELLAIRES. (A)
LOI DE CENS signifie amende de cens non payé : c'est de-là qu'on trouve dans les anciens dénombremens cens à loi & amende, ou bien cens & loi, qui en défaut de payement peuvent échoir. Voyez le contrat de 1477 pour la fondation de la messe dite de Mouy en l'église de S. Quentin. Lafont, sur Vermandois, art. 135. (A)
LOI CINCIA étoit un plébiscite qui fut fait par le tribun M. Cincius, sous le consulat de M. Cethegus & de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à la persuasion de Fabius, celui-là qui sut en temporisant, rétablir les affaires de la république. Dans les premiers siecles de Rome, les avocats plaidoient gratuitement, le peuple leur faisoit des présens. Dans la suite, comme on leur marquoir moins de reconnoissance, ils exigerent de leurs cliens des présens, qui étoient d'abord volontaires. C'est pourquoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de prêter gratuitement leur ministere au menu peuple. La loi cincia avoit encore deux autres chefs. L'un cassoit les donations faites aux avocats, lorsqu'elles excédoient une certaine somme ; l'autre concernoit la forme de ces donations. Le jurisconsulte Paulus avoit fait un livre sur la loi cincia, mais qui est perdu : nous avons un commentaire sur cette même loi par Fréderic Prummerus.
Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de ce qui concerne les avocats & leurs honoraires, au mot AVOCATS. (A)
LOI CIVILE, (Droit civil d'une nation) reglement émané du souverain, pour procurer le bien commun de ses sujets.
L'assemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil ; & l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obscurité, ou on les applique convenablement aux actions des citoyens, s'appelle jurisprudence civile.
Pour pourvoir d'une maniere stable au bonheur des hommes & à leur tranquillité, il falloit établir des lois fixes & déterminées, qui éclairées par la raison humaine, tendissent à perfectionner & à modifier utilement la loi naturelle.
Les lois civiles servent donc, 1°. à faire connoître plus particulierement les lois naturelles elles-mêmes. 2°. A leur donner un nouveau degré de force, par les peines que le souverain inflige à ceux qui les méprisent & qui les violent. 3°. A expliquer ce qu'il peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit naturel. 4°. A modifier en diverses manieres l'usage des droits que chacun a naturellement. 5°. A déterminer les formalités que l'on doit suivre, les précautions que l'on doit prendre pour rendre efficaces & valables les divers engagemens que les hommes contractent entr'eux, & de quelle maniere chacun doit poursuivre son droit devant les tribunaux.
Ainsi les bonnes lois civiles ne sont autre chose que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées & modifiées par autorité souveraine, d'une maniere convenable à l'état de la société qu'il gouverne & à ses avantages.
On peut distinguer deux sortes de lois civiles ; les unes sont telles par rapport à leur autorité seulement, & les autres par rapport à leur origine.
On rapporte à la premiere classe toutes les lois naturelles qui servent de regles dans les tribunaux civils, & qui sont d'ailleurs confirmées par une nouvelle sanction du souverain : telles sont toutes les lois qui déterminent quels sont les crimes qui doivent être punis.
On rapporte à la seconde classe les lois arbitraires, qui ont pour principe la volonté du souverain, ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en elles-mêmes : telles sont les lois qui reglent les formalités nécessaires aux contrats, aux testamens, la maniere de procéder en justice, &c. Mais quoique ces réglemens soient arbitraires, ils doivent toujours tendre au bien de l'état & des particuliers.
Toute la force des lois civiles consiste dans leur justice & dans leur autorité, qui sont deux caracteres essentiels à leur nature, & au défaut desquels elles ne sauroient produire une véritable obligation.
L'autorité des lois civiles consiste dans la force que leur donne la puissance de celui, qui, étant revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces lois, & dans les maximes de la droite raison, qui veulent qu'on lui obéisse.
La justice des lois civiles dépend de leur rapport à l'ordre de la société dont elles sont les regles, & de leur convenance avec l'utilité particuliere qui se trouve à les établir, selon que le tems & les lieux le demandent.
La puissance du souverain constitue l'autorité de ces lois, & sa bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injustes.
S'il y en avoit qui renversassent les principes fondamentaux des lois naturelles & des devoirs qu'elles imposent, les sujets seroient en droit & même dans l'obligation de refuser d'obéir à des lois de cette nature.
Il convient absolument que les sujets ayent connoissance des lois du souverain : il doit par conséquent publier ses lois, les bien établir & les notifier. Il est encore absolument essentiel qu'elles soient écrites de la maniere la plus claire, & dans la langue du pays, comme ont été écrites toutes les lois des anciens peuples. Car comment les observeroit-on, si on ne les connoît pas, si on ne les entend pas ? Dans les premiers tems, avant l'invention de l'écriture, elles étoient composées en vers que l'on apprenoit par coeur, & que l'on chantoit pour les bien retenir. Parmi les Athéniens, elles étoient gravées sur des lames de cuivre attachées dans des lieux publics. Chez les Romains, les enfans apprenoient par coeur les lois des douze tables.
Quand les lois civiles sont accompagnées des conditions dont on vient de parler, elles ont sans contredit la force d'obliger les sujets à leur observation, non seulement par la crainte des peines qui sont attachées à leur violation, mais encore par principe de conscience, & en vertu d'une maxime même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au souverain en tout ce qu'on peut faire sans crime.
Personne ne sauroit ignorer l'auteur des lois civiles, qui est établi ou par un consentement exprès des citoyens, ou par un consentement tacite, lorsqu'on se soumet à son empire, de quelque maniere que ce soit.
D'un autre côté, le souverain dans l'établissement des lois civiles, doit donner ses principales attentions à faire ensorte qu'elles ayent les qualités suivantes, qui sont de la plus grande importance au bien public.
1°. D'être justes, équitables, conformes au droit naturel, claires, sans ambiguité & sans contradiction, utiles, nécessaires, accommodées à la nature & au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, à l'état & au génie du peuple pour lequel elles sont faites ; relatives au physique du pays, au climat, au terroir, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs coûtumes.
2°. De nature à pouvoir être observées avec facilité ; dans le plus petit nombre, & le moins multipliées qu'il soit possible ; suffisantes pour terminer les affaires qui se trouvent le plus communément entre les citoyens, expéditives dans les formalités & les procédures de la justice, tempérées par une juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public.
Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas changées sans nécessité ; que le souverain ne doit pas accorder des dispenses pour ses lois, sans les plus fortes raisons ; qu'elles doivent s'entre-aider les unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que le prince doit s'y assujettir lui-même & montrer l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hommes d'Angleterre nomme la merveille & l'ornement de tous les siecles. Ce prince admirable, après avoir dressé pour son peuple un corps de lois civiles, pleines de sagesse & de douceur, pensa, disent les historiens, que ce seroit en vain qu'il tâcheroit d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, si les magistrats, si lui même n'en donnoit le premier l'exemple.
Ce n'est pas assez que les lois civiles des souverains renferment les qualités dont nous venons de parler, si leur style n'y répond.
Les lois civiles demandent essentiellement & nécessairement un style précis & concis : les lois des douze tables en sont un modele. 1°. Un style simple ; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. 2°. Sans subtilités, parce qu'elles ne sont point un art de Logique. 3°. Sans ornemens, ni comparaison tirée de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. 4°. Sans détails d'exceptions, limitations, modifications ; excepté que la nécessité ne l'exige, parce que lorsque la loi présume, elle donne aux juges une regle fixe, & qu'en fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, dont elle évite les jugemens arbitraires. 5°. Sans artifice, parce qu'étant établies pour le bien des hommes, ou pour punir leurs fautes, elles doivent être pleines de candeur. 6°. Sans contrariété avec les lois politiques du même peuple, parce que c'est toujours pour une même société qu'elles sont faites. 7°. Enfin, sans effet rétroactif, à moins qu'elles ne regardent des choses d'elles-mêmes illicites par le droit naturel, comme le dit Cicéron.
Voilà quelles doivent être les lois civiles des états, & c'est dans toutes ces conditions réunies que consiste leur excellence. Les envisager ensuite sous toutes leurs faces, relativement les unes aux autres, de peuples à peuples, dans tous les tems & dans tous les lieux, c'est former en grand, l'esprit des lois, sur lequel nous avons un ouvrage immortel, fait pour éclairer les nations & tracer le plan de la félicité publique. (D.J.)
LOI CLAUDIA, on connoît deux lois de ce nom. L'une surnommée de jure civitatis, c'est-à-dire au sujet du droit de citoyen romain, fut faite par Claudius, consul l'an 577 de Rome, sur les instances des habitans du pays latin, lesquels voyant que ce pays se dépeuploit par le grand nombre de ceux qui passoient à Rome, & que le pays ne pouvoit plus facilement fournir le même nombre de soldats, obtinrent du sénat que le consul Claudius feroit une loi portant que tous ceux qui étoient associés au nom latin, seroient tenus de se rendre chacun dans leur ville avant les calendes de Novembre.
Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patriciens. Cette loi défendoit à tout sénateur, & aux peres des sénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les provisions de leurs maisons des champs ; car du reste on ne vouloit pas qu'ils fissent aucun commerce. Voyez Livius, lib. XXXI. Cicéron, actione in Verrem sept. Cette loi fut dans la suite reprise par César, dans la loi julia de repetundo.
LOI CLODIA. Il y eut diverses lois de ce nom ; savoir,
La loi clodia monetaria, étoit celle en vertu de laquelle on frappa des pieces de monnoie marquées du signe de la victoire, au lieu qu'auparavant elles représentoient seulement un char à deux ou à quatre chevaux. Voyez Pline, lib. XXXIII. cap. ij.
Clodius surnommé pulcher, ennemi de Cicéron, fit aussi pendant son tribunat quatre lois qui furent surnommées de son nom, & qui furent très-préjudiciables à la république.
La premiere surnommée annonaire ou frumentaire, ordonna que le blé qui se distribuoit aux citoyens, moyennant un certain prix, se donneroit à l'avenir gratis. Voyez ci-après LOI FRUMENTAIRE.
La seconde fut pour défendre de consulter les auspices pendant les jours auxquels il étoit permis de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que l'on avoit de s'opposer aux mauvaises lois per obnuntiationem. Voyez ce qui sera dit ci-après de la loi celia fusia.
La troisieme loi fut pour le rétablissement des différens colléges ou corps que Numa avoit institués pour distinguer les personnes de chaque art & métier. La plûpart de ces différens colléges avoient été supprimés sous le consulat de Marius ; mais Clodius les rétablit, & en ajouta même de nouveaux. Toutes ces associations furent depuis défendues, sous le consulat de Lentulus & de Metellus.
La quatrieme loi Clodia, surnommée de censoribus, défendit aux censeurs d'omettre personne lorsqu'ils liroient leurs dénombremens dans le sénat, & de noter personne d'aucune ignominie, à moins qu'il n'eût été accusé devant eux, & condamné par le jugement des deux censeurs ; car auparavant les censeurs se donnoient la liberté de noter publiquement qui bon leur sembloit, même ceux qui n'étoient point accusés ; & quand un des deux censeurs avoit noté quelqu'un, c'étoit la même chose que si tous deux l'avoient condamné, à-moins que l'autre n'intervînt, & n'eût déchargé formellement de la note qui avoit été imprimée par son collegue. Voyez Zazius.
LOI CAECILIA & DIDIA, fut faite par Q. Caecilius Metellus, & T. Didius, consuls l'an de Rome 656. Ce fut à l'occasion de ce que les tribuns du peuple & autres auxquels il étoit permis de proposer des lois, engloboient plusieurs objets dans une même demande, & souvent y mêloient des choses injustes, d'où il arrivoit que le peuple qui étoit frappé principalement de ce qu'il y avoit de juste, ordonnoit également ce qu'il y avoit d'injuste compris dans la demande ; c'est pourquoi par cette loi il fut ordonné que chaque réglement seroit proposé séparément, & en outre que la demande en seroit faite pendant trois jours de marché, afin que rien ne fût adopté par précipitation ni par surprise. Cicéron en parle dans la cinquieme Philippique, & en plusieurs autres endroits. Voyez aussi Zazius.
LOI CAECILIA REPETUNDARUM, fut une des lois qui furent faites pour réprimer le crime de concussion. L. Lentulus, homme consulaire, fut poursuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu'elle fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Voyez LOI CALPHURNIA, ZIUSZIUS.
LOI COELIA, étoit une des lois tabellaires qui fut faite par Caelius pour abolir entierement l'usage de donner les suffrages de vive-voix. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES.
LOI COMMISSOIRE, ou PACTE DE LA LOI COMMISSOIRE, est une convention qui se fait entre le vendeur & l'acheteur, que si le prix de la chose vendue n'est pas payé en entier dans un certain tems, la vente sera nulle s'il plaît au vendeur.
Ce pacte est appellé loi, parce que les conventions sont les lois des contrats ; on l'appelle commissoire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la chose est rendue au vendeur, res venditori committitur ; le vendeur rentre dans la propriété de sa chose, comme si elle n'avoit point été vendue. Il peut même en répéter les fruits, à moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas l'acheteur peut retenir les fruits pour se récompenser de la perte de ses arrhes, ou de la portion qu'il a payée du prix.
La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer ; car le contrat l'avertit suffisamment, dies interpellat pro homine.
La peine de la loi commissoire n'a pas lieu lorsque dans le tems convenu l'acheteur a offert le prix au vendeur, & qu'il l'a consigné ; autrement les offres pourroient être réputées illusoires. Elle n'a pas lieu non plus lorsque le payement du prix, ou de partie d'icelui, a été retardé pour quelque cause légitime.
Quand on n'auroit pas apposé dans le contrat de vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours au pouvoir du vendeur de poursuivre l'acheteur, pour le payement du prix convenu, & à faute de ce il peut faire déclarer la vente nulle, & rentrer dans le bien par lui vendu ; mais avec cette différence, que dans ce cas l'acheteur en payant même après le tems convenu, demeure propriétaire de la chose à lui vendue ; au lieu que quand le pacte de la loi commissoire a été apposé dans le contrat, & que l'acheteur n'a pas payé dans le tems convenu, le vendeur peut faire résoudre la vente, quand même l'acheteur offriroit alors de payer.
Mais soit qu'il y ait pacte ou non, il faut toûjours un jugement pour résoudre la vente, sans quoi le vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en possession de la chose vendue. Voyez au digeste le titre de lege commissoriâ.
Le pacte de la loi commissoire n'a pas lieu en fait de prêt sur gage, c'est-à-dire que l'on ne peut pas stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, la chose engagée sera acquise au créancier ; un tel pacte est réputé usuraire, à moins que le créancier n'achetât le gage pour son juste prix. Voyez la loi 16. §. ult. ff. de pign. & hyppot. & la loi derniere au code de pactis pignorum.
LOIS CONSULAIRES étoient celles qui étoient faites par les consuls, comme les lois tribunitiennes étoient faites par les tribuns.
LOI CORNELIA ; il y a eu plusieurs lois de ce nom, savoir :
La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partoit pour une guerre périlleuse, d'accorder le droit de cité à ceux qui auroient bien mérité de la république ; elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, & par Cn. Cornelius Lentulus.
La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur Sylla, pour adjuger & partager aux soldats beaucoup de terres, & sur-tout en Toscane : les soldats rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur possession, soit en s'emparant des terres qu'ils trouvoient à leur bienséance. Cicéron en parle dans une de ses oraisons.
La loi cornelia de falso ou de falsis, fut faite par Cornelius Sylla, à l'occasion des testamens ; c'est pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire ; elle confirmoit les testamens de ceux qui sont en la puissance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les faussetés & altérations qui pouvoient être faites dans un testament ; elle statuoit aussi sur les faussetés des autres écritures, des monnoies, des poids & mesures.
La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, concernoit ceux qui se plaignoient d'avoir reçu quelque injure, comme d'avoir été poussés, battus, ou leur maison forcée. Cette loi excluoit tous les proches parens & alliés du plaignant, d'être juges de l'action.
La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla rendit tous les jugemens au senat, & retrancha les chevaliers du nombre des juges ; il abrogea les lois Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque chose dans la sienne ; elle ordonnoit encore que l'on ne pourroit pas récuser plus de trois juges.
La loi cornelia majestatis fut faite par Sylla, pour régler le jugement du crime de leze-majesté. Voyez LOI JULIA.
La loi cornelia de parricidio, qui étoit du même Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée dont elle prit le nom. Voyez LOI POMPEIA.
La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron dans sa troisieme Verrine, fut faite par Valerius Flaccus ; elle est nommée ailleurs loi Valeria ; elle donnoit à Sylla droit de vie & de mort sur les citoyens.
La loi cornelia repetundarum, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats qui gouvernoient les provinces. Voyez Cicéron, épitre à Appius.
La loi cornelia de sicariis & veneficis, fut aussi faite par Sylla ; elle concernoit ceux qui avoient tué quelqu'un, ou qui l'avoient attendu dans ce dessein, ou qui avoient préparé, gardé, ou vendu du poison, ceux qui par un faux témoignage avoient fait condamner quelqu'un publiquement, les magistrats qui recevoient de l'argent pour quelque affaire capitale, ceux qui par volupté ou pour un commerce infame auroient fait des eunuques.
La loi cornelia sumptuaria fut encore une loi de Sylla, par laquelle il régla la dépense que l'on pourroit faire les jours ordinaires, & celle que l'on pourroit faire les jours solemnels qui étoient ceux des calendes, des ides, des nones, & des jeux ; il diminua aussi par cette loi le prix des denrées.
Le tribun Cornelius fit aussi deux lois qui porterent son nom, l'une appellée
Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendoit d'accorder aucune grace ou privilege contre les lois, qu'il n'y eût au-moins 200 personnes dans le senat ; & à celui qui auroit obtenu quelque grace, d'être présent lorsque l'affaire seroit portée devant le peuple.
La loi cornelia de jure dicendo, du même tribun, ordonna que les préteurs seroient tenus de juger suivant l'édit perpétuel, au lieu qu'auparavant leurs jugemens étoient arbitraires. Il y avoit encore une autre loi surnommée Cornelia, savoir,
La loi Cornelia & Titia, suivant laquelle on pouvoit faire des conventions ou gageures pour les jeux où l'adresse & le courage ont part. Le jurisconsulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes lois voyez Zazius.
LOI DE CREDENCE, c'est ainsi que l'on appelloit anciennement les enquêtes, lorsque les témoins déposoient seulement qu'ils croyoient tel & tel fait, à la différence du témoignage positif & certain, où le témoin dit qu'il a vu ou qu'il sait telle chose ; il en est parlé au style du pays de Normandie. François I. par son ordonnance de 1539, article 36, ordonna qu'il n'y auroit plus de réponses par crédit, &c. (A)
LOI CRIMINELLE, (Droit civil ancien & mod.) loi qui statue les peines des divers crimes & délits dans la société civile.
Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liberté, on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Aristote nous dit qu'à Cumes les parens pouvoient être témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d'Ancus Martius, accusés d'avoir assassiné le roi son beau-pere. Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi en 560, pour qu'un accusé ne pût être condamné sans être oui, ce qui prouve qu'il régnoit une pratique contraire dans quelques cas particuliers. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages : quand l'innocence des citoyens n'est pas assûrée, la liberté des citoyens ne l'est pas non plus.
Les connoissances que l'on a acquises dans plusieurs pays, & que l'on acquerra dans d'autres, sur les regles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde ; car c'est sur la pratique de ces connoissances que sont fondés l'honneur, la sûreté, & la liberté des hommes.
Ainsi la loi de mort contre un assassin est très-juste, parce que cette loi qui le condamne à périr, a été faite en sa faveur ; elle lui a conservé la vie à tous les instans, il ne peut donc pas reclamer contr'elle.
Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce caractere de justice. Il n'y en a que trop qui révoltent l'humanité, & trop d'autres qui sont contraires à la raison, à l'équité, & au but qu'on doit se proposer dans la sanction des lois.
La loi d'Henri II. qui condamnoit à mort une fille dont l'enfant avoit péri, au cas qu'elle n'eût point déclaré sa grossesse au magistrat, blessoit la nature. Ne suffisoit-il pas d'obliger cette fille d'instruire de son état une amie, une proche parente, qui veillât à la conservation de l'enfant ? Quel aveu pourroit-elle faire au fort du supplice de sa pudeur ? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur, & à peine dans ces momens reste-t-il dans son ame une idée de la perte de la vie.
La loi qui prescrit dans plusieurs états, sous peine de mort, de revéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, est bien dure, du-moins ne doit-elle être appliquée dans les états monarchiques, qu'au seul crime de lese majesté au premier chef, parce qu'il est très-important de ne pas confondre les différens chefs de ce crime.
Nos lois ont puni de la peine du feu la magie, l'hérésie, & le crime contre nature, trois crimes dont on pourroit prouver du premier qu'il n'existe pas ; du second, qu'il est susceptible d'une infinité de distinctions, interpretations, limitations ; & du troisieme, qu'il est dangereux d'en répandre la connoissance ; & qu'il convient mieux de le proscrire sévérement par une police exacte, comme une infame violation des moeurs.
Mais sans perdre de tems à rassembler des exemples puisés dans les erreurs des hommes, nous avons un principe lumineux pour juger des lois criminelles de chaque peuple. Leur bonté consiste à tirer chaque peine de la nature particuliere du crime, & leur vice à s'en écarter plus ou moins. C'est d'après ce principe que l'auteur de l'esprit des lois a fait lui-même un code criminel : je le nomme code Montesquieu, & je le trouve trop beau, pour ne pas le transcrire ici, puisque d'ailleurs sa briéveté me le permet.
Il y a, dit-il, quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece, choquent la religion ; ceux de la seconde, les moeurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.
Il ne faut mettre dans la classe des crimes qui intéressent la Religion, que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples ; car les crimes qui en troublent l'exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à ces classes.
Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la Religion ; telles sont l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.
Dans les choses qui troublent la tranquillité, ou la sûreté de l'état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matiere de crime ; tout s'y passe entre l'homme & Dieu, qui sait la mesure & le tems de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire, il détruit la liberté des citoyens, en armant contr'eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité ; mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. Si l'on se conduisoit par cette derniere idée, quelle seroit la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, & non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.
La seconde classe des crimes, est de ceux qui sont contre les moeurs ; telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c'est-à-dire de la police, sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens, & à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des moeurs, les amendes, la honte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville & de la société, enfin, toutes les peines qui sont de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour reprimer la témérité des deux sexes. En effet ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l'oubli ou le mépris de soi-même.
Il n'est ici question que de crimes qui intéressent uniquement les moeurs ; non de ceux qui choquent aussi la sureté publique, tels que l'enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espece.
Les crimes de la troisieme classe, sont ceux qui choquent la tranquillité. Les peines doivent donc se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l'ordre établi.
Il faut restreindre les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même tems la sûreté, doivent être mises dans la quatrieme classe.
Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté, au point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade.
Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale ; mais il vaudroit peut-être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens, fût punie par la perte des biens ; & cela devroit être ainsi si les fortunes étoient communes ou égales ; mais comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays qu'il le falloit.
S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme pour un crime, lorsqu'il ne s'est pas exposé à la perdre par son attentat, il y auroit de la cruauté à punir de mort le projet d'un crime ; mais il est de la clémence d'en prévenir la consommation, & c'est ce qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un crime consommé. (D.J.)
LOI DE DESRENNE, étoit une maniere de procéder usitée dans l'ancienne coutume de Normandie, pour les matieres qui se terminent par desrenne ou simple loi ; elle y fut abolie. Desfontaines en fait mention chap. xxxiv. n. 2. Voyez DESRENNE, I SIMPLEMPLE. (A)
LOI DIOCESAINE, (Hist. ecclés.) taxe que les évêques imposoient anciennement sur les ecclésiastiques de leur diocèse pour leurs visites ; c'étoit une espece de droit qui n'entroit point dans la jurisdiction spirituelle ou temporelle des évêques, mais émanoit de leur siege & de leur caractere, en les autorisant d'exiger des curés & des monasteres, une aide pour soutenir les dépenses qu'ils étoient obligés de faire en visitant leurs diocèses.
Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques procuratio ; mais il est appellé dispensa, la dépense de l'évêque dans les capitulaires de Charles le chauve ; procuratio paroit le véritable nom qu'on doit lui donner ; car procurare aliquem, signifie traiter bien quelqu'un, lui faire bonne chere : Virgile dit dans l'Enéïde, lib. IX.
Quod superest laeti benè gestis corpora rebus
Procurate, viri.
Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoiqu'ils y soient autorisés par plusieurs conciles, lesquels leur recommandent en même tems la modération, & leur défendent les exécutions. En effet la plûpart des évêques sont si fort à leur aise, & leurs curés si pauvres, qu'il est plus que juste qu'ils visitent leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourroit être répété que sur les riches monasteres qui sont sujets à la visite : les décimateurs en ont toujours été exemts. Voyez Hautessere, l. IV. c. iv. de ses dissertations canoniques. (D.J.)
LOI DOMITIA, étoit la même que la loi Licinia, qui régloit que les prêtres ne seroient plus choisis par les colleges, mais par le peuple. Le préteur Laelius ayant fait abroger cette loi, elle fut remise en vigueur par Domitius Oenobarbus tribun du peuple, d'où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta seulement un tempérament à la loi Licinia, en ce qu'il ordonna que l'on appelleroit le peuple en moindre nombre, & que celui qui seroit ainsi proposé seroit confirmé par le college des prêtres. Ce qui donna lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia, fut le ressentiment qu'il eut de ce que les prêtres ne l'avoient point admis au sacerdoce en la place de son pere. Voyez Suétone in Nerone, Cicéron pro Rullo, & dans ses épitres à Brutus. (A)
LOI DIDIA, étoit une des lois somptuaires des Romains ; elle fut ainsi nommée de Didius tribun du peuple. C'étoit une extension de la loi Orchia & Fannia, qui régloit la dépense des repas. Elle ordonna que ceux qui invitoient & ceux qui seroient invités, encouroient également la peine portée par la loi, en cas de contravention. Voyez ci-après LOI FANNIA, LOI ORCHIA, LOIS SOMPTUAIRES, & le catalogue de Zazius. (A)
LOI DIVINE, (Droit divin) Les lois divines sont celles de la Religion, qui rappellent sans cesse l'homme à Dieu, qu'il auroit oublié à chaque instant.
Elles tirent leur force principale de la croyance qu'on donne à la religion. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint : les lois humaines sont variables, les lois divines sont invariables. Les lois humaines statuent sur le bien, celles de la Religion sur le meilleur.
Il ne faut donc point toujours statuer par les lois divines, ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par les lois divines.
Les choses qui doivent être réglées par les lois humaines, peuvent rarement l'être par les principes des lois de la Religion ; ces dernieres ont plus de sublimité, & les lois humaines plus d'étendue. Les lois de perfection tirées de la Religion, ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées. Les lois humaines au contraire ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui naissent immédiatement de la Religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.
Il ne faut point non plus opposer les lois religieuses à celles de la loi naturelle, au sujet, par exemple, de la défense de soi-même, & de la prolongation de sa vie, parce que les lois de la Religion n'ont point abrogé les préceptes des lois naturelles.
Grotius admettoit un droit divin, positif, universel ; mais la peine de prouver la plûpart des articles qu'on rapporte à ce prétendu droit universel, forme d'abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. S'il y a quelque loi divine qu'on puisse appeller positive, & en même tems universelle, dit M. Barbeyrac, elle doit 1°. être utile à tous les hommes, dans tous les tems & dans tous les lieux ; car Dieu étant très-sage & très-bon, ne sauroit prescrire aucune loi qui ne soit avantageuse à ceux-là même auxquels on l'impose. Or une loi convenable aux intérêts de tous les hommes, en tous tems & en tous lieux, vû la différence infinie de ce que demande le climat, le génie, les moeurs, la situation, & cent autres circonstances particulieres ; une telle loi, dis-je, ne peut être conçue que conforme à la constitution de la nature humaine en général, & par conséquent c'est une loi naturelle.
En second lieu, s'il y avoit une telle loi, comme elle ne pourroit être découverte que par les lumieres de la raison, il faudroit qu'elle fût bien clairement revélée à tous les peuples. Or, un grand nombre de peuples n'ont encore eu aucune connoissance de la revélation. Si l'on replique que les lois dont il s'agit, n'obligent que ceux à la connoissance desquels elles sont parvenues, on détruit par-là l'idée d'universalité, sans nous apprendre pourquoi elles ne sont pas publiées à tous les peuples, puisqu'elles sont faites pour tous. Aussi M. Thomasius qui avoit d'abord admis ce système de lois divines, positives & universelles, a reconnu depuis qu'il s'étoit trompé, & a lui-même renversé son édifice, le trouvant bâti sur de trop foibles fondemens. (D.J.)
LOI DOREE, lex aurea : on a donné ce surnom à une disposition de la novelle 149 de Justinien, chap. cxliij. où cet empereur veut que le salut du peuple soit la premiere loi, salus populi suprema lex esto.
LOI DUELLIA ; il y en eut deux de ce nom : l'une appellée aussi duellia-moenia, fut la premiere loi que l'on fit pour réprimer les usures excessives. Cette loi fut ainsi nommée de M. Duellio, d'autres disent Duellius, & de Menenius ou Maenius tribuns du peuple, qui en furent les auteurs ; elle défendoit d'exiger plus d'une once ou douzieme partie de la somme à titre d'usure, c'est-à-dire un pour cent ; cela arriva l'an 398 de Rome. Voyez Tite Live, lib. VII.
L'autre loi appellée aussi duellia, fut faite l'an 306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle ordonnoit que celui qui laisseroit le peuple sans tribuns, ou qui créeroit des magistrats sans convoquer le peuple, seroit frappé de verges & décapité. Voyez Denys d'Halicarnasse, lib. XIII.
LOI EBUTIA, ou AEBUTIA ci-devant, voyez ci-après LOI LICINIA & EBUTIA.
LOI ECCLESIASTIQUE, en général est toute loi qui concerne l'Eglise ou ses ministres, & les matieres qui ont rapport à l'Eglise, telles que les bénéfices, les dixmes.
Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on entend spécialement celles qui sont faites par les prélats ; elles sont générales pour toute l'Eglise, ou particulieres à une nation, à une province, ou à un seul diocèse, suivant le pouvoir de ceux dont elles sont émanées.
Quiconque veut voir les lois ecclésiastiques digérées dans un ordre méthodique, doit consulter l'excellent ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre les lois ecclésiastiques.
LOIS ECHEVINALES, c'est la jurisdiction des échevins de certaines villes des Pays-Bas : le magistrat est pris en cette occasion pour la loi même, quia magistratus est lex loquens, la loi vivante. Il est parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutumes de Hainaut, chap. iij. Mons, chap. xxxvij. xxxviij. & xlix. Valenciennes, article 160.
LOI ECRITE ; on entend quelquefois par ce terme la loi de Moïse, & aussi le tems qui s'est écoulé depuis ce prophete jusqu'à Jesus-Christ, pour le distinguer du tems qui a précédé, qu'on appelle le tems de la loi de nature, où les hommes n'avoient pour se gouverner que la raison naturelle & les traditions de leurs ancêtres. Voyez LOI DE MOÏSE.
En France, dans les commencemens de la troisieme race, on entendoit par loi écrite, le Droit romain, qui étoit ainsi appellé par opposition aux coutumes qui commencerent alors à se former, & qui n'étoient point encore rédigées par écrit. Voyez DROIT ECRIT, DROIT ROMAIN.
LOI DE L'EGLISE, est une regle reçûe par toute l'Eglise, telles que sont les regles de foi. Il y a des lois qui ne concernent que la discipline, & qui peuvent être reçûes dans une église, & ne l'être pas dans une autre.
LOI D'EMENDE, dans les anciennes coutumes, signifie un reglement qui prononce quelque amende. On entend aussi quelquefois par-là l'amende même qui est prononcée par la coutume. Voyez la coutume d'Anjou, article 146. 150. & 250. celle du Maine, article 161. 163. 182. & 458.
LOI DE L'ETAT, est toute regle qui est reçûe dans l'état, & qui y a force de loi, soit qu'elle ait rapport au gouvernement général, ou au droit des particuliers.
Quelquefois par la loi de l'état, on entend seulement une regle que l'on suit dans le gouvernement politique de l'état. En France, par exemple, on appelle lois de l'état, celles qui excluent les femelles de la couronne, & qui empêchent le partage du royaume ; celle qui déclare les rois majeurs à 14 ans, & qui rend les apanages réversibles à la couronne à défaut d'hoirs mâles, & ainsi des autres. Quelques-unes de ces regles sont écrites dans les ordonnances de nos rois ; d'autres ne sont fondées que sur d'anciens usages non écrits qui ont acquis force de loi.
On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui touche sa constitution, comme en France l'exclusion des femelles, &c.
LOI FABIA, fut faite par Fabius, pour restreindre le nombre des sectateurs. On appelloit ainsi ceux qui accompagnoient les candidats : le peuple se mit peu en peine de faire observer cette loi. Voyez Cicéron, pro Murena.
LOI FALCIDIA, défendit de léguer plus des trois quarts de son bien. Voyez QUARTE FALCIDIE.
LOI FANNIA, ainsi nommée de Fannius. Strabon qui fut consul onze ans avant la troisieme guerre punique, la croit la seconde loi somptuaire qui fut faite à Rome ; elle fixa la dépense qu'il seroit permis de faire ; elle défendit de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, & plus de cinq les jours des nones ou des foires ; la dépense fut fixée à cent sols chaque repas les jours des jeux & des fêtes publiques, 30 sols les jours des nones ou des foires, & 10 sols les autres jours ; les légumes & les herbes n'y étoient point comprises ; & pour maintenir cette frugalité, la même loi défendit de servir dans un repas d'autre volaille qu'une poule non engraissée. Voyez Zazius, le traité de police, titre des festins, page 461. & ci-après LOIS SOMPTUAIRES.
LOI FAVIA, que d'autres appellent aussi Fabia, d'autres Flavia, & dont l'auteur est incertain, fut faite contre les plagiaires : elle ordonnoit que celui ou ceux qui auroient celé un homme ingénu, c'est-à-dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui l'auroit tenu dans les liens, ou l'auroit acheté sciemment & de mauvaise foi ; ceux qui auroient persuadé à l'esclave d'autrui de se sauver, ou qui l'auroient celé, l'auroient tenu dans les fers, ou l'auroient acheté sciemment ; enfin, ceux qui seroient complices de ces diverses sortes de plagiat, seroient punis suivant la loi : cette peine n'étoit d'abord que pécuniaire ; dans la suite, on prononça des peines afflictives ; même la peine de mort, ou la condamnation aux mines. Voyez Cicéron, pro Rabirio.
LOI FLAVIA ; c'est ainsi que quelques-uns nomment la loi précédente : il y eut aussi une autre loi Flavia, du nombre des lois agraires, qui fut faite par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle n'avoit rien de populaire que son auteur. Voyez LOIS AGRAIRES. (A)
LOI FONDAMENTALE, (Droit politique) toute loi primordiale de la constitution d'un gouvernement.
Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute leur étendue, sont non-seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation détermine quelle doit être la forme du gouvernement, & comment on succédera à la couronne ; mais encore ce sont des conventions entre le peuple, & celui ou ceux à qui il défere la souveraineté ; lesquelles conventions reglent la maniere dont on doit gouverner, & prescrivent des bornes à l'autorité souveraine.
Ces reglemens sont appellés lois fondamentales, parce qu'ils sont la base & le fondement de l'état, sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, & que les peuples les considerent comme ce qui en fait toute la force & la sûreté.
Ce n'est pourtant que d'une maniere, pour ainsi dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois ; car, à proprement parler, ce sont de véritables conventions ; mais ces conventions étant obligatoires entre les parties contractantes, elles ont la force des lois mêmes.
Toutefois pour en assurer le succès dans une monarchie limitée, le corps entier de la nation peut se réserver le pouvoir législatif, la nomination de ses magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, & donner au monarque entr'autres prérogatives, le pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement est fondé sur ce pié-là par l'acte primordial d'association, cet acte primordial porte le nom de lois fondamentales de l'état, parce qu'elles en constituent la sûreté & la liberté. Au reste, de telles lois ne rendent point la souveraineté imparfaite ; mais au contraire elles la perfectionnent, & réduisent le souverain à la nécessité de bien faire, en le mettant pour ainsi dire dans l'impuissance de faillir.
Ajoutons encore, qu'il y a une espece de lois fondamentales de droit & de nécessité, essentielles à tous les gouvernemens, même dans les états où la souveraineté est, pour ainsi dire absolue ; & cette loi est celle du bien public, dont le souverain ne peut s'écarter sans manquer plus ou moins à son devoir. (D.J.)
LOIS FORESTIERES, sont les reglemens qui concernent la police des eaux & forêts. M. Becquet grand maître des eaux & forêts au département de Berry, a donné au public en 1753 les lois forestieres, en deux vol. in-4 °. C'est un commentaire historique & raisonné sur l'ordonnance des eaux & forêts, & sur les réglemens qui ont précédé & suivi.
Il y a en Angleterre les lois forestieres, concernant la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois. Il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edouard III. & le recueil appellé charta de forestâ. Voyez EAUX & FORETS, MAITRES DES EAUX & FORETS.
LOI DES FRANCS, lex Francorum, seu Francica, appellée plus communément loi salique. Voyez ci-après LOI SALIQUE.
LOI DES FRISONS, est une des lois apportées dans les Gaules par les peuples du Nord, & qui se trouve dans le code des lois antiques. (A)
LOIS FRUMENTAIRES, chez les Romains, étoient des lois faites pour régler la distribution du blé que l'on faisoit d'abord aux troupes & aux officiers du palais, & enfin que l'on étendit aussi aux citoyens, & même à tout le peuple. Chaque chef de famille recevoit tous les mois une certaine quantité de froment des greniers publics. Cet usage, à l'égard du peuple, fut établi par le moyen des largesses que les grands de Rome faisoient au menu peuple pour gagner ses bonnes graces ; ils lui faisoient délivrer du blé, d'abord c'étoit seulement à bas prix, ensuite ce fut tout-à-fait gratuitement. On fit diverses lois à ce sujet ; savoir, les lois Sempronia, Livia, Terentia, Cassia, Clodia & Roscia, qui furent appellées d'un nom commun, lois frumentaires ; elles sont expliquées par Lipse, cap. viij. electorum ; & par Rosinus, antiquit. roman. lib. VIII. cap. xij. Ces distributions continuerent sous les empereurs, & se pratiquoient encore du tems de Justinien. Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. j. n°. 59. & suiv.
LOI FURIA, fut faite par Furius, tribun du peuple. Elle défendoit à tout testateur de léguer à quelqu'un plus de mille écus, à peine de restitution du quadruple, pour empêcher que les héritiers institués n'abdicassent l'hérédité, qui se trouvoit épuisée par des legs excessifs. Voyez Théophile, dans ses institutions grecques, & Cicéron, pro Cornelio Balbo.
LOI FUSIA CANINIA, fut faite pour limiter le pouvoir d'affranchir ses esclaves par testament ; d'un côté, elle régla le nombre des esclaves que l'on pourroit ainsi affranchir, savoir que celui qui en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux ; que celui qui en auroit trois, n'en pourroit affranchir que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis 10 jusqu'à 30 le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart, depuis 100 jusqu'à 500 la cinquieme partie, & que l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre que 100. Cette même loi ordonnoit que les esclaves ne pourroient être affranchis par le testament qu'en les appellant par leur nom-propre. Dans la suite, le jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir aussi en les désignant par le nom de leur emploi.
Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux institutes.
LOI GABINIA, il y en eut trois de ce nom.
La premiere fut une des lois tabellaires. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES.
La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls, dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la vie de Pompée.
La troisieme loi de ce nom fut faite par le même Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les receveurs publics commettoient dans les provinces. Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, & Zazius.
LOI GELLIA, voyez ci-devant LOI CORNELIA, à l'article premier.
LOI GENERALE est celle qui est observée dans tous les pays d'une même domination, ou du moins dans toute une province. Telles sont les lois romaines, les ordonnances, édits & déclarations, les coûtumes générales de chaque province, à la différence des lois particulieres, telles que sont les coûtumes locales & statuts particuliers de certaines villes, cantons ou communautés.
LOI GENUTIA, fut un plébiscite proposé par Genutius, tribun du peuple, par lequel les intérêts furent entiérement proscrits, comme nous l'apprenons de Tite-Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu à Rome, mais il n'étoit pas d'abord observé chez les autres peuples du pays latin, desorte qu'un Romain qui avoit prêté de l'argent à un de ses concitoyens, transportoit sa dette à un latin, parce que celui-ci pouvoit en exiger l'intérêt ; & comme, par ce moyen, la loi étoit éludée, le tribun Sempronius fit une loi, appellée sempronia, portant que les Latins & autres alliés du peuple romain seroient sujets à la loi genutia.
LOI GLAUCIA fut faite par C. Servilius Glaucia, pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pouvoir de juger avec le sénat, qui lui avoit été ôté. Voyez Cicéron, in Bruto, & ci-après, LOIS JUDICIAIRES.
LOI GLICIA, ainsi nommée, parce qu'elle fut faite, à ce que l'on croit, par quelqu'un de la famille Glicia, qui étoit une des plus célebres de la ville de Rome. Tacite, Suétone, Florus & Tite-Live ont parlé de cette famille, & les marbres capitolins en ont conservé la mémoire : ce fut cette loi qui introduisit la querelle ou plainte d'inofficiosité en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhérédés par le testament de leur pere ; nous devons à Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom ; mais les auteurs les plus accrédités attribuent, comme Cujas, à cette loi l'origine de la querelle d'inofficiosité ; & la preuve que cette loi a existé, se trouve encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de inoffic. testam. lequel nous apprend que le jurisconsulte Caïus avoit fait un traité sous le titre de liber singularis ad legem Gliciam. Voyez l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson, p. 125.
LOI GOMBETTE ou LOI DES BOURGUIGNONS, lex Gundebada seu Burgundionum, étoit la loi des peuples du royaume de Bourgogne ; elle fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de son regne, c'est-à-dire en 501 ; c'est du nom de ce roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées gombettes, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur. Il le reconnoît lui-même, & Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher de maltraiter les Romains : elle porte les souscriptions de trente comtes, qui promettent de l'observer, eux & leurs descendans. Il y a quelques additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est-à-dire dix ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons ; elle fait mention de la loi romaine, & l'on y voit clairement que le nom barbare n'étoit point une injure, puisque les Bourguignons même, pour qui elle est faite, y sont nommés barbares pour les distinguer des Romains. Comme ce qui obéissoit aux Bourguignons forme environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du Droit françois. Elle se trouve dans le code des lois antiques sous ce titre : Liber constitutionum de praeteritis & praesentibus atque in perpetuo conservandis, editus sub die 4 kal. April. Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards, dans les capitulaires & dans plusieurs auteurs. Ce qui nous reste de cette loi, fait connoître que les Bourguignons en avoient plusieurs autres ; ainsi que l'observe M. le président Bouhier sur la coûtume de Bourgogne chap. ix. §. 14. Cette loi défere le duel à ceux qui ne voudroient pas s'en tenir au serment ; c'étoit une coûtume barbare venue du nord, & qui étoit usitée alors chez tous les nouveaux peuples qui s'étoient établis dans les Gaules. (A)
LOI GOTHIQUE ou LOI DES VISIGOTHS, est celle qui fut faite pour les Visigoths, qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine. Comme ce royaume fut le premier qui s'établit sur les ruines de l'empire romain, ses lois paroissent aussi avoir été écrites les premieres : elles furent d'abord rédigées sous Evarix, qui commença à regner en 466 ; & comme elles n'étoient que pour les Goths, son fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé du code théodosien. Voyez LOI ROMAINE.
La loi gothique fut corrigée & augmentée par le roi Leuvigild, & ensuite Chindaswind & Receswind lui donnerent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil seroit l'unique loi de tous ceux qui étoient sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, desorte que l'on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt on la mêla avec la gothique ; car ce fut de la loi romaine (c'est ainsi qu'on appelloit un abrégé du code théodosien fait par ordre d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique fut divisé en douze livres, & s'appelloit le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu'en 701, fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par le concile de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d'Evarix ; peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c'est la plus belle & la plus ample de toutes les lois des Barbares, & l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observoit du tems de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espagne, & elle se conserva dans le Languedoc longtems après que les Goths eurent cessé d'y dominer, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. chap. j.
LOI DE GRACE ou LOI CHRETIENNE, LOI EVANGELIQUE, est celle qui nous a été apportée par Jesus-Christ. Voyez EVANGILE.
LOI DE GRANDS SIX SOLS, c'est l'amende de quatre francs bordelois, & au-dessus.
Loi de petits six sols, c'est l'amende qui est au dessous des quatre francs ; il en est parlé dans la coûtume de la Boust, tit. VI. art. 6.
Loi de sept sols six deniers, c'est aussi une amende, coûtume de Lodunois, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.
LOIS DES GRACQUES, c'étoient les lois agraires, & autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems de Tiberius & Caïus Gracchus freres, qui furent tous deux successivement tribuns du peuple. Pour savoir quel fut le sort de ces lois des Gracques, voyez ce qui est dit ci-devant à l'article LOIS AGRAIRES, en parlant de la loi licinia, dont les Gracques s'efforcerent de procurer l'exécution.
LOIS DE LA GUERRE, jus belli, ce sont certaines maximes du droit des gens, que toutes les nations conviennent d'observer même en se faisant la guerre, comme la suspension des hostilités, pour enterrer les morts ; la sûreté que l'on donne à ceux qui viennent pour porter quelque parole, de ne point empoisonner les armes, ni les eaux, &c. Voyez DROIT DE LA GUERRE, voyez Grotius, de jure belli & pacis.
LOI habeas corpus, est un usage observé en Angleterre, suivant lequel un accusé est élargi en donnant caution de se représenter lorsqu'il ne s'agit point de vol, homicide ni trahison.
LOI HIERONICA fut donnée aux Siciliens par le tyran Hiéron ; elle régloit la maniere de payer les dîmes au receveur public, la quantité de froment, le prix, & le tems du payement. Les choses étoient réglées de maniere que le laboureur ne pouvoit frauder le receveur public, ni le receveur exiger du laboureur plus du dixieme ; le rôle des laboureurs devoit être souscrit tous les ans par le magistrat. Cette loi parut si équitable aux Romains, lorsqu'ils se rendirent maîtres de la Sicile, qu'ils laisserent les choses sur le même pié. Voyez Zazius.
LOI HIRCIA fut faite par Hirtius, ami de César, pour exclure de la magistrature tous ceux qui avoient suivi le parti de Pompée. Voyez la 13. Philippique de Cicéron.
LOI HORATIA fut l'ouvrage de M. Horatius, surnommé Barbatus, lequel voulut signaler son consulat par la publication de cette loi ; elle ordonnoit que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonneroit, auroit la même force que si les patriciens & le sénat l'eussent décidé dans une assemblée générale. Cette loi fut dans la suite renouvellée par plusieurs autres, qui furent de-là surnommées lois horatiennes. Voyez Zazius, & l'hist. de la jurisprud. rom. de M. Terrasson, p. 207.
LOI HORTENSIA fut faite par Qu. Hortensius, dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome ; elle portoit que les plébiscites obligeroient tout le monde de même que les autres lois. Voyez les institutes de Justinien, tit. de jure nat.
LOI HOSTILIA permit d'intenter l'action pour vol au nom de ceux qui étoient prisonniers chez les ennemis, apud hostes, d'où elle prit son nom. Elle ordonna la même chose à l'égard de ceux qui étoient absens pour le service de l'état, ou qui étoient sous la tutele de quelque personne semblable. Voyez aux instit. le titre per quos agere possumus. (A)
LOI HUMAINE, (Jurisprud.) les lois humaines sont toutes celles que les hommes font en divers tems, lieux & gouvernemens. Leur nature est d'être soumises à tous les accidens qui arrivent, & de varier à mesure que les volontés des hommes changent, au lieu que les lois naturelles sont invariables. Il y a même des états où les lois humaines ne sont qu'une volonté capricieuse & transitoire du souverain. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint ; mais elles tirent un grand avantage de leur justice, & de l'attention particuliere & actuelle du législateur à les faire observer.
Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d'un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives ; car, quoiqu'il y ait des lois naturelles qui font la matiere des lois humaines, ce n'est point du législateur humain qu'elles tirent leur force obligatoire, elles obligeroient également sans son intervention, puisqu'elles émanent du souverain maître de la nature.
Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matiere des lois humaines. La religion parle du meilleur & du parfait, mais la perfection ne regardant pas l'universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels. Le célibat étoit un conseil du christianisme pour quelques êtres privilégiés. Lorsqu'on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles pour réduire les hommes qu'on vouloit forcer à l'observation de celle-ci. Le législateur demandoit plus que ce que la nature humaine comportoit, il se fatigua, il fatigua la société pour faire exécuter à tous les hommes par précepte, par jussion, ce que plusieurs d'entr'eux auroient exécuté comme un conseil de perfection. (D.J.)
LOI ICILIA fut faite par L. Icilius, tribun du peuple, cinq années avant la création des décemvirs ; c'étoit une des lois qu'on appella sacrées ; elle comprenoit tous les droits du peuple & ceux des tribuns, peut-être fut-elle surnommée sacrée, parce qu'elle fut faite sur le mont Aventin, qui étoit un mont sacré, sur lequel le peuple s'étoit retiré par mécontentement contre les grands ; & il se peut faire que par imitation, on appelle aussi sacrées les autres lois du même genre ; cependant voyez ce qui est dit au mot LOIS SACREES. Tite-Live, lib. III. fait mention de cette loi.
LOI IMMUABLE, est celle qui ne peut être changée, telles sont celles qui dérivent du droit naturel & du droit divin, & des regles de la justice & de l'équité, qui sont les mêmes dans tous les tems & dans tous les pays, au lieu qu'il y a des lois arbitraires qui sont muables, parce qu'elles dépendent de la volonté du législateur, ou des tems & autres conjonctures. (A)
LOIS JUDICIAIRES ou JUDICIELLES, on appelloit ainsi chez les Romains celles qui concernoient les jugemens.
Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls avec les consuls & les préteurs, jusqu'à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom sempronia, qui ordonna que l'on adjoindroit aux trois cent sénateurs six cent chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Caepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appellée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Silanus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante personnes, qui seroient juges pendant l'année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l'autorité des jugemens au sénat, & en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres ; c'est-à-dire aux sénateurs, aux chevaliers & aux tribuns, appellés aerarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger ; mais elle régla différemment l'ordre des procédures ; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit plusieurs autres réglemens, tant sur l'âge & la dignité des juges, que sur la forme des jugemens publics & privés sur ces différentes lois. Voyez Zazius. (A)
LOI DES JUIFS, voyez LOI DE MOÏSE.
LOI JULIA, on a donné ce nom à plusieurs lois différentes ; sçavoir, la loi julia agraria, faite par Jules César, pour la distribution des terres. Voyez LOIS AGRAIRES.
Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques-uns employoient pour parvenir à la magistrature.
Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seroient coupables d'adultere.
Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçoit des peines contre ceux qui étoient coupables de monopole pour le fait des blés.
Loi julia caducaria, voyez LOI CADUCARIA.
Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.
Loi julia de faenore, faite par Jules-César, régla la maniere dont les débiteurs satisferoient leurs créanciers.
Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiroient. Cette loi, qui ne s'appliquoit qu'aux biens d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxoriae actione.
Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des sénateurs & celui des chevaliers, & en exclut les tribuns du peuple.
Loi julia de libertatibus, contenoit un réglement par rapport à ceux qui étoient affranchis de la servitude.
Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier ; elle décernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui avoient femme & enfans, & des peines contre les célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans.
Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet effet à une femme veuve de se remarier, & de prendre ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se point marier, pourvû qu'elle jurât dans l'année qu'elle se remarioit pour procréer des enfans.
Loi julia de majestate, qui étoit de Jules-César, régloit le jugement & les peines du crime de leze-majesté ; elle abolit l'appel au peuple qui étoit auparavant usité dans cette matiere.
Loi julia norbana, faite la cinquieme année du regne de Tibere, régloit la condition des affranchis. D'autres l'appellent junia norbana. Voyez LOI JUNIA.
Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçoit des peines contre ceux qui détournoient les deniers publics, ou l'argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d'un édifice sacré.
Loi julia de pecuniis mutuis, étoit la même que l'on connoît sous le nom de loi julia de faenore.
Loi julia repetundarum, dont Jules-Cesar fut aussi l'auteur, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats.
Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, étoit une de celles qui régloient la maniere de conférer le sacerdoce.
Loi julia sumptuaria, qui étoit aussi de Jules-César, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyez ci-après LOIS SOMPTUAIRES.
Loi julia testamentaria, qui est de l'empereur Auguste, avoit pour objet la publicité des testamens & la reconnoissance de la signature des témoins.
Loi julia théatrale, fut un adoucissement que fit Jules-César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.
Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.
Sur ces différentes lois, surnommées julia, on peut voir Zazius, & les auteurs qu'il indique sur chacune.
LOI JUNIA, l'on en connoît quatre de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, qui fut faite l'an 690 de Rome, par Junius Silanus, & Licinius Murena, consuls, pour prescrire plus étroitement l'observation des fêtes, & empêcher que ces jours-là, on ne traitât d'aucune affaire avec le peuple, ou qu'on ne fît quelque loi. Cic. Philipp. 5. & l. IV. ad Atticum.
Loi junia annale, annalis, fut ainsi appellée, parce qu'elle régloit le nombre d'années qu'il falloit avoir pour chaque degré de magistrature ; elle fut faite sous le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fulvius Flaccus.
Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Silanus & de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels elle fut faite l'an de grace 21, régloit l'état des affranchis. Elle établit une sorte d'affranchis, appellés latini, qui vivoient libres ; mais qui en mourant retomboient dans la condition servile, & leurs biens retournoient au patron, comme par droit de pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tester, ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette loi d'abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seroient réputés citoyens romains. Voyez aux instit. & le tit. de succ. libert.
Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d'instituer tous ceux qui étoient ses héritiers siens, sui, présomptifs, & que si quelqu'un de ses héritiers cessoit d'être sien, il institueroit ses enfans. Elle régloit encore plusieurs autres choses concernant les testamens ; quelques-uns croient que cette loi fut faite par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius & la note de Charondas.
LOI LAETORIA, défendoit de prêter à usure aux fils de famille ; cette prohibition fut encore portée plus loin par le sénatusconsulte macédonien, qui annulla indistinctement toutes les obligations des fils de famille pour cause de prêt. Voyez MACEDONIEN.
LOIS DE LAYRON, voyez LOIS D'OLERON.
LOI LECTORIA, ou LAETORIA fut faite par Qu. Lectorius, pour empêcher les mineurs & les personnes en démence d'être trompés ; & pour cet effet, elle ordonna qu'on leur donneroit des curateurs. Cicéron fait mention de cette loi, Lib. III. de nat. Deor. & lib. III. offic.
LOI LICINIA, il y eut diverses lois de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, dont on a parlé ci-devant à l'article LOI JUNIA.
Loi licinia & ebutia ; ces deux lois furent faites par deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats de s'enrichir aux dépens du public, eux & leur famille. On ne sait pas précisément le tems où ces lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de lege agrariâ.
Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff. de alienat.
Loi licinia & mutia, fut faite par les consuls L. Licinius Crassus & Mucius Scaevola, pour empêcher ceux qui n'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome. Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic. & ailleurs.
Loi licinia agraria, pour le partage des terres. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.
Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l'un des consuls seroit choisi entre les Plébeïens.
Loi licinia de aere minuendo, qui étoit du même tribun, fut faite pour le soulagement des débiteurs ; elle ordonnoit qu'en déduisant sur le capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, le surplus seroit payé en trois ans en trois payemens égaux.
Loi licinia de sacerdotiis, faite par M. Licinius Crassus, ordonnoit que les prêtres ne seroient plus choisis par leurs colleges, mais par le peuple.
Loi licinia de sodalitiis, qui étoit du même auteur, avoit pour objet de défendre toutes les associations qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les suffrages pour parvenir aux honneurs. Ciceron, pro Plantio en fait mention.
Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le luxe. Voyez ci-après LOIS SOMPTUAIRES.
Sur ces différentes lois, voyez Zazius & l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson.
LOI DES LOMBARDS, lex Longobardorum, fut d'abord mise en ordre par leur roi Rotharis, & se trouve sous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges Longobardorum, quas Rotharis rex solâ memoriâ & usu retinebat & composuit, jussitque edictum appellari, anno 707 ex quo Longobardi in Italiam venerant. La même chose a été observée par Herman, moine de saint Gal, sous l'an 637 ; dans ces tems, dit-il, Rotharis roi des Lombards, amateur de la justice, quoiqu'il fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la suite les rois Grimoald, la sixieme année de son regne, & Luitprand la premiere année, Ratchis & Aistulphe, réformerent cette loi, & y ajouterent de nouvelles dispositions, qui sont distinguées en leur lieu dans l'édition d'Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis le Débonnaire, Lothaire, Pepin, Guy, Othon, Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques additions, & le tout fut distribué en trois livres, sans néanmoins que l'on sache précisément dans quel tems elle a été mise dans cet ordre ; dans cette derniere rédaction, il se trouve plusieurs choses tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on le voit par l'édition qu'en a donné le docte M. Baluze.
LOI LURCONIENNE, lurconis de ambitu, fut faite par Lurcon, tribun du peuple ; elle avoit pour objet de prévenir les brigues que l'on faisoit pour parvenir à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui dans cette vue auroit répandu de l'argent dans sa tribu, seroit obligé tant qu'il vivroit, de payer une somme considérable à chaque tribu. Ciceron, lib. I. ad Atticum.
LOI MAENIA, fut faite par le tribun Maenius, pour diminuer l'autorité du sénat ; avant cette loi, lorsque le peuple avoit donné son suffrage, le sénat interposoit son autorité ; au lieu que suivant cette loi, le sénat étoit réputé auteur de ce qui se proposoit même avant que le peuple eût donné son suffrage ; de maniere que tout ce que le peuple ordonnoit, paroissoit fait de l'autorité du sénat. Tite-Live, lib. I.
LOI MAMILIA, est la même que la loi manilia, dont il est parlé ci-après ; quelques-uns appellent son auteur Mamilius, mais on l'appelle plus communément Manilius.
LOI MANILIA ; il y en eut trois de ce nom, sçavoir la loi manilia, faite par le tribun Manilius Lemetanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient malversé dans la guerre jugurthine, soit en négligeant les decrets du sénat, soit en recevant de l'argent.
Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour commettre au grand Pompée la direction de la guerre contre Mithridate.
Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis droit de suffrage dans toutes les tribus ; ce qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion populaire ; mais ce trouble ayant été appaisé par le questeur Domitius Aenobarbus, le projet de Manilius fut rejetté. Voyez Ciceron, pro Milone.
LOI MANLIA, fut faite par le consul M. Manlius Capitolin ; elle ordonnoit que l'on payeroit au tresor public le vingtieme de ceux qui seroient affranchis. Voyez Tite-Live, lib. VII. & Ciceron, ad Atticum, lib. II.
LOI MARIA ; il y eut deux lois de ce nom, l'une surnommée de pontibus ; cette loi, pour dissiper les brigues, ordonna que les ponts construits dans le champ de Mars, par lesquels on devoit aller au scrutin, seroient rendus si étroits qu'il n'y pourroit passer qu'une personne à la fois. On ne sait si cette loi est du préteur Marius, ou du consul de ce nom.
L'autre loi appellée maria de moneta, parce qu'elle eut pour objet de fixer le prix des monnoies, qui étoit alors si incertain, que chacun ne pouvoit sçavoir la valeur de ce qu'il avoit en espece ; elle fut faite par le préteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta la tête par toute la ville. Voyez Ciceron, lib. III. de offic.
LOI MEMNIA, établit des peines contre les calomniateurs ; elle dispensoit aussi ceux qui étoient absens pour le service de l'état de comparoître en jugement. Voyez Zazius.
LOI MENSIA, régloit que l'enfant né d'un pere ou d'une mere étrangers, suivroit la condition de celui qui étoit étranger. Voyez Charondas en sa note sur Zazius à la fin.
LOI METELLA, fut présentée au peuple par le consul Metellus, de l'ordre des censeurs Flaminius & Aemilius, elle concernoit la police du métier de foulon. Voyez Pline, lib. XXXV. cap. xvij.
LOIS DE LA MER, voyez ci-après LOIS D'OLERON.
LOI DE MELEE, c'est l'amende dûe pour une rixe. Voyez la coûtume de Mons, chap. xlix.
LOI MOLMUTINE, lex molmutina, seu molmucina, vel mulmutina ; ce sont les lois faites en Angleterre par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon, roi de Cornouaille, lequel succéda à son pere. Ces lois furent célebres en Angleterre jusqu'au tems d'Edouard, surnommé le Confesseur, c'est-à-dire jusques dans le onzieme siecle. Voyez le glossaire de Ducange, au mot lex molmutina.
LOI MONDAINE, lex mundana seu terrena ; sous la premiere & la seconde race de nos rois, on appelloit ainsi les lois civiles par opposition au droit canonique ; elle étoit composée du code théodosien pour les Romains, & des codes nationaux des Barbares, suivant lesquels ces derniers étoient jugés, tels que les lois saliques & ripuaires pour les Francs, les lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les capitulaires & écrits des sept, huit, neuf & dixieme siecles, le terme de loi mondaine signifie les lois propres de chaque peuple, & désigne presque toujours les capitulaires. Voyez M. le président Henault sous Clovis, & les recherches sur le droit françois, p. 162.
LOI MUABLE, voyez LOI ARBITRAIRE.
LOI MUNICIPALE, est celle qui est propre à une ville ou à une province : ce nom vient du latin municipium, lequel chez les Romains signifioit une ville qui se gouvernoit par ses propres lois, & qui avoit ses magistrats particuliers.
Les lois municipales sont opposées aux lois générales, lesquelles sont communes à toutes les provinces qui composent un état, telles que les ordonnances, édits & déclarations qui sont ordinairement des lois générales ; au lieu que les coutumes des provinces & des villes & autres lieux sont des lois municipales. Voyez DROIT MUNICIPAL. (A)
LOI NATURELLE, (Morale) la loi naturelle est l'ordre éternel & immuable qui doit servir de regle à nos actions. Elle est fondée sur la différence essentielle qui se trouve entre le bien & le mal. Ce qui favorise l'opinion de ceux qui refusent de reconnoître cette distinction, c'est d'un côté la difficulté que l'on rencontre quelquefois à marquer les bornes précises qui séparent la vertu & le vice : de l'autre, la diversité d'opinions qu'on trouve parmi les savans mêmes qui disputent entr'eux pour savoir si certaines choses sont justes ou injustes, sur-tout en matiere de politique, & enfin les lois diamétralement opposées les unes aux autres qu'on a faites sur toutes ces choses en divers siecles & en divers pays ; mais comme on voit dans la peinture, qu'en détrempant ensemble doucement & par degrés deux couleurs opposées, il arrive que de ces deux couleurs extrêmes, il en résulte une couleur mitoyenne, & qu'elles se mêlent si bien ensemble, que l'oeil le plus fin ne l'est pas assez pour marquer exactement où l'une finit & l'autre commence, quoique pourtant les couleurs soient aussi différentes l'une de l'autre qu'il se puisse : ainsi quoiqu'en certains cas douteux & délicats, il puisse se faire que les confins où se fait la séparation de la vertu & du vice, soient très-difficiles à marquer précisément, desorte que les hommes se sont trouvés partagés là-dessus, & que les lois des nations n'ont pas été par-tout les mêmes, cela n'empêche pas qu'il n'y ait réellement & essentiellement une très-grande différence entre le juste & l'injuste. La distinction éternelle du bien & du mal, la regle inviolable de la justice se concilie sans peine l'approbation de tout homme qui réfléchit & qui raisonne ; car il n'y a point d'homme à qui il arrive de transgresser volontairement cette regle dans des occasions importantes, qui ne sente qu'il agit contre ses propres principes, & contre les lumieres de sa raison, & qui ne se fasse là-dessus de secrets reproches. Au contraire, il n'y a point d'homme qui, après avoir agi conformément à cette regle, ne se sache gré à lui-même, & ne s'applaudisse d'avoir eu la force de résister à ces tentations, & de n'avoir fait que ce que sa conscience lui dicte être bon & juste ; c'est ce que saint Paul a voulu dire dans ces paroles du chap. ij. de son épître aux Romains : que les Gentils qui n'ont point de loi, font naturellement les choses qui sont de la loi, & que n'ayant point de loi, ils sont leur loi à eux-mêmes, qu'ils montrent l'oeuvre de la loi écrite dans leurs coeurs, leur conscience leur rendant témoignage, & leurs pensées entr'elles s'accusant ou s'excusant.
Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui, gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débauche, & accoutumés au vice par une longue habitude, ont furieusement dépravé leurs principes naturels, & pris un tel ascendant sur leur raison, qu'ils lui imposent silence pour n'écouter que la voix de leurs préjugés, de leurs passions & de leurs cupidités. Ces gens plutôt que de se rendre & de passer condamnation sur leur conduire, vous soutiendront impudemment, qu'ils ne sauroient voir cette distinction naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prêche tant ; mais ces gens-là, quelque affreuse que soit leur dépravation, quelque peine qu'ils se donnent pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils se font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s'empêcher de laisser échapper leur secret, & de se découvrir dans de certains momens où ils ne sont point en garde contre eux-mêmes. Il n'y a point d'homme en effet si scélérat & si perdu, qui après avoir commis un meurtre hardiment & sans scrupule, n'aimât mieux si la chose étoit mise à son choix, n'avoir obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes, fût-il sûr de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu des principes d'Hobbes, & placé dans son état de nature, qui, toutes choses égales, n'aimât beaucoup mieux pourvoir à sa propre conservation, sans être obligé d'ôter la vie à tous ses semblables, qu'en la leur ôtant. On n'est méchant, s'il est permis de parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est-à-dire, parce qu'on ne sauroit autrement satisfaire ses desirs & contenter ses passions. Il faut être bien aveuglé pour confondre les forfaits & les horreurs avec cette vertu qui, si elle étoit soigneusement cultivée, feroit voir au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens poëtes se sont servis pour peindre l'âge d'or.
La loi naturelle est fondée, comme nous l'avons dit, sur la distinction essentielle qui se trouve entre le bien & le mal moral, il s'ensuit que cette loi n'est point arbitraire. " La loi naturelle, dit Cicéron, liv. II. des lois, n'est point une invention de l'esprit humain, ni un établissement arbitraire que les peuples aient fait, mais l'impression de la raison éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que Tarquin fit à Lucrece, n'en étoit pas moins un crime, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous les tems, & non pas seulement depuis l'instant qu'elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne que l'esprit divin : car la véritable, la primitive, & la principale loi, n'est autre que la souveraine raison du grand Jupiter ".
Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caracteres de la vertu sont écrits au fond de nos ames : de fortes passions nous les cachent à la vérité quelques instans ; mais elles ne les effacent jamais, parce qu'ils sont ineffaçables. Pour les comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux cieux, ni de percer dans les abymes ; ils sont aussi faciles à saisir que les principes des arts les plus communs : il en sort de toutes parts des démonstrations, soit qu'on réfléchisse sur soi-même, ou qu'on ouvre les yeux sur ce qui s'offre à nous tous les jours. En un mot, la loi naturelle est écrite dans nos coeurs en caracteres si beaux, avec des expressions si fortes & des traits si lumineux, qu'il n'est pas possible de la méconnoître.
LOI NUMMARIA, défendit à tout particulier de fabriquer des pieces de monnoie. Voyez Zazius sur la loi Cornelia de falso. (A)
LOI OGULNIA, fut faite l'an de Rome 453 par les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius ; elle portoit, que quand il y auroit quatre augures & quatre pontifes, & que l'on voudroit augmenter le nombre des prêtres, on choisiroit quatre pontifes & cinq augures, tous parmi les plébéïens, au lieu qu'auparavant le ministere du sacerdoce étoit affecté aux seuls patriciens. Voyez Zazius sur la loi Julia de sacerdotiis. (A)
LOIS D'OLERON, appellées quelquefois par corruption lois de Layron ou droits de Layron, & connues aussi sous le titre de coutumes de la mer, sont des lois faites pour les habitans de l'île d'Oleron, lesquels depuis 6 à 7 cent ans ont toujours passé pour bons hommes de mer ; desorte que les lois particulieres qui avoient été faites pour eux, par rapport à la navigation, furent regardées comme les coutumes de la mer, sans doute parce qu'il n'y en avoit point d'autres alors, la premiere ordonnance de la marine n'étant que de 1681. Selden dans sa dissertation sur fleta, p. 532 & 539, tient que Richard I. roi d'Angleterre, fut l'auteur de ces lois ; mais ce sentiment est réfuté par Denis Morisot & par Cleyrac, lequel fit imprimer ces lois à Rouen & ensuite à Bordeaux l'an 1647 ; ceux-ci assurent que ces lois furent faites par Eléonore, duchesse d'Aquitaine, à son retour de Syrie, & qu'on les appella le rouleau d'Oleron, qu'elles furent ensuite augmentées par Richard I. fils d'Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne différoient point de la charte du même Richard, intitulée Statuta illorum qui per mare ituri erunt.
Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait voir combien on en faisoit de cas & d'usage. (A)
LOI OPPIA, dont Oppius tribun du peuple, fut l'auteur du tems de la seconde guerre punique, fut faite pour réprimer le luxe des dames Romaines ; elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une demi-once d'or, & qu'elle eût un habit de diverses couleurs, ou qu'elle se fît voiturer dans un char par la ville ou à mille pas de distance, à moins que ce ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la suite les tribuns Valérius & Fundanius demanderent l'abrogation de cette loi ; le consul Portius Caton parla pour maintenir la loi ; le tribun Valérius insista ; enfin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par ordre du peuple à la grande satisfaction des dames. Voyez Tite-Live, lib. XXXVII. (A)
LOI ORCHIA, ainsi nommée du tribun Orchius, fut la premiere loi somptuaire des Romains ; elle limita le nombre des convives, mais ne fixa rien pour la dépense. Voyez LOI DIDIA, LOI FANNIA, LOIS SOMPTUAIRES. (A)
LOI DE L'OSTRACISME, c'est-à-dire la peine de l'ostracisme ou bannissement que l'on prononçoit à Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit donnoit de l'ombrage aux autres citoyens. Voyez OSTRACISME.
LOI OUTREE, dans l'ancienne coutume de Normandie, étoit lorsque quelque différend étoit terminé par enquête ou brief. Quelques-uns ont cru que loi outrée étoit la même chose que loi de bataille ou duel, appellé combat à outrance ; mais cette explication ne peut s'accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij. de l'ancienne coutume de Normandie, où il est parlé de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux-ci avoient terme jusqu'à vingt-un ans pour les querelles qui se terminoient par bataille ; ainsi par loi outrée, on doit entendre, comme Terrien, les brefs & enquêtes en matiere possessoire, desorte que loi outrée n'est proprement autre chose qu'une loi apparoissant. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere au mot LOI. Voyez LOI APPARENTE. (A)
LOI PAPIA, il y en eut deux de ce nom ; savoir la
Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un certain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems des Gracques ; elle concernoit les étrangers qui usurpoient les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III. Officior.
Loi Papia Popaea de maritandis ordinibus, qui fut aussi appellée loi Julia, fut faite par Papius Popaeus, consul, sous l'autorité d'Auguste. Voyez ci-devant LOI JULIA de maritandis ordinibus, & Zazius. (A)
LOI PAPYRIA, il y eut cinq différentes lois de ce nom, qui furent faites par différens tribuns ou consuls surnommés Papyrius ; savoir la
Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendoit de consacrer aucune maison, terre ou autel sans le consentement du peuple.
Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit permis par la loi des douze tables.
Loi Papyria de refectione Trib. pleb. fut faite par Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour autoriser à créer tribun la même personne autant de fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant défendu par plusieurs lois.
Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde guerre punique pour la fabrication des sols appellés semiunciales ; ce fut un nommé Papyrius qui en fut l'auteur, mais on ne sait quel est celui de la race papyrienne qui eut part à cette loi.
Loi Papyria tabellaria qui étoit du même auteur, regloit la maniere de donner les suffrages. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES. (A)
LOI PARTICULIERE, est opposée à loi générale ; mais ce terme se prend en deux sens différens, une coutume locale, un statut d'une ville ou d'une communauté sont des lois particulieres, en tant qu'elles sont des exceptions à la coutume générale de la province ; on entend aussi quelquefois par loi particuliere, celle qui est faite précisément pour un certain cas, à la différence des autres lois, qui contiennent seulement des regles générales que l'on applique par interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)
LOI PEDIA, fut faite par le consul Pedius, contre les meurtriers de César, elle prononça contr'eux la peine du bannissement. Voyez Suétone, in Nerone.
LOI PENALE, (Droit nat. & polit.) loi faite pour prévenir les délits & les crimes, & les punir.
Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui sont accompagnées de menaces expresses d'une certaine punition ; mais encore celles qui laissent quelquefois à la prudence des juges, le soin de déterminer la nature, & le degré de la peine sur laquelle ils doivent prononcer.
Comme il est impossible que les lois écrites ayent prévû tous les cas de délits ; les maximes de la raison, la loi naturelle, le climat, les circonstances & l'esprit de modération, serviront de boussole & de supplément à la loi civile ; mais on ne sauroit trop restraindre la rigueur des peines, sur-tout capitales ; il faut que la loi prononce.
Lors même que les lois pénales sont positives sur la punition des crimes, il est des cas où le souverain est le maître de suspendre l'exécution de ces lois, sur-tout lorsqu'en le faisant, il peut procurer autant ou plus d'utilité, qu'en punissant.
S'il se trouve d'autres voies plus commodes d'obtenir le but qu'on se propose, tout dicte qu'il faut les suivre.
Ce n'est pas tout, les lois pénales doivent avoir de l'harmonie, de la proportion entr'elles, parce qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque le moins. C'est un grand mal en France, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, qu'à celui qui vole & assassine ; on assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans des colonies, & jamais les assassins.
Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non-seulement contraires à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu d'effet, que comme destruction.
Enfin, la premiere intention des lois pénales, est de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on les exécute à la rigueur, si l'on emploie la moindre subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce seront autant de fléaux qui tomberont sur la tête du peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas dormir tout-à-fait, mais reposer très-souvent. S'il est permis aux juges, dit Bacon,de montrer quelque foiblesse, c'est en faveur de la pitié. (D.J.)
LOI PESULANIA, que quelques-uns ont appellée par corruption Pesolonia, & Cujas loi Solonia, mais sans fondement, fut faite probablement par quelque tribun du peuple nommé Pesulanius ou Pesulanius ; elle avoit établi au sujet des chiens en particulier, ce que la loi des douze tables avoit reglé pour le dommage causé par toutes sortes de bêtes en général, c'est-à-dire, que si le chien avoit causé du dommage dans un chemin ou lieu public, que le maître du chien étoit tenu du dédommagement, sinon de livrer le chien ; mais par l'édit des édiles dont Justinien fait mention en ses institutes, le maître de l'animal fut astreint à réparer le dommage, en payant une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voyez le jurisconsulte Paulus, recept. sentent. lib. I. tit. 15. §. 1.
LOI PETILIA de ambitu, fut faite par le tribun Petilius vers l'an de Rome 397, ce fut la premiere loi que l'on fit pour réprimer les brigues que l'on employoit pour parvenir à la magistrature. Voyez Tite-Live, lib. VII.
LOI Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui s'étoient rendus coupables de péculat, lors de la guerre que l'on avoit faite en Asie contre le roi Antiochus. Voyez Tite-Live, lib. XXXVIII.
LOI PETRONIA, fut faite par un tribun du peuple nommé Petronius ; on ignore quel étoit son principal objet, tout ce que l'on en sait est qu'elle défendoit aux maîtres de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre avec les bêtes, & qu'elle ordonnoit que celui qui n'auroit pas prouvé l'adultere qu'il avoit mis en avant, ne pourroit plus intenter cette accusation. Voyez Zazius.
LOI DE PHILIPPE, lex Philippi ; on appella de ce nom une loi agraire faite par un certain Philippus, tribun du peuple. Voyez Valere-Maxime & LOIS AGRAIRES.
LOI PLANTIA, déclaroit que les choses usurpées par force n'étoient pas sujettes à l'usucapion ; on croit qu'elle fut faite sous le consulat de Lepidus & de Catullus. Voyez ci-après LOI PLOTIA de judiciis.
LOI PLOTIA, il y en eut deux de ce nom, savoir
LOI Plotia agraria, fut une des lois faites pour le partage des terres. Voyez Zazius sur les lois agraires.
LOI Plotia de judiciis, étoit une des lois qui déféroient le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjointement avec les chevaliers ; d'autres écrivent loi Plautia ; & en effet, on tient qu'elle fut faite par Plautius Silanus, tribun du peuple. Voyez Zazius.
LOI PLENIERE, lex plenaria, étoit la même chose en Normandie, que loi apparoissant ; les lois de Guillaume le conquérant disent plener lei.
LOI POLITIQUE, (Droit polit.) les lois politiques, sont celles qui forment le gouvernement qu'on veut établir ; les lois civiles sont celles qui le maintiennent.
La loi politique a pour objet, le bien & la conservation de l'état, considéré politiquement en lui-même, & abstraction faite des sociétés renfermées dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le cas particulier où s'applique la raison humaine pour l'intérêt de l'état qui gouverne.
Les lois politiques décident seules, si le domaine de l'état est aliénable ou non : seules elles reglent les successions à la couronne.
Il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister un état, qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'état des lois civiles qui reglent la disposition des biens des particuliers. Si donc on aliene le domaine, l'état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine ; mais cet expédient renverse le gouvernement politique, parce que par la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain tirera toujours moins. En un mot, le domaine est nécessaire, & l'aliénation ne l'est pas.
L'ordre de succession dans une monarchie, est fondée sur le bien de l'état, qui demande pour la conservation de cette monarchie, que cet ordre soit fixé. Ce n'est pas pour la famille régnante que cet ordre est établi ; mais parce qu'il est de l'intérêt de l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui regle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle qui regle la succession à la monarchie, est une loi politique, qui a pour objet l'avantage & la conservation de l'état. Voyez SUCCESSION à la couronne, (Droit polit.)
Quant aux successions des particuliers, les lois politiques les reglent conjointement avec les lois civiles ; seules elles doivent établir dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d'autres ; car quoique l'ordre politique demande généralement que les enfans succedent aux peres, il ne le veut pas toujours ; en un mot, l'ordre des successions ne dépend nullement des principes du droit naturel.
D'un autre côté, il ne faut pas décider par les lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent au droit des gens. Les lois politiques demandent, que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels ou civils du pays où il est, & à l'animadversion du souverain. Le droit des gens a voulu que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.
Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de religion, en voici le principe général. Elles doivent soutenir la religion dominante, & tolérer celles qui sont établies dans l'état, & qui contribuent à le faire fleurir.
Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les conditions, toutes les qualités pour le fonds & le style, qui sont requises dans les lois civiles, & dont nous avons fait le détail au mot LOI CIVILE. (D.J.)
LOI POMPEIA : il y en eut six de ce nom qui furent faites par les Pompeius ; savoir la
LOI Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les brigues que l'on employoit pour s'élever à la magistrature.
LOI Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les juges seroient choisis également dans les trois ordres qui composoient le peuple romain.
LOI Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pompeius Strabon, attribua aux latins la capacité de parvenir à la magistrature, & de jouir de tous les autres droits de cité.
LOI Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils du précédent fut l'auteur, regla la peine du parricide.
Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il donna en Bithynie, qui regloit entr'autres choses l'âge auquel on pourroit être admis à la magistrature ; sur toutes ces lois, voyez Zazius.
LOI PORCIA, fut une de celles que l'on fit pour maintenir les privileges des citoyens Romains, celle-ci prononçoit des peines graves contre ceux qui auroient tué, ou même seulement frappé un citoyen Romain. Voyez Cicéron, pro Rabirio.
LOI POSITIVE, est celle qui a été faite, elle est opposée à la loi naturelle qui n'est point proprement une loi en forme, & qui n'est autre chose que la droite raison. La loi positive se sous-divise en loi divine & loi humaine. Voyez DROIT POSITIF.
LOI PREDIALE, le terme de loi est pris ici pour condition, ou bien c'est l'acte par lequel on a imposé & imprimé quelque qualité & condition à un héritage qui l'affectent en lui-même & lui demeurent en quelques mains qu'il passe ; par exemple, ut ager sit vectigalis vel emphyteuticus vel censualis. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. X. ch. iij. n °. 2.
LOI PROBABLE & MONSTRABLE, on appelloit ainsi anciennement celle qui étoit appuyée du serment d'une ou de plusieurs personnes.
LOI PUBLILIENNES, on appella ainsi trois lois que fit le dictateur Q. Publilius, l'une pour ordonner que les plébiscites obligeroient tous les Romains ; l'autre portant, que le sénat seroit réputé le seul auteur de toutes les lois qui se feroient dans les contrées avant que l'on eût pris les suffrages. La premiere portoit, que l'un des censeurs pourroit être pris entre les plébéïens ; ces lois furent depuis englobées dans d'autres. Voyez Tite-Live, liv. VIII.
LOI PUPIA, que l'on croit de Pupius Pison, tribun du peuple, régla le tems où le sénat devoit tenir ses séances. Voyez Zazius & Charondas en sa note au même endroit.
LOI QUINTIA, AGRARIA, étoit une des lois agraires. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.
LOI REGIA, est celle par laquelle le peuple Romain accorda à Auguste, au commencement de son empire, le droit de législation. Ulpien fait mention de cette loi en ces termes : Quod principi placuit legis habet vigorem, & ajoûte que cela eut lieu en conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple lui remit tout le pouvoir qu'il avoit : quelques auteurs ont prétendu que cette loi n'avoit jamais existé, & qu'elle étoit de l'invention de Tribonien, mais il faudroit donc dire aussi qu'il a supposé le passage d'Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renouvellée en faveur de chaque empereur, & notamment du tems de Vespasien ; suivant les fragmens que l'on en a trouvés, elle donnoit à l'empereur le droit de faire des traités & des alliances avec les ennemis & avec les peuples dépendans ou indépendans de l'empire ; il pouvoit, suivant cette même loi, assembler & congédier le sénat à sa volonté, & faire des lois qui auroient la même autorité que si elles avoient émané du sénat & du peuple, il avoit tout pouvoir d'affranchir sans observer les anciennes formalités ; la nomination aux emplois & aux charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre d'étendre ou de resserrer les limites de l'empire, enfin, de regler tout ce qui regardoit le bien public & les intérêts des particuliers ; ce pouvoir ne différant en rien de celui qu'avoient les rois de Rome, ce fut apparemment ce qui fit donner à cette loi le nom de regia. Voyez l'hist. de la Jurisp. rom. par M. Terrasson, page 240. & suivantes. Voyez LOIS ROYALES. (A)
LOI RHODIA DE JACTU, est une loi du digeste qui décide, qu'en cas de péril imminent sur mer, s'il est nécessaire de jetter quelques marchandises pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises doit être supportée par tous ceux dont les marchandises ont été conservées.
Cette loi fut nommée Rhodia. parce que les Romains l'emprunterent des Rhodiens ; qui étoient fort expérimentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.
Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par Antonin, à la reserve de ce qui pouvoit être contraire à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de lege Rhodiâ de jactu. (A)
LOI DES RIPUARIENS ou RIPUAIRES, lex Ripuariorum, n'est quasi qu'une répétition de la loi Salique, aussi l'une & l'autre étoient-elles pour les Francs : on croit que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & la Loire, & la loi Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin ; elle fut rédigée sous le roi Théodoric étant à Châlons-sur-Marne avec celles des Allemands & des Bavarois ; il y avoit fait plusieurs corrections, principalement de ce qui n'étoit pas conforme au christianisme. Childebert, & ensuite Clotaire II. la corrigerent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit dans sa perfection, comme il a été dit en parlant de la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi, nous en citerons seulement deux dispositions : il en coûtoit cent sols pour avoir coupé une oreille à un homme, & si la surdité ne suivoit pas, on en étoit quitte pour cinquante sols. Le chap. iij. de cette loi permet au meurtrier d'un évêque de racheter son crime avec autant d'or que pesoit une tunique de plomb de la hauteur du coupable, & d'une épaisseur déterminée : ainsi ce n'étoit pas tant la qualité des personnes, ni les autres circonstances du délit, qui regloient la peine, c'étoit la taille du coupable ; quelle ineptie ! Il est parlé de la loi des Ripuariens dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (A)
LOIS ROMAINES, on donna ce nom à un abrégé du code Théodosien, qui fut fait par l'ordre d'Alaric, roi des Goths qui occupoient l'Espagne, & une grande partie de l'Aquitaine ; il fit faire cet abrégé par Anien son chancelier, qui le publia en la ville d'Aire en Gascogne : cette loi n'étoit pas pour les Goths, mais pour les Romains.
On entend aussi par lois romaines en général, toutes les lois faites pour les Romains, & qui sont renfermées dans le corps de droit civil. Voy. DROIT ROMAIN & CODE.
LOI ROMULEIA, fut faite par un des triumvirs nommé Romuleius, elle institua le college des ministres & des sacrifices, appellés epulones, & défera cet emploi aux triumvirs. Voyez Tite-Live, lib. III. Décad. 4.
LOI ROSCIA, il y en eut deux de ce nom, savoir la Loi Roscia, qui étoit une des lois frumentaires, dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.
Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers les quatorze premiers rangs au théâtre. V. Cicéron pro Murenâ. Voyez aussi LOIS THEATRALES.
LOI ROYALE, en Danemark, est une loi faite en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut alors déférée à Charles Gustave, puissance bien plus étendue que celle qu'avoient eu jusqu'alors les rois ses prédécesseurs, avant la révolution arrivée en 1660. Le gouvernement de Danemark, semblable en ce point à tous les gouvernemens gothiques, étoit partagé entre un roi électif, les grands de la nation ou le sénat, & les états. Le roi n'avoit presque point d'autre droit que celui de présider au sénat & de commander les armées : les rois qui précéderent Frédéric III. avoient souscrit à des capitulations qui limitoient leur pouvoir ; mais Charles Gustave, roi de Suede, entra en Danemark sous prétexte de secourir le roi contre le sénat, & la nation blessée de la supériorité que s'attribuoit la noblesse, se réunit pour déférer au roi une puissance absolue & héréditaire : on rendit au roi les capitulations qui limitoient son pouvoir, & l'on s'obligea par serment de maintenir la nouvelle puissance que l'on venoit de déférer au roi.
La loi qui la confirme, & qu'on appelle la loi royale, contient quarante articles, dont les principaux sont, que les rois héréditaires de Danemark & de Norwege seront regardés par leurs sujets comme les seuls chefs suprèmes qu'ils ayent sur la terre ; qu'ils seront au-dessus de toutes les lois humaines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles & ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul ; qu'ils jouiront du droit suprème de faire & d'interpreter les lois, de les abroger, d'y ajoûter ou d'y déroger ; de donner ou d'ôter les emplois à leur volonté ; de nommer les ministres & tous les officiers de l'état ; de disposer & des forces & des places du royaume ; de faire la guerre avec qui & quand ils jugeront à propos ; de faire des traités ; d'imposer des tributs ; de déterminer & regler les cérémonies de l'office divin ; de convoquer des conciles ; & enfin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils puissent être, & les exerce en vertu de sa propre autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré dans sa quatorzieme année, dès ce moment il déclare publiquement lui-même qu'il est son maître, & qu'il ne veut plus se servir de tuteur ni de curateur ; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir doit appartenir à la reine héréditaire, si dans la suite des tems la couronne passoit à quelque princesse du sang royal ; si quelqu'un, de quelque rang qu'il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui aura été ainsi accordé & obtenu sera nul & de nul effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles choses seront punis comme coupables du crime de lése-majesté. Tel est le précis de cette loi, la seule à laquelle il ne soit pas permis au roi lui-même de déroger. Voyez les Lettres sur le Danemark, imprimées à Genève, & l'extrait qui en est fait dans l'année littéraire, année 1758, let. XIV. p. 314. & suiv. (A)
LOI RUPILIA, fut donnée aux Siciliens par P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la recette des revenus publics, fut fait consul, & délivra la Sicile de la guerre des brigands & des transfuges ; elle regloit la forme des jugemens & la compétence des juges. Voyez Cicéron, Verrinâ quartâ.
LOI SACREE, (Hist. rom.) en latin lex sacrata ; les Romains appelloient lois sacrées, dit Grotius, les lois à l'observation desquelles le peuple Romain s'étoit lui-même astreint par la religion du serment. Il falloit, à la vérité, que l'autorité du peuple intervînt pour faire une loi sacrée ; mais toute loi dans l'établissement de laquelle le peuple étoit intervenu, n'étoit pas pour cela sacrée, à moins qu'elle ne portât expressément, que la tête de quiconque la violeroit, seroit devouée aux dieux, ensorte qu'il pourroit être impunément tué par toute autre personne ; car c'est ce qu'on entendoit par caput sacrum sancire, ou consecrare. Voyez Paul Manuce dans son traité de legibus ; Festus au mot sacratae leges, & Perizonii animadversiones. (D.J.)
LOIS SACREES, on donna ce nom à certaines lois, qui pour peine des contraventions que l'on y commettroit, ordonnoient que le contrevenant & toute sa famille & son argent, seroient consacrés à quelqu'un des dieux. Voyez Cicéron pro Cornelio Balbo.
La qualité de sacrée que l'on donnoit à ces lois, étoit différente de ce qu'on entend par lois saintes. Voyez ci-après LOIS SAINTES. Voyez aussi LOI CILIA. (A)
LOIS SACREES des Mariages, (Hist. & Jurisprud. rom.) leges sacratae nuptiarum ; c'est une sorte d'hypallage, pour dire, lois des mariages sacrés.
Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre, ou les mariages qui se pratiquoient par la confarréation, laquelle se faisoit avec un gâteau de froment, en présence de dix témoins, & avec certains sacrifices & des formules de prieres ; d'où vient que les enfans qui naissoient de ce mariage s'appelloient, confarreatis parentibus geniti : ou bien il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisoient ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les femmes étoient nommées matres familias, meres de famille. Ces deux sortes de mariages sont également appellés par les anciens jurisconsultes, justae nuptiae, pour les distinguer d'une troisieme sorte de mariage, qui s'appelloit matrimonium ex usu, concubinage.
Les lois des mariages sacrés portoient, que la femme, ainsi mariée, entreroit en communauté de sacrifices & de biens avec son mari, sacrorum, fortunarumque esset socia ; qu'elle seroit la maîtresse de la famille, comme lui en étoit le maître ; qu'elle seroit héritiere de ses biens en portion égale, comme un de ses enfans, s'ils en avoient de leur mariage, si non, qu'elle hériteroit de tout, ex asse verò, si minùs.
Cette communauté, cette société de sacrifices & de biens, dans laquelle la femme entroit avec son mari, doit s'entendre des sacrifices privés de certaines familles, qui étoient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations, & des funérailles, à quoi même étoient tenus les héritiers & les descendans des mêmes familles. De-là vient que Plaute a dit, qu'il lui étoit échu un grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de famille, se hereditatem adeptum esse, sine sacris, effertissimam.
La femme unie juxtà sacratas leges, ou pour m'exprimer avec les jurisconsultes, justis nuptiis, devenoit maîtresse de la famille, comme le mari en étoit le maître.
On sait qu'après la conclusion du mariage la mariée se présentoit sur le seuil de la porte, & qu'alors on lui demandoit qui elle étoit ; elle répondoit à cette question, ego sum Caïa, je suis Caïa, parce que Caïa Cecilia, femme de Tarquin l'ancien, avoit été fort attachée à son mari & à filer ; ensuite, on lui présentoit le feu & l'eau, pour lui marquer qu'elle devoit avoir part à toute la fortune de son mari. Plutarque nous apprend encore, dans la troisieme question romaine, que le mari disoit à son épouse, lorsqu'elle le recevoit à son tour chez elle, ego sum Caïus, je suis Caïus, & qu'elle lui repliquoit de nouveau, ego Caïa, & moi je suis Caïa. Ces sortes d'usages peignent les moeurs, ils se sont perdus avec elles. (D.J.)
LOIS SAINTES. Les lois sont ainsi appellées, parce que le respect leur est dû, sub sanctione poenae ; c'est pourquoi elles sont mises au nombre des choses que l'on appelle en Droit res sanctae. Voyez aux instit. le tit. de rer. divis. & les annotateurs. (A)
LOI DE SAINT BENOIST ; c'est ainsi que l'on appelle vulgairement dans le pays de Labour le droit que les habitans de chaque paroisse ont de s'assembler pour leurs affaires communes, & de faire des statuts particuliers pour leurs bois padouans & paturages, pourvu que leurs délibérations ne soient pas préjudiciables au bien public & aux ordonnances du roi. Ce droit est ainsi appellé dans les coutumes de Labour, tit. XX. article 4 & 5. Voyez aussi celle de Sole, tit. I. art. 4 & 5 ; & la conférence des eaux & forêts, titre XXV. article 7. (A)
LOI SALIQUE, lex salica ou plutôt pactum legis salicae, appellée aussi lex Francorum seu francica ; étoit la loi particuliere des Francs qui habitoient entre la Meuse & le Rhin, comme la loi des Ripuaires étoit celle des Francs qui habitoient entre la Loire & la Meuse.
Il y a beaucoup d'opinions diverses sur l'origine & l'étymologie de la loi salique ; nous ne rapporterons ici que les plus plausibles.
Quelques-uns ont prétendu que cette loi avoit été nommée salica, parce qu'elle avoit été faite en Lorraine sur la petite riviere de Seille, appellée en latin Salia, laquelle se jette dans la Moselle.
Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la préface de la loi salique, qui porte qu'elle avoit été écrite avant que les Francs eussent passé le Rhin.
Ceux qui l'attribuent à Pharamond, disent qu'elle fut nommée salique de Salogast, l'un des principaux conseillers de ce prince, ou plutôt duc ; mais du Tillet remarque que Salogast n'étoit pas un nom propre, que ce mot signifioit gouverneur des pays saliens. On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an 422 en langue germanique, avant que les Francs eussent passé le Rhin ; mais cette premiere rédaction ne se trouve plus.
D'autres veulent que le mot salica vienne de sala, qui signifie maison, d'où l'on appella terre salique celle qui étoit autour de la maison, & que la loi dont nous parlons ait pris le surnom de salica, à cause de la disposition fameuse qu'elle contient au sujet de la terre salique, & qui est regardée comme le titre qui assure aux mâles la couronne à l'exclusion des femelles.
D'autres encore tiennent, & avec plus de raison, que la loi salique a été ainsi nommée, comme étant la loi des Francs Saliens, c'est-à-dire de ceux qui habitoient le long de la riviere de Sala, fleuve de l'ancienne Germanie.
D'autres enfin croient que les François Saliens du nom desquels fut surnommée la loi salique, étoient une milice ou faction de Francs qui furent appellés Saliens à saliendo, parce que cette milice ou nation faisoit des courses imprevûes hors de l'ancienne France sur la Gaule. Et en effet, les François Saliens étoient cités par excellence, comme les peuples les plus legers à la course, suivant ce que dit Sidon Apollinaire, sauromata clypeo, salius pede, falce gelonus.
Quoiqu'il en soit de l'étymologie du nom des Saliens, il paroît certain que la loi salique étoit la loi de ce peuple, & que son nom est dérivé de celui des Saliens ; c'étoient les plus nobles des Francs, lesquels firent la conquête d'une partie des Gaules sur les Romains.
Au surplus, telle que soit aussi l'étymologie du surnom de salique donné à cette loi, on entend par loi salique la loi des Francs ou premiers François, ce qui se prend en deux sens, c'est-à-dire ou pour le droit public de la nation qui comprend, comme disent les Jurisconsultes, tout ce qui sert à conserver la religion & l'état ; ou le droit des particuliers, qui sert à régler leurs droits & leurs différends les uns par rapport aux autres.
Nous avons un recueil des lois de nos premiers ancêtres : il y en a deux textes assez différens pour les termes, quoiqu'à peu de chose près les mêmes pour le fond ; l'un encore à moitié barbare, est celui dont on se servoit sous la premiere race, l'autre réformé & publié par Charlemagne en 798.
Le premier texte est celui qui nous a d'abord été donné en 1557 par Herold, sur un manuscrit de la bibliotheque de Fulde, qui, au jugement d'Herold, avoit 700 ans d'antiquité ; ensuite en 1720 par M. Eccard, sur un manuscrit de la bibliotheque du duc de Volfenbutel, écrit au commencement de la seconde race. Enfin, en 1727 par Schelter, sur un manuscrit de la bibliotheque du Roi, n°. 5189. Ce texte a 80 articles, ou plutôt 80 titres dans le manuscrit de Fulde, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel, 100 dans le manuscrit du Roi.
Le second texte est celui que nous ont donné du Tillet, Pithou, Goldast, Lindenbrog, le célebre Bignon & Baluse, qui l'avoit revû sur onze manuscrits. Il n'a que 71 articles, mais avec une remarque que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires.
Goldast a attribué ce recueil à Pharamond, & a supposé en conséquence le titre qu'il lui a donné dans son édition. M. Eccard rejette avec raison cette opinion, qui n'est fondée sur aucune autorité : car l'auteur même des Gestes qui parle de l'établissement de cette loi, après avoir rapporté l'élection de Pharamond, ne la lui attribue pas, mais aux chefs de la noblesse & premiers de la nation. Quae consiliarii eorum priores gentiles, ou, suivant une autre leçon, quae eorum priores gentiles tractaverunt ; & de la façon dont sa narration est disposée, il fait entendre que l'élection de Pharamond & l'institution des lois, se firent en même tems. Après la mort de Sunnon, dit-il, ils résolurent de se réunir sous le gouvernement d'un seul roi, comme étoient les autres nations ; ce fut aussi l'avis de Marcomir ; & ils choisirent Pharamond son fils. C'est aussi alors qu'ils commencerent à avoir des lois qui furent dressées par leurs chefs & les premiers de la nation, Salogan, Bodogan & Widogan, au-delà du Rhin à Salehaim, Bodehaim & Widehaim. Cette loi fut dressée dans l'assemblée des états de chacune de ces provinces, c'est pourquoi elle n'est pas intitulée lex simplement, mais pactum legis salicae.
L'ancienne préface du recueil, écrite à ce qu'il paroît sous Dagobert, ne reconnoît point non plus d'autre auteur de ces lois que ces mêmes seigneurs, & on ne peut raisonnablement aujourd'hui proposer une autre opinion, sans quelqu'autorité nouvelle.
Une note qui est à la fin du manuscrit de Wolfembutel, dit que le premier roi des François n'autorisa que 52 titres, statuit, disposuit judicare ; qu'ensuite, de l'avis de ses seigneurs, cum optimatis suis, il ajouta les titres 63 & suivans, jusque & compris le 78 ; que longtems après Childebrand (c'est Childebert) y en ajouta 5 autres, qu'il fit agréer facilement à Clotaire, son frere cadet, qui lui-même en ajouta 10 nouveaux, c'est-à-dire jusqu'au 93, qu'il fit réciproquement approuver par son frere.
L'ancienne préface dit en général que ces lois furent successivement corrigées & publiées par Clovis, Thierry, Childebert & Clotaire, & enfin par Dagobert, dont l'édition paroît s'être maintenue jusqu'à Charlemagne.
Clovis, Childebert & Clotaire firent traduire cette loi en langue latine, & en même tems la firent réformer & amplifier. Il est dit aussi que Clovis étoit convenu avec les Francs de faire quelques additions à cette loi.
Elle ne paroît même qu'un composé d'articles faits successivement dans les parlemens généraux ou assemblées de la nation ; car son texte le plus ancien porte presque à chaque article des noms barbares, qui sont sans doute les lieux de ces parlemens.
Childebert & Clotaire, fils de Clovis, firent un traité de paix ; & dans ce traité de nouvelles additions à la loi salique, il est dit que ces résolutions furent prises de concert avec les Francs, & l'on regarde cela comme un parlement.
Cette loi contient un grand nombre d'articles, mais le plus célebre est celui qui se trouve au titre LXII. de alode, où se trouve prononcée l'exclusion des femelles en faveur des mâles dans la succession de la terre salique, de terrâ vero salicâ nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terrae hereditas perveniat.
Il s'agit ici en général de toute terre salique dont les filles étoient excluses à la différence des autres aleux non saliques, auxquels elles succédoient.
M. Eccard prétend que le mot salique vient de sala, qui signifie maison : qu'ainsi la terre salique étoit un morceau de terre autour de la maison.
Ducange croit que la terre salique étoit toute terre qui avoit été donnée à un franc lors du partage des conquêtes pour la posséder librement, à la charge seulement du service militaire ; & que comme les filles étoient incapables de ce service, elles étoient aussi excluses de la succession de ces terres. Le même usage avoit été suivi par les Ripuariens & par les Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons ni par les Bourguignons.
L'opinion qui paroît la mieux établie sur le véritable sens de ce mot alode, est qu'il signifioit hereditas aviatica, c'est-à-dire un propre ancien. Ainsi les filles ne succédoient point aux propres : elles n'étoient pourtant excluses des terres saliques que par des mâles du même degré.
Au reste, dans les pays même où la loi salique étoit observée, il étoit permis d'y déroger & de rappeller les filles à la succession des terres saliques, & cela étoit d'un usage assez commun. C'est ce que l'on voit dans le II. liv. des formules de Marculphe. Le pere amenoit sa fille devant le comte ou le commissaire, & disoit : " Ma chere fille, un usage ancien & impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux filles ; mais ayant considéré cette impiété, j'ai vû que, comme vous m'avez été donnés tous de Dieu également, je dois vous aimer de même. Ainsi, ma chere fille, je veux que vous héritiez par portion égale avec vos freres dans toutes mes terres, &c. ".
La loi salique a toujours été regardée comme une des lois fondamentales du royaume, pour l'ordre de succéder à la couronne, à laquelle l'héritier mâle le plus proche est appellé à l'exclusion des filles, en quelque degré qu'elles soient.
Cette coutume nous est venue de Germanie, où elle s'observoit déja avant Clovis. Tacite dit que dès-lors les mâles avoient seuls droit à la couronne ; il remarque comme une singularité que les peuples de Germanie, appellés Sitones, étoient les seuls chez lesquels les femmes eussent droit au trône.
Cette loi fut observée en France sous la premiere race, après le décès de Childebert, de Cherebert & de Gontran, dont les filles furent excluses de la couronne.
Mais la premiere occasion où l'on contesta l'application de la loi salique, fut en 1316, après la mort de Louis Hutin. Jeanne sa fille, qui prétendoit à la couronne en fut excluse par Philippe V. son oncle.
Cette loi fut encore réclamée avec le même succès en 1328, par Philippe de Valois contre Edouard III. qui prétendoit à la couronne de France, comme étant fils d'Isabelle de France, soeur de Louis Hutin, Philippe-le-long & Charles IV. qui regnerent successivement & moururent sans enfans mâles.
Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maistre, petit-fils de Gilles le Maistre, prémier président, prononça le célebre arrêt par lequel la cour déclara nuls tous traités faits & à faire pour transférer la couronne en maison étrangere, comme étant contraires à la loi salique & autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui écarta toutes les prétentions de la ligue.
La loi salique écrite contient encore une chose remarquable, savoir que les Francs seroient juges les uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient ensemble les lois de l'avenir, selon les occasions qui se présenteroient, soit qu'il fallût garder en entier ou réformer les anciennes coutumes qui venoient d'Allemagne.
Nous avons trois éditions différentes de la loi salique.
La premiere & la plus ancienne est celle qui a été tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Fulde, & publiée par Heroldus, sur laquelle Wendelinus a fait un commentaire.
La seconde est celle qui fut réformée & remise en vigueur par Charlemagne ; elle a été publiée par Pithou & Lindenbrog : on y a ajouté plusieurs capitulaires de Charlemagne & de Louis le débonnaire. C'est celle qui se trouve dans le code des lois antiques.
La troisieme est un manuscrit qu'un allemand nommé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus ample que les autres exemplaires, & qui contient la troisieme partie de cette loi, avec une chronologie de la même loi.
Au reste la loi salique est bien moins un code de lois civiles qu'une ordonnance criminelle. Elle descend dans les derniers détails sur le meurtre, le viol, le larcin, tandis qu'elle ne statue rien sur les contrats ni sur l'état des personnes & les droits des mariages, à peine effleure-t-elle la matiere des successions ; mais ce qui est de plus étrange, c'est qu'elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle ; elle n'assujettit les coupables qu'à des compositions : les vengeances privées y sont même expressément autorisées ; car elle défend d'ôter les têtes de dessus les pieux sans le consentement du juge ou sans l'agrément de ceux qui les y avoient exposées.
Cependant sous Childebert on inséra par addition dans la loi salique, la peine de mort pour l'inceste, le rapt, l'assassinat & le vol : on y défendit toute composition pour les crimes, & les juges devoient en connoître hors du parlement.
Cette loi, de même que les autres lois des Barbares, étoit personnelle & non territoriale, c'est-à-dire qu'elle n'étoit que pour les Francs ; elle les suivoit dans tous les pays où ils étoient établis ; & hors les Francs elle n'étoit loi que pour ceux qui l'adoptoient formellement par acte ou déclaration juridique.
On suivoit encore en France la loi salique pour les Francs, du tems de Charlemagne, puisque ce prince prit soin de la réformer ; mais il paroit que depuis ce tems, sans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans l'oubli, si ce n'est la disposition que l'on applique à la succession à la couronne ; car par rapport à toutes les autres dispositions qui ne concernoient que les particuliers, les capitulaires qui étoient des lois plus récentes, fixerent davantage l'attention. On fut sans doute aussi bien aise de quitter la loi salique, à cause de la barbarie qu'elle marquoit de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les moeurs : desorte que présentement on ne cite plus cette loi qu'historiquement, ou lorsqu'il s'agit de l'ordre de succéder à la couronne.
Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur la loi salique ; on peut voir Wendelinus, du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet, Boulainvilliers en son traité de la pairie, &c. (A)
LOI DES SAXONS, lex Saxonum, étoit la loi des peuples de Germanie ainsi appellés ; cette loi succéda au code théodosien, & devint insensiblement le Droit commun de toute l'Allemagne. L'édition de cette loi se trouve dans le code des lois antiques ; c'est le droit que Charlemagne permit à ces peuples de suivre après les avoir soumis. Voyez le code des lois antiques. (A)
LOI SCANTINIA, que l'on attribue à C. Scantinius, tribun du peuple, fut publiée contre ceux qui se prostituoient publiquement, qui débauchoient les autres. La peine de ce crime étoit d'abord pécuniaire ; les empereurs chrétiens prononcerent ensuite la peine de mort. Voyez Zazius. (A)
LOI SEMPRONIA ; il y eut un grand nombre de lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus, savoir :
Loi Sempronia agraria. Voyez LOIS AGRAIRES.
Loi Sempronia de aetate militari, qui défendoit de forcer au service militaire ceux qui étoient au-dessous de 17 ans.
Loi Sempronia de coloniis, ordonna d'envoyer des colonies romaines dans toutes les parties du monde.
Loi Sempronia de faenore, que l'on croit de M. Sempronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts de l'argent prêté aux Latins & aux autres alliés du nom romain, se régleroient de même qu'à l'égard des Romains.
Loi Sempronia de libertate civium ; elle défendit de décider du sort d'un citoyen romain sans le consentement du peuple.
Loi Sempronia de locatione agri Attalici & Asiae, fut faite pour ordonner aux censeurs de louer chaque année les terres léguées au peuple romain par Attalus roi de Pergame.
Loi Sempronia de suffragiis, regle que les centuries auroient un nombre de voix, à proportion du cens qu'elles payoient.
Loi Sempronia de provinciis, régla que le sénat déféreroit le gouvernement des provinces.
Loi Sempronia de veste militari, ordonna que l'habit des soldats leur seroit donné gratuitement.
Loi Sempronia frumentaria, ordonne que le blé seroit distribué au peuple pour un certain prix.
Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sénat le pouvoir de juger, & le transmit aux chevaliers. Voyez Plutarque en la vie des Gracques.
Sur toutes ces lois en général, voyez Zazius & les auteurs qu'il cite. (A)
LOI SENILIA ; on en connoît trois de ce nom ; savoir la
Loi Senilia agraria. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.
Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Servilius Caepio, rendit au sénat le droit de participer aux jugemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé par la loi Sempronia.
Loi Senilia repetundarum, fut faite par C. Servilius Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient commis des concussions dans la guerre d'Asie. Voyez Zazius. (A)
LOI SIMPLE. Voyez ci-devant LOI APERTE.
LOIS SOMPTUAIRES, sont celles qui ont pour objet de reprimer le luxe, soit dans la table ou dans les habits, ameublemens, équipages, &c.
Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires pour reprimer l'excès du vivre & des habits. Il ordonna le partage égal des terres, défendit l'usage de la monnoie d'or & d'argent.
Chez les Romains ce fut le tribun Orchius qui fit la premiere loi somptuaire ; elle fut appellée de son nom Orchia, de même que les suivantes prirent le nom de leur auteur ; elle régloit le nombre des convives, mais elle ne fixa point la dépense. Elle défendit seulement de manger les portes ouvertes, afin que l'on ne fît point de superfluités par ostentation : il est parlé de cette loi dans Aulugelle, lib. II. c. xxiv. & dans Macrobe, l. II. c. xxviij.
Cette loi défendoit aussi à toutes les femmes, sans distinction de conditions, de porter des habits d'étoffes de différentes couleurs, & des ornemens qui excédassent le poids d'une demi-once. Elle leur défendoit pareillement d'aller en carrosse, à moins que ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou pour un voyage éloigné au-moins d'une demi-lieue de la ville, ou du bourg de leur demeure.
Les dames romaines murmurerent de cette loi, & vingt ans après l'affaire fut mise en délibération dans les comices ou assemblées générales. Les tribuns demanderent que la liberté fût rétablie ; Caton fut d'avis contraire, & parla fortement en faveur de la loi ; mais l'avis des tribuns prévalut, & la loi Appia fut révoquée.
Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Romains furent de retour de leurs expéditions en Asie ; ce qui engagea Jules-Cesar, lorsqu'il fut parvenu à l'empire, à donner un édit, par lequel il défendit l'usage des habits de pourpre & de perles, à l'exception des personnes d'une certaine qualité, auxquelles il permit d'en porter les jours de cérémonie seulement. Il défendit aussi de se faire porter en litiere, dont la coûtume avoit été apportée d'Asie.
Auguste voulut reprimer le luxe des habits, mais trouva tant de résistance, qu'il se réduisit à défendre de paroître au barreau ou au cirque sans habit long.
Tibere défendit aux hommes l'usage des habits de soie.
Néron défendit à toutes personnes l'usage de la pourpre.
Alexandre Severe eut dessein de régler les habits selon les conditions ; mais Ulpien & Paul, deux de ses conseillers, l'en détournerent, lui observant que ces distinctions feroient beaucoup de mécontens ; que ce seroit une semence de jalousie & de division ; que les habits uniformes seroient un signal pour se connoître & s'assembler, ce qui étoit dangereux par rapport aux gens de certaines conditions, naturellement séditieux, tels que les esclaves. L'empereur se contenta donc d'établir quelque distinction entre les habits des sénateurs & ceux des chevaliers.
Le luxe croissant toujours malgré les précautions que l'on avoit prise pour le réprimer, les empereurs Valentinien & Valens défendirent en 367 à toutes personnes privées, hommes & femmes, de faire broder aucun vêtement ; les princes furent seuls exceptés de cette loi. Mais l'usage de la pourpre devint si commun, que les empereurs, pour arrêter cet abus, se réserverent à eux-seuls le droit d'envoyer à la pêche du poisson qui servoit à teindre la pourpre : ils firent faire cet ouvrage dans leur palais, & prirent des précautions pour empêcher que l'on n'en vendît de contrebande.
L'usage des étoffes d'or fut totalement interdit aux hommes par les empereurs Gratien, Valentinien & Théodose, à l'exception de ceux qui auroient obtenu permission d'en porter. Il arriva de-là que chacun prit l'habit militaire ; les sénateurs même affectoient de paroître en public dans cet habit. C'est pourquoi les mêmes empereurs ordonnerent aux sénateurs, greffiers & huissiers, lorsqu'ils alloient en quelqu'endroit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit de leur état ; & aux esclaves de ne porter d'autres habits que les chausses & la cape.
Les irruptions fréquentes que diverses nations firent dans l'empire sur la fin du iv. siécle, & au commencement du v. y ayant introduit plusieurs modes étrangeres, cela donna lieu de faire trois lois différentes, dans les années 397, 399 & 416, qui défendirent de porter dans les villes voisines de Rome & à Constantinople, & dans la province voisine, des cheveux longs, des hauts-de-chausse & des bottines de cuir, à peine contre les personnes libres, de bannissement & de confiscation de tous biens, & pour les esclaves, d'être condamnés aux ouvrages publics.
L'empereur Théodose défendit en 424, à toutes personnes sans exception, de porter des habits de soie, & des étoffes teintes en pourpre, ou mêlées de pourpre, soit vraie ou contrefaite : il défendit d'en receler sous peine d'être traité comme criminel de lése-majesté.
Le même prince & Honorius, défendirent, sous la même peine, de contrefaire la teinture de couleur de pourpre.
Enfin, la derniere loi romaine somptuaire qui est de l'empereur Léon en 460, défendit à toutes personnes d'enrichir de perles, d'émeraudes ou d'hyacinthes, leurs baudriers, le frein des brides, ou les selles de leurs chevaux. La loi permit seulement d'y employer toutes autres sortes de pierreries, excepté aux mords de brides ; les hommes pouvoient avoir des agraffes d'or à leurs casaques, mais sans autres ornemens, le tout sous peine d'une amende de 50 livres d'or.
La même loi défendit à toutes personnes, autres que ceux qui étoient employés par le prince dans son palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pierres précieuses, à l'exception des ornemens permis aux dames, & des anneaux que les hommes & les femmes avoient droit de porter. Ceux qui contrevenoient à cette partie de la loi, étoient condamnés en une amende de 100 livres d'or, & punis du dernier supplice.
En France, le luxe ne commença à paroître que sous Charlemagne, au retour de ses conquêtes d'Italie. L'exemple de la modestie qu'il donnoit à ses sujets n'étant pas assez fort pour les contenir, il fut obligé de faire une ordonnance en 808, qui défendit à toutes personnes de vendre ou acheter le meilleur sayon ou robe de dessous, plus cher que 20 sols pour le double, 10 sols le simple, & les autres à proportion, & le rochet qui étoit la robe de dessus, étant fourré de martre ou de loutre, 30 sols, & de peau de chat, 10 sols, le tout sous peine de 40 sols d'amende.
Il n'y eut point d'autres lois somptuaires en France jusqu'à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux bourgeois d'avoir des chars, & à tous bourgeois de porter aucune fourrure, or, ni pierres précieuses, & aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur chaperon, à moins qu'ils ne fussent constitués en dignité.
La quantité d'habits que chacun pouvoit avoir par an, est réglé par cette ordonnance ; savoir, pour les ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, & leurs femmes, quatre robes ; les prélats, deux robes, & une à leurs compagnons, & deux chapes par an ; les chevaliers de 3000 livres de rente, & les bannerets, trois paires de robes par an, y compris une robe pour l'été, & les autres personnes à proportion.
Il est défendu aux bourgeois, & même aux écuyers & aux clercs, s'ils ne sont constitués en dignité, de brûler des torches de cire.
Le prix des étoffes est réglé selon les conditions ; les plus cheres pour les prélats & les barons, sont de 25 sols l'aune, & pour les autres états à proportion.
Sous le même regne s'introduisit l'usage des souliers à la poulaine, qui étoient une espece de chaussure fort longue, & qui occasionnoit beaucoup de superfluités. L'église cria beaucoup contre cette mode ; elle fut même défendue par deux conciles, l'un tenu à Paris en 1212, l'autre à Angers en 1365, & enfin abolie par des lettres de Charles V. en 1368.
Les ouvrages d'orfévrerie au-dessus de 3 marcs, furent défendus par Louis XII. en 1506 ; cela fut néanmoins révoqué quatre ans après, sous prétexte que cela nuisoit au commerce.
Charles VIII. en 1485 défendit à tous ses sujets de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de soie, soit en robes ou doublures, à peine de confiscation des habits, & d'amende arbitraire. Il permit cependant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de se vêtir de toutes sortes d'étoffes de soie, & aux écuyers ayant pareil revenu, de se vêtir de damas ou satin figuré ; il leur défendit sous les mêmes peines le velours & autres étoffes de cette qualité.
Le luxe ne laissant pas de faire toujours des progrès, François I. par une déclaration de 1543, défendit à tous princes, seigneurs, gentilshommes, & autres sujets du roi, de quelque état qu'ils fussent, à l'exception des deux princes enfans de France, du dauphin & du duc d'Orléans, de se vêtir d'aucun drap, ou toile d'or ou d'argent, & de porter aucunes profilures, broderies, passemens d'or ou d'argent, velours, ou autres étoffes de soie barrées d'or ou d'argent, soit en robes, saies, pourpoints, chausses, bordure d'habillement, ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit, sinon sur les harnois, à peine de mille écus d'or d'amende, de confiscation, & d'être punis comme infracteurs des ordonnances. Il donna néanmoins trois mois à ceux qui avoient de ces habillemens, pour les porter ou pour s'en défaire.
Les mêmes défenses furent renouvellées par Henri II. en 1547, & étendues aux femmes, à l'exception des princesses & dames, & demoiselles qui étoient à la suite de la reine, & de madame soeur du roi.
Ce prince fut obligé de donner en 1549 une déclaration plus ample que la premiere ; l'or & l'argent furent de nouveau défendus sur les habits, excepté les boutons d'orfévrerie.
Les habits de soie cramoisi ne furent permis qu'aux princes & princesses.
Le velours fut défendu aux femmes de justice & des autres habitans des villes, & aux gens d'église, à moins qu'ils ne fussent princes.
Il ne fut permis qu'aux gentilshommes de porter saie sur soie.
On régla aussi la dorure que l'on pourroit mettre sur les harnois.
Il fut dit que les pages ne seroient habillés que de drap, avec une bande de broderie en soie ou velours.
Les bourgeoises ne devoient point prendre le titre de damoiselles, à moins que leurs maris ne fussent gentilshommes.
Enfin il fut défendu à tous artisans, & gens de pareil état ou au-dessous, de porter des habillemens de soie.
Il y eut des explications données sur plusieurs articles de cette déclaration, sur lesquels il y avoit des doutes.
L'article 145 de l'ordonnance d'Orléans, qui paroît être une suite des remontrances que les députés de la noblesse & du tiers-état avoient fait sur le luxe, défendit à tous les habitans des villes d'avoir des dorures sur du plomb, du fer, ou du bois, & de se servir des parfums des pays étrangers, à peine d'amende arbitraire, & de confiscation des marchandises.
Cette disposition qui étoit fort abrégée, fut étendue à tous les autres cas du luxe par des lettres patentes du 22 Avril 1561, qui reglent les habillemens selon les conditions.
Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution, fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier 1563, qui défendit encore de nouveaux abus qui s'étoient introduits, entr'autres de porter des vertugadins de plus d'une aune & demie de tour.
Cependant par une autre déclaration de 1565, le roi permit aux dames d'en porter à leur commodité, mais avec modestie.
Ceux qui n'avoient pas la liberté de porter de l'or & de l'argent, s'en dédommageoient en portant des étoffes de soie figurée, qui coûtoient aussi cher que les étoffes mêlées d'or ou d'argent, desorte qu'on fut obligé de défendre cette contravention.
Henri III. ordonna en 1576, que les lois somptuaires de ses prédécesseurs seroient exécutées : il en fit lui-même de nouvelles en 1577, & 1583.
Il y en eut de semblables sous Henri IV. en 1599, 1601 & 1606.
Louis XIII. en fit aussi plusieurs en 1613, 1633, 1634, 1636 & 1640.
Louis XIV. prit aussi grand soin de réformer le luxe des meubles, habits, & des équipages, comme il paroît par ses ordonnances, édits & déclarations de 1644, 1656, 1660, 1661, 1663, 1664, 1667, 1672, 1687, 1689, 1700, 1704.
La multiplicité de ces lois, fait voir combien on a eu de peine à les faire observer.
Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la table, il y en eut chez les Lacédémoniens, & chez les Athéniens. Les premiers étoient obligés de manger ensemble tous les jours à frais communs ; les rables étoient pour quinze personnes ; les autres mangeoient aussi ensemble tour à tour dans le prytanée, mais aux dépens du public.
Chez les Romains, après la seconde guerre punique, les tables étant devenues trop nombreuses, le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne seroit pas de plus de neuf.
Quelque tems après le sénat défendit à tous magistrats & principaux citoyens de dépenser plus de 120 sols pour chaque repas qui se donneroient après les jeux mégalésiens, & d'y servir d'autre vin que celui du pays.
Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les festins, & la loi fut appellée de son nom Fannia. Il fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, & plus de cinq les jours des nones ou des foires. La dépense fut fixée à cent sols par repas, les jours de jeux & fêtes publiques ; 30 sols, les jours des nones ou des foires, & 10 sols les autres jours. Il fut défendu de servir des volailles engraissées, parce que cette préparation coûtoit beaucoup.
La loi Didia, en renouvellant les défenses précédentes, ajoûta que non-seulement ceux qui inviteroient, mais encore ceux qui se trouveroient à un repas contraire aux lois, seroient punis comme prévaricateurs.
La dépense des repas fut encore réglée selon les jours & les occasions, par la loi Licinia. Mais comme elle permettoit de servir à discrétion tout ce que la terre produisoit, on inventa des ragoûts de légumes si délicats, que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres & aux lamproies qu'il aimoit beaucoup.
La loi Cornelia renouvella toutes les précédentes, & régla le prix des vivres.
Jules César fit aussi une loi somptuaire ; mais tout ce que l'on en sait, est qu'il établit des gardes dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit exposé en contravention, & des huissiers qui avoient ordre de saisir jusque sur les tables, ce qui étoit échappé à ces gardes.
Auguste mitigea les lois somptuaires, dans l'espérance qu'elles seroient mieux observées. Il permit de s'assembler jusqu'à douze ; d'employer aux repas des jours ordinaires 200 sols ; à ceux des calendes, ides, nones, & autres fêtes 300 ; & aux jours des noces & du lendemain, jusqu'à 1000 sesterces.
Tibere permit de dépenser depuis 300 sesterces jusqu'à 2000, selon les différentes solemnités.
Le luxe des tables augmenta encore sous Caligula, Claude & Néron. Les lois somptuaires étoient si mal observées que l'on cessa d'en faire.
En France, les capitulaires de la deuxieme race, & les ordonnances de S. Louis, défendent l'ébriété, ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe.
Philippe le Bel, par un édit de l'an 1294, défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets & un potage au lard ; & dans un repas ordinaire, un mets & un entre-mets. Il permit les jours de jeûne seulement de servir deux potages aux harengs, & deux mets, ou un seul potage & trois mets. Il défendit de servir dans un plat plus d'une piece de viande, ou d'une seule sorte de poisson ; enfin il déclara que toute grosse viande seroit comptée pour un mets, & que le fromage ne passeroit pas pour un mets, s'il n'étoit en pâte ou cuit dans l'eau.
François I. fit un édit contre l'ivrognerie ; du reste il ne régla rien pour la table.
Mais par un édit du 20 Janvier 1563, Charles IX. mit un taux aux vivres, & régla les repas. Il porte qu'en quelques noces, festins ou tables particulieres que ce soit, il n'y aura que trois services ; savoir, les entrées, la viande ou le poisson, & le dessert ; qu'en toute sorte d'entrées, soit en potage, fricassée ou patisserie, il n'y aura au plus que six plats, & autant pour la viande ou le poisson, & dans chaque plat une seule sorte de viande ; que ces viandes ne seront point mises doubles, comme deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un plat ; que l'on pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, les grives, becassines, & autres oiseaux semblables, jusqu'à quatre, & les alouettes & autres especes semblables, jusqu'à une douzaine ; qu'au dessert, soit fruits, patisserie, fromage ou autre chose, il ne pourra non plus être servi que six plats, le tout sous peine de 200 livres d'amende pour la premiere fois, & 400 livres pour la seconde.
Il ordonne que ceux qui se trouveront à un festin où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans le jour, à peine de 40 livres d'amende ; & si ce sont des officiers de justice qui se trouvent à de pareils festins, qu'ils ayent à se retirer aussi-tôt, & procéder contre les contrevenans.
Que les cuisiniers qui auroient servi à ces repas, seront condamnés pour la premiere fois en 10 livres d'amende, à tenir prison 15 ans au pain & à l'eau ; pour la seconde fois, au double de l'amende & du tems de la prison, & pour la troisieme, au quadruple, au fouet & au bannissement du lieu.
Enfin il défend de servir chair & poisson en un même repas.
La disette qui se fit sentir en 1573, donna lieu à une déclaration du 20 Octobre, par laquelle le roi mande aux gens tenans la police générale de Paris, que pour faire cesser les grandes & excessives dépenses qui se faisoient en habits & en festins, ils fissent de nouveau publier & garder inviolablement toutes ses ordonnances somptuaires ; & afin que l'on pût être averti des contraventions qui se commettroient à cet égard, que les commissaires de Paris pourroient aller & assister aux banquets qui se feroient. Une autre déclaration du 18 Novembre suivant, enjoignit aux commissaires du châtelet & juges des lieux, chacun en droit soi, de faire les perquisitions nécessaires pour la découverte des contraventions.
La ville de Paris étant bloquée en 1591, les magistrats dans une assemblée générale de police, rendirent une ordonnance portant défense de faire aucuns festins ou banquets en salles publiques, soit pour nôces ou autrement, jusqu'à ce que par justice il en eût été autrement ordonné ; & à l'égard des maisons particulieres, il fut défendu d'y traiter plus de douze personnes.
La derniere loi touchant les repas, est l'ordonnance de 1629, dont quelques articles concernent la réformation du luxe des tables. Il y est dit qu'il n'y aura que trois services d'un simple rang chacun, & de six pieces au plus dans chaque plat. Tous les repas de réception sont abolis ; enfin il est défendu aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête, pour les nôces & festins.
Il seroit à souhaiter que toutes ces lois somptuaires fussent observées pour reprimer le luxe, tant des tables, que celui des meubles, habits & équipages. Voyez le traité de la police de la Marre, tom. I. liv. III. tit. 2. (A)
LOIS SULPITIENNES, leges Sulpitiae, furent l'ouvrage de P. Sulpitius, homme qui fut d'abord cher à tous les gens de bien, & célebre par son éloquence ; mais étant devenu tribun du peuple, l'ambition & l'esprit de parti l'aveuglerent tellement, qu'il perdit l'estime des grands, & que son éloquence même lui devint pernicieuse par le mauvais usage qu'il en fit. Lorsque César voulut de la place d'édile s'élever à celle de consul sans passer par la préture, ce qui étoit défendu par les lois annales, Sulpitius s'y opposa comme les autres tribuns du peuple ; il le fit d'abord avec modération, mais bientôt il en vint aux armes ; il fit quelques lois, une entr'autres contre le sénat, portant qu'un sénateur ne pouvoit emprunter plus de 2000 drachmes ; une autre loi, pour rappeller les exilés ; une portant que les affranchis & nouveaux citoyens seroient distribués dans les tribus ; la derniere loi fut pour destituer Sylla du commandement que le sénat lui avoit décerné pour la guerre contre Mithridate : cette loi fut une des causes de la guerre civile qui s'éleva, Sylla disant publiquement qu'il n'étoit pas tenu de se soumettre aux lois de Sulpitius, qui n'avoient été établies que par force ; & s'étant mis à la tête de l'armée, il prit Capoue, chassa Marius son compétiteur, tua Sulpitius, & révoqua tous ses décrets. Voyez Cicéron, Philipp. VIII. & de resp. arusp. Appien. lib. I. Florus, &c.
LOIS TABELLAIRES étoient celles qui autoriserent à donner les suffrages sur des tablettes enduites de cire, dans laquelle on marquoit un point pour exprimer son avis.
Le peuple romain donnoit d'abord son avis de vive voix, soit pour le choix des magistrats, soit pour le jugement des coupables, soit pour la formation ou abrogation des lois.
Mais comme cette maniere d'opiner exposoit le peuple au ressentiment des grands, cela fit que l'on donna au peuple une table ou tablette pour marquer les suffrages comme on vient de le dire.
Il y eut quatre différentes lois surnommées tabellaires, parce qu'elles établirent ou confirmerent cette maniere d'opiner.
La premiere fut la loi Gabinia, promulguée sous le consulat de Calphurnius Pison & de Popilius Laenas, par Gabinius, homme de néant & peu connu ; elle portoit que dans les comices où les magistrats seroient élus, le peuple n'opineroit point de vive voix, mais donneroit son suffrage sur une tablette ; & afin qu'il y eût plus de liberté, il fut défendu de regarder cette tablette, ni de prier ou appeller quelqu'un pour donner son suffrage.
Deux ans après vint une seconde loi tabellaire, appellée Cassia, de L. Cassius qui la proposa : celui-ci étoit de la famille patricienne ; il fit ordonner que, dans le jugement des accusés, on opineroit de même que pour l'élection des magistrats : cette loi passa contre l'avis de tous les gens de bien, pour prévenir jusqu'au moindre bruit que le peuple faisoit courir.
La troisieme loi tabellaire fut la loi Papiria, que proposa Carbon, homme séditieux & méchant, pour étendre l'usage des tablettes aux délibérations qui concernoient la démission ou reprobation des lois.
Cassius ayant excepté de sa loi le crime de trahison contre l'état, cela donna lieu à Caelius de faire une quatrieme loi tabellaire, appellée de son nom Caelia, par laquelle l'usage des tablettes fut aussi admis dans cette matiere, au moyen de quoi tout suffrage de vive voix fut aboli.
Dans la suite, le droit de suffrage & de créer des magistrats ayant été ôté au peuple, soit par Jules César, ou selon d'autres, par Tibere, & transféré au sénat, celui-ci qui usoit comme auparavant des suffrages vocaux, changea de maniere du tems de Trajan, & se servit aussi des tablettes pour l'élection des magistrats ; avec cette différence néanmoins que dans ces tablettes les sénateurs ne marquoient pas des points, mais les noms même des candidats. Cette méthode ne dura pas non plus long-tems dans le sénat, à cause de l'impudence & de la pétulance de quelques-uns. Pline, lib. IV. epist. & V. ad Maximum ; voyez aussi Zazius.
LOI DES DOUZE TABLES, est celle qui fut faite pour les Romains par les décemvirs.
Les lois faites par les rois de Rome & par les premiers consuls, n'ayant pas pourvu à tout & n'étant pas suffisantes pour en composer un corps de lois, on envoya trois députés à Athenes & dans d'autres villes grecques, pour y recueillir ce qu'il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de plusieurs autres législateurs. On nomma dix personnes qu'on appella les décemvirs, pour en composer un corps de lois ; ils y joignirent plusieurs dispositions tirées des usages non écrits des Romains.
A peine la premiere année du décemvirat étoit finie, que chacun des décemvirs présenta au peuple la portion des lois dont la rédaction lui avoit été confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudissement ; on les fit d'abord graver sur des tables de chêne, & non pas d'ivoire, comme quelques-uns ont cru. Chacun eut la liberté de proposer ses réflexions ; & cette critique ayant produit plusieurs changemens & augmentations, le sénat s'assembla pour examiner de nouveau ces lois, &, après que tous les ordres furent demeurés d'accord de les accepter, le sénat les approuva par un arrêt ; & pour les faire recevoir dans les comices assemblés par centuries, on ordonna des comices pendant trois jours de marché : & enfin les dix tables ayant été reçues solemnellement par le peuple, on les grava sur des colonnes d'airain, arrangées par ordre dans la place publique, & elles servirent de fondement à toutes les décisions.
Depuis que ces dix tables furent ainsi exposées en public, on trouva qu'il y manquoit beaucoup de choses nécessaires à la religion & à la société ; on résolut d'y suppléer par deux autres tables, & les décemvirs prirent de-là occasion de prolonger encore leur administration pendant une troisieme année ; les onzieme & douzieme tables furent donc présentées au peuple, aux ides de Mai de l'année suivante ; on les grava pareillement sur des tables d'airain que l'on mit à côté des premieres. Et Diodore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un des éperons de navire, dont le frontispice du sénat étoit orné.
Ces premieres tables furent consumées peu de tems après dans l'incendie de Rome par les Gaulois, mais elles furent rétablies, tant sur les fragmens qui en restoient, que sur les copies qui en avoient été tirées ; & pour en mieux conserver la teneur, on les fit apprendre par coeur aux enfans. Rittershusius, dans ses commentaires sur cette loi, prétend que les douze tables périrent encore lors de l'irruption des Goths. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien, puisqu'on lit dans le digeste que Caïus les avoit toutes commentées, & en avoit rapporté tous les textes, dont la plus grande partie se trouve aujourd'hui perdue ; & il y a apparence que ce fut du tems de Justinien que les exemplaires de cette loi furent détruits, de même que les livres des jurisconsultes dont il composa le digeste.
Plusieurs auteurs ont travaillé à rassembler dans les écrivains de l'ancienne Rome les fragmens de la loi des douze tables, dont il nous reste encore cent cinq lois ; les unes, dont le texte s'est conservé en partie ; les autres, dont on ne sait que la substance.
Suivant les différentes inductions que l'on a tiré des auteurs qui ont parlé de cette loi, on tient que la premiere table traitoit des procédures civiles ; la seconde, des jugemens & des vols, la troisieme, des dettes ; la quatrieme, de la puissance paternelle ; la cinquieme, des successions & des tuteles ; la sixieme, de la possession des biens & du divorce ; la septieme, des crimes ; la huitieme, des métiers, des biens de ville & de campagne, & des servitudes ; la neuvieme, du droit public ; la dixieme des cérémonies funebres ; les onzieme & douzieme, servant de supplément aux dix autres, traitoient de diverses matieres.
Pour donner une idée de l'esprit de cette loi, nous remarquerons que quand le débiteur refusoit de payer ou de donner caution, le créancier pouvoit l'emmener chez lui, le lier par le col, lui mettre les fers aux piés, pourvu que la chaîne ne pesât que 15 livres : & quand le débiteur étoit insolvable à plusieurs créanciers, ils pouvoient l'exposer pendant trois jours de marché, & après le troisieme jour, mettre son corps en pieces, & le partager en plus ou moins de parties, ou bien le vendre à des étrangers.
Un pere auquel il naissoit un enfant difforme, devoit le tuer aussi-tôt. Il avoit en général le droit de vie & de mort sur ses enfans, & pouvoit les vendre quand il vouloit : quand le fils avoit été vendu trois fois, il cessoit d'être sous la puissance paternelle.
Il est dit que quand une femme libre avoit demeuré pendant un an entier dans la maison d'un homme, sans s'être absentée pendant trois nuits, elle étoit réputée son épouse, par l'usage & la cohabitation seulement.
La loi prononce des peines contre ceux que l'on disoit jetter des sorts sur les moissons, ou qui se servoient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un.
Le latin de la loi des douze tables est aussi barbare que le sont la plûpart de ses dispositions.
Au surplus, on y découvre l'origine de plusieurs usages qui ont passé de cette loi dans les livres de Justinien, & qui sont observés parmi nous, en quoi les fragmens de cette loi ne laissent pas d'être curieux & utiles. Voyez le commentaire de Rittershusius, les trois dissertations de M. Bonamy, & le commentaire de M. Terrasson inséré dans son hist. de la jurisprud. rom.
LOI DU TALION est celle qui veut que l'on inflige au coupable une peine toute semblable au mal qu'il a fait à un autre ; c'est ce que l'on appelle aussi la peine du talion.
Cette loi est une des plus anciennes, puisqu'elle tire son origine des lois des Hébreux. Il est dit en la Genese, chap. ix. v. 6. " qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera répandu " ; & dans l'Exode, chap. xxj. en parlant de celui qui a maltraité un autre, il est dit qu'il " rendra vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pié pour pié, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure " ; & dans le Lévitique, chap. xxiv. il est dit pareillement " que celui qui aura frappé & occis un homme, mourra de mort ; que celui qui aura occis la bête, rendra le pareil ", c'est-à-dire bête pour bête ; que quand quelqu'un aura fait outrage à un de ses parens, il lui sera fait de même, fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent, &c.
Il paroît que les Grecs adopterent cette loi ; car, selon les lois de Solon, la peine du talion avoit lieu contre celui qui avoit arraché le second oeil à un homme qui étoit déja privé de l'usage du premier, & le coupable étoit condamné à perdre les deux yeux.
Entre les lois que les Romains emprunterent des Grecs, & dont ils formerent une espece de code, que l'on appella la loi des douze tables, fut comprise la loi du talion ; il étoit dit que tout homme qui auroit rendu un autre impotent d'un membre, seroit puni par la loi du talion, s'il ne faisoit pas un accommodement avec sa partie.
La loi du talion fut encore en usage long-tems après les douze tables ; car Caton, cité par Priscien, liv. VI. parloit encore de son tems de la loi du talion, comme d'une loi qui étoit actuellement en vigueur, & qui donnoit même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance : talione proximus cognatus ulciscitur.
La loi des douze tables n'étendoit pas ainsi le droit de vengeance jusqu'au cousin du lésé ; ce qui a fait croire à quelques-uns que Caton avoit parlé de la loi du talion relativement à quelque autre peuple.
Il n'y a même pas d'apparence que la loi du talion ait guere eu lieu chez les Romains, le coupable ayant le choix de racheter la peine en argent ; elle n'auroit pû avoir lieu qu'à l'égard des misérables qui n'avoient pas le moyen de se racheter, encore n'en trouve-t-on pas d'exemple ; & il y a lieu de penser que, dans les tems polis de Rome, on n'a jamais mis en usage cette loi.
Il est du-moins certain que long-tems avant Justinien, la loi du talion étoit abolie, puisque le droit du préteur, appellé jus honorarium, avoit établi que les personnes lésées feroient procéder à l'estimation du mal par-devant le juge ; c'est ce que nous apprend Justinien dans ses institutes, liv. IV. tit. IV. où il dit que, suivant la loi des douze tables, la peine pour un membre rompu étoit le talion, que pour un os cassé il y avoit une peine pécuniaire ; cela fait voir que le talion n'avoit pas lieu dans tous les cas. Justinien ajoute que la peine des injures introduite par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, qu'on pratique dans les jugemens celles que les préteurs ont introduites.
Jesus-Christ, dans saint Matthieu, chap. v. condamne la loi du talion : " Vous avez entendu, dit-il, que l'on vous a dit, oeil pour oeil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point vous défendre du mal qu'on veut vous faire, & si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez lui la gauche ". Cette loi qui enseigne le pardon des injures est une doctrine bien plus pure que celle du talion.
Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la loi du talion comme une loi barbare, contraire au droit naturel. Grotius, de jure belli & pacis, l. III. c. ij. dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d'un peuple à un autre : il tire sa décision de ces belles paroles d'Aristide : " Ne seroit-il pas absurde de justifier & d'imiter ce que l'on condamne en autrui comme une mauvaise action " ?
Il faut cependant convenir que le droit de représailles, dont on use en tems de guerre envers les ennemis, approche beaucoup de la loi du talion. Voyez le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IV. Aulu-Gell. l. XX. c. j. institut. de injur. §. 7. Jurisprud. rom. de Terrasson, part. II. §. 9.
LOI TARPEIA, Voyez ci-devant LOI ATERINA.
LOI TERENTIA & CASSIA, fut une des lois frumentaires ; elle fut faite sous le consulat de M. Terentius & de Cassius Varus ; elle ordonna que l'on acheteroit du blé pour le distribuer au peuple dans les tems de disette, ce qui devint très-préjudiciable à la république. Le blé de Sicile devoit être distribué également à toutes les villes ; mais Verrès, gouverneur de cette province, fut plus occupé de son intérêt particulier que de celui du public, comme Cicéron le lui reproche.
LOI TERENTILLA, fut faite par Terentius Arsa, tribun du peuple, à l'occasion des mécontentemens du peuple romain qui se plaignoit de ce qu'il n'y avoit aucun droit certain, & que le sénat jugeoit tout arbitrairement ; elle ordonnoit que le peuple, après avoir assemblé légitimement des comices, choisiroit dix hommes d'un âge mûr, d'une sagesse consommée, & d'une réputation saine pour composer un corps de lois, tant pour l'administration publique que pour la décision des affaires particulieres, & que ces lois seroient affichées dans la place publique, afin que chacun pût en dire son avis. Cette loi excita de nouvelles divisions entre le sénat & le peuple ; enfin après cinq années de contestations au sujet de l'acceptation de la loi Terentilla, les plébéïens l'emporterent ; & ce qui est de singulier, c'est que ce fut Romilius, homme consulaire, qui poursuivit l'exécution de la loi Terentilla. On envoya donc trois députés en Grece pour y rassembler les meilleures lois, dont les décemvirs formerent ensuite la loi des 12 tables. Voyez le catalogue de Zazius & ci-devant au mot LOI DES DOUZE TABLES. (A)
LOIS TESTAMENTAIRES, on appelle ainsi les lois romaines qui concernent la matiere & la forme des testamens.
LOIS THEATRALES chez les Romains étoient celles qui regloient les places que chacun devoit occuper au théâtre & dans les jeux publics, selon son rang & sa condition.
La premiere loi qui regla ainsi les places ne fut faite par Valere que 656 ans après la fondation de Rome ; jusques-là personne ne s'étoit avisé de prendre place devant les sénateurs. Cependant, au rapport de Tite-Live, le peuple s'offensa de cette loi ; & lorsque Roscius eut fait faire la loi qui donna rang à part aux chevaliers dans le théâtre, ce qui arriva sous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâtre une grande sédition que Cicéron appaisa promtement par son éloquence, dont Plutarque le loue grandement. Auguste fit aussi quelques années après une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Voyez Tite Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c. j. n. 29.
LOI THORIA AGRARIA, fut faite par le tribun Sp. Thorius, lequel déchargea les terres du fisc de toute redevance, au moyen de quoi le peuple fut privé de ce revenu qu'on lui distribuoit auparavant. Voyez LOIS AGRAIRES.
LOI TITIA, il y en a eu plusieurs de ce nom, savoir la
Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires, faite par Sextus Titius. Voyez Valere Maxime.
Loi Titia de donis & muneribus, défendoit de rien recevoir pour plaider une cause. Voyez Tacite, liv. VI. Quelques-uns croient que c'est la même que la loi Cincia ; cependant Ausone en fait mention. Voyez Zazius.
Loi Titia & Cornelia, défendit de jouer de l'argent à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice dont l'adresse, le courage ou la vertu fissent l'objet ; il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de Meatoribus.
Loi Titia de provinciis quaestoris, regla le pouvoir des questeurs dans les provinces où ils étoient envoyés.
Loi Titia de vocatione consulatus, fut faite par P. Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour ordonner que le consulat finiroit au bout de cinq ans. Voyez Appien, liv. IV. Sur toutes ces lois, voyez Zazius. (A)
LOI TRIBUNITIA PRIMA, étoit celle par laquelle le senat de Rome consentit, en faveur du peuple, à la création de cinq tribuns dont la personne seroit sacrée, c'est pourquoi cette loi fut nommée sacrata ; il étoit défendu de rien attenter sur leur personne. Elle fut surnommée prima, parce qu'il y eut dans la suite d'autres lois faites en faveur des tribuns, entr'autres celle qui défendoit de les interrompre lorsqu'ils haranguoient le peuple. La loi Tribunitia défendoit aussi de consacrer une maison ou un autel sans la permission du peuple. Voyez Fulvius Ursinus dans ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, & la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. 75.
LOIS TRIBUNITIENNES, c'étoient les plébiscites qui étoient proposés par les tribuns & faits de l'autorité du peuple.
LOI TULLIA, DE AMBITU, fut faite sous le consulat de M. Tullius Cicéron ; c'étoit un senatus-consulte, portant que celui qui aspireroit à la magistrature ne pourroit, dans les deux années qui précéderoient son élévation, donner au peuple des jeux ni des repas, ni se faire précéder ou accompagner de gens gagés, sous peine d'exil. Voyez Cicéron, pro Murena.
LOI VALERIA ; on en connoît plusieurs de ce nom, savoir la
Loi Valeria faite par M. Valerius, consul, collegue d'Apuleius ; elle défendoit de condamner à mort un citoyen romain, même de le faire battre de verges.
Loi Valeria de provocatione, étoit de P. Valerius, surnommé Publicola, lequel pendant son consulat fit plusieurs réglemens utiles à la république & favorables à la liberté du peuple ; une de ces lois entre autres fut que l'on pouvoit appeller de tous les magistrats au peuple.
Le même Valerius fit encore d'autres lois, portant que personne n'auroit de commandement à Rome, à moins qu'il ne lui eût été déféré par le peuple ; que l'on consacreroit aux dieux la personne & les biens de celui qui auroit conspiré contre l'état : il déchargea aussi le menu peuple des impôts, pensant que de telles gens sont assez chargés de leur famille qu'ils ont à élever.
Loi Valeria de aere alieno, étoit de Valerius Flaccus, lequel succéda, pour le consulat, à Marius ; elle autorisoit les débiteurs à ne payer que le quart de ce qu'ils devoient. Ce Valerius fit une fin digne de son injustice ; car il fut tué dans une sédition excitée par les troupes d'Asie où il commandoit. Voyez Zazius.
Loi Valeria, de proscriptione, étoit de L. Valerius Flaccus ; il ordonna que Sylla seroit créé dictateur, & qu'il auroit droit de vie & de mort sur tous les citoyens. Voyez aussi Zazius. (A)
LOI VARIA, ainsi nommée de Qu. Varius tribun du peuple, ordonna d'informer contre ceux par le fait ou conseil desquels les alliés auroient pris les armes contre les Romains. Voyez Zazius.
LOI VATINIA, fut faite par Vatinius pour déférer à César le gouvernement des Gaules & de l'Illyrie avec le commandement de dix légions pendant cinq ans. Voyez l'Oraison de Cicéron contre Vatinius.
LOI VIAIRE, lex viaria, faite par Curion, tribun du peuple, par laquelle il se fit attribuer l'inspection & la police des chemins. Appian, liv. II.
LOI VISCELLIA ou VISELLIA, défendit aux affranchis d'aspirer aux charges qui étoient destinées aux ingénus ou personnes de condition libre ; mais cette loi fut abrogée lorsqu'on supprima la distinction des affranchis & des ingénus. Voyez Bugnion, des lois abrogées, liv. I. n. 190.
LOI VOCONIA, faite par le tribun Voconius, contenoit plusieurs dispositions dont l'objet étoit de limiter la faculté de léguer par testament.
L'une défendoit à un homme riche de cent mille sesterces, de laisser à des étrangers plus qu'il ne laissoit à son héritier. Un autre chapitre de cette loi excluoit toutes les femmes & filles de pouvoir être instituées héritieres, & d'autres disent que les soeurs étoient exceptées ; d'autres encore prétendent qu'il n'y avoit que la femme & la fille unique du testateur qui étoient comprises dans la prohibition ; d'autres enfin soutiennent que la loi défendoit seulement de léguer à sa femme plus du quart de son bien.
L'exclusion des filles fut dans la suite révoquée par Justinien, mais elle continua d'avoir lieu pour les successions qui ne venoient pas de la famille.
Le jurisconsulte Paulus fait mention que cette loi défendoit aussi d'acquérir par usucapion des servitudes. Voyez la Dissertation de Perizonius sur la loi Voconia. (A)
LOI DU VICOMTE, c'est le droit & l'usance du vicomte ; il en est parlé dans la coutume de Boulenois, art. 180, & dans celle de Monstreuil, art. 1.
LOI VILLAINE, lex villana, c'est le nom qu'on donnoit autrefois aux lois des villageois ou plutôt aux lois qui concernoient les gens de la campagne.
LOI VOLERONIA, fut faite par P. Volero, tribun du peuple ; elle portoit que les magistrats plébéïens seroient nommés dans les comices assemblés par tribus, dans lesquelles assemblées on ne s'arrêtoit point aux auspices, & l'autorité du sénat n'étoit point nécessaire ; cela arriva sous le consulat de T. Quintius & d'Appius Claudius. Voyez le catalogue de Zazius.
LOI DES WISIGOTHS. Voyez ci-devant LOI GOTHIQUE. (A)
LOI, à la monnoie, exprime la bonté intérieure des especes. Il n'y a que les ouvriers qui se servent de ce mot. Voyez TITRE, ALOI.
|
| LOIBEIA | (Antiq. grecq.) , ce mot manque dans nos meilleurs lexicographes : c'étoient de petits vases avec lesquels on faisoit les libations, & que l'on appelloit autrement . Voyez LIBATION. (D.J.)
|
| LOIMIEN | (Littér.) surnom d'Apollon sous lequel les Lindiens l'honoroient, comme le dieu de la Medecine, qui pouvoit guérir les malade attaqués de la peste, & la chasser du pays ; car en grec veut dire la peste. (D.J.)
|
| LOING | LE, (Géog.) riviere de France ; elle a sa source en Puysaye, sur les confins de la Bourgogne, passe à Châtillon, Montargis, Nemours, Moret, & se rend dans la Seine. Son nom en latin est Lupa ou Lupia. (D.J.)
|
| LOINTAIN | en Peinture, sont les parties d'un tableau qui paroissent les plus éloignées de l'oeil. Les lointains sont ordinairement bleuâtres, à cause de l'interposition de l'air qui est entr'eux & l'oeil. Ils conservent leur couleur naturelle à proportion qu'ils en sont proches, & sont plus ou moins brillans, selon que le ciel est plus ou moins serein. On dit, ces objets fuient bien, il semble qu'on entre dans le tableau, qu'il y a dix lieues du devant au lointain.
|
| LOIR | glis, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) rat dormeur qui se trouve dans les bois comme l'écureuil, & qui lui ressemble beaucoup par la forme du corps, surtout par la queue, qui est garnie de longs poils d'un bout à l'autre. Cependant le loir est beaucoup plus petit que l'écureuil ; il a la tête & le museau moins larges que l'écureuil, les yeux plus petits & moins saillans, les oreilles moins longues, plus minces, & presque nues ; les jambes & les piés plus petits, & les poils de la queue moins longs. Il y a des différences très-apparentes dans les couleurs du poil de ces deux animaux ; les yeux du loir sont bordés de noir : la face supérieure de cet animal, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrêmité de la queue, est d'une couleur grise, mêlée de noir & argentée : la face inférieure a une couleur blanche légerement teinte de fauve en quelques endroits, & argentée sur quelques poils. Le milieu de la face supérieure du poignet & du métatarse est noirâtre.
Le loir se nourrit, comme l'écureuil, de farine, de noisettes, de châtaignes, & d'autres fruits sauvages ; il mange aussi de petits oiseaux dans leurs nids. Il se fait un lit de mousse dans les creux des arbres ou dans les fentes des rochers élevés. Le mâle & la femelle s'accouplent sur la fin du printems ; les petits naissent en été : il y en a quatre ou cinq à chaque portée. On assure que les loirs ne vivent que six ans : ils faisoient partie de la bonne-chere chez les Romains ; on en mange encore en Italie. Pour en avoir on fait des fosses dans un lieu sec, à l'abri d'un rocher, au milieu d'une forêt : on tapisse de mousse ces fosses, on les recouvre de paille, les loirs s'y retirent, & on les y trouve endormis vers la fin de l'automne. En France, la chair de cet animal n'est guere meilleure que celle du rat d'eau. Les loirs sont courageux, ils mordent violemment : ils ne craignent ni la belette ni les petits oiseaux de proie : ils évitent le renard en grimpant au sommet des arbres ; mais ils deviennent la proie du chat sauvage & de la marte. On ne dit pas qu'il y ait des loirs dans les climats très-froids ou très-chauds, mais seulement dans les pays tempérés & couverts de bois. On en trouve en Espagne, en France, en Grece, en Italie, en Allemagne, en Suisse, &c. Voyez l'hist. nat. génér. & particul. tome VIII. Voyez RAT DORMEUR, quadrupede.
LOIR, le, Lidericus, (Géogr.) riviere de France qui prend sa source dans le Perche, passe à Illiers, à Chateaudun, à Claye, à Vendôme, à Montoire, à la Fleche, à Duretal, & se perd dans la Sarte à Briolé, une demi-lieue au-dessus de l'île de S. Aubin.
|
| LOIRE | LA, (Géogr.) grande riviere de France. Elle prend sa source dans le Vivarais au mont Gerbier-le-joux, sur les confins du Velai, coule dans le Forès, le Bourbonnois, le Nivernois, cotoie le Berry, qu'elle sépare de l'Orléanois, arrose Gien & Orléans ; ensuite se tournant vers le sud-ouest, elle passe à Beaugency, à Blois, à Tours, puis vient à Saumur, sort de l'Anjou, entre dans la Bretagne, baigne Nantes ; & élargissant son lit, qui est semé d'îles, elle se perd dans l'Océan entre le Croisic & Bourgneuf.
Un poëte anglois a peint avec élegance les ravages que cause la Loire dans ses débordemens : je vais transcrire son tableau en faveur des lecteurs sensibles à la poésie de cette langue.
When this french river raisd' with sudden rains,
Or snows dissolvd, o'erflows the adjoi'ning plains,
The husbandmen with high rais'd banks secure
Their greedy hopes ; and this he can endure :
But if with bays, and dams, they strive to force
His channel, to a new or narrow'r course,
No longer then within his banks he dwells,
First to a torrent, then a deluge swells ;
Stronger and fiercer by restraints he roas,
And knows no bound, but makes his pow'r his shores.
Je voudrois bien que quelque bon françois nous peignît aussi le débordement excessis des droits honteux qu'on exerce sur cette riviere, sous prétexte de maintenir sa navigation, mais en réalité pour ruiner le commerce. On compte au-moins une trentaine de divers péages qui s'y sont introduits, indépendamment desquels on paie une imposition assez bien nommée le trépas de Loire, ainsi que les droits de simple, double, triple cloison, établis anciennement pour l'entretien des fortifications de la ville d'Angers. On n'en peut guere voir de plus cheres ni de plus mauvaises, à ce qu'assure un homme éclairé.
Le droit de boëte des marchands fréquentant la Loire, a été établi solemnellement à Orléans pour le balisage & le curage de la riviere, dont on ne prend aucun soin, malgré les éloges de ce curage, par le sieur Piganiol de la Force, mais en revanche, dit avec plus de vérité l'auteur estimable des recherches sur les finances, une petite compagnie de fermiers y fait une fortune honnête & qui mérite l'attention du conseil, soit à raison du produit, soit à raison des vexations qu'elle exerce sur le Commerce.
|
| LOIRET | (Géogr.) petite riviere de France en Orléanois, nommée par Grégoire de Tours Ligeretus, par d'autres Ligericinus, & par plusieurs modernes Ligerulus.
Elle tire sa naissance au-dessus d'Olivet, du milieu des jardins du château de la Source (que le lord Bollingbrocke, & depuis M. Boutin receveur général des finances, ont rendu la plus charmante maison de campagne qui soit aux environs d'Orléans), & coule jusqu'au-delà du pont de Saint Mesmin, où elle se jette dans la Loire, après un cours d'environ deux lieues.
Il s'en faut beaucoup que le Loiret soit une riviere dès son origine ; elle ne mérite même le nom de riviere qu'un peu au-dessus du pont de Saint Mesmin, jusqu'à son embouchure dans la Loire, c'est-à-dire dans l'étendue seulement d'une petite demi-lieue. En effet, le bassin du Loiret dans cet espace ne contient communément d'eau courante que 500 piés cubiques, trois fois moins qu'il n'en passe sous le pont royal à Paris, où il s'en écoule à chaque instant 2000 piés cubiques, selon la supputation de Mariotte.
Cependant presque tous les auteurs ont parlé du Loiret, comme d'un prodige. Papyre Masson, Coulon, Léon, Tripaut, François le Maire, Guion, Daviti, Symphorien, Corneille, Peluche, & tant d'autres, nous représentent le Loiret aussi gros à sa naissance qu'à son embouchure, par tout navigable, & capable de porter bateau à sa source même.
Je n'ai rien vû de tout cela sur les lieux, mais ce n'est pas mon témoignage que je dois donner. Il faut lire, pour s'assurer de l'exacte vérité des faits, les réflexions de M. l'abbé de Fontenu sur le Loiret, insérées dans le recueil historique de l'académie des Inscriptions, tome VI. où l'on trouvera de plus la carte détaillée du cours de cette petite riviere.
L'objet principal de l'académicien de Paris a été de rectifier & de ramener à leur juste valeur les exagérations des auteurs qui ont parlé de cette riviere, laquelle ne paroît considérable que parce que ses eaux sont retenues par des digues qui les font refluer dans son bassin.
Cependant M. de Fontenu, après avoir dissipé les fausses préventions dans lesquelles on est dans tout l'Orléanois au sujet du Loiret, convient que cette petite riviere est digne des regards des amateurs de l'histoire Naturelle.
Premierement, l'abondance des deux sources dont le Loiret tire son origine, est curieuse. On voit sortir du sein de la terre par ces deux sources, seize à dixhuit piés cubiques d'eau, qui rendent le Loiret capable dès-lors de former un ruisseau assez considérable. La grande source du Loiret prend de si loin son essor de dessous la terre, que l'antre d'où elle s'éleve est un abîme dont il n'a pas été possible jusqu'à-présent de trouver le fond, en en faisant sonder la profondeur avec 300 brasses de cordes attachées à un boulet de canon.
Cette expérience a été faite en 1583 par M. d'Entragues, gouverneur d'Orléans, au rapport de François le Maire ; & milord Bollingbrocke répéta la même tentative, je crois, en 1732, avec aussi peu de succès. Toutefois cette maniere de sonder ne prouve pas absolument ici une profondeur aussi considérable qu'on l'imagine, parce que le boulet de canon peut être entraîné obliquement par l'extrême rapidité de quelque torrent qui se précipite au loin par des pentes souterraines.
Non-seulement la petite source du Loiret ne se peut pas mieux sonder, mais elle a cette singularité, que dans les grands débordemens de la Loire, son eau s'élance avec un bourdonnement qu'on entend de deux ou trois cent pas : la cause vient apparemment de ce que se trouvant alors trop resserrée entre les rochers à-travers desquels elle a son cours sous terre, elle fait de grands efforts pour s'y ouvrir un passage.
Ces deux sources du Loiret annoncent dans le pays, par leurs crues inopinées, le débordement de la Loire vingt ou vingt-quatre heures avant qu'on apperçoive à Orléans aucune augmentation de cette riviere. Ces crues inopinées prouvent que les sources du Loiret tirent de fort loin leur origine de la Loire, & qu'elles ne sont qu'un dégorgement des eaux de cette riviere, qui s'étant creusé un canal très-profond, viennent en droiture se faire jour dans les jardins du château de la Source. Ces crues arrivent ici beaucoup plus tôt que la crue de la Loire devant Orléans, parce qu'elles ont plus de pente sous terre, qu'elles sont plus resserrées dans leur canal, & qu'elles viennent plus en droiture que les eaux qui coulent dans le lit de la Loire.
On vante beaucoup dans le pays les paturages des prairies du Loiret, les laitages, & les vins de ses côteaux. L'eau de cette riviere est légere, elle ne gele, dit-on, jamais, du-moins ce doit être très-rarement, parce que c'est une eau souterraine & de sources vives.
Les vapeurs épaisses qui s'élevent du Loiret venant à se répandre sur les terres voisines, les préservent aussi de la gelée, leur servent d'engrais, & conservent la verdure des prairies d'alentour.
Enfin les eaux du Loiret sont d'un verd foncé à la vûe, & celles de la Loire blanchâtres. La raison de ce phénomene procede de la différence du fond, dont l'un a beaucoup d'herbes, & l'autre n'est que du sable qu'elle charrie sans cesse dans son cours. (D.J.)
|
| LOISIR | S. m. (Gramm.) tems vuide que nos devoirs nous laissent, & dont nous pouvons disposer d'une maniere agréable & honnête. Si notre éducation avoit été bien faite, & qu'on nous eût inspiré un goût vif de la vertu, l'histoire de nos loisirs seroit la portion de notre vie qui nous feroit le plus d'honneur après notre mort, & dont nous nous ressouviendrions avec le plus de consolation sur le point de quitter la vie : ce seroit celle des bonnes actions auxquelles nous nous serions portés par goût & par sensibilité, sans que rien nous y déterminât que notre propre bienfaisance.
|
| LOJOWOGOROD | Loiovogrodum, (Géogr.) petite ville de Pologne dans la basse Volhinie, fameuse par la bataille de 1649. Elle est sur la rive occidentale du Nieper, à environ 20 lieues N. O. de Kiovie. Long. 49. 22. lat. 50. 48. (D.J.)
|
| LOK | S. m. (Marine) c'est un morceau de bois de 8 à 9 pouces de long, quelquefois de la forme du fond d'un vaisseau ou d'une figure triangulaire, qu'on leste d'un peu de plomb pour le fixer sur l'eau à l'endroit où on le jette. On appelle ligne de lok une petite corde attachée à ce morceau de bois, au moyen de laquelle on mesure le chemin qu'on a fait. Pour cet effet on dévide la ligne ou corde ; sa portion dévidée dans un tems donné, marque l'intervalle du vaisseau au lok. On appelle noeud de la ligne de lok les portions de la ligne distinguées par des noeuds éloignés les uns des autres d'environ 41 piés 8 pouces. Si l'on file trois noeuds dans une demi-minute, on estime le chemin qu'on fait à une lieue par heure. La table du lok est une planche de bois divisée en cinq colonnes : on y écrit avec de la craie l'estime de chaque jour. A la premiere colonne sont les heures de deux en deux ; à la seconde le rumb du vent ou la direction du vaisseau ; à la troisieme la quantité de noeuds filés ; à la quatrieme le vent qui regne ; à la cinquieme les observations sur la variation de l'aiguille aimantée. Ce sont des officiers qui reglent la table de lok.
|
| LOKE | S. m. (Mythol.) nom donné par les anciens peuples du Nord au démon. Suivant leur mythologie Loke étoit le calomniateur des dieux, l'artisan des tromperies, l'opprobre du ciel & de la terre. Il étoit fils d'un géant, & avoit une femme nommée Signie. Il en eut plusieurs fils ; il eut aussi trois enfans de la géante Angerbode, messagere des malheurs ; savoir le loup Fenris, le grand serpent de Midgard, & Hela le mort. Loke faisoit une guerre éternelle aux dieux, qui le prirent enfin, l'attacherent avec les intestins de son fils, & suspendirent sur sa tête un serpent dont le venin lui tombe goutte à goutte sur le visage. Cependant Signie sa femme est assise auprès de lui, & reçoit ces gouttes dans un bassin qu'elle va vuider ; alors le venin tombant sur Loke, le fait hurler & frémir avec tant de force, que la terre en est ébranlée. Telle étoit, suivant les Goths, la cause des tremblemens de terre. Loke devoit rester enchaîné jusqu'au jour des ténébres des dieux. Voyez l'Edda des Islandois.
|
| LOLARDS | S. m. plur. (Théolog.) nom de secte. Les lolards sont une secte qui s'éleva en Allemagne au commencement du xiv. siecle. Elle prit son nom de son auteur nommé Lolhard Walter qui commença à dogmatiser en 1315.
Le moine de Cantorbery dérive le mot lolard de lolioud qui signifie de l'ivraie, comme si le lolard étoit de l'ivraie semée dans le champ du seigneur. Abelly dit que lolard signifie louant Dieu, apparemment de l'allemand loben, louer, & herr, seigneur ; parce qu'ils faisoient profession d'aller de côté & d'autre en chantant des pseaumes & des hymnes.
Lolard & ses sectateurs rejettoient le sacrifice de la messe, l'extrême-onction & les satisfactions propres pour les péchés, disant que celle de J. C. suffisoit. Il rejettoit aussi le baptême qu'il soutenoit n'avoir aucune efficace, & la pénitence qu'il disoit n'être point nécessaire. Lolard fut brûlé vif à Cologne en 1322.
On appella en Angleterre les sectateurs de Wiclef lolards, à cause que ses dogmes avoient beaucoup de conformité avec ceux de cet hérésiarque. D'autres prétendent qu'ils viennent des lolards d'Allemagne. Voyez WICLEFITES.
Ils furent solemnellement condamnés par Thomas d'Arundel archevêque de Cantorbery, & par le concile d'Oxford. Voyez le Dictionn. de Trévoux.
|
| LOLOS | S. m. (Hist. mod.) C'est le titre que les Macassarois donnent aux simples gentilshommes, qui chez eux formoient un troisieme ordre de noblesse. Ce titre est héréditaire, & se donne par le souverain. Les Dacus forment le premier ordre de la noblesse ; ils possedent des fiefs qui relevent de la couronne & qui lui sont dévolus faute d'hoirs mâles ; ils sont obligés de suivre le roi à la guerre avec un certain nombre de soldats qu'ils sont forcés d'entretenir. Les Carrés forment le second ordre : le souverain leur confere ce titre qui répond à celui de comte ou de marquis.
|
| LOMAGNE | LA (Géogr.) ou LAUMAGNE, en latin moderne Leomania ; petit pays de France, en Gascogne, qui fait partie du bas Armagnac ; c'étoit autrefois une vicomté, c'est aujourd'hui une pauvre élection dont le commerce est misérable. (D.J.)
|
| LOMBAIRES | adj. (Anat.) qui appartient aux lombes. Voyez LOMBES.
Arteres lombaires sont des branches de l'aorte qui se distribuent aux muscles des lombes. Voy. AORTE & ARTERES.
Veines lombaires sont des veines qui rapportent le sang des arteres, & vont se décharger dans le tronc de la veine-cave. Voyez VEINES.
Glandes lombaires. Voyez GLANDES.
Les nerfs lombaires sont au nombre de cinq paires : ils ont cela de commun qu'ils communiquent ensemble avec le nerf intercostal.
La premiere paire passe entre la premiere & la seconde vertebre des lombes : elle communique avec la premiere dorsale & la seconde lombaire ; elle jette plusieurs rameaux qui se distribuent aux muscles de bas ventre, au muscle psoas, à l'iliac, au ligament de Fallope, au cordon spermatique, &c.
La seconde paire sort entre la deuxieme & la troisieme vertebre des lombes : elle communique avec la premiere paire, & la troisieme paire lombaire, avec le nerf intercostal : elle jette plusieurs rameaux, parmi lesquels il y en a qui s'unissent au nerf crural & au nerf obturateur : les autres se distribuent aux muscles psoas, sacro-lombaires, long dorsal, vertébraux obliques, &c. au scrotum, aux glandes inguinales, aux membranes des testicules, &c.
La troisieme paire sort entre la troisieme & la quatrieme vertebre des lombes : elle communique avec la seconde paire & la quatrieme paire lombaire & avec le nerf intercostal : elle jette plusieurs filets dont quelques-uns s'unissent avec le nerf obturateur, & d'autres avec le nerf crural ; & plusieurs se perdent dans les muscles vertébraux, psoas, pectiné, &c.
La quatrieme paire sort entre la quatrieme & la cinquieme vertebre des lombes, s'unit à la troisieme & à la cinquieme paire lombaire, & communique avec le nerf intercostal : elle jette des branches aux muscles vertébraux & aux muscles voisins, & s'unit avec le nerf crural & avec le nerf obturateur.
La cinquieme paire passe entre la derniere vertebre des lombes & l'os sacrum : elle s'unit avec la quatrieme paire lombaire & avec la premiere sacrée : elle communique avec le nerf intercostal : elle jette des rameaux aux muscles vertébraux, &c. en fournit un au nerf crural, & se joint au nerf sacré pour former le nerf sciatique.
Le muscle lombaire interne. Voyez PSOAS.
|
| LOMBARD | (Hist. mod. & Com.) ancien peuple d'Allemagne qui s'établit en Italie dans la décadence de l'empire romain, & dont on a long-tems donné le nom en France aux marchands italiens qui venoient y trafiquer, particulierement aux Génois & aux Vénitiens. Il y a même encore à Paris une rue qui porte leur nom, parce que la plûpart y tenoient leurs comptoirs de banque, le commerce d'argent étant le plus considérable qu'ils y fissent.
Le nom de lombard devint ensuite injurieux & synonyme à usurier.
La place du change à Amsterdam conserve encore le nom de place lombarde, comme pour y perpétuer le souvenir du grand commerce que les lombards y ont exercé, & qu'ils ont enseigné aux habitans des Pays-bas.
On appelle encore à Amsterdam le lombard ou la maison des lombards, une maison où tous ceux qui sont pressés d'argent en peuvent trouver à emprunter sur des effets qu'ils y laissent pour gages. Il y a dans les bureaux du lombard des receveurs & des estimateurs : ces derniers estiment la valeur du gage qu'on porte, à-peu-près son juste prix ; mais on ne donne dessus que les deux tiers, comme deux cent florins sur un gage de trois cent. L'on délivre en même tems un billet qui porte l'intérêt qu'on en doit payer, & le tems auquel on doit retirer le gage. Quand ce tems est passé, le gage est vendu au plus offrant & dernier enchérisseur, & le surplus (le prêt & l'intérêt préalablement pris) est rendu au propriétaire. Le moindre intérêt que l'on paye au lombard, est de six pour cent par an ; & plus le gage est de moindre valeur, plus l'intérêt est grand : en sorte qu'il va quelquefois jusqu'à vingt pour cent.
Les Hollandois nomment ce lombard bank van-leeninge, c'est-à-dire banque d'emprunt. C'est un grand bâtiment que les régens des pauvres avoient fait bâtir en 1550 pour leur servir de magasin, & qu'ils céderent à la ville en 1614 pour y établir une banque d'emprunt sur toutes sortes de gages, depuis les bijoux les plus précieux jusqu'aux plus viles guenilles, que les particuliers qui les y ont portées peuvent retirer quand il leur plaît, en payant l'intérêt ; mais s'ils laissent écouler un an & six semaines, ou qu'ils ne prolongent pas le terme du payement en payant l'intérêt de l'année écoulée, leurs effets sont acquis au lombard qui les fait vendre, comme on a déja dit.
L'intérêt de la somme se paye, savoir, au-dessous de cent florins, à raison d'un pennin par semaine de chaque florin, ce qui revient à 16 1/4 pour cent par an. Depuis 100 jusqu'à 500 florins, on paye l'intérêt à 6 pour cent par an : depuis 500 florins jusqu'à 3000, 5 pour cent par an : & depuis 3000 jusqu'à 10000 florins, l'intérêt n'est que de 4 pour cent par an.
Outre le dépôt général, il y a encore par la ville différens petits bureaux répandus dans les divers quartiers, qui ressortissent tous au lombard. Tous les commis & employés de cette banque sont payés par la ville. Les sommes dont le lombard a besoin se tirent de la banque d'Amsterdam, & tous les profits qui en proviennent, sont destinés à l'entretien des hôpitaux de cette ville. Dictionn. de comm. Jean P. Ricard, Traité du commerce d'Amsterdam.
|
| LOMBARDES | (Jurisprud.) Voyez ci-devant LETTRES LOMBARDES.
|
| LOMBARDIE | (Géog.) en latin moderne Longobardia ; contrée d'Italie, qui répond dans sa plus grande partie, à la gaule Cisalpine des Romains ; elle a pris son nom des Lombards, qui y fonderent un royaume, après le milieu du sixieme siecle.
Comme la Gaule Cisalpine des Romains comprenoit la Gaule Transpadane, & la Gaule Cispadane ; il y avoit pareillement dans le royaume de Lombardie la Lombardie transpadane & la Lombardie cispadane, qui toutes deux sont regardées comme deux des plus beaux quartiers de l'Italie. Les collines y sont couvertes de vignes, de figuiers, d'oliviers, &c. Les campagnes coupées de rivieres poissonneuses & portant bateau, produisent en abondance de toutes sortes de grains.
A la faveur des guerres d'Italie, & des révolutions qui survinrent, tant en Allemagne, qu'en France, il se forma dans le royaume de Lombardie, diverses souverainetés & républiques, qui dans la suite, furent annexées au royaume de Lombardie ; de sorte que ce royaume, alors improprement royaume de Lombardie, se trouva renfermer divers états, qui n'avoient jamais appartenu aux rois Lombards. Voici les terres que l'on comprend aujourd'hui sous la dénomination de Lombardie improprement dite.
1°. Le Padouan, le Véronois, le Vicentin, le Bressan, le Crémasque & le Bergamasque, qui sont soumis à la république de Venise.
2°. Le duché de Milan & le duché de Mantoue, sont possédés par la maison d'Autriche.
3°. Le Piémont, le comté de Nice, & le duché de Montferrat, reconnoissent pour souverain le roi de Sardaigne.
4°. Le duché de Modene, le duché de Reggio, la principauté de Carpi, la Frignane & la Carfagnane, appartiennent à la maison de Modene.
5°. Le duché de Parme, le duché de Plaisance, l'état Palavicini & la principauté de Landi, sont dévolus à la maison de Parme.
6°. La maison de la Mirandole jouit du duché de la Mirandole.
Au reste, il ne faut pas croire que cet arrangement subsiste long-tems. La possession des états divers qui composent l'Italie, n'offre qu'un tableau mouvant de vicissitudes. (D.J.)
|
| LOMBARDS | (Géog. anc.) en latin Langobardi ou Longobardi, anciens peuples de la Germanie, entre l'Elbe & l'Oder.
Il y auroit de la témérité à vouloir désigner plus spécialement leur pays & en marquer les bornes, parce qu'aucun ancien auteur n'en parle : nous ne savons que quelques faits généraux qui concernent ces peuples. Tacite nous apprend seulement que quoiqu'ils fussent placés au milieu de diverses nations puissantes, ils ne laisserent pas de conserver leur liberté.
Sous le regne de Marc-Aurele, les Lombards quitterent leur ancienne demeure, s'avancerent jusqu'au Danube, passerent ce fleuve, & s'emparerent d'une province dont ils furent chassés par Vindex & par Candidus chefs de l'armée romaine. Ensuite, pendant plus de deux siecles on n'entendit plus parler d'eux : on ignore même le pays qu'ils allerent habiter.
Mais sous l'empire de Théodose, Agilmund leur chef rendit fameux le nom des Lombards. Vers l'an 487 ils aiderent Odoacre roi des Hérules à s'emparer de l'île de Rugen ; & dans la suite eux-mêmes en devinrent les maîtres.
En 526, leur roi Audouin les conduisit en Pannonie, & ils ne furent pas long-tems à subjuguer cette province. Le royaume des Ostrogoths ayant été détruit vers l'an 560, Alboin invité par Narsés conduisit ses Lombards en Italie, & il y fonda un royaume puissant, sous le nom de royaume de Lombardie.
Bientôt les vainqueurs adopterent les moeurs, la politesse, la langue, & la religion des vaincus : c'est ce qui n'étoit pas arrivé aux premiers Francs ni aux Bourguignons, qui porterent dans les Gaules leur langage grossier & leurs moeurs encore plus agrestes. La nation lombarde étoit composée de payens & d'ariens, qui d'ailleurs s'accordoient fort bien ensemble, ainsi qu'avec les peuples qu'ils avoient subjugués. Rotharis leur roi publia vers l'an 640 un édit qui donnoit la liberté de professer toute religion ; desorte qu'il y avoit dans presque toutes les villes d'Italie un évêque catholique & un évêque arien, qui laissoient vivre paisiblement les idolâtres répandus encore dans les bourgs & les villages.
Enfin, le royaume des Lombards qui avoit commencé par Alboin en 568 de l'ere vulgaire, dura tranquillement sous vingt-trois rois jusqu'à l'an 774, tems auquel Pepin défit Astolphe roi de ce peuple, & l'obligea de remettre au pape étienne l'exarchat de Ravenne. Cependant Didier duc de Toscane s'empara du royaume, & fut le vingt-troisieme & dernier roi des Lombards. Le pape mécontent de ce prince, appella Charlemagne en Italie. Ce guerrier mit le siege devant Pavie, & fit Didier prisonnier.
Pour lors tout cédant à la force de ses armes, il nomma des gouverneurs dans les principales villes de ses nouvelles conquêtes, & joignit à ses autres titres celui de roi des Lombards. On peut dire néanmoins que le royaume ne finit pas pour cela ; parce que les principaux de cette nation voyant que leur roi étoit pris, & conduit en France dans un monastere, sans espérance d'obtenir jamais sa délivrance, ils reconnurent Charlemagne à sa place, à condition qu'il maintiendroit leur liberté, leurs privileges & leurs lois. En effet, nous avons encore le code de ces lois particulieres, selon lesquelles Charlemagne & ses successeurs s'engagerent de les gouverner : & l'on voit plusieurs des capitulaires de ce prince inserés en divers endroits de ce code. (D.J.)
|
| LOMBES | S. m. en Anatomie, est cette partie du corps qui est autour des reins. Proprement, c'est la partie inférieure de l'épine du dos, laquelle est composée de cinq vertebres, qui sont plus grosses que celles du dos, auxquelles elles servent de base, & ont leur articulation un peu lâche, afin que le mouvement des lombes soit plus libre. Voyez Pl. Anat. Voyez aussi EPINE & VERTEBRE.
|
| LOMBEZ | (Géog.) en latin Lumbaria, petite ville de France, en Gascogne, dans la Comminges, avec un évêché suffragant de Toulouse. Elle est sur la Seve, à 8 lieues S. O. de Toulouse, 4 S. E. d'Ausch, 5 N. O. de Rieux, 166 S. O. de Paris. Long. 18. 33. lat. 43. 33. (D.J.)
|
| LOMBOYER | v. naut. (Salines) faire épaissir le sel ; l'on ne mixtionne point le sel par mêlange quelconque, sauf que quelquefois pour lui donner plus de vif, on y jette des pieces, ce que l'on appelle lomboyer.
|
| LOMBRICAL | adj. (Méd.) épithete que l'on donne à quatre muscles que font mouvoir les doigts de la main. On les a appellés lombricaux ou vermiformes, parce qu'ils ont la figure de vers. Il y a aux piés un pareil nombre de muscles.
|
| LOMOND-LOGH | (Géog.) ou le lac Lomond ; grand lac d'Ecosse, dans la province de Lenox. Il abonde en poisson ; la longueur du nord au sud est de 24 milles, & sa plus grande largeur de 8 milles. Il y a des îles dans ce lac qui sont habitées, & qui ont des églises. (D.J.)
|
| LON-YE | ou LUM-YEN, s. m. (Botan. exot.) nom d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans les provinces australes de l'empire, à un arbre sauvage ou cultivé, lequel est de la grandeur de nos noyers. Le lon-yen est de la grosseur de nos cerises, d'une figure ronde, d'une chair blanche, aigrelette, pleine d'eau, & d'un goût approchant de celui de nos fraises. Il est couvert d'une pelure mince, lisse, d'abord grisâtre, & jaunissant ensuite, à mesure que le fruit mûrit. Les Chinois des provinces australes, & en particulier les habitans de Focheu, font la récolte de ces fruits en Juillet, & les arrosent d'eau salée pour les conserver frais ; mais ils en sechent la plus grande partie pour les transporter pendant l'hiver, dans les autres provinces, ils en font aussi du vin agréable, en les pilant, & les laissant fermenter ; la poudre des noyaux de ce fruit est d'un grand usage dans leur médecine. Plus la nature a caché le germe de ses productions, plus l'homme ridiculement fin, s'est persuadé d'y trouver la conservation de sa vie, ou du moins le remede à ses maux. (D.J.)
|
| LONCHITE | ou HASTIFORME, s. f. (Phys.) est le nom qu'on donne à une espece de comete, qui ressemble à une lance ou pique. Sa tête est d'une forme ovale, & sa queue est très-longue, mince & pointue par le bout, cette expression n'est plus en usage, & ne se trouve que dans quelques anciens auteurs. Harris.
|
| LONCLOATH | ou LONGLOATH, s. m. (Comm.) toiles de coton, blanches ou bleues qui viennent de la côte de Coromandel. Elles ont 72 cobres de longueur sur 2 & 1/4 de largeur.
|
| LONDINIUM | (Géog. anc.) ancienne ville de la grande Bretagne, sur la Tamise, chez les Trinobantes. Londinium (dit déja Tacite de son tems, l. XIV. ch. xxxiij) cognomento quidem coloniae non insigne, sed copiâ negociatorum & commeatuum maximè celebre. Il falloit que ce fût la plus importante place de l'île, dès le tems que l'itinéraire d'Antonin fut dressé ; car c'est de-là comme du centre, qu'il fait commencer ses routes, & c'est-là qu'elles aboutissent : Ammien Marcellin, dit en parlant d'elle, Londinium, vetus oppidum, quod Augustam posteritas adpellabit. Bede la nomme, Lundonia. Les anciens l'ont appellée plus constamment Londinium. Les chroniques saxonnes portent Lundone, Lundenbyrig, Lundenburgh, Lundenceaster, & enfin, Lundenric, selon les observations du docte Gibson. Les Anglois d'aujourd'hui l'appellent London, les Italiens Londra, & les François Londres. Voyez LONDRES.
|
| LONDONDERRI | LE COMTE DE, (Géog.) contrée maritime d'Irlande, dans la province d'Ulster. Elle a 56 milles de long, sur 30 de large, & est très-fertile ; on la divise en cinq baronies. Londonderri en est la capitale. (D.J.)
LONDONDERRI, (Géog.) ville d'Irlande, capitale de la province d'Ulster, & du comté de Londonderri, avec un évêché suffragant d'Armagh, & un port très-commode ; elle est célebre par les siéges qu'elle a soutenus. Elle est sur la Lough-Foyle, à 108 milles N. O. de Dublin, 45 N. E. d'Armagh. Son véritable & ancien nom, est Derry ; il s'augmenta des deux premieres syllabes, à l'occasion d'une colonie angloise, qui vint s'y établir de Londres en 1612. Long. 10. 10. lat. 54. 58. (D.J.)
|
| LONDRES | (Géog.) en bon latin Londinium, (voyez ce mot) & en latin moderne Londinum, capitale de la grande Bretagne, le siege de la monarchie, l'une des plus anciennes, des plus grandes, des plus riches, des plus peuplées & des plus florissantes villes du monde. Elle étoit déja très-célebre par son commerce du tems de Tacite, copiâ negociatorum ac commeatuum maximè celebre ; mais Ammien Marcellin a été plus loin, il a tiré l'horoscope de sa grandeur future : Londinium, dit-il, vetus oppidum, quod Augustam posteritas adpellabit.
Elle mérite aujourd'hui ce titre à tous égards. M. de Voltaire la présente dans sa Henriade, comme le centre des arts, le magasin du monde & le temple de Mars.
Pour comble d'avantages, elle jouit du beau privilege de se gouverner elle-même. Elle a pour cet effet, ses cours de justice, dont la principale est nommée, commun-conncil, le conseil-commun ; c'est une espece de parlement anglois, composé de deux ordres ; le lord maire & les échevins, représentent la chambre des seigneurs ; & les autres membres du conseil, au nombre de 231, choisis dans les différens quartiers de la ville, représentent la chambres des communes. Cette cour seule a le pouvoir d'honorer un étranger du droit de bourgeoisie. C'est dans cette cour que se font les lois municipales, qui lient tous les bourgeois, chacun y donnant son consentement, ou par lui-même, ou par ses représentans ; en matieres ecclésiastiques, la ville est gouvernée par son évêque, suffragant de Cantorbery.
Londres contient cent trente-cinq paroisses, & par conséquent un grand nombre d'églises, dont la cathédrale nommée S. Paul, est le plus beau bâtiment qu'il y ait dans ce genre, après S. Pierre de Rome. Sa longueur de l'orient à l'occident, est de 570 piés ; sa largeur du septentrion au midi, est de 311 piés ; son dôme depuis le rez de chaussée, est d'environ 338 piés de hauteur. La pierre de cet édifice qui fût commencé en 1667, après l'incendie, & qui fut promtement achevé, est de la pierre de Portland, laquelle dure presque autant que le marbre.
Les Non-conformistes ont dans cette ville environ quatre-vingt assemblées ou temples, au nombre desquels les protestans étrangers en ont pour eux une trentaine ; & les Juifs y jouissent d'une belle synagogue.
On compte dans Londres cinq mille rues, environ cent mille maisons, & un million d'habitans.
Cette capitale, qui selon l'expression des auteurs anglois, éleve sa tête au-dessus de tout le monde commerçant, est le rendez-vous de tous les vaisseaux qui reviennent de la Méditerranée, de l'Amérique & des Indes orientales. C'est elle, qui après avoir reçu les sucres, le tabac, les indiennes, les épiceries, les huiles, les fruits, les vins, la morue, &c. répand toutes ces choses dans les trois royaumes : c'est aussi dans son sein que viennent se rendre presque toutes les productions naturelles de la grande Bretagne. Cinq cent gros navires y portent continuellement du charbon de terre ; que l'on juge par ce seul article, de l'étonnante consommation qui s'y fait des autres denrées nécessaires à la subsistance d'une ville si peuplée. Les provinces méditerranées qui l'entourent, transportent dans ses murs toutes leurs marchandises, soit qu'elles les destinent à y être consommées, ou à être embarquées pour les pays étrangers. Vingt mille mariniers sont occupés sur la Tamise à conduire à Londres, ou de Londres dans les provinces, une infinité de choses de mille especes différentes. Enfin, elle est comme le ressort qui entretient l'Angleterre dans un mouvement continuel.
Je ne me propose point d'entrer ici dans de plus grands détails sur ce sujet. John Stow a comme immortalisé les monumens de cette ville immense, par son ample description, que l'auteur de l'état de la grande Bretagne a poursuivi jusqu'à ce jour ; on peut les consulter.
Mais je ne puis m'empêcher d'observer, que la plûpart des belles choses, ou des établissemens importans qu'on y voit, sont le fruit de la munificence de ses citoyens estimables qui ont été épris de l'amour du bien public, & de la gloire d'être utiles à leur patrie.
L'eau de la nouvelle riviere, dont les habitans de Londres jouissent, outre l'eau de la Tamise, est dûe aux soins, à l'habileté & à la générosité du chevalier Hugues Middleton. Il commença cet ouvrage de ses propres deniers en 1608, & le finit au bout de cinq ans, en y employant chaque jour des centaines d'ouvriers. La riviere qui fournit cette eau, prend sa source dans la province de Hartford, fait 60 milles de chemin, avant que d'arriver à Londres, & passe sous huit cent ponts.
La bourse royale, cet édifice magnifique destiné aux assemblées des négocians, & qui a donné lieu à tant d'excellentes réfléxions de M. Addisson dans le spectateur, fut fondée en 1566 par le chevalier Thomas Gresham, négociant, sous le regne d'Elisabeth. C'est aujourd'hui un quarré long de 230 piés de l'orient à l'occident, & de 171 piés du septentrion au midi, qui a couté plus de 50 mille livres sterling ; mais comme il produit 4 mille livres sterling de rente, on peut le regarder pour un des plus riches domaines du monde, à proportion de sa grandeur.
Le même Gresham, non content de cette libéralité, bâtit le college qui porte son nom, & y établit sept chaires de professeurs, de 50 liv. sterling par an chacune, outre le logement.
On est redevable à des particuliers, guidés par le même esprit, de la fondation de la plûpart des écoles publiques, pour le bien des jeunes gens : par exemple, l'école nommée des Tailleurs, où l'on enseigne cent écoliers gratis ; cent pour deux schellings 6 sols chacun par quartier ; & cent autres pour cinq schellings chacun par quartier, (ce qui ne fait que 3 ou 6 livres de notre monnoie par tête, pour trois mois.) Cette école, dis-je, a été fondée par Thomas White, marchand tailleur, de Londres ; il devint échevin de la ville, & ensuite fut créé chevalier.
M. Sutton acheta en 1611 le monastere de la Chartreuse, 13 mille liv. sterling, & en fit un hôpital pour y entretenir libéralement quatre-vingt personnes, tirées d'entre les militaires & les négocians.
Ce même citoyen crut aussi devoir mériter quelque chose de ses compatriotes qui voudroient cultiver les lettres. Dans cette vûe, il fonda une école, pour apprendre le latin & le grec à quarante jeunes gens, dont les plus capables passeroient ensuite à l'université de Cambridge, où d'après sa fondation, l'on fournit annuellement à chacun d'eux, pour leur dépense pendant huit ans, 30 liv. sterling.
La statue de Charles II. qui est dans Soho-Square, a été élevée aux frais du chevalier Robert Viner.
Mais la bourse de Gresham, & tous les bâtimens dont nous venons de parler, périrent dans l'incendie mémorable de 1666, par lequel la ville de Londres fut presque entierement détruite. Ce malheur arrivé après la contagion, & au fort d'une triste guerre contre la Hollande, paroissoit irréparable. Cependant, rien ne fait tant voir la richesse, l'abondance & la force de cette nation, quand elle est d'accord avec elle-même, que le dessein formé par elle, d'abord que l'embrasement eut cessé, de rétablir de pierres & de briques sur de nouveaux plans, plus réguliers & plus magnifiques, tout ce que le feu avoit emporté d'édifices de bois, d'aggrandir les temples & les lieux publics, de faire les rues plus larges & plus droites, & de reprendre le travail des manufactures & de toutes les branches du commerce en général, avec plus de force qu'auparavant ; projet qui passa dans l'esprit des autres peuples, pour une bravade de la nation Angloise, mais dont un court intervalle de tems justifia la solidité. L'Europe étonnée, vit au bout de trois ans, Londres rebâtie, plus belle, plus réguliere, plus commode qu'elle n'étoit auparavant ; quelques impôts sur le charbon, & sur-tout l'ardeur & le zéle des citoyens, suffirent à ce travail, également immense & couteux ; bel exemple de ce que peuvent les hommes, dit M. de Voltaire, & qui rend croyable ce qu'on rapporte des anciennes villes de l'Asie & de l'Egypte, construites avec tant de célérité.
Londres se trouve bâtie dans la province de Middlesex, du côté septentrional de la Tamise, sur un côteau élevé, situé sur un fond de gravier, & par conséquent très-sain. La riviere y forme une espece de croissant ; la marée y monte pendant quatre heures, baisse pendant huit, & les vaisseaux de charge peuvent presque arriver jusqu'au pont de cette métropole ; ce qui est un avantage infini pour le prodigieux commerce qu'elle fait.
Son étendue de l'orient à l'occident, est au moins de huit milles ; mais sa plus grande largeur du septentrion au midi, n'a pas plus de deux milles & demi. Comme Londres est éloignée de la mer d'environ 60 milles, elle est à couvert dans cette situation de toute surprise de la part des flottes ennemies.
Sa distance est à 85 lieues S. E. de Dublin, 90 S. d'Edimbourg, 100 N. O. de Paris, 255 N. E. de Madrid, 282 N. O. de Rome, & 346 N. E. de Lisbonne, avec laquelle néanmoins elle a une poste reglée chaque semaine, par le moyen de ses pacquebots.
Par rapport à d'autres grandes villes, Londres est à 70 lieues N. O. d'Amsterdam, 170 S. O. de Copenhague, 240 O. de Vienne, 295 S. O. de Stockholm, 280 O. de Cracovie, 530 O. de Constantinople & de Moscow.
Long. suivant Flamstead & Cassini, 17. 26. 15. lat. 51. 31. La difference des méridiens entre Paris & Londres, ou pour mieux dire entre l'observatoire de Paris & celui de Gresham, est de 2. 20. 45. dont Londres est plus à l'occident que Paris. (D.J.)
LONDRES, (Géog.) ville de l'Amérique méridionale dans le Tucuman, bâtie en 1555, par Tarita, gouverneur du Tucuman : le fondateur la nomma Londres, pour faire sa cour à la reine Marie d'Angleterre, fille d'Henri VIII. qui venoit d'épouser Philippe II. roi d'Espagne. Long. 313. 25. lat. mérid. 29. (D.J.)
|
| LONDRINS | S. m. pl. (Comm.) draps de laine qui se fabriquent en France, & qu'on envoye au levant. Il y en a de deux sortes, qu'on distingue par des épithetes de premiers & de seconds. Ceux-là sont tout de laine sigovie, tant en trame qu'en chaîne ; la chaîne de 3000 fils, faites dans des rots de deux aunes, pour revenir du foulon larges d'une aune 1/4 entre deux lisieres, & marquées au chef, londrins premiers. Ceux-ci sont de laine soria ou autre pour la chaîne, & de seconde sigovie pour la trame ; la chaîne de 2600 fils dans des rots au moins de deux aunes moins 1/16, pour revenir du foulon, larges d'une aune 1/6 entre les lisieres. Voyez les regl. des Manufact.
|
| LONG | adj. (Gram.) voyez LONGUEUR.
LONG, en Anatomie, nom d'un grand nombre de muscles, par opposition à ceux qui sont nommés courts. Voyez COURT.
Le long extenseur de l'avant-bras. Voy. ANCONE.
Le long radial externe. Voyez RADIAL.
Le long palmaire. Voyez PALMAIRE.
Le long extenseur du pouce de la main & du pié. Voyez EXTENSEUR.
Le long supinateur. Voyez SUPINATEUR.
Le long extenseur commun du pié ou orteils. Voyez EXTENSEUR.
Le long peronier. Voyez PERONIER.
Le long dorsal. Voyez DORSAL.
Le long fléchisseur commun des orteils. Voyez PERFORANT.
Le long du cou vient des parties latérales du corps des quatre à cinq vertebres supérieures du dos, & s'insere aux cinq à six vertebres inférieures du cou.
LONG JOINTE, (Maréchal.) se dit du cheval qui a la jointure, c'est-à-dire, le paturon trop long. Chevaucher long. Voyez CHEVAUCHER.
Un cheval long jointé n'est pas propre à la fatigue, parce qu'il a le paturon si pliant & si foible, que le boulet donne presque à terre.
LONG, terme de Fauconnerie, on dit voler en long.
|
| LONG-CHAMP | (Géog.) en latin Longus-campus, abbaye royale de filles en France, située à 2 lieues de Paris. Elle fut fondée en 1260, par sainte Elisabeth, soeur de saint Louis, & cela se fit avec un appareil merveilleux ; car dans ce tems-là on n'étoit occupé que de choses de ce genre ; on ne connoissoit point encore les autres fondations vraiment utiles. (D.J.)
LONGE, s. f. (Maréchal.) laniere de cuir ou de corde qu'on attache dans les maneges à la têtiere d'un cheval. Voyez TETIERE. Donner dans les longes ou cordes, se dit d'un cheval qui travaille entre deux piliers.
Longe d'un licou, est une corde ou une bande de cuir attachée à une têtiere, & arrêtée à la mangeoire, pour tenir la tête du cheval sujette.
LONGE, on dit, en Fauconnerie, tirer à la longe, de l'oiseau qui vole pour revenir à celui qui le gouverne.
Longe cul, se dit en Fauconnerie d'une ficelle qu'on attache au pié de l'oiseau quand il n'est pas assuré.
|
| LONGANUS | (Géog. anc.) en grec, , ancien nom d'une riviere de Sicile. Polybe, liv. I. chap. ix. en parle, son nom moderne est Ruzzolino-Fiume. Elle prend sa source auprès de Castro-Réale. (D.J.)
|
| LONGER | en terme de Guerre ; on dit longer la riviere, pour signifier qu'on peut aller librement le long de ses bords ou sur la riviere : c'est pourquoi l'on dit qu'il faut attaquer un poste ou se rendre maître d'un pont pour pouvoir longer la riviere, parce que ce pont ou ce poste empêche qu'on ne puisse naviger en sureté sur cette riviere & marcher le long de ses bords.
LONGER un chemin, terme de Chasse, c'est quand une bête va d'assurance, ou qu'elle fuit, on dit la bête longe le chemin ; & quand elle retourne sur ses voies, cela s'appelle ruse & retour.
|
| LONGFORD | (Géog.) petite ville d'Irlande, dans la province de Leinster, au comté de Longford, canton de 27 milles d'étendue, large de 16, & qu'on divise en six baronies. Son chef-lieu est la ville dont nous parlons, située sur la riviere de Camlin, à 5 milles O. de S. John's-Town, & à 6 milles d'Ardagh. Long. 9. 50. lat. 53. 38. (D.J.)
|
| LONGIMÉTRIE | S. f. (Géom.) c'est l'art de mesurer les longueurs, soit accessibles, comme les routes, soit inaccessibles, comme les bras de mer. Voyez MESURE, &c.
La longimétrie est une partie de la trigonométrie, & une dépendance de la Géométrie, de même que l'altimétrie, la planimétrie, la stéréométrie, &c. Voyez l'article de la LONGIMETRIE, aux articles où l'on parle des instrumens qui servent à la résolution des problèmes particuliers à cette science, consultez sur-tout les articles PLANCHETTE, CHAINE, &c.
On appelle aussi longimétrie cette partie de la Géométrie élémentaire qui traite des propriétés des lignes droites ou circulaires. Voyez GEOMETRIE, LIGNE, &c.
|
| LONGITUDE | LONGITUDE
Ainsi, la longitude d'une étoile comme S, (Pl. d'Ast. fig. 32.) est un arc de l'écliptique T L, compris entre le commencement d'aries, & le cercle de latitude T M, qui passe par le centre S de l'étoile, & par les poles de l'écliptique.
La longitude est par rapport à l'écliptique ce que l'ascension droite est par rapport à l'équateur. Voyez ASCENSION.
Dans ce sens la longitude d'une étoile n'est autre chose que son lieu dans l'écliptique, à compter depuis le commencement d'aries.
Pour trouver la longitude d'une étoile, ainsi que sa latitude, la difficulté se réduit à trouver son inclinaison & son ascension droite. Voyez ces deux mots ; car connoissant ces deux derniers, & connoissant de plus l'angle de l'équateur avec l'écliptique, & l'endroit où l'écliptique coupe l'équateur, il est visible qu'on aura par les seules regles de la Trigonométrie sphérique la longitude & la latitude de l'étoile. Or nous avons donné & indiqué aux mots DECLINAISON, ÉTOILE, ASCENSION & GLOBE, les différens moyens de trouver l'ascension droite & la déclinaison des étoiles ou des planetes.
La longitude du soleil ou d'une étoile depuis le point équinoxial le plus proche de l'étoile, c'est le nombre de degrés, de minutes qu'il y a du commencement d'aries ou de libra, jusqu'au soleil ou à l'étoile, soit en avant, soit en arriere, & cette distance ne peut jamais être de plus de 180 degrés.
Longitude d'un lieu, en Géographie, c'est la distance de ce lieu à un méridien qu'on regarde comme le premier ; ou un arc de l'équateur, compris entre le méridien du lieu & le premier méridien. Voyez MERIDIEN.
Le premier méridien étoit autrefois placé à l'île de Fer, la plus occidentale des Canaries, & Louis XIII. l'avoit ainsi ordonné pour rendre la Géographie plus simple ; aujourd'hui presque tous les Géographes & les Astronomes comptent les longitudes de leur méridien, c'est-à-dire du méridien du lieu où ils observent : cela est assez indifférent en soi ; car il est égal de prendre pour premier méridien un méridien ou un autre, & on aura toûjours la longitude d'un endroit de la terre lorsqu'on aura la position de son méridien par rapport au méridien de quelque autre lieu, comme Paris, Londres, Rome, &c. Il est pourrant vrai que si tous les Astronomes convenoient d'un méridien commun, on ne seroit point obligé de faire des réductions qui sont nécessaires pour ne pas embrouiller la géographie moderne. On peut en général définir la longitude, le nombre de degrés de l'équateur compris entre le méridien du lieu & celui de tout autre lieu proposé. Vous voulez savoir, par exemple, de combien Pekin, capitale de la Chine, est éloignée de Paris en longitude, amenez Paris sous le méridien commun, & éloignez ensuite ce point vers l'occident, en comptant combien il passe de degrés de l'équateur sous le méridien, jusqu'à ce que vous apperceviez Pekin arrivé sous le méridien ; suivant le grand globe de M. Delille, vous trouverez 113 degrés de l'équateur, écoulés entre le méridien de Paris & celui de Pekin.
Dans la numération des degrés, le pole arctique étant toûjours vers le haut, la distance qui s'étend à droite jusqu'à 180 degrés, marque de combien un lieu proposé est plus oriental qu'un autre. La distance qui s'étend de même à gauche jusqu'à 180 degrés, marque de combien un lieu est plus occidental qu'un autre. Ce seroit une commodité d'appeller longitude orientale les degrés qui sont à droite du méridien d'un lieu, jusqu'au nombre de 180 degrés, & longitude occidentale ceux qui s'étendent à la gauche du même méridien, en pareil nombre : mais c'est un usage universel de ne compter qu'une seule progression de longitude jusqu'à 360 degrés.
Longitude, en Navigation, c'est la distance du vaisseau, ou du lieu où on est à un autre lieu, compté de l'est à l'ouest, en degrés de l'équateur.
La longitude de deux lieux sur mer peut s'estimer de quatre manieres ; ou par l'arc de l'équateur compris entre les méridiens de ces deux lieux ; ou par l'arc du parallele qui passe par le premier de ces lieux, & qui est terminé par les deux méridiens ; ou par l'arc du parallele compris entre les deux méridiens, & qui passe par le second de ces deux lieux ; ou enfin par la somme des arcs de différens paralleles compris entre les différens méridiens qui divisent l'espace compris entre les deux méridiens. Or de quelque maniere qu'on s'y prenne il faudra toûjours estimer la distance des méridiens en degrés, & il paroît plus commode de la marquer par des degrés de l'équateur qu'autrement. Mais il faut remarquer que ces degrés ne donnent point la distance des deux lieux : car tous les arcs, soit de l'équateur, soit des paralleles compris entre les mêmes méridiens, ont le même nombre de degrés, & tous les lieux situés sous ces méridiens ont la même différence de longitude, mais ils sont d'autant plus proches les uns des autres qu'ils sont plus près du pole ; c'est à quoi il faut avoir égard en calculant les distances des lieux dont les longitudes & les latitudes sont communes, & les marins ont des tables toutes dressées pour cela.
La recherche d'une méthode exacte pour trouver les longitudes en mer, est un problême qui a beaucoup exercé les Mathématiciens des deux derniers siecles, & pour la solution duquel les Anglois ont proposé publiquement de grandes récompenses : on a fait de vains efforts pour en venir à bout, & on a proposé différentes méthodes, mais sans succès ; les projets se sont toûjours trouvés mauvais, supposant des opérations trop impraticables, ou vicieuses par quelque endroit ; de façon que la palme n'a encore été déférée à personne.
L'objet que la plûpart se proposent, est de trouver une différence de tems entre deux points quelconques de la terre : car il répond une heure à 15 degrés de l'équateur, c'est-à-dire, 4 minutes de tems à chaque degré de l'équateur, 4 secondes de tems à chaque minute de degré ; & ainsi la différence de tems étant connue & convertie en degrés, elle donneroit la longitude, & réciproquement.
Pour découvrir la différence de tems, on s'est servi d'horloges, de montres & d'autres machines, mais toûjours en vain, n'y ayant, de tous les instrumens propres à marquer le tems, que la seule pendule qui soit assez exacte pour cet effet, & la pendule ne pouvant être d'usage à la mer. D'autres avec des vûes plus saines, & plus de probabilité de succès, vont chercher dans les cieux les moyens de découvrir les longitudes sur terre. En effet, si l'on connoît pour deux différens endroits les tems exacts de quelque apparence céleste, la différence de ces deux tems donnera la différence des longitudes entre ces deux lieux. Or nous avons dans les éphémérides les mouvemens des planetes, & les tems de tous les phénomènes célestes, comme les commencemens & les fins des éclipses, les conjonctions de la lune avec les autres planetes dans l'écliptique calculées pour un certain lieu. Si donc on pouvoit observer exactement l'heure & la minute dans laquelle ces phénomenes arrivent dans un autre lieu quelconque, la différence de tems entre ces momens-là & celui qui est marqué dans les tables étant convertie en degrés, donneroit la différence de longitude entre le lieu où l'on fait l'observation & celui pour lequel les tables ont été construites.
La difficulté ne consiste pas à trouver exactement l'heure qu'il est, on en vient à bout par les observations de la hauteur du soleil ; mais ce qui manque, c'est un nombre suffisant d'apparences qui puissent être observées ; car tous ces mouvemens lents, par exemple, celui de saturne, sont d'abord exclus, parce qu'une petite différence d'apparence ne s'y laisse appercevoir que dans un grand espace de tems, & qu'il faut ici que le phénomene varie sensiblement en deux minutes de tems au plus, une erreur de deux minutes sur le tems en produisant une de trente mille dans la longitude. Or parmi les phénomenes qui se trouvent dans ce cas, ceux qui ont paru les plus propres à cet objet, sont les différentes phases des éclipses de la lune, la longitude de cet astre ou son lieu dans le zodiaque, sa distance des étoiles fixes, ou le mouvement où elle se joint à elles, & la conjonction, la distance & les éclipses des satellites de Jupiter : nous allons parler de chacun de ces moyens l'un après l'autre.
1°. La méthode par les éclipses de lune est très-aisée, & seroit assez exacte s'il y avoit des éclipses de lune chaque nuit. Au moment que nous voyons le commencement ou le milieu d'une éclipse de lune, nous n'avons qu'à prendre la hauteur ou le zénith de quelque étoile fixe, & nous en conclurons l'heure, cela suppose que nous connoissons d'ailleurs la latitude, & alors il n'y aura qu'à résoudre un triangle sphérique dont les trois côtés sont connus, savoir le premier, la distance du zénith au pole, complément de la latitude ; le second, celle de l'étoile au zénith, complément de la hauteur de l'étoile ; le troisieme, celle de l'étoile au pole, complement de la déclinaison de l'étoile, car on tirera de-là la valeur de l'angle formé par le méridien & le cercle de déclinaison passant par l'étoile, ce qui ajoûté à la différence d'ascension droite du soleil & de l'astre pour ce jour-là, donnera la distance du soleil au méridien, ou le tems qu'on cherche, c'est-à-dire, l'heure du jour au moment & au lieu de l'observation ; on n'auroit pas même besoin de connoître la hauteur de l'étoile, si l'étoile étoit dans le méridien. En effet, l'heure du moment de l'observation sera donnée alors par la seule différence d'ascension droite de l'oeil & de l'étoile pour ce jour-là, convertie en tems ; ce moment qu'on aura trouvé de la sorte, étant comparé à celui qui est marqué dans les tables pour la même éclipse, nous donnera la longitude. Voyez ÉCLIPSE.
2°. Le lieu de la lune dans le zodiaque n'est pas un phénomene qui ait, comme ce dernier, le défaut de ne pouvoir être observé que rarement ; mais en revanche l'observation en est difficile, & le calcul compliqué & embarrassé à cause de deux parallaxes auxquelles il faut avoir égard ; desorte qu'à peine peut-on se servir de ce phénomene avec la moindre assurance, pour déterminer les longitudes. Il est vrai que si l'on attend que la lune passe au méridien du lieu, & qu'on prenne alors la hauteur de quelque étoile remarquable (on suppose qu'on a connu déjà la latitude du lieu) la latitude déduira assez exactement le tems, quoiqu'il fût mieux encore d'employer à cela l'observation de quelques étoiles situées dans le méridien.
Or le tems étant trouvé, il sera aisé de connoître quel point de l'écliptique passe alors par le méridien, & par-là nous aurons le lieu de la lune dans le zodiaque correspondant au tems de l'endroit où nous nous trouvons ; nous chercherons alors dans les éphémérides à quelle heure du méridien des éphémérides la lune doit se trouver dans le même point du zodiaque, & nous aurons ainsi les heures des deux lieux dans le même instant, enfin leur différence convertie en degrés de grand cercle, nous donnera la longitude.
3°. Comme il arrive souvent que la lune doit être observée dans le méridien, les Astronomes ont tourné pour cette raison leurs vues du côté d'un autre phénomene plus fréquent pour en déduire les longitudes, c'est l'occultation des étoiles fixes par la lune ; en effet, l'entrée des étoiles dans le disque de la lune, ou leur sortie de ce disque, peut déterminer le vrai lieu de la lune dans le ciel pour le moment donné de l'observation ; mais les parallaxes auxquelles il faut avoir égard, ces triangles sphériques obliquangles qu'il faut résoudre, & la variété des cas qui peuvent se présenter, rendent cette méthode si difficile & si compliquée, que les gens de mer n'en ont fait que très-peu d'usage jusqu'à présent. Ceux qui voudront s'en servir trouveront un grand secours dans le zodiaque des étoiles, publié par les soins du docteur Halley, & qui contient toutes les étoiles dont on peut observer les occultations par la lune.
Mais malgré le peu d'usage qu'on a fait jusqu'ici de cette méthode, la plûpart des plus habiles astronomes de ce siecle croient que l'observation de la lune est peut-être le moyen le plus exact de découvrir les longitudes. Il n'est pas nécessaire, selon eux, d'observer l'occultation des étoiles par la lune pour marquer un instant déterminé ; le mouvement de la lune est si rapide, que si on rapporte sa situation à deux étoiles fixes, elle forme avec ces étoiles un triangle qui, changeant continuellement de figure, peut être pris pour un phénomene instantané, & déterminer le moment auquel on l'observe. Il n'y a plus d'heure de la nuit, il n'y a plus d'heure où la lune & les étoiles soient visibles, qui n'offre à nos yeux un tel phénomene ; & nous pouvons par le choix des étoiles, par leur position, & par leur splendeur prendre entre tous les triangles celui qui paroîtra le plus propre à l'observation.
Pour parvenir maintenant à la connoissance des longitudes, il faut deux choses : l'une qu'on observe sur mer avec assez d'exactitude le triangle formé par la lune & par les étoiles ; l'autre qu'on connoisse assez exactement le mouvement de la lune pour savoir quelle heure marqueroit la pendule reglée dans le lieu où l'on est parti, lorsque la lune forme avec les deux étoiles le triangle tel qu'on l'observe. On peut faire l'observation assez exactement, parce qu'on a assez exactement sur mer l'heure du lieu où l'on est, & que d'ailleurs on a depuis quelques années un instrument avec lequel on peut, malgré l'agitation du vaisseau, prendre les angles entre la lune & les étoiles avec une justesse assez grande pour déterminer le triangle dont nous parlons. La difficulté se réduit à la théorie de la lune, à connoître assez exactement ses distances & ses mouvemens pour pouvoir calculer à chaque instant sa position dans le ciel, & déterminer à quel instant pour tel ou tel lieu le triangle qu'elle forme avec deux étoiles fixes, sera tel ou tel. Nous ne dissimulerons point que c'est en ceci que consiste la plus grande difficulté. Cet astre qui a été donné à la terre pour satellite, & qui semble lui promettre les plus grandes utilités, échappe aux usages que nous en voudrions faire, par les irrégularités de son cours : cependant si on pense aux progrès qu'a faits depuis quelque tems la théorie de la lune, on ne sauroit s'empêcher de croire que le tems est proche où cet astre qui domine sur la mer, & qui en cause le flux & reflux, enseignera aux navigateurs à s'y conduire, Préface du traité de la parallaxe de la lune par M. de Maupertuis. On verra à l'article LUNE le détail des travaux des plus habiles géometres & astronomes sur une matiere aussi importante.
Il faut avouer que cette méthode pour découvrir les longitudes demandera plus de science & de soin qu'il n'en eût fallu, si on eut pû trouver des horloges qui conservassent sur mer l'égalité de leur mouvement ; mais ce sera aux Mathématiciens à se charger de la peine des calculs ; pourvû qu'on ait les élémens sur lesquels la méthode est fondée, on pourra par des tables ou des instrumens, réduire à une grande facilité la pratique d'une théorie difficile.
Cependant la prudence voudra qu'au commencement on ne fasse qu'un usage fort circonspect de ces instrumens ou de ces tables, & qu'en s'en servant on ne néglige aucune des autres pratiques par lesquelles on estime la longitude sur mer ; un long usage en fera connoître la sûreté.
Comme les lieux de la lune sont différens pour les différens points de la surface de la terre, à cause de la parallaxe de cette planete, il sera nécessaire dans les observations qu'on fera des lieux de la lune, de pouvoir réduire ces lieux les uns aux autres, ou au lieu de la lune vue du centre de la terre. M. de Maupertuis dans son Discours sur la parallaxe de la lune, dont nous avons tiré une partie de ce qui précéde, donne des méthodes très-élégantes pour cela, & plus exactes qu'aucune de celles qu'on avoit publiées jusqu'à lui. Voyez PARALLAXE.
4°. On préfere généralement dans la recherche des longitudes sur terre les observations des satellites de Jupiter à celles de la lune, parce que les premieres sont moins sujettes à la parallaxe que les autres, & que de plus elles peuvent toujours se faire commodément quelle que soit la situation de Jupiter sur l'horison. Les mouvemens des satellites sont promts & doivent se calculer pour chaque heure : or pour découvrir la longitude au moyen de ces satellites, vous observerez avec un bon télescope la conjonction de deux d'entr'eux ou de l'un d'eux avec Jupiter, ou quelques autres apparences semblables, & vous trouverez en même tems l'heure & la minute pour l'observation de la hauteur méridienne de quelques étoiles. Consultant ensuite les tables des satellites, vous observerez l'heure & la minute à laquelle cette apparence doit arriver au méridien du lieu pour lequel les tables sont calculées, & la différence du tems vous redonnera, comme ci-dessus, la longitude. Voyez SATELLITES.
Cette méthode de déterminer les longitudes sur terre est aussi exacte qu'on le puisse desirer, & depuis la découverte des satellites de Jupiter, la Géographie a fait de très-grands progrès par cette raison ; mais il n'est pas possible de s'en servir par mer. La longueur des lunettes jusqu'ici necessaires pour pouvoir observer les immersions & les émersions des satellites, & la petitesse du champ de leur vision, font qu'à la moindre agitation du vaisseau l'on perd de vue le satellite, supposé qu'on l'ait pu trouver. L'observation des éclipses de lune est plus praticable sur mer ; mais elle est beaucoup moins bonne pour connoître les longitudes, à cause de l'incertitude du tems précis auquel l'éclipse commence ou finit, ou se trouve à son milieu ; ce qui produit nécessairement de l'incertitude dans le calcul de la longitude qui en résulte.
Les méthodes qui ont pour fondement des observations de phénomene céleste ayant toutes ce défaut qu'elles ne peuvent être toujours d'usage, parce que les observations ne se peuvent pas faire en tous tems, & étant outre cela d'une pratique difficile en mer, par rapport au mouvement du vaisseau ; il y a par cette raison des mathématiciens qui ont abandonné les moyens que peuvent fournir la lune & les satellites ; ils ont recours aux horloges & autres instrumens de cette espece, & il faut avouer que s'ils pouvoient en faire d'assez justes & d'assez parfaits pour qu'ils allassent précisément sur le soleil sans avancer ni retarder, & sans que d'ailleurs la chaleur ou le froid, l'air, & les differens climats n'y apportassent aucune altération, on auroit en ce cas la longitude avec toute l'exactitude imaginable ; car il n'y auroit qu'à mettre sa pendule ou son horloge sur le soleil au moment du départ, & lorsqu'on voudroit avoir la longitude d'un lieu, il ne s'agiroit plus que d'examiner au ciel l'heure & la minute qu'il est ; ce qui se fait la nuit au moyen des étoiles, & le jour au moyen du soleil : la différence entre le tems ainsi observé, & celui de la machine, donneroit évidemment la longitude. Mais on n'a point découvert jusqu'aujourd'hui de pareille machine ; c'est pourquoi on a eu encore recours à d'autres méthodes.
M. Whiston a imaginé une méthode de trouver les longitudes par la flamme & le bruit des grands canons. Le son, comme on le sait, se meut assez uniformément dans toutes ses ondulations, quel que soit le corps sonore d'où il part, & le milieu par où il se transmet. Si l'on tire donc un mortier ou un grand canon dans un endroit où la longitude est connue, la différence entre le tems où le feu, qui se meut comme dans un instant, sera vu, & celui où le son qui se meut sur le pié de 173 toises par seconde, sera entendu, donnera la distance des deux lieux l'un de l'autre ; ainsi en supposant qu'on eût la latitude des lieux, on pourra par ce moyen parvenir à la connoissance de la longitude. Voyez SON, &c.
De plus si l'heure & la minute où l'on tire le canon sont connues pour le lieu où l'on le tire, observant alors, par le soleil & les étoiles, l'heure & la minute dans le lieu dont on cherche la longitude, & où nous supposons qu'on entend le canon même sans le voir, la différence de ces deux tems sera la différence de longitude.
Enfin, si ce mortier étoit chargé d'un boulet creux ou d'une maniere de bombe pleine de mariere combustible, & qu'on le plaçât perpendiculairement, il porteroit sa charge à un mille de haut, & on en pourroit voir le feu à près de cent milles de distance. Si l'on se trouve donc dans un endroit d'où l'on ne puisse appercevoir la flamme du canon, ni en entendre le son, on pourra néanmoins déterminer la distance du lieu où on sera, à celui où le mortier aura été braqué, par la hauteur dont la bombe s'élevera au-dessus de l'horison : or la distance & la latitude étant une fois connues, la longitude se trouvera facilement.
Suivant cette idée, on proposoit d'avoir de ces mortiers placés de distance en distance, & à des stations connues, dans toutes les côtes, les îles, les caps, &c. qui sont fréquentés, & de les tirer à certains momens marqués de la journée pour l'usage & l'avantage des navigateurs.
Cette méthode, qui pourroit plaire à l'esprit dans la théorie est cependant entierement inutile, parce qu'elle est très-incommode & même qu'elle suppose trop. Elle suppose, par exemple, que le son peut-être entendu de 40, 50 ou 60 milles, & il est vrai qu'on en a des exemples ; mais ces exemples sont très-rares, & d'ordinaire le bruit du canon ne s'entend que de la moitié au plus de cet espace, & quelquefois de beaucoup moins loin. Elle suppose encore que le son se meut toujours avec une egale vîtesse, au lieu que dans le fait sa vîtesse peut augmenter ou diminuer selon qu'il se meut ou en même sens que le vent, ou en sens contraire.
Il est vrai que suivant quelques expériences le vent n'altere en rien la vîtesse du son ; mais ces expériences auroient besoin d'être répétées un grand nombre de fois pour qu'on pût en déduire des regles générales ; & il y en a même qui leur paroissent contraires, puisque souvent on entend les cloches lorsque le vent en pousse le son aux oreilles, & qu'on cesse de les entendre quand le vent y est contraire.
Cette méthode suppose enfin que la force de la poudre est uniforme, & que la même quantité porte toujours le même boulet à la même hauteur ; or il n'y a aucun canonnier qui ne sache le contraire. Nous ne disons rien des nuits couvertes & obscures où on ne peut point voir de lunes, ni des nuits orageuses ou on ne peut point entendre le son, même à de très-petites distances.
C'est pourquoi les marins sont réduits à des méthodes fort imparfaites pour trouver la longitude : voici une idée générale de la principale de ces méthodes. Ils estiment le chemin que le vaisseau a fait depuis l'endroit d'où ils veulent compter la longitude, ce qui ne se peut faire que par des instrumens jusqu'ici fort peu exacts. Ils observent la latitude du lieu où le vaisseau est arrivé, & la comparant à la latitude de l'autre lieu pour savoir combien ils ont changé en latitude ; & connoissant à-peu-près le rhumb de vent sous lequel ils ont couru pendant ce tems, ils déterminent par la combinaison de ces différens élémens la différence des longitudes.
On voit assez combien d'élémens suspects entrent dans cette détermination, & combien la recherche des longitudes à cet égard est encore loin de la perfection qu'on y desire.
On peut encore se servir de la déclinaison de la boussole pour déterminer la longitude en mer. Voyez sur cela le Traité de navigation de M. Bouguer, pag. 313, ainsi que les méthodes les plus usitées par les marins pour trouver la longitude. (O)
|
| LONGITUDINAL | en Anatomie, se dit des parties étendues, ou situées en long.
Les membranes qui composent les vaisseaux, sont tissues de deux sortes de fibres, les unes longitudinales, & les autres circulaires, qui coupent les fibres longitudinales à angles droits. Voyez MEMBRANE.
Les fibres longitudinales sont tendineuses & élastiques. Les circulaires sont musculeuses & motrices, comme les sphincters. Voyez FIBRE.
Le sinus longitudinal supérieur ou grand sinus de la dure-mere s'étend depuis la connexion de la crête éthmoïdale avec l'os frontal, le long du bord supérieur de la faulx jusqu'au milieu du bord postérieur de la tente ou cloison transversale où il se bifurque dans les deux sinus latéraux. Voyez DURE MERE, &c.
|
| LONGONÉ | (Géog.) Voyez PORTO-LONGONE.
|
| LONGPAN | S. m. (terme d'Arch.) c'est le plus long côté d'un comble, qui a environ le double de sa largeur ou plus.
|
| LONGUE | adj. f. en terme de Grammaire. On appelle longue une syllabe relativement à une autre que l'on appelle brève, & dont la durée est de moitié plus courte, voyez BREVE. La longueur & la brieveté n'appartiennent jamais qu'au son qui est l'ame de la syllabe ; les articulations sont essentiellement instantanées & indivisibles.
|
| LONGUE | est dans nos anciennes Musiques, une note quarrée avec une queue à droite, ainsi . Elle vaut ordinairement quatre mesures à deux tems, c'est-à-dire deux brèves : quelquefois aussi elle en vaut trois, selon le mode. Voyez MODE.
Aujourd'hui on appelle longue, 1°. toute note qui commence le tems, & sur-tout le tems fort, quand il est partagé en plusieurs notes égales ; 2°. toute note qui vaut deux tems ou plus, de quelque mesure que ce soit ; 3°. toute note pointée, 4°. & toute note syncopée. Voyez MESURE, POINT, SYNCOPE, TEMS, VALEUR DES NOTES.
LONGUES PIECES (Fondeur de caracteres d'Imprimerie) Longues pieces du moule, ainsi appellées parce qu'elles sont les plus longues de toutes. C'est sur un bout des longues pieces que le blanc est retenu par une vis & la potence. De l'autre côté est la fourchette ou entaille, dans laquelle se place & coule la tête de la potence de l'autre piece, lorsque le moule est fermé. Voyez MOULE, Planche, figures.
LONGUES, terme de Fondeur de caracteres d'Imprimerie. On entend par longues les lettres qui occupent les deux tiers du corps par en-haut, comme les d, D, b, B, &c. p, q, g, y, par en-bas, & dont on ne coupe que d'un côté l'extrêmité du corps du côté de l'oeil. On appelle ces lettres longues relativement aux courtes que l'on coupe des deux côtés, comme les m, o, e, &c. & aux pleines qui occupent tout le corps, & qu'on ne coupe point, comme Q. s. ffi. &c. Voyez COUPER.
|
| LONGUET | S. m. (Lutherie) sorte de marteau dont les facteurs de clavessins se servent pour enfoncer les pointes auxquelles les cordes sont attachées. Ce marteau est ainsi nommé à cause de la longueur de son fer, qui est telle que la tête puisse atteindre les pointes sans que le manche du marteau touche au bord du clavecin. Voyez la figure de cet outil Planches de Lutherie.
|
| LONGUEUR | S. f. (Gramm.) la plus grande dimension d'un corps, mesuré par une ligne droite.
LONGUEUR de l'étrave à l'étambord, (Marine) c'est la longueur en ligne droite qu'il peut y avoir de l'un à l'autre.
Longueur de la quille portant sur terre, c'est toute la longueur de la quille droite, & celle qui porte sur les tins.
Longueur d'un cable ; c'est une mesure de 120 brasses de long, qui est celle de la plus grande longueur des cables.
LONGUEUR, (Maréch.) Passéger un cheval de sa longueur, en termes de manege, c'est le faire aller en rond, de deux pistes, soit au pas, soit au trot, sur un terrein si étroit, que ses hanches étant au centre de la volte, sa longueur soit à-peu-près le demi-diametre de la volte, & qu'il manie toujours entre deux talons, sans que la croupe échappe, & sans qu'il marche plus vîte, ou plus lentement à la fin qu'au commencement. Voyez PISTE, VOLTE, &c.
LONGUEUR, (Rubanier) s'entend des soies de la chaîne, depuis les ensuples de derriere, jusqu'aux lisses ou lissettes ; ainsi l'ouvrier dit, j'ai fait ma longueur ; j'ai nettoyé ma longueur, c'est-à-dire, j'ai épluché toutes les bourres & noeuds de ma longueur.
|
| LONGUNTICA | (Géog. anc.) ville maritime d'Espagne. Il paroît d'un passage de Tite-Live, liv. XXII. c. xx. que Longuntica n'étoit pas loin de Carthagène ; quelques-uns conjecturent que c'est aujourd'hui Guardamar, place sur la côte du royaume de Valence.
|
| LONGW | ou LONWIC, (Géog.) en latin moderne Longus-Wicus ; petite ville de France, sur les frontieres du duché de Luxembourg, avec un château. Elle est divisée en ville vieille & en ville neuve ; cette derniere fut bâtie par Louis XIV. après la paix de Nimégue, & fortifiée à la maniere du maréchal de Vauban. Elle est sur une hauteur, à 6 lieues S. O. de Thionville, 67 N. E. de Paris. Long. 23. 26. 25. lat. 49. 31. 35. (D.J.)
|
| LONKITE | S. f. lonchitis, (Hist. nat.) genre de plante, dont les feuilles ne different de celles de la fougere, qu'en ce qu'elles ont une oreillette à la base de leurs découpures. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LONS-LE-SAUNIER | (Géog.) en latin Ledo, plus communément Ledo-Salinarius, & quelquefois Leodunum : on dit aussi par abus, Lion-le-Saunier, petite ville de France en Franche-comté, près du duché de Bourgogne. Elle prend son nom d'une auge, ou mesure d'eau salée, laquelle en terme de saunerie, s'appelle long. Gollut dit qu'un long contient 24 muids. Cette ville est située sur la petite riviere de Solvan ; à 8 lieues de Dôle, 9 de Châlons. Long. 23. 15. lat. 46. 36. (D.J.)
|
| LOOCH | ou LOOH, s. m. (Pharm. & Thérap.) mot pris de l'arabe, & les noms d'une composition pharmaceutique d'une consistance moyenne, entre le syrop & l'électuaire mou, destinée à être roulée dans la bouche, & avalée peu-à-peu, ou à être prise par très-petites portions, & en léchant. Les Grecs ont appellé cette préparation eclegma, & les Latins linctus. Le mot looch est depuis long-tems le plus usité, même chez les auteurs qui ont écrit en latin.
Le looch n'est composé que de remedes appellés pectoraux (voyez PECTORAL), & principalement des liquides, ou au moins mous, comme décoctions, eaux distillées, émulsions, huiles douces, syrops, mucilages délayés, miel, pulpes, gelées, conserves, &c. ou consistans, mais solubles, comme sucre, gomme, &c. On y fait entrer quelquefois aussi des matieres pulvérulentes, non solubles, comme de l'amydon, de la réglisse en poudre, des absorbans porphyrisés, &c. mais alors le remede est moins élégant & moins parfait.
Pour unir différens ingrédiens sous forme de looch, il n'y a 1°. s'ils sont tous vraiment miscibles, ou réciproquement solubles, qu'à y mêler exactement en agitant, triturant, appliquant une chaleur convenable ; en un mot procurant la dissolution ou combinaison réelle, ces différens ingrédiens employés en proportion convenable, pour que le mêlange achevé ait la consistance requise : cette proportion s'apprend facilement par l'usage, & un tâtonnement facile y conduit.
2°. Si les différens ingrédiens ne sont pas analogues, qu'il s'agisse, par exemple, d'incorporer une huile avec des liqueurs aqueuses & des gommes ; en joignant ces substances immiscibles par l'intermede des substances savonneuses, le sucre & le jaune d'oeuf, & en leur faisant contracter une union, au-moins superficielle, indépendamment de celle qui est procurée par cet intermede, par une longue conquassation, en les battant, & broyant long-tems ensemble.
Le looch blanc de la Pharmacopée de Paris, nous fournira & le modele de la composition la plus compliquée, & la plus artificielle du looch.
Looch blanc de la Pharmacopée de Paris réformé. Prenez quatre onces d'émulsion ordinaire, préparées avec douze amandes douces ; dix-huit grains de gomme adragant réduite en poudre très-subtile. Mettez votre gomme dans un mortier de marbre, & versez peu-à-peu votre émulsion, en agitant continuellement & long-tems, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la consistance de mucilage. Alors mêlez exactement avec une once de syrop de capillaire, & une once d'huile d'amandes douces, que vous incorporerez avec le mêlange précédent, en continuant d'agiter le tout dans le mortier, fournissant l'huile peu-à-peu : enfin vous introduirez par la même manoeuvre environ deux drachmes d'eau de fleurs d'orang.
Ce que j'appelle la réforme de ce looch, consiste à substituer de l'eau pure à une décoction de réglisse demandée dans les dispensaires, & qui ôte de l'élégance au remede, en ternissant sa blancheur, sans y ajoûter aucune vertu réelle ; & à mettre le syrop de capillaire à la place du syrop d'althéa de Fernel, & de celui de diacode, qui le rendent désagréable au goût, sans le rendre plus efficace. Les bons apoticaires de Paris préparent le looch blanc de la maniere que nous avons adoptée. Ils dérogent à cet égard à la loi de la Pharmacopée ; & certes c'est-là une espece d'infidélité plutôt louable, que condamnable, & presque de convention ; les Medecins qui connoissent le mieux la nature des remedes, l'approuvent, & ce suffrage vaut assurement mieux que la soumission servile à un précepte dicté par la routine.
Quant à l'usage médicinal, & à la vertu des looch, il faut observer premierement, qu'ils sont donnés, ou comme topiques, dans les maladies de la bouche & du gosier, en quoi ils n'ont absolument rien de particulier, mais agissant au contraire selon la condition commune des topiques (voyez TOPIQUE), ou bien qu'on les roule dans la bouche aussi long-tems qu'on peut les y tenir, sans céder au mouvement de la déglutition, qui est machinalement déterminé par ce roulement dans la bouche (quantùm patitur frustratae deglutitionis taedium), dans l'espoir que l'air à inspirer, qui passera à travers le looch retenu dans la bouche, se chargera, sinon de la propre substance, dumoins d'une certaine émanation du remede ; & qu'ainsi il arrivera au poumon empreint de la vertu médicamenteuse de ce remede.
Secondement, que le premier emploi du looch, c'est-à-dire, à titre de topique, est très-rare, pour ne pas dire absolument nul ; car, dans les cas de maladies de la bouche & du gosier, c'est presqu'uniquement le gargarisme qu'on emploie. Voyez GARGARISME.
Troisiemement, que le second emploi, à titre de pectoral, ou béchique incrassant, dirigé immédiatement vers le poumon par le véhicule de l'air inspiré, qui est très-ordinaire & très-usuel, est fondé sur un des préjugés des plus puériles, des plus absurdes, des plus répandus pourtant, non-seulement chez le peuple, mais même chez les gens de l'art, & dans les livres.
Car d'abord l'air ne peut certainement rien enlever des corps doux ou huileux, qui font la nature essentielle des looch, ni par une action menstruelle, car l'air ne dissout point ces substances grossieres ; ni par une action méchanique, car l'air ne traverse pas impétueusement la bouche, pour se porter par un courant rapide dans le poumon ; l'air est au contraire doucement attiré par l'inspiration ; d'où il est clair à priori, que l'air inspiré ne se charge d'aucune partie intégrante substantielle du looch. En second lieu, cette vérité est démontrée à posteriori, par cette observation familiere, vulgaire, qu'une seule goutte d'un liquide très-benin, blandissimi, d'eau pure, qui enfile l'ouverture de la glotte, occasionne sur le champ une toux convulsive, suffocante, qui s'appaise à peine par l'expulsion du corps dont la présence l'excitoit. Que seroit-ce si des matieres plus grossieres, plus irritantes, telles que sont celles qui composent le looch, si de pareilles matieres, dis-je, étoient portées dans la trachée-artere.
Quatriemement, que si on se restraint à prétendre que l'air ne se charge que d'une émanation d'une vapeur, la prétention est au moins tout aussi frivole ; car la matiere des looch n'exhale absolument qu'une substance purement aqueuse : c'est-là un fait très-connu des Chimistes. Ce n'est donc certainement pas la peine de rouler un looch dans la bouche pour envoyer de l'eau, un air humide au poumon. Si c'étoit là une vûe utile, il vaudroit mieux que le malade tînt continuellement devant la bouche, un vaisseau plein d'eau chaude, fumante, que de tenir sa bouche continuellement pleine de salive.
On emploie communément le looch, le blanc ci-dessus décrit principalement, pour servir de véhicule à des remedes qu'on donne peu-à-peu, & pendant toute la journée, le kermès minéral, par exemple. Cet usage a commencé d'après un préjugé : on a donné le kermès principalement destiné à agir sur la poitrine, dans un véhicule prétendu pectoral ; la vûe est certainement vaine, mais l'usage est indifférent. (b)
LOOCH BLANC, (Pharm. & Thérap.) voyez l'article précédent.
|
| LOOPEN | S. m. (Commerce) mesure pour les grains dont on se sert à Riga. Les 46 loopens font le last de cette ville ; ils font aussi le last d'Amsterdam. Voyez LAST. Dict. de Comm.
|
| LOOPER | S. m. (Comm.) mesure des grains dont on se sert dans quelques lieux de la province de Frise, particulierement à Groningue, à Leeuwarden & à Haarlingen. Trente-six loopers font le laste de ces trois villes, qui est de 33 mudes, ils font aussi trois hoeds de Roterdam. Voyez LAST & HOEDS. Dict. de Comm.
|
| LOOT | S. m. (Comm.) C'est ainsi qu'on nomme à Amsterdam la trente-deuxieme partie de la livre poids de marc. Le loot se divise en dix engels, & l'engel en 32 as. Voyez LIVRE. Dict. de Comm.
|
| LOPADIUM | ou LOPADI, (Géog. anc.) lieu de Natolie, que les Francs nomment Loubat. (D.J.)
|
| LOPOS | (Géog.) peuples sauvages de l'Amérique méridionale, au Bresil. Ils sont voisins des Motayes, petits de taille, de couleur brune, de moeurs rudes & farouches. Ils se tiennent dans les montagnes, où ils vivent de pignons, & de fruits sauvages. Delaet dit, que cette contrée abonde autant en métaux & en pierres précieuses, qu'aucune autre de l'Amérique, mais qu'elle est à une distance si grande de la mer, qu'on n'y peut aller que très-difficilement. (D.J.)
|
| LOQUE | S. f. (Jardinage) terme de jardinage, qui n'est autre chose qu'un petit morceau de drap, avec lequel on attache sur les murailles chaque branche & chaque bourgeon à leurs places, en y chassant un clou. On prétend que cette maniere de palisser les arbres, quoique moins élégante que les treillages peints en verd, est plus avantageuse aux fruits, & les blesse moins que le bois de treillage.
|
| LOQUET | S. m. (Serrurerie) fermeture que l'on met aux portes, où les serrures sont dormantes & sans demi-tour, ou à celles où il n'y a point de serrures.
Il y a le loquet à bouton. Il n'a qu'un bouton rond ou à olive ; la tige passe à-travers la porte ; au bout il y a une bascule rivée ou fixée avec un écrou, de maniere qu'en tournant le bouton, le battant pose sur la bascule qui se leve.
Le loquet à la capucine. Sa clé a une espece d'anneau ouvert selon la forme de la broche. Lorsque la broche est entrée dans sa serrure, on leve la clé, & en levant la clé on leve le battant auquel tient la broche.
Le loquet poucier ; c'est le commun. Il est fait d'un battant, d'un crampon, d'un poucier, d'une plaque, d'une poignée ou d'un mantonnet.
Le loquet à vrille ; c'est un loquet à serrure qui se pose en dehors, dans l'épaisseur du bois, s'ouvre à clé, est garni en-dedans de rouets & rateaux, & a au lieu de pêne, une manivelle comme celle d'une vrille, laquelle est fixée avec un étochio sur le palâtre. La clé mise dans la serrure, en tournant, fait lever la manivelle, dont la queue fait lever le battant qui étoit fermé dans le mantonnet.
LOQUETS, s. m. (Comm.) laine qu'on enleve de dessus les cuisses de bêtes à laine ; c'est la moins estimée ; on en fait des matelats. Elle entre aussi en trame dans la fabrication des droguets de Rouen.
LOQUET, en terme de vergettier, est un petit paquet de chiendent ou de soie, dont on remplit les trous du bois, & qui fait la brosse, à proprement parler.
|
| LOQUETEAU | S. m. (Serrurerie) c'est un loquet monté sur une platine dont le battant est percé au milieu d'un trou rond, en aîle, pour recevoir un étochio rivé sur la platine, au bord du derriere sur lequel il roule. Au bord antérieur de la platine, est posé verticalement un crampon dans lequel passe la tête du battant, qui excede la platine environ d'un pouce, pour entrer dans le mantonnet. Il faut que le crampon soit assez haut, pour que le battant se leve & se place dans le mantonnet. Sur la platine, audessus du battant, il y a un ressort à boudin ou à chien, dont les extrêmités passent sous le crampon, & agissent sur le battant qu'ils tiennent baissé. Le bout où est pratiqué l'oeil, est posé sur un étochio rivé sur la platine. Il y a au bout de la queue du battant un oeil où passe le cordon qui fait ouvrir. La partie du battant depuis l'oeil où est l'étochio sur lequel roule le battant, peut se lever. Ce qui est arrondi jusqu'à l'oeil où passe le cordon, se nomme queue du battant. Lorsque le battant du loqueteau n'a point de queue, il faut que l'oeil où passe le cordon soit percé à l'autre bout, & au bord de dessous de la tête du battant. Alors le ressort est posé sous le battant, & le mantonnet est aussi renversé. La raison de ce changement de position du mantonnet, c'est que quand le cordon étoit à la queue du battant, en tirant on faisoit lever la bascule & le battant. Or cela ne se peut plus, lorsque le cordon est à la tête du battant. Au contraire, en tirant le cordon on le feroit appuyer plus fort sur le mantonnet ; il a donc fallu retourner le mantonnet sen-dessus-dessous, afin d'ouvrir, & ce changement a entraîné le déplacement du ressort, pour qu'il tînt le battant levé, & poussé en-haut dans le mantonnet.
On appelle loqueteau à panache celui où le bout de la platine est découpé.
On place le loqueteau aux endroits à fermer, où l'on ne peut atteindre de la main, comme croisées, portes, contrevents, &c.
|
| LORARIUS | S. m. (Hist. anc.) homme armé de fouet, qui animoit au combat les gladiateurs, & qui les punissoit lorsqu'ils ne montroient pas assez de courage ; on les appelloit aussi pour châtier les esclaves paresseux ou coupables.
|
| LORBUS | (Géog.) ville d'Afrique, au royaume de Tunis en Barbarie. Le mot Lorbus paroît corrompu de urbs ; Marmol, tom. II. liv. vj. ch. xxx. entre dans d'assez grands détails sur cette ville, & dit qu'on y voyoit encore de son tems de beaux restes d'antiquité. Elle est dans une plaine très-fertile en blé, à 60 lieues O. de Tunis. Long. 26. 35. lat. 35. 35. (D.J.)
|
| LORCA | (Géog.) ancienne ville d'Espagne, au royaume de Murcie. Elle est fort délabrée, quoique située dans un pays fertile, sur une hauteur, au pié de laquelle coule le Guadalentin, à 6 lieues de la mer, 14 lieues S. O. de Murcie, 12. N. O. de Carthagène. Long. 16. 32. lat. 37. 25. (D.J.)
|
| LORD | S. m. (Hist. mod.) titre d'honneur qu'on donne en Angleterre à ceux qui sont nobles, ou de naissance, ou de création, & qui sont de plus revêtus de la dignité de baron. Voyez NOBLESSE & BARON.
Ce mot tire son origine de l'anglo-saxon, & il signifioit anciennement un homme qui donne du pain à d'autres, pour faire allusion à la charité & à l'hospitalité des anciens nobles. Il s'est formé selon Camden, de hlaxond qu'on a écrit depuis lofendet qui est composé de hlax, pain, & xond, fournir. Dans ce sens lord veut dire la même chose que pair du royaume, lord du parlement. Voyez PAIR & PARLEMENT.
On donne aussi par politesse en Angleterre, le titre de lord à tous les fils de ducs ou de marquis, & aux fils aînés des comtes.
Lord se donne aussi aux personnes distinguées par leurs grands emplois, comme le lord chef de la justice, le lord chancelier, le lord du trésor, de l'amirauté, &c. Voyez JUSTICE, CHANCELIER, TRESOR, AMIRAUTE.
Ce titre se donne encore à des personnes d'un rang inférieur, qui ont des terres seigneuriales, & à qui des personnes qui en relevent doivent hommage à leur manoir. Voyez FIEF & MANOIR.
Car ses vassaux l'appellent lord, & en quelques endroits lord de terre, pour le distinguer des autres. C'est dans cette derniere signification que les livres anglois de droit prennent le plus souvent le mot lord. Ils en distinguent de deux especes : lord paramount, ou seigneur suzerain, & lord mesne, ou seigneur direct. Lord ou seigneur direct, c'est celui qui rend foi & hommage à un autre seigneur, & qui en vertu de cela a des vassaux qui relevent de lui en fief, & par acte enregistré à la chambre des comptes, quoiqu'il releve lui-même d'un autre seigneur supérieur, qui s'appelle suzerain. Voyez SUZERAIN. On trouve aussi dans les livres de droit franc lord, ou franc seigneur, & franc vassal. Voyez FRANC. Franc lord ou seigneur est celui qui est seigneur immédiat de son vassal ; & franc vassal est celui qui releve immédiatement de son lord ou seigneur ; de sorte que lorsqu'il y a seigneur suzerain, seigneur direct & vassaux, le seigneur suzerain n'est pas franc seigneur des vassaux.
Lord, haut amiral d'Angleterre, est un des grands officiers de la couronne, dont l'autorité & les honneurs sont si considérables, qu'on en a rarement créé qui ne fussent des fils cadets du roi, ou ses proches parens ou alliés. Voyez AMIRAL. C'est lui à qui le roi remet le maniement & la direction de toutes les affaires maritimes, soit de jurisdiction, soit de protection, le commandement de la marine, & le pouvoir de décider toutes les différentes causes, tant civiles que criminelles, entre les sujets de sa majesté, soit sur les côtes, soit delà les mers. C'est aussi à lui qu'appartiennent les débris des naufrages, & les prises qu'on appelle lagonjetson & flotson, c'est-à-dire les marchandises qui sont restées flottantes sur la mer, ou tombées sur les côtes, excepté dans les royaumes où elles appartiennent au lord ou seigneur de terre, & avec tous les grands poissons nommés poissons royaux, excepté les baleines & les esturgeons, une part considérable des prises en tems de guerre, & les biens des pirates ou félons condamnés. Voyez FLOTSON, &c.
Le lord haut-amiral a sous lui plusieurs officiers de plus & de moins haut rang, les uns de mer, & les autres de terre ; les uns militaires, d'autres de plume ; les uns dans la judicature, d'autres dans le ministere, ou ecclésiastiques ; dans sa cour qu'on appelle cour de l'amirauté, tous les procès se jugent en son nom, & non pas en celui du roi, comme c'est la coutume dans les autres cours ; ensorte que le domaine & la jurisdiction de la mer peuvent être à juste titre considérés en Angleterre, comme une autre république ou un royaume à part ; & le lord, haut-amiral comme le viceroi de cette espece de royaume maritime ; il a sous lui un lieutenant qui est juge de l'amirauté ; c'est ordinairement un docteur en droit, d'autant que dans cette cour tous les procès en matiere civile se jugent suivant le droit civil ; mais quant aux matieres criminelles, on y procede par une commission particuliere de la secrétairerie, suivant les lois d'Angleterre. Voyez AMIRAUTE.
Le lord, grand-maître de la maison du roi, est le principal officier pour le gouvernement civil des domestiques du roi dans le bas, & non dans la chambre, ou passé l'escalier, & il a jurisdiction sur les officiers de la maison. Voyez GRAND MAITRE & MAISON. On l'investit de sa charge en lui délivrant le bâton blanc qu'on regarde comme la marque de son office ; & sans autre commission il juge de toutes les fautes commises dans la cour & dans la barre ou jurisdiction de la cour, & y rend des jugemens ou sentences, selon que le cas le requiert. A la mort du roi il porte son bâton sur le tombeau où le corps du roi est déposé, & il congédie par-là tous les officiers qui servoient sous lui.
Lord avocat. Voyez AVOCAT. Lord haut-trésorier. Voyez TRESORIER. Lord chambellan de la maison, lord grand-chambellan d'Angleterre. Voyez CHAMBELLAN. Lord haut-chancelier d'Angleterre. Voyez CHANCELIER. Lords de la chambre. Voyez CHAMBRE. Lords de la trésorerie. Voyez TRESORERIE.
Les lords des comtés ou provinces sont des officiers de grande distinction, que le roi charge de commander la milice de la comté, & de régler toutes les affaires militaires qui la concernent. Voyez COMTE. Ils sont généralement choisis de la premiere qualité, parmi les personnes les plus puissantes du pays. Ils doivent assembler les milices en cas de rébellion, & marcher à leur tête où le roi ordonnera. Voyez MILICE. Ces lords ont le pouvoir de donner des commissions de colonels, de majors, de capitaines, comme aussi de présenter au roi les noms des députés, lieutenans, lesquels doivent être choisis dans la meilleure noblesse de la comté ou province, & faire les fonctions des lords lieutenans en leur absence. Sous les lords lieutenans & les députés lieutenans, sont les juges de paix, qui selon les ordres qu'ils reçoivent des premiers, sont chargés de publier les ordres des hauts & petits connétables, pour le service militaire, &c.
LORD MAIRE, (Jurisprud.) est le premier magistrat de la ville de Londres. Son pouvoir dure un an ; il a la jurisdiction souveraine sur la ville, les fauxbourgs, & la Tamise ; sa cour est composée de plusieurs officiers, & l'on porte toûjours devant lui l'épée de justice ; le roi ne peut entrer dans la ville sans sa permission ; & même dans ce cas il faut qu'il la traverse sans suite. Le lord-maire doit toûjours être membre d'un des douze corps de métiers établis dans la ville, & on le tire par élection du corps des aldermans, qui sont les échevins : ceux-ci sont au nombre de 26, & leur fonction est à vie ; on ne peut même devenir lord-maire, sans avoir exercé le shériffat, qui est une fonction assez desagréable. Les shérifs sont élus tous les ans ; ils sont chargés de mettre à exécution les ordres du roi, & de faire mettre à exécution les sentences de mort. Ils sont aussi gardiens nés des prisons, & responsables envers les créanciers des sommes dûes par ceux qui s'en échappent. Voyez l'état abregé des lois, revenus, usages & productions de la Grande Bretagne. (A)
|
| LORDOSE | S. f. (Medecine) , maladie des os propre aux ulceres. Ce nom vient du grec qui signifie plié, courbé en-devant ; ainsi suivant l'étymologie & la signification rigoureuse, on appelle de ce nom l'état de l'épine opposé à la bosse, c'est-à-dire dans lequel les vertebres se courbent, se déjettent vers les parties antérieures, & laissent un vuide dans le dos ; c'est ainsi que Galien l'a défini, comment. III. in lib. de articul. où il dit que cette maladie n'est autre chose que la distorsion () de l'épine, sur le devant () occasionnée par cette inclinaison des vertebres : cependant Hippocrate moins exact, confond ce nom avec ceux de & de , par lesquels il désigne la bosse, lib. de articul. Ce vice, suite du rachitis, dépend absolument des mêmes causes que la bosse, & lorsqu'il est guérissable, c'est par les mêmes remedes ; il pourroit aussi être occasionné par un coup, par une chûte, &c. Voy. BOSSE. Cependant il faut remarquer que cet état-ci est beaucoup plus dangereux. Les visceres de la poitrine ou du bas-ventre sont beaucoup plus génés, lorsque l'épine se porte en-dedans ; il est impossible que leurs fonctions se fassent avec l'aisance requise ; aussi ne voit-on personne vivre avec une pareille maladie. Article de M. MENURET.
|
| LORETTE | (Géog.) petite & assez forte ville d'Italie, dans la marche d'Ancone, avec un évéché relevant du pape, & érigé par Sixte V. en 1586.
Malgré cet avantage, Lorette n'est qu'un pauvre lieu, peuplé seulement d'ecclésiastiques & de marchands de chapelets benis ; mais l'église & le palais épiscopal sont du dessein du célebre Bramante ; cependant l'église ne sert pour ainsi dire que d'étui à la chambre, où selon la tradition vulgaire du pays, Jesus-Christ lui-même s'est incarné ; & ce sont des anges qui ont transporté cette chambre, la casa santa, de la Palestine, dans la marche d'Ancone.
La casa santa a 32 piés d'Angleterre de longueur, 13 de largeur, & 17 de hauteur. On y voit une image de la sainte Vierge en sculpture, haute de 4 piés, & qu'on donne pour être l'ouvrage de Saint-Luc. Sa triple couronne couverte de joyaux, est un présent de Louis XIII. roi de France.
La chambre du trésor est un endroit spacieux, dont 17 armoires à doubles battans lambrissent les murs. On prétend que ces armoires sont remplies des plus riches offrandes en or pur, en vases, & en pierres précieuses ; mais bien des gens doutent de l'existence actuelle de toutes ces richesses.
Quoi qu'il en soit, Lorette est située sur une montagne, à 3 milles de la côte du golfe de Venise, 5 S. E. d'Ancone, 45 N. O. de Rome. Long. 31. 25. lat. 43. 24. ou plutôt selon la fixation du P. Viva, 43. 42.
Les Jésuites ont aussi une place dans l'Amérique septentrionale, au bord de la mer Vermeille, au pays de Concho, qu'ils ont nommée Lorette-concho, sur laquelle on peut lire les lettres édifiantes, tom. V. Ils ont là quelques bourgades, il n'y manque plus que des pélerins. (D.J.)
|
| LORETZ | LE, (Géog.) petite riviere de Suisse, au canton de Zug. Elle a sa source dans le lac d'Egeri, nommé sur la carte Egeri-sée, & se perd dans la Russ. (D.J.)
|
| LORGNETTE | S. f. (Dioptr.) on donne ce nom ou à une lunette à un seul verre qu'on tient à la main, ou à une petite lunette à tuyau, composée de plusieurs verres, & qu'on tient aussi à la main. Les lunettes à mettre sur le nez, ou les lunettes à long tuyau, s'appellent simplement lunettes. Voyez LUNETTES. Les lorgnettes s'appellent aussi par les Physiciens monocles, en ce qu'elles ont la propriété de ne servir que pour un seul oeil ; au lieu que les lunettes ou besicles servent pour les deux. Les lorgnettes à un seul verre doivent être formées d'un verte concave pour les myopes, & d'un verre convexe pour les presbytes. (Voyez MYOPE & PRESBYTE), parce que l'usage de ces lorgnettes est de faire voir l'objet plus distinctement. (O)
|
| LORGUES | (Géog.) en latin dans les anciennes chartres, Leonica, petite ville de France en Provence, chef-lieu d'une viguerie de même nom. Elle est située sur la riviere d'Argent, à deux lieues de Draguignan, cinq de Fréjus, 14 d'Aix, 172 S. O. de Paris. Long. 24 d. 2'. 1''. lat. 43 d. 29'. 31''. (D.J.)
|
| LORIN | S. m. (Corderie) corde qu'on attache à une ancre, & à l'autre extrêmité de laquelle on met un morceau de liége pour retrouver l'ancre, en cas que le gros cable s'en sépare. Voyez ANCRE.
|
| LORIOT | S. m. (Hist. nat. Ornitholog.) galbula Aldr. chloreus Arist. oriolus, Gesn. oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du merle. Il a neuf pouces & demi de longueur depuis l'extrêmité du bec jusqu'au bout de la queue, & environ seize pouces d'envergeure. La tête, la gorge, le cou, la partie antérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les petites plumes du dessous de la queue & des aîles, sont d'un beau jaune ; la partie postérieure du dos, le croupion, & les petites plumes du dessous de la queue, ont une couleur jaune mêlée d'olivâtre. Il y a une tache noire de chaque côté de la tête entre le bec & l'oeil ; les plumes des épaules ont du noir & du jaune olivâtre ; les petites plumes du dessus de l'aîle sont noires, quelques-unes ont du jaune pâle à la pointe ; les grandes plumes des aîles sont noires en entier ou bordées de blanc pur ou de blanc jaunâtre ; les deux plumes du milieu de la queue sont en partie de couleur d'olive, en partie noires & terminées par un point jaune ; les autres sont noires & jaunes ; le bec est rouge, les piés sont livides, & les ongles noirâtres. Cet oiseau suspend son nid avec beaucoup d'art à des branches d'arbres : les couleurs de la femelle ne sont pas si belles que celles du mâle. Voyez l'Ornithologie de M. Brisson, où sont aussi les descriptions des loriots de la Cochinchine, des Indes, & de Bengale, & du loriot à la tête rayée. Voyez OISEAU.
|
| LORMERIE | S. f. ouvrage de Lormerie, (Cloutier) sous ce mot sont compris tous les petits ouvrages de fer qu'il est permis aux maîtres Cloutiers-Lormiers de forger & fabriquer, comme gourmettes de chevaux, anneaux de licols & autres. Voyez CLOUTIER.
|
| LORMIER | S. m. (Cloutier) qui fait des ouvrages de Lormerie. Les Cloutiers, Selliers, & Eperonniers, sont qualifiés dans leurs statuts maîtres Lormiers, parce qu'il est permis aux maîtres de ces trois arts de faire des ouvrages de Lormerie, savoir aux deux premiers sans se servir de lime ni d'estoc, & aux derniers en les limant & les polissant.
|
| LOROS | S. m. (Hist. nat.) nom que les Espagnols donnent à une espece de perroquet commun dans le Mexique & les autres parties de la nouvelle Espagne. Ses plumes sont vertes, mais sa tête & l'extrêmité de ses aîles sont d'un beau jaune. Il y a encore une petite espece de perroquets de la même couleur, mais qui ne sont pas plus gros que des grives ; on les nomme periccos.
|
| LORRAINE | (Géog.) état souverain de l'Europe, entre les terres de l'empire, & celles du royaume de France. Plusieurs écrivains, entr'autres le P. Calmet, ont donné l'histoire intéressante de cet état, en 7 vol. in-fol. nous n'en dirons ici que deux mots.
Le premier sort des peuples qui l'habitoient, fut de subir le joug des Romains comme les autres Gaulois ; ils obéirent à ces maîtres du monde, jusqu'au commencement de la monarchie françoise.
Ce pays fit la plus considérable partie du royaume d'Austrasie, qui se forma dans les partages des enfans de Clovis & de Clotaire. Il ne changea de nom que sous le regne du jeune Lothaire, fils de l'empereur Lothaire, & sous lequel il eut le titre de royaume, regnum Lotharii ; d'où l'on fit Lotharingia, & de Lotharingia, vint le vieux mot françois Loherregne : depuis pour Loherregne, on a dit Lorrène, & enfin Lorraine. Ce pays dans le xiij. siecle se nommoit aussi Lothier, comme il paroît par une publication de paix de l'an 1300, qui commence ainsi : " Jehan, par la grace de Dieu, duc de Lothier, de Braibant & Lemboure "....
La Lorraine fut par succession de tems divisée en deux grands duchés, dont l'un s'appelle Lorraine supérieure, ou Lorraine Mosellane, & l'autre Lorraine inférieure, ou Lorraine sur la Meuse.
Enfin, la Lorraine fut réduite à une bien petite portion du pays qui avoit porté ce nom, & ne fut plus connue que sous la simple dénomination de duché de Lorraine, dont nous devons parler ici.
Cet état est borné au nord par les évêchés de Metz, Toul, & Verdun, par le Luxembourg, & par l'archevêché de Treves ; à l'orient par l'Alsace, & par le duché des Deux-ponts ; au midi par la Franche-Comté, & au couchant par la Champagne & par le duché de Bar. Il a 35 à 40 lieues de long depuis Longwick jusqu'à Philipsbourg, & 25 à 30 lieues de large depuis Bar jusqu'à Vaudrange. Nancy en est la capitale.
Ce pays abonde en grains, vins, chanvre, gibier & poisson ; il s'y trouve de vastes forêts, des mines de fer, & plusieurs salines. Il est arrosé d'un grand nombre de rivieres, dont les plus considérables sont la Meuse, la Moselle, la Seille, la Meurte, la Saône & la Sare. Jaillot est le géographe qui en a donné la meilleure carte.
Les terres du domaine de la Lorraine comprennent quatre grands bailliages ; le bailliage de Nancy, celui de Vosge, celui de Bassigni, & le bailliage allemand, appellé aussi la Lorraine allemande.
Les ducs de Lorraine descendent en ligne directe masculine de Gerard d'Alsace, comte de Castinach, issu d'une noble & ancienne maison du pays ; & oncle de l'empereur Conrard. Henri le Noir empereur, lui donna la Lorraine supérieure à titre de duché, en 1048, & ses descendans en ont joui jusqu'au traité conclu à Vienne en 1738, par lequel ce duché est cédé au roi Stanislas I. pendant sa vie, pour être réuni à la couronne de France après la mort de ce prince ; c'est l'ouvrage du cardinal de Fleuri. Ainsi par la sagesse de ce ministre, cette province a eu pour la derniere fois un prince résident chez elle & ce souverain l'a rendue très-heureuse ; son nom sera long-tems cher aux habitans d'un pays dont il est le pere. (D.J.)
|
| LORRÉ | adj. (Blason) en termes de Blason se dit des nageoires des poissons.
|
| LORRIS | (Géog.) petite ville de France en Orléanois, située dans les marécages, à six lieues de Montargis. Cette ville a une coutume singuliere qui porte son nom, & qui s'étend assez loin. Elle fut rédigée en 1531 ; le sieur de la Thaumassiere a fait un ample commentaire sur cette coutume, qui parut à Bourges en 1679 in-fol. C'est un grand malheur que cette multiplicité de coutumes dans ce royaume, & cette foule de commentateurs qu'un avocat doit avoir dans sa bibliotheque ; mais il ne s'agit pas ici de déplorer nos folies, il est question d'une ville dont la long. est 20. 24. la lat. 47. 55.
Guillaume de Lorris prit ce surnom parce qu'il naquit dans cette ville sous le regne de S. Louis. Fauchet & la Croix du Maine, racontent qu'il entreprit de composer le fameux roman de la Rose, pour plaire à une dame qu'il aimoit. Il mourut vers l'an 1260, sans avoir achevé cet ouvrage, qui a été continué par Jean Clopinel, dit de Meun, sous le regne de Philippe-le-Bel. (D.J.)
|
| LOSANGE | S. m. (Géom.) espece de parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux & chacun parallele à son opposé, & dont les angles ne sont point droits, mais qui en a deux aigus opposés l'un à l'autre, & deux autres obtus opposés aussi l'un à l'autre. Voyez PARALLELOGRAMME.
Quelques-uns n'appellent losange, que celui où la diagonale qui joint les deux angles obtus, est égale aux côtés du losange ; mais la dénomination générale a prévalu.
Scaliger dérive le mot losange, de laurengia, parce que cette figure ressemble à quelques égards à la feuille de laurier. On l'appelle ordinairement rhombe en Géométrie, & rhomboïde, quand les côtés contigus sont inégaux. Voyez RHOMBE & RHOMBOÏDE. Chambers. (E)
LOSANGE, (Menuiserie) est un quarré qui a deux angles aigus. Les Menuisiers en mettent dans le milieu des panneaux des pilastres pour en interrompre la longueur.
LOSANGE, (Pâtisserie) c'est un gâteau feuilleté & glacé de nompareilles, c'est-à-dire d'ouvrages de confiserie de plusieurs couleurs & de toutes façons.
LOSANGE, terme de Blason, figure à quatre pointes, dont deux sont un peu plus étendues que les autres, & qui est assise sur une de ces pointes : les filles portent leur écu en losange.
|
| LOSANGÉ | en terme de Blason, se dit de l'écu & de toute figure couverte de losange.
Craon en Anjou, losangé d'or & de gueules.
|
| LOSON | (Géog.) nom de deux petites rivieres de France, l'une en Béarn, qui se perd dans le Gave, l'autre dans le Cotantin, qui finit son cours dans la riviere de Tante. (D.J.)
|
| LOT | S. m. (Jurisprud.) signifie portion d'une chose divisée en plusieurs parties pour la partager & distribuer entre plusieurs personnes.
Dans les successions, quand l'aîné fait les lots, c'est ordinairement le cadet qui choisit.
Quelquefois on les fait tirer au sort par un enfant, ou bien la distribution s'en fait par convention.
Entre co-héritiers, les lots sont garans les uns des autres. Voyez HERITIER, PARTAGE, SUCCESSION.
Tiers lot, en matiere bénéficiale, est celui qui est destiné à acquiter les charges, les deux autres étant l'un pour l'abbé commendataire, l'autre pour les religieux. Voyez ABBE, BENEFICE, RELIGIEUX, REPARATIONS. (A)
LOT, se dit aussi en termes de loterie, de la part en argent, en bijoux, en meubles, marchandises, &c. dont est composée une loterie & que le hasard fait tomber à quelques-uns de ceux qui y ont mis. On appelle gros-lot celui qui est le plus considérable de tous. Dictionnaire de Commerce.
LOT, (Mesure des liquides) vieux mot de notre langue, qui entr'autres significations, dit Ménage, désigne une mesure de choses liquides ; ensuite cet auteur nous renvoie pour l'explication, au Glossaire de Ducange, lequel ne nous instruit pas mieux ; mais Cotgrave nous apprend que le lot est une mesure contenant un peu plus de deux pintes d'eau ; Borel, dans ses recherches & antiquités gauloises, remarque qu'en 1351, le lot de vin valoit deux deniers.
LOT, le, (Géog.) riviere de France ; ses anciens noms latins sont, selon Baudrand, Olda, Oldus, Olindis, Olitus, & plus récemment Lotus. Il prend sa source dans le Gévaudan, au-dessous de la ville de Mende, & se jette dans la Garonne à Aiguillon. Il commence d'être navigable à Cahors, & quoiqu'il ne le soit que par des écluses, sa navigation est très-utile. (D.J.)
|
| LOTARIUS | S. m. (Hist. anc.) homme qui se rendoit de bonne heure aux spectacles & prenoit une place commode, qu'il cédoit ensuite à quelque personne riche pour une legere rétribution.
|
| LOTE | S. f. (Hist. nat. Icthiolog.) mustella fluviatilis ; vel locustris, Rond. poisson de lac & de riviere qui differe de la mustelle vulgaire de mer, en ce qu'elle a le corps moins rond & moins épais. La lote a un barbillon au bout de la machoire de dessous, deux nageoires près des ouies, deux au-dessous, une au-delà de l'anus qui s'étend jusqu'à la queue, une aussi grande sur la partie postérieure du dos, & enfin une petite nageoire au-devant de la grande du dos. La queue ressemble à la pointe d'une épée ; le corps a de petites écailles & une couleur mêlée de roux & de brun, avec des taches noires disposées en ondes. Rondelet, hist. des poissons des lacs.
|
| LOTERIE | S. f. (Arithmetique) espece de jeu de hasard dans lequel différens lots de marchandises ou différentes sommes d'argent sont déposées pour en former des prix & des bénéfices à ceux à qui les billets favorables échoient. L'objet des loteries & la maniere de les tirer, sont des choses trop communes pour que nous nous y arrêtions ici. Nos loteries de France ont communément pour objet de parvenir à faire des fonds destinés à quelques oeuvres pieuses ou à quelque besoin de l'état ; mais les loteries sont très fréquentes en Angleterre & en Hollande, où on n'en peut faire que par permission du magistrat.
M. Leclerc a composé un traité sur les loteries, où il montre ce qu'elles renferment de louable & de blâmable. Grégorio Leti a donné aussi un ouvrage sur les loteries, & le P. Menetrier a publié en 1700 un traité sur le même sujet, où il montre l'origine des loteries, & leur usage parmi les Romains ; il distingue divers genres de loteries, & prend de-là occasion de parler des hasards & de resoudre plusieurs cas de conscience qui y ont rapport. Chambers.
Soit une loterie de n billets dans laquelle m soit le prix du billet, m n sera l'argent de toute la loterie ; & comme cet argent ne rentre jamais en total dans la bourse des intéressés pris ensemble, il est évident que la loterie est toujours un jeu desavantageux. Par exemple, soit une loterie de 10 billets à 20 livres le billet, & qu'il n'y ait qu'un lot de 150 livres, l'espérance de chaque intéressé n'est que de 150/10 liv. = 15 l. & sa mise est de 20 liv. ainsi il perd un quart de sa mise, & ne pourroit vendre son espérance que 15 l. Voyez JEU, AVANTAGE, PROBABILITE, &c.
Pour calculer en général l'avantage ou le desavantage d'une loterie quelconque, il n'y a qu'à supposer qu'un particulier prenne à lui seul toute la loterie, & voir le rapport de ce qu'il a déboursé à ce qu'il recevra, soit m l'argent déboursé, ou la somme de la valeur des billets, & n la somme des lots qui est toujours moindre, il est évident que le desavantage de la loterie est . Voyez AVANTAGE, JEU, PARI, PROBABILITE, &c.
Si une loterie contient n billets & m lots, on demande quelle probabilité il y a qu'on ait un lot, si on prend r billets. Prenons un exemple : on suppose en tout 20 billets, 15 lots, & par conséquent 15 billets qui doivent sortir, & qu'on ait pris 4 billets : on représentera ces 4 billets par les quatre premieres lettres de l'alphabet, a, b, c, d, & les 20 billets par les vingt premieres lettres du même alphabet. Il est visible, 1°. que la question se réduit à savoir combien de fois 20 lettres peuvent être prises quinze à quinze ; 2°. quelle probabilité il y a que l'un des 4 billets se trouve dans les 15. Or l'article COMBINAISON apprend que vingt choses peuvent être combinées quinze à quinze au nombre de fois représenté par une fraction dont le dénominateur est 1. 2. 3. 4. &c. jusqu'à 15. & le numérateur 6. 7. 8... &c. jusqu'à 6 + 14 ou 20. A l'égard de la seconde question, elle se réduit à savoir combien de fois 20 billets (excepté les quatre a, b, c, d.) peuvent être pris quinze à quinze, c'est-à-dire combien de fois 16 billets peuvent être pris quinze à quinze, ce qui s'exprime (Voyez l'article COMBINAISON) par une fraction dont le dénominateur 1. 2. 3. 4. &c. jusqu'à 15. & le numérateur 2. 3. 4. jusqu'à 2 + 14 ou 16. Donc la probabilité cherchée est en raison de la premiere de ces deux fractions, moins la seconde à la premiere ; car la différence des deux fractions exprime évidemment le nombre de cas où l'un des billets a, b, c, d, sortira de la roue. Donc cette probabilité est en raison de 6. 7. 8.... 20 - 2. 3. 4.... 16 à 6. 7. 8.... 20, c'est-à-dire de 17. 18. 19. 20 - 2. 3. 4. 5. à 17. 18. 19. 20.
Donc en général la probabilité cherchée est exprimée par le rapport de (n - m + 1. n - m + 2.... n) - (n - r - m + 1. n - r - m + 2.... n - r) à (n - m + 1. n - m + 2.... n) D'où l'on voit que si n - r - m + 1 = 0 ou est négatif, on jouera à jeu sûr. Si, par exemple, dans le cas précédent au lieu de 4 billets on en prenoit 6, alors on auroit n - r - m + 1 = 20 - 6 - 15 + 1 = 0 ; & il y auroit certitude d'avoir un lot, ce qui est évident, puisque si de 20 billets on en prend 6 & qu'il en doive sortir 15 de la roue, il est infaillible qu'il en sortira un des 6, les autres ne faisant ensemble que 14. Voyez JEU, &c. (O)
LOTERIE, (Jeu). Ce jeu est ainsi nommé de la ressemblance qu'il y a entre la maniere de le jouer & de tirer une loterie ; il est d'ailleurs fort récréatif & d'un grand commerce. Il n'est beau qu'autant qu'on est beaucoup de monde à le jouer ; mais il ne faut pas être moins de quatre. On prend deux jeux de cartes où sont toutes les petites ; l'un sert pour faire les lots, & l'autre les billets. Voyez LOTS & BILLETS. Quand on est convenu du nombre des jettons que chacun doit avoir devant soi, de leur valeur & des autres choses qui regardent le jeu & les joueurs, deux des joueurs prennent chacun un jeu de cartes (ce sont les premiers venus, car il n'y a nul avantage d'être premier ou dernier à ce jeu) ; & après les avoir battues & fait couper à ceux qui sont à leur gauche, l'un d'eux en met une devant chaque joueur de façon qu'elle ne peut être vûe. Quand toutes ces cartes sont ainsi rangées sur la table, chaque joueur met le nombre des jettons qu'il juge à-propos sur celle qui est vis-à-vis de lui, faisant attention à ce que ces jettons ne soient point de nombre égal. Les lots ainsi chargés, celui qui a l'autre jeu de cartes en donne à chacun une : ensuite on tourne les lots, & alors chaque joueur voit si sa carte est semblable à quelqu'une des lots, c'est-à-dire que s'il a pour billet un valet de coeur, une dame de carreau, & que quelqu'un des lots soit une dame de carreau ou un valet de coeur, il gagne ce lot, & ainsi des autres.
Les lots qui n'ont pas été enlevés sont ajoutés au fond de la loterie, pour être tirés au coup suivant, & on continue à jouer ainsi jusqu'à ce que le fonds de la loterie soit tout tiré. Voyez LOTS, BILLETS.
Lorsque la partie est trop long-tems à finir, on double ou on triple les billets qu'on donne à chaque, mais toujours cependant l'un après l'autre : la grosseur des lots abrege encore beaucoup la partie.
LOTERIES des Romains, (Hist. rom.) en latin pittacia, n. pl. dans Pétrone.
Les Romains imaginerent pendant les saturnales des especes de loteries, dont tous les billets qu'on distribuoit gratis aux conviés, gagnoient quelque prix ; & ce qui étoit écrit sur les billets se nommoit apophoreta. Cette invention étoit une adresse galante de marquer sa libéralité & de rendre la fête plus vive & plus intéressante, en mettant d'abord tout le monde de bonne humeur.
Auguste goûta beaucoup cette idée ; & quoique les billets des loteries qu'il faisoit consistassent quelquefois en de pures bagatelles, ils étoient imaginés pour donner matiere à s'amuser encore davantage ; mais Néron, dans les jeux que l'on célébroit pour l'éternité de l'empire, étala la plus grande magnificence en ce genre. Il créa des loteries publiques en faveur du peuple de mille billets par jour, dont quelques-uns suffisoient pour faire la fortune des personnes entre les mains desquels le hasard les distribuoit.
L'empereur Héliogabale trouva plaisant de composer des loteries moitié de billets utiles & moitié de billets qui gagnoient des choses risibles & de nulle valeur. Il y avoit, par exemple, un billet de six esclaves, un autre de six mouches, un billet d'un vase de grand prix, & un autre d'un vase de terre commune, ainsi du reste.
Enfin en 1685 Louis XIV. renouvella dans ce royaume la mémoire des anciennes loteries romaines : il en fit une fort brillante au sujet du mariage de sa fille avec M. le Duc. Il établit dans le salon de Marly quatre boutiques remplies de ce que l'industrie des ouvriers de Paris avoit produit de plus riche & de plus recherché. Les dames & les hommes nommés du voyage, tirerent au sort les bijoux dont ces boutiques étoient garnies. La fête de ce prince étoit sans doute très-galante, & même à ce que prétend M. de Voltaire, supérieure en ce genre à celle des empereurs romains. Mais si cette ingénieuse galanterie du monarque, si cette somptuosité, si les plaisirs magnifiques de sa cour eussent insulté à la misere du peuple, de quel oeil les regarderions-nous ? (D.J.)
|
| LOTH | ou LOOT, s. m. (Commerce) poids usité en Allemagne, & qui fait une demi-once ou la trente-deuxieme partie d'une livre commune.
|
| LOTHIANE | (Géog.) en latin Laudamia, province maritime de l'Ecosse méridionale, sur le golfe de Forth. C'est la plus belle, la plus fertile & la plus peuplée de toute l'Ecosse. On la divise en trois parties, l'une orientale, l'autre occidentale, & une troisieme qui est celle du milieu, nommée par cette raison mid-Lothian ; c'est dans cette derniere partie qu'est Edimbourg, capitale de l'Ecosse. (D.J.)
|
| LOTIER | lotus, s. m. (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur légumineuse ; il sort du calice un pistil qui devient dans la suite une silique divisée dans quelques especes en cellules par des cloisons transversales ; cette silique renferme des semences ordinairement arrondies. Ajoutez à ces caracteres qu'il y a trois feuilles sur un même pédicule, dont la base est encore garnie de deux autres feuilles. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE.
LOTIER odorant, (Botan.) ou treffle odoriférant, ou treffle musqué. C'est une des especes de mélilot, c'est le melilotus major, odorata, violacca de Tournefort, I. R. H. 407, lotus hortensis, odora de C.B.P. 331. Trifolium odoratum de Gérard, de Parkinson & de Ray, histor. I. 950.
Sa racine est menue, simple, blanche, ligneuse, garnie de quelques fibres. Sa tige est au-moins haute d'une coudée, droite, grêle, cannelée, un peu anguleuse, lisse, creuse & branchue dès le bas. Ses feuilles naissent alternativement portées trois ensemble sur une longue queue ; elles sont d'un verd pâle, lisses, dentelées tout autour : celles du bas des tiges sont obtuses, plus courtes & plus arrondies : celles du haut sont plus longues & plus pointues. Dos aisselles des feuilles supérieures sortent de longs pédicules qui portent des épics ou des bouquets de petites fleurs légumineuses d'un bleu clair, répandant une odeur aromatique un peu forte, mais agréable, & qui dure même lorsque la plante est arrachée & sechée. Il s'éleve du calice de chaque fleur un pistil qui se change en une capsule dure, nue, c'est-à-dire qui n'est pas cachée dans le calice comme dans le treffle, & qui renferme deux ou trois graines jaunes odorantes & arrondies. Cette plante est annuelle : on la cultive dans les jardins pour sa bonne odeur. (D.J.)
LOTIER odorant, (Mat. med.) treffle musqué, ou faux baume du Pérou.
Les feuilles & les fleurs de cette plante sont d'usage en Medecine.
Cette plante déterge, digere, calme les douleurs, résout le sang épanché & grumelé, & consolide les plaies. Quelques-uns même la mettent au nombre des alexipharmaques : on la mêle dans les potions vulnéraires avec les autres plantes vulnéraires. Les sommités fleuries prises à la dose d'un gros en décoction dans du vin ou dans de l'hydromel, guérissent la pleurésie en procurant la sueur. Cette même décoction excite les regles & les urines : on dit qu'on la donne encore utilement, ou la graine pilée à la dose d'un gros dans du vin, contre le poison, quand on croit avoir été empoisonné.
On l'emploie extérieurement dans les décoctions & les fomentations vulnéraires. On fait avec les sommités fleuries, macerées dans l'huile commune, une huile qui est très-recommandée pour réunir les plaies & les défendre de l'inflammation, pour guérir les hernies des ensans, pour amollir & faire aboutir les tumeurs.
On met dans les habits la plante quand elle est séche, & l'on croit qu'elle empêche qu'ils ne soient mangés des vers. L'eau distillée passe pour vulnéraire & ophthalmique. Geoffroi, mat. med.
|
| LOTION | S. f. (Chimie) l'action de laver. Ce mot n'est usité, & même peu usité, que dans la Chimie pharmaceutique ; il s'emploie dans le même sens que celui d'édulcoration, & ce dernier est beaucoup plus en usage. Voyez EDULCORATION. L'action de laver, dans les travaux de la Métallurgie, s'appelle lavage, voyez LAVAGE. (b)
LOTION, (Med. therap.) l'action de laver différentes parties du corps, comme la tête, les mains & les piés : c'est-là une espece de bain, voyez BAIN. La lotion des piés, qui est la plus usitée des lotions medicinales & celle dont les effets sont les mieux observés, est connue dans l'art sous le nom de pédiluve, voyez PEDILUVE.
C'est un usage établi chez plusieurs peuples, & principalement chez ceux qui habitent les pays du Nord, de se laver habituellement la tête, les piés & les mains avec de l'eau froide : cette pratique est recommandée par plusieurs medecins, tant anciens que modernes, & Locke la recommande beaucoup dans son traité de l'éducation des enfans. Nous sommes assez portés à la croire salutaire, sur-tout lorsqu'on s'y est accoutumé dès la plus tendre enfance. Nous en avons parlé à l'article EAU, Matiere médicale. Voyez cet article (b)
|
| LOTISSAGE | S. m. (Commerce) c'est la division que l'on fait de quelque chose en diverses parts, pour être tirées au sort entre plusieurs personnes.
Ce terme n'est guere usité que dans les communautés de Paris, qui font lottir les marchandises foraines qui arrivent dans leurs bureaux. Voyez LOTISSEMENT.
|
| LOTISSEMENT | S. m. (Comm.) est le partage qui se fait au sort d'une marchandise arrivante à un port, ou dans un marché, ou à un bureau de marchands, entre les différens marchands qui se présentent pour acheter, c'est un très-bon expédient pour empêcher le monopole des riches marchands ou artisans, qui enleveroient toute la marchandise au préjudice de ceux de leurs confreres qui sont plus pauvres qu'eux. Voyez ENEAU.
|
| LOTISSEUR | S. m. (Commerce) celui qui fait le partage & la division des lots. La plûpart des communautés qui font lottir des marchandises, ont des lotisseurs choisis d'entre les maîtres de la communauté ; quelques-unes, comme celle des corroyeurs, ont des lotisseurs en titre d'office. Dict. de commerce.
|
| LOTOPHAGES | (Géog. anc.) peuples d'Afrique, auprès du golfe de la Sidre, ainsi nommés, parce qu'ils se nourrissoient du fruit du lotus. Ptolémée, l. III. c. iv. place l'île des lotophages, Lotophagites insula, dans le même golfe. On croit que c'est présentement l'île de Zerbi, que nous appellons l'île de Gerbes.
Ulysse, dit Homere, ayant été jetté par la tempête sur la côte des Lotophages, envoya deux de ses compagnons pour la reconnoître. Les habitans enchantés de l'abord de ces deux étrangers, ne songerent qu'à les retenir auprès d'eux, en leur donnant à goûter de leur lotus, ce fruit agréable qui faisoit oublier la patrie à tous ceux qui en mangeoient ; c'est qu'on l'oublie naturellement au milieu des plaisirs. (D.J.)
|
| LOTUS | LE, s. m. (Botan.) nom commun à plusieurs genres de plantes, & qui peut justifier que les Botanistes modernes ne sont pas toujours exempts des défauts d'homonimie qu'ils reprochent à leurs prédécesseurs.
Saumaise a perdu son tems & ses peines à vouloir découvrir quelles sont les diverses plantes auxquelles les anciens ont donné le nom de lotus. Tout ce qu'il en dit, n'est qu'un étalage d'érudition qui ne répand aucune lumiere sur ce sujet. Il est clair qu'il ne faut pas espérer de rien apprendre par l'étymologie du nom, parce que ce nom est commun à beaucoup de plantes, & que Théophraste avoue qu'il y en a effectivement plusieurs qui le portent.
Cependant à force de recherches, il semble dumoins que nous soyons parvenus à connoître aujourd'hui le lotus en particulier, dont parle le même Théophraste, le lotus, dis-je, qui croissoit en Egypte & au bord du Nil.
Le merveilleux qui se lit dans la description qu'en a donné cet auteur, avoit tellement & si long-tems ébloui les Botanistes, que ne trouvant rien de plus commun dans les campagnes arrosées par le Nil que des nymphaea, ils ont été des siecles entiers à n'oser croire que c'en fût un.
Abanbitar, savant medecin de Malaga, est le premier qui l'ait reconnu pour tel, dans le voyage qu'il fit au Caire avec Saladin, au commencement du xiij. siecle. Prosper Alpin en est convenu depuis ; & de nos jours, M. Lippi, à qui l'amour de la Botanique fit entreprendre en 1704 le voyage de la haute Egypte, a confirmé cette notion dans les mémoires de ses découvertes, qu'il envoyoit à M. Fagon, premier medecin du feu roi.
La figure que nous en avons la plus conforme à la description de Théophraste, nous a été donnée d'après nature par l'auteur du recueil des plantes de Malabar ; les parties qui en sont représentées sur les monumens, s'y trouvent très conformes. La fleur est de toutes ces parties celle qui s'y remarque le plus ordinairement en toutes sortes d'états ; ce qui vient du rapport que ces peuples croyoient qu'elle avoit avec le soleil, à l'apparition duquel elle se montroit d'abord sur la surface de l'eau, & s'y replongeoit dès qu'il étoit couché ; phénomene d'ailleurs très-commun à toutes les especes de nymphaea.
C'étoit-là l'origine de la consécration que les Egyptiens avoient faite de cette fleur à cet astre, le premier & le plus grand des dieux qu'ils ayent adoré. De-là vient la coûtume de la représenter sur la tête de leur Osiris, sur celles d'autres divinités, sur celle même des prêtres qui étoient à leur service. De tous tems & en tous pays les prêtres ont voulu partager les honneurs qu'on rend aux divinités qu'ils servent.
Les rois d'Egypte affectant les symboles de la divinité, se sont fait des couronnes de cette fleur. Elle est aussi représentée sur les monnoies, tantôt naissante, tantôt épanouie, & environnant son fruit. On la voit avec sa tige comme un sceptre royal dans la main de quelques idoles.
Le lotus de Théophraste est donc l'espece de nénuphar, nommée nymphaea alba, major, aegyptiaca, par quelques-uns de nos Botanistes, & que Prosper Alpin a si bien décrite dans son second livre des plantes d'Egypte, chap. xvj.
Sa tige ressemble à celle de la feve, & pousse quantité de fleurs blanches, comme celles du lis. Ses fleurs se resserrent, plongent la tête dans l'eau quand le soleil se couche, & se redressent quand il paroît sur l'horison. Il porte une tête & une graine comme le pavot, ou semblable au millet dont les Egyptiens faisoient autrefois du pain, ainsi que le témoignent Hérodote & Théophraste. Cette plante a une racine faite en forme de pin, qui est bonne à manger crue & cuite.
Il y a une autre espece de lotus ou de nymphaea, dont Cluvius & Herman nous ont donné des figures, & qui ne differe de la précédente que par la couleur incarnate de sa fleur. Cette fleur, au rapport d'Athénée, liv. XV. est celle qu'un certain poëte présenta comme une merveille, sous le nom de lotus antoien, à l'empereur Hadrien, qui renouvella dans Rome le culte d'Isis & de Sérapis.
Le fruit de cette plante, qui a la forme d'une coupe de ciboire, en portoit le nom chez les Grecs. Dans les bas reliefs, sur les médailles & sur les pierres gravées, souvent elle sert de siege à un enfant, que Plutarque dit être le crépuscule, à cause de la similitude de couleur de ce beau moment du jour avec cette fleur. Le lotus antoien est vraisemblablement la même chose que la feve d'Egypte, qui a été assez amplement décrite par Théophraste.
Les autres lotus mentionnés dans les écrits des anciens sont des énigmes qu'on n'a point encore devinées. Nous n'avons point vu ces plantes dans leur lieu natal pour les reconnoître, & les descriptions qui nous en restent sans figures sont très-vagues, très-courtes & très-imparfaites.
Les modernes n'ont que trop imité les anciens à imposer le nom de lotus à plusieurs genres de plantes différentes, à les mal caractériser, à en donner de mauvaises représentations & des descriptions incomplete s. C'est un nouveau chaos, qu'on a bien de la peine à débrouiller.
Il y a d'abord le lotus, en françois lotier ou treffle sauvage, genre de plante particulier, dont on compte vingt-trois especes.
Il y a le lotus ou melilotus vulgaris, en françois mélilot, autre genre de plante, qui renferme 14 ou 15 especes. Voyez MELILOT.
Il y a le lotus hortensis, odora, en françois lotier odorant, treffle musqué, qu'on peut regarder comme une espece de mélilot. Voyez LOTIER ODORANT.
Il y a le lotus d'Afrique, qui est le guajacana augustiore flore de Tournefort, plante originaire des Indes occidentales, & que les Anglois nomment Indian-date-plumb-tree.
Enfin il y a le lotus arbor africana, que nous appellons en françois micocoulier ; cet arbre dont le fruit parut si délicieux aux compagnons d'Ulysse, qu'après en avoir mangé, il fallut user de violence pour les faire rentrer dans leurs vaisseaux. Voyez donc MICOCOULIER. (D.J.)
|
| LOUAGE | S. m. (Jurisprud.) qu'on appelle aussi location, est un contrat du droit des gens, par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que l'un donne à l'autre une chose mobiliaire ou immobiliaire, pour en jouir pendant un certain tems, moyennant une certaine somme payable dans les termes convenus.
On entend par ce terme de louage l'action de celui qui loue, & celle de celui qui prend à titre de loyer ; dans certaines provinces, on entend aussi par-là l'acte qui contient cette convention.
Le terme de louage est générique, & comprend les baux à ferme aussi-bien que les baux à loyer.
Celui qui donne à louage ou loyer est appellé dans les baux le bailleur, & celui qui prend à loyer ou ferme, est appellé preneur, c'est-à-dire locataire ou fermier.
Le louage est un contrat obligatoire de produit, & produit une action, tant en faveur du bailleur, qu'en faveur du preneur.
L'action du bailleur a pour objet d'obliger le preneur à payer les loyers ou fermages, & à remplir ses autres engagemens, comme de ne point dégrader la chose qui lui a été louée, d'y faire les réparations locatives si c'est une maison.
Celui qui loue doit avoir le même soin de la chose louée que si c'étoit la sienne propre ; il ne doit point s'en servir à d'autres usages que ceux aux quels elle est destinée, & doit se conformer en tout à son bail. Mais on n'exige pas de lui une exactitude aussi scrupuleuse que si la chose lui avoit été prêtée gratuitement, desorte que quand la chose louée vient à périr, si c'est par un cas fortuit ou par une faute très-légere du preneur, la perte tombe sur le propriétaire ; car, dans ce contrat, le preneur n'est tenu que de ce qu'on appelle en droit lata aut levis culpa.
L'action du preneur contre le bailleur est pour obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur n'est pas non plus tenu de levissimâ culpâ, mais il est responsable du dommage qui arrive en la chose louée par sa faute, lata aut levi.
Il y a un vieux axiome qui dit que morts & mariages rompent tous baux & louages, ce qui ne doit pas être pris à la lettre ; car il est certain que la mort ni le mariage, soit du bailleur ou du preneur, ne rompent point les baux, les héritiers des uns & des autres sont obligés de les tenir, mais ce que l'on a voulu dire par cet axiome, est que, comme la mort & le mariage amenent du changement, il arrive ordinairement dans ces cas que le propriétaire demande à occuper sa maison en personne.
En effet, il y a trois cas où le locataire d'une maison peut être évincé avant la fin de son bail ; le premier est lorsque le propriétaire veut occuper en personne ; le second est pour la réparer ; le troisieme, lorsque le locataire dégrade la maison ou en fait un mauvais usage. Voyez la loi Aede au code locato-conducto.
On loue non-seulement des choses inanimées, mais les personnes se louent elles-mêmes pour un certain tems pour faire quelques ouvrages, ou pour servir ceux qui les prennent à ce titre, moyennant le salaire dont on est convenu. Voyez DOMESTIQUES & OUVRIERS. Voyez au ff. le titre locati, conducti, au code celui de locato conducto, & aux institutes de locatione conduction. Voyez aussi BAIL, CONGE, FERME, & ci-après LOYER. (A)
|
| LOUANGE | S. f. (Morale) c'est le discours, l'écrit ou l'action, par lesquels on releve le mérite d'une action, d'un ouvrage, d'une qualité d'un homme, ou d'un être quelconque. Tous les hommes desirent la louange, ou parce qu'ils ont des doutes sur leur propre mérite, & qu'elle les rassure contre le sentiment de leur foiblesse, ou parce qu'elle contribue à leur donner promtement le plus grand avantage de la société, c'est-à-dire l'estime du public. Il faut louer les jeunes gens, mais toujours avec restriction ; la louange, comme le vin, augmente les forces quand elle n'enivre pas. Les hommes qui louent le mieux, mais qui louent rarement, sont ceux que le beau, l'agréable & l'honnête frappent par-tout où ils les rencontrent ; le vil intérêt, pour obtenir des graces ; la plate vanité pour obtenir grace, prodiguent la louange, & l'envie la refuse. L'honnête homme releve dans les hommes ce qu'il y a de bien, ne l'exagere pas, & se tait sur les défauts ou sur les fautes ; il trouve, quoiqu'en dise la Fontaine, qu'on peut trop louer, non les dieux qu'on ne tromperoit pas, mais sa maîtresse & son roi qu'on tromperoit.
|
| LOUBAT | (Géog. anc. & mod.) village d'Asie, dans la Natolie. Cet endroit ainsi nommé par les Francs, Ulabat par les Turcs, Lopadion par les Grecs du moyen âge, Lopadium, par Nicétas & Chalcondyle, Loupadi par Spon, & Lopadi par Tournefort, est sur une colline, au pié de laquelle coule le Rhindacus des anciens. Voyez RHINDACUS.
Quoique Loubat n'ait aujourd'hui qu'environ 200 maisons d'assez mauvaise apparence, habitées par des Turcs & par des Chrétiens, cependant ce lieu a été considérable sous les empereurs grecs. Ses murailles qui sont presque ruinées, étoient défendues par des tours, les unes rondes, les autres pentagones, quelques-unes triangulaires. On y voyoit encore dans le dernier siecle des morceaux de marbre antique, des colonnes, des chapiteaux, des bas-reliefs & des architraves, le tout brisé & très-maltraité.
L'empereur Jean Comnène, qui parvint à l'empire en 1118, y fit bâtir un château, qui est présentement tout démoli. La ville étoit plus ancienne que cet empereur ; car elle fut pillée par les Mahométans sous Andronic Comnène, qui régnoit en 1081. Cet Andronic Comnène envoya une armée à Lopadion, pour ramener à leur devoir les habitans, qui à l'exemple de ceux de Nicée & de Pruse, avoient abandonné son parti.
Après la prise de Constantinople par le comte de Flandres, Pierre de Bracheux mit en fuite les troupes de Théodore Lascaris, à qui Lopadium resta par la paix qu'il fit avec Henri, successeur de Baudouin, comte de Flandres & premier empereur latin d'Orient.
Quand le grand Ottoman eut défait le gouverneur de Pruse, & les princes voisins qui s'étoient ligués pour arrêter le cours de ses conquêtes, il poursuivit le prince de Feck dans Lopadium, & le fit hacher en morceaux à la vûe de la citadelle.
Enfin Lopadium est aussi fameux dans les annales turques par la victoire qu'Amurat remporta sur son oncle Mustapha, que le Rhindacus l'est dans l'histoire romaine par la défaite de Mithridate. On peut lire Leunclavius & Chalcondyle sur cet évenement.
M. Spon a fait bien des fautes en parlant de Lopadi, ou comme il l'appelle Loupadi. Il a eu tort de prendre le lac de Lopadi pour le lac Ascanius des anciens, qui est celui que les Turcs nomment Isnich. Il s'est encore trompé, en assûrant que la riviere de Lopadi se jette dans le Granique.
Il paroît aussi que le même Spon, le sieur Lucas & M. Vaillant sont tous trois dans l'erreur, quand ils ont pris Lopadion ou Loubat pour être l'ancienne Apollonia. Cette fameuse ville où Apollon étoit sans doute révéré, est aujourd'hui le village d'Abouillona, qui en conserve le nom. Son lac est appellé par Strabon le lac Apolloniate. Voyez les voyages de Tournefort, & le Dict. de la Martiniere aux mots LOUBAT, Lopadium, APOLLONIE & ABOUILLONA. (D.J.)
|
| LOUCHET | S. m. (Econ. rustiq.) espece de hoyau ou de bêche propre à fouir la terre. Il est plat, tranchant, droit, & avec son manche il ressemble à une pelle.
|
| LOUDUN | (Géog.) ville de France en Poitou. On la nomme en latin, castrum Lausdunense, Losdunum, Lavesdunum, Laucidunum, & Laudunum.
Macrin & les freres Sainte-Marthe sont les premiers qui, par une licence poétique, ont donné à cette ville le nom de Juliodunum, que Chevreau & quelques autres ont tâché de lui conserver.
Il est certain qu'on doit la mettre au rang des anciennes villes, puisqu'avant l'an 1000, elle figuroit déja comme un lieu considérable, & la principale place du Loudunois soumis à l'obéissance des comtes d'Anjou. Voyez à ce sujet ce qu'en dit Longuerue, dans sa description de la France, I. partie, pag. 151.
Cette ville se fit considérer dans les guerres civiles du seizieme siecle, & par sa situation, & par son château, que Louis XIII. démolit en 1633. Le couvent des Ursulines de Loudun se rendit célebre dans la même année, par l'histoire de la possession imaginaire de plusieurs de ses religieuses, & par la condamnation d'Urbain Grandier, qui fut une des malheureuses victimes de la haine du cardinal de Richelieu. On pourroit opposer ce seul trait de la vie du grand ministre de Louis XIII. à tous les éloges si fades & si bas que lui prodiguent nos académiciens lors de leur réception à l'académie françoise.
Loudun est située sur une montagne à douze lieues N. O. de Poitiers, quinze S. O. de Tours, soixante-deux S. O. de Paris. Long. 17. 42. lat. 47. 2.
Il me reste à dire que cette ville est la patrie de plusieurs gens de lettres, parmi lesquels je ne dois pas oublier de nommer Mrs. Bouillaud, Chevreau, Macrin, Renaudot, & les freres de Sainte-Marthe.
Bouillaud (Ismael) possédoit la Théologie, l'Histoire, les Belles-Lettres, & les Mathématiques ; j'en ai pour preuve les divers ouvrages qu'il a publiés, & le journal des savans, tom. XXIII. pag. 126. Ses voyages en Italie, en Allemagne, en Pologne, & au Levant, lui procurerent des connoissances qu'on n'acquiert que par ce moyen. Il mourut à Paris en 1694, âgé de quatre-vingt-neuf ans. Son éloge se trouve parmi les hommes illustres de Perrault.
Chevreau (Urbain) savant & bel esprit, qui a eu beaucoup de réputation, mais elle ne s'est pas soutenue ; l'histoire du monde, son meilleur ouvrage, souvent réimprimé, fourmille de trop de fautes pour qu'on puisse le louer. M. Chevreau est mort en 1701, à quatre-vingt-huit ans.
Macrin (Jean) un des meilleurs poëtes latins du seizieme siecle, au jugement de M. de Thou, qui a fait son éloge ; son vrai nom étoit Maigret : il s'appella Macrinus dans ses poésies latines, d'où lui vint le nom de Macrin en françois, qui lui est demeuré. Il mourut de vieillesse dans sa patrie en 1555.
Renaudot (Théophraste) medecin, mort en 1653 à soixante-dix ans, commença le premier en 1631, à publier les nouvelles publiques si connues sous le nom de gazettes. Il a eu pour petit-fils, l'abbé Renaudot, savant dans l'histoire & les langues orientales, mort à Paris en 1720 âgé de soixante-quatorze ans.
Mais les freres jumeaux, Scévole & Louis de Sainte-Marthe, fils du premier Scévole, enterrés tous les deux à Paris à S. Severin dans le même tombeau, furent très-illustres par leur savoir. On a d'eux l'histoire généalogique de la maison de France, la Gallia Christiana pleine d'érudition, & plusieurs autres ouvrages. Scévole mourut à Paris en 1650 à soixante-dix-sept ans, & Louis en 1656.
Leur pere Scévole leur avoit servi d'exemple dans la culture des sciences. C'est lui qui réduisit Poitiers sous l'obéissance d'Henri IV. & qui sauva la ruine de Loudun, où il finit ses jours en 1623, âgé de soixante-dix-huit ans. On doit le mettre au rang des meilleurs poëtes latins de son siecle. C'est une famille bien noble que celle de Sainte-Marthe, car elle n'a produit que des gens de mérite, qui tous ont prolongé leur carriere dans le sein des muses, jusqu'à la derniere vieillesse. Aucun d'eux n'est mort avant l'âge de soixante-dix ans. Nous ne voyons plus de familles aussi heureusement organisées que l'étoit celle des Sainte-Marthe. (D.J.)
|
| LOUDUNOIS | ou LODUNOIS, (Géogr.) contrée de France, dont la capitale est Loudun. La petite riviere de Dive sépare cette contrée de l'Anjou & du Poitou. Le Loudunois a sa coûtume particuliere, à laquelle le parlement a tantôt égard & tantôt point. De Lauriere a fait un commentaire sur cette coûtume, avec une histoire abrégée du pays, qui est ce qui nous intéresse le plus ici. (D.J.)
|
| LOUER | v. act. (Gramm. & Morale) c'est témoigner qu'on pense avantageusement. La louange devroit toujours être l'expression de l'estime. Louer délicatement, c'est faire croire à la louange. Toute louange qui ne porte pas avec elle le caractere de la sincérité, tient de la flatterie ou du persiflage, & par conséquent indique de la malice dans celui qui la donne, & quelque sottise dans celui qui la reçoit. L'homme de sens la rejette & en ressent de l'indignation. Rien ne se prodigue plus entre les hommes que la louange ; rien ne se donne avec moins de grace. L'intérêt & la complaisance inondent de protestations, d'exagérations, de faussetés ; mais l'envie & la vanité viennent presque toujours à la traverse, & répandent sur la louange un air contraint qui la rend insipide. Ce seroit peut-être un paradoxe que de dire qu'il n'y a point de louange qui ne peche ou par le défaut de mérite en celui à qui elle est adressée, ou par défaut de connoissance en celui qui la donne ; mais je sais bien que l'écorce d'une belle action, séparée du motif qui l'a inspirée, n'en fait pas le mérite, & que la valeur réelle qui dépend de la raison secrette de celui qui agissoit, & qu'on loue d'avoir agi, nous est souvent inconnue, & plus souvent encore déguisée.
Le louangeur éternel m'ennuie ; le railleur impitoyable m'est odieux. Voyez l'article LOUANGE.
LOUER, (Comm.) prendre ou donner à louage des terres, des vignes, des maisons & autres immeubles. Il se dit aussi des meubles, des voitures, des bestiaux, & encore des personnes & de leur travail.
Dans tous ces sens on dit dans le commerce louer une boutique, un magasin, une échope dans les rues, une place aux halles, une loge à la foire.
Louer des meubles, des habits chez les Tapissiers & Fripiers ; louer un carrosse, une litiere, un cheval, une place dans une voiture publique ; ce qui appartient aux voituriers, messagers, carrossiers, loueurs de chevaux, maquignons, &c.
Enfin louer des compagnons, des garçons, des gens de journée, manouvriers, &c. ce que font les maîtres des communautés des arts & métiers, & les particuliers qui ont quelques travaux à faire faire. Dictionn. de commerce.
|
| LOUER UN CABLE | ou ROUER UN CABLE, (Marine) c'est mettre un cable en rond en façon de cerceaux, afin de le tenir prêt à filer lorsqu'il faut mouiller. Les cables doivent toujours être loués dans le vaisseau, parce qu'ils tiennent alors moins de place : lorsqu'on met les cables en bas, il faut les tenir séchement ; pour cet effet on met dessous quelques pieces de bois, afin que s'il entre de l'eau dans le lieu où ils sont loués, elle ne les touche pas. C'est le contremaître qui en est chargé.
Autrefois on disoit louer une manoeuvre, mais présentement on dit rouer des manoeuvres. Voy. ROUER.
|
| LOUEUR | S. m. (Comm.) celui qui donne quelque chose à louage ; on le dit particulierement des loueurs de chevaux, des loueurs de carrosses.
|
| LOUGH NEAGH | (Hist. nat.) ce mot signifie lac de Neagh. C'est le nom d'un lac fameux d'Irlande, situé au nord de cette île, entre les comtés d'Antrim, de Tyrone & d'Ardmach. Il a environ trente milles, c'est-à-dire dix lieues de longueur ; & quinze milles, c'est-à-dire cinq lieues de largeur. Il est remarquable par la propriété que quelques auteurs lui ont attribuée de pétrifier & de changer même en fer les corps que l'on y jette. On a, dit-on, observé qu'en enfonçant des pieux de bois dans ce lac, ils étoient au bout d'un certain tems pétrifiés dans la partie qui avoit été enfoncée dans l'eau, tandis que la partie qui étoit restée hors de l'eau, restoit combustible, & dans l'état d'un vrai bois. M. Barton a examiné ce phénomene avec une attention particuliere, & il a trouvé que ce n'est point une incrustation ou un dépôt qui se fait à l'extérieur du bois, comme M. de Buffon l'a cru, mais toute la substance est pénétrée du suc lapidifique & changée en pierre. Les bois pétrifiés, que l'on tire de ce lac, sont de deux especes ; il y en a qui se changent en une pierre blanche, légere, poreuse & propre à aiguiser les outils. On trouve d'autres bois changés en une pierre noire, dure, pesante, dans laquelle il y a souvent soit à sa surface, soit à son intérieur, des parties ligneuses qui n'ont point été changées en pierre. Ces deux especes de bois pétrifiés conservent le tissu ligneux, & font feu lorsqu'on les frappe avec de l'acier ; elles soutiennent le feu le plus violent sans se calciner ni se changer en verre ; la seconde espece, après avoir été calcinée, devient blanche, légere & poreuse comme la premiere. On croit que c'est du bois de houx qui a été ainsi pétrifié ; mais il paroît que c'est plutôt un bois résineux, car on dit qu'il répand une odeur agréable lorsqu'on le calcine. Quelques gens ont cru que cette pétrification se faisoit en sept ans de tems, mais ce fait ne paroît point constaté.
La pétrification ne se fait pas seulement dans le lac de lough Neagh, mais encore elle se fait dans la terre qui en approche jusqu'à huit milles de distance, & l'on y trouve des amas de bois enfouis en terre, & parfaitement pétrifiés. Voyez Barton, philosophical lectures.
Boyle dit dans son traité sur l'origine des pierres précieuses, que dans le fond du lac de Neagh, il y a des rochers où sont attachées des crystallisations de différentes couleurs.
|
| LOUGH-LENE | (Hist. nat.) le mot lough en irlandois signifie lac ; ainsi lough-Lene veut dire lac de Lene. C'est un lac singulier d'Irlande dans le comté de Kerry, à la partie méridionale de cette île, qui contient environ trois mille arpens quarrés ; on le divise en supérieur & en inférieur. Il est commandé par des montagnes ; au haut de l'une, qui s'appelle Mangerton, est un lac dont on ne connoît pas le fond, & qu'en langue du pays on nomme pour cette raison poulle iferon, c'est-à-dire trou d'enfer. Ce lac est sujet à se déborder ; alors il en sort des torrens très considérables qui retombent dans le lac inférieur, & qui forment des cascades ou des chûtes d'eau, dont l'aspect est très-singulier. On dit qu'il se trouve des pierres précieuses dans ce lac, & dans son voisinage on rencontre des mines de cuivre & d'argent.
|
| LOUGNON | (Géog.) riviere qui prend sa source dans les montagnes de Vosges aux confins de la Bourgogne, traverse une partie de ce comté, & se jette dans la Saône à trois lieues au-dessous de Gray.
|
| LOUIS D'ARGENT | (Monnoie) piece de monnoie de France qu'on commença de fabriquer sous Louis XIII. en 1641, peu de tems après les louis d'or.
L'ordonnance porte que les louis d'argent seront fabriqués les uns de soixante sols, les autres de trente sols, de quinze sols & de cinq sols, tous au titre de onze deniers de fin, au remede de deux grains. Les louis d'argent de soixante sols, pesant vingt-un deniers huit grains trébuchant chacun, à la taille de huit pieces, onze douziemes de piece, au remede d'un douzieme de piece, & les autres especes à proportion. On n'avoit point encore fait de monnoie d'argent si pesante en France depuis le commencement de la monarchie. Les louis d'argent de Louis XV. ont été à la taille de huit, de dix au marc & ont valu tantôt plus, tantôt moins, selon les opérations de finance, dont nous ne ferons pas ici l'éloge. Nous remarquerons seulement que les louis d'argent de soixante sols, se nomment à présent un petit écu, & que par-tout où il est parlé d'écus avant l'an 1641, il faut toujours l'entendre de l'écu d'or.
LOUIS D'OR, (Monnoie) piece de monnoie de France qu'on a commencé à fabriquer sous le regne de Louis XIII. en 1640.
Les louis d'or fabriqués alors & depuis, étoient à vingt-deux karats, & par conséquent plus foibles d'un karat que les écus d'or. Le louis d'or du poids de cinq deniers six grains trébuchant, valoit dix livres ; celui de deux deniers quinze grains trébuchant, valoit cinq livres.
Mais il ne faut pas oublier de remarquer ici qu'on fabriqua pour la premiere fois en 1646, la majeure partie des louis d'or au moulin, dont enfin l'utilité fut reconnue & protégée par le chancelier Séguier, contre les oppositions & les cabales qui duroient depuis vingt-cinq ans, & qui avoient obligé Briot, l'auteur de cette invention, à la porter en Angleterre, où on n'hésita pas à l'adopter sur le champ.
On fit aussi dans ce tems-là, des demi-louis, des doubles louis, des quadruples, & des pieces de dix louis ; mais ces deux dernieres especes ne furent que des pieces de plaisir, & n'ont point eu cours dans le commerce. Le célebre Varin en avoit fait les coins ; jamais les monnoies n'ont été si belles ni si bien monnoyées, que pendant que cet habile homme en a eu l'intendance.
Les louis d'or, ou comme nous les nommons simplement, les louis, ont fréquemment changé de poids & de prix idéal. Ceux qu'on fait aujourd'hui sont de 30 au marc & valent 24 livres, ainsi le marc d'or monnoyé vaut 720 livres, au lieu qu'en 1640 les louis d'or valant 10 livres & étant de 36 1/4 au marc, le marc ne valoit que 362 livres 10 sols.
On trouvera, si l'on en est curieux, dans le Blanc, Boizard, & autres écrivains modernes, les différens changemens idéaux qui sont arrivés au prix du louis d'or, sous le regne de Louis XIV. & de Louis XV. jusqu'à ce jour ; mais il vaudra mieux lire les mots ESPECES (commerce), & MONNOIE.
|
| LOUISBOURG | (Géogr.) petite ville de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle France, capitale de l'Isle royale ; on la nommoit précédemment le Havre à l'Anglois. Elle est située au détroit, ou passage de Fronsac, qui sépare l'Isle royale de l'Acadie, sur une langue de terre qui forme l'entrée du port, & qui est très-bien fortifiée ; le port est aussi défendu par plusieurs batteries ; d'ailleurs le gouverneur de l'Isle royale, le conseil & l'état-major, avec une bonne garnison, font leur résidence à Louisbourg. Cependant elle fut prise en 1746 par les Anglois, après cinquante jours d'une vigoureuse défense. Ce ne fut point une opération du cabinet des ministres de Londres, comme le remarque M. de Voltaire ; ce fut le fruit de la hardiesse des négocians établis dans la nouvelle Angleterre. Ils armerent quatre mille hommes, les soudoyerent, les approvisionnerent, & leur fournirent des vaisseaux de transport. Tant une nation commerçante & guerriere est capable de grandes choses ! La long. de Louisbourg, à l'égard de Paris, est de 4h. 8'. 27''. selon M. Delisle, dans les mémoires de l'académie des Sciences, ann. 1751.
Louisbourg a été reprise de nouveau par les Anglois en 1758.
|
| LOUNIGUIN | S. m. terme de relation, nom donné par les Sauvages d'Amérique, au trajet de terre qui fait la distance du passage d'une riviere à une autre, pendant lequel trajet on est obligé de porter son canot sur la tête ou sur les épaules. Il se trouve aussi des endroits dans les rivieres, où la navigation est empêchée par des sauts, par des chûtes d'eau entre des rochers, qui retrécissent le passage, & rendent le courant si rapide, que l'on est forcé de porter le canot jusqu'à l'endroit où le cours de la riviere permet qu'on en fasse usage ; quelquefois le portage du canot est de quelques lieues, & se répete assez souvent ; mais ce portage ne fatigue ni n'arrête les Sauvages, à cause de la légéreté de leurs canots. Nous indiquerons ailleurs leur fabrique & leur forme.
|
| LOUP | lupus, s. m. (Hist. nat. Zool.) animal quadrupede qui a beaucoup de rapport avec les grands chiens mâtins, pour la taille, les proportions du corps, & la conformation intérieure. Le principal trait qui distingue la face du loup de celle du mâtin, est dans la direction de l'ouverture des paupieres qui est fort inclinée, au lieu d'être horisontale, comme dans les chiens. Les oreilles sont droites. Le loup a le corps plus gros que le mâtin, les jambes plus courtes, la tête plus large, le front moins élevé, le museau un peu plus court & plus gros, les yeux plus petits & plus éloignés l'un de l'autre. Il paroît plus robuste, plus fort & plus gros ; mais la longueur du poil contribue beaucoup à cette apparence, principalement le poil de la tête qui est au-devant de l'ouverture des oreilles, celui du cou, du dos, des fesses, & de la queue qui est fort grosse. Les couleurs du poil sont le noir, le fauve, le gris, & le blanc mêlé différemment sur différentes parties. Le loup est très-carnassier, naturellement grossier & poltron, mais ingénieux par le besoin & hardi par nécessité. Il attaque en plein jour les animaux qu'il peut emporter, tels que les agneaux, les chevreaux, les petits chiens, quoiqu'ils soient sous la garde de l'homme. Mais lorsqu'il a été maltraité par les hommes ou par les chiens, il ne sort que la nuit ; il rôde autour des habitations ; il attaque les bergeries ; il creuse la terre pour passer sous les portes ; & lorsqu'il est entré, il met tout à mort avant de choisir & d'emporter sa proie. Lorsqu'il n'a pu rien trouver dans les lieux habités, il se met en quête au fond des bois ; il poursuit les animaux sauvages ; enfin, dans l'extrême besoin, il se jette sur les femmes & les enfans, & même sur les hommes. Les loups qui se sont accoûtumés à manger de la chair humaine en suivant les armées, attaquent les hommes par préférence : on les appelle loups-garoux, c'est-à-dire loup dont il faut se garer. Quoique le loup ressemble beaucoup au chien par la conformation du corps, cependant ils sont antipathiques par nature, & ennemis par instinct. Les jeunes chiens fuient les loups ; les chiens qui ont assez de force, les combattent à toute outrance. Si le loup est plus fort, il dévore sa proie : au contraire le chien abandonne le loup qu'il a tué ; il sert de pâture à d'autres loups, car ces animaux s'entre-dévorent : s'il s'en trouve un qui soit griévement blessé, les autres s'attroupent pour l'achever. On apprivoise de jeunes loups ; mais avec l'âge ils reprennent leur caractere féroce, & retournent, s'ils le peuvent, à leur état sauvage. Les louves deviennent en chaleur dans l'hiver ; les vieilles à la fin de Décembre, & les jeunes au mois de Février ou au commencement de Mars. Leur chaleur ne dure que douze ou quinze jours. Elles portent pendant environ trois mois & demi ; elles font ordinairement cinq ou six petits, quelquefois sept, huit, & même neuf, & jamais moins de trois. Elles mettent bas au fond d'un bois, dans un fort, sur une grande quantité de mousse qu'elles y apportent pour servir de lit à leurs petits. Ils naissent les yeux fermés comme les chiens ; la mere les alaite pendant quelques semaines, & leur donne ensuite de la chair qu'elle a mâchée. Au bout de six semaines ou deux mois, ils sortent avec la mere qui les mene boire ; ils la suivent ainsi pendant plusieurs mois ; elle les ramene au gîte ; les cache, lorsqu'elle craint quelque danger ; & si on les attaque, elle les défend avec fureur. Les mâles & les femelles sont en état d'engendrer à l'âge d'environ deux ans ; ils vivent quinze ou vingt ans. La couleur & le poil de ces animaux changent suivant les différens climats, & varient quelquefois dans le même pays. Il y a des loups dans toutes les parties du monde. Hist. natur. géner. & part. tom. VII.
LOUP, le, (Chasse) est le plus robuste des animaux carnassiers, dans les climats doux de l'Europe : il a sur-tout beaucoup de force dans les parties antérieures du corps : il est pourvû d'haleine, de vîtesse, & d'un fonds de vigueur qui le rend presqu'infatigable. Avec ces avantages, la nature lui a encore donné des sens très-déliés. Il voit, il entend finement ; mais son nez principalement est l'organe d'un sentiment exquis. C'est le nez qui apprend à cet animal, à de très-grandes distances, où il doit chercher sa proie, & qui l'instruit des dangers qu'il peut rencontrer sur sa route. Ces dons de la nature joints au besoin de se nourrir de chair, paroissent destiner le loup singulierement à la rapine : en effet, c'est le seul moyen qu'il ait de se nourrir. Nous l'appellons cruel, parce que ses besoins sont souvent en concurrence avec les nôtres. Il attaque les troupeaux que l'homme reserve pour sa nourriture, & les bêtes fauves qu'il destine à ses plaisirs. Aussi lui faisons-nous une guerre déclarée ; mais cette guerre même qui fait périr un grand nombre d'individus de cette espece vorace, sert à étendre l'instinct de ceux qui restent : elle multiplie leurs moyens, met en exercice la défiance qui leur est naturelle, & fait germer en eux des précautions & des ruses qui sans cela leur seroient inconnues.
Avec une grande vigueur jointe à une grande sagacité, le loup fourniroit facilement à ses besoins, si l'homme n'y mettoit pas mille obstacles ; mais il est contraint de passer tout le jour retiré dans les bois pour se dérober à la vûe de son ennemi : il y dort d'un sommeil inquiet & leger, & il ne commence à vivre qu'au moment où l'homme revenu de ses travaux, laisse régner le silence dans les campagnes. Alors il se met en quête ; & marchant toujours le nez au vent, il est averti de fort loin du lieu où il doit trouver sa proie : dans les pays où les bois sont peuplés de bêtes fauves, la chasse lui procure aisément de quoi vivre. Un loup seul abat les plus gros cerfs. Lorsqu'il est rassasié, il enterre ce qui lui reste, pour le retrouver au besoin ; mais il ne revient jamais à ces restes que quand la chasse a été malheureuse. Lorsque les bêtes fauves manquent, le loup attaque les troupeaux, cherche dans les campagnes quelque cheval ou quelque âne égaré : il est très-friand sur-tout de la chair de l'ânon.
Si les précautions des bergers & la vigilance des chiens mettent les troupeaux hors d'insulte ; devenu hardi par nécessité, il s'approche des habitans, cherche à pénétrer dans les basse-cours, enleve les volailles, & dévore les chiens qui n'ont pas la force ou l'habitude de se défendre contre lui. Lorsque la disette rend sa faim plus pressante, il attaque les enfans, les femmes ; & même après s'y être accoûtumé par degré, il se rend redoutable aux hommes faits. Malgré ces excés, cet animal vorace est souvent exposé à mourir de faim. Lorsqu'il est trahi par ses talens pour la rapine, il est contraint d'avaler de la glaise, de la terre, afin, comme l'a remarqué M. de Buffon, de lester son estomac & de donner à cette membrane importante l'étendue & la contension nécessaires, pour que le ressort ne manque pas à toute la machine.
Il doit à ce secours l'avantage d'exister peut-être quelques jours encore ; & il lui doit la vie, lorsque pendant ce tems le hazard lui offre une meilleure nourriture qui le répare.
Les loups restent en famille tant qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont besoin d'être ensemble pour s'aider réciproquement à vivre. Lorsque vers l'âge de dix huit mois ils ont acquis de la force & qu'ils la sentent, ils se séparent jusqu'à ce que l'amour mette en société un mâle & une femelle : parmi celles-ci, les vieilles entrent en chaleur les premieres. Elles sont d'abord suivies par plusieurs mâles, que la jalousie fait combattre entr'eux cruellement : quelques-uns y périssent ; mais bien-tôt le plus vigoureux écarte les rivaux ; & l'union étant une fois décidée, elle subsiste. Les deux loups que l'amour a joints, chassent ensemble, ne se quittent point, ou ne se séparent que de convention, & pour se rendre mutuellement la chasse plus facile. Voyez INSTINCT. Le tems de la chaleur n'est pas long ; mais la société n'en subsiste pas moins pendant les trois mois & demi que dure la gestation de la femelle, & même beaucoup au-delà. On prétend que la louve se dérobe au mâle pour mettre bas ses petits. Mais il est certain que très-souvent le pere chasse encore avec elle après ce tems, & qu'il apporte avec elle à manger aux louvetaux.
La vigueur & la finesse de sens dont les loups sont doués, leur donnant beaucoup de facilité pour attaquer à force ouverte ou surprendre leur proie, ils ne sont pas communément forcés à beaucoup d'industrie : il n'est pas nécessaire que leur mémoire, quant à cet objet, soit chargée d'un grand nombre de faits, ni qu'ils en tirent des inductions bien compliquées. Mais si le pays, quoiqu'abondant en gibier, est assiégé de pieges ; le vieux loup instruit par l'expérience, est forcé à des craintes qui balancent son appétit : il marche toujours entre le double écueil ou de donner dans l'embuche ou de mourir de faim. Son instinct acquiert alors de l'étendue ; sa marche est précautionnée ; tous ses sens excités par un intérêt aussi vif veillent à sa garde, & il est très-difficile de surprendre sa défiance.
On a pour chasser le loup des équipages de chiens courans, composés comme ceux avec lesquels on chasse les bêtes fauves. Voyez VENERIE. Mais il est nécessaire que les chiens d'un équipage du loup soient plus vîtes ; c'est pourquoi on les tire ordinairement d'Angleterre. Il faut aussi que les chevaux aient plus de vigueur & de fonds d'haleine ; parce qu'il est impossible de placer surement les relais pour la chasse du loup. Quoique ces animaux aient comme les autres, des refuites qui leur sont familieres, leur défiance naturelle & la finesse de leur odorat y mettent beaucoup plus d'incertitude : ils en changent, dès qu'il se présente quelqu'obstacle sur leur route. D'ailleurs le loup va toujours en avant, & il ne fait gueres de retours à moins que quelque blessure ne l'ait affoibli.
La raison des retours qui sont familiers à la plûpart des bêtes fauves qu'on chasse, est pour les uns la foiblesse, & pour d'autres la crainte de s'égarer dans des lieux inconnus. Les cerfs nés dans un pays, ne s'écartent guere quand ils sont chassés de l'enceinte des trois ou quatre lieues qu'ils connoissent. Mais lorsque dans le tems du rut, l'effervescence amoureuse & la disette de femelles les a forcés de quitter le lieu de leur naissance, pour chercher au loin la jouissance & le plaisir ; s'ils sont attaqués, on les voit aussi-tôt prendre leur parti & refuir sans retour dans les bois d'ou ils étoient venus. Or, le loup connoît toujours une grande étendue de pays ; souvent il parcourt vingt lieues dans une seule nuit. Né vagabond & inquiet, il n'est retenu que par l'abondance de gibier ; & cet attrait est aisément détruit par le bruit des chiens & la nécessité de se dérober à leur poursuite.
On va en quête avec le limier pour détourner le loup aussi bien que pour le cerf, mais il faut beaucoup plus de précautions pour s'assurer du premier. On peut approcher assez près du cerf sans le faire lever de la reposée, mais le moindre bruit fait partir le loup du liteau. Ainsi quand on l'a rembuché, il faut prendre les devans de très loin pour s'assurer s'il n'est pas passé plus avant. On est forcé souvent de faire ainsi plusieurs lieues à la suite d'un loup. Souvent encore, d'enceinte en enceinte, on arrive au bord d'une plaine où l'on trouve qu'il s'est déchaussé, c'est-à-dire qu'il a pissé & gratté comme fait le chien : alors il est sûr qu'il a pris son parti de percer en avant, & il est inutile de le suivre.
Il seroit très-rare de forcer les loups avec des chiens courans, parce qu'il est peu de chiens qui puissent joûter de vigueur contre ces animaux. Ainsi quand on chasse, des gens à cheval cherchent à gagner les devans pour tuer, ou du moins blesser le loup à coups de fusils. On l'attend aussi dans les plaines qu'on suppose qu'il doit traverser, & on l'y fait attaquer par des levriers & des mâtins qu'on tient en laisse pour cet usage. Les levriers atteignent assez promtement le loup : pendant qu'ils l'amusent, les mâtins plus lourds ont le tems d'arriver. Alors le combat devient inégal & sanglant ; & pendant que le loup est occupé à se défendre, on le tue assez facilement à coups d'épées.
La chasse du loup est en général vive & piquante, par le desir que les chasseurs ont de tuer l'animal, par la rapidité du train & la singularité des refuites. Mais elle a cet inconvénient, qu'on n'est jamais sûr de trouver l'occasion de chasser. Le moindre bruit fait vuider l'enceinte aux loups les mieux détournés : & les buissons creux sont très-ordinaires à cette chasse. Dans les provinces où les seigneurs n'ont pas d'équipages, on s'assemble pour tuer les loups en battue. Les paysans rangés & serrés passent dans les bois en faisant beaucoup de bruit, & les chasseurs se postent pour attendre & tuer les bêtes effrayées : mais ordinairement il en échappe beaucoup ; outre que souvent les battues sont mal faites, & les postes mal gardés, ces animaux défians éventent de loin les embuscades, & retournent sur les batteurs malgré le bruit.
Toutes ces chasses d'appareil n'ont pas un grand succès pour la destruction des loups. Le plus sûr moyen d'y parvenir, c'est d'être assidu à leur tendre des piéges, à multiplier les dangers sous leurs pas, & à les attirer par des apâts convenables. Le meilleur piége, lorsqu'on sait en faire usage, est celui qui est connu dans beaucoup d'endroits sous le nom de traquenard. Avant de le tendre, on commence par traîner un cheval ou quelqu'autre animal mort dans une plaine que les loups ont coûtume de traverser ; on le laisse dans un gueret ; on passe le rateau sur la terre des environs pour juger mieux les pas de l'animal, & d'ailleurs le familiariser avec la terre égalée qui doit couvrir le piége. Pendant quelques nuits le loup rode autour de cet appât, sans oser en approcher. Il s'enhardit enfin : il faut le laisser s'y assurer plusieurs fois. Alors on tend plusieurs piéges autour, & on les couvre de trois pouces de terre pour en dérober la connoissance au défiant animal. Le remuement de la terre que cela occasionne, ou peut-être des particules odorantes de l'homme qui y restent, réveillent toute l'inquiétude du loup, & il ne faut pas esperer de le prendre les premieres nuits. Mais enfin l'habitude lui fait perdre la défiance, & lui donne une sécurité qui le trahit. Il est un appât d'un autre genre, qui attire bien plus puissamment les loups, & dont les gens du métier font communément un mystere. Il faut tâcher de se procurer la matrice d'une louve en pleine chaleur. On la fait sécher dans le four, & on la garde dans un lieu sec. On place ensuite à plusieurs endroits, soit dans le bois, soit dans la plaine une pierre, autour de laquelle on répand du sable. On frotte la semelle de ses souliers avec cette matrice, & on en frotte bien sur-tout les différentes pierres qu'on a placées. L'odeur s'y conserve pendant plusieurs jours, & les loups mâles & femelles l'éventent de très-loin : elle les attire & les occupe fortement. Lorsqu'ils se sont accoûtumés à venir gratter à quelqu'une des pierres, on y tend le piége, & rarement sans succès lorsqu'il est bien tendu & bien couvert.
Quelque défiant que soit le loup, on le prend avec assez de facilité par-tout où les piéges ne lui sont pas connus. Mais lorsqu'il est instruit par l'expérience, il met en défaut tout l'art des louvetiers. Cet animal naturellement grossier, parce qu'il est fort, acquiert alors un degré supérieur d'intelligence, & il apprend à se servir de tous les avantages que lui donne la finesse de ses sens : il devient nécessaire de connoître toutes les ruses de l'animal, & de varier à l'infini celles qu'on leur oppose. Cet assemblage d'observations & de connoissances forme une science dont la perfection, comme celle de toutes les autres, passe les bornes de l'esprit humain. Voyez PIEGE. Il est certain que sans tous ces moyens de destruction, la multiplication des loups deviendroit funeste à l'espece humaine. Les louves sont ordinairement en état de porter à dix-huit mois : elles font quelquefois jusqu'à huit ou neuf petits, & jamais moins de trois. Elles les défendent avec fureur lorsqu'ils sont attaqués, & s'exposent aux plus grands périls pour les nourrir.
LOUP, (Mat. médic.) Les parties médicamenteuses du loup sont, selon l'énumération de Schroeder, les dents, le coeur, le foie, les boyaux, les os, la graisse, la fiente, & la peau : & encore Schroeder a-t-il oublié la chair.
On prétend que les hochets faits avec une dent de loup sont très-utiles pour rendre la dentition plus aisée aux enfans ; & que si on leur fait porter des dents de loup en amulete, ils ne sont point sujets à la peur.
Parmi les vertus attribuées aux autres parties dont nous avons fait mention, les plus célébrées sont du même ordre que cette derniere : il s'agit d'une ceinture de peau ou de boyau de loup contre la colique ; de sa fiente appliquée aux bras ou aux jambes, au moyen d'une bandelette faite avec la laine d'une brebis qui ait été égorgée par un loup, &c. Il est inutile d'ajouter que le peuple même croit à présent à peine à ces contes.
La graisse de loup n'a absolument que les qualités très-génériques, très-communes des graisses (Voyez GRAISSE), & c'est encore là un remede très-peu employé.
La seule partie encore mise en usage, c'est le foie. Les paysans & les chasseurs qui prennent des loups, ne manquent point d'en conserver le foie qu'ils font sécher au four, ou de le vendre à quelqu'apoticaire. C'est une drogue qui se trouve assez communément dans les boutiques : elle est vantée contre tous les vices du foie, & principalement contre les hydropisies qui dépendent d'un vice de ce viscere. On le donne en poudre, à la dose d'un gros : c'est un remede peu éprouvé. (b)
On prétend que le loup fournit lui-même un remede très efficace contre sa voracité ; & l'on assure que si on frotte les brebis avec sa fiente, il ne leur fait plus aucun mal. Pour cet effet, on dit qu'il n'y a qu'à détremper de la fiente de loup dans de l'eau ; on en frotte ensuite la gorge, le dos, & les côtés des brebis : cette fiente s'attache si fortement à leur laine, qu'elle y reste pendant très-long tems. On prétend que les loups ont de l'antipathie pour l'odeur qui en part, & qu'ils ne touchent point aux animaux qui ont été ainsi frottés. C'est à l'expérience à constater un fait qui, s'il se trouvoit véritable, seroit d'un grand avantage dans l'économie rustique. Voyez les Mémoires de l'académie de Suede, année 1753.
LOUP, (Pelletterie) la peau du loup, garnie de son poil, après avoir été préparée par le pelletier ou le mégissier, sert à faire des manchons & des housses de chevaux.
LOUP MARIN, lupus, (Hist. nat.) poisson de mer ainsi nommé à cause de sa voracité ; on lui donne aussi le nom de lubin ou lupin qui vient de lupus : les petits sont appellés lupassons en Languedoc. Ce poisson est grand, épais, couvert d'écailles ; il a la tête longue, la bouche & les yeux grands, deux nageoires près des ouies, deux au-dessous, des aiguillons pointus & inégaux sur le dos ; ces aiguillons sont soutenus par une membrane mince : la nageoire de la queue n'a qu'un aiguillon, mais il y en a trois dans la nageoire qui est au-delà de l'anus. Lorsque ce poisson reste dans la mer, il a le dos mêlé de blanc & de bleu ; celui qui est à l'embouchure des rivieres est presque tout blanc, il vit de poissons & d'algue. Rond. hist. des poissons, liv. IX.
LOUP, (Astronomie) constellation méridionale qui comprend dix-neuf étoiles. Voyez ETOILE & CONSTELLATION.
LOUP, (Chimie) c'est un des noms que les Chimistes ont donné à l'antimoine, parce qu'il dévore dans la fonte tous les métaux, excepté l'or & l'argent ; qu'il divise ou qu'il dissout non seulement ces substances, mais même tout limon, sable ou pierre avec lesquels on le fait fondre. (b)
LOUP, en Chirurgie, ulcere virulent & chancreux qui vient aux jambes ; ainsi appellé, de ce qu'il ronge & consume les chairs voisines comme un loup affamé. Voyez ULCERE.
LOUP-GAROU, (Hist. des superstitions) c'est dans l'opinion du menu peuple & des laboureurs un esprit malin, très-dangereux, travesti en loup, qui court les champs & les rues pendant la nuit.
L'idée superstitieuse que les hommes pouvoient être changés en loups, & reprendre ensuite leur forme, est des plus anciennes : hominem in lupos verti, rursùmque restitui sibi, falsum existimare debemus, dit Pline, lib. VIII. Cependant cette idée extravagante a subsisté long-tems ; la Religion & la Philosophie ne l'avoient point encore détruite en France sur la fin du seizieme siecle. La Rocheflavin, liv. II. tit. xij. art. 9. rapporte un arrêt du parlement de Dôle, du 18 Janvier 1574, qui condamne au feu Gilles Garnier, lequel ayant renoncé à Dieu, & s'étant obligé par serment de ne plus servir que le diable, avoit été changé en loup-garou. Bodin & Daniel Auge, Augentius, ont cité l'arrêt entier.
Il faut quelquefois rappeller ces sortes de traits aux hommes pour leur faire sentir les avantages des siecles éclairés. Nous devrions à jamais les bénir ces siecles éclairés, quand ils ne nous procureroient d'autres biens que de nous guérir de l'existence des loups-garou, des esprits, des lamies, des larves, des liliths, des lémures, des spectres, des génies, des démons, des fées, des revenans, des lutins, & autres phantômes nocturnes si propres à troubler notre ame, à l'inquiéter, à l'accabler de craintes & de frayeurs. Voyez LUTIN. (D.J.)
LOUP, le, (Art milit.) machine de guerre des anciens. Voyez CORTEAU.
LOUP, terme de Pêche, sorte de filet que l'on peut rapporter à l'espece des ravoirs simples. Elle est en usage sur la côte de l'amirauté de Nantes. Cette pêche se fait à demi-lieue ou environ de terre. Pour cet effet, il faut trois grandes perches dont voici la destination. Celle de terre, qu'ils nomment perche amortie ou sédentaire, a environ vingt-deux piés de long ; elle reste toujours, & on ne la releve point comme les deux autres. La deuxieme se nomme la perche de rade qu'on plante, & qu'on releve tous les jussans. La forme du sac du ret ou filet est en losange à bout coupé ; il n'a aux deux bouts que trois brasses de haut, dans le milieu ou le fond, huit brasses, & sa longueur d'un bout à l'autre est de douze à treize brasses. La troisieme perche est celle du milieu.
Ce filet, dans son opération, est ajusté de maniere que ce tiers environ releve ou est retroussé comme aux filets que l'on nomme ravoirs.
Il ne faut qu'un bateau pour faire la pêche du loup, & souvent il n'y a qu'un homme & des femmes ou filles, trois à quatre personnes au plus.
Quand les pêcheurs veulent tendre leur loup, ils amarrent à la perche de terre ou amortie une haussiere de trente à quarante brasses de long ; on file le lin ; & à treize à quatorze brasses de la perche amortie, on jette le grapin frappé sur un petit cablot dont on file environ dix brasses : on fixe ensuite la perche de rade, en la faisant couler à pic sur un fond de vase où elle enfonce aisément par son propre poids, & on y amarre le cablot du grapin qui de cette maniere lui sert d'étai, & la rend plus ferme & plus stable sur le fond.
Avant de piquer la perche de rade, on passe le bas & le haut des haussieres, bras ou halles du filet qui ont huit brasses de long ; celle du bas reste frappée à cinq piés au-dessus du fond, & celle du haut à cinq à six piés au-dessous du bout de la perche : on amarre ensuite le haut & le bas des bras de la perche de terre qui est la perche amortie.
L'ouverture du ret est établie de maniere que la marée s'y entonne. Lorsque le filet est tendu, on met au milieu la troisieme perche qui peut avoir environ douze à treize piés de haut ; le bas passe environ un pié la partie du ret du loup qui est sur le fond, & cette perche se pique d'elle-même sur les vases durant que la pêche se fait. Les pêcheurs, dans leur bateau, se tiennent sur leur filet au-dessus de la perche du milieu.
Le ret de cette maniere est un filet non flotté, n'ayant ni plomb par bas, ni flottes par la tête ou le haut, de même que les ravoirs auxquels on le pourroit plutôt comparer qu'à toute autre espece de ret ; il se tend à une heure de jussant ou de reflux, c'est-à-dire une heure environ après que la marée a commencé de perdre.
L'ouverture, comme nous avons dit, est de bout à la marée, & il est établi de maniere qu'aux deux tiers du jussant il en paroit alors trois piés de hors l'eau. On le releve une heure avant la basse eau.
Pour prendre le poisson du filet, on démonte la perche de rade, on dépique celle du milieu, & on dégage les deux bras de celle de terre ou sédentaire.
Cette pêche se fait avec succès depuis la saint Michel jusqu'à Noël ; il faut un tems calme & le gros de l'eau ; elle se fait également de jour & de nuit. On y prend de toutes sortes d'especes de poissons plats & des ronds, suivant les saisons & les marées.
Les mailles des rets des loups de Bourg-neuf, où nous n'avons trouvé que deux de ces filets, sont du grand échantillon, ayant seize à dix-sept lignes en quarré ; ces filets sont au surplus mal lacés & mal travaillés.
Cette pêche, comme on le peut remarquer par sa manoeuvre, ne peut être que très-utile, sans pouvoir apporter aucun dommage sur les fonds où l'on la peut pratiquer, ne traînant point & ne pouvant jamais arrêter de frai ni de poisson du premier âge, parce que les mailles qui en sont larges, restent aussi toujours ouvertes & étendues de toute leur grandeur. Voyez nos Pl. de Pêche.
Il y a aussi une autre sorte de filets qu'on appelle loup, & dont on se sert dans la riviere de Loire ; ce sont les mêmes que l'on appelle verveux dans le canal de la Manche, avec cette différence qu'ils sont bien moins proprement faits & beaucoup plus petits. Ils sont composés d'un demi-cercle à l'entrée, & le sac du ret est soutenu de trois autres especes de cercles composés de petits bâtons emboîtés dans des morceaux de bois de sureau.
Le goulet du sac de ces loups va jusqu'au fond, & les mailles du sac qui en font le tour, sont de cinq à six especes différentes d'échantillons ; celles de l'entrée sont de trois sortes, les plus larges ont 37 lignes en quarré, les suivantes 29 lignes, & les plus serrés 27 lignes ; celles du fond du loup sont d'un assez bon calibre, & fort larges par rapport aux rets qu'elles forment ; les plus larges sont de 15 lignes, les autres ont 14 & 13 lignes, ensorte qu'on peut juger que le petit poisson ni le frai ne sauroient y être arrêtés, parce que le ret étant tendu, les mailles sont ouvertes, & qu'il a autant de liberté d'en sortir que d'y entrer. Les Pêcheurs tendent les loups dans les repos de la riviere.
|
| LOUPE | S. f. (Dioptr.) on appelle ainsi une lentille à deux faces convexes, dont les rayons sont fort petits ; cette lentille a la propriété de grossir les objets, voyez LENTILLE ; & elle les grossit d'autant plus que son foyer, c'est-à-dire le rayon de sa convexité, est plus court. Supposons que l'objet placé au foyer de la loupe puisse être vû distinctement sans loupe à 8 pouces de distance, & que le foyer de la loupe soit demi-ligne, l'objet sera augmenté en raison de demi-ligne à 8 pouces, c'est-à-dire de 1 à 192, parce que la loupe fait voir l'objet distinctement (comme s'il étoit à la distance de 8 pouces), & sous le même angle à peu près sous lequel on le verroit sans loupe, mais confusément à la distance de demi-ligne. Voyez l'article MICROSCOPE, où on donne la raison de cette proportion.
LOUPE, terme de Chirurgie, tumeur qui se forme sous la peau dans les cellules du tissu adipeux. Cette tumeur est circonscrite, sans chaleur, sans douleur, & sans changement de la couleur naturelle de la peau qui la couvre. La peau n'y est pas adhérente, & l'on sent dans son centre une fluctuation quelquefois très-sensible, & quelquefois plus obscure.
Les loupes sont des humeurs enkistées, qu'on a rangées sous trois classes, relativement à la nature de l'humeur qu'elles contiennent : mais cela ne forme que des différences accidentelles, puisque, comme l'a fort bien remarqué notre célebre chirurgien françois Ambroise Paré, on ne connoit ce que contiennent ces tumeurs que lorsqu'elles sont ouvertes. Voyez les art. ENKISTE, ATHEROME, STEATOME, MELICERIS.
M. Littre ajoute une quatrieme sorte de loupe formée par une graisse molle, & qu'il a nommée lipoma. Voyez LIPOME.
La cause formelle des loupes est une accumulation des sucs lymphatiques, qui prennent des couleurs & des consistances différentes, suivant qu'ils sont plus ou moins chargés de sucs bilieux, graisseux, gélatineux, ou d'autres sucs recrémenteux. Les coups, les chûtes peuvent en être les causes occasionnelles & primitives. Les loupes se forment peu-à-peu par des degrés insensibles ; aussi ne comprimant point les vaisseaux du voisinage, & ne le faisant que fort peu & très-lentement, le sang se conserve une entiere liberté de circuler, en dilatant à proportion les vaisseaux collatéraux, ce qui fait que les loupes n'attirent ordinairement aucune inflammation. Quand elles grossissent, elles peuvent s'enflammer, s'abscéder ; il y en a qui deviennent skirrheuses & carcinomateuses, cela dépend de la dégénération vicieuse des sucs qui y sont renfermés. Voyez CANCER & CARCINOME.
Paré appelle énorme une loupe dont il a fait heureusement l'extirpation. Elle pesoit huit livres, étoit de la grosseur de la tête d'un homme, située derriere le col, & pendoit entre les épaules. Il est parlé, dans les Transactions philosophiques, d'une loupe bien plus extraordinaire qu'avoit à la mâchoire inférieure un nommé Alexandre Palmer, de Keith en Ecosse : il la portoit depuis vingt-sept ans. Sa grosseur énorme & les douleurs violentes qu'elle lui causoit, le déterminerent à se la faire couper. La base de cette loupe avoit cinq pouces d'étendue, ce qui est considérable par le lieu qu'elle occupoit ; elle pesoit vingt-une à vingt-deux livres : elle étoit de figure sphéroïde, & avoit trente-quatre pouces de tour dans un sens & vingt huit dans un autre. L'hémorrhagie qui suivit l'opération, fut arrêtée par le moyen de la poudre de vitriol, & la plaie par des pansemens ordinaires fut guérie en six semaines.
Les loupes sont des maux opiniâtres, mais qui ne sont pas ordinairement dangereux, lorsqu'elles ne changent point de nature ; elles peuvent néanmoins incommoder beaucoup par leur volume ou par leur situation. On ne peut espérer de les guérir par la voie de la résolution, que quand elles sont commençantes ; & les loupes graisseuses se résoudront plus facilement que les autres par des applications discussives, telles que la fumigation de vinaigre dans lequel on aura fait dissoudre de la gomme ammoniaque : les emplâtres de ciguë, de diabotanum, de vigo cum mercurio, sont fort recommandés, & ne font pas grand effet.
Les loupes, dont la base est étroite, peuvent être détruites par la ligature ; l'extirpation est plus promte & moins douloureuse. J'ai vû plusieurs personnes qui craignoient l'instrument tranchant, en demander l'usage par préférence à la ligature qu'on avoit tentée. Quand le pédicule est assez considérable, on peut inciser circulairement la peau vers la base de la tumeur, & en lier la base intérieurement ; ce procédé épargne les grandes douleurs qui viennent de la grande sensibilité de la peau. On peut aussi cautériser circulairement la peau, & tracer par une escare la voie de la ligature.
Nous avons donné au mot ENKISTEE des regles pour l'extirpation de ces sortes de tumeurs ; mais les grands principes se tirent de l'Anatomie, qui instruit dans chaque cas particulier des parties auxquelles la tumeur a ses attaches. Elle peut tenir à des tendons, à des nerfs, être sur la route de vaisseaux considérables, &c. toutes ces différences font varier le traitement, ou établissent des procédés particuliers. On peut attaquer la tumeur par sa partie la plus éminente par le moyen des cathérétiques, dont on continue l'usage méthodiquement jusqu'à la parfaite éradication de la tumeur. Si la loupe étoit carcinomateuse, ce seroit une voie fort dangereuse ; l'extirpation par l'instrument tranchant est indispensable, si elle est possible. Quand le kiste est emporté ou détruit en entier, l'ulcere est simple, & se guérit aisément par les pansemens ordinaires. (Y)
LOUPES, (Monnoie) on appelle ainsi dans les monnoies les briques & les carreaux des vieux fourneaux qui ont servi à la fonte de l'or & de l'argent. On les broye & on les concasse, pour en tirer par le moyen du moulin aux lavures, les particules de ces deux métaux qui peuvent s'y être attachées. Voyez LAVURES.
Loupes se dit encore en terme de jouaillier, des perles & des pierres précieuses imparfaites, dans la formation desquelles la nature est, pour ainsi dire, restée à moitié chemin.
Les pierres qui restent le plus ordinairement en loupes, sont les saphirs, les rubis & les éméraudes. A l'égard de ces dernieres, il ne faut pas confondre leurs loupes avec ce qu'on appelle prime d'éméraudes. Voyez EMERAUDE.
Pour ce qui est des loupes de perles, ce n'est quelquefois des endroits que de nacre de perles un peu élevés en demi bosse, que les Lapidaires ont l'adresse de scier & de joindre ensemble en forme de vraies perles. Voyez PERLE.
|
| LOURD | adj. (Gramm.) terme relatif à la pesanteur ; il en marque la quantité ou plutôt l'excès. On dit ce fardeau est lourd. L'or est le plus lourd de tous les métaux : voilà ses acceptions physiques. En morale, on dit d'un homme qui n'a nulle finesse, ni d'idées, ni d'expressions, qu'il est lourd ; & qu'une plaisanterie lourde est tout-à-fait insupportable.
|
| LOURDE | Laperdum, (Géog.) petite ville de France en Gascogne, ville unique, & chef lieu du Lavedan, avec un ancien château sur un rocher. Elle est sur le Gave de Pau, à 4 lieues de Bagnieres. Long. 17. 30. lat. 43. 8. (D.J.)
|
| LOURE | S. f. (Musique) est, selon quelques-uns, le nom d'un ancien instrument, semblable à une musette. C'est aussi une sorte de danse dont le mouvement est grave, & marqué le plus souvent par la mesure à 6/4. On pointe ordinairement la note au milieu de chaque tems, & l'on marque le premier tems un peu plus que le second.
La gigue n'est qu'une espece de loure, dont le mouvement est plus vif que celui de la loure ordinaire. Voyez GIGUE.
LOURE DE PERTUIS, terme de riviere, est une piece de bois sur laquelle posent les aiguilles.
|
| LOURER | v. act. en Musique, c'est nourrir les sons avec douceur, & marquer un peu plus sensiblement la premiere note de chaque tems, que la seconde de même valeur. (S)
|
| LOÜS | S. m. (Antiq. greq.) mois macédonien ; il répondoit, suivant le P. Petau, au mois attique Boédromion, & au mois Panaemus des Corinthiens, c'est-à-dire au mois de Novembre. Nous traiterons ailleurs ce sujet avec soin, & d'après les meilleures sources. Voyez MOIS DES GRECS. (D.J.)
|
| LOUTH | comté de, (Géog.) canton d'Irlande, dans la province de Leinster. Il n'a que 25 milles de long sur 13 de large, & se divise en 4 baronies, qui contiennent cinq petites villes ; sçavoir, Carlingford, Dundalk, Louth, Atherdée & Drogheda. Ce pays s'appelloit anciennement Luva ou Luda, & en irlandois Iriel.
LOUTH, (Géog.) en latin Luvapolis, petite ville à marché d'Irlande, dans la province de Leinster, capitale du comté de Louth. Elle est à 7 milles S. O. de Dundalk, & à 6 N. O. d'Atherdée. Long. 11. lat. 53. 56. (D.J.)
|
| LOUTRE | S. f. (Hist. nat. Zoolog.) lutea, animal quadrupede, qui a le corps presque aussi long que le blaireau, les jambes beaucoup plus courtes ; la tête plate, le museau, la mâchoire du dessous plus étroite, & moins longue que celle du dessus ; le cou court & gros, la queue grosse à son origine, & pointue à l'extrêmité. La loutre a deux sortes de poils ; un duvet court, soyeux, & un poil plus long & plus ferme. Toutes les parties supérieures de cet animal sont de couleur brune, luisante ; les parties inférieures sont blanchâtres & luisantes ; les piés ont une couleur brune, roussâtre. Il y a cinq doigts dans chaque pié ; ils tiennent les uns aux autres par une forte membrane, qui est plus longue dans les piés de derriere que dans ceux du devant, parce que les doigts sont aussi plus longs. Ces membranes donnent à cet animal beaucoup de facilité pour nager ; il est plus avide de poisson que de chair ; il ne s'éloigne guere des rivieres & des lacs. Quelquefois il dépeuple les étangs. Lorsqu'il ne trouve ni poisson, ni écrevisse, ni grenouille, ni rat d'eau, il mange l'écorce des arbres aquatiques, ou l'herbe nouvelle au printems. La loutre devient en chaleur en hiver, & met bas au mois de Mars. La chair de cet animal se mange en maigre, & a un très-mauvais goût de poisson, ou plutôt de marais. On trouve des loutres en Europe, depuis la Suede jusqu'à Naples, & dans l'Amérique septentrionale. Les Grecs les connoissoient. Il y en a vraisemblablement dans tous les climats tempérés, sur-tout où il y a beaucoup d'eau. Voyez l'Hist. nat. génér. & part. tome VII.
LOUTRE, (Diete) la chair de cet animal est dure & coriasse, quoique chargée de beaucoup de graisse ; elle est fade, gluante, & d'un goût désagréable de poisson. Elle est par conséquent dégoûtante & malsaine ; & elle doit être rejettée de la classe des alimens. (b)
LOUTRE, (Pelletterie.) Les peaux de loutres garnies de leur poil, font une partie du commerce de la Pelletterie.
On trouve en France & dans d'autres pays de l'Europe des loutres, mais qui ne sont comparables, ni pour la longueur, ni pour la couleur & la finesse de leur poil, à celles qu'on tire du Canada, & d'autres cantons de l'Amérique septentrionale.
M. Furetiere a avancé dans son dictionnaire que le poil de loutre entroit dans la composition des chapeaux. M. Savary prétend que c'est une erreur ; & les plus habiles chapeliers de Paris conviennent de bonne foi qu'ils ne s'en servent jamais, & que s'ils donnent quelquefois le nom de loutre à certains chapeaux, ce n'est que pour les déguiser, & les faire mieux valoir en les vendant au public, auquel on en impose par un nouveau nom.
Les Chapeliers appellent chapeaux de loutre, certains chapeaux dans lesquels ils supposent qu'il entre de la peau de loutre.
|
| LOUVAIN | (Géog.) en flamand Loeven, ville des Pays bas, dans le Brabant, avec une université qui jouit de grands privileges.
Louvain a l'honneur d'être la premiere à l'assemblée des états de Brabant. Son ancien nom latin est Luvonum ou Lovonium, changé depuis en Lovanium. Il n'est fait aucune mention de son existence avant le regne des petits fils de Louis le débonnaire.
Ce n'étoit qu'un bourg au commencement du xij. siecle. Le duc Godefroy le fit entourer de murailles en 1165. Cette nouvelle ville s'aggrandit promtement, se peupla prodigieusement, & devint dans l'espace de deux cent ans, la plus grande, la plus riche, & la plus marchande de tout le pays. Son principal trafic consistoit en drap, en laine, en toile ; & ce trafic étoit si florissant au milieu du xiv siecle, qu'on y comptoit plus de quatre mille maisons de drapiers ou de tisserans, & plus de 150 mille ouvriers ; mais ce commerce vint à cesser tout d'un coup, par les révolutions que causa la révolte de 1382, contre Venceslas duc de Brabant. Tous les ouvriers qui étoient entrés dans la révolte furent pendus ou bannis. Alors les exilés se retirerent pour la plûpart en Angleterre, où ils furent reçus à bras ouverts ; ainsi Louvain demeura dépeuplée faute de commerce & d'habitans, & elle ne s'est jamais relevée depuis. En vain Jean IV. duc de Brabant, crut la rétablir, en y fondant l'an 1426, une université ; mais des professeurs, des colleges & des étudians, ne rendent point la valeur du commerce & de l'industrie ; aussi cette valeur est aujourd'hui resserrée dans Louvain, au triste débit d'une biere très-médiocre.
Louvain appartient au diocèse de Malines pour le spirituel. Elle est située sur la Dyle, à 4 lieues de Bruxelles & de Malines, 3 de Tirlemont, 12 N. O. de Namur, 16 N. E. de Mons, 65 N. de Paris. Long. selon Street 22 deg. 26 min. 15 sec. lat. 50. 50.
Espen (Zeger Bernard van) célebre jurisconsulte, & savant canoniste, naquit dans cette ville en 1646, & mourut à Amersfort en 1728, à 83 ans. On doit des éloges à quelques-uns de ses ouvrages, mais surtout à son jus ecclesiasticum universum, dans lequel il fait paroître une grande connoissance de la discipline ecclésiastique ancienne & moderne. (D.J.)
|
| LOUVE | S. f. (Litter.) nourrice de Rémus & de Romulus. Ces deux freres jumeaux, dit Virgile, d'après la tradition populaire, suçoient les mamelles de cet animal, badinoient sans crainte autour de la bête féroce, qu'ils regardoient comme leur mere, & qui les traitoit comme ses enfans. Cette louve se trouve souvent dans les anciens monumens de Rome, avec les deux enfans qui tetent. Telle est cette belle statue du Tibre copiée sur l'antique, & que l'on voit dans le jardin des Tuileries. Plutarque, bien ou mal instruit, raconte dans ses paralleles un fait à-peu-près semblable à celui de Rome, arrivé dans l'Arcadie : mais sur les médailles, un loup ou une louve signifient toujours l'origine de la ville de Rome, ou la domination romaine à laquelle les peuples étoient soumis. (D.J.)
LOUVE, (Architect.) dans l'art de bâtir, est un morceau de fer comme une main, avec un oeil, qu'on serre dans un trou fait exprès à une pierre prête à poser, avec deux louveteaux, qui sont deux coins de fer ; ensuite on attache le cable d'une grue ou autre machine à l'oeil de la louve, ce qui sert à enlever la pierre du chantier sur le cas.
Louver, c'est faire le trou dans la pierre pour y mettre la louve.
LOUVE LA, (Géog.) nom de deux petites rivieres de France, l'une en Franche-comté, a sa source dans le bailliage de Pontarlier, & se jette dans le Doux au-dessous de Dôle. Elle est rapide, poissonneuse, & très-utile pour le flottage du bois. L'autre a sa source en Béarn, au village de Louboux. & se perd dans l'Adour, un peu au-dessous de Castelnau. (D.J.)
|
| LOUVESTAN | (Géog.) pays d'Asie, dans le Curistan méridional, entre le Tigre, le Curistan & la Perse. M. Fréret juge avec beaucoup de vraisemblance, que c'est la Bactriane de Xénophon ; qu'il ne faut pas confondre avec la Bactriane, qui s'étendoit sur la rive méridionale du fleuve Oxus, & dont Bactra, aujourd'hui Termend, sur le Gihon, étoit la capitale, au sentiment de plusieurs géographes. (D.J.)
|
| LOUVET | (Maréch.) poil de cheval, il est d'un gris couleur de poil de loup.
|
| LOUVETEAU | S. m. (Pelletterie) petit engendré d'un loup & d'une louve. La peau du louveteau garnie de son poil, est une assez bonne fourrure quand elle est bien préparée par le pelletier. On l'emploie à en faire des manchons & autres fourrures semblables, qui sont plus ou moins estimées, suivant la beauté & la finesse du poil. Voyez LOUP.
|
| LOUVETERIE | S. f. (Vén.) équipage de chasse pour le loup. Il y a des officiers de louveterie, & dans plusieurs provinces la louveterie a ses lieutenans.
|
| LOUVETIER | S. m. (Vénerie) officier qui commande à l'équipage du roi, pour la chasse du loup. Le grand louvetier de France porte à ses armes deux têtes de loup au-dessous de l'écu ; il fut créé sous François I. en 1520. On se proposa d'exterminer les animaux malfaisants appellés loups : on établit des louvetiers particuliers. Ils ont encore leurs fonctions dans la plûpart de nos villages avoisinés de forêts.
LOUVETIER, (Hist. mod.) officier qui commande à l'équipage de la chasse du loup. Autrefois il y avoit des louvetiers entretenus dans toutes les forêts ; & il en reste encore en beaucoup d'endroits. Le grand louvetier a deux têtes de loup au-dessous de l'écu de ses armes : ce fut François I. qui en créa la charge en 1520. Le grand louvetier prête serment entre les mains du roi, les autres officiers de la louveterie le prêtent entre ses mains. Le ravage que causa dans les provinces la grande multiplication de loups, occasionnée par la dépopulation qui suivit les incursions des barbares dans les Gaules, attirerent l'attention du gouvernement : il y eut des lois faites à ce sujet. Il fut ordonné par celles des Bourguignons, & par les capitulaires de nos rois d'avertir les seigneurs du nombre de loups que chacun aura tués, d'en présenter les peaux au roi ; de chercher & de prendre les louveteaux au mois de Mai ; & aux vicaires ou lieutenans des gouverneurs, d'avoir chacun deux louvetiers dans leur district : on proposa des prix à ceux qui prendroient des loups. On finit par établir des louvetiers dans chaque forêt, & par créer un grand louvetier, auquel les autres seroient subordonnés. Les places de louvetiers, en chaque province, n'étoient que des commissions, lorsque François I. les mit en titre d'office, & au-dessus des officiers, celui de grand louvetier de France. On attribua d'abord aux louvetiers deux deniers par loup, & trois deniers par louve, salaire qui dans la suite fut porté à quatre deniers par louve, & qui dut être payé par chaque feu de village, à deux lieues à la ronde du lieu où l'animal avoit été pris. Les habitans de la banlieue de Paris en furent & ont continués d'en être exempts.
|
| LOUVEURS | S. m. pl. (Maçonnerie) ouvriers qui font les trous dans la pierre, & qui y placent la louve. Voyez LOUVE.
|
| LOUVIER | ou plutôt LOUVOIER, (Marine) c'est courir au plus près du vent, tantôt à stribord, tantôt à bas-bord, en portant quelque tems le cap d'un côté, puis revirant & le portant d'un autre côté, ce qui se fait lorsqu'on a le vent contraire, & qu'on veut chicaner le vent, & maintenir le vaisseau dans le parage où il est, afin de ne se pas éloigner de la route.
|
| LOUVIERS | (Géog.) en latin moderne Lupapariae ; ville de France dans la haute Normandie, avec titre de comté. Il y a une manufacture de draperies qui est assez considérable. Louviers est d'ailleurs située favorablement dans une plaine fertile, à 4 lieues N. d'Evreux, 2 S. du Pont-de-l'arche, 8 S. E. de Rouen, 22 N. O. de Paris. Long. 18. 50. lat. 49. 10.
|
| LOUVO | ou LOUVEAU, (Géog.) Kempfer écrit LIVO, & les Siamois l'appellent Noccheboury ; ville d'Asie, au royaume de Siam, avec un palais que les rois de Siam habitent une partie de l'année ; c'est leur Versailles. Elle est fort peuplée, & située dans une belle plaine à 9 lieues de la capitale, où l'on peut aller par un canal. Long. selon les PP. Jésuites, 118. 33. selon M. Delille, 121. 11. 30. lat. 14. 43. 25.
|
| LOUVOYER | verbe neutre, (Marine) c'est voguer quelque tems d'un côté, puis virer de cap, & aller autant de l'autre, afin de se conserver toujours une même hauteur, & dériver de sa route le moins qu'il est possible. On louvoie quand le vent est contraire.
|
| LOUVRE | LE, (Hist. mod.) en latin lupara, palais auguste des rois de France dans Paris, & le principal ornement de cette capitale. Tout le monde connoît le louvre, du-moins par les descriptions détaillées de Brice & autres écrivains.
Il fut commencé grossierement en 1214 sous Philippe Auguste, & hors de la ville. François I. jetta les fondemens des ouvrages, qu'on appelle le vieux louvre ; Henri II. son fils employa d'habiles architectes pour le rendre régulier. Louis XIII. éleva le pavillon du milieu couvert en dôme quarré ; Louis XIV. fit exécuter la superbe façade du louvre qui est à l'orient du côté de saint Germain l'Auxerrois. Elle est composée d'un premier étage, pareil à celui des autres façades de l'ancien louvre ; & elle a au-dessus un grand ordre de colonnes corinthiennes, couplées avec des pilastres de même. Cette façade, longue d'environ 88 toises, se partage en trois avant-corps, un au milieu, & deux aux extrêmités.
L'avant-corps du milieu est orné de huit colonnes couplées, & est terminé par un grand fronton, dont la cimaise est de deux seules pierres, qui ont chacune cinquante-deux piés de longueur, huit de largeur & quatorze pouces d'épaisseur.
Claude Perrault donna le dessein de cette façade, qui est devenue par l'exécution, un des plus augustes monumens qui soient au monde. Il inventa même les machines, avec lesquelles on transporta les deux pierres dont nous venons de parler.
L'achevement de ce majestueux édifice, exécuté dans la plus grande magnificence, reste toujours à désirer. On souhaiteroit, par exemple, que tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés & rétablis en portiques. Ils serviroient ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler ces sortes d'ouvrages précieux, épars dans les jardins où on ne se promene plus, & où l'air, le tems & les saisons, les perdent & les ruinent. Dans la partie située au midi, on pourroit placer tous les tableaux du roi, qui sont présentement entassés & confondus ensemble dans des gardes-meubles où personne n'en jouit. On mettroit au nord la galerie des plans, s'il ne s'y trouvoit aucun obstacle. On transporteroit aussi dans d'autres endroits de ce palais, les cabinets d'Histoire naturelle, & celui des médailles.
Le côté de saint Germain l'Auxerrois libre & dégagé, offriroit à tous les regards cette colonade si belle, ouvrage unique, que les citoyens admireroient, & que les étrangers viendroient voir.
Les académies différentes s'assembleroient ici, dans des salles plus convenables que celles qu'elles occupent aujourd'hui ; enfin, on formeroit divers appartemens pour loger des académiciens & des artistes. Voilà, dit-on, ce qu'il seroit beau de faire de ce vaste édifice, qui peut-être dans deux siecles n'offrira plus que des débris. M. de Marigni a depuis peu executé la plus importante de ces choses, la conservation de l'édifice. (D.J.)
LOUVRE, honneur du, (Hist. de France) on nomme ainsi le privilege d'entrer au louvre & dans les autres maisons royales, en carrosse. En 1607, le duc d'Epernon étant entré de cette maniere dans la cour du louvre, sous prétexte d'incommodité, le roi voulut bien le lui permettre encore à l'avenir, quoique les princes seuls eussent ce privilege ; mais il accorda la même distinction au duc de Sully en 1609 ; enfin, sous la régence de Marie de Médicis, cet honneur s'étendit à tous les ducs & officiers de la couronne, & leur est demeuré. (D.J.)
|
| LOUYSIANE | LA, (Géog.) grande contrée de l'Amérique septentrionale, & qui faisoit autrefois partie de la Floride. Le P. Charlevoix en a donné une description détaillée dans son Histoire de la nouvelle France ; je n'en dirai qu'un mot.
Fernand de Soto, Espagnol, la découvrit le premier, mourut dans le pays, & les Espagnols ne songerent pas à s'y établir. Le P. Marquette, jésuite, & le sieur Jolyet y aborderent en 1672. Dix ans après, M. de la Sale perfectionna cette découverte, & nomma cette vaste contrée la Louysiane. En 1698, M. d'Iberville, capitaine de vaisseau, entra dans le Mississipi, & le remonta jusqu'à son embouchure. En 1718, 1719 & 1720, la France y projetta un établissement qui n'a point eu de succès jusqu'à ce jour : cependant ce pays paroît un des meilleurs de l'Amérique ; il est traversé du nord au sud par le Mississipi. Le P. Hennepin, récollet, a donné en 1683 une description de la Louysiane, qui a grand besoin de corrections, Longitude 279-289. latit. 39-39. (D.J.)
|
| LOVANGIR | ou LOANGIRO, (Géog.) contrée maritime d'Afrique, dans la basse Ethiopie, au royaume de Loango. Cette contrée est arrosée de petites rivieres qui la fertilisent.
|
| LOVANGO-MONGO | (Géog.) Voyez LOANGO-MONGO.
|
| LOWICK | ou LOWIECKZ, ou LOWITZ, (Géog.) en latin Lovicium, ville de Pologne au palatinat de Rava, avec une forteresse ; c'est la résidence des archevêques de Gnesne ; elle est sur le ruisseau de Bzura, à 7 lieues S. de Ploczko, 12. N. de Rava. Long. 37. 49. lat. 52. 18.
|
| LOWLANDERS | (Géog.) nom qu'on donne aux Ecossois qui demeurent dans le plat-pays, pour les distinguer des montagnards qui sont appellés Highlanders, Les Lowlanders sont composés de diverses nations, d'Ecossois, d'Anglois, de Normands, de Danois, &c. Leur langue renferme quantité de termes tirés de l'ancien Saxon ; mais ces termes s'abolissent tous les jours, depuis que l'anglois y a pris si fort racine, que le vieux langage écossois ne se parle plus que dans les montagnes, & dans les îles parmi le petit peuple.
|
| LOXA | (Géog.) ou LOJA, car c'est la même prononciation ; ville d'Espagne au royaume de Grenade, dans un terroir agréable & fertile sur le Xénil, à 6 lieues de Grenade. Long. 14. 5. lat. 37. 5.
Il y a une petite ville de Loxa au Pérou, dans l'audience de Quito, sur le confluent de deux petits ruisseaux, qui descendent du nord de Caxanuma, & qui tournant à l'est, & grossis de plusieurs autres, forment la riviere de Zamora, qui se jette dans le Maragnon, sous le nom de Sant Jago. Loxa est situé quatre degrés au-delà de la ligne équinoxiale, environ cent lieues au sud de Quito, un degré plus à l'ouest. La montagne de Caxanuma, célebre par l'excellent quinquina qui y croît, est à plus de deux lieues & demie au sud de Loxa. Cette petite ville a été fondée en 1546, dans un vallon assez agréable, par Mercadillo, l'un des capitaines de Gonçale Pizarre. Son sol est d'environ 1100 toises au-dessus du niveau de la mer. Le climat y est fort doux, quoique les chaleurs y soient quelquefois incommodes. J'en parle ainsi d'après M. de la Condamine, Mém. de l'acad. des Sc. ann. 1745. (D.J.)
|
| LOXODROMIE | S. f. loxodromia, (Navigat. & Géométrie) ligne qu'un vaisseau décrit sur mer, en faisant toûjours voile avec le même rhumb de vent. Voyez RHUMB.
Ce mot vient du grec, & il est formé de , oblique, & de , course.
Ainsi la loxodromie, qu'on appelle aussi ligne loxodromique, ou loxodrimique, coupe tous les méridiens sous un même angle, qu'on appelle angle loxodromique.
La loxodromie est une espece de spirale logarithmique tracée sur la surface d'une sphere, & dont les méridiens sont les rayons. Voyez LOGARITHMIQUE (SPIRALE). M. de Maupertuis, dans son discours sur la parallaxe de la lune, nous a donné plusieurs propriétés de la loxodromie, ainsi que dans un mémoire imprimé parmi ceux de l'académie des sciences de Paris, en 1744. Voyez l'article CAPOTAGE.
La loxodromie tourne autour du pole sans jamais y arriver, comme la logarithmique spirale tourne autour de son centre. Il est de plus évident qu'une portion quelconque de la loxodromie est toûjours en raison constante avec la portion correspondante du méridien.
Si on nomme z l'arc compris entre le pole & un point de la loxodromie, & 1 le rayon, d u la différence de la longitude, on aura l'arc infiniment petit du parallele correspondant égal à d u sin. z ; & cet arc doit être en raison constante avec d z, à cause que la loxodromie coupe toûjours le méridien sous le même angle, donc est = b ; c'est l'équation de la loxodromie ; soit sin. z = x on aura dz = & b d u = ; soit x = 1/r, on aura b d u = - ou - b d u = dont l'intégrale est - b u + C = log. r + . Voyez INTEGRAL & LOGARITHME. Par cette équation on peut construire des tables loxodromiques pour tel rhumb de vent qu'on voudra. Voyez LOXODROMIQUE.
La loxodromie, ou plutôt sa projection sur le plan de l'équateur, est représentée fig. 7 & 8. de Navigat. P représente le pole ; P A, P B, P C, &c. les méridiens, ou plutôt leurs projections sur le plan de l'équateur ; A I H G est la loxodromie. (O)
|
| LOXODROMIQUE | S. f. (Navigat.) est l'art ou la méthode de faire voile obliquement au moyen de la loxodromie. Voyez NAVIGATION, RHUMB & LOXODROMIE.
Loxodromique se prend aussi adjectivement, & il est beaucoup plus en usage dans ce sens.
Ligne loxodromique, ou simplement loxodromique, est la même chose que loxodromie ; on l'appelle aussi ligne de rhumb.
Tables loxodromiques sont des tables dressées pour l'usage des navigateurs, dans lesquelles on calcule pour chaque rhumb de vent partant de l'équateur, la longueur du chemin parcouru, & le changement de longitude, en supposant le changement en latitude de dix en dix minutes. Voy. l'art. CAPOTAGE & CARTE. Voyez aussi l'histoire des Mathématiques de M. Montucla, tome I. pag. 608-617.
En général, pour construire ces tables, on remarquera que par la propriété de la loxodromie qui fait toûjours un angle constant avec les méridiens, un arc ou portion quelconque de la loxodromie, qui est le chemin du vaisseau, est à l'arc du méridien correspondant comme le sinus total est au co-sinus de l'angle de la loxodromie avec le méridien, ou au sinus de son angle avec l'équateur. A l'égard de la longitude, on peut la calculer de deux manieres. 1°. Par cette proportion l'angle de la loxodromie avec l'équateur est au co sinus de ce même angle comme l'incrément de la latitude est à l'incrément de la longitude pris dans l'arc du parallele ; & ainsi on aura pour chaque particule du méridien de dix en dix minutes l'arc du parallele correspondant, qui divisé par le rayon du parallele, ou le co-sinus de latitude, donnera l'incrément réel de la longitude ; la somme de ces incrémens sera évidemment la longitude totale. 2°. On peut se servir de la formule que nous avons donnée au mot LOXODROMIE, & qui contient l'équation entre les longitudes & les latitudes. Ceux qui desireront un plus long détail, peuvent avoir recours à l'histoire des Mathématiques déjà citée. Voyez aussi MILLES de longitude, & LIEUES MINEURES de longit.
|
| LOYAL | adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est légitime & conforme à la loi ; il sembleroit par-là que légal & loyal seroient toujours la même chose : on dit un préciput légal, un augment légal, c'est-à-dire fondé sur la loi, & non sur la convention : on appelle du grain bon, loyal & marchand, lorsqu'il est tel que la loi veut qu'on le donne ; néanmoins dans quelques coutumes, on dit loyal administrateur pour légal.
Loyal signifie aussi quelquefois féal ou fidele ; c'est en ce sens que l'on dit qu'un vassal doit être féal & loyal à son seigneur. (A)
LOYAL, (Maréch.) : cheval loyal, est celui qui étant recherché de quelque manege, donne librement ce qu'il a, qui emploie sa force pour obéir, & ne se défend point, quoiqu'on le maltraite.
Bouché loyale, est une bouche excellente, une bouche à pleine main. Voyez BOUCHE.
LOYAUX-COUTS ou LOYAUX-COUTEMENS, (Jurisprud.), sont toutes les sommes que l'acquéreur a été obligé de payer outre le prix de son acquisition, tant pour les frais de son contrat que pour les proxénetes, pour pot-de-vin & épingles, pour les frais d'un decret volontaire, s'il en a fait un, pour les droits seigneuriaux & pour les réparations nécessaires, faites par autorité de justice.
Ce terme est usité en matiere de retrait ; l'acquéreur qui est évincé par retrait devant être indemne, le retrayant doit lui rembourser, outre le prix principal, tous les loyaux.
On les appelle loyaux, parce que le retrayant n'est tenu de rembourser que ce qui a été payé légitimement ou suivant la loi ; desorte que, si l'acquéreur a trop payé pour les frais du contrat ou pour ceux de son decret, ou s'il a fait des réparations inutiles, ou sans les avoir fait constater par justice, le retrayant n'est tenu de lui rembourser que ce qui pouvoit être dû légitimement.
Il en est parlé dans l'art. 129. de la coutume de Paris ; à l'occasion du retrait lignager. Voyez les Commentateurs sur cet article. (A)
|
| LOYER | (Jurisprud.) est ce que le locataire d'une chose donne pour le prix de la location.
On donne à loyer ou plutôt à louage des choses mobiliaires, comme un cheval, des meubles meublans, &c.
Le terme de loyer se prend plus particulierement pour le prix du louage d'une maison, terre ou autre héritage.
Le propriétaire d'une maison a un privilege sur les meubles de ses locataires pour les trois derniers quartiers & le courant, à moins que le bail n'ait été passé devant notaire, auquel cas le privilege s'étend sur tous les loyers qui doivent échoir jusqu'à la fin du bail. Voyez l'article 171. de la coûtume de Paris.
L'ordonnance de 1629, art. 142, dit que les loyers des maisons & prix des baux à ferme, ne pourront être demandés cinq ans après les baux expirés.
Cette décision paroît suivie au parlement de Paris. Voy. BAIL, LOCATAIRE, LOCATION, LOUAGE. (A)
|
| LOYS | (Hist. mod. Géog.) c'est le nom des peuples qui habitent le royaume de Champa ou Siampa dans les Indes orientales ; ils ont été subjugués par les Cochinchinois qui sont aujourd'hui les maîtres du pays, & à qui les premiers payent tribut. Les Loys ont les cheveux noirs, le nez applati, des moustaches, & se couvrent de toile de coton. Ils sont plus laborieux, plus riches & plus humains que les Cochinchinois leurs maîtres. Parmi eux les gens du bas peuple n'ont point la permission d'avoir de l'argent chez eux.
|
| LOYTZ | (Géog.) ville d'Allemagne au cercle de la haute Saxe, dans la Poméranie citérieure, sur la Pêne, à 9 lieues S. de Stralsund, 5 N. O. de Gutzkow. Les historiens Allemands la nomment en latin Lutitia, & prétendent que c'est un reste des Lutitii ou Luticii, ancien peuple de Germanie entre les Slaves, & cette opinion a quelque fondement dans la Topographie. (D.J.)
|
| LUA | (Mythol.) divinité romaine, qu'on invoquoit à la guerre. Il n'en est parlé que dans Tite-Live, liv. VIII. & ce qu'il en dit ne nous rend pas trop savans. Cet historien rapporte qu'après un combat contre les Volsques, le consul qui commandoit l'armée des Romains, consacra à la déesse Lua les armes des morts qui se trouverent sur le champ de bataille. Loméier infere de-là, dans son savant traité de lustrationibus Gentilium, cap. iv, qu'il étoit d'usage de faire des expiations après un combat, & que l'offrande des armes des morts se fit par le consul, pour expier son armée du sang humain répandu. Selon ce système, Lua étoit la déesse des expiations, du moins son nom le désigneroit assez clairement ; il est tiré de luere, expier. (D.J.)
|
| LUBECK | (Géog.) en latin moderne Lubecum ; ville d'Allemagne dans le cercle de la basse-Saxe, capitale de la Wagrie, avec un évêché, dont l'évêque est prince de l'empire, & suffragant de Brême, une citadelle & un port. C'est une ville libre, impériale, anséatique & très-florissante, qui fait une espece de république.
Elle doit sans doute sa naissance à des cabanes de pêcheurs ; car on ne sait ni quand, ni qui l'a fait bâtir ; & comme on n'en trouve aucune mention avant Godeschale, roi des Hérules ou Obotrites, lequel fut assassiné par les Slaves vers l'an 1066, on prétend qu'il en fut le restaurateur ; mais que ce soit lui, Vikbon danois, Trutton le vandale ou tel autre que l'on voudra qui en ait jetté les fondemens, ce n'est certainement aucun roi de Pologne, quoi qu'en disent les historiens de ce royaume.
Nous savons que dans le xiij. siecle Lubeck étoit déjà considérable, qu'elle avoit la navigation libre de la Trave, & que Voldemar, frere de Canut, roi de Danemarck, s'en étant emparé, ne ménagea pas les habitans. Ceux-ci, pour s'en délivrer, s'adresserent à l'empereur Frédéric II, à condition d'être ville libre & impériale. Aussi de puis 1227, Lubeck conserva sa liberté, & devint une véritable république sous la protection de l'empereur. Malheureusement elle fut réduite en cendres par un incendie en 1276.
Elle a joué le premier rang entre les anciennes villes anséatiques, & en eut le directoire. Elle embrassa la confession d'Augsbourg en 1535, & jouit actuellement d'un territoire assez étendu, dans lequel on compte une centaine de villages ; elle a rang au banc des villes impériales à la diete de l'empire, & elle y alterne pour la préséance avec la ville de Worms.
Lubeck est située au confluent des rivieres de la Trave, de Wackenitz & de Steckenitz, à 4 lieues du golfe de son nom, dans la Wagrie, aux confins de Stomar, & du duché de Lawenbourg ; elle est à 19 lieues N. O. de Lawenbourg, 15 N. E. d'Hambourg, 53 S. O. de Copenhague, 178 N. O. de Vienne. Long. selon Appien, 28, 20 ; selon Bertius, 32, 45. lat. selon tous les deux, 54, 48. Jean Kirchman, Henri Meibomius, Henri Muller, & Laurent Surius sont nés à Lubeck. Je ne m'appesantirai pas sur leur vie, ni sur leurs ouvrages.
Kirchman est un littérateur dont on estime les deux Traités de annulis, & de funeribus Romanorum ; il mourut en 1643 à 68 ans.
Meibom s'est fait un grand nom dans la Littérature & la Médecine. Ses ouvrages composent 3 vol. in-fol. Il mourut en 1700, à 52 ans.
Muller est auteur de plusieurs écrits polémiques en Théologie ; il mourut en 1675, à 44 ans, las de la vie, & assurant ses amis, qu'il ne se ressouvenoit pas d'avoir encore passé un seul jour agréable.
Surius, de protestant devenu chartreux, chose rare, a publié un Recueil des conciles en 4. vol. in-fol. Le cardinal du Perron le traite d'ignorant, & Seckendorf d'aveugle. Il a plus que justifié cette derniere épithete par son apologie du massacre de la S. Barthélemi. Il est mort à 56 ans, en 1578. (D.J.)
LUBECK, le droit, (Droit Germaniq.) c'est originairement le droit que Lubeck a établi dans son ressort pour le régir & le gouverner.
Comme autrefois cette ville avoit acquis une grande autorité par sa puissance & par son commerce maritime, il arriva que ses lois & ses statuts furent adoptés par la plûpart des villes situées sur la mer du nord. Stralsund, Rostock, & Wismar en particulier, obtinrent de leurs maîtres la liberté d'introduire ce droit chez elles, & d'autres villes le reçurent malgré leurs souverains.
Plusieurs auteurs placent les commencemens de ce droit sous Fréderic II. qui le premier accorda la liberté à la ville de Lubeck, & de plus confirma ses statuts & son pouvoir légatif ; il y a néanmoins apparence que le droit qui la gouverne ne fut pas établi tout-à-la fois, mais qu'on y joignit de nouveaux articles de tems à autres, selon les diverses conjonctures. Ce ne fut même qu'en 1582 que le sénat de Lubeck rangea tous ses statuts en un corps de lois, qui vit le jour en 1586. L'autorité de ce code est encore aujourd'hui fort considérée dans le Holstein, la Poméranie, le Mecklenbourg, la Prusse & la Livonie : quoique les villes de ces pays n'aient plus le privilege d'appeller à Lubeck, on juge néanmoins leurs procès selon le droit de cette ville ; ce qui s'observe particulierement au tribunal de Wismar.
On peut consulter l'ouvrage latin de Jean Sibrand sur cette matiere, & le savant commentaire, Commentarius ad jus Lubecense, de David Mevius, qui fut d'abord professeur à Grypswald, & enfin vice-président de la chambre de Wismar. (D.J.)
|
| LUBEN | Lubena, (Géog.) petite ville d'Allemagne, capitale de la basse Lusace sur la Sprée. Long. 31. 50. lat. 51. 58.
LUBEN, (Géog.) petite ville de Silésie au duché de Lignitz, sur le ruisseau de Kaltzback, & faisant un cercle à part, selon Zeyler. Elle est à 3 milles de Bokowitz sur la route de Breslau à Francfort sur l'Oder : long. 33. 49. lat. 51. 27. (D.J.)
|
| LUBENTEA | S. f. (Mytholog.) déesse du desir. C'étoit elle qui l'exécutoit.
|
| LUBLIN | PALATINAT DE, (Géog.) province de la petite Pologne, qui prend son nom de sa capitale. La Vistule la borne au couchant, & le Viepers la coupe d'abord du S. O. au N. O. & ensuite du levant au couchant.
LUBLIN, (Géog.) ville de Pologne, capitale du palatinat de même nom, avec une citadelle, un évêché suffragant de Cracovie, une académie, & une synagogue pour les Juifs. Lublin est remarquable par ses foires, & plus encore parce qu'on y tient les grands tribunaux judiciaires de toute la Pologne. Elle est située dans un terroir fertile sur la Bystrzna, à 36 milles N. E. de Cracovie, 24 S. E. de Varsovie, 14 N. E. de Sendomir, & 70 S. O. de Vilna : long. 40. 50. lat. 51. 41.
|
| LUBOLO | (Géog.) pays d'Afrique dans l'Ethiopie occidentale, au royaume d'Angola, c'est-là le Lubolo proprement dit, contrée couverte d'animaux carnassiers, de chevres & de cerfs sauvages, qui y trouvent abondamment de quoi subsister à leur aise. (D.J.)
|
| LUBRIFIER | v. act. (Méd.) Il est synonyme à oindre & rendre glissant. L'huile d'amande douce lubrifie les intestins, amortit l'action des humeurs âcres & caustiques, & peut soulager dans la colique.
|
| LUBRIQUE | LUBRICITé, s. f. (Gram.) termes qui désignent un penchant excessif dans l'homme pour les femmes, dans la femme pour les hommes, lorsqu'il se montre extérieurement par des actions contraires à la décence ; la lubricité est dans les yeux, dans la contenance, dans le geste, dans le discours. Elle annonce un tempérament violent ; elle promet dans la jouissance beaucoup de plaisir & peu de retenue. On dit de quelques animaux, comme les boucs, les chats, qu'ils sont lubriques ; mais on ne dira pas qu'ils sont impudiques : il semble donc que l'impudicité soit un vice acquis, & la lubricité un défaut naturel. La lasciveté tient plus aux mouvemens qu'à la sensation.
|
| LUC | EVANGILE DE SAINT, (Théol.) nom d'un des livres canoniques du nouveau Testament, qui contient l'histoire de la vie & des miracles de Jesus-Christ, écrite par saint Luc, qui étoit syrien de nation, natif d'Antioche, medecin de profession, & qui fut compagnon des voyages & de la prédication de S. Paul.
Quelques-uns, comme Tertullien, liv. IV. contre Marcion, ch. v. & S. Athanase ou l'auteur de la synope qu'on lui attribue, enseignent que l'évangile de S. Luc étoit proprement l'évangile de saint Paul ; que cet apôtre l'avoit dicté à S. Luc ; & que quand il parle de son évangile, comme Rom. xj. 16. & xvj. 25. & II. Thessalonic. xj. v. 13, il entend l'évangile de S. Luc. Mais S. Irenée, liv. III. ch. j. dit simplement que S. Luc rédigea par écrit ce que S. Paul prêchoit aux nations, & S. Grégoire de Nazianze, que cet évangéliste écrivit appuyé du secours de S. Paul. Il est certain que S. Paul cite ordinairement l'évangile de S. Luc, comme on peut voir I. Cor. xj. 23. 24 & 25, & I. Cor. xv. v. 5. Mais S. Luc ne dit nulle part qu'il ait été aidé par S. Paul ; il adresse son évangile, aussi bien que les actes des apôtres, à un nommé Théophile, personnage qui n'est pas connu, & plusieurs anciens ont pris ce nom dans un sens appellatif pour un homme qui aime Dieu. Les Marcionites ne recevoient que le seul évangile de S. Luc, encore le tronquoient-ils en plusieurs endroits, comme l'ont remarqué Tertullien, liv. V. contre Marcion, & saint Epiphane, haeres. 42.
Le style de S. Luc est plus pur que celui des autres évangélistes, mais on y remarque plusieurs expressions propres aux juifs hellenites, plusieurs traits qui tiennent du génie de la langue syriaque & même de la langue grecque, au jugement de Grotius. Voyez la préface de dom Calmet sur cet évangile. Calmet, Dictionn. de la Bible.
|
| LUCANIE | LA, (Géogr. anc.) région de l'Italie méridionale, nommée Lucania par les Romains, & par les Grecs.
Elle étoit entre la mer Tyrrène & le golfe de Tarente, & confinoit avec les Picentins, les Hirpins, la Pouille & le Brutium. Le Silaris, aujourd'hui le Silaro, la séparoit des Picentins ; le Brodanus, aujourd'hui le Brandano, la séparoit de la Pouille ; le Laus, aujourd'hui le Laino, & le Sibaris, aujourd'hui la Cochile, la séparoient du Brutium.
Pline, liv. III. ch. v. dit que les Lucaniens tiroient leur origine des Samnites. Elien rapporte qu'ils avoient une belle loi, laquelle condamnoit à l'amende ceux qui refusoient de loger les étrangers qui arrivoient dans leurs villes après le soleil couché ; cependant du tems de Strabon ce peuple étoit tellement affoibli, qu'à peine ces mêmes villes, si bonnes hospitalieres, étoient-elles reconnoissables. Le P. Briet a tâché de les retrouver dans les noms modernes ; mais c'est assez pour nous de remarquer en général que l'ancienne Lucanie est à-présent la partie du royaume de Naples qui comprend la Basilicate (demeure des anciens Sybarites), la partie méridionale de la principauté citérieure, & une petite portion de la Calabre moderne.
Il y a un grand nombre de belles médailles frappées dans les anciennes villes de cette contrée d'Italie : il faut lire à ce sujet Goltzius, Nonius, & le chevalier Marsham. (D.J.)
|
| LUCAR | S. m. (Hist. anc.) l'argent qu'on dépensoit pour les spectacles, & sur-tout pour les gages des acteurs. Ce mot vient de locus, place, ou ce que chaque spectateur payoit pour sa place. Le salaire d'un acteur étoit de cinq ou sept deniers : Tibere le diminua. Sous Antonin, il alla jusqu'à sept aurei ; il étoit défendu d'en donner plus de dix : peut-être faut-il entendre que sept ou cinq denarii furent le salaire du jour ou d'une représentation ; & sept ou dix aurei, le mois. On prenoit les frais du fisc, & ils étoient avancés par ceux qui donnoient les jeux.
LUCAR, San, cap, (Géog.) cap de l'Amérique septentrionale dans la mer du Sud ; ce cap fait la pointe la plus méridionale de la Californie. Nous savons que sa longitude est exactement 258d. 3'. 0''.
LUCAR de BARRAMEDA, San, (Géogr.) ville & port de la mer d'Espagne dans l'Andalousie, sur la côte de l'Océan, à l'embouchure du Guadalquivir, sur le penchant d'une colline.
Les anciens ont nommé cette ville Lux dubia, phosphorus sacer, ou Luciferi fanum. Son port est également bon & important, parce qu'il est la clé de Seville, qui en est à 14 lieues ; & celui qui se rendroit maître de San Lucar pourroit arrêter tous les navires & les empêcher de monter. Il y a d'ailleurs une rade capable de contenir une nombreuse flotte. Long. 11. 30. lat. 36. 50.
LUCAR de GUADIANA, San, (Géog.) ville forte d'Espagne dans l'Andalousie, aux confins de l'Algarve & du Portugal, & sur la rive orientale de la Guadiana. Long. 10. 36. lat. 37. 20.
LUCAR la MAYOR, San, (Géogr.) petite ville d'Espagne dans l'Andalousie, avec titre de duché & de cité depuis 1636. Elle est sur la Guadiamar, à 3 lieues N. O. de Seville. Long. 12. 12. lat. 37. 25. (D.J.)
|
| LUCARIES | Lucaria, s. f. pl. (Littérat.) fêtes romaines qui tomboient au 18 Juillet, & qui prenoient leur nom d'un bois sacré, Lucus, situé entre le Tibre & le chemin appellé via salaria. Les Romains célébroient les lucaries dans ce lieu-là, en mémoire de ce qu'ayant été battus par les Gaulois, ils s'étoient sauvés dans ce bois & y avoient trouvé un heureux asyle. D'autres tirent l'origine de cette fête des offrandes en argent qu'on faisoit aux bois sacrés, & qu'on appelloit luci. Plutarque observe que le jour de la célébration des lucaries on payoit les comédiens des deniers qui provenoient des coupes réglées qu'on faisoit dans le bois sacré dont nous parlons. (D.J.)
|
| LUCARNE | S. f. (Architect.) espece de fenêtre sur une corniche dans le toît d'un bâtiment, qui est placée à plomb, & qui sert à donner du jour au dernier étage. Voyez FENETRE & nos Pl. de Charp.
Ce mot vient du latin lucerna, qui signifie lumiere ou lanterne.
Nos architectes en distinguent de différens genres, suivant les différentes formes qu'elles peuvent avoir.
Lucarne quarrée, celle qui est fermée quarrément en plate bande, ou celle dont la largeur est égale à la hauteur.
Lucarne ronde, celle qui est cintrée par sa fermeture, ou celle dont la base est ronde.
Lucarne bombée, celle qui est fermée en portion de cercle par le haut.
Lucarne flamande, celle qui, construite de maçonnerie, est couronnée d'un fronton & porte sur l'entablement.
Lucarne damoiselle, petite lucarne de charpente qui porte sur les chevrons & est couverte en contre-auvent ou triangle.
Lucarne à la capucine, celle qui est couverte en croupe de comble.
Lucarne faîtiere, celle qui est prise dans le haut d'un comble, & qui est couverte en maniere de petit pignon fait de deux noulets.
|
| LUCAYES | LES, (Géogr.) îles de l'Amérique septentrionale dans la mer du Nord, aux environs du tropique du cancer, à l'orient de la presqu'île de la Floride, au nord des îles de Cuba & de Saint-Domingue.
Ces îles, qu'on met au nombre des Antilles, & dont Bahama est la plus considérable, sont presque toutes desertes, grandes & petites. C'est cependant par elles que Christophe Colomb découvrit le nouveau monde ; il les appella Lucayes, parce qu'il apprit que leurs habitans se nommoient ainsi. Les Espagnols les ont dépeuplées par la rage funeste de s'enrichir, employant ces malheureux insulaires à l'exploitation des mines de Saint-Domingue.
|
| LUCAYONEQUE | (Géog.) l'une des grandes îles Lucayes dans l'Amérique septentrionale. Elle est deserte, toute entourée d'écueils au nord, à l'orient & au couchant. Long. 300. lat. 26. 27. (D.J.)
|
| LUCCIOLE | S. f. (Hist. nat. Insectolog.) mouche luisante ; il y en a une prodigieuse quantité près de Samagia, les haies en sont couvertes ; elles en font comme des buissons ardens. Elles sont à-peu-près de la forme des hannetons, mais plus petites : l'endroit brillant est sous le ventre ; c'est un petit poil velouté de couleur citron, qui s'épanouit à chaque coup d'aîle, & qui jette en même tems un trait de lumiere.
|
| LUCE | EAU DE, (Chimie & Mat. med.) l'eau de luce est une liqueur laiteuse, volatile, très-pénétrante, formée par la combinaison de l'esprit volatil de sel ammoniac, avec une petite portion d'huile de karabé.
Cette eau, dont feu M. du Balen, apoticaire de Paris, a eu seul le secret pendant long-tems, a excité la curiosité des Chimistes. Quelques-uns ne connoissant cette nouvelle liqueur que par réputation, l'ont confondue avec une autre eau volatile de couleur bleue qui a fait du bruit à Paris, sous le nom du sieur Luce, apoticaire de Lille en Flandre ; les autres, plus à portée d'analyser l'eau de luce du sieur du Balen, en ont d'abord reconnu les principes constitutifs.
Il seroit trop long de faire ici l'énumération de tous les procédés que l'envie de découvrir le mystere de cette préparation a fait imaginer ; il suffit de rappeller que tous ces procédés se réduisent à trouver un intermede qui rende miscible l'esprit de sel ammoniac à l'huile de karabé. Celui que M. de Machi vient de rendre public, est un des plus raisonnables & des plus ingénieux : l'eau de luce qui en résulte est blanche, pénétrante, & paroît avoir toutes les qualités de l'eau de luce du sieur du Balen. Malgré ces avantages, nous sommes fondés à avancer que le procédé de M. de Machi n'est pas le plus simple qu'il soit possible d'employer, puisqu'il se sert de l'intermede de l'esprit-de-vin pour combiner l'esprit volatil avec l'huile, & que tout intermede devient inutile pour cette combinaison, puisqu'elle peut s'exécuter par le seul rapport de ces deux principes : elle s'execute en effet par le procédé suivant.
Mettez dans un flacon de crystal quelques gouttes d'huile blanche de karabé rectifiée, versez dessus le double de bon esprit volatil de sel ammoniac ; bouchez le flacon avec son bouchon de crystal, & portez-le pendant quelques jours dans la poche de la culotte, la plus grande partie de l'huile se dissoudra. Ajoutez pour lors une pareille quantité du même esprit volatil ; & après avoir laissé le tout en digestion à la même chaleur pendant quelques jours encore, vous trouverez l'huile entierement combinée avec l'alkali volatil, sous la forme & la consistance d'un lait clair de couleur jaunâtre. Ce produit n'est proprement qu'une espece de savon resout. Conservez-le dans le même flacon exactement fermé.
Il est essentiel, pour le succès de ce procédé, de n'exposer à l'action de l'alkali volatil que trois ou quatre gouttes d'huile de karabé ; si on emploie cette derniere matiere jusqu'à la quantité d'un gros, le procédé ne réussit point.
Pour faire l'eau de luce, il suffit de verser quelques gouttes du savon que nous venons de décrire sur de l'esprit volatil de sel ammoniac bien vigoureux : on en ajoute plus ou moins à une quantité donnée d'esprit volatil, suivant le degré de blancheur & d'odeur de karabé qu'on veut donner à son eau de luce. Extrait de deux écrits de M. Betbeder, medecin de Bordeaux, insérés dans le recueil périodique d'observations de Medecine, &c. l'un au mois d'Octobre 1756, & l'autre au mois de Mai 1757.
Le procédé de M. de Machi dont il a été fait mention au commencement de cet article, est rapporté dans le même ouvrage périodique au mois de Juin 1756 : voici ce procédé.
Prenez un gros d'huile de succin extrêmement blanche, faites-la dissoudre dans suffisante quantité d'esprit-de-vin : il en faudra bien près de deux onces. Ajoutez y deux autres onces d'esprit-de-vin, & servez-vous de cette dissolution pour préparer le sel volatil ammoniac suivant la méthode ordinaire ou celle qu'on emploie pour les esprits ou les sels volatils aromatiques huileux. Cette liqueur vous servira à blanchir de bon esprit volatil préparé avec la chaux vive, & la liqueur blanche ne sera sujette à aucun changement ; elle sera toujours laiteuse, ne fera jamais de dépôt, & remplira par conséquent toutes les conditions desirées pour faire une bonne eau de luce. Quelques gouttes de la premiere liqueur suffisent, mais on ne craint rien de la surabondance : l'auteur en a mêlangé presque à partie égale d'esprit volatil, & la liqueur étoit seulement plus épaisse & plus blanche, à-peu-près comme est du bon lait de vache, & sans qu'il ait paru le plus leger sédiment.
L'eau de luce n'a de vertus réelles que celles de l'esprit volatil de sel ammoniac, tant dans l'usage intérieur que dans l'usage extérieur. La très-petite portion d'huile de succin qu'elle contient, ne peut être comptée pour rien dans l'action d'un remede aussi efficace. Voyez SEL AMMONIAC & SEL VOLATIL. (b)
|
| LUCENSES | (Géog. anc.) peuple ancien d'Italie au pays des Marses, selon Pline, liv. III. ch. xij. édition du P. Hardouin. Ce peuple tiroit son nom du bourg Lucus, & ce bourg tiroit le sien d'un bois, le même que Virgile nomme Angitiae nemus.
|
| LUCERA | (Géog.) c'est la Lucéria des Romains, ancienne ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Capitanate, avec un évêché suffragant de Bénevent. Les Italiens la nomment Lucera delli pagani ; ce surnom lui vient de ce que l'empereur Constance l'ayant ruinée, Frédéric II. en fit présent aux Sarrazins pour demeure, à condition de la réparer ; mais ensuite Charles II. roi de Naples les en chassa. Elle est à 8 lieues S. O. de Manfrédonia. Long. 32. 59. lat. 41. 28. (D.J.)
|
| LUCERES | S. m. pl. (Littér.) nom de la troisieme tribu du peuple romain, au commencement de la fondation. Romulus, dit Varron de ling. lat. lib. IV. divisa les habitans de la nouvelle ville en trois tribus ; la premiere fut appellée les Tatiens, qui prirent ce nom de Tatius ; la seconde les Rhamnes, ainsi nommés de Romulus ; & la troisieme les Luceres, qui tiroient leur nom de Lucumon. (D.J.)
|
| LUCÉRIE | Luceria, (Géog. anc.) aujourd'hui Lucera, étoit une ville considerable d'Italie dans la Pouille daunienne aux confins des Hirpins, avec le titre de colonie romaine. C'est la Nuceria Apulorum de Ptolémée, liv. III. ch. j. Ses peuples sont nommés Lucerini dans Tite-Live. Ses paturages passoient pour excellens : les laines de ses troupeaux, au rapport de Strabon, quoiqu'un peu moins blanches que celles de Tarente, étoient plus fines, plus douces & plus estimées. Horace, ode 15. liv. III. assure Chloris qu'elle n'a point de graces à jouer du luth & à se couronner de roses, & qu'elle n'est propre qu'à filer des laines de Lucerie.
Te lanae prope nobilem
Tonsae Luceriam, non citharae decent,
Nec flos purpureus rosae. (D.J.)
|
| LUCERIUS | (Littérat.) Lucerius & Luceria sont des surnoms dont l'antiquité payenne honoroit Jupiter & Junon, comme les divinités qui donnoient la lumiere au monde. Dans la langue osque Jupiter portoit aussi le nom de Lucerius, par la même raison. (D.J.)
|
| LUCERNE | LE CANTON DE, (Géog.) Ce canton tient le troisieme rang entre les treize du corps helvétique, & le premier rang des cantons catholiques. Il a les Alpes au midi, & au nord un pays de bois, de prés ou de champs assez fertiles en blé. On retire beaucoup de poisson du lac qui porte le nom de Lucerne, ainsi que celui des quatre cantons, en allemand vier waldstetten-sée, parce que ceux d'Uri, de Schwitz & d'Undervald sont situés sur ses bords. Ce lac a 8 lieues de longueur & deux de largeur : en plusieurs endroits il est entouré de rochers escarpés, qui sont le repaire des chamois, des chevreuils & autres bêtes fauves de cette nature. Le canton de Lucerne a encore en particulier deux ou trois petits lacs fertiles en écrevisses assez grosses, qui ne deviennent point rouges à la cuisson, mais prennent une couleur livide. On trouve ailleurs des écrevisses qui restent noires quand on les fait cuire.
LUCERNE, Lucerna, (Géog.) ville de Suisse, autrefois impériale, capitale du canton de même nom. Elle a peut-être tiré le sien d'une vieille tour qui borde un de ses ponts, au haut de laquelle on allumoit un fanal pour éclairer les bateaux qui sortoient ou entroient dans la ville.
Son gouvernement civil est aristocratique, & fort approchant de celui de Berne ; mais quant au gouvernement ecclésiastique, les Lucernois bons catholiques dépendent de l'évêque de Constance, & les nonces du pape y exercent aussi leur autorité. Ils secouerent en 1333 le joug de la maison d'Autriche, & entrerent dans la ligue des cantons de Schwitz, Uri & Underwald.
Lucerne est située sur le lac qui porte son nom, dans l'endroit où la Russ sort de ce lac, à 12 lieues S. O. de Zurich, 14 N. E. de Berne, 19 S. E. de Bâle. Long. 26. 1. lat. 47. 5. (D.J.)
|
| LUCETTE | S. f. terme à l'usage de ceux qui travaillent l'ardoise. Voyez l'article ARDOISE.
|
| LUCIANISTES | S. m. pl. (Théol.) nom de secte, qui prit son nom de Lucianus ou Lucanus, hérétique du second siécle. Cet hérétique fut disciple de Marcion, dont il suivit toutes les erreurs, auxquelles il en ajouta même de nouvelles.
S. Epiphane dit qu'il abandonna Marcion, en enseignant de ne point se marier, de crainte d'enrichir le Créateur. Cependant, comme a remarqué le P. le Quien, c'étoit-là une erreur de Marcion, & des autres Gnostiques. Il nioit l'immortalité de l'ame, qu'il croyoit matérielle. Voyez MARCIONITES.
Il y a eu d'autres Lucianistes qui ont paru quelque tems après les Ariens ; ils disoient que le pere avoit toujours été pere, & qu'il en avoit pû avoir le nom avant que d'avoir produit son fils, parce qu'il avoit la vertu de le produire, ce qui suppose l'erreur des Ariens au sujet de l'éternité du verbe. Dictionn. de Trévoux.
|
| LUCIE | sainte ou sainte ALOUZIE, s. f. (Géog.) c'est une des îles Antilles, située dans l'océan, à 7 lieues de distance de la pointe méridionale de la Martinique, & à 10 de la partie du nord de l'île de saint Vincent.
Sainte-Lucie, peut avoir environ 25 lieues de tour, la nature y a formé un excellent port dans lequel les vaisseaux de toutes grandeurs peuvent se mettre à l'abri des ouragans & de la grosse mer ; cette île est fort montagneuse, très-brisée & arrosée de plusieurs rivieres ; la terre y produit un grand nombre de fruits & de plantes, dont on pourroit faire un objet de commerce ; les bestiaux y multiplient beaucoup, & la chasse ainsi que la pêche y sont très-abondantes ; ces avantages sont un peu balancés par les maladies qu'occasionne le climat, & par la prodigieuse quantité d'insectes venimeux & de serpens dont le pays est rempli. En 1640 l'île de sainte Lucie n'étant occupée par aucune nation, M. Duparquet, gouverneur général des îles, en prit possession au nom du roi, sans nulle opposition de la part des Anglois de la Barbade ; il y fit passer une colonie qui depuis ce tems ne s'est pas fort étendue.
|
| LUCIFER | S. m. (Astron.) est le nom que l'on donne à la planete de Venus, lorsqu'elle paroît le matin avant le lever du soleil. Comme cette planete ne s'éloigne jamais du soleil de plus de 48°, elle doit paroître sur l'horison quelque-tems avant le lever du soleil, lorsqu'elle est plus occidentale que le soleil. Elle annonce alors pour ainsi dire, le lever de cet astre, & c'est pour cette raison que les Astronomes & les Poëtes l'ont nommée lucifer, c'est-à-dire, qui apporte la lumiere. Quand elle paroît le soir après le soleil, on la nomme hesperus ; ce mot lucifer pour désigner Venus, ne se trouve plus que dans quelques Astronomes qui ont écrit en latin. Voyez PHOSPHORUS & HESPERUS. (O)
LUCIFER LAPIS, (Hist. nat.) nom donné par quelques Naturalistes à la pierre qui a la propriété de luire dans l'obscurité, telle que celle de Bologne, &c. Voyez PHOSPHORE.
LUCIFER, s. m. (Mythol.) nom que la poésie donne à l'étoile de Venus, lorsqu'elle paroît le matin, quand elle est orientale au soleil. Les Poëtes l'ont divinisée ; c'est le fils de la belle aurore aux doigts de rose, le chef & le conducteur des astres ; il prend soin des coursiers & du char du soleil, qu'il attelle & dételle avec les heures : on le reconnoît à ses chevaux blancs dans la voûte azurée, albo clarus equo ; & c'est pour lors qu'il annonce aux mortels, l'agréable nouvelle de l'arrivée de sa mere. Les chevaux de main, desultorii, n'étoient consacrés qu'à ce dieu ; Milton n'a pas oublié de le saluer sur son passage.
Wellcome Guide of the starry flock,
Fairest of stars, last of the train of night,
If better thou belong not to the down,
Sure pledge of the day ! Thou, crown'st the smiling morn
With thy bright circlet ! (D.J.)
|
| LUCIFERE | (Littér.) Lucifera, surnom de Proserpine, de Diane-lune, en un mot de la triple Hécate. Les Grecs invoquent Diane Lucifere pour l'accouchement, dit Ciceron, de même que nous invoquons Junon-lucine. Diane Lucifere est représentée, couverte d'un grand voile, parsemé d'étoiles, portant un croissant sur sa tête, & tenant à la main un flambeau élevé.
Pindare nous la décrit dans sa sixieme olympionique, où il lui donne l'épithete de , à cause des chevaux blancs qu'elle attelloit toujours à son char, qui est celui que les Poëtes ont feint que Jupiter lui envoya dans le sombre royaume de Pluton, pour la ramener pendant quelque tems sur l'olympe ; la plûpart de nos médailles portent le nom de Diana Lucifera. (D.J.)
|
| LUCIFERIEN | S. m. (Théolog.) nom de secte. On appelle Luciferiens, ceux qui adhererent au schisme de Lucifer de Cagliari au quatrieme siecle.
S. Augustin semble indiquer, qu'ils croyoient que l'ame étoit transmise aux enfans par leurs peres. Théodoret dit, que Lucifer fut auteur d'une nouvelle erreur. Les Luciferiens se multiplierent beaucoup dans les Gaules, sur-tout à Trèves, à Rome, en Espagne, en Egypte & en Afrique.
L'occasion de ce schisme fut, que Lucifer ne put souffrir qu'on eût rétabli les évêques tombés dans l'hérésie, qu'il se sépara de leur communion & persista dans ce schisme jusqu'à la mort. Il y eut peu d'évêques Luciferiens, mais beaucoup de prêtres & de diacres. Ceux de cette secte avoient une aversion extrême pour les Ariens. Dict. de Trév. (D.J.)
|
| LUCINE | S. f. (Mythol.) déesse qui présidoit aux accouchemens des femmes & à la naissance des enfans. Souvent c'est Diane, comme dans une inscription antique recueillie par Gruter, qui porte Diana Lucina invicta ; mais plus communément, c'est Junon ; Térence ne dit que Junon Lucina. Olen de Lycie, un des plus anciens poëtes de la Grece, donne cette déesse pour mere de Cupidon, dans un hymne qu'il avoit fait en son honneur, & dont parle Pausanias, mais Olen est le seul qui ait imaginé cette fiction.
Dès que les femmes en travail invoquoient Lucine, elle venoit pour les assister, & leur procurer une heureuse délivrance. Les Parques accouroient aussi de leur côté, mais c'étoit pour se rendre maîtresses de la destinée de l'enfant, au moment de sa naissance.
On connoît les formules de prieres des femmes en couche, lorsqu'elles appelloient Lucine à leur secours : elles s'écrioient, casta fave Lucina ! Juno Lucina fer opem ; serva me, obsecro ! Mais Ovide qu'on peut regarder comme un grand prêtre, initié dans les mysteres les plus secrets de Lucine, ou plutôt instruit par elle-même, apprit aux femmes en travail la conduite importante qu'elles doivent tenir dans ces momens, lorsqu'il leur dit :
Ferte Deae flores, gaudet florentibus herbis
Haec Dea ; de tenero cingite flore caput ;
Dicite : Tu lumen nobis Lucina dedisti,
Dicite : Tu voto parturientis ades.
Le même Ovide nous décrit toutes les fonctions de Lucine ; mais c'est assez pour nous de voir, que les couronnes & les guirlandes entroient dans les cérémonies de son culte. Tantôt on représentoit cette déesse comme une matrone, qui tenoit une coupe de la main droite, & une lance de la gauche ; tantôt elle est figurée assise sur une chaise, tenant de la main gauche un enfant emmailloté, & de la droite une fleur faite en lys. Quelquefois on lui donnoit une couronne de dictamne, parce qu'on croyoit que cette plante produisoit une promte & heureuse délivrance.
On appelloit cette déesse Ilithie, Zygie, Natalis, Opigene, Olympique ; & sous ce dernier nom, elle avoit un temple en Elide, dont la prêtresse étoit annuelle.
Le nom de Lucine vient, dit Ovide, de lux, lumiere, parce que c'est cette divinité qui donne par sa puissance, le jour, la lumiere aux enfans. (D.J.)
|
| LUCINIENNE | (Littér.) surnom de Junon-Lucine chez les Romains ; c'est aussi sous ce surnom de Lucinienne qu'elle avoit un autel à Rome, où l'on sacrifioit en son honneur, & où les femmes grosses portoient leur encensement. (D.J.)
|
| LUCKO | (Géog.) en latin Luccovia, en allemand Lusnc ; ville de Pologne dans la Volhinie, avec un évêché suffragant de Gnesne. Bodeslas, roi de Pologne, s'en rendit maître en 1074, après un siege de plusieurs mois. Elle est située sur la Stur, à 25 lieues N. E. de Lembourg, 67 S. E. de Varsovie, 78 N. E. de Cracovie, long. 43. 48. lat. 50. 52. (D.J.)
|
| LUCON | (Géog.) île considérable d'Asie dans l'Océan oriental, la plus grande & la plus septentrionale des îles Philippines, situées à la latitude d'environ 15 degrés. Elle est cependant saine, & a les eaux les meilleures du monde ; elle produit tous les fruits qui croissent dans les climats chauds, & est admirablement placée pour le commerce de la Chine & des Indes.
On la nomme aussi Manille, du nom de sa capitale, elle a environ 160 lieues de long, 30 à 40 de large, & 360 de circuit : On y trouve de la cire, du coton, de la canelle sauvage, du souffre, du cacao, du ris, de l'or, des chevaux sauvages, des sangliers & des bufles. Elle fut conquise en 1571 par Michel Lopez espagnol, qui y fonda la ville de Manille ; les habitans sont Espagnols & Indiens, tributaires de l'Espagne.
La baye & le port de Manille qui sont à sa côte occidentale, n'ont peut-être rien de pareil. La baye est un bassin circulaire de près de 10 lieues de diametre, renfermé presque tout par les terres ; voyez les Voyages du Lord Anson, & la belle carte qu'il a donnée de cette île.
Sa situation, selon les cartes de Tornton, est à 116. 30. à l'orient du méridien de Londres, & 114. 5. du méridien de Paris, lat. 14. à 15. (D.J.)
LUÇON, (Géog.) petite ville de France en Poitou, avec un évêché suffragant de Bordeaux, érigé en 1317 par Jean XXII : long. 16. 29. 26. lat. 46. 27. 14.
|
| LUCOPIDIA | (Geog. anc.) ancienne ville de l'île d'Albion, c'est-à-dire, de la grande Bretagne, selon Ptolémée, liv. II. ch. iij. Neubridge, Talbot & Humfret, croyent que c'est présentement Carlisle. (D.J.)
|
| LUCQUES | (Géog.) en latin Luca & Lucca, ancienne ville d'Italie, capitale de la république de Lucques, avec un archevêché.
Cette ville est fort ancienne ; elle fut déclarée colonie, lorsque Rome l'an 576 de sa fondation, y envoya deux mille citoyens. Les Triumvirs qui la formerent, furent P. Elius, L. Egilius, & Cn. Sicinius ; lors de la décadence de l'empire romain, elle tomba sous le pouvoir des Goths, puis des Lombards qui la garderent jusqu'au regne de Charlemagne ; ensuite, elle a passé sous différentes dominations d'états & de particuliers, jusqu'à l'année 1450 qu'elle recouvra sa liberté, & elle a eu le bonheur de la conserver jusqu'à ce jour.
Lucques est située sur le Serchio, au milieu d'une plaine environnée de côteaux agréables, à 4 lieues N. E. de Pise, 15 N. O. de Florence, 8 N. E. de Livourne, 62 N. O. de Rome ; long. selon Cassini, 31. 4. lat. 43. 50.
Cette petite ville est la patrie, 1°. d'André Ammonius, poëte latin, qui devint secrétaire d'Henri VIII. & qui mourut de la suette en Angleterre, en 1517 : 2°. de Jean Guidiccioni, qui fleurissoit aussi dans le seizieme siecle, & qui fut élevé aux premieres dignités de la cour de Rome ; ses oeuvres ont vû le jour à Naples en 1718 : 3°. de Martino Poli, chimiste associé de l'ac. des Sciences de Paris, mort en 1714 ; il combattit dans son Traité intitulé, il triompho degli acidi, un violent préjugé de médecine qui régnoit alors, & qui subsistoit encore un peu dans ce pays : 4°. de Sanctes Pagninus, religieux dominicain, très-versé dans la langue hébraïque & chaldaïque ; il est connu de ce côté-là, par son Thesaurus linguae sanctae, qu'on a réimprimé plusieurs fois ; il mourut à Lyon en 1536.
Les Lexicographes vous indiqueront quelques autres gens de lettres, dont Lucques est la patrie. (D.J.)
|
| LUCQUOIS | LE, (Géog.) ou l'état de la république de Lucques, en italien il Luchese, pays d'Italie, sur la mer de Toscane, d'environ 31 milles de long sur 25 au moins de large. C'est un petit état souverain, dont le gouvernement aristocratique, sous la protection de l'empereur, paroît très-sage & très-bien entendu.
Le chef est nommé gonfalonier ; il porte un bonnet ducal, de couleur cramoisi, bordé d'une frange d'or ; le terroir que possede la république a du vin, mais il abonde principalement en olives, lupins, phaseoles, chataignes, millet, lin & soie. Les Lucquois vendent de ce dernier article, tous les ans, pour trois à quatre cent mille écus.
Leur mont de Piété, ou leur office d'abondance, comme ils l'appellent (établissement admirable dans tout pays de commerce), prend de l'argent à cinq pour cent des particuliers, & le négocie en toutes sortes de marchandises avec les pays étrangers, en Flandres, Hollande, Angleterre, ce qui rapporte un grand profit à l'état. Il prête aussi du blé aux habitans qui en ont besoin, & s'en indemnise peu-à-peu. Tous les fours sont à la république, qui oblige d'y cuire tout le pain qui se mange, & c'est une idée fort censée : la ville de Lucques est la capitale de cet état, également économe & industrieux. (D.J.)
|
| LUCRATIF | adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui emporte le gain de quelque chose comme un titre lucratif, ou une cause lucrative : les donations, les legs sont des titres lucratifs : deux causes lucratives ne peuvent pas concourir pour la même personne sur un même objet, c'est-à-dire, qu'elle ne peut pas avoir deux fois la même chose. Voyez TITRE LUCRATIF & TITRE ONEREUX. (A)
|
| LUCRE | S. m. (Gram.) c'est le gain, le profit, le produit des actions, des professions qui ont pour objet l'intérêt & non l'honneur ; dans les professions les plus honorées, si le profit devient considérable, il dégénere en lucre, & la profession s'avilit.
|
| LUCRETILE | (Géog. anc.) Lucretilis, montagne de la Sabine, en Italie, dans le canton de Bandusie, peu loin de la rive droite de la Currèze. Horace avoit sa maison de campagne sur un côteau de ce mont, & je trouve qu'elle étoit mal placée pour un poëte qui ne haïssoit pas le bon vin ; car les vignobles de tout le pays, & particulierement du mont Lucretile, étoient fort décriés ; mais il avoit tant d'autres agrémens, qu'Horace n'a pu s'empêcher de le célébrer & d'y inviter Tyndaride : " Faune, lui dit-il, ne fait pas toûjours sa démeure sur le Lycée ; souvent il lui préfere les délices de Lucretile ; c'est-là qu'il garantit mes troupeaux contre les vents pluvieux, & contre les chaleurs brûlantes de l'été. Il ne tiendra qu'à vous de venir dans ce riant séjour ".
Velox amoenum saepè Lucretilem
Mutat Lycaeo Faunus, & igneam
Defendit aestatem capellis
Usque meis, pluviosque ventos, &c.
Ode xvij. liv. I.
(D.J.)
|
| LUCRIN LE | (Géog. anc.) Lucrinus lacus, lac d'Italie, qui étoit sur les côtes de la Campanie, entre le promontoire de Misène & les villes de Bayes & de Pouzzoles, au fond du golphe Tyrrhénien.
Il communiquoit avec le lac Averne, par le moyen d'un canal qu'Agrippa fit ouvrir l'an 717 de Rome. Il construisit dans cet endroit un magnifique port, le port de Jules, portus Julius, en l'honneur d'Auguste, qui s'appelloit alors seulement Julius Octavianus ; la flatterie ne lui avoit pas encore décerné d'autre titre.
Outre Pline & Pomponius Méla, nous avons Horace, qui parle plus d'une fois du lac Lucrin ; tantôt ce sont les huitres de ce lac qu'il vante, à l'imitation de ses compatriotes : non me Lucrina juverint conchilia, Ode xj. liv. V. " Non, les huitres du lac Lucrin ne me feroient pas faire une meilleure chere ". En effet, les Romains donnerent long-tems la préférence aux huitres de ce lac ; ils s'en régaloient dans les festins de nôces, nuptiae videbant ostreas lucrinas, dit Varron ; ils les regardoient comme les plus délicates, concha Lucrini delicatior stagni, disoit Martial de son tems : ensuite ils aimerent mieux celles de Brindes & de Tarente ; enfin ils ne purent plus souffrir que celles de l'Océan atlantique.
Horace portant ses réflexions sur les progrès du luxe dit, qu'il avoit formé de grands viviers & de vastes étangs dans les maisons de plaisance, des étangs même d'une plus grande étendue que le lac Lucrin.
.... Undique latius
Extincta visentur Lucrino
Stagna lacu.
Ode xv. liv. II.
Mais nous ne pouvons plus juger de la grandeur de ce lac, ni du mérite de ses coquillages. En 1538, le 29 Septembre, le lac Lucrin fut presque entierement comblé ; la terre, après plusieurs secousses, s'ouvrit, jetta des flammes & des pierres brûlées en si grande quantité, qu'en vingt-quatre heures de tems il s'éleva du fond une nouvelle montagne qu'on nomma Monte nuovo di Cinere, & que Jules-César Capaccio a décrite dans ses antiquités de Pouzzoles, historia Puteolana, cap. xx. Ce qui reste de l'ancien lac, autour de cette montagne, sur laquelle il ne croît point d'herbes, n'est plus qu'un marais qu'on appelle lago di Licola. Voyez LICOLA, (Géog.) (D.J.)
|
| LUCULLEUM | LUCULLEUM
|
| LUCULLIENS, JEUX | (Littér.) ludi luculliani, jeux publics, que la province d'Asie décerna à Lucullus, en mémoire de ses bienfaits.
Ce général romain célebre par son éloquence, par ses victoires, & par ses richesses, après avoir chassé Mithridate du Pont, & soumis presque tout le reste de ce royaume, employa près d'un an à réformer les abus que les exactions des traitans y avoient introduits. Il remédia à tous les desordres, & gagna si fort l'estime & le coeur de toute la province, qu'elle institua, l'an 70 avant Jesus-Christ, des jeux publics en son honneur, qui furent nommés luculliens, & qui durerent assez long-tems ; on les célébroit tous les ans avec un nouveau plaisir ; mais les partisans voyant leurs grosses fortunes détruites par les reglemens de Lucullus, vinrent cabaler fortement à Rome contre lui, & firent si bien par leur argent & leurs intrigues, qu'on le rappella & qu'on lui donna un successeur qui recueillit les lauriers dûs à ses victoires. (D.J.)
|
| LUCUMA | S. m. (Botan. exot.) arbre qui vient en plein vent dans le Pérou : il a de grandes racines ; son tronc est de la grosseur d'un homme ; l'écorce qui le couvre est gercée, d'un verd grisâtre jusqu'où se fait la subdivision des branches, qui forment une belle tête ; ses feuilles sont alternes, d'un verd foncé, différentes dans leur longueur & dans leur largeur. Les moyennes ont à peu près cinq pouces de long & deux pouces de large : la côte qui les traverse d'un bout à l'autre répand des nervures en tout sens. Les queues des feuilles ont environ huit lignes de long sur deux d'épaisseur : sa fleur n'est point décrite par le pere Feuillée, & je n'y saurois suppléer : son fruit a la figure d'un coeur applati par les deux bouts ; il est rond, large de trois pouces, long d'un peu plus de deux, & couvert d'une peau fort mince ; sa chair est mollasse, fade, douçâtre, & d'un blanc sale ; elle renferme au centre deux ou trois noyaux, qui dans leur maturité, ont la figure & la couleur de nos châtaignes. Frézier nomme cet arbre lucumo, & a commis plusieurs erreurs dans la description qu'il en a faite. (D.J.)
|
| LUCUMON | S. m. (Littérat.) prince ou chef particulier de chaque peuple des anciens Etrusques. Comme l'Etrurie se partageoit en douze peuples, chacun avoit son lucumon, mais un d'eux jouissoit d'une autorité plus grande que les autres. Les privileges distinctifs des lucumons, étoient de s'asseoir en public dans une chaire d'ivoire, d'être précedés par douze licteurs, de porter une tunique de pourpre enrichie d'or, & sur la tête une couronne d'or, avec un sceptre au bout duquel pendoit une aigle. (D.J.)
|
| LUCUS | (Géog.) ce mot latin veut dire un bois saint ; & comme l'antiquité avoit l'usage de consacrer les bois à des dieux ou à des déesses, il est arrivé en géographie, qu'il y a des noms de divinités, même des noms d'empereurs, joints à lucus, qui désignent des villes ou lieux autrefois célebres, comme Lucus Augusti, ville de la Gaule narbonnoise, dont nous dirons un mot ; Lucus Asturum, qui est Oviedo, ville d'Espagne en Asturie, & autres semblables.
L'étymologie du mot lucus, bois consacré aux dieux, vient de ce qu'on éclairoit ces sortes de bois aux jours de fêtes, quod in illis maximè lucebat ; dumoins cette étymologie me semble préférable à celle de Quintilien & de Servius, qui ont recours à l'antiphrase, figure de l'invention des Grammairiens, que les habiles critiques ne goûtent gueres, & dont ils ont fort sujet de se moquer. (D.J.)
LUCUS AUGUSTI, (Géogr. anc.) ville de la Gaule narbonnoise, alliée des Romains, selon Pline, liv. III. chap. iv. Tacite, Hist. liv. I. la nomme Lucus vocontiensis, & n'en fait qu'un municipe ; c'étoit la ville de Luc en Dauphiné dans le Diois, grande route des Alpes, sur la Drome. Il y a seulement quelques siecles, qu'une roche étant tombée dans cette riviere, en boucha le lit, & causa une inondation, dont l'ancien Luc fut submergé & détruit. Le nouveau Luc qu'on rebâtit au-dessus de Die, n'est resté qu'un simple village.
Les anciens ont encore donné le nom de Lucus Augusti à la ville de Lugo en Espagne, &c. le mot lucus signifie un bois, & l'on sait que la religion payenne ayant consacré les bois aux divinités, la flatterie ne tarda pas d'y joindre des noms d'empereurs, elle commença par Auguste. (D.J.)
|
| LUDLOW | (Géog.) Ludlovia, petite ville à marché d'Angleterre, en Shropshire, aux frontieres du pays de Galles, avec un mauvais château pour sa défense. Elle envoye deux députés au parlement, & est à 106 milles N. O. de Londres. Long. 14. 59. lat. 52. 25. (D.J.)
|
| LUDUS HELMONTII | (Hist. nat.) pierre ou substance fossile, d'une figure indéterminée & irréguliere à l'extérieur, mais dont l'arrangement intérieur est très-régulier. Elle est d'une couleur terreuse, & divisée en masses distinctes & séparées les unes des autres par plusieurs veines de différentes couleurs & d'une matiere plus pure que le reste de la pierre ; ces petites masses sont souvent d'une figure assez réguliere, qui les fait ressembler à des dés à jouer ; mais le plus communément elles n'ont point de forme déterminée. Quelques-unes de ces masses sont composées de plusieurs croûtes ou enveloppes placées les unes sur les autres autour d'un noyau qui est au centre : dans celles-ci les veines ou cloisons qui les séparent sont très-minces, elles sont plus épaisses dans les autres. On ne fait usage que de ces veines ou cloisons dans la médecine ; on prétend que c'est un remede pour les maux de reins, Supplément de Chambers. Son nom lui vient du célebre Van-Helmont qui a célébré ses vertus réelles ou prétendues. On dit que cette pierre se trouve sur les bords de l'Escaut, près d'Anvers. Schroeder & Ettmuller disent qu'elle est calcaire. Paracelse l'a appellée fel terrae. Quelques auteurs ont cru que Van-Helmont vouloit désigner sous ce nom la pierre de la vessie.
|
| LUETS | S. m. pl. (Jurisprud.) devoir de luets, terme usité en Bretagne pour exprimer une redevance d'un boisseau de seigle dûe sur chacune terre & sur chacun ménager tenant feu & fumée & labourant terre en la paroisse : il en est fait mention dans le recueil des arrêts des chambres de Bretagne du 26 Octobre 1361, & du 20 Mai 1564. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere, au mot LUETS.
|
| LUETTE | uvula, s. f. (Anatomie) c'est un corps rond, mol & spongieux, semblable au bout du doigt d'un enfant, qui est suspendu à la portion la plus élevée de l'arcade formée par le bord libre & flottant de la valvule du palais, près des trous des narines, perpendiculairement sur la glotte. Voyez GLOTTE, LARYNX, VOIX, &c.
Son usage est de briser la force de l'air froid, & d'empêcher qu'il n'entre avec trop de précipitation dans le poumon. Voyez RESPIRATION, POUMON, &c.
Elle est formée d'une duplicature de la tunique du palais. Quelques auteurs la nomment columella, & d'autres gurgulio.
Elle est mue par deux paires de muscles, & suspendue par autant de ligamens. Les muscles sont l'externe, appellé sphénostaphylin, qui tire la luette en haut & en arriere, & empêche les alimens qui ont été mâchés, de passer dans les trous des narines pendant la déglutition. Voyez SPHENOSTAPHYLIN. L'interne, appellé ptérygostaphylin, qui tire la luette en haut & en-devant. Voyez PTERYGOSTAPHYLIN.
Ces deux muscles tirent la luette en-haut pour faciliter la déglutition, & servent à la relever lorsqu'elle est relâchée & tombée. Dans ce cas-là, on a coutume d'aider à la relever, en y appliquant un peu de poivre concassé que l'on met sur le bout d'une cuillere. Voyez DEGLUTITION.
Bartholin dit que ceux qui n'ont point de luette, sont sujets à la phthisie, & en meurent ordinairement ; parce que l'air froid entrant trop rapidement dans les poumons, les corrompt. Voyez PHTHISIE.
Chûte de la LUETTE, voyez CHUTE.
LUETTE, (maladies de la) cette partie est sujette à s'enflammer, & à devenir grosse & longue par un engorgement d'humeur pituiteuse. Dans le premier cas, les saignées, le régime humectant, & les gargarismes rafraîchissans peuvent calmer l'inflammation, & résoudre la tumeur. Si elle se terminoit par gangrène, comme on le voit quelquefois dans la maladie vénérienne, il faudroit en faire l'amputation.
La luette relâchée par des humeurs exige des gargarismes astringens & fortifians. On lui donne aussi du ressort en mettant dans une petite cuillere du poivre en poudre fine, que l'on porte sous la luette pour la saupoudrer. Mais si elle étoit devenue blanche, longue, sans irritabilité, & incapable d'être rétablie dans son état naturel, il faudroit en retrancher la partie excédente.
Celse a parlé de cette opération, en disant qu'il faut saisir la luette avec des pinces, & couper audessus ce qu'il est nécessaire d'emporter. Mais Fabrice d'Aquapendente ne trouve pas cette opération facile : comment, dit-il, saisir la luette avec des pincettes d'une main, & la couper de l'autre dans la partie la plus étroite, la plus profonde & la plus obscure de la bouche, principalement par la nécessité qu'il y a d'une main-tierce pour abaisser la langue ? C'est pourquoi, dit-il, je ne me sers point de pinces. J'abaisse la langue, & je coupe la luette avec des petits ciseaux. Il seroit à propos d'avoir pour cette opération des ciseaux, dont les lames échancrées en croissant embrasseroient la luette, & la couperoient nécessairement d'un seul coup. 2°. Les branches doivent être fort longues, & former une courbe de côté du plat des lames, afin d'avoir les anneaux fort bas, & que la main ne bouche pas le jour. Fabricius Hildanus avoit imaginé un anneau cannelé, portant un fil noué, propre à embrasser la luette, & à la lier. Scultet a corrigé cet instrument, & dit s'en être servi utilement à Ulm le 8 Juin 1637, sur un soldat de l'empereur, qui avoit la luette pourrie. Après que Fabrice d'Aquapendente avoit coupé la portion de luette relâchée, qu'il avoit jugé à propos de retrancher ; il portoit un instrument de fer, fait en forme de cuillere, bien chaud, non pour brûler & cautériser la luette, mais pour fortifier la chaleur naturelle presque éteinte de la partie, & rappeller sa vie languissante. Nous avons parlé au mot FEU, comment cet auteur s'étoit servi du feu d'une façon qu'il n'avoit pas une action immédiate, dans la même intention de fortifier & de resserrer le tissu d'une partie trop humide. (Y)
|
| LUEUR | S. m. (Gram.) lumiere foible & sombre. Il se dit au physique & au moral : je vois à la lueur du feu : cet homme n'a que des lueurs.
|
| LUFFA | S. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante dont les fleurs sont des bassins divisés en cinq parties jusque vers leur centre. Sur la même plante, on trouve quelques-unes de ces fleurs qui sont nouées, & quelques autres qui ne le sont pas : celles qui sont nouées tiennent à un embryon, qui devient un fruit semblable à un concombre ; mais ce fruit n'est pas charnu ; on ne voit sous sa peau qu'un tissu de fibres qui forment un admirable raiseau, & qui laissent trois loges dans la longueur du fruit, lesquelles renferment des grains presque ovales. Tournefort, Mém. de l'Acad. roy. des scien. année 1706. Voyez PLANTE.
|
| LUGANO | Lucanum, (Géogr.) ville de Suisse dans les bailliages d'Italie, capitale d'un bailliage de même nom, qui est considérable ; car il contient une soixantaine de bourgs ou paroisses, & une centaine de villages. Il a été conquis par les Suisses sur les ducs de Milan. Lugano, sa capitale, est située sur le lac de Lugano, à 6 lieues N. O. de Come, 10 S. O. de Chiavenne. Long. 26. 28. latit. 45. 58.
|
| LUGDUNUM | (Géog. anc.) ce nom a été écrit si différemment, Lugdunum, Lugdunus, Lugodinum, Lugudunum, Lugodunum, Lucdunum, Lygdunum, & a été donné à tant de villes, que ne pouvant point entrer dans ce détail, nous renvoyons le lecteur aux remarques de Mrs de Valois, de Méziriac, & autres qui ont tâché de l'éclaircir. Nous remarquerons seulement que tous ces noms ont été donnés spécialement par les anciens à la ville de Lyon, capitale du Lyonnois ; Lugdunum signifie-t-il en vieux gaulois, la montagne du corbeau, ou la montagne de Lucius, parce que Lucius Munatius Plancus y conduisit une colonie ? C'est ce que nous ignorons. Nous ne savons pas mieux l'origine du nom de plusieurs autres villes qui ont la même épithete, comme Lugdunum Batavorum, Leyden ; Lugdunum Clavatum, Laon ; Lugdunum Convenarum, Comminges, &c. Elles n'ont pas toutes certainement été appellées de la sorte du nom de Lucius Plancus, ni des corbeaux qui y étoient quand on en a jetté les fondemens. Peut-être pourroit-on dire que ce nom leur a été donné, à cause de leur situation près des bois, ou sur des montagnes, des collines & des côteaux. Cette derniere idée paroît la plus vraisemblable.
|
| LUGO | (Géog.) les anciens l'ont connue sous le nom de Lucus-Augustus ; c'est de nos jours une petite ville d'Espagne en Galice, avec un évêché suffragant de Compostelle. Elle est située sur le Minho, à 13 lieues de Mondonédo, 24 S. E. d'Oviédo, 23 N. E. de Compostelle. Long. 10. 40. latit. 43. 1. (D.J.)
|
| LUGUBRE | adj. (Gram.) qui marque la tristesse. Un vêtement est lugubre : un chant est lugubre. Il ne se dit guere des personnes ; cependant un homme lugubre ne déplairoit pas. C'est que notre langue commence à se permettre de ces hardiesses. Elles passent du style plaisant, où on les reçoit sans peine, dans le style sérieux.
LUGUBRE, oiseau, (Hist. nat. superstition,) c'est le nom que quelques voyageurs ont donné à un oiseau du Brésil, dont le plumage est d'un gris cendré ; il est de la grosseur d'un pigeon, il a un cri lugubre & affligeant, qu'il ne fait entendre que pendant la nuit, ce qui le fait respecter par les Brésiliens sauvages, qui sont persuadés qu'il est chargé de leur porter des nouvelles des morts. Léry, voyageur françois, raconte que passant par un village, il en scandalisa les habitans, pour avoir ri de l'attention avec laquelle ils écoutoient le cri de cet oiseau. Tais-toi, lui dit rudement un vieillard, ne nous empêche point d'entendre les nouvelles que nos grands-peres nous font annoncer.
|
| LUGUVALLIUM | (Géogr. anc.) ancien lieu de la grande Bretagne qu'Antonin désigne par Luguvallium ad vallum, auprès d'un fossé. Le savant Gale démontre presque que c'est Old Carleil sur le Wize, entre Boulness & Périth, qui est Voreda. On y a trouvé des inscriptions, des statues équestres, & autres monumens de sa grande antiquité. (D.J.)
|
| LUISANT | (Rubanier) s'entend de quelques portions de chaîne qui levant continuellement pendant un certain nombre de coups de navette, & par conséquent n'étant point compris dans le travail, forment au moyen de cette inaction un compartiment de soies traînantes sur l'ouvrage qui fait le luisant, la lumiere n'étant point rompue par l'inégalité que le travail occasionne ; il faut pourtant que cette levée continuelle soit interrompue d'espace en espace, pour les faire adhérer au corps de la chaîne, sans quoi ces soies traînant toujours seroient inutiles ; on les fait baisser sur un seul coup de navette qui sert à couper cette continuité, & à les lier avec la chaîne ; après ce coup de navette, le luisant leve de nouveau comme il a fait précédemment, & ainsi de suite : les luisans se mettent plus ordinairement qu'ailleurs sur les bords ou lisieres des ouvrages, & servent à donner plus de relief aux desseins qu'ils environnent. On en met indifféremment sur tous les ouvrages de ce métier, où l'on juge qu'ils feront un bon effet.
|
| LUISANTE | adj. (Astron.) est un nom qu'on a donné à plusieurs étoiles remarquables par leur éclat dans différentes constellations.
Luisante de la couronne, est une étoile fixe de la seconde grandeur, située dans la couronne septentrionale. Voyez COURONNE SEPTENTRIONALE.
Luisante de la lyre, est une étoile brillante de la premiere grandeur dans la constellation de la lyre.
Il y a aussi dans la constellation de l'aigle une étoile brillante, appellée la luisante de l'aigle, &c. (O)
|
| LUKAW | (Géog.) petite ville d'Allemagne, au cercle de haute Saxe dans l'Osterland, à 2 milles de Zeitz en Misnie, & à 4 de Leipsick. Long. 30. 4. latit. 51. 12.
|
| LUL | (Bot. exot.) nom persan d'un arbre de la Perse & de l'Inde ; les Portugais l'appellent arbol de reyes, arbre des rois, & les François arbre des Banianes, parce que les Banianes se retirent dessous. Les descriptions que les voyageurs donnent de cet arbre, sont si pleines de fables & d'inepties, que je n'en connois aucune qui puisse nous instruire. Ajoûtez-y les contradictions dont elles fourmillent. Les uns nous représentent cet arbre comme le liseron d'Amérique, jettant des rameaux sarmenteux sans feuilles qui s'allongent à terre, s'y insinuent, poussent des racines & deviennent de nouveaux troncs d'arbres, ensorte qu'un seul lul produit une forêt. D'autres nous le peignent comme le plus bel arbre du pays, qui ne trace ni ne jette des sarmens, qui est tout garni de feuilles semblables à celles du coignassier, mais beaucoup plus larges & plus longues, & donnant un fruit assez agréable au goût, de couleur incarnate tirant sur le noir. Qui croirois-je, de Tavernier ou de Pietro della Valle, sur la description de cet arbre ? Aucun des deux.
|
| LUL | ou LUHLA, (Géog.) ville de la Laponie, au bord du golfe de Bothnie, au nord de l'embouchure de la riviere dont elle porte le nom. Long. 40. 30. latit. 66. 30. (D.J.)
|
| LULAF | S. m. (Antiq.) c'est ainsi que les Juifs nomment des guirlandes & des bouquets de myrthes, de saules, de palmes, &c. dont ils ornent leurs synagogues à la fête des tabernacles.
|
| LUMACHELLE | marbre, (Hist. nat.) c'est ainsi que, d'après les Italiens, on nomme un marbre rempli d'un amas de petites coquilles ; il y en a de noir. Il s'en trouve de cette espece en Westphalie, au village de Belem, à environ une lieue d'Osnabruck. Mais le marbre lumachelle le plus connu est d'un gris de cendre, mêlé quelquefois d'une teinte de jaune ; c'est celui que les Italiens nomment lumachella dorata antica, ou lumachella cinerea ; ils l'appellent aussi lumachella di trapani, & lumachellone antico. Il y a des carrieres de ce marbre en Italie ; il s'en trouve pareillement en Angleterre dans la province d'Oxford ; on dit que depuis peu l'on en a découvert une très-belle carriere en Champagne.
|
| LUMB | S. m. (Hist. natur.) oiseau aquatique, qui se trouve sur les côtes de Spitzberg ; il a le bec long, mince, pointu & recourbé, comme le pigeon plongeur du même pays ; ses piés & ses ongles sont noirs, ainsi que les pattes qui sont courtes ; il est noirâtre sur le dos, & d'une blancheur admirable sous le ventre. Son cri est celui du corbeau ; cet oiseau se laisse tuer plutôt que de quitter ses petits qu'il couvre de ses aîles, en nageant sur les eaux. Les lumbs se rassemblent en troupes, & se retirent sur les montagnes.
|
| LUMBIER | (Géog.) en latin Lumbaria, & le peuple Lumberitani, dans Pline, l. III. c. iij. ancienne petite ville d'Espagne, dans la haute Navarre, sur la riviere d'Irato, près de Langueça. Long. 16. 36. lat. 42. 30. (D.J.)
|
| LUMBO-DORSAL | en Anatomie, nom d'un muscle appellé sacro-lombaire. Voyez SACRO-LOMBAIRE.
|
| LUMBON | (Hist. nat.) arbre qui croît dans les îles Philippines. Il produit des especes de petites noix dont l'écorce est très-dure, mais le dedans est indigeste ; on en tire une huile, qui sert au lieu de suif pour espalmer les vaisseaux.
|
| LUMBRICAUX | (Anat.) on nomme ainsi quatre muscles de la main, & autant du pié. Le mot est formé du latin lumbricus, ver, parce que ces muscles ressemblent à des vers par leur figure & leur petitesse. C'est pourquoi on les nomme aussi vermiculaires.
Les lumbricaux de la main sont des muscles, que l'on regarde communément comme de simples productions des tendons du muscle profond. Ils se terminent au côté interne du premier os de chacun des quatre derniers doigts. Quelquefois leur tendon se confond avec ceux des interosseux.
Les lumbricaux du pié sont des muscles qui viennent, comme ceux de la main, chacun d'un des tendons du profond, & qui se terminent au côté interne de la premiere phalange des quatre derniers orteils, & quelquefois se confondent avec les tendons des interosseux.
|
| LUME | S. f. terme de grosses forges, voyez cet article.
|
| LUMIERE | S. f. (Optiq.) est la sensation que la vûe des corps lumineux apporte ou fait éprouver à l'ame, ou bien la propriété des corps qui les rend propres à exciter en nous cette sensation. Voyez SENSATION.
Aristote explique la nature de la lumiere, en supposant qu'il y a des corps transparens par eux-mêmes, par exemple, l'air, l'eau, la glace, &c. c'est-à-dire des corps qui ont la propriété de rendre visibles ceux qui sont derriere eux ; mais comme dans la nuit nous ne voyons rien à-travers de ces corps, il ajoute qu'ils ne sont transparens que potentiellement ou en puissance, & que dans le jour ils le deviennent réellement & actuellement ; & d'autant qu'il n'y a que la présence de la lumiere qui puisse réduire cette puissance en acte, il définit par cette raison la lumiere l'acte du corps transparent considéré comme tel. Il ajoute que la lumiere n'est point le feu ni aucune autre chose corporelle qui rayonne du corps lumineux, & se transmet à-travers le corps transparent, mais la seule présence ou application du feu, ou de quelqu'autre corps lumineux, au corps transparent.
Voilà le sentiment d'Aristote sur la lumiere ; sentiment que ses sectateurs ont mal compris, & au lieu duquel ils lui en ont donné un autre très-différent, imaginant que la lumiere & les couleurs étoient de vraies qualités des corps lumineux & colorés, semblables à tous égards aux sensations qu'elles excitent en nous, & ajoutant que les objets lumineux & colorés ne pouvoient produire des sensations en nous, qu'ils n'eussent en eux-mêmes quelque chose de semblable, puisque nihil dat quod in se non habet. Voyez QUALITE.
Mais le sophisme est évident : car nous sentons qu'une aiguille qui nous pique nous fait du mal, & personne n'imaginera que ce mal est dans l'aiguille. Au reste on se convaincra encore plus évidemment au moyen d'un prisme de verre, qu'il n'y a aucune ressemblance nécessaire entre les qualités des objets, & les sensations qu'ils produisent. Ce prisme nous représente le bleu, le jaune, le rouge, & d'autres couleurs très-vives, sans qu'on puisse dire néanmoins qu'il y ait en lui rien de semblable à ces sensations.
Les Cartésiens ont approfondi cette idée. Ils avouent que la lumiere telle qu'elle existe dans les corps lumineux, n'est autre chose que la puissance ou faculté d'exciter en nous une sensation de clarté très-vive ; ils ajoutent que ce qui est requis pour la perception de la lumiere, c'est que nous soyons formés de façon à pouvoir recevoir ces sensations ; que dans les pores les plus cachés des corps transparens, il se trouve une matiere subtile, qui à raison de son extrême petitesse peut en même-tems pénétrer ce corps, & avoir cependant assez de force pour secouer & agiter certaines fibres placées au fond de l'oeil ; enfin que cette matiere poussée par ce corps lumineux, porte ou communique l'action qu'il exerce sur elle, jusqu'à l'organe de la vûe.
La lumiere premiere consiste donc selon eux en un certain mouvement des particules du corps lumineux, au moyen duquel ces particules peuvent pousser en tout sens la matiere subtile qui remplit les pores des corps transparens.
Les petites parties de la matiere subtile ou du premier élément étant ainsi agitées, poussent & pressent en tout sens les petits globules durs du second élément, qui les environnent de tous côtés, & qui se touchent. M. Descartes suppose que ces globules sont durs, & qu'ils se touchent, afin de pouvoir transmettre en un instant l'action de la lumiere jusqu'à nos yeux ; car ce philosophe croyoit que le mouvement de la lumiere étoit instantané.
La lumiere est donc un effort au mouvement, ou une tendance de cette matiere à s'éloigner en droite ligne du centre du corps lumineux ; & selon Descartes l'impression de la lumiere sur nos yeux, par le moyen de ces globules, est à-peu-près semblable à celle que les corps étrangers font sur la main d'un aveugle par le moyen de son bâton. Cette derniere idée a été employée depuis par un grand nombre de philosophes, pour expliquer différens phénomenes de la vision ; & c'est presque tout ce qui reste aujourd'hui du systême de Descartes, sur la lumiere. Car en premier lieu la lumiere, comme nous le ferons voir plus bas, emploie un certain tems, quoique très-court, à se répandre ; & ainsi ce philosophe s'est trompé, en supposant qu'elle étoit produite par la pression d'une suite de globules durs. D'ailleurs si les particules des rayons de lumiere étoient des globules durs, elles ne pourroient se réfléchir de maniere que l'angle de réflexion fût égal à l'angle d'incidence. Cette propriété n'appartient qu'aux corps parfaitement élastiques. Un corps d'or qui vient frapper perpendiculairement un plan, perd tout son mouvement, & ne se réfléchit point. Il se réfléchit au contraire dans cette même perpendiculaire, s'il est élastique ; si ce corps vient frapper le plan obliquement, & qu'il soit dur, il perd par la rencontre du plan tout ce qu'il avoit de mouvement perpendiculaire, & ne fait plus après le choc, que glisser parallélement au plan : si au contraire le corps est élastique, il reprend en arriere en vertu de son ressort, tout son mouvement perpendiculaire, & se réfléchit par un angle égal à l'angle d'incidence. Voyez REFLEXION. Voyez aussi MATIERE SUBTILE, & CARTESIANISME.
Le P. Malebranche déduit l'explication de la lumiere, d'une analogie qu'il lui suppose avec le son. On convient que le son est produit par les vibrations des parties insensibles du corps sonore. Ces vibrations ont beau être plus grandes ou plus petites, c'est-à-dire se faire dans de plus grands ou de plus petits arcs de cercle, si malgré cela elles sont d'une même durée, elles ne produiront en ce cas dans nos sensations, d'autre différence que celle du plus ou moins grand degré de force ; au lieu que si elles ont différentes durées, c'est-à-dire si un des corps sonores fait dans un même tems plus de vibrations qu'un autre, les deux sons différeront alors en espece, & on distinguera deux différens tons, les vibrations promtes formant les tons aigus, & les plus lentes les tons graves. Voyez SON AIGU & GRAVE.
Le P. Malebranche suppose qu'il en est de même de la lumiere & des couleurs. Toutes les parties du corps lumineux sont selon lui dans un mouvement rapide ; & ce mouvement produit des pulsations très-vives dans la matiere subtile qui se trouve entre le corps lumineux & l'oeil ; ces pulsations sont appellées par le P. Malebranche, vibration de pression. Selon que ces vibrations sont plus ou moins grandes, le corps paroît plus ou moins lumineux ; & selon qu'elles sont plus promtes ou plus lentes, le corps paroîtra de telle ou telle couleur.
Ainsi on voit que le P. Malebranche ne fait autre chose que de substituer aux globules durs de Descartes, de petits tourbillons de matiere subtile. Mais indépendamment des objections générales qu'on peut opposer à tous les systêmes qui font consister la lumiere dans la pression d'un fluide, objections qu'on trouvera exposées dans la suite de cet article ; on peut voir à l'article TOURBILLON, les difficultés jusqu'ici insurmontables, que l'on a faites contre l'existence des tourbillons tant grands que petits.
M. Huyghens croyant que la grande vîtesse de la lumiere, & la décussation ou le croisement des rayons ne pouvoit s'accorder avec le systême de l'émission des corpuscules lumineux, a imaginé un autre systême qui fait encore consister la propagation de la lumiere dans la pression d'un fluide. Selon ce grand géomêtre, comme le son s'étend tout-à-l'entour du lieu où il a été produit par un mouvement qui passe successivement d'une partie de l'air à l'autre, & que cette propagation se fait par des surfaces ou ondes sphériques, à cause que l'extension de ce mouvement est également promte de tous côtés ; de même il n'y a point de doute selon lui, que la lumiere ne se transmette du corps lumineux jusqu'à nos yeux, par le moyen de quelque fluide intermédiaire, & que ce mouvement ne s'étende par des ondes sphériques semblables à celles qu'une pierre excite dans l'eau quand on l'y jette.
M. Huyghens déduit de ce systême, d'une maniere fort-ingénieuse, les différentes propriétés de la lumiere, les lois de la réfléxion, & de la réfraction, &c. mais ce qu'il paroît avoir le plus de peine à expliquer, & ce qui est en effet le plus difficile dans cette hypothèse, c'est la propagation de la lumiere en ligne droite. En effet M. Huyghens compare la propagation de la lumiere à celle du son : pourquoi donc la lumiere ne se propage-t-elle pas en tout sens comme le son ? L'auteur fait voir assez bien que l'action ou la pression de l'onde lumineuse doit être la plus forte dans l'endroit où cette onde est coupée par une ligne menée du corps lumineux ; mais il ne suffit pas de prouver que la pression ou l'action de la lumiere en ligne droite, est plus forte qu'en aucun autre sens, il faut encore démontrer qu'elle n'existe que dans ce sens-là ; c'est ce que l'expérience nous prouve, & ce qui ne suit point du systême de M. Huyghens.
Selon M. Newton, la lumiere premiere, c'est-à-dire la faculté par laquelle un corps est lumineux, consiste dans un certain mouvement des particules du corps lumineux, non que ces particules poussent une certaine matiere fictice qu'on imagineroit placée entre le corps lumineux & l'oeil, & logée dans les pores des corps transparens ; mais parce qu'elles se lancent continuellement du corps lumineux qui les darde de tous côtés avec beaucoup de force ; & la lumiere secondaire, c'est-à-dire, l'action par laquelle le corps produit en nous la sensation de clarté, consiste selon le même auteur non dans un effort au mouvement, mais dans le mouvement réel de ces particules qui s'éloignent de tous côtés du corps lumineux en ligne droite, & avec une vîtesse presqu'incroyable.
En effet, dit M. Newton, si la lumiere consistoit dans une simple pression ou pulsation, elle se répandroit dans un même instant aux plus grandes distances ; or nous voyons clairement le contraire par les phénomenes des éclipses des satellites de Jupiter. En effet lorsque la terre approche de Jupiter, les immersions des satellites de cette planete anticipent un peu sur le tems vrai, ou commencent plus tôt ; au lieu que lorsque la terre s'éloigne de Jupiter, leurs émersions arrivent de plus en plus tard, s'éloignant beaucoup dans les deux cas du tems marqué par les tables.
Cette déviation qui a été observée d'abord par M. Roemer, & ensuite par d'autres astronomes, ne sauroit avoir pour cause l'excentricité de l'orbe de Jupiter ; mais elle provient selon toute apparence, de ce que la lumiere solaire que les satellites nous réfléchissent, a dans un cas plus de chemin à faire que dans l'autre, pour parvenir du satellite à nos yeux : ce chemin est le diamêtre de l'orbe annuel de la terre. Voyez SATELLITE.
Descartes qui n'avoit pas une assez grande quantité d'expérience, avoit cru trouver dans les éclipses de lune, que le mouvement de la lumiere étoit instantané. Si la lumiere, dit-il, demande du tems, par exemple une heure pour traverser l'espace qui est entre la terre & la lune, il s'ensuivra que la terre étant parvenue au point de son orbite où elle se trouve entre la lune & le soleil, l'ombre qu'elle cause, ou l'interruption de la lumiere ne sera pas encore parvenue à la lune, mais n'y arrivera qu'une heure après ; ainsi la lune ne sera obscurcie qu'une heure après que la terre aura passé par la conjonction avec la lune : mais cet obscurcissement ou interruption de lumiere ne sera vû de la terre qu'une heure après. Voilà donc une éclipse qui ne paroîtroit commencer que deux heures après la conjonction, & lorsque la lune seroit déjà éloignée de l'endroit de l'écliptique qui est opposé au soleil. Or toutes les observations sont contraires à cela.
Il est visible qu'il ne résulte autre chose de ce raisonnement, sinon que la lumiere n'emploie pas une heure à aller de la terre à la lune, ce qui est vrai ; mais si la lumiere n'emploie que 7 minutes à venir du soleil jusqu'à nous, comme les observations des satellites de Jupiter le font connoître ; elle employera beaucoup moins d'une minute à venir de la terre à la lune, & de la lune à la terre, & alors il sera difficile de s'appercevoir d'une si petite quantité dans les observations astronomiques.
J'ai cru devoir rapporter cette objection pour montrer que si Descartes s'est trompé sur le mouvement de la lumiere, au-moins il avoit imaginé le moyen de s'assurer du tems que la lumiere met à parcourir un certain espace. Il est vrai que la lune étant trop proche de nous, les éclipses de cette planete ne peuvent servir à décider la question, mais il y a apparence que si les satellites de Jupiter eussent été mieux connus alors, ce philosophe auroit changé d'avis ; & on doit le regarder comme le premier auteur de l'idée d'employer les observations des satellites, pour prouver le mouvement de la lumiere.
La découverte de l'aberration des étoiles fixes, faite il y a 20 ans par M. Bradley, a fourni une nouvelle preuve du mouvement successif de la lumiere, & cette preuve s'accorde parfaitement avec celle qu'on tire des éclipses des satellites. Voyez ABERRATION.
La lumiere semblable à cet égard aux autres corps, ne se meut donc pas en un instant. M. Roemer & M. Newton ont mis hors de doute par le calcul des éclipses des satellites de Jupiter, que la lumiere du soleil emploie près de sept minutes à parvenir à la terre, c'est-à-dire, à parcourir un espace de plus de 23, 000, 000, de lieues, vîtesse 10000000 fois plus grande que celle du boulet qui sort d'un canon.
De plus, si la lumiere consistoit dans une simple pression, elle ne se répandroit jamais en droite ligne ; mais l'ombre la feroit continuellement fléchir dans son chemin. Voici ce que dit là-dessus M. Newton : " Une pression exercée sur un milieu fluide, c'est-à-dire un mouvement communiqué par un tel milieu au-delà d'un obstacle qui empêche en partie le mouvement du milieu, ne peut point être continuée en ligne droite, mais se répandre de tous côtés dans le milieu en repos par-delà l'obstacle. La force de la gravité tend en en-bas, mais la pression de l'eau qui en est la suite, tend également de tous côtés, & se répand avec autant de facilité & autant de force dans des courbes que dans des droites ; les ondes qu'on voit sur la surface de l'eau lorsque quelques obstacles en empêchent le cours, se fléchissent en se répandant toujours & par degré dans l'eau qui est en repos, & par-delà l'obstacle. Les ondulations, pulsations, ou vibrations de l'air, dans lesquelles consiste le son, subissent aussi des inflexions, & le son se répand aussi facilement dans des tubes courbes, par exemple dans un serpent, qu'en ligne droite " ; or on n'a jamais vû la lumiere se mouvoir en ligne courbe ; les rayons de lumiere sont donc de petits corpuscules qui s'élancent avec beaucoup de vîtesse du corps lumineux. Sur quoi voyez l'article ÉMISSION.
Quant à la force prodigieuse avec laquelle il faut que ces corpuscules soient dardés pour pouvoir se mouvoir si vîte, qu'ils parcourent jusques à plus de 3000000 lieues par minutes, écoutons là-dessus le même auteur : " Les corps qui sont de même genre, & qui ont les mêmes vertus, ont une force attractive, d'autant plus grande par rapport à leur volume, qu'ils sont plus petits. Nous voyons que cette force a plus d'énergie dans les petits aimans que dans les grands, eu égard à la différence des poids ; & la raison en est, que les parties des petits aimans étant plus proches les unes des autres, elles ont par-là plus de facilité à unir intimement leur force, & à agir conjointement ; par cette raison, les rayons de lumiere étant les plus petits de tous les corps, leur force attractive sera du plus haut degré, eu égard à leur volume ; & on peut en effet conclure des regles suivantes, combien cette attraction est forte. L'attraction d'un rayon de lumiere, eu égard à sa quantité de matiere est à la gravité qu'a un projectile, eu égard aussi à sa quantité de matiere, en raison composée de la vîtesse du rayon, à celle du projectile, & de la courbure de la ligne que le rayon décrit dans la réfraction, à la courbure de la ligne que le projectile décrit aussi de son côté ; pourvû cependant que l'inclination du rayon sur la surface réfractante, soit la même que celle de la direction du projectile sur l'horison. De cette proportion il s'ensuit que l'attraction des rayons de lumiere est plus que 1, 000, 000, 000, 000, 000, fois plus grande que la gravité des corps sur la surface de la terre, eu égard à la quantité de matiere du rayon & des corps terrestres, & en supposant que la lumiere vienne du soleil à la terre en 7 minutes de tems ".
Rien ne montre mieux la divisibilité des parties de la matiere, que la petitesse des parties de la lumiere. Le docteur Nieuwentit a calculé qu'un pouce de bougie, après avoir été converti en lumiere, se trouve avoir été divisé par-là en un nombre de parties exprimé par le chiffre 2696 17040, suivi de quarante zéros, ou, ce qui est la même chose, qu'à chaque seconde que la bougie brûle, il en doit sortir un nombre de parties exprimé par le chiffre 418660, suivi de trente-neuf zéros, nombre beaucoup plus que mille millions de fois plus grand que celui des sables que pourroit contenir la terre entiere, en supposant qu'il tienne cent parties de sable dans la longueur d'un pouce.
L'expansion ou l'étendue de la propagation des parties de la lumiere est inconcevable : le docteur Hook montre qu'elle n'a pas plus de bornes que l'univers, & il le prouve par la distance immense de quelques étoiles fixes, dont la lumiere est cependant sensible à nos yeux au moyen d'un télescope. Ce ne sont pas seulement, ajoute-t-il, les grands corps du soleil & des étoiles qui sont capables d'envoyer ainsi leur lumiere jusques aux points les plus reculés des espaces immenses de l'univers, il en peut être de même de la plus petite étincelle d'un corps lumineux, du plus petit globule qu'une pierre à fusil aura détaché de l'acier.
Le docteur Gravesande prétend que les corps lumineux sont ceux qui dardent le feu, ou qui donnent un mouvement au feu en droite ligne ; & il fait consister la différence de la lumiere & de la chaleur, en ce que pour produire la lumiere, il faut selon lui, que les particules ignées viennent frapper les yeux, & y entrent en ligne droite, ce qui n'est pas nécessaire pour la chaleur. Au contraire, le mouvement irrégulier semble plus propre à la chaleur ; c'est ce qui paroît par les rayons qui viennent directement du soleil au sommet des montagnes, lesquelles n'y font pas à beaucoup près autant d'effet, que ceux qui se font sentir dans les vallées, & qui ont auparavant été agités d'un mouvement irrégulier par plusieurs réflexions. Voyez FEU & FEU ELECTRIQUE.
On demande s'il peut y avoir de la lumiere sans chaleur, ou de la chaleur sans lumiere ; nos sens ne peuvent décider suffisamment cette question, la chaleur étant un mouvement qui est susceptible d'une infinité de degrés, & la lumiere une matiere qui peut être infiniment rare & foible ; à quoi il faut ajouter qu'il n'y a point de chaleur qui nous soit sensible, sans avoir en même tems plus d'intensité que celle des organes de nos sens. Voyez CHALEUR.
M. Newton observe que les corps & les rayons de lumiere agissent continuellement les uns sur les autres ; les corps sur les rayons de lumiere, en les lançant, les réfléchissant, & les réfractant ; & les rayons de lumiere sur les corps, en les échauffant, & en donnant à leurs parties un mouvement de vibration dans lequel consiste principalement la chaleur : car il remarque encore que tous les corps fixes lorsqu'ils ont été échauffés au-delà d'un certain degré, deviennent lumineux, qualité qu'ils paroissent devoir au mouvement de vibrations de leurs parties ; & enfin, que tous les corps qui abondent en parties terrestres & sulphureuses, donnent de la lumiere s'ils sont suffisamment agités de quelque maniere que ce soit. Ainsi la mer devient lumineuse dans une tempête ; le vif-argent lorsqu'il est secoué dans le vuide ; les chats & les chevaux, lorsqu'on les frotte dans l'obscurité ; le bois, le poisson, & la viande, lorsqu'ils sont pourris. Voyez PHOSPHORE.
Hawksbée nous a fourni une grande variété d'exemples de la production artificielle de la lumiere par l'attrition des corps qui ne sont pas naturellement lumineux, comme de l'ambre frotté sur un habit de laine, du verre sur une étoffe de laine, du verre sur du verre, des écailles d'huitres sur une étoffe de laine, & de l'étoffe de laine sur une autre, le tout dans le vuide.
Il fait sur la plûpart de ces expériences les réflexions suivantes, que différentes sortes de corps donnent diverses sortes de lumieres, qui différent soit en couleur, soit en force ; qu'une même attrition a divers effets, selon les différentes préparations des corps qui la souffrent, ou la différente maniere de les frotter, & que les corps qui ont donné une certaine lumiere en particulier, peuvent être rendus par la friction incapables d'en donner davantage de la même espece.
M. Bernoulli a trouvé par expérience que le mercure amalgamé avec l'étain, & frotté sur un verre, produisoit dans l'air une grande lumiere, que l'or frotté sur un verre en produisoit aussi & dans un plus grand degré ; enfin, que de toutes ces especes de lumieres produites artificiellement, la plus parfaite étoit celle que donnoit l'attrition d'un diamant, laquelle est aussi vive que celle d'un charbon qu'on souffle fortement. Voyez DIAMANT, ECTRICITECITE.
M. Boyle parle d'un morceau de bois pourri & brillant, dont la lumiere s'éteignit lorsqu'on en eut fait sortir l'air, mais qui redevint de nouveau brillant comme auparavant, lorsqu'on y eut fait rentrer l'air. Or il ne paroît pas douteux que ce ne fût-là une flamme réelle, puisqu' ainsi que la flamme ordinaire, elle avoit besoin d'air pour s'entretenir ou se conserver. Voyez PHOSPHORE.
L'attraction des particules de la lumiere par les autres corps, est une vérité que des expériences innombrables ont rendues évidente. M. Newton a observé le premier ce phénomene ; il a trouvé par des observations répétées, que les rayons de lumiere dans leur passage près des bords des corps, soit opaques, soit transparens, comme des morceaux de métal, des tranchans de lames de couteaux, des verres cassés, &c. sont détournés de la ligne droite. Voyez DISTRACTION.
Cette action des corps sur la lumiere s'exerce à une distance sensible, quoiqu'elle soit toûjours d'autant plus grande, que la distance est plus petite ; c'est ce qui paroît clairement dans le passage d'un rayon entre les bords de deux plaques minces à différentes ouvertures. Les rayons de lumiere lorsqu'ils passent du verre dans le vuide, ne sont pas seulement fléchis ou pliés vers le verre ; mais s'ils tombent trop obliquement, ils retournent alors vers le verre, & sont entierement réfléchis.
On ne sauroit attribuer la cause de cette réflexion à aucune résistance du vuide ; mais il faut convenir qu'elle procede entierement de quelque force ou puissance qui réside dans le verre, par laquelle il attire & fait retourner en-arriere les rayons qui l'ont traversé, & qui sans cela passeroient dans le vuide. Une preuve de cette vérité, c'est que si vous frottez la surface postérieure du verre avec de l'eau, de l'huile, du miel, ou une dissolution de vif-argent, les rayons qui sans cela auroient été réfléchis, passeront alors dans cette liqueur & au-travers ; ce qui montre aussi que les rayons ne sont pas encore réfléchis tant qu'ils ne sont pas parvenus à la seconde surface du verre ; car si à leur arrivée sur cette surface, ils tomboient sur un des milieux dont on vient de parler ; alors ils ne seroient plus réfléchis, mais ils continueroient leur premiere route, l'attraction du verre se trouvant en ce cas contre-balancée par celle de la liqueur. De cette attraction mutuelle entre les particules de la lumiere, & celles des autres corps, naissent deux autres grands phénomenes, qui sont la réflexion & la réfraction de la lumiere. On sait que la direction du mouvement d'un corps, change nécessairement s'il se rencontre obliquement dans son chemin quelqu'autre corps ; ainsi la lumiere venant à tomber sur la surface des corps solides, il paroîtroit par cela seul qu'elle devroit être détournée de sa route, & renvoyée ou réfléchie de façon que son angle de réflexion fût égal, (comme il arrive dans la réflexion des autres corps) à l'angle d'incidence ; c'est aussi ce que fait voir l'expérience, mais la cause en est différente de celle dont nous venons de faire mention. Les rayons de lumiere ne sont pas réfléchis en heurtant contre les parties des corps mêmes qui les réfléchissent, mais par quelques puissances répandues également sur toute la surface des corps, & par laquelle les corps agissent sur la lumiere, soit en l'attirant, soit en la repoussant, mais toûjours sans contact : cette puissance est la même par laquelle dans d'autres circonstances les rayons sont réfractés. Voy. REFLEXION & REFRACTION.
M. Newton prétend que tous les rayons qui sont réfléchis par un corps ne touchent jamais le corps, quoiqu'à la vérité ils en approchent beaucoup. Il prétend encore que les rayons qui parviennent réellement aux parties solides du corps s'y attachent, & sont comme éteints & perdus. Si l'on demande comment il arrive que tous les rayons ne soient pas réfléchis à la fois par toute la surface, mais que tandis qu'il y en a qui sont réfléchis, d'autres passent à-travers, & soient rompus :
Voici la réponse que M. Newton imagine qu'on peut faire à cette question. Chaque rayon de lumiere dans son passage à-travers une surface capable de le briser, est mis dans un certain état transitoire, qui dans le progrès du rayon se renouvelle à intervalles égaux ; or à chaque renouvellement le rayon se trouve disposé à être facilement transmis à-travers la prochaine surface réfractante. Au contraire, entre deux renouvellemens consécutifs, il est disposé à être aisément réfléchi : & cette alternative de réflexions & de transmissions, paroît pouvoir être occasionnée par toutes sortes de surfaces & à toutes les distances. M. Newton ne cherche pas par quel genre d'action ou de disposition ce mouvement peut être produit ; s'il consiste dans un mouvement de circulation ou de vibration, soit des rayons, soit du milieu, ou en quelque chose de semblable ; mais il permet à ceux qui aiment les hypothèses, de supposer que les rayons de lumiere lorsqu'ils viennent à tomber sur une surface réfringente ou réfractante, excitent des vibrations dans le milieu réfringent ou réfractant, & que par ce moyen ils agitent les parties solides du corps. Ces vibrations ainsi répandues dans le milieu, pourront devenir plus rapides que le mouvement du rayon lui-même ; & quand quelque rayon parviendra au corps dans ce moment de la vibration, où le mouvement qui forme celle-ci, conspirera avec le sien propre, sa vîtesse en sera augmentée, de façon qu'il passera aisément à-travers de la surface réfractante ; mais s'il arrive dans l'autre moment de la vibration, dans celui où le mouvement de vibration est contraire au sien propre, il sera aisément réfléchi ; d'où s'ensuivent à chaque vibration des dispositions successives dans les rayons, à être réfléchis ou transmis. Il appelle accès de facile réflexion, le retour de la disposition que peut avoir le rayon à être réfléchi, & accès de facile transmission, le retour de la disposition à être transmis ; & enfin, intervalle des accès, l'espace de tems compris entre les retours. Cela posé, la raison pour laquelle les surfaces de tous les corps épais & transparens réfléchissent une partie des rayons de lumiere qui y tombent & en réfractent le reste, c'est qu'il y a des rayons qui au moment de leur incidence sur la surface du corps, se trouvent dans des accès de réflexion facile, & d'autres qui se trouvent dans des accès de transmission facile.
Nous avons déja remarqué à l'article COULEUR, que cette théorie de M. Newton, quelque ingénieuse qu'elle soit, est encore bien éloignée du degré d'évidence nécessaire pour satisfaire l'esprit sur les propriétés de la lumiere réfléchie. V. REFLEXION & MIROIR.
Un rayon de lumiere qui passe d'un milieu dans un autre de différente densité, & qui dans son passage, se meut dans une direction oblique à la surface qui sépare les deux milieux, sera réfracté ou détourné de son chemin, parce que les rayons sont plus fortement attirés par un milieu plus dense que par un plus rare. Voyez REFRACTION.
Les rayons ne sont point réfractés en heurtant contre les parties solides des corps, & le sont au contraire sans aucun contact, & par la même force par laquelle ils sont réfléchis, laquelle s'exerce différemment en différentes circonstances. Cela se prouve à-peu-près par les mêmes argumens qui prouvent que la réflexion se fait sans contact.
Pour les propriétés de la lumiere rompue ou réfractée, voyez REFRACTION & LENTILLE.
On observe dans le crystal d'Islande, une espece de double réfraction très-différente de celle qu'on remarque dans tous les autres corps. Voyez à l'article CRYSTAL D'ISLANDE, le détail de ce phénomene, & les conséquences que M. Newton en a tirées.
M. Newton ayant observé que l'image du soleil projetée sur le mur d'une chambre obscure par les rayons de cet astre, & transmise à-travers un prisme, étoit cinq fois plus longue que large, se mit à rechercher la raison de cette disproportion ; & d'expérience en expérience, il découvrit que ce phénomene provenoit de ce que quelques-uns des rayons de lumieres étoient plus réfractés que d'autres, & que cela suffisoit pour qu'ils représentassent l'image du soleil allongée. Voyez PRISME.
De-là il en vint à conclure, que la lumiere elle-même est un mêlange hétérogene de rayons différemment réfrangibles, ce qui lui fit distinguer la lumiere en deux especes ; celle dont les rayons sont également refrangibles, qu'il appella lumiere homogene, similaire ou uniforme ; & celle dont les rayons sont inégalement refrangibles, qu'il appella lumiere hétérogene. Voyez REFRANGIBILITE.
Il n'a trouvé que trois affections par lesquelles les rayons de lumiere différassent les uns des autres ; sçavoir, la réfrangibilité, la réflexibilité & la couleur ; or les rayons qui conviennent entr'eux en réfrangibilités, conviennent aussi dans les autres affections, d'où il s'ensuit qu'ils peuvent à cet égard être regardés comme homogenes, quoiqu'à d'autres égards, il fût possible qu'ils fussent hétérogenes.
Il appelle de plus, couleurs homogenes, celles qui sont représentées par une lumiere homogene, & couleurs hétérogenes, celles qui sont produites par une lumiere hétérogene. Ces définitions expliquées, il en déduit plusieurs propositions. En premier lieu, que la lumiere du soleil consiste en des rayons qui different les uns des autres par des degrés indéfinis de réfrangibilités. Secondement, que les rayons qui different en réfrangibilité, différeront aussi à proportion dans les couleurs qu'ils représenteront lorsqu'ils auront été séparés les uns des autres. Troisiémement, qu'il y a autant de couleurs simples & homogenes, que de degrés de réfrangibilité ; car à chaque degré différent de réfrangibilité, répond une couleur différente.
Quatriémement, que la blancheur semblable à celle de la lumiere immédiate du soleil, est un composé de sept couleurs primitives. Voy. COULEUR.
Cinquiémement, que les rayons de lumiere ne souffrent aucunes altérations dans leurs qualités par la réfraction.
Sixiémement, que la réfraction ne sauroit décomposer la lumiere en couleurs qui n'y auroient pas été mêlées auparavant, puisque la réfraction ne change pas les qualités des rayons, mais qu'elle sépare seulement les uns des autres ceux qui ont différentes qualités, par le moyen de leurs différentes réfrangibilités.
Nous avons déja observé que les rayons de lumiere sont composés de parties dissimilaires ou hétérogenes, y en ayant probablement de plus grandes les unes que les autres. Or plus ces parties sont petites, plus elles sont réfrangibles ; c'est-à-dire plus il est facile qu'elles se détournent de leur cours rectiligne. De plus nous avons encore fait remarquer que les parties qui différoient en réfrangibilité, & par conséquent en volume, différoient en même-tems en couleur.
De-là on peut déduire toute la théorie des couleurs. Voyez COULEUR.
L'académie royale des Sciences de Paris, ayant proposé pour le sujet du prix de 1736, la question de la propagation de la lumiere, M. Jean Bernoulli le fils, docteur en Droit, composa à ce sujet une dissertation qui remporta le prix. Le fond du systême de cet auteur est celui du pere Malebranche, avec cette seule différence que M. Bernoulli ajoute aux petits tourbillons des petits globules durs ou solides, répandus çà & là, selon lui, dans l'espace que les petits tourbillons occupent. Ces petits globules, quoiqu'éloignés assez considérablement les uns des autres, par rapport à leur petitesse, se trouvent en grand nombre dans la plus petite ligne droite sensible. Ces petits corps demeureront toujours en repos, étant comprimés de tous côtés. Mais si on conçoit que les particules d'un corps lumineux, agitées en tout sens avec beaucoup de violence, frappent suivant quelque direction, les tourbillons environnans ; ces tourbillons ainsi condensés, chasseront le corpuscule le plus voisin ; celui-ci comprimera de même les tourbillons suivans, jusqu'au second corpuscule, &c. Cette compression étant achevée, les tourbillons reprendront leur premier état, & feront une vibration en sens contraire, puis ils seront chassés une seconde fois, & feront ainsi des oscillations, par le moyen desquelles la lumiere se répandra. M. Bernoulli déduit de cette explication plusieurs phénomenes de la lumiere ; & les recherches mathématiques dont sa piece est remplie sur la pression des fluides élastiques, la rendent fort instructive & fort intéressante à cet égard. C'est sans doute ce qui lui a mérité le glorieux suffrage de l'académie ; car le fond du systême de cet auteur est d'ailleurs sujet à toutes les difficultés ordinaires contre le systême de la propagation de la lumiere par pression. Le systême de ceux qui avec M. Newton, regardent un rayon de lumiere comme une file de corpuscules émanés du corps lumineux, ne peut être attaqué que par les deux objections suivantes. 1°. On demande comment dans cette hypothese, les rayons de lumiere peuvent se croiser sans se nuire. A cela on peut répondre, que les rayons qui nous paroissent parvenir à nos yeux en se croisant, ne se croisent pas réellement, mais passent l'un au-dessus de l'autre, & sont censés se croiser à cause de leur extrême finesse. 2°. On demande comment le soleil n'a point perdu sensiblement de sa substance, depuis le tems qu'il envoie continuellement de la matiere lumineuse hors de lui. On peut répondre que non-seulement cette matiere est renvoyée en partie au soleil par la réflexion des planetes, & que les cometes qui approchent fort de cet astre, servent à le reparer par les exhalaisons qui en sortent ; mais encore que la matiere de la lumiere est si subtile, qu'un pouce cube de cette matiere suffit peut-être pour éclairer l'univers pendant l'éternité. En effet, on démontre aisément, qu'étant donnée une si petite portion de matiere qu'on voudra, on peut diviser cette portion de matiere en parties si minces, que ces parties rempliront un espace donné, en conservant entr'elles des intervalles moindres que 1/10000000, &c. de ligne. Voyez dans l'introduction ad veram Physicam de Keill, le chapitre de la divisibilité de la matiere. C'est pourquoi une portion de matiere lumineuse, si petite qu'on voudra, suffit pour remplir pendant des siecles un espace égal à l'orbe de Saturne. Il est vrai que l'imagination se revolte ici ; mais l'imagination se revolte en vain contre des vérités démontrées. Voyez DIVISIBILITE. Chambers.
Il est certain d'une part, que l'opinion de Descartes & de ses partisans, sur la propagation de la lumiere, ne peut se concilier avec les lois connues de l'Hydrostatique ; & il ne l'est pas moins de l'autre, que les émissions continuelles lancées des corps lumineux, suivant Newton & ses partisans, effrayent l'imagination. D'ailleurs, il n'est pas facile d'expliquer (même dans cette derniere hypothese) pourquoi la lumiere cesse tout d'un coup dès que le corps lumineux disparoît, puisqu'un moment après que ce corps a disparu, les corpuscules qu'il a lancés, existent encore autour de nous, & doivent conserver encore une grande partie du mouvement prodigieux qu'ils avoient, étant lancés par ce corps jusqu'à nos yeux. Les deux opinions, il faut l'avouer, ne sont démontrées ni l'une ni l'autre ; & la plus sage réponse à la question de la matiere & de la propagation de la lumiere, seroit peut-être de dire que nous n'en savons rien. Newton paroît avoir bien senti ces difficultés, lorsqu'il dit de naturâ radiorum lucis, utrum sint corpora nec ne, nihil omninò disputans. Ces paroles ne semblent-elles pas marquer un doute si la lumiere est un corps ? mais si elle n'en est pas un, qu'est-elle donc ? Tenons-nous-en donc aux assertions suivantes.
La lumiere se propage suivant une ligne droite d'une maniere qui nous est inconnue, & les lignes droites suivant lesquelles elle se propage, sont nommées ses rayons. Ce principe est le fondement de l'Optique. Voyez OPTIQUE & VISION.
Les rayons de lumiere se réfléchissent par un angle égal à l'angle d'incidence. Voyez REFLEXION & MIROIR. Ce principe est le fondement de toute la Catoptrique. Voyez CATOPTRIQUE.
Les rayons de lumiere qui passent d'un milieu dans un autre, se rompent de maniere que le sinus d'incidence est au sinus de réfraction en raison constante. Ce principe est le fondement de toute la Dioptrique. Voyez DIOPTRIQUE, REFRACTION, VERRE, LENTILLE, &c. Avec ces propositions bien simples, la théorie de la lumiere devient une science purement géométrique, & on en démontre les propriétés sans savoir ni en quoi elle consiste, ni comment se fait sa propagation ; à-peu-près comme le professeur Saunderson donnoit des leçons d'Optique quoiqu'il fût presque aveugle de naissance. Voyez AVEUGLE. Voyez aussi VISION.
LUMIERE ZODIACALE, (Physiq.) est une clarté ou une blancheur souvent assez semblable à celle de la voie lactée que l'on apperçoit dans le ciel en certains tems de l'année après le coucher du soleil ou avant son lever, en forme de lame ou de pyramide, le long du zodiaque, où elle est toûjours renfermée par sa pointe & par son axe, appuyée obliquement sur l'horison par sa base. Cette lumiere a été découverte, décrite & ainsi nommée par feu M. Cassini.
M. de Mairan, en son traité de l'aurore boréale, est entré dans un assez grand détail sur la lumiere zodiacale : nous allons faire l'extrait de ce qu'il dit sur ce sujet, & c'est lui qui parlera dans le reste de cet article.
Les premieres observations de feu M. Cassini sur la lumiere zodiacale, furent faites au printems de 1683, & rapportées dans le journal des Savans, du 10 Mai de la même année. M. Fatio de Duillier, qui se trouvoit alors à Paris en liaison avec M. Cassini, & qui étoit très-capable de sentir toute la beauté de cette découverte, y fut témoin de plusieurs de ces observations. Ayant passé peu de tems après à Genève, il observa de son côté très-soigneusement le même phénomene pendant les années 1684, 1685, & jusque vers le milieu de 1686, où il en écrivit à M. Cassini une grande lettre qui fut imprimée à Amsterdam la même année. M. Cassini a fait mention de cette lettre & avec éloge, en plus d'un endroit du traité qu'il nous a laissé sur ce sujet, sous le titre de découverte de la lumiere céleste qui paroît dans le zodiaque, & qui fut donné au public quatre ans après, dans le volume des voyages de l'académie des Sciences. Il est parlé encore dans les miscellanea naturae curiosorum, de plusieurs observations de cette lumiere faites en Allemagne par MM. Kirch & Eimmart, aux années 1688, 89, 91 & 93, jusqu'au commencement de 1694 ; mais il n'y en a qu'un petit nombre qui y soient détaillées.
On pourroit conjecturer, dit M. Cassini, que ce phénomene a paru autrefois, & qu'il est du nombre de ceux que les anciens ont appellés trabes ou poutres. M. Cassini se rappelle aussi avoir vû dès l'année 1668, étant à Boulogne, un phénomene fort semblable à celui dont il s'agit, dans le tems que le chevalier Chardin en observoit un tout pareil dans la ville capitale de l'une des provinces de Perse.
Mais un avertissement que Childrey donna aux Mathématiciens à la fin de son histoire naturelle d'Angleterre, Britannia Baconica, écrite environ l'an 1659, porte quelque chose de plus positif sur ce sujet, & dont M. Cassini n'a pas oublié de lui faire honneur. " C'est, dit le savant anglois, qu'au mois de Février, un peu avant, un peu après, il a observé, pendant plusieurs années consécutives vers les six heures du soir, & quand le crépuscule a presque quitté l'horison, un chemin lumineux fort aisé à remarquer, qui se darde vers les pléiades, & qui semble les toucher ".
Enfin M. Cassini ajoute à ces témoignages celui de plusieurs anciens auteurs qui ont vû des apparences célestes qu'on ne peut méconnoître pour la lumiere zodiacale, quoiqu'ils ne l'aient pas soupçonnée en tant que telle, ce qui acheve de le convaincre de l'ancienneté de ce phénomene.
L'opinion la plus reçue touchant la lumiere de la queue des cometes, est qu'elle consiste dans la réflexion des rayons du soleil qui les éclaire. Or M. Cassini remarque en cent endroits de son ouvrage la ressemblance extrême de la lumiere zodiacale avec la queue des cometes. " Les queues des cometes, dit-il, sont une apparence semblable à celle de notre lumiere, elles sont de la même couleur.... Leur extrémité qui est plus éloignée du soleil, paroît aussi douteuse : desorte qu'en un même instant elles paroissent diversement étendues à diverses personnes, étant de même variables selon les divers degrés de clarté de l'air, & selon le mélange de la lumiere de la lune & des autres astres. On voit aussi à-travers de ces queues les plus petites étoiles : desorte que par tous ces rapports on peut juger que l'une & l'autre apparence peut avoir un sujet semblable ".
M. Fatio, qui a aussi examiné très-assidument la lumiere zodiacale pendant trois ou quatre années, en porte le même jugement. Ce sera donc vraisemblablement, comme M. Fatio l'insinue en plusieurs endroits de sa lettre, une espece de fumée ou de brouillard, mais si délié, qu'on voit à-travers les plus petites étoiles. Cette derniere circonstance est remarquable, & se trouve souvent de même ou à-peu-près, soit dans les parties les plus claires & les plus brillantes de l'aurore boréale, soit dans les plus obscures & les plus fameuses, telles que le segment qui borde ordinairement l'horison, & qui est concentrique aux arcs lumineux.
M. Cassini compare encore très-souvent la lumiere zodiacale à la voie lactée, tant parce qu'elle paroît ou disparoît dans les mêmes circonstances, que par leur rapport de clarté. C'est sous cette idée qu'il l'annonça aux Savans dans le journal de 1683... " Une lumiere semblable à celle qui blanchit la voie de lait, mais plus claire & plus éclatante vers le milieu, & plus foible vers les extrémités, s'est répandue par les signes que le soleil doit parcourir, &c. " Mais il paroît qu'elle augmenta de force & de densité dans la suite, & sur-tout en 1686 & 1687.
A en juger par mes propres yeux depuis que j'observe, dit M. de Mairan, elle est aussi plus forte, plus dense que la lumiere de la voie de lait, dans les jours favorables à l'observation, & presque toujours plus uniforme, moins blanche quelquefois, & tirant un peu vers le jaune ou le rouge dans sa partie qui borde l'horison, ce qui pourroit aussi venir sans doute des vapeurs & du petit brouillard dont il est rare que l'horison soit parfaitement dégagé ; & dans cet état je ne vois pas, ajoute le même auteur, qu'on puisse distinguer les petites étoiles à-travers, excepté vers les extrémités de la lumiere. M. Derham, de la société royale de Londres, a apperçu cette couleur rougeâtre dans la lumiere zodiacale en 1707. On peut avoir pris garde aussi depuis quelques années, que sa base est très-souvent confondue avec une espece de nuage fumeux qui nous en dérobe la clarté, qui déborde plus ou moins au-delà à droite & à gauche sur l'horison, & qui est tout-à-fait semblable par sa couleur & par sa consistance apparente, au segment obscur qu'on a coutume de voir au-dessous de l'arc lumineux de l'aurore boréale. Ce phénomene s'y mêle encore d'ordinaire dans cette occasion, & fait corps avec la lumiere zodiacale au-dessus du nuage fumeux, en s'étendant vers le nord-ouest, & quelquefois jusqu'au nord & au-delà.
Enfin, je ne dois pas passer sous silence, continue M. de Mairan, une singularité remarquable du tissu apparent de cette lumiere, c'est qu'en la regardant attentivement par de grandes lunettes, feu M. Cassini y a vû petiller comme de petites étincelles ; il a douté cependant si cette apparence n'étoit point causée par la forte application de l'oeil, ne pouvant déterminer ni le nombre ni la configuration de ces atomes lumineux, & ceux qui observoient avec lui n'y distinguant rien de plus fixe. M. de Mairan a vu deux fois ce petillement avec une lunette de 18 piés : & même avec une de 7, & il lui semble l'avoir vu une fois sans lunettes. J'avoue, continue-t-il, que je me défie beaucoup, avec M. Cassini, du témoignage des yeux, quand il s'agit des objets de cette nature, & si peu marqués. Mais je trouve encore quelques autres observations dont on peut inférer qu'il y a eu des tems & certains cas où les étincelles apperçues dans la lumiere zodiacale, & ce pétillement, ont été sensibles à la vue simple, si ce n'est dans cette lumiere, du moins dans celle de la queue des cometes, qui lui ressemble déja si fort par d'autres endroits.
A en juger par les observations, & à rassembler toutes les circonstances qui les accompagnent, M. de Mairan trouve que la lumiere zodiacale, lorsqu'elle a été apperçue, n'a jamais occupé guere moins de 50 ou 60 degrés de longueur depuis le soleil jusqu'à sa pointe, & de 8 à 9 degrés de largeur à sa partie la plus claire & la plus proche de l'horison : ce sont des dimensions qu'elle eut souvent en l'année 1683, où M. Cassini commença de l'observer. Elle ne parut avoir que 45 degrés de longueur en 1688, le 6 Janvier, mais les brouillards qu'il y avoit près de l'horison, & la clarté de la planete de Vénus, où elle se terminoit, ne peuvent manquer de l'avoir beaucoup diminuée. M. de Mairan trouve de même que sa plus grande étendue apparente, & c'est aux années 1686, 1687, a été de 90, 95, & jusqu'à 100 ou 103 degrés de longueur, & de plus de 20 de largeur.
Je n'ai jamais pu me convaincre, dit M. de Mairan, d'aucun mouvement propre dans la lumiere zodiacale, & je ne trouve pas que M. Cassini lui en ait attribué d'autre que celui qu'elle doit avoir ou paroît avoir en qualité de compagne ou d'atmosphere du soleil. " Elle paroît, dit-il, s'avancer peu-à-peu d'occident en orient, & parcourir les signes du zodiaque par un mouvement à-peu-près égal à celui du soleil ". Ce fut d'abord une des principales raisons qu'il apporta pour prouver que le sujet de cette lumiere n'étoit pas dans la sphere élémentaire.
Voilà un précis de ce que M. de Mairan nous a donné sur la lumiere zodiacale, qu'il attribue à une atmosphere répandue autour du soleil. On peut voir dans l'ouvrage dont nous venons d'extraire ce qui précéde, les raisons sur lesquelles M. de Mairan se fonde pour attribuer à cette atmosphere la lumiere zodiacale, raisons trop mêlées de géométrique, & qui demandent un trop grand détail pour pouvoir être insérées ici. Voyez aussi l'article AURORE BOREALE.
LUMIERE, (Artillerie) La lumiere d'un canon, d'un mortier, ou d'une autre arme à feu, est un trou proche la culasse qui communique avec l'ame de la piece par où on met l'amorce pour faire prendre feu à sa charge. Voyez CANON & MORTIER.
La lumiere des pieces de canon, mortiers & pierriers, doit, suivant l'ordonnance du 7 Octobre 1732, être percée dans le milieu d'une masse de cuivre rouge pure rozette, bien corroyée, & elle doit avoir la figure d'un cone tronqué renversé ; cette masse sert à conserver la lumiere, parce qu'elle resiste davantage à l'effort de la poudre que le métal ordinaire du canon.
Dans les pieces de 12 le canal de la lumiere aboutit à 8 lignes du fond de l'ame ; dans celles de 8, à 7 lignes ; & dans celles de 4, à 6 lignes. Ce canal va un peu en biaisant de la partie supérieure de la piece à l'intérieur de l'ame : ensorte qu'il fait à-peu-près un angle de 100 degrés avec la partie intérieure de la piece vers la volée.
Dans les pieces de 24 & de 16, où il y a de petites chambres, elles ont deux pouces 6 lignes de longueur dans les premieres, & un pouce 6 lignes de diamêtre ; dans les secondes, elles ont un pouce 19 lignes de longueur, & un pouce de diamêtre ou de calibre. La lumiere aboutit à 9 lignes du fond de ces petites chambres dans les pieces de 24, & à 8 lignes dans les pieces de 16.
Ces petites chambres n'étant point sphériques, mais cylindriques, elles ne sont pas propres à retenir des parties de feu comme les sphériques dont on a parlé à l'article du CANON. Ainsi elles n'ont pas l'inconvénient de ces chambres qui conservoient du feu qui a causé différens accidens. Voyez CHAMBRE.
Il a été proposé autrefois différentes inventions pour diminuer l'action de la poudre sur le canal de la lumiere ; mais comme elles n'étoient pas sans inconvénient, on a conservé l'ancienne maniere, qui consiste à percer le canal de la lumiere comme on vient de l'expliquer.
On a montré dans nos Planches de Fortification la disposition du canal de la lumiere c d dans une piece de 24. La masse de cuivre rouge dans laquelle elle est percée, est marquée par une hachure particuliere qui sert à la faire distinguer du métal de la piece.
LUMIERE, terme à l'usage de ceux qui travaillent l'ardoise. Voyez l'article ARDOISE.
LUMIERE, terme d'Arquebusier, c'est le petit trou qui est fait dans le côté droit du canon à un pouce de la culasse qui communique dans le bassinet, & qui sert pour faire passer la flamme de l'amorce dans le canon de fusil, & pour enflammer la poudre qui est dedans.
LUMIERE, (Peinture) Par ce terme l'on n'entend point en Peinture la lumiere en elle-même, mais l'imitation de ses effets représentés dans un tableau : on dit, voilà une lumiere bien entendue, une belle intelligence de lumiere, une belle distribution, une belle économie de lumiere, un coup hardi de lumiere, &c.
Il y a lumiere naturelle & lumiere artificielle. La lumiere naturelle est celle qui est produite par le soleil lorsqu'il n'est point caché par des nuages, ou celle du jour lorsqu'il en est caché ; & la lumiere artificielle est celle que produit tout corps enflammé, tel qu'un feu de bois, de paille, un flambeau, &c. On appelle lumiere directe, soit qu'elle soit naturelle ou artificielle, celle qui est portée sans interruption sur les objets, & lumiere de reflet, celle qui renvoie en sens contraire les objets éclairés sur le côté ombré de ceux qui les entourent, voyez REFLET. Il ne faut qu'une lumiere principale dans un tableau ; & que celles qu'on pourroit y introduire par une porte, par une lucarne, ou à l'aide d'un flambeau, &c. qu'on appelle accidentelle, lui soient subordonnées en étendue & en vivacité. Il faut que les objets éclairés participent à la nature des corps lumineux qui les éclairent, c'est-à-dire qu'ils soient plus colorés si c'est un flambeau que si c'est le soleil ; & plus colorés si c'est le soleil que si c'est le jour qui les éclaire, &c. On doit observer que ces lumieres colorent plus ou moins les objets, suivant les différentes heures du jour.
|
| LUMIGNON | S. m. (Chandelier & Cirier) sorte de fil d'étoupe de chanvre écru, dont les marchands épiciers-ciriers font les meches des flambeaux de poing & des torches.
|
| LUMINAIRES | S. m. pl. luminaria, (Astronom.) nom qu'on donne comme par excellence au soleil & à la lune, à cause de leur éclat extraordinaire & de la grande quantité de lumiere qu'ils nous envoient. Ce mot se trouve employé dans le premier chapitre de la Genèse, où Moïse dit que Dieu fit deux grands luminaires, duo luminaria magna, le soleil pour présider au jour, & la lune pour présider à la nuit. Il faut cependant remarquer que le soleil brille de sa lumiere propre, au lieu que la lumiere de la lune est une lumiere empruntée du soleil ; & cette planete, qui est un corps dense & opaque, ne nous éclaire si fort que parce qu'elle est fort près de nous. De plus, la lune ne nous éclaire pas toutes les nuits, comme l'expérience journaliere le prouve ; & quand on dit que la lune préside à la nuit, c'est en prenant une partie pour le tout. (O)
|
| LUMINEUX | EUSE, adj. (Phys.) qui a la propriété de rendre de la lumiere. Le soleil, la flamme d'une bougie, &c. sont des corps lumineux. Voyez LUMIERE & COULEUR. (O)
LUMINEUSE, pierre, (Hist. nat.) On rapporte que Henri II. roi de France, étant à Boulogne-sur-mer, un homme inconnu lui apporta une pierre qu'il disoit venir des Indes orientales ; elle avoit la propriété de répandre des éclairs si brillans, que les yeux des spectateurs avoient peine à en soutenir l'éclat. Voy. l'histoire du président de Thou, liv. VI. On ne peut décider si cet effet étoit dû à une pierre ou à une composition ; quoi qu'il en soit, les éphémérides des curieux de la nature nous apprennent qu'un nommé Jean Daniel Krafft fit voir à l'électeur de Brandebourg une substance renfermée dans une bouteille de verre scellée hermétiquement, qu'il nommoit le feu perpétuel ; ayant ouvert la phiole, il mit cette matiere sur du papier bleu ; & lorsque l'on eut ôté toutes les bougies, elle répandit des éclairs semblables à ceux qui se font voir en été dans les soirées qui suivent les journées fort chaudes. Cette matiere frottée avec le doigt, y laissoit une empreinte lumineuse. En ayant enfermé quelques petits grains dans un tube de verre bouché avec de la cire d'Espagne, on vit qu'à des intervalles très-courts il en partoit des éclairs. Voyez éphémerides nat. curiosor. decad. I. ann. 8 & 9.
|
| LUMINIERS | S. m. pl. (Jurisprud.) est le nom que l'on donne en quelques endroits aux marguilliers, à cause que ce sont eux qui prennent soin de l'entretien du luminaire de l'église. Ils sont ainsi nommés dans la coutume d'Auvergne, chap. ij. article 7. Voyez MARGUILLIERS.
|
| LUN | S. m. (Botan. exot.) arbrisseau du Chili qu'on trouve à 33d de hauteur du pole austral. La tige de cet arbrisseau s'éleve à huit & dix piés, se divise & se subdivise en branches & en rameaux ; elle est hérissée de piquans fort courts, mais peu pointus : les seules extrêmités des tiges & des branches sont garnies de feuilles assez semblables à celles de l'olivier. Les fleurs naissent de l'aisselle des feuilles ; elles sont portées sur un embryon de fruit qui se termine par un calice d'un beau rouge, taillé comme en entonnoir : la partie postérieure est un tuyau, lequel s'évase en un pavillon découpé en cinq lobes. Ce calice renferme une fleur de la même couleur & de la même figure. (D.J.)
|
| LUNA | (Géogr. anc.) ancienne ville & port d'Italie : elle étoit dans l'Etrurie, au bord oriental de la Macra, près de son embouchure ; mais il n'en reste plus que les ruines, qu'on nomme Luna distrutta. Cependant elle a l'honneur de donner encore son nom au canton de la Toscane appellé la Lunégiane. Le port de Luna, Lunae portus, golfe de la Méditerranée, est, dit Strabon, un très-grand & très-beau port, lequel en renferme plusieurs qui sont tous assez profonds près du rivage. Aussi Silius Italicus parlant de Luna, dit, liv. VIII. v. 482 :
Insignis portus, quo non spatiosior alter,
Innumeras cepisse rates, & claudere pontum.
(D.J.)
|
| LUNAIRE | ou BULBONAC, lunaria, (Botan.) genre de plante à fleur en croix, composée de quatre petales ; il sort du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit très-applati, divisé en deux loges par une cloison qui soutient des panneaux membraneux & transversaux. Ce fruit renferme des semences qui ont ordinairement la forme d'un rein & qui sont bordées. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
M. de Tournefort distingue sept especes de ce genre de plante, qu'il a eu l'honneur d'établir & de caractériser le premier. La principale des especes est celle qu'il appelle lunaria major, siliquâ rotundiore, grande lunaire, à silique arrondie. Cette grande lunaire est nommée vulgairement le bulbonac, la médaille, la satinée, le satin blanc ou passe-satin ; voyez-en la description au mot BULBONAC.
Elle tire son nom de bulbonac de sa racine bulbeuse ; celui de médaille dérive de la rondeur de ses siliques & de leur bord argentin. Le nom de lunaire dépend de la même cause ou de la forme de ses graines ; les noms de satinée, de satin blanc ou de passe-satin viennent de ce que les cosses de cette plante, dans leur maturité, sont transparentes & ressemblent à du satin blanc. Cette transparence est produite par la cloison mitoyenne de ces siliques, laquelle cloison est d'un blanc argenté, très-luisant. Les Anglois connoissent aussi cette espece de lunaire sous le nom de white satin, & ce sont eux qui m'ont appris l'origine du nom françois.
Mais une chose plus importante, c'est d'avertir le lecteur, que plusieurs de nos botanistes modernes ont nommé lunaires des plantes d'un genre tout différent de celui de Tournefort ; ainsi la lunaire biscutata de quelques-uns est le thlaspidium de Montpellier, la lunaire peltata des autres est une des especes de Jonthlaspi ; la lunaire radiata de Lobel est une sorte de luzerne, &c. (D.J.)
LUNAIRE, (pierre) (Hist. nat.) lapis lunaris, en allemand monden-stein. C'est une pierre qui se trouve, dit-on, dans quelques mines de Suede ; elle est ronde & plate, & lisse d'un côté : on prétendoit y voir des demi-cercles qui représentoient comme une demi-lune d'une couleur jaune, & l'on étoit dans le préjugé de croire que cette tache semblable à la lune, croissoit & décroissoit avec cet astre. Mais Kunckel assure n'avoir jamais remarqué ce phénomene, & dit que la tache restoit toujours dans le même état, quoique cependant l'humidité de l'air contribuât quelquefois à rendre cette tache plus apparente, effet que l'on pouvoit produire, même en poussant l'haleine sur cette pierre.
On a encore donné le nom de pierre lunaire au talc, à la sélenite, à la pierre spéculaire, &c. Voyez éphémerides natur. curios. decad. III. ann. v. & vj.
LUNAIRE, adj. (Astron.) se dit de ce qui appartient à la lune. Voyez LUNE.
Les mois périodiques lunaires sont de 27 jours 7 heures & quelques minutes.
Les mois synodiques lunaires sont de 29 jours 12 heures 3/4. Voyez LUNAISON & SYNODIQUE.
L'année lunaire est de 354 jours. Voyez ANNEE.
Dans les premiers âges, toutes les nations se servoient de l'année lunaire. Ces variétés du cours de la lune étant plus fréquentes & par conséquent mieux connues aux hommes que celles de toutes les autres planetes, les Romains réglerent leurs années par la lune jusques au tems de Jules Cesar. Voyez AN & CALENDRIER.
Les Juifs avoient aussi leur mois lunaire. Quelques rabbins prétendent que le mois lunaire ne commençoit pas au premier moment où la lune paroissoit, mais qu'il y avoit une loi qui obligeoit la premiere personne qui la verroit paroître, d'en aller avertir le sanhedrin : sur quoi le président du sanhedrin prononçoit solemnellement que le mois étoit commencé, & on en donnoit avis au peuple par des feux qu'on allumoit au haut des montagnes ; mais ce fait ne paroît pas trop certain. Chambers.
Cadran lunaire. Voyez CADRAN.
Eclipse lunaire. Voyez ECLIPSE.
Arc-en-ciel lunaire. Voyez ARC-EN-CIEL.
|
| LUNAISON | S. f. (Astron.) période ou espace de tems compris entre deux nouvelles lunes consecutives. Voyez LUNE.
La lunaison est aussi nommée mois synodique, & elle est composée de 29 jours 12 heures 3/4. Voyez MOIS, &c.
La lunaison est fort différente de l'espace de tems que la lune met à faire sa révolution autour de la terre ; car cet espace de tems qu'on appelle mois périodique lunaire, est de 27 jours 7 heures 43 sec. plus court d'environ 2 jours que la lunaison. Voyez la raison de cette différence à l'article LUNE.
Après 19 ans, les mêmes lunaisons reviennent au même jour, mais non pas au même instant du jour ; y ayant au contraire une différence d'une heure 25 minutes 33 secondes ; en quoi les anciens étoient tombés dans l'erreur, croyant le nombre d'or plus sûr & plus infaillible qu'il n'est. Voyez NOMBRE D'OR, METHONIQUE, éPACTE, & CALENDRIER. Voyez aussi SAROS.
On a trouvé depuis qu'en 312 ans les lunaisons avancent d'un jour sur le commencement du mois ; de façon que lorsque l'on réforma le calendrier, les lunaisons arrivoient dans le ciel quatre à cinq jours plus tôt que le nombre d'or ne le marquoit. Pour remedier à cela, nous faisons maintenant usage du cycle perpétuel des épactes.
Nous prenons 19 épactes pour répondre à un cycle de 29 ans ; & quand au bout de 300 ans la lune a avancé d'un jour, nous prenons dix-neuf autres épactes : ce qui se fait aussi lorsque l'on est obligé de rajuster, pour ainsi dire, le calendrier au soleil par l'omission d'un jour intercalaire, comme il arrive trois fois dans 400 ans.
Il faut avoir soin que l'index des épactes ne soit jamais changé, si ce n'est au bout du siecle, lorsqu'il doit l'être en effet par rapport à la métemptose ou proemptose. Voyez METEMPTOSE & PROEMPTOSE.
LUNAIRE, (Comm.) On appelle dans le Levant intérêts lunaires, les intérêts usuraires que les nations chrétiennes payent aux Juifs chaque lune ; les Turcs comptent par lunes & non par mois pour l'argent qu'ils empruntent d'eux. Voyez INTERET. Dictionn. de comm.
|
| LUNATIQUE | (Marechall.) On appelle ainsi un cheval qui est atteint ou frappé de la lune, c'est-à-dire, qui a une débilité de vûe plus ou moins grande, selon le cours de la lune ; qui a les yeux troublés & chargés sur le déclin de la lune, & qui s'éclaircissent peu-à-peu, mais toujours en danger de perdre entierement la vûe.
|
| LUNDE | S. f. (Hist. natur.) c'est un oiseau que Clusius appelle anas arctica, & Linnaeus alca rostri sulcis quatuor, oculorum regione temporibusque albis. Cet oiseau, qui est un peu plus gros qu'un pigeon, a un bec fort & crochu ; il est toujours en guerre avec le corbeau qui en veut à ses petits. Dès que le corbeau s'approche, la lunde s'élance sur lui, le saisit à la gorge avec son bec, & lui serre la poitrine avec ses ongles, & pour ainsi dire, se crampone à lui ; quand le corbeau s'envole, la lunde se tient toujours attachée à lui, jusqu'à-ce qu'il soit arrivé au-dessus de la mer, alors elle l'entraîne dans l'eau où elle l'étrangle. La lunde fait son nid dans des antres pierreux ; quand son petit est éclos & en état de prendre l'essor, elle nettoie son nid, ôte toutes les branches qu'elle y avoit apportées, & y remet du gason frais. On prend les petits de ces oiseaux dans leurs nids en faisant entrer des chiens dans les creux où il y en a. Il s'en trouve beaucoup dans les îles de Feroé. Voyez Acta hafniensia, ann. 1671.
|
| LUNDEN | (Géog.) Lundinum Scanorum, ville de Suede capitale de la province de Schone avec un évêque de la confession d'Augsbourg, & une université fondée en 1668 par Charles XI. Cette ville avoit été érigée en archevêché en 1103, & en primatie de Suede & de Norvège en 1151. Les Danois furent obligés de la céder à la Suéde en 1658. Ce fut près de cette ville que Charles XI. défit Christian V. roi de Danemarck en 1676. Elle est à 7 lieues E. de Copenhague, 90 S. O. de Stockholm. Long. selon Picard & les Acta litterar. suec. 30. 53. 45. lat. selon les mêmes 55. 42. 10.
Lunden est encore une petite ville ou plutôt un bourg au cercle de basse Saxe dans le Ditzmarsz, vers les confins de Sleswig, proche l'Eyder ; ce bourg appartient au duc de Holstein. (D.J.)
|
| LUNDI | S. m. (Chronolog.) est le second jour de la semaine : on l'appelle ainsi, parce que chez les payens il étoit consacré à la lune. Ce jour est appellé dans l'office de l'église feria secunda, seconde férie, le dimanche étant regardé comme la premiere férie.
|
| LUNE | S. f. (Astr.) est l'un des corps celestes que l'on met ordinairement au nombre des planetes, mais qu'on doit regarder plûtôt comme un satellite, ou comme une planete secondaire. Voyez PLANETE & SATELLITE.
La lune est un satellite de notre terre, vers laquelle elle se dirige toujours dans son mouvement comme vers un centre, & dans le voisinage de laquelle elle se trouve constamment, de façon que si on la voyoit du soleil, elle ne paroîtroit jamais s'éloigner de nous d'un angle plus grand que dix minutes.
La principale différence que l'on apperçoit entre les mouvemens des autres planetes & celui de la lune se peut aisément concevoir : car puisque toutes ces planetes tournent autour du soleil qui est à peu près au centre de leur mouvement, & puisqu'il les attire, pour ainsi dire, à chaque instant, il arrive delà qu'elles sont toujours à peu près à la même distance du soleil, au-lieu qu'elles s'approchent quelquefois considérablement de la terre, & d'autres fois s'en éloignent considérablement. Mais il n'en est pas tout-à-fait de même de la lune, on doit la regarder comme un corps terrestre. Ainsi selon les lois de la gravitation elle ne peut guere s'éloigner de nous, mais elle est retenue à peu près dans tous les tems à la même distance.


Il est si visible que la lune tourne autour de la terre, que nous ne voyons point qu'aucun philosophe de l'antiquité, ni même de ces derniers tems, ait pensé à faire un système différent. Il étoit reservé au P. D. Jacques Alexandre, bénédictin, de soutenir le premier que ce n'est point la lune qui tourne autour de la terre, mais la terre autour de la lune. Il a avancé cette opinion dans une dissertation sur le flux & reflux de la mer, qui remporta le prix de l'académie de Bordeaux en 1727 ; & toute son explication du flux & reflux porte sur l'hypothese du mouvement de la terre autour de la lune. L'académie de Bordeaux, dans le programme qu'elle a fait imprimer à la tête de cet ouvrage, a eu grand soin d'avertir qu'en couronnant l'auteur, elle n'avoit pas prétendu adopter son système, & que si elle n'adjugeoit le prix qu'à des systèmes démontrés, elle auroit souvent le déplaisir de ne pouvoir le distribuer ; M. de Mairan, membre de cette académie & de plusieurs autres, a cru qu'il étoit nécessaire de réfuter l'opinion de D. Jacques Alexandre, & il l'a fait par une dissertation imprimée dans les mémoires de l'académie des Sciences de Paris 1727. Il y démontre par des observations astronomiques que la lune tourne autour de la terre, & non la terre autour de la lune. Ceux qui voudront voir ces preuves en détail, peuvent consulter la dissertation dont nous parlons, ou l'extrait qu'en a donné M. de Fontenelle.
De même que toutes les planetes premieres se meuvent autour du soleil, de même la lune se meut autour de la terre ; son orbite est à peu près une ellipse dans laquelle elle est retenue par la force de la gravité ; elle fait sa révolution autour de nous en 27 jours, 7 heures 43 minutes, ce qui est aussi le tems précis de sa rotation autour de son axe. Voyez LIBRATION.
La moyenne distance de la lune à la terre est d'environ 60 1/2 diametres de la terre, ce qui fait environ 80000 lieues.
L'excentricité moyenne de son orbite est environ 51/1000 de sa moyenne distance, ce qui produit une variation dans la distance de cette planete à la terre, car elle s'en approche & s'en éloigne alternativement de plus d'un dixieme de sa moyenne distance.
Le diametre de la lune est à celui de la terre à peu près comme 11 est à 40, c'est-à-dire, qu'il est d'environ 725 lieues, son diametre apparent moyen est de 31'.16"1/2. & celui du soleil de 32'.12". Voyez DIAMETRE.
La surface de la lune contient environ 1555555 lieues quarrées, &c. La densité de la lune est à celle de la terre, suivant M. Newton, :: 48911.39214, & à celle du soleil :: 48211 à 10000: sa quantité de matiere est à celle de la terre à peu près :: 1.39, & la force de gravité sur sa surface, est à la force de gravité sur la surface de la terre :: 139:407. Voyez DENSITE, GRAVITE.
Les Astronomes sont assez d'accord entr'eux sur la plûpart de ces rapports, qui sont assez exactement déterminés par les observations. Celui qui jusqu'à présent est le plus incertain, est le rapport de la densité de la lune à celle de la terre ou du soleil ; le rapport que nous venons d'en donner, est celui qu'a assigné M. Newton. Mais les observations & les calculs desquels il la déduit ne paroissent pas satisfaisans à M. Bernoulli dans sa piece sur le flux & reflux de la mer. Il est certain que la détermination de la densité de la lune est un des problèmes les plus difficiles de l'Astronomie ; nous en parlerons à la fin de cet article, lorsque nous ferons mention des travaux des géometres modernes sur la lune.
Phénomenes de la lune. On distingue un grand nombre de différentes apparences ou phases de la lune : tantôt elle croît, tantôt elle décroît ; quelquefois elle est cornue, d'autres fois demi-circulaire, d'autres fois bossue, pleine, & circulaire, ou plûtôt sphérique. Voyez PHASE.
Quelquefois elle nous éclaire la nuit entiere, quelquefois une partie de la nuit seulement ; quelquefois elle est visible dans l'hémisphere méridional, & quelquefois dans le boréal ; or comme toutes ses variations ont été d'abord découvertes par Endimion ancien grec, qui a été le premier attentif à observer les mouvemens de la lune, la fable a supposé par cette raison qu'il en étoit amoureux.
La cause de la plûpart de ces apparences, c'est que la lune est un corps obscur, opaque & sphérique, & qu'elle ne brille que de la lumiere qu'elle reçoit du soleil ; ce qui fait qu'il n'y a que celle des deux moitiés qui est tournée vers cet astre, qui soit éclairée, la moitié opposée conservant toujours son obscurité naturelle.
La face de la lune qui est visible pour nous, c'est cette partie de son corps qui est tout-à-la-fois tournée vers la terre & éclairée du soleil, d'où il arrive que suivant les différentes positions de la lune par rapport au soleil & à la terre, on en voit une plus ou moins grande partie éclairée, parce que c'est tantôt une plus grande portion,
& tantôt une plus petite de son hémisphere lumineux qui nous est visible.
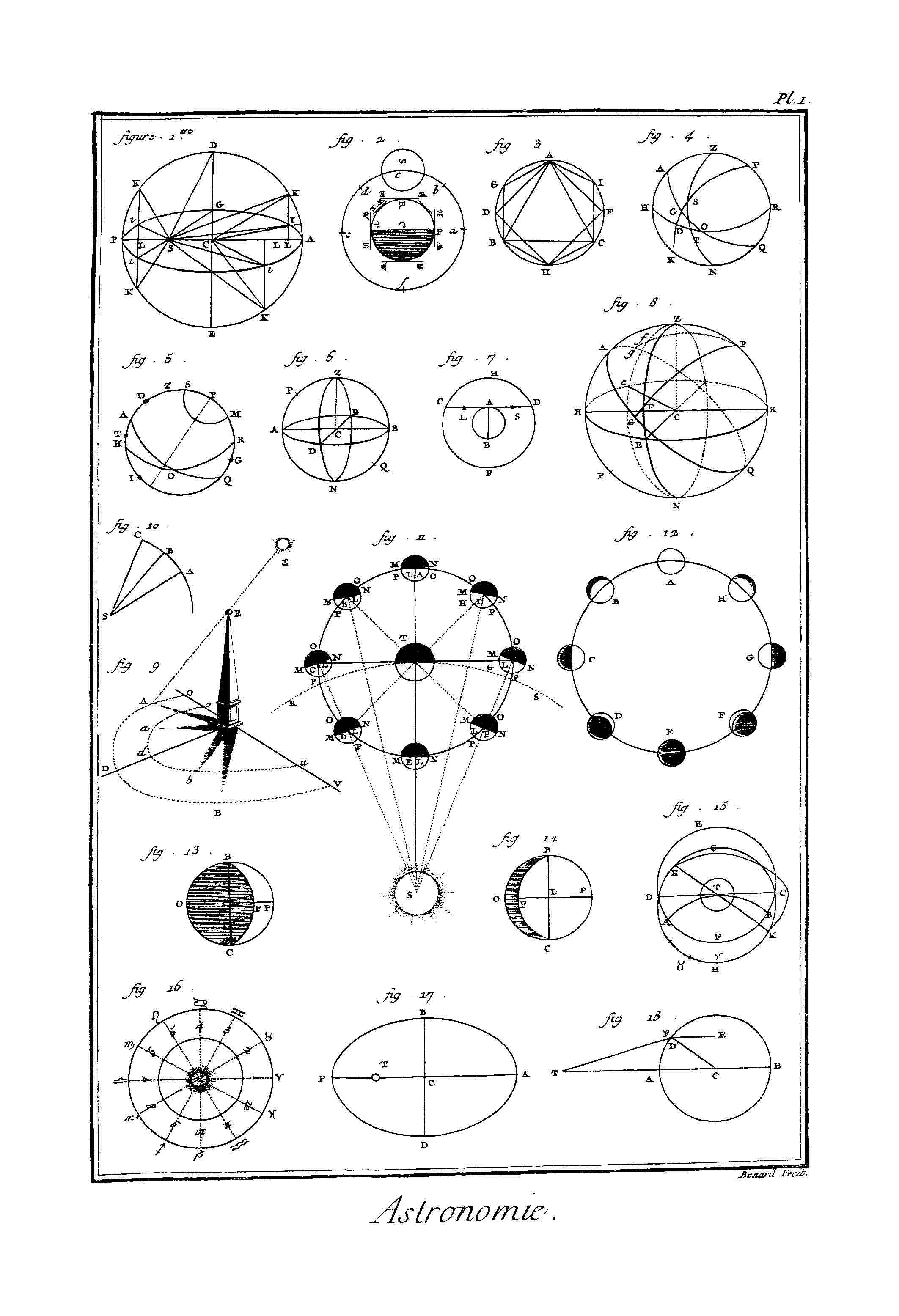
Phases de la lune. Pour concevoir les phases de la lune, supposons que S (Pl. d'Astr. fig. 11.) représente le soleil, T la terre, R T S une portion de l'orbite de la terre, & A B C D E F l'orbite de la lune, où elle fait sa révolution autour de la terre dans l'espace d'un mois, & d'occident en orient ; joignez les centres du soleil & de la lune par la droite S L, & imaginez un plan M L N, qui passe par le centre de la lune & qui soit perpendiculaire à la droite S L, la section de ce plan avec la surface de la lune marquera la ligne qui termine la lumiere & l'ombre, & qui sépare la face lumineuse de l'obscure.
Joignez les centres de la terre & de la lune par la ligne T L, à laquelle vous menerez par le centre de la lune un plan perpendiculaire P L O, ce plan donnera sur la surface de la lune le cercle qui sépare l'hémisphere visible, ou celui qui est tourné vers nous, de l'hémisphere invisible, cercle que l'on nomme par cette raison, cercle de vision.
Il s'ensuit de-là que la lune étant en A, le cercle qui termine la lumiere & l'ombre, & le cercle de vision coïncideront ; de façon que toute la surface lumineuse de la lune sera tournée alors vers la terre ; la lune en ce cas sera pleine par rapport à nous, & luira toute la nuit ; mais par rapport au soleil elle sera en opposition, parce que le soleil & la lune seront vûs de la terre dans des points des cieux directement opposés, l'un de ces astres se levant quand l'autre se couchera. Voyez OPPOSITION.
Quand la lune arrive en B, le disque éclairé M P N ne sera pas tourné en entier vers la terre, de façon que la partie qui sera alors tout-à-la-fois éclairée & visible, ne sera pas tout-à-fait un cercle, & la lune paroîtra bossue comme en B. Voyez BOSSUE.
Quand elle sera arrivée vers C, où l'angle C T S est droit, il n'y aura plus qu'environ la moitié du disque éclairé qui sera tournée vers la terre, & nous verrons une demi-lune, elle sera dite alors dichotomisée, ce qui veut dire coupée en deux. Voyez DICHOTOMIE.
Dans cette situation le soleil & la lune ne sont éloignés l'un de l'autre que d'un quart de cercle, & on dit que la lune est dans son aspect quadral, ou dans sa quadrature. Voyez QUADRATURE.
La lune arrivant en D, il n'y aura plus qu'une petite partie du disque éclairé M P N qui soit tournée vers la terre, ce qui fera que la petite partie qui nous luira paroîtra cornue, ou comme une faulx, c'est-à-dire terminée par de petits angles ou cornes comme en O. Voyez CORNES & FAULX.
Enfin la lune arrivant en E, elle ne montre plus à la terre aucune partie de sa face éclairée comme en O, & c'est cette position qu'on appelle nouvelle lune ; la lune est dite alors en conjonction avec le soleil, parce que ces deux astres répondent à un même point de l'écliptique. Voyez CONJONCTION.
A mesure que la lune avance vers F elle reprend ses cornes, mais avec cette différence qu'avant la nouvelle lune les cornes étoient tournées vers l'occident, au-lieu qu'à présent elles changent de position & elles regardent l'orient : lorsqu'elle est arrivée en G, elle se trouve de nouveau dichotomisée ; en H elle est encore bossue, & en A elle redevient pleine.
Voyez la Figure 12.
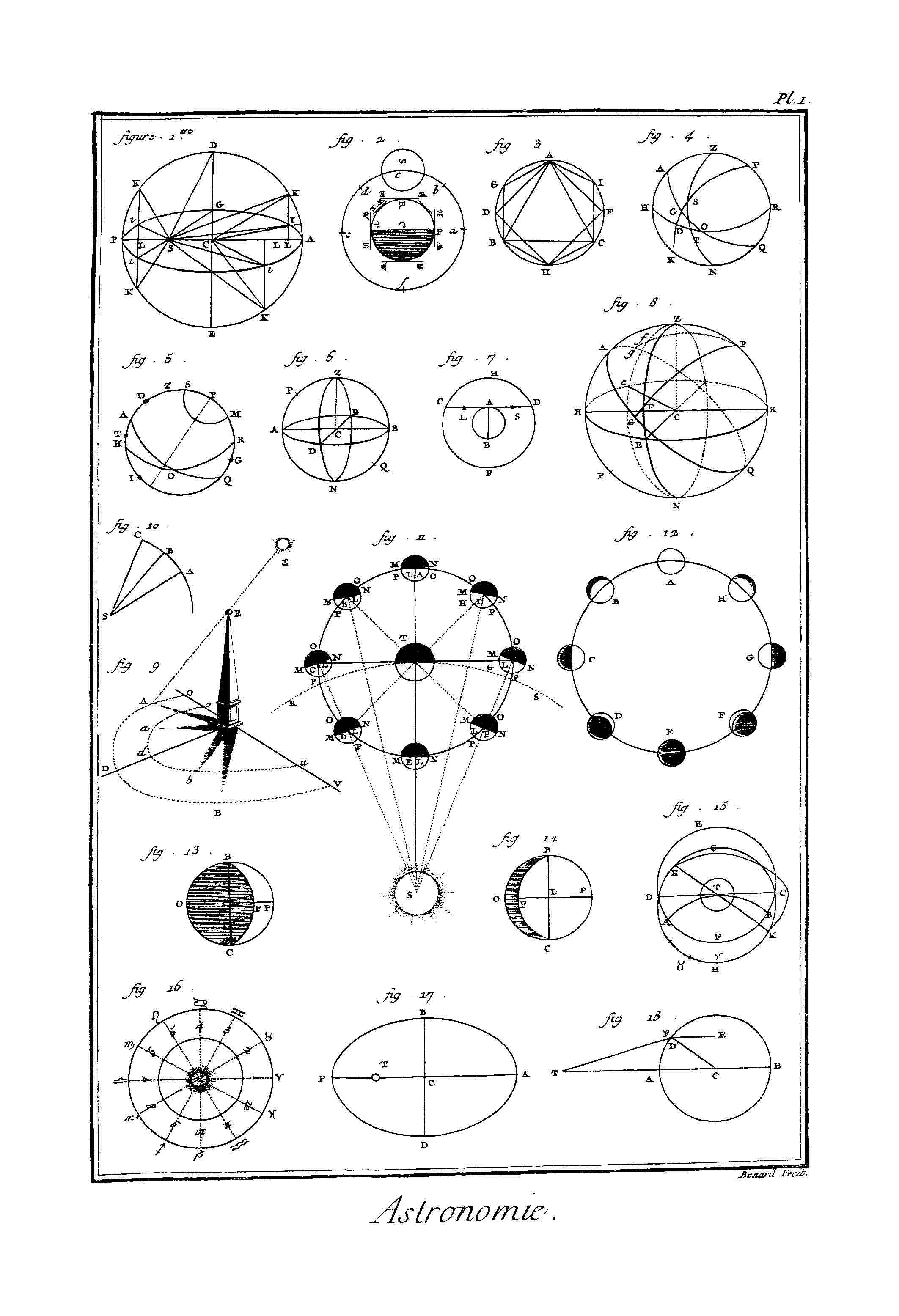
L'angle S T L compris entre les lignes tirées des centres du soleil & de la lune, à celui de la terre, est nommée l'élongation de la lune au soleil, & l'arc P N, qui représente la portion du cercle éclairée M O N, laquelle est tournée vers nous, est par-tout presque semblable à l'arc d'élongation E L ; ou ce qui est la même chose, l'angle S T L est presque égal à l'angle M L O, selon que les Géometres le démontrent.
Moyen de décrire les phases de la lune pour un tems donné. Que le cercle C O B P (fig. 13. & 14.) représente le disque de la lune qui est tourné vers la terre, & soit O P la ligne dans laquelle le demi-cercle O C P est projetté, laquelle nous supposerons coupée à angles droits par le diametre B C ; prenez L P pour rayon, & dans cette supposition L F pour cosinus de l'élongation de la lune sur B C prise pour grand axe, & L F prise pour petit axe ; décrivez une ellipse B F C, cette ellipse retranchera du disque de la lune la portion B F C P de la face éclairée laquelle est visible.
Ceux qui voudront avoir la démonstration de cette pratique, la trouveront dans l'Introductio ad veram Astronomiam de Keill, qui a été traduite en françois par M. Lemonnier, avec beaucoup d'additions : c'est dans le chapitre ix. de cet ouvrage que cet auteur a donné la démonstration dont nous parlons.
Comme la lune éclaire la terre d'une lumiere qu'elle reçoit du soleil, de même elle est éclairée par la terre qui lui renvoye aussi de son côté par reflexion des rayons du soleil, & cela en plus grande abondance qu'elle n'en reçoit elle-même de la lune ; car la surface de la terre est environ quinze fois plus grande que celle de la lune, & par conséquent en supposant à chacune de ces surfaces une texture semblable, eu égard à l'aptitude de réflechir les rayons de lumiere, la terre enverra à la lune dans cette supposition quinze fois plus de lumiere qu'elle n'en reçoit d'elle. Or dans les nouvelles lunes, le côté éclairé de la terre est tourné en plein vers la lune, & il éclaire par conséquent alors la partie obscure de la lune : les habitans de la lune, s'il y en a, doivent donc avoir alors pleine terre, comme dans une position semblable nous avons pleine lune ; de-là cette lumiere foible qu'on observe dans les nouvelles lunes, qui outre les cornes brillantes, nous fait appercevoir encore le reste de son disque, & nous le fait même appercevoir assez bien pour y distinguer des taches. Il est vrai que cette lumiere est bien moins vive que celle du croissant, mais elle n'en est pas moins réelle ; la preuve qu'on en peut donner, c'est qu'elle va en s'affoiblissant à mesure que la terre s'écarte du lieu qu'elle occupoit relativement au soleil & à la lune, c'est-à-dire à mesure que la lune s'approche de ses quadratures & de son opposition au soleil.
Quand la lune parvient en opposition avec le soleil, la terre vûe de la lune doit paroître alors en conjonction avec lui, & son côté obscur doit être tourné vers la lune ; dans cette position la terre doit cesser d'être visible aux habitans de la lune, comme la lune cesse de l'être pour nous lorsqu'elle est nouvelle dans sa conjonction avec le soleil ; peu après les habitans de la lune doivent voir la terre cornue, en un mot la terre doit présenter à la lune les mêmes phases que la lune présente à la terre.
Le docteur Hook cherchant la raison pourquoi la lumiere de la lune ne produit point de chaleur sensible, observe que la quantité de lumiere qui tombe sur l'hémisphere de la pleine lune est dispersée avant que d'arriver jusqu'à nous, dans une sphere 188 fois plus grande en diametre que la lune, que par conséquent la lumiere de la lune est 104368 plus foible que celle du soleil, & qu'ainsi il faudroit qu'il y eût tout-à-la-fois dans les cieux 104368 pleines lunes, pour donner une lumiere & une chaleur égale à celle du soleil à midi. Voyez SOLEIL, CHALEUR, &c.
On a même observé que la lumiere de la lune ramassée au foyer d'un miroir ardent ne produisoit aucune chaleur. Sans avoir recours au calcul du docteur Hook, on peut en apporter une raison fort simple, savoir que la surface de la lune absorbe la plus grande partie des rayons du soleil, & ne nous en envoie que la plus petite partie.
Cours & mouvemens de la lune. Quoique la lune finisse son cours en 27 jours 7 heures, intervalle que nous appellons mois périodiques, elle emploie cependant plus de tems à passer d'une conjonction à la suivante, & ce dernier intervalle de tems s'appelle mois synodique ou lunaison. Voyez MOIS & LUNAISON.
La raison en est que pendant que la lune fait sa révolution autour de la terre dans son orbe, la terre avec tout son système fait de son côté une partie de sa révolution autour du soleil, de façon qu'elle & son satellite, la lune, avancent l'un & l'autre de presque un signe entier vers l'orient ; le point de l'orbite, qui dans sa premiere position répondoit à la droite qui passe par les centres de la terre & du soleil, se trouve donc alors à l'occident du soleil, & par conséquent lorsque la lune revient à ce même point elle ne doit plus se retrouver comme auparavant en conjonction avec le soleil, ce qui fait que la lunaison ne peut s'achever en moins de 29 jours & demi. Voyez PERIODIQUE, SYNODIQUE, &c.
C'est pourquoi le mouvement dont la lune s'éloigne chaque jour du soleil n'est que de 12d. & quelques minutes : on a nommé ce mouvement, le mouvement diurne de la lune au soleil.
Si le plan de l'orbite de la lune étoit coincident avec celui de l'écliptique, c'est-à-dire si la terre & la lune se mouvoient dans un même plan, le chemin de la lune dans les cieux, vû de la terre, paroîtroit précisément le même que celui du soleil, avec cette seule différence que le soleil se trouveroit décrire son cercle dans l'espace d'une année, & que la lune décriroit le sien dans un mois ; mais il n'en est pas ainsi, car ces deux plans se coupent l'un l'autre dans une droite qui passe par le centre de la terre, & sont inclinés l'un à l'autre d'un angle d'environ 5d. Voyez INCLINAISON.
Supposons, par exemple, que A B (fig. 15.) soit une portion de l'orbite de la terre, T la terre, & C E D F l'orbite de la lune dans lequel se trouve le centre de la terre ; décrivez de ce même centre T, dans le plan de l'écliptique, un autre cercle C G D H dont le demi-diametre, soit égal à celui du demi-diametre de l'orbite de la lune, ces deux cercles qui sont dans un différent plan & qui ont le même centre T, se couperont l'un l'autre dans une droite D C qui passera par le centre de la terre, & par conséquent l'une des moitiés C E D de l'orbite de la lune sera élevée au-dessus du plan du cercle C G H vers le nord, & l'autre moitié D F C sera au-dessous vers le sud. La droite D C dans laquelle les deux cercles se coupent, s'appelle la ligne des noeuds, & les points des angles C & D les noeuds, celui de ces noeuds dans lequel la lune s'éleve au-dessus du plan de l'écliptique vers le nord, s'appelle noeud ascendant ou tête du dragon, & l'autre noeud descendant & queue du dragon. Voyez NOEUD ; & l'intervalle de tems que la lune emploie en partant du noeud ascendant pour revenir au même noeud, s'appelle mois dracontique. Voyez DRAGON & DRACONTIQUE.
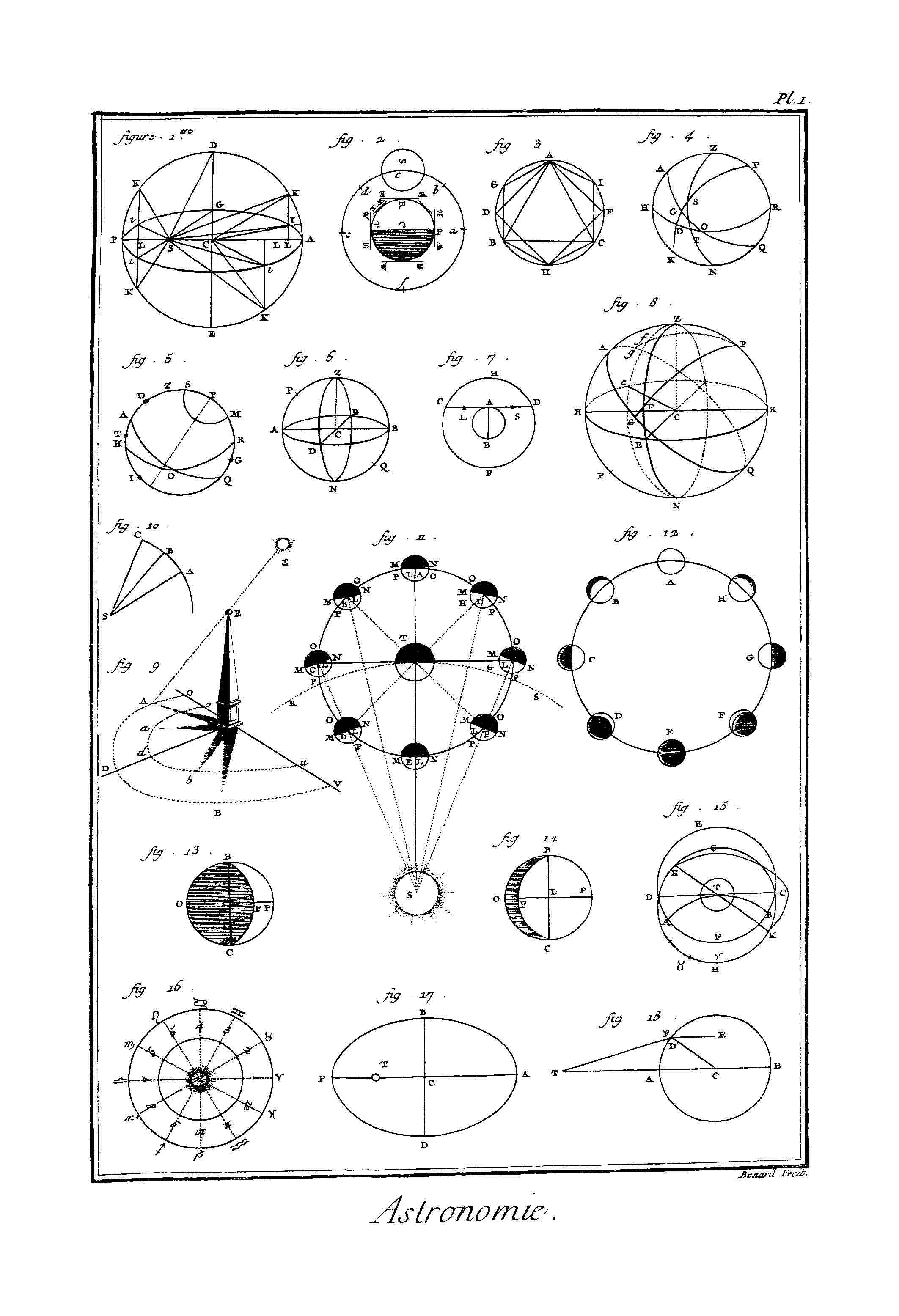
Si la ligne des noeuds étoit immobile, c'est-à-dire si elle n'avoit d'autre mouvement que celui par lequel elle tourne autour du soleil, elle regarderoit toujours en ce cas le même point de l'écliptique, c'est-à-dire qu'elle resteroit toujours parallele à elle-même. Mais ces observations prouvent au contraire que la ligne des noeuds change continuellement de place, que sa situation décline toujours de l'orient à l'occident contre l'ordre des signes, & qu'elle finit la révolution de ce mouvement rétrograde dans un espace d'environ 19 ans, après quoi, chacun des noeuds revient au même point de l'écliptique dont il s'étoit d'abord éloigné. Voyez CYCLE.
Il s'ensuit de-là que la lune n'est jamais précisément dans l'écliptique que deux fois dans chaque période, savoir lorsqu'elle se trouve dans ses noeuds. Dans tout le reste de son cours elle s'éloigne plus ou moins de l'écliptique, suivant qu'elle est plus ou moins proche de ces noeuds. Les points F & E où elle est le plus éloignée de ces noeuds, sont nommés ses limites. Voyez LIMITE.
La distance de la lune à l'écliptique est nommée sa latitude, & elle se mesure par un arc de cercle qui va de la lune perpendiculairement à l'écliptique, & qui est comprise entre la lune & l'écliptique, ayant la terre pour centre ; la latitude de la lune, même lorsqu'elle est la plus grande, comme en E & en F, ne passe jamais 5d. & environ 18'. & cette latitude est la mesure des angles des noeuds. Voyez LATITUDE.
Il paroît par ces observations, que la distance de la lune à la terre change continuellement, desorte que la lune est tantôt plus proche & tantôt plus loin de nous. En effet, elle paroît tantôt sous un angle plus grand, tantôt sous un angle plus petit : l'angle sous lequel le diametre horisontal de la lune a été observé lorsqu'elle étoit pleine & périgée, excede un peu 33'1/2 ; mais étant pleine & apogée, on ne l'apperçoit guere que sous un angle de 29d. 30'. la raison en est que la lune ne se meut point dans une orbite circulaire qui ait la terre pour centre, mais dans une orbite à peu près elliptique (telle que celle qui est représentée dans la fig. 17.) dont l'un des foyers est le centre de la terre ; A P y marque le grand axe de l'ellipse, ou la ligne des apsides ; T C l'excentricité : le point A qui est la plus haute apside s'appelle l'apogée de la lune, P ou l'apside inférieure est le périgée de la lune, ou le point de son orbite dans lequel elle est le plus proche de la terre. Voyez APOGEE & PERIGEE.
L'espace de tems que la lune employe en partant de l'apogée pour revenir au même point, s'appelle mois anomalistique.
Si la ligne des apsides de la lune n'avoit d'autre mouvement que celui par lequel elle est emportée autour du soleil, elle conserveroit toujours une position semblable, c'est-à-dire qu'elle resteroit parallele à elle-même, qu'elle regarderoit toujours le même point des cieux, & qu'on l'observeroit toujours dans le même point de l'écliptique ; mais on a observé que la ligne des apsides est aussi mobile, ou qu'elle a un mouvement angulaire autour de la terre d'occident en orient selon l'ordre des signes, mouvement dont la révolution se fait dans l'espace d'environ neuf années. Voyez APSIDE.
Les irrégularités du mouvement de la lune & de celui de son orbite sont très-considérables : car
1°. quand la terre est dans son aphélie, la lune finit sa révolution dans un tems plus court ; au contraire, quand la terre est dans son périhélie, la lune ralentit alors son mouvement ; ainsi ses révolutions autour de la terre se font en moins de tems, toutes choses d'ailleurs égales, lorsque la terre est dans son aphélie que lorsqu'elle est dans son périhélie, desorte que les mois périodiques ne sont point égaux les uns aux autres. Voyez PERIODIQUE.
2°. Quand la lune est dans ses syzygies, c'est-à-dire dans la droite qui joint les centres de la terre & du soleil, ou, ce qui est la même chose, dans sa conjonction ou son opposition, elle se meut (toutes choses égales d'ailleurs) plus vîte que dans les quadratures. Voyez SYZYGIE.
3°. Le mouvement de la lune varie suivant les différentes distances de cet astre aux syzygies, c'est-à-dire à l'opposition ou à la conjonction dans le premier quartier, c'est-à-dire depuis la conjonction jusqu'à la premiere quadrature, elle perd un peu de sa vîtesse pour la recouvrer dans le second quartier, & elle en perd encore un peu dans le troisieme pour la recouvrer dans le quatrieme. Ticho Brahé a découvert le premier cette inégalité, & l'a nommée variation de la lune. Voyez VARIATION.
4°. La lune se meut dans une ellipse, dont l'un des foyers est placé dans le centre de la terre, & son rayon vecteur décrit autour de ce point des aires proportionnelles au tems, comme il arrive aux planetes à l'égard du soleil ; son mouvement doit donc être plus rapide dans le périgée, & plus lent dans l'apogée.
5°. L'orbite même de la lune est variable, & ne conserve pas toujours la même figure, son excentricité augmentant quelquefois, & diminuant d'autres fois. Elle est la plus grande, lorsque la ligne des apsides coïncide avec celle des syzygies ; & la plus petite, lorsque la ligne des apsides coupe l'autre à angles droits.
Cela est aisé à reconnoître par les diametres apparens que l'on observe. M. Picard est le premier qui ait découvert que la lune périgée au premier & au second quartier, paroissoit sous un angle d'environ une minute plus petit que lorsqu'elle étoit pleine & périgée ; ce qui a fait connoître la loi suivant laquelle l'excentricité de l'orbite varioit à chaque lunaison. Il est encore à remarquer que la différence entre la plus grande & la plus petite excentricité, est si grande, que dans le premier de ces deux cas elle excede de la moitié cette derniere. Par les observations des éclipses de lune on avoit conclu autrefois la plus petite excentricité de l'orbite de cette planete ; ce qui donnoit pour sa plus grande équation du centre, 5° ou 4° 59' 30"°; mais de l'observation de M. Picard il a fallu conclure que l'équation du centre pouvoit être vers le premier ou second quartier de 7d 30' 0", & qu'ainsi les deux plus grandes équations qui peuvent arriver, l'une dans la pleine lune, l'autre dans les quadratures, different d'environ 2° 30'.
6°. L'apogée de la lune n'est pas exempt d'irrégularité ; car on trouve qu'il se meut en avant, lorsqu'il coïncide avec la ligne des syzygies, & en arriere, lorsqu'il coupe cette ligne à angles droits. Ces deux mouvemens en avant & en arriere ne sont pas non plus égaux. Dans la conjonction ou l'opposition, le mouvement en avant est assez rapide ; dans les quadratures, ou bien l'apogée se meut lentement en avant, ou bien il s'arrête, ou bien il se meut en arriere.
7°. Le mouvement des noeuds n'est pas uniforme ; mais quand la ligne des noeuds coïncide avec celle des syzygies, les noeuds s'arrêtent. Lorsque les noeuds sont dans les quadratures, c'est-à-dire que leurs lignes coupent celles des syzygies à angles droits, ils vont en arriere d'orient en occident, & M. Newton sait voir que c'est avec une vîtesse de 16" 19"' 24"" par heure.
Le seul mouvement uniforme qu'ait la lune, est celui par lequel elle tourne autour de son axe, précisément dans le même espace de tems qu'elle employe à faire sa révolution autour de nous dans son orbite, d'où il arrive qu'elle nous présente toujours à-peu-près la même face : nous disons à-peu-près, & non pas exactement ; car comme le mouvement de la lune autour de son axe est uniforme, & que cependant son mouvement ou sa vîtesse dans son orbite est inégale, il arrive de-là que quelque partie du limbe de la lune s'éloigne quelquefois du centre de son disque, & que d'autres fois elle s'en approche, & que quelques parties qui étoient auparavant invisibles, deviennent par-là visibles. Voyez VIBRATION.
Si la lune décrivoit un cercle autour de la terre, & qu'elle décrivît ce cercle d'un mouvement uniforme dans le même tems qu'elle tourne autour de son axe, assurément ce seroit toujours le plan du même méridien lunaire qui passeroit par notre oeil ou par le centre de la terre, & l'on appercevroit exactement chaque jour le même hémisphere. Il suit de ces observations que si la lune est habitée, quelques-uns de ses habitans doivent tantôt voir la terre & tantôt ne la plus voir, que près de la moitié doivent ne la voir jamais, & près de la moitié la voir toujours. Cette espece d'ondulation ou de vacillation de la lune se fait d'abord d'occident en orient, ensuite d'orient en occident ; desorte que diverses régions qui paroissoient situées vers le bord occidental ou oriental de la lune, se cachent ou se montrent alternativement. On a donné à ce mouvement le nom de libration.
Cette uniformité de rotation produit encore une autre irrégularité apparente ; car l'axe de la lune n'étant point perpendiculaire au plan de son orbite, mais étant un peu incliné à ce plan, & cet axe conservant continuellement son parallelisme dans son mouvement autour de la terre, il faut nécessairement qu'il change de situation, par rapport à un observateur placé dans la terre, & à la vue duquel il présentera tantôt l'un des poles, & tantôt l'autre. Desorte que l'observateur, placé sur la surface de la terre, ne verra pas toujours exactement un hémisphere terminé par un plan qui passe par l'axe de la lune, mais l'axe se trouvera presque toujours tantôt d'un côté de ce plan, tantôt de l'autre ; ce qui fait qu'il paroît avoir une espece d'ondulation ou vacillation.
Causes physiques du mouvement de la lune. Nous avons déjà observé que la lune se meut autour de la terre suivant les mêmes lois & de la même maniere que les autres planetes se meuvent autour du soleil ; & il s'ensuit de-là que l'explication du mouvement lunaire en général retombe dans celle du mouvement des autres planetes autour du soleil. Voyez PLANETE & TERRE.
Quant aux irrégularités particulieres au mouvement de la lune, & auxquelles la terre & les autres planetes ne sont point sujettes, elles proviennent du soleil qui agit sur la lune, & trouble son cours ordinaire dans son orbite, & elles peuvent toutes se déduire méchaniquement de la même loi qui dirige le mouvement général de la lune, je veux dire de la loi de gravitation & d'attraction. Voyez GRAVITATION.
Les autres planetes secondaires, par exemple les satellites de Jupiter & de Saturne sont sans doute sujets aux mêmes irrégularités que la lune, parce qu'ils sont exposés à cette même force d'action du soleil sur eux, qui peut les troubler dans leur cours ; aussi apperçoit-on dans le mouvement de ces satellites de grandes irrégularités. Voyez SATELLITE.
Astronomie de la lune. Premier moyen de déterminer la révolution de la lune autour de la terre ou le mois périodique, & le tems compris entre une opposition & la suivante ou le mois synodique.
Puisque la lune dans le milieu d'une éclipse lunaire est opposée au soleil, voyez ECLIPSE, calculez le tems compris entre deux éclipses ou oppositions, & divisez-le par le nombre des lunaisons qui se sont écoulées dans cet intervalle, le quotient sera la quantité du mois synodique. Calculez le mouvement moyen du soleil durant le tems du mois synodique, & ajourez y le cercle entier décrit par la lune, après quoi vous ferez cette proportion : comme la somme trouvée est à 360 secondes, de même la quantité du mois synodique est à celle du périodique. Ainsi Copernic ayant observé à Rome en l'an 1500, le 6 Novembre à minuit une éclipse de lune, & une autre à Cracovie le premier Aout 1523, à 4 heures 25 secondes, il en conclut de cette sorte la quantité du mois synodique de 29 jours 12 heures 41. min. 9 sec. 9 tierces.
e même auteur, au moyen de deux autres éclipses observées, l'une à Cracovie, l'autre à Babylone, a déterminé encore plus exactement la quantité du mois synodique qu'il a trouvée par-là ;
De 29 jours,.... 11 heures 43' 3" 10"'
Moyen mouvement du soleil en même tems,.. 19°6'24"18"'
Moyen de la lune,....................... 389°6'24"18"'
Quantité du mois périodique, 27 jours 7 heures 43' 5".
D'où il s'ensuit
1°. que la quantité du mois périodique étant donnée, on peut trouver par la regle de trois le mouvement diurne & horaire de la lune, &c. & de cette sorte construire des tables du moyen mouvement de la lune.
2°. Si on soustrait le moyen mouvement diurne du soleil du moyen mouvement diurne de la lune, le restant donnera le mouvement diurne de la lune au soleil ; ce qui fournira le moyen de construire une table de ce mouvement diurne.
3°. Puisqu'au milieu des éclipses totales, la lune se trouve dans le noeud ; il s'ensuit de-là que si on cherche le lieu du soleil pour ce tems, & qu'on y ajoûte six signes, la somme donnera le lieu du noeud.
4°. En comparant les observations anciennes avec les modernes, il paroît, comme nous l'avons déja dit, que les noeuds ont un mouvement, & qu'ils avancent in antecedentia, ou contre l'ordre des signes, c'est-à-dire, de taurus à aries, d'aries à pisces, &c. Si l'on ajoûte donc au moyen mouvement diurne de la lune le mouvement diurne des noeuds, la somme sera le mouvement de la lune par rapport aux noeuds ; & on pourra conclure de-là, au moyen de la regle de trois, en combien de tems la lune parcourt 360°, à compter du noeud ascendant, ou combien de tems elle met à revenir à ce point depuis qu'elle en est partie, c'est-à-dire la quantité du mois dracontique.
Moyen de trouver l'âge de la lune. Ajoûtez au jour du mois, l'épacte de l'année, & les mois écoulés depuis Mars inclusivement, la somme, si elle est audessous de 30, & si elle est au-dessus, son excès sur 30 sera l'âge de la lune ; en supposant que le mois ait 31 jours, & si le mois n'a que 30 jours, sera l'excès sur 29.
La raison de cette pratique est
1°. que l'épacte de l'année donne toujours l'âge de la lune au premier Mars.
2°. Que comme l'année lunaire est plus courte de 11 à 12 jours que l'année solaire (voyez EPACTE), & que l'année a 12 mois, la nouvelle lune anticipe ou remonte à-peu-près d'un jour chaque mois, en commençant par Mars. Au reste cette pratique ne donne l'âge de la lune que d'une maniere approchée ; la seule maniere de connoître exactement l'âge de la lune, c'est d'avoir recours aux tables astronomiques.
Pour trouver le tems où la lune passe au méridien, on remarquera
1°. que le jour de la nouvelle lune, la lune passe au méridien en même tems que le soleil.
2°. Que d'un jour à l'autre, le passage de la lune au méridien retarde d'environ trois quarts d'heure (voyez FLUX & REFLUX), ainsi prenez autant de fois trois quarts d'heure qu'il y a de jours dans l'âge de la lune, & vous aurez le tems qui doit s'écouler entre l'heure de midi d'un jour donné, & le passage de la lune au méridien qui doit suivre. Cette seconde pratique n'est encore qu'approchée & seulement pour un usage journalier & grossier. Le véritable tems du passage de la lune au méridien, se trouve dans les tables astronomiques, dans les éphémérides, dans la connoissance des tems, &c. Voyez EPHEMERIDE, &c.
Quant aux éclipses de lune, voyez ECLIPSE ; sur la parallaxe de la lune, voyez PARALLAXE.
Théorie des mouvemens & des irrégularités de la lune. Supposons qu'on demande dans un tems donné, le lieu de la lune dans le zodiaque en longitude, nous trouverons d'abord dans les tables le lieu où la lune seroit, si son mouvement étoit uniforme, c'est ce qu'on appelle son mouvement moyen, lequel est quelquefois plus promt, & quelquefois plus lent que le mouvement vrai. Pour trouver ensuite où elle doit se rencontrer en conséquence de son mouvement vrai, qui est aussi l'apparent, nous chercherons dans une autre table à quelle distance elle est de son apogée, car cette distance rend plus ou moins grande la différence entre le mouvement vrai & le mouvement moyen, & les deux lieux qui correspondent à ces deux mouvemens. Le vrai lieu trouvé de la sorte n'est pas encore le vrai lieu, mais il en est plus ou moins éloigné, selon que la lune est plus ou moins éloignée & du soleil, & de l'apogée du soleil ; & comme cette variation dépend en même tems de ces deux différentes distances, il faudra les considérer & les combiner ensemble dans une table à part ; cette table donne la correction qu'il faut faire au vrai lieu trouvé ci-dessus. Mais ce lieu ainsi corrigé n'est pas encore le vrai lieu, à moins que la lune ne soit en conjonction ou en opposition ; si elle est hors de ces deux cas, il y aura encore une correction à faire, laquelle dépend de deux élémens qu'il faut prendre ensemble, & comparer, savoir la distance du lieu corrigé de la lune au soleil, & celle du lieu où elle est par rapport à son propre apogée, cette derniere distance ayant été changée par la derniere correction.
Par toutes ces opérations & ces corrections, on arrive enfin au vrai lieu de la lune pour l'instant donné, mais il faut convenir qu'il se rencontre en tout cela des difficultés prodigieuses. Les inégalités de lune sont si grandes que ç'a été inutilement que les Astronomes ont travaillé jusqu'au grand Newton à les soumettre à quelque regle. C'est à ce grand homme que nous devons la découverte de leur cause méchanique, ainsi que la méthode de les calculer & de les déterminer, de façon qu'on peut dire de lui qu'il a découvert un monde presque entier, ou plûtôt qu'il se l'est soumis.
Suivant la théorie de M. Newton, on démontre d'une maniere fort élégante les lois méchaniques d'où dépendent les mouvemens que l'on a reconnus tant à l'égard de la lune que de son orbite apparent. C'est une chose remarquable que l'astre qui est le plus proche de la terre, soit celui dont les mouvemens nous sont, pour ainsi dire, le moins connus. Au reste, quelque utilité que l'Astronomie ait retiré du travail de M. Newton, les mouvemens de la lune sont si irréguliers, qu'on n'est pas encore parvenu à découvrir entierement tout ce qui appartient à la théorie de cette planete, & cela faute d'une longue suite d'observations qui demandent beaucoup de veilles & d'assiduités.
M. Newton fait voir par la théorie de la gravité, que les plus grandes planetes, en tournant autour du soleil, peuvent emporter avec elles de plus petites planetes qui tournent autour d'elles, & il prouve à priori, que ces dernieres doivent se mouvoir dans des ellipses dont les foyers se trouvent dans le centre des plus grandes, & qu'en même tems leur mouvement dans leur orbite est différemment troublé par l'action du soleil. Enfin, il infere de-là que les satellites de Saturne sont sujets à des irrégularités analogues. Il examine d'après la même théorie quelle est la force du soleil pour troubler le mouvement de la lune, il détermine quel seroit l'incrément horaire de l'aire que la lune décriroit dans une orbite circulaire par des rayons vecteurs aboutissant à la terre, sa distance de la terre, son mouvement horaire dans une orbite circulaire & elliptique, le mouvement moyen des noeuds, le mouvement vrai des noeuds, la variation horaire de l'inclinaison de l'orbite de la lune au plan de l'écliptique.
Enfin, il a conclu de la même théorie que l'équation annuelle du mouvement moyen de la lune provient de la différente figure de son orbite, & que cette variation a pour cause la différente force du soleil ; laquelle étant plus grande dans le périgée, allonge alors l'orbite, & devenant plus petite dans l'apogée, lui permet de nouveau de se contracter. Dans l'allongement de l'orbite, la lune se meut plus lentement, & dans la contraction elle va plus vîte, & l'équation annuelle propre à compenser cette inégalité est nulle, lorsque le soleil est apogée ou périgée ; dans la moyenne distance du soleil, elle va suivant les observations à 11' 50", & dans les autres distances elle est proportionnelle à l'équation du centre du soleil, on l'ajoute au moyen mouvement de la lune, lorsque la terre va de son aphélie au périhélie, & on la soustrait lorsqu'elle va en sens contraire. Or, supposant le rayon du grand orbe de mille parties & l'excentricité de la terre de 16 7/8, cette équation, lorsqu'elle sera la plus grande, ita suivant la théorie de la gravité à 11' 49"°; ce qui s'accorde, comme l'on voit, avec l'observation.
M. Newton ajoute que dans le périhélie de la terre les noeuds de la lune & son apogée se meuvent plus promtement que dans l'aphélie, & cela en raison triplée inverse de la distance de la terre au soleil, d'où proviennent des équations annuelles des mouvemens des noeuds proportionnelles à celui du centre du soleil ; or les mouvemens du soleil sont en raison doublée inverse de la distance de la terre au soleil, & la plus grande équation du centre que cette inégalité puisse produire est de 1° 56' 26", en supposant l'excentricité de 16 15/15 partie.
Si le mouvement du soleil étoit en raison triplée inverse de sa distance, cette inégalité donneroit pour plus grande équation 2° 56' 9", & par conséquent les plus grandes équations que puissent produire les inégalités des mouvemens de l'apogée de la lune & des noeuds, sont à 2° 56' 9", comme le mouvement diurne de l'apogée de la lune & le moyen mouvement diurne de ces noeuds sont au moyen mouvement diurne du soleil ; d'où il s'ensuit que la plus grande équation du moyen mouvement de l'apogée est d'environ 19' 52", & que la plus grande équation du moyen mouvement des noeuds est de 9' 27". On ajoute la premiere équation, & on soustrait la seconde, lorsque la terre va de son périhélie à son aphélie, & dans l'autre cas on fait le contraire.
Il paroît aussi par la même théorie de la gravité, que l'action du soleil sur la lune doit être un peu plus grande, quand l'axe transverse de l'orbite lunaire passe par le soleil, que lorsqu'il coupe à angles droits la droite qui joint la terre & le soleil, & que par conséquent l'orbite lunaire est un peu plus grande dans le premier cas que dans le second ; ce qui donne naissance à une autre équation du moyen mouvement de la lune, laquelle dépend de la situation de l'apogée de la lune par rapport au soleil, & devient la plus grande qui soit possible, lorsque l'apogée de la lune est à 45° du soleil ; & nulle, lorsque la lune arrive aux quadratures & aux syzygies. On l'ajoute au moyen mouvement, lorsque l'apogée de la lune passe des quadratures aux syzygies, & on l'en soustrait, lorsque l'apogée passe des syzygies aux quadratures.
Cette équation que M. Newton appelle semestre, devient de 3' 45", lorsqu'elle est la plus grande qui soit possible (c'est-à-dire à 45° de l'apogée) dans les moyennes distances de la terre au soleil ; mais elle augmente & diminue en raison triplée inverse de la distance du soleil ; ce qui fait que dans les plus grandes distances du soleil elle est environ de 3' 34", & dans la plus petite, de 3' 56"; mais lorsque l'apogée de la lune est hors des octans, c'est-à-dire a passé 45°, elle diminue alors, & elle est à la plus grande équation, comme le sinus de la distance double de l'apogée de la lune à la plus prochaine syzygie ou quadrature, est au rayon.
De la même théorie de la gravité il s'ensuit que l'action du soleil sur la lune, est un peu plus grande, lorsque la droite tirée par les noeuds de la lune, passe par le soleil, que lorsque cette ligne est à angles droits avec celle qui joint le soleil & la terre ; & de-là se déduit une autre équation du moyen mouvement de la lune, que M. Newton appelle seconde équation semestre, & qui devient la plus grande possible, lorsque les noeuds sont dans les octans du soleil, c'est-à-dire à 45°. du soleil ; & nulle, lorsqu'ils sont dans les syzygies ou quadratures. Dans d'autres situations des noeuds cette équation est proportionnelle au sinus du double de la distance de chaque noeud à la derniere syzygie ou quadrature. On l'ajoûte au moyen mouvement de la lune, lorsque les noeuds sont dans leur passage des quadratures du soleil à la plus prochaine syzygie, & on l'en soustrait dans leur passage des syzygies aux quadratures.
Lorsqu'elle est la plus grande qu'il est possible, c'est-à-dire dans les octans & dans la distance moyenne de la terre au soleil, elle monte à 45", selon qu'il paroît par la théorie de la gravité : à d'autres distances du soleil, cette équation dans les octans des noeuds est réciproquement comme le cube de la distance du soleil à la terre ; elle est par conséquent dans le périgée du soleil de 45", & dans son apogée, d'environ 49".
Suivant la même théorie de la gravité, l'apogée de la lune va le plus vîte, lorsqu'il est ou en conjonction ou en opposition avec le soleil, & il retrograde lorsqu'il est en quadrature avec lui. L'excentricité est dans le premier cas la plus grande possible, & dans le second, la plus petite possible. Ces inégalités sont très-considérables, & elles produisent la principale équation de l'apogée qui s'appelle semestre ou semimenstruelle. La plus grande équation semimenstruelle est d'environ 12' 18", suivant les observations.
Horrox a observé le premier que la lune faisoit à-peu-près sa révolution dans une ellipse dont la terre occupoit le foyer ; & Halley a mis le centre de l'ellipse dans une épicycle dont le centre tourne uniformément autour de la terre, & il déduit du mouvement dans l'épicycle les inégalités qu'on observe dans le progrès & la rétrogradation de l'apogée & la quantité de l'excentricité.
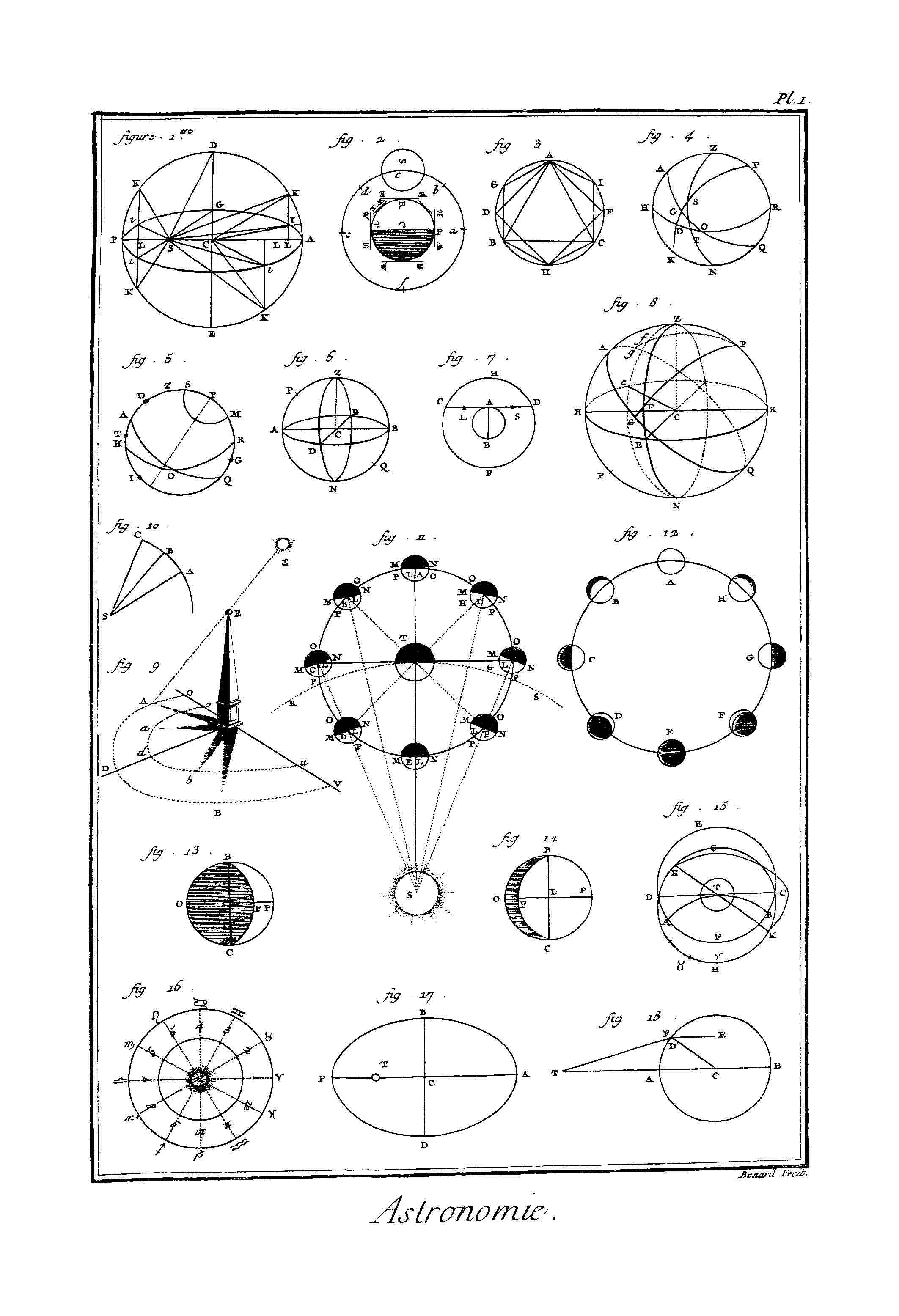
Supposons la moyenne distance de la lune à la terre divisée en 100000 parties, & que T (Pl. astronom. figure 18.) représente la terre, & T C, la moyenne excentricité de la lune de 5505 parties, qu'on prolonge T C en B, de façon que B C puisse être le sinus de la plus grande équation semimenstruelle ou de 11° 18' pour le rayon T C, le cercle B D A, décrit du centre C & d'un intervalle C B, sera l'épicycle dans lequel est placé le centre de l'orbite lunaire, & dans lequel il tourne selon l'ordre des lettres B D A. Prenez l'angle B C D égal au double de l'argument annuel, ou au double de la distance du vrai lieu du soleil à l'apogée de la lune corrigée une fois, & C T D sera l'équation semimenstruelle de l'apogée de la lune, & T D, l'excentricité de son orbite, en allant vers l'apogée ; d'où il s'ensuit qu'on peut trouver par les méthodes connues le moyen mouvement de la lune, son apogée & son excentricité, comme aussi le grand axe de son orbite de 200000 parties, son vrai lieu & sa distance de la terre. On peut voir dans les Principes mathématiques les corrections que M. Newton fait à ce calcul.
Voilà la théorie de la lune telle que M. Newton nous l'a donnée dans le troisieme livre de son bel ouvrage intitulé : Philosophiae naturalis principia mathematica : mais ce grand géometre n'a point démontré la plûpart des regles qu'il donne pour calculer le lieu de la lune. Dans le second volume de l'astronomie de Grégori, on trouve un autre ouvrage de M. Newton, qui a pour titre, Lunae theoria Newtoniana, & où il explique d'une maniere encore plus précise & plus particuliere les opérations qu'il faut faire pour trouver le lieu de la lune dans un tems donné, mais toujours sans démonstration : dans le commentaire que les PP. Le Sueur & Jacquier, Minimes, ont publié sur les principes de Newton, M. Calandrin, célebre professeur de mathématiques à Genève, & depuis l'un des principaux magistrats de la république, a commenté fort au-long toute cette théorie, & a tâché de développer la méthode que M. Newton a suivie ou pu suivre pour y parvenir : mais il avoue que sur certains points, comme le mouvement de l'apogée & l'excentricité, il y a encore quelque chose à desirer de plus précis & de plus exact que ne donne la théorie de M. Newton. Rien ne seroit plus utile que la connoissance des mouvemens de la lune pour la recherche des longitudes ; & c'est ce qui doit porter tous les Astronomes & les Géometres à perfectionner de plus en plus les tables qui doivent y servir. Voyez LONGITUDE, & la fin de cet article.
Au reste, quelles que soient les causes des irrégularités des mouvemens de la lune, les observations ont appris qu'après 223 lunaisons, c'est-à-dire 223 retours de la lune vers le soleil, les circonstances du mouvement de la lune redevenant les mêmes, par rapport au soleil & à la terre, ramenent dans son cours les mêmes irrégularités qu'on y avoit observées dix-huit ans auparavant. Une suite d'observations continuées pendant une telle période avec assez d'assiduité & d'exactitude, donnera donc le mouvement de la lune pour les périodes suivantes.
Ce travail si long & si pénible d'une période entiere bien remplie d'observations, fut entrepris par M. Halley, lorsqu'il étoit déja dans un âge si avancé, qu'il ne se flattoit plus de le pouvoir terminer. Ce grand & courageux astronome nous avertit que n'étant encore qu'à la fin d'une autre période qui ne contient que 111 lunaisons, & qui ne donne pas si exactement que celle de 223 le retour des mêmes inégalités, il pouvoit déja déterminer sur mer la longitude à 20 lieues près vers l'équateur, à 15 lieues près dans nos climats, & plus exactement encore plus près des poles.
Mais on n'aura rien à desirer, & on aura l'ouvrage le plus utile qu'on puisse espérer sur cette matiere, si le travail qu'a entrepris M. Lemonnier s'accomplit. Depuis qu'il s'est attaché à la théorie de la lune, il a fait un si grand nombre d'excellentes observations, qu'on ne sauroit espérer de voir cette partie de la période mieux remplie : & dans les institutions astronomiques qu'il a publiées en 1746, il a déja donné d'après la théorie de M. Newton, des tables du mouvement de la lune, plus exactes & plus complete s qu'aucune de celles qu'on a publiées jusqu'ici.
A la fin de ce même ouvrage, il donne la maniere de se servir de ces tables, & de calculer par leur secours quelques lieux de la lune. Nous parlerons à la fin de cet article de la suite de ses travaux par rapport à cet objet.
Nature & propriétés de la lune.
1°. De ce que la lune ne montre qu'une petite partie de son disque, lorsqu'elle suit le soleil prêt à se coucher ; de ce que cette portion croit à mesure qu'elle s'éloigne du soleil jusqu'à la distance de 180d où elle est pleine, qu'elle diminue au contraire à mesure que l'astre s'approche du soleil, & qu'elle perd toute sa lumiere lorsqu'elle l'a atteint ; de ce que sa partie lumineuse est constamment tournée vers l'occident lorsqu'elle est dans son croissant, & vers l'orient quand elle est dans son décours ; de tout cela il suit évidemment qu'elle n'a d'éclairée que la seule partie sur laquelle tombent les rayons du soleil ; enfin des phénomenes des éclipses qui n'arrivent que lorsque la lune est pleine, c'est-à-dire lorsqu'elle est éloignée de 180d du soleil, on doit conclure qu'elle n'a point de lumiere propre, mais qu'elle emprunte du soleil toute celle qu'elle nous envoie. Voyez PHASE, ÉCLIPSE.
2°. La lune disparoît quelquefois par un ciel clair, serein, de façon qu'on ne sauroit la découvrir avec les meilleurs verres, quoique des étoiles de la 5e & 6e grandeur restent toûjours visibles. Kepler a observé deux fois ce phénomene en 1581 & 1583 ; & Hévelius en 1620 ; Riccioli, d'autres jésuites de Boulogne, & beaucoup d'autres personnes dans la Hollande observerent la même chose le 14 Avril 1642, quoique cependant la lune fût restée toûjours visible à Venise & à Vienne. Le 23 Décembre 1703, il y eut une autre disparition totale, la lune parut d'abord à Arles d'un brun jaunâtre, & à Avignon elle parut rougeâtre & transparente, comme si le soleil avoit brillé au-travers ; à Marseille un des côtés parut rougeâtre, & l'autre fort obscur ; & à la fin, elle disparut entierement, quoique par un tems serein. Il est évident dans ce phénomene que ces couleurs qui paroissoient différentes dans un même tems, n'appartenoient pas à la lune, mais qu'elles provenoient de quelque matiere qui l'entouroit & qui se trouvoit différemment disposée pour donner passage à des rayons de telle ou telle couleur.
3°. L'oeil nud ou armé d'un télescope, voit dans la face de la lune des parties plus obscures que d'autres, qu'on appelle maculae ou taches. A travers le télescope, les bornes de la lumiere paroissent dentelées & inégales, composées d'arcs dissemblables, convexes & concaves. On observe aussi des parties lucides, dispersées ou semées parmi de plus obscures, & on voit des parties illuminées par-delà les limites de l'illumination ; d'autres intermédiaires, restant toûjours dans l'obscurité & auprès des taches, ou même dans les taches : on voit souvent de ces petites taches lumineuses. Outre les taches qu'avoient observées les anciens, il en est d'autres variables, invisibles à l'oeil nud, qu'on nomme taches nouvelles, qui sont toûjours opposées au soleil, & qui se trouvent par cette raison dans les parties qui sont le plûtôt éclairées dans le croissant, & qui perdent dans le décours leur lumiere plus tard que les autres intermédiaires, tournant autour de la lune, & paroissant quelquefois plus grandes & quelquefois plus petites. Voyez TACHES.
Or, comme toutes les parties de la surface de la lune sont également illuminées par le soleil, puisqu'elles en sont également éloignées ; il s'ensuit delà que s'il y en a qui paroissent plus brillantes, & d'autres plus obscures, c'est qu'il en est qui réfléchissent les rayons du soleil plus abondamment que d'autres, & par conséquent qu'elles sont de différente nature : les parties qui sont le plûtôt éclairées par le soleil, sont nécessairement plus élevées que les autres, c'est-à- dire qu'elles sont au-dessus du reste de la surface de la lune. Les nouvelles taches répondent parfaitement aux ombres des corps terrestres.
4°. Hévelius rapporte qu'il a souvent trouvé dans un tems très-serein, lors même que l'on pouvoit voir les étoiles de la 6e & de la 7e grandeur, qu'à la même hauteur & à la même élongation de la terre, & avec le même télescope qui étoit excellent, la lune & ses taches n'étoient pas toujours également lumineuses, claires & visibles, mais qu'elles étoient plus brillantes, plus pures & plus distinctes dans un tems que dans un autre. Or, par les circonstances de cette observation, il est évident qu'il ne faut point chercher la raison de ce phénomene, ni dans notre air, ni dans la lune, ni dans l'oeil du spectateur, mais dans quelqu'autre chose qui environne le corps de la lune.
5°. Cassini a souvent observé que Saturne, Jupiter & les étoiles fixes, lorsqu'elles se cachoient derriere la lune, paroissoient près de son limbe, soit éclairé, soit obscur, changer leur figure circulaire en ovale ; & dans d'autres occultations, il n'a point trouvé du tout d'altération ; il arrive de même que le soleil & la lune se levant & se couchant dans un horison vaporeux ne paroissent plus circulaires, mais elliptiques.
Or, comme nous savons par une expérience certaine que la figure circulaire du soleil & de la lune ne se changent en elliptique qu'à cause de la réfraction que les rayons de ces astres souffrent dans l'athmosphere, il est donc permis d'en conclure que dans les tems où la figure presque circulaire des étoiles est changée par la lune, cet astre est alors entouré d'une matiere dense qui réfracte les rayons que les étoiles envoient ; & que si dans d'autres tems on n'observe point ce changement de figure, cette même matiere ne se trouve plus autour de la lune. Voyez ATHMOSPHERE.
6°. La lune est donc un corps opaque, couvert de montagnes & de vallées. Riccioli a mesuré la hauteur d'une de ces montagnes, & a trouvé qu'elle avoit neuf milles, ou environ 3 lieues de haut. Il y a de plus dans la lune de grands espaces, dont la surface est unie & égale, & qui réfléchissent en même tems moins de lumiere que les autres. Or, comme la surface des corps fluides est naturellement unie, & que ces corps entant que transparens transmettent une grande partie de la lumiere, & n'en réfléchissent que fort peu, plusieurs astronomes ont conclu de-là que les taches de la lune sont des corps fluides transparens, & que lorsqu'elles sont fort étendues, ce sont des mers. Il y a donc dans la lune des montagnes, des vallées & des mers. De plus, les parties lumineuses des taches doivent être par la même raison des îles & des péninsules. Et puisque dans les taches & près de leur limbe on remarque certaines parties plus hautes que d'autres, il faut donc qu'il y ait dans les mers de la lune des rochers & des promontoires.
Il faut avouer cependant que d'autres astronomes ont prétendu qu'il n'y avoit point de mers dans la lune ; car si on regarde, disent-ils, avec un bon télescope les grandes taches que l'on prend pour des mers, on y remarque une infinité de cavernes ou de cavités très-profondes, ce qui s'apperçoit principalement par le moyen des ombres qui sont jettées au-dedans lorsque la lune croît, ou lorsqu'elle est en décours. Or c'est, ajoutent-ils, ce qui ne paroît guere convenir à des mers d'une vaste étendue. Ainsi ils croient que ces régions de la lune ne sont point des mers, mais qu'elles sont d'une matiere moins dure & moins blanche que les autres contrées des pays montueux.
7°. La lune est entourée, selon plusieurs astronomes, d'un athmosphere pesant & élastique, dans lequel les vapeurs & les exhalaisons s'élevent pour retomber ensuite en forme de rosée ou de pluie.
Dans une éclipse totale du soleil, on voit la lune couronnée d'un anneau lumineux parallele à sa circonférence.
Selon ces astronomes, on en a trop d'observations pour en douter. Dans la grande éclipse de 1715, on vit l'anneau à Londres, & par-tout ailleurs ; Kepler a observé qu'on a vu la même chose à Naples & à Anvers dans une éclipse de 1605 ; & Wolf l'a observé aussi à Leipsick dans une de 1706, décrite fort au long dans les acta eruditorum, avec cette circonstance remarquable que la partie la plus voisine de la lune étoit visiblement plus brillante que celle qui en étoit plus éloignée, ce qui est confirmé par les observations des astronomes françois dans les mémoires de l'Académie de l'année 1706.
Il faut donc, concluent-ils, qu'il y ait autour de la lune quelque fluide dont la figure corresponde à celle de cet astre, & qui tout-à-la-fois réfléchisse & brise les rayons du soleil ; il faut aussi que ce fluide soit plus dense près du corps de la lune, & plus rare au-dessus ; or comme l'air qui environne notre terre est un fluide de cette espece, on peut conclure de-là que la lune doit avoir son air ; & puisque la différente densité de notre air dépend de sa différente gravité & élasticité, il faut donc aussi attribuer la différente densité de l'air lunaire à la même cause. Nous avons de plus observé que l'air lunaire n'est pas toujours également transparent, qu'il change quelquefois les figures sphériques des étoiles en ovales, & que dans quelques-unes des éclipses totales dont nous avons parlé, on a apperçu immédiatement avant l'immersion un tremblement dans le limbe de la lune avec une apparence d'une fumée claire & légere qui se tenoit suspendue au-dessus durant l'immersion, & qui s'est fait fort remarquer en particulier en Angleterre ; & comme ces mêmes phénomenes s'observent aussi dans notre air quand il est plein de vapeur, il est donc presque sûr que lorsqu'on les observe dans l'athmosphere de la lune, cette athmosphere doit être alors pleine de vapeurs & d'exhalaisons : enfin puisque dans d'autres tems l'air de la lune est clair & transparent, & qu'il ne produit aucun de ces phénomenes, il s'ensuit aussi que les vapeurs ont été alors précipitées sur la lune, & qu'il faut par conséquent qu'il soit tombé sur cet astre de la rosée, de la pluie ou de la neige.
Cependant d'autres astronomes prétendent que quand des étoiles s'approchent de la lune, elles ne paroissent souffrir aucune réfraction, ce qui prouveroit que la lune n'a point d'athmosphere, du-moins telle que notre terre. Ils ajoutent qu'il y a beaucoup d'apparence que sur la lune il n'y a jamais de nuages, ni de pluies. Car s'il s'y trouvoit des nuages, on les verroit, disent-ils, se répandre indifféremment sur toutes les régions du disque apparent, ensorte que ces mêmes régions nous seroient souvent cachées : or c'est ce qu'on n'a point observé. Il faut donc que le ciel de la lune soit parfaitement serein. Cependant les nuages pourroient se trouver dans la partie de l'athmosphere qui n'est point éclairée du soleil : car la chaleur qui est très-grande dans la partie éclairée, l'unique hémisphere qu'il nous est permis d'appercevoir, cette chaleur, dis-je, excitée par les rayons du soleil qui éclairent sans discontinuer ces régions de la lune pendant près de quinze fois 24 heures, suffit, ce semble, pour raréfier l'athmosphere de la lune. De plus, au sujet de cette athmosphere, M. le Monnier dit avoir remarqué en 1736 & 1738, que l'étoile Aldebaran s'avançoit en plein jour un peu sur le disque éclairé de la lune, où cette même étoile disparut ensuite après avoir entamé très-sensiblement le disque, & cela vers le diametre horisontal de la lune.
8°. La lune est donc à tous égards un corps semblable à la terre, & qui paroît propre aux mêmes fins ; en effet, nous avons fait voir qu'elle est dense, opaque, qu'elle a des montagnes & des vallées ; selon plusieurs auteurs, elle a des mers avec des îles, des péninsules, des rochers & des promontoires, une athmosphere changeante où les vapeurs & les exhalaisons peuvent s'élever pour y retomber ensuite ; enfin elle a un jour & une nuit, un soleil pour éclairer l'un, & une lune pour éclairer l'autre, un été & un hiver, &c.
On peut encore conclure de-là par analogie une infinité d'autres propriétés dans la lune. Les changemens auxquels son athmosphere est sujette, doivent produire des vents & d'autres météores, &, suivant les différentes saisons de l'année, des pluies, des brouillards, de la gelée, de la neige, &c. Les inégalités de la surface de la lune doivent produire de leur côté des lacs, des rivieres, des sources, &c.
Or comme nous savons que la nature ne produit rien en vain, que les pluies & les rosées tombent sur notre terre pour faire végéter les plantes, & que les plantes prennent racine, croissent & produisent des semences pour nourrir des animaux ; comme nous savons d'ailleurs que la nature est uniforme & constante dans ses procédés, que les mêmes choses servent aux mêmes fins : pourquoi ne conclurions-nous donc pas qu'il y a des plantes & des animaux dans la lune ? A quoi bon sans cela cet appareil de provisions qui paroît si bien leur être destiné ? Ces preuves recevront une nouvelle force, quand nous ferons voir que notre terre est elle-même une planete, & que si on la voyoit des autres planetes, elle paroîtroit dans l'une semblable à la lune, dans d'autres à Vénus, dans d'autres à Jupiter, &c. En effet, cette ressemblance, soit optique, soit physique, entre les différentes planetes, fournit une présomption bien forte qu'il s'y trouve les mêmes choses. Voyez TERRE & PLANETE.
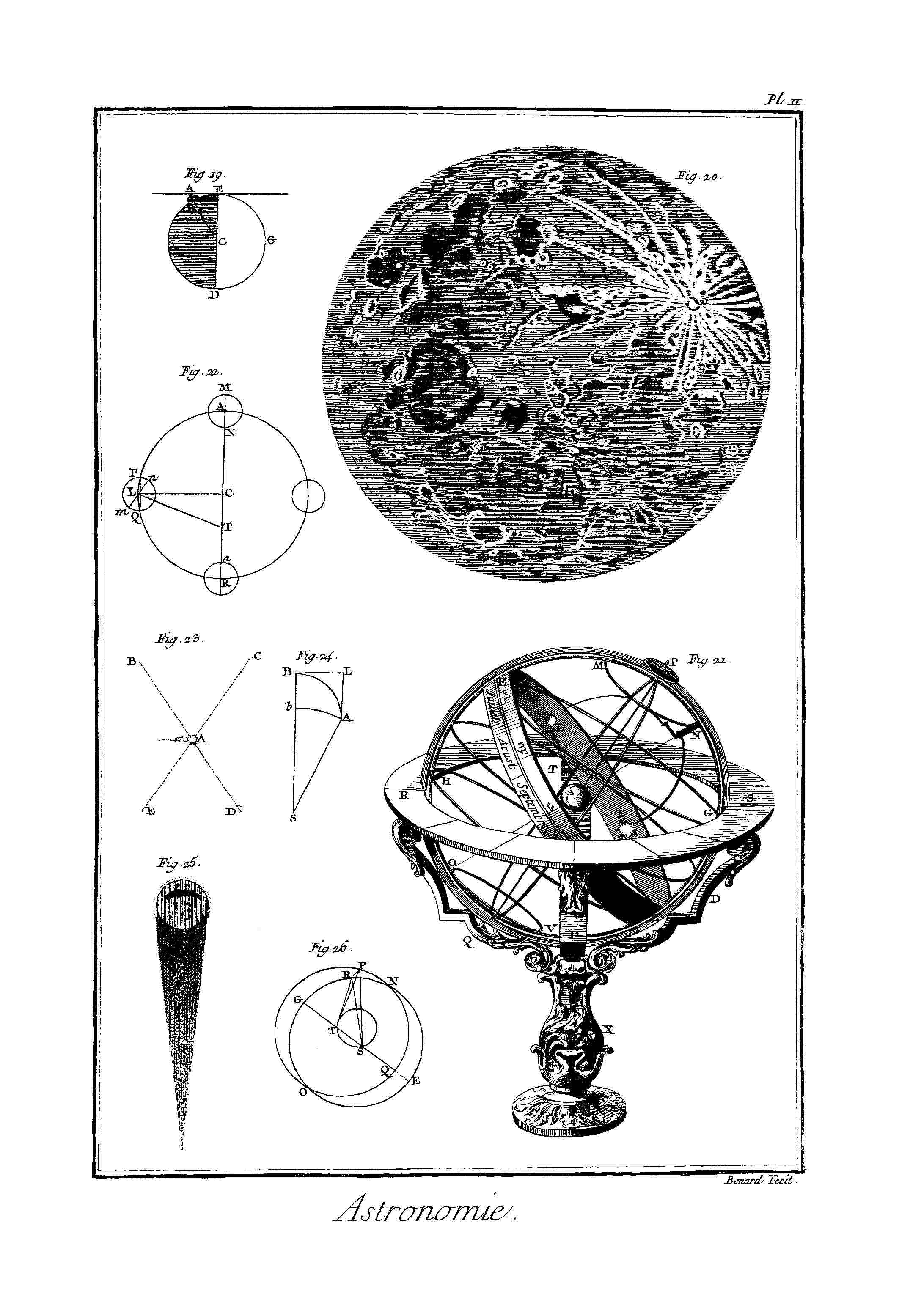
Moyen de mesurer la hauteur des montagnes de la lune. Soit E D, fig. 19. le diametre de la lune, E C D le terme de la lumiere & de l'ombre, & A le sommet d'une montagne situé dans la partie obscure, lequel commence à être éclairé ; observez avec un télescope le rapport que A E, c'est -à-dire la distance du point A à la ligne où la lumiere commence, aura avec le diametre E D, & vous aurez par-là deux côtés d'un triangle rectangle, savoir A E, C E, dont les quarrés étant ajoutés ensemble, donneront le quarré du 3e, voyez HYPOTHENUSE ; vous soustrairez de ce 3e côté le rayon C E, & il restera A B hauteur de la montagne. Riccioli a distingué les différentes parties de la lune par les noms des plus célebres savans, & c'est par ces noms qu'on les marque toujours dans les observations des éclipses de lune, &c. Voyez en la figure, Pl. astron. fig. 20.
Parmi les autres observateurs qui ont tâché de représenter la figure de la lune, telle qu'on l'apperçoit avec des lunettes ordinaires, on compte principalement Langrenus, Hevelius & Grimaldi. Ils ont surtout représenté dans leur sénélographie, ou description de la lune, les plus belles taches. Hevelius qui appréhendoit les guerres civiles qui se seroient élevées entre les Philosophes modernes, si on donnoit leurs noms aux taches de la lune, au lieu de leur distribuer tout ce domaine, comme il se l'étoit proposé, jugea à propos d'y appliquer des noms de notre Géographie. Il est vrai que ces taches ne ressemblent guere, tant par rapport à leurs situations qu'à leurs figures, aux mers & aux continens de notre terre, dont ils portent le nom ; cependant on a recommandé jusqu'ici aux Astronomes, ces noms géographiques, qui ne sauroient leur devenir trop familiers, principalement à ceux qui veulent étudier dans Ptolémée la Géographie ancienne.
M. le Monnier prétend que toutes les figures de la lune qui ont été publiées jusqu'ici, celles qui ont été gravées en 1635 par le fameux D. Mellan, par ordre de Peiresc, sur les observations de Gassendi, & qui consiste en trois phases (dont l'une représente la pleine lune, & les deux autres le premier quartier & le décours), sont sans contredit les meilleures & les plus ressemblantes. Quoiqu'il n'y ait pas plus de vingt ans qu'elles sont devenues publiques, ces mêmes phases sont néanmoins les plus anciennes, puisqu'elles ont précédé celles d'Hevelius & de Riccioli, qui sont celles qu'on a le plus imitées, & dont les Astronomes ont le plus fait d'usage jusqu'à ce jour.
M. le Monnier a donné dans ses institutions astronomiques, pag. 140, trois différentes figures ou phases de la lune. La premiere est celle qu'Hevelius a publiée en 1645, avec les termes de la plus grande & de la plus petite libration ; la seconde a été publiée pour la premiere fois dans les mém. de l'académie royale des Sciences, pour l'année 1692 ; les termes de la plus grande & de la plus petite libration n'y sont point marqués, mais seulement la libration moyenne, c'est-à-dire les termes entre la plus grande & la plus petite. La troisieme table que donne M. le Monnier est celle des PP. Grimaldi & Riccioli, avec la plus grande & la plus petite libration. Ces trois figures du disque de la lune sont assez différentes entr'elles.
On a attribué autrefois beaucoup de puissance à la lune sur les corps terrestres, & plusieurs personnes sont encore dans cette opinion, que les Philosophes regardent comme chimérique. Cependant si on examine la chose avec attention, il ne doit point paroître impossible que la lune ne puisse avoir beaucoup d'influence sur l'air que nous respirons & les différens effets que nous observons. Il est certain que le soleil & la lune sur-tout, agissent sur l'Océan, & en causent le flux & le reflux. Or si l'action de ces astres est si sensible sur la masse des eaux, pourquoi ne le sera-t-elle pas sur l'athmosphere qui les couvre ? Pourquoi ne causera-t-elle pas dans cette athmosphere des mouvemens & des altérations sensibles ? Il est vrai que le vulgaire tombe dans beaucoup d'erreurs à ce sujet, & nous ne prétendons point adopter tous les préjugés sur la nouvelle lune, sur les effets de la lune, tant en croissant ou en décours, sur les remedes qu'il faut faire quand la lune est dans certains signes du zodiaque ; mais nous croyons pouvoir dire que plusieurs vents, par exemple, & les effets qui en résultent, peuvent être attribués très-vraisemblablement à l'action de la lune ; que par son action sur l'air que nous respirons, elle peut changer la disposition de nos corps, & occasionner des maladies : il est vrai que comme les dérangemens qui arrivent dans l'athmosphere ont encore une infinité d'autres causes dont la loi ne paroît point réglée, les effets particuliers de la lune se trouvant mêlés & combinés avec une infinité d'autres, sont par cette raison très-difficiles à connoître & à distinguer ; mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient réels, & dignes de l'observation des Philosophes. Le docteur Mead, célebre médecin anglois, a fait un livre qui a pour titre, de imperio solis ac lunae in corpore humano, de l'empire du soleil & de la lune sur les corps humains.
Jusqu'ici nous n'avons presque fait que traduire l'article lune tel qu'il se trouve à-peu-près dans l'encyclopédie angloise, & nous y avons joint quelques remarques tirées de différens auteurs, entr'autres des institutions astronomiques de M. le Monnier. Il s'agit à présent d'entrer dans le détail de ce que les savans de notre siecle ont ajouté à la théorie de M. Newton.
Ce qu'on a lû jusqu'ici dans cet article contient les phénomenes du mouvement de la lune, tels à peu-près que les observations les ont fait connoître successivement aux Astronomes, & tels que M. Newton a tenté de les expliquer : nous disons a tenté, car quelque estimable que soit l'essai de théorie que ce grand homme nous a donné sur ce sujet, on a dû voir, par ce qui précede, que cet essai laisse encore beaucoup à desirer ; la raison en est que M. Newton n'avoit point résolu le problème fondamental, nécessaire pour trouver les différentes irrégularités de la lune ; ce problème consiste à déterminer au moins par approximation, l'équation de l'orbite que la lune décrit autour de la terre ; c'est une branche du problème fameux connu sous le nom du problème des trois corps. Voyez PROBLEME DES TROIS CORPS.
La lune est attirée vers la terre en raison inverse du quarré de la distance, suivant la loi générale de la gravitation (voyez GRAVITATION), & en même tems elle est attirée par le soleil ; mais comme la terre est aussi attirée par ce dernier astre, & qu'il s'agit ici non du mouvement absolu de la lune, mais de son mouvement par rapport à la terre, il faut transporter à la lune en sens contraire, l'action du soleil sur la terre, ainsi que la force avec laquelle la lune agit sur la terre (voyez les mém. de l'académie de 1745, pag. 365.) ; & en combinant ces différentes actions avec la force de gravitation de la lune vers la terre, il en résultera deux forces, l'une dirigée vers la terre, l'autre perpendiculaire au rayon vecteur. La force dirigée vers la terre est composée de deux parties, dont l'une est la force d'attraction de la lune vers la terre, & l'autre est très-petite par rapport à celle-là, & dépendante de celle du soleil. Il s'agit donc de trouver l'équation de la courbe, que la lune décrit en vertu de ces forces, & son intégration approchée ; or c'est ce que M. Euler, M. Clairaut & moi, avons trouvé en 1747 par différentes méthodes, qui toutes s'accordent quant au résultat. Je donnerai au mot PROBLEME DES TROIS CORPS, une idée de la mienne, qui me paroît la plus simple de toutes ; mais quelque jugement qu'on en porte, il est certain que les trois méthodes conduisent exactement aux mêmes conclusions. La seule difficulté est dans la longueur peut-être du calcul. On peut en voir la preuve dans les ouvrages que Messieurs Euler, Clairaut & moi, avons publiés sur ce sujet. Celui de M. Euler a pour titre Theoria motûs lunae ; celui de M. Clairaut est la piece qui a remporté le prix à Petersbourg en 1751, & le mien est intitulé Recherches sur différens points importans du système du monde.
M. Euler est le premier qui ait imaginé de donner aux tables de la lune une nouvelle forme différente de celle de M. Newton ; au lieu de faire varier l'équation du centre, il regarde l'excentricité comme constante, & il ajoute à l'équation du centre une autre équation qu'on peut appeller évection (voyez EVECTION), & qui fait à peu-près le même effet que la variation supposée par M. Newton à l'excentricité, & au mouvement de l'apogée. M. Euler a publié le premier des tables suivant cette nouvelle forme, & dans lesquelles il a fait encore quelques autres changemens à la forme des tables de M. Newton ; on peut voir sur cela le premier volume de ses opuscules, Berlin 1746 : mais ses tables très-commodes & très- expéditives pour le calcul, avoient le défaut de n'être pas assez exactes. M. Mayer, célebre astronome de Gottingue, a perfectionné ces mêmes tables, en suivant la théorie de M. Euler, & en la corrigeant par les observations ; du reste il a conservé la forme donnée par M. Euler aux tables de la lune, & il l'a même encore simplifiée ; par ce moyen il a formé de nouvelles tables, qui ont paru en 1753, dans le second volume des mém, de l'acad. de Gottingue, & qui ont l'avantage d'être jusqu'ici les plus commodes & les plus exactes que l'on connoisse ; aussi l'académie royale des Sciences de Paris les a-t- elles adoptées par préférence à toutes les autres, dans la connoissance des tems pour l'année 1760 ; cependant malgré toutes les raisons qu'on a de croire les tables de M. Mayer plus exactes que les autres, il est nécessaire, pour n'avoir aucun doute là-dessus, de les comparer à un plus grand nombre d'observations ; & j'ai exposé dans la troisieme partie de mes recherches sur le système du monde, les doutes qu'on pourroit encore former sur l'exactitude de ces mêmes tables, ou du-moins les raisons de suspendre son jugement à cet égard, jusqu'à ce qu'on en ait fait une plus longue épreuve.
M. Clairaut & moi avons aussi publié des tables de la lune suivant notre théorie ; celles de M. Clairaut, qui sont moins exactes que celles de M. Mayer, ont encore l'inconvénient de demander beaucoup plus de tems pour le calcul, parce qu'elles renferment un très-grand nombre d'équations. On assure que M. Clairaut a depuis ce tems perfectionné & simplifié beaucoup ces mêmes tables, mais il n'a encore rien publié de son travail dans le moment où nous écrivons ceci (le 15 Nov. 1759). Pour moi je me suis presque borné à donner d'après ma théorie, des tables de correction pour celle des institutions astronomiques ; mais j'ai reconnu depuis par la comparaison avec les observations & avec les meilleures tables, que ces tables de correction pourroient être perfectionnées à plusieurs égards ; non-seulement je les ai perfectionnées, mais j'ai plus fait, j'ai dressé des tables de la lune entierement nouvelles, dont le calcul est très-expéditif, & qui, je crois, répondront assez exactement aux observations. Je n'en dirai pas davantage ici, parce que ces tables auront probablement vû le jour avant que cet article paroisse.
Ces nouvelles tables sont dressées en partie sur les calculs que j'ai faits par théorie, en partie sur la comparaison que j'ai faite de mes premieres tables avec celles de Messieurs le Monnier & Mayer, qui ont été comparées jusqu'ici à un plus grand nombre d'observations que les autres, & qui ont l'avantage de s'en écarter peu, & d'être d'ailleurs les plus expéditives pour le calcul, & les plus familieres aux Astronomes. La raison qui m'a déterminé à ne pas dresser mes tables uniquement d'après la théorie, c'est l'épreuve que j'ai faite par mes propres calculs, & par ceux des autres, de la plûpart des coefficiens des équations lunaires, dont on ne peut, ce me semble, assurer qu'aucun soit exact à une minute près, peut- être davantage. Cet inconvénient vient 1°. de ce que le nombre de petits termes & de petites quantités qui entrent dans chacun de ces coefficiens est si grand, qu'on n'est jamais assuré de n'en avoir point omis que puisse produire d'effet sensible. 2°. De ce que plusieurs des series qui expriment les coefficiens sont assez peu convergentes. 3°. Enfin de ce qu'il y a des termes qui étant très-petits dans la différencielle, peuvent devenir très-grands, ou au moins beaucoup plus grands par l'intégration. On peut voir les preuves de tout cela dans mes recherches sur le système du monde, premiere & troisieme parties, & dans un écrit inséré à la fin de la seconde édition de mon traité de dynamique, en réponse à quelques objections qui m'avoient été faites sur ce sujet.
Une des preuves les plus frappantes de ce que j'avance ici sur l'incertitude des coefficiens des équations lunaires, c'est l'erreur où nous avons été longtems Messieurs Euler, Clairaut & moi, sur le mouvement de l'apogée de la lune. Nous nous étions bornés tous trois à calculer d'abord le premier terme de la serie qui exprime ce mouvement, nous avons trouvé que ce terme ne donnoit que la moitié du mouvement réel de l'apogée, parce que nous supposions tacitement que le reste de la serie pouvoit se négliger par rapport au premier terme ; de-là M. Clairaut avoit conclu que la gravitation n'étoit pas la raison inverse du quarré des distances, mais qu'elle suivoit quelqu'autre loi ; en quoi il faut avouer que sa conclusion a été trop précipitée, puisque quand même le mouvement de l'apogée trouvé par la théorie ne seroit que la moitié de ce qu'il est réellement, on pourroit sans changer la loi d'attraction & y substituer une loi bizarre, attribuer cet effet comme je l'avois imaginé, à quelque cause particuliere différente de la gravitation, comme à la force magnétique, dont M. Newton fait mention expressément. On peut voir dans les mém. de l'acad. des Sciences de 1745, la dispute de Messieurs Clairaut & de Buffon sur ce sujet. On peut aussi consulter l'article ATTRACTION, & mes recherches sur le système du monde, premiere partie, art. 173. Quoi qu'il en soit, M. Clairaut s'apperçut le premier de l'erreur commune à nos calculs, & me communiqua la remarque qu'il en avoit faite ; on peut en voir le détail dans mes recherches sur le système du monde, art. 107 & suivans. Il m'apprit qu'ayant voulu calculer le second terme de la serie du mouvement de l'apogée, pour connoître à très-peu près ce que le fond de la gravitation donnoit pour le mouvement, il lui étoit venu un second terme qui n'étoit pas fort différent du premier, ce qui rendoit à la gravitation tout son effet pour produire le mouvement entier de l'apogée. Cette remarque, il faut l'avouer, étoit très-forte en faveur de la gravitation ; cependant il est évident qu'elle ne suffit pas encore pour décider la question ; car puisque les deux premiers termes de la serie étoient presqu'égaux, le troisieme pouvoit l'être encore aux deux premiers ; & en ce cas, selon le signe de ce troisieme terme, on auroit trouvé le mouvement de l'apogée beaucoup plus grand ou beaucoup plus court qu'il ne falloit pour la théorie de la gravitation. Il étoit donc absolument nécessaire de calculer ce troisieme terme, & même quelques-uns des suivans, pour s'assurer si la théorie de la gravitation répondoit en effet aux phénomenes ; car jusques-là, je le répete, il n'y avoit encore rien de décidé. J'entrepris donc ce calcul, que jusqu'ici aucun autre géometre n'a fait encore. J'en ai donné le résultat dans mes recherches sur le système du monde, au chap. xx. de la premiere partie, & il en résulte que le mouvement de l'apogée trouvé par la théorie, est tel que les observations le donnent. Voilà ce que l'Astronomie doit à M. Clairaut & à moi sur cette importante matiere.
Une autre remarque qui m'est entierement dûe, & que je communiquai à M. Clairaut au mois de Juin 1748, c'est le calcul des termes, qui dans l'équation de l'orbite lunaire ont pour argument la distance du soleil à l'apogée de la lune. M. Clairaut croyoit alors, faute d'avoir calculé tous les termes essentiels qui entrent dans cette équation, qu'elle montoit à environ 35 ou 40 minutes ; ce qui, comme M. Clairaut le croyoit alors, renversoit entierement la théorie & le système newtonien ; je lui fis voir que cette équation étoit beaucoup moindre, & de deux à trois minutes seulement ; ce qui rétablissoit la théorie dans tous ses droits.
Je ne dois pas oublier d'ajouter 1°. que ma méthode pour déterminer le mouvement de l'apogée, est très-élégante & très-simple, n'ayant besoin d'aucune intégration, & ne demandant que la simple inspection des coefficiens du second terme de l'équation différencielle ; 2°. que j'ai démontré le premier par une méthode rigoureuse, ce que personne n'avoit encore fait, & n'a même fait jusqu'ici, que l'équation de l'orbite lunaire ne devoit point contenir d'arcs de cercle ; si on ajoute à cela la maniere simple & facile dont je parviens à l'équation différentielle de l'orbite lunaire, sans avoir besoin pour cela, comme d'autres géometres, de transformations & d'intégrations multipliées ; & le détail que j'ai donné ci-dessus de mes travaux & de ceux des autres géometres, on conviendra, ce me semble, que j'ai eu plus de part à la théorie de la lune que certains mathématiciens n'avoient voulu le faire croire. Je ne dois pas non plus passer sous silence la maniere élégante dont M. Euler integre l'équation de l'orbite lunaire ; méthode plus simple & plus facile que celle de M. Clairaut & que la mienne ; & cette observation jointe à ce que j'ai dit plus haut des travaux de ce grand géometre, par rapport à la lune, suffira pour faire voir qu'il a aussi travaillé très-utilement à cette théorie, quoiqu'on ait aussi cherché à le mettre à l'écart autant qu'on l'a pû. L'Encyclopédie faite pour transmettre à la postérité l'histoire des découvertes de notre siecle, doit par cette raison rendre justice à tout le monde ; & c'est ce que nous croyons avoir fait dans cet article. Comme ce manuscrit est prêt à sortir de nos mains pour n'y rentrer peut être jamais, nous ajouterons par la suite dans les supplémens de l'Encyclopédie ce qui aura été ajouté à la théorie de la lune, depuis le mois de Novembre 1759, où nous écrivons cet article.
Nous avons dit plus haut que M. Halley avoit commencé l'observation d'une période de deux cent vingt-trois lunaisons, & que M. le Monnier avoit continué ce travail ; le public en a déja recueilli le fruit, M. le Monnier ayant publié deux volumes de ses observations, qui serviront à connoître l'erreur des tables ; il continue ce travail avec ardeur & avec assiduité ; & il espere publier successivement le résultat de ses observations à la fin de chaque période ; au reste il ne faut pas croire, comme je l'ai remarqué & prouvé ce me semble le premier dans mes recherches sur le système du monde, troisieme partie, qu'au bout de la période de deux cent vingt-trois lunaisons, les inégalités reviennent exactement les mêmes, mais la différence n'est pas bien considérable, & au moyen d'une méthode facile que j'ai indiquée, on peut déterminer assez exactement l'erreur des tables pour chaque lieu calculé de la lune. Voyez l'article xxxj. de l'ouvrage cité.
Pour achever de rendre compte des travaux des Géometres de notre siecle sur la lune, il ne nous reste plus qu'à parler de leurs recherches sur la masse de cette planete. M. Newton, par quelques phénomenes des marées, avoit essayé de la déterminer. Voyez FLUX & REFLUX. M. Daniel Bernoulli a depuis corrigé ce calcul ; enfin par une théorie de la précession des équinoxes & de la nutation, j'ai déterminé la masse de la lune d'environ un 1/75 de celle de la terre ; c'est-à-dire environ la moitié de ce qu'avoit trouvé M. Newton ; ce calcul est fondé sur ce que la nutation de l'axe de la terre vient presqu'uniquement de la force lunaire, & qu'au contraire la précession vient de la force lunaire & de la force solaire réunies ; d'où il s'ensuit qu'on trouvera le rapport des deux forces, en comparant la quantité observée de la nutation avec la quantité observée de la précession. Or le rapport des forces étant connu, on en déduit aisément la masse de la lune. Voyez mes recherches sur la précession des équinoxes, 1749, & la seconde partie de mes recherches sur le système du monde, liv. III. art. iij. voyez aussi les articles NUTATION & PRECESSION.
J'ajouterai ici que dans l'hypothese de la non-sphéricité de la lune, la terre & le soleil doivent produire dans l'axe de cette planete un mouvement analogue à celui que l'action de la lune & du soleil produisent dans l'axe de la terre, & d'où résulte la précession des équinoxes ; sur quoi voyez mes recherches sur le système du monde seconde partie, articles cccxliij. & suiv. voyez aussi l'article LIBRATION. Au reste, si les diametres de la lune sont inégaux, leur inégalité est très-peu sensible par les observations, comme je l'ai prouvé dans les mêmes recherches, seconde partie, art. ccclxxvj. & suiv. (O)
|
| LUNE | (Chimie) nom que les Chimistes donnent à l'argent. Voyez ARGENT.
|
| LUNE | crystaux de, (Chimie) c'est ainsi que s'appelle le sel qui résulte de l'union de l'acide nitreux & de l'argent. Les crystaux de lune fondus & moulés dans une lingotiere, fournissent la pierre infernale des Chirurgiens. Voyez PIERRE INFERNALE. (b)
|
| LUNE | (Hist. nat. Chimie, Métallurgie & Minéralogie) luna chimicorum ; c'est le nom sous lequel un grand nombre de Chimistes ont désigné l'argent. Comme dans l'article ARGENT, contenu dans le premier volume de ce Dictionnaire, on n'est point entré dans tous les détails nécessaires pour faire connoître ce métal, ses mines & les opérations par lesquelles on est obligé de le faire passer, on a cru devoir y suppléer ici, afin de ne rien laisser à desirer au lecteur sur une matiere si intéressante.
L'argent est un des métaux que l'on nomme parfaits, à cause de la propriété qu'il a de ne point s'altérer ni dans le feu, ni à l'air, ni dans l'eau. Il est d'un blanc brillant, dur, sonore ; & c'est après l'or, le plus ductile des métaux. Sa pesanteur est à celle de l'eau comme 11091 est à 1000. Son poids est à celui de l'or environ comme 5 est à 9. L'argent entre en fusion plus promtement que le cuivre. Il se dissout très-aisément dans l'acide nitreux ; il se dissout dans l'acide vitriolique, lorsqu'on fait bouillir ce dissolvant. Il s'unit avec l'acide du sel marin qui le dégage & le précipite des autres dissolvans, & forme avec lui ce qu'on appelle lune cornée. Il a beaucoup de disposition à s'unir avec le soufre, & par cette union l'argent devient noir ou rougeâtre. Il s'amalgame très-bien avec le mercure. Il ne se dissout point dans le feu par la litharge ou le verre de plomb.
L'argent se montre sous un grand nombre de formes différentes dans le sein de la terre, ce qui fait que les Minéralogistes en comptent plusieurs mines différentes.
1°. Ce métal se trouve sous la forme qui lui est propre, c'est ce qu'on nomme argent-vierge ou argent-natif, alors il est très-aisé à reconnoître ; il se montre sous différentes formes, tantôt il est en masses compactes & solides, que les Espagnols nomment pepitas. Il y en a de différentes grandeurs ; M. Henckel dans la préface de sa pyritologie nous apprend que l'on trouva autrefois dans les mines de Freyberg en Misnie une masse d'argent natif qui pesoit 400 quintaux. L'argent natif se trouve plus communément par lames ou en petits feuillets attachés à la pierre qui lui sert de matrice. Il forme souvent des ramifications semblables à des arbrisseaux ou à des feuilles de sapin, enfin il ressemble très-souvent à des fils ou à des poils. Cet argent natif n'est point parfaitement pur, il est souvent mêlé d'arsenic ou de soufre ou même de cuivre.
2°. L'argent est minéralisé avec du soufre seul, & forme la mine que l'on nomme mine d'argent vitreuse, parce qu'elle a quelque ressemblance avec du verre. Elle a à peu-près la couleur du plomb, quoique cependant elle soit un peu plus noire que ce métal. Cette mine est si tendre, qu'on peut la couper avec un couteau ; elle prend différentes formes, & se mêle souvent avec des mines d'autres métaux. Cette mine d'argent est très-riche, & ne contient que peu de soufre.
3°. La mine d'argent rouge n'est composée que d'argent, de soufre & d'arsenic ; tantôt elle est par masses compactes & irrégulieres, tantôt elle est en crystaux réguliers d'un rouge vif comme celui du rubis ou du grenat ; tantôt elle est d'un brun noirâtre, & sans transparence, alors elle est très-riche ; quelquefois elle forme des especes de lames ou d'écailles. Cette mine se trouve fort abondamment dans les mines d'Andreasberg au Hartz. Cette mine d'argent écrasée donne une poudre rouge ; exposée au feu, elle pétille & se gerse, après quoi elle entre aisément en fusion, & le feu en dégage l'arsenic.
4°. La mine d'argent cornée, en allemand horn-ertz ; elle est extrèmement rare ; c'est de l'argent qui a été minéralisé par l'acide du sel marin, suivant quelques auteurs ; & par l'arsenic, suivant d'autres. Il y en a de la brune, & un peu transparente comme de la corne ; ce qui lui a fait donner son nom ; cette espece est cassante. Il y en a aussi qui a une couleur qui approche de celle des perles ; elle est demi-transparente & ductile. Cette mine se volatilise à un grand feu. On en a trouvé à Johann-Georgenstadt en Misnie.
5°. La mine d'argent blanche est composée d'argent, de cuivre, de soufre, d'arsenic, & quelquefois d'une petite portion de plomb. C'est improprement qu'on lui donne le nom de mine d'argent blanche, vû qu'elle est d'un gris clair. Plus elle contient de cuivre, plus elle est d'une couleur foncée, & alors on la nomme mine d'argent grise, en allemand fahl-ertz. C'est relativement à cette derniere que la premiere s'appelle blanche. Ces mines varient pour la quantité d'argent qu'elles contiennent ; souvent elles en ont jusqu'à vingt marcs par quintal.
6°. La mine d'argent en plumes, en allemand feder-ertz ; c'est une mine composée de petites houpes semblables à des poils ou aux barbes d'une plume ; elle est légere & noire comme de la suie, & colore les doigts. C'est de l'argent minéralisé par le soufre, l'arsenic & l'antimoine. On pourroit soupçonner que cette mine est formée par la décomposition de celle que les Allemands nomment leber-ertz, ou mine de foie, qui n'est autre chose que l'argent minéralisé par le soufre & l'antimoine ; elle est brune, & se trouve à Braunsdorf en Saxe.
7°. La mine d'argent de la couleur de merde d'oie, est un mélange de la mine d'argent rouge & grise, de l'argent natif dans une roche verdâtre ou dans une espece d'ochre. Elle est très-rare.
Telles sont les principales mines d'argent ; mais ce métal se trouve encore en plus ou moins d'abondance dans les mines d'autres métaux ; c'est ainsi qu'il n'y a presque point de mine de plomb qui ne contienne une portion d'argent ; il n'y a, dit-on, que la mine de plomb de Willach en Carinthie, qui n'en contient point du tout. Voyez PLOMB. Plusieurs terres ferrugineuses jaunes & couleur d'ochre, contiennent aussi de l'argent ; les Allemands les nomment gilben. On trouve des terres noires qui ne sont que des mines décomposées qui renferment ce métal. L'argent se rencontre aussi dans des mines de fer, dans celles de cobalt, dans les pyrites, dans la blende ou mine de zinc. On en trouve dans des ardoises ou pierres feuilletées, dans des terres argilleuses, dans quelques especes de guhrs, &c. L'or natif est souvent mêlé d'une portion d'argent. Voy. OR.
M. de Justi, célebre minéralogiste allemand, assure avoir trouvé à Annaberg en Autriche, une mine dans laquelle l'argent se trouvoit minéralisé avec un alkali, & enveloppé dans de la pierre à chaux. Cette découverte seroit importante dans la minéralogie, vû que jusqu'ici on ne connoissoit que le soufre & l'arsenic, qui fussent propres à minéraliser les métaux. Cependant il y a lieu de douter de la réalité de la découverte de M. de Justi, qui demande des preuves plus convaincantes que celles qu'il a données jusqu'à présent au public.
Il est bon de remarquer que la plûpart des minéralogistes ont donné le nom de mines d'argent à des mines qui contenoient une très-petite quantité de ce métal, contre une beaucoup plus grande quantité, soit de cuivre, soit de fer, &c. On sent que ces dénominations sont vicieuses, & qu'il seroit plus exact de nommer ces mines d'après le métal qui y domine, en ajoutant qu'elles contiennent de l'argent ; ainsi la mine d'argent grise pourroit s'appeller mine de cuivre tenant argent. Il en est de même de beaucoup d'autres.
Aucun pays ne produit une aussi grande quantité d'argent que l'Amérique espagnole ; c'est sur-tout dans le Potosi & le Méxique que se trouvent les mines les plus abondantes de ce métal. L'Europe ne laisse pas d'en fournir une très-grande quantité. On en trouve principalement dans les mines de Hartz, qui produisent un revenu très-considérable pour la maison de Brunswick. Les mines de Freyberg en Misnie, ont été pareillement depuis plusieurs siecles, une source de richesses pour la maison de Saxe. L'Espagne fournissoit autrefois une quantité d'argent presqu'incroyable aux Carthaginois & aux Romains. Pline nous apprend qu'Annibal en tiroit réguliérement de la seule mine de Belbel trois cent livres par jour. Il paroît que depuis que ce pays eut été entierement soumis aux Romains, ces fiers conquérans tirerent d'Espagne la valeur de 111542 livres d'argent dans l'espace de neuf années. La Norwege produit aussi une assez grande quantité d'argent. On trouvera dans le premier volume de ce Dictionnaire à l'article ARGENT, les noms des principaux endroits du monde, où l'on trouve des mines de ce métal, ainsi que les différens noms que les Espagnols donnent aux différentes mines du Potosi.
Lorsque l'on a trouvé une mine d'argent, il faudra s'assurer par les essais de la quantité de ce métal qui y est contenu. Si c'est de l'argent natif, on n'aura qu'à dégager ce métal de la matrice ou de la roche qui l'enveloppe, après quoi on le fera fondre dans un creuset avec du flux noir ; ou bien on joindra la mine pulvérisée avec du mercure, qui formera un amalgame avec l'argent ; on passera cet amalgame par une peau de chamois, & on prendra la masse qui sera restée dans le chamois, & on la placera sous une moufle pour en dégager le mercure ; par ce moyen l'on aura l'argent seul que l'on pesera. Si la mine d'argent que l'on voudra essayer est ou sulfureuse ou arsenicale, ou l'un & l'autre à-la-fois, on commencera par la pulvériser grossierement, on la fera griller doucement pour en dégager les substances étrangeres ; après quoi on fera fondre huit parties de plomb dans une écuelle placée sous un moufle ; on y portera une partie de la mine grillée & encore chaude, que l'on aura mêlée préalablement avec partie égale de litharge ; on augmentera le feu, on remuera le mélange, afin que l'argent qui est dans la mine puisse s'incorporer avec le plomb fondu ; lorsqu'il se sera formé une scorie semblable à du verre à la surface, on vuidera le tout dans un cône frotté de suif ; le plomb uni à l'argent tombera au fond, & formera un culot ou régule, à la surface duquel seront les scories que l'on pourra en détacher. Ce régule est alors en état de passer à la coupelle. Voyez COUPELLE & ESSAI.
Les mines d'argent se traitent en grand de trois manieres ; savoir 1°. par la simple fusion ; 2°. en les joignant soit avec du plomb, soit avec de la litharge, soit avec des mines de plomb ; 3°. en les amalgamant avec du mercure.
Lorsque les mines d'argent sont très-riches, telles que celles qui contiennent de l'argent vierge, les mines d'argent rouges & blanches, &c. on les fait griller pour dégager les parties sulfureuses & arsenicales qui pourroient y être jointes ; après quoi on les fait fondre simplement dans le fourneau, & en leur joignant un fondant qui puisse vitrifier la pierre qui sert de matrice à la mine d'argent, par-là ce métal se dégage & tombe au fond du fourneau. On le purifie ensuite pour lui enlever les substances étrangeres qui ont pû se combiner avec lui.
Mais comme les mines d'argent vierge sont assez rares, & comme ce métal est plus communément joint en petite quantité avec un grand volume d'autres métaux, tels que le cuivre & le plomb, on est obligé de joindre du plomb ou de la mine de plomb, avec de la mine d'argent, après l'avoir grillée, afin que le plomb s'unisse avec ce métal, le sépare des autres métaux, & l'entraîne au fond du fourneau, tandis que les matieres hétérogenes sont converties en scories, & nagent à sa surface. Ce plomb ainsi combiné avec l'argent, se nomme plomb d'oeuvre ; on le verse dans des poëlons de fer, où il refroidit & prend de la consistance. Voyez OEUVRE. Ce plomb uni avec l'argent est en gâteaux, que l'on porte à la grande coupelle, où le plomb est converti en un verre que l'on nomme litharge, & l'argent seul reste sur la coupelle. Voyez COUPELLE.
Lorsque les mines sont peu riches en argent, on tâche de rapprocher & de concentrer sous un moindre volume l'argent qu'elles contiennent, sans quoi on dépenseroit trop en plomb pour les mettre en fusion. Pour cet effet, on mêle ces mines d'argent avec des scories & avec des pyrites, & on les fait fondre au fourneau ; c'est ce qu'on appelle dégrossir la mine. Ce travail produit un mêlange ou une matte, que l'on fait passer par différens feux pour la griller ; après quoi on joint ces mattes grillées avec des mines d'argent plus riches, ou avec du plomb ou des mines de plomb que l'on traite de la maniere indiquée ci-dessus, alors le produit s'appelle matte de plomb ; elle nage au-dessus du plomb d'oeuvre & au-dessous des scories. Lorsque la matte de plomb a été grillée convenablement, on en fait l'essai en petit, pour savoir la quantité d'argent qu'il donne à la grande coupelle.
Lorsque des mines de cuivre contiennent une portion d'argent, on l'obtient en joignant du plomb au cuivre, opération qui se nomme liquation. Voyez cet article.
Dans les pays où l'on trouve beaucoup d'argent vierge, ou bien où le bois est trop rare pour qu'on fasse fondre ces mines, on les traite par l'amalgame, en les écrasant & en les triturant ensuite avec le mercure que l'on fait évaporer ensuite par le moyen du feu ; c'est-là ce qui se pratique au Pérou, au Potosi & dans les autres endroits de l'Amérique espagnole. Voyez PIGNES.
Au sortir des travaux en grand, il est très-rare que l'argent soit d'une pureté parfaite : quand on veut l'avoir entierement pur, on est obligé de le faire passer par de nouvelles opérations ; la principale est celle de la coupelle, voyez COUPELLE. Elle est fondée sur la propriété que le plomb a de vitrifier tous les métaux, à l'exception de l'or & de l'argent ; mais la coupelle n'a point toujours purifié l'argent aussi parfaitement qu'on le desire, alors pour achever de le rendre pur, on se sert du soufre. Pour cet effet, on prendra de l'argent de coupelle que l'on mettra dans un creuset avec du soufre ; on donnera un feu assez fort pour que l'argent entre en fusion ; lorsqu'il sera parfaitement fondu, on vuidera la matiere dans un mortier de fer ; lorsqu'elle sera refroidie, elle aura la couleur du plomb & sera semblable à la mine d'argent vitreuse. On divisera cette masse & on la pulvérisera autant qu'il sera possible ; on la mettra dans une écuelle de terre, où on la fera calciner pour en dégager le soufre ; lorsqu'il sera entierement dissipé, on fera fondre l'argent avec du borax & de l'alkali fixe, & l'argent qu'on obtiendra sera parfaitement pur.
On peut encore purifier l'argent par le moyen du nitre. On n'a pour cela qu'à faire fondre de l'argent de coupelle avec ce sel, & le tenir en fusion jusqu'à ce qu'il n'en parte plus aucune vapeur. Alors l'argent sera aussi pur que l'on puisse le desirer ; on jugera que ce métal aura été parfaitement purifié, lorsque les scories qui se forment à sa surface n'auront aucune couleur verte.
On purifie encore l'argent par le moyen de l'antimoine crud, dont le soufre s'unit aux métaux qui sont alliés avec l'argent, sans toucher à ce métal qui se combine avec la partie réguline de l'antimoine. On le sépare ensuite de ce régule en le faisant détonner avec le nitre qui réduit l'antimoine en chaux sans décomposer l'argent.
Pour s'assurer si l'argent est pur, on n'aura qu'à le faire dissoudre dans de l'eau forte ; pour peu qu'il donne une couleur verte à ce dissolvant, on aura lieu d'être convaincu que l'argent contenoit encore quelques portions de cuivre. C'est souvent le plomb qui a été joint avec l'argent dans la coupelle, qui lui communique du cuivre, & c'est ce cuivre qui est cause du déchet que l'on éprouve lorsqu'on fait fondre l'argent à plusieurs reprises, parce qu'alors l'action du feu calcine le cuivre, ce qui est cause du déchet dont on s'apperçoit. Si on verse de l'alkali volatil sur de l'argent, il se colorera en bleu, pour peu que ce métal contienne du cuivre.
Lorsque l'argent est parfaitement pur, il est fort mou, au point qu'il est difficile d'en faire des ouvrages d'orfévrerie, c'est pour cela qu'on l'allie communément avec du cuivre pour lui donner du corps. D'où l'on voit que les vaisseaux d'argent ainsi allié, peuvent avoir souvent les mêmes dangers que les vaisseaux ou ustensiles de cuivre. Si l'on vouloit avoir des pieces d'argent parfaitement pur, il faudroit les faire faire plus épaisses & plus fortes.
Les Orfévres pour donner de la blancheur & de l'éclat aux ouvrages d'argent, les font bouillir dans une eau où ils ont fait dissoudre du tartre avec du sel marin, auxquels quelques-uns joignent du sel ammoniac. On sent aisément que cette opération n'est point une vraie purification ; elle ne pénetre point dans l'intérieur de l'argent, & n'enleve que les parties cuivreuses qui se trouvent à la surface.
Ce qu'on appelle le titre de l'argent, est son degré de pureté. Une masse d'argent quelconque se divise en douze parties, que l'on nomme deniers, & chaque denier en trente-deux grains. Ainsi si une masse étoit composée de onze parties d'argent fin & d'une partie de cuivre, on diroit que cet argent est à onze deniers & ainsi de suite. En Allemagne l'argent eu égard à sa pureté, se divise en seize parties que l'on nomme loths ou demi-onces. La maniere dont les Orfévres jugent communément de la pureté ou du titre de l'argent est très-peu exacte ; ils frottent la piece d'argent qu'ils veulent connoître sur une pierre de touche, sur la trace que ce métal a laissé sur la pierre, ils mettent de l'eau forte ; si elle devient verte ou bleuâtre, ils jugent que cet argent contient du cuivre, mais ils ne peuvent point connoître par-là la quantité de cuivre que l'argent contient ; d'ailleurs cette épreuve ne peut faire connoître si les morceaux qu'on leur présente ne renferment point quelque autre métal à leur intérieur.
Les Chimistes ont long-tems cru que l'argent non plus que l'or ne pouvoit point se calciner, c'est-à-dire, que l'action du feu ne pouvoit point le décomposer ou lui enlever son phlogistique ; maintenant on est convaincu de cette vérité. On n'a qu'à prendre de l'argent en limaille, ou ce qui vaut encore mieux, on prendra de l'argent, qui aura été dissout dans de l'eau forte, on l'exposera pendant deux mois à un feu de réverbere qui ne soit point assez fort pour le faire fondre, & l'on obtiendra une véritable chaux d'argent ; d'où l'on voit que l'argent perd son phlogistique, quoique plus lentement que les autres métaux. Cette chaux d'argent vitrifiée donne un verre jaune.
L'auteur d'un ouvrage allemand fort estimé des Chimistes, qui a pour titre Alchymia denudata, indique un autre moyen pour calciner l'argent. Il dit de mettre l'argent en cementation avec de la craie, de la corne de cerf, &c. & de l'exposer ensuite à un feu de réverbere. Le même auteur donne encore un autre procedé ; il consiste à dissoudre l'argent dans l'acide nitreux ; on met cette dissolution dans une cornue, on y ajoute de l'acide vitriolique & du mercure. On pousse le feu fortement ; d'abord il passe un peu de mercure dont une partie demeure unie avec les acides, mais il s'attache au col de la cornue un vrai cinnabre. En répétant plusieurs fois cette opération, la quantité du cinnabre qui s'attache au col de la cornue augmente, & à la fin on ne retrouve plus d'argent. M. Rouelle trouve que ce procedé démontre que l'acide vitriolique s'unit avec le phlogistique de l'argent, ce qui fait du soufre, & ce soufre en se combinant avec le mercure forme un vrai cinnabre.
De l'argent pur exposé à un feu très-violent pendant un mois n'a perdu qu'un 1/66 de son poids ; au lieu que l'or pur, exposé à ce même feu pendant trois mois, n'a souffert aucun déchet.
L'argent se dissout dans l'acide nitreux, dans l'acide vitriolique & dans l'acide du sel marin, mais ce métal n'est point attaqué par l'eau régale. Les acides tirés des végétaux agissent sur l'argent, pourvû que son aggrégation soit rompue, c'est-à-dire, pourvû qu'il soit dans un état d'atténuation & de division. Pour faire dissoudre ce métal dans l'acide nitreux, il faut le réduire en lames bien minces que l'on fera rougir pour les rendre plus nettes, & que l'on trempera dans de l'esprit de nitre étendu d'eau ; il se fera une effervescence, & lorsqu'elle sera finie la dissolution sera faite ; elle sera claire & un peu jaunâtre, si l'argent est parfaitement pur, mais elle deviendra verdâtre si l'argent contient du cuivre. Si l'argent contient de l'or, ce dernier métal tombera au fond du vaisseau sous la forme d'une poudre ; c'est sur cette expérience qu'est fondée la maniere de séparer l'or d'avec l'argent. Voyez DEPART & QUARTATION.
L'acide vitriolique & l'acide du sel marin ont plus de disposition à s'unir avec l'argent, que l'acide nitreux ; ainsi lorsque l'argent a été dissout dans de l'eau forte, mêlée d'acide vitriolique & d'acide du sel marin ; ces derniers acides s'emparent de l'argent & se précipitent sous la forme d'un sel, cela fournit un moyen de purifier l'eau forte des autres acides qui y sont mêlés, ce qui se fait en versant quelques gouttes de dissolution d'argent faite par l'acide nitreux, dans l'eau forte que l'on veut purifier, ce que l'on continue jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien ; alors l'eau forte s'appelle précipitée, & elle est beaucoup plus pure qu'auparavant.
L'argent dissout dans l'acide nitreux, versé dans une eau minérale, est très-propre à faire connoître si cette eau contient le sel appellé séléniteux, qui est une combinaison de l'acide vitriolique & d'une terre calcaire ; si une eau contient de ce sel, elle se trouble & devient laiteuse aussi-tôt qu'on y verse quelques gouttes de dissolution d'argent, parce qu'alors l'acide vitriolique contenu dans la sélénite, quitte la terre calcaire pour s'unir avec l'argent.
L'argent dissout dans l'acide nitreux, noircit la peau. On peut s'en servir pour former des desseins sur l'agathe & le caillou ; secret dont on se sert quelquefois pour tromper les curieux qui font des collections d'histoire naturelle sans connoissance de cause.
En faisant évaporer cette dissolution, on obtient des crystaux blancs, composés de lames qui s'unissent à angles droits, & qui, lorsque l'évaporation s'est faite doucement ressemblent assez à ceux du nitre quadrangulaire ; c'est-là ce que quelques Chimistes ont nommé assez mal-à-propos vitriol de lune, on les appelle avec plus de raison crystaux de lune. Lorsqu' avant de faire évaporer la dissolution, on y a joint un peu d'esprit de vin, ces crystaux se nomment hydragogue d'angelus sala ou fel metallorum, parce qu'ils ont un goût amer ; ce remede qui est peu sûr, est corrosif & passe pour un puissant diurétique.
Si on met des crystaux de lune dans du plomb fondu, & qu'on leur donne le tems de s'y incorporer par la fusion, tout l'argent passera dans le plomb. C'est une des fourberies des Alchimistes qui s'en servent pour persuader aux simples, qu'ils savent convertir le plomb en argent.
Si l'on joint du mercure à de l'argent qui a été dissout dans l'acide nitreux, on obtiendra une végétation métallique que l'on nomme arbre de Diane.
Les crystaux de lune unis avec de la dissolution de mercure, étendue dans une grande quantité d'eau, teignent les cheveux en noir. Si on fait évaporer jusqu'à siccité la dissolution d'argent par l'acide nitreux dans une capsule de verre, garnie de terre grasse que l'on place à feu nud ; les crystaux de lune entreront en fusion : en versant la matiere fondue dans des moules, on aura ce qu'on appelle le caustique lunaire ou la pierre infernale. Il faut pour cela de l'argent très-pur, parce que s'il étoit mêlé de cuivre, la pierre infernale attireroit l'humidité de l'air. Cette méthode est celle de M. Rouelle.
Kunckel dit dans son laboratoire chimique, que si l'on fait fondre la pierre infernale dans un creuset, & que l'on y joigne de l'esprit d'urine avec de son sel, spiritum urinae cum suo sale, en donnant un degré de chaleur convenable, il se fait une masse tenace d'un rouge de sang, & que l'on peut plier comme un fil autour du doigt.
L'argent qui a été dissout dans l'acide nitreux, se précipite par l'alkali fixe, par l'alkali volatil ; mais il ne faut en mettre que ce qui est nécessaire pour saturer l'acide nitreux, sans quoi l'argent qui aura été précipité se dissoudra de nouveau. Cette précipitation se fait encore par les terres calcaires, par le zinc, le fer, le cuivre, le plomb, le bismuth, le mercure ; par ce moyen on a de l'argent très-atténué & très-pur que l'on pourra édulcorer avec de l'eau chaude, pour lui enlever l'acide nitreux qui lui est demeuré attaché, & ensuite avec du vinaigre pour en enlever les petites molécules de cuivre qui peuvent encore lui être jointes.
Cette dissolution de l'argent se précipite encore par le moyen de l'acide vitriolique, l'argent tombe sous la forme d'une poudre blanche. Quand on veut dissoudre l'argent dans l'acide vitriolique, il faut que ce dissolvant soit chauffé & que l'aggrégation de ce métal ait été rompue. Le sel produit par la combinaison de l'acide vitriolique & de l'argent est fusible, comme la lune cornée, dont nous allons parler.
Kunckel dit, que si on fait dissoudre de l'argent dans de l'esprit de nitre ; qu'on précipite ce métal par le cuivre, qu'on édulcore & qu'on fasse sécher le précipité ; qu'on y verse ensuite deux parties d'acide vitriolique concentré ; on mettra le tout au bain de sable, & on donnera le degré de feu nécessaire pour faire bouillir le dissolvant & pour l'évaporer, jusqu'à ce que la matiere soit fluide comme de la cire. Si on joint à cette dissolution du mercure vif, elle prendra la consistance d'une pierre, & elle deviendra rouge & malléable. En ajoutant plus d'acide vitriolique, cette masse devient si solide, qu'il n'y a plus que le feu de fusion qui puisse la décomposer. Voyez le laborat. chimic.
Si dans une dissolution d'argent par l'acide nitreux on verse de l'acide du sel marin, ou du sel marin dissout dans de l'eau, il se fait une effervescence, le mêlange devient trouble & il se forme une espece de matiere coagulée, qui n'est autre chose que de l'argent combiné avec l'acide du sel marin ; c'est ce qu'on nomme lune cornée, parce qu'elle entre en fusion à un feu assez foible, & alors elle forme une espece de verre semblable à de la corne. Cette matiere est volatile au feu, insoluble dans l'eau. M. Henckel a cru que cette lune cornée étoit une espece de verre malléable si recherché par les anciens, vû que cette substance a de la flexibilité. Les Alchimistes ont regardé la lune cornée comme un moyen de parvenir à la calcination de l'argent ; ils ont exposé cette substance pendant long-tems au feu de réverbere sans la laisser entrer en fusion, & ils se promettent de grands effets de cette chaux.
La volatilité de la lune cornée, la rend très-difficile à réduire, il faut pour cela recourir à des intermedes. On met de l'antimoine dans une cornue avec la lune cornée ; on donne un feu très-violent, par ce moyen l'acide du sel marin s'unit à l'antimoine & forme du beurre d'antimoine, & l'argent reste au fond de la cornue uni avec un peu d'antimoine, dont on le sépare en le faisant détonner avec du nitre.
On peut encore faire cette réduction de la lune cornée, en mettant avec elle du plomb dans une cornue, la réduction est faite aussi-tôt que le plomb a été fondu. Il se forme au-dessus du plomb une scorie qui ressemble beaucoup à de la lune cornée, & qui en a le poids ; expérience, qui suivant M. Zimmermann, mérite l'attention des Chimistes.
Le soufre s'unit avec l'argent, & le rend si fusible & si divisé, qu'il perce les creusets, & en même-tems il devient si cassant, que l'on peut le pulvériser. C'est sur la disposition que le soufre a de s'unir à l'argent, qu'est fondée l'opération par laquelle l'on dégage l'or d'avec l'argent par la voie seche, parce que le soufre ne touche point à l'or. Voyez, séparation ou départ par la voie seche. Lorsque l'argent est uni avec le soufre, l'eau forte n'agit plus sur ce métal, parce qu'il est alors entouré d'une enveloppe grasse, qui le défend contre l'action de l'acide. On peut dégager l'argent du soufre, en le faisant fondre avec du cuivre, auquel on pourra joindre un peu de limaille de fer à la fin de l'opération. On peut encore dégager ce soufre par le moyen de l'alkali fixe, en prenant garde de ne point faire du foie de soufre qui dissoudroit l'argent : ce soufre se dégagera aussi, si on joint du mercure sublimé avec l'argent sulfuré, alors le soufre s'unira au mercure & sera du cinnabre, tandis que l'argent s'unira à l'acide du sel marin avec qui il fera la lune cornée.
Les Alchimistes, toujours occupés de mysteres, ont donné plusieurs noms différens à l'argent ; ils ont désigné ce métal sous le nom de luna, lumen minus, regina, Diana, mater Dianae, fermentum album. Ils ont cru que pour être de l'or, il ne lui manquoit qu'un soufre colorant, mais ils n'ont point jugé àpropos de nous expliquer ce qu'ils entendoient parlà.
Les Chimistes disent, que l'argent est composé, 1°. d'une terre fine qui se démontre par sa fixité au feu, & par la difficulté qu'on a de le calciner, 2°. d'une terre inflammable qui est le phlogistique, 3°. d'une terre mercurielle qui lui donne la fusibilité.
A l'exception de la pierre infernale, l'argent n'est d'aucun usage dans la Médecine & dans la Pharmacie ; les prétendues teintures lunaires dont parlent quelques auteurs, sont des remedes très-suspects, vû que l'argent par lui-même ne donne point de couleur, & lorsqu'il en donne une, elle est dûe au cuivre avec qui il est mêlé.
Les usages de l'argent dans les arts & métiers, sont très-étendus & très-connus de tout le monde, on ne s'arrêtera pas à les décrire ici, vû qu'il en sera parlé aux articles où l'on traite ces différens arts.
Quand on voudra argenter une piece à froid, on n'aura qu'à faire dissoudre de l'argent dans de l'eau-forte ; on précipitera la dissolution par le cuivre ; on mêlera l'argent qui se sera précipité, avec parties égales de sel ammoniac & de sel marin ; on frottera avec ce mêlange la piece de cuivre jaune que l'on voudra argenter. D'autres artistes sont dans l'usage de se servir de sel marin & de crême de tartre, au lieu du mélange précédent.
LUNE CORNEE, (Chimie Métall.) les Chimistes nomment ainsi l'argent qui a été dissout dans l'esprit de nitre, & précipité par de l'esprit de sel, par une dissolution de sel marin, ou de sel ammoniac. Pour cette opération, on fait dissoudre de l'argent dans de l'esprit de nitre ; ensuite on fait dissoudre du sel marin ou du sel ammoniac dans de l'eau ; on verse l'une de ces dissolutions, ou bien simplement de l'esprit de sel dans l'esprit de nitre chargé d'argent, il devient double & laiteux ; on ajoute de l'eau claire, & on laisse reposer ce mêlange. Au bout de quelque tems il tombe au fond du vaisseau une poudre ou un précipité blanc ; on décante la liqueur qui surnage, & on verse de nouveau de l'esprit de nitre, ou de l'esprit de sel sur le précipité, & l'on fait chauffer le tout au bain de sable ; on décante cette nouvelle liqueur ; on verse de l'eau chaude sur le précipité ; on le fait bouillir ; on réitere la même chose plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau soit entierement insipide ; on la décante, & l'on fait sécher la poudre blanche ou le précipité qui a été ainsi édulcoré ; c'est-là ce qu'on nomme lune cornée. C'est de l'argent combiné avec l'acide du sel marin : cette combinaison de l'argent est très-aisée à mettre en fusion ; & quand elle a été fondue, elle forme une masse qui ressemble à de la corne ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de lune cornée. Cette matiere conserve une certaine flexibilité ; de-là vient que M. Henckel a cru que ce pouvoit être-là le verre malléable des anciens.
Il n'y a point de moyen plus sûr d'avoir un argent bien pur & dégagé de toute partie cuivreuse, que de le mettre en lune cornée. On peut ensuite en retirer ce métal ou le réduire, en mettant la lune cornée dans un creuset enduit de savon ; on y joint la moitié de son poids de sel de tartre bien sec & pulvérisé, que l'on couvrira d'huile, de suif, ou de quelque matiere grasse, on placera le creuset dans un fourneau de fusion ; on ne donnera d'abord qu'un degré de feu suffisant pour faire rougir le creuset ; on l'augmentera ensuite, & l'on remettra de tems en tems de nouvelle matiere grasse ; lorsqu'il ne partira plus de fumée du creuset, on le vuidera à l'ordinaire dans un cône de fer enduit de suif. Voyez la Chimie pratique de M. Macquer.
LUNE, (Mythologie) Pindare l'appelle ingénieusement l'oeil de la nuit, & Horace, la reine du silence, Diana, quae silentium regis ! C'étoit après le soleil, la plus grande divinité du paganisme : Hésiode la fait fille de Théa, c'est-à-dire, de la divinité. Une partie des peuples orientaux l'honoroient sous le titre d'Uranie, ou de Céleste. C'est elle que les Egyptiens adoroient sous le symbole du boeuf Apis ; les Phéniciens sous le nom d'Astarté ; les Perses sous le nom de Militra ; les Arabes sous le nom d'Alizat ; les Africains sous le nom du dieu Lunus ; les Grecs & les Romains sous le nom de Diane.
L'Ecriture-sainte parle souvent du culte que l'on rendoit à la reine du ciel, car le soleil en étoit le roi ; & Macrobe a prétendu que toutes les divinités des payens pouvoient se rapporter à ces deux astres. Du moins il est sûr qu'ils firent l'un & l'autre les premiers objets de l'idolatrie chez la plûpart des peuples de la terre.
Les hommes frappés de ces deux globes lumineux qui brilloient sur tous les autres avec tant de grandeur & de régularité, se persuaderent aisément qu'ils étoient les maîtres du monde, & les premiers dieux qui le gouvernoient. Ils les crurent animés ; & comme ils les voyoient toûjours les mêmes, & sans aucune altération, ils jugerent qu'ils étoient immuables & éternels.
Dès-lors on commença à se prosterner devant eux, à leur bâtir des temples découverts, & à leur adresser mille hommages, pour se les rendre favorables.
Mais la lune ne paroissant que la nuit, inspira le plus de craintes & de frayeurs aux hommes ; ses influences furent extrêmement redoutées ; de-là vinrent les conjurations des magiciennes de Thessalie, celles des femmes de Crotone, les sortiléges, & tant d'autres superstitions de divers genres, qui n'ont pas encore disparu de dessus notre hémisphere.
César ne donna point d'autres divinités aux peuples du Nord, & aux anciens Germains que le feu, le soleil, & la lune. Le culte de ce dernier astre franchit les bornes de l'océan germanique, & passa de la Saxe dans la grande Bretagne.
Il ne fut pas moins répandu dans les Gaules ; & si nous en croyons l'auteur de la religion des Gaulois, il y avoit un oracle de la lune desservi par des druidesses dans l'île de Saïn, située sur la côte méridionale de la basse Bretagne.
En un mot, on ne vit qu'un petit nombre de philosophes Grecs & Romains, qui regarderent la lune comme une simple planete, & pour m'exprimer avec Anaximandre, comme un feu renfermé dans la concavité d'un globe dix-neuf fois plus grand que la terre. C'est-là, disent-ils, que les ames moins legeres que celles des hommes parfaits, sont reçûes, & qu'elles habitent les vallées d'Hécate, jusqu'à ce que dégagées de cette vapeur qui les avoit empêchées d'arriver au séjour céleste, elles y parviennent à la fin. (D.J.)
|
| LUNEBOURG | (Géog.) Luneburgum, ville d'Allemagne, au cercle de la basse Saxe, capitale du duché de même nom. Elle étoit autrefois impériale, mais à présent elle appartient à l'électeur de Hanover ; elle a une bonne douanne & des salines d'un revenu considérable, sur le produit desquelles sont assignées les pensions de toutes les personnes en charge & des gens d'église ; desorte que ce qui passe ailleurs pour un honoraire, est à Lunebourg un vrai salaire, si l'origine de ce mot donnée par Turnebe, à sale, n'est pas fausse. Lunebourg se trouve située avantageusement, près d'une montagne qui lui fournit beaucoup de chaux pour bâtir, & sur l'Elmenow, à 14 lieues S. E. de Hambourg, 31 N. de Brunswick. Long. 28. 15. lat. 53. 28.
Sagittarius (Gaspard) littérateur, & célebre historiographe d'Allemagne, naquit à Lunebourg en 1643. Ses principaux ouvrages, comme historiographe, tous écrits en latin, sont l'histoire de la Lusace, du duché de Thuringe, des villes d'Harderwick, d'Halberstad, & de Nuremberg ; l'histoire de la succession des princes d'Orange, jusqu'à Guillaume III, &c. Il a publié en latin comme littérateur, un traité des oracles, un livre sur les chaussures des anciens, intitulé de nudipedalibus veterum, la vie de Tullia fille de Cicéron, & quelques autres, dont le P. Nicéron vous donnera la liste dans ses mémoires des hommes illustres, tome IV. page 229. Sagittarius est mort en 1694. (D.J.)
|
| LUNEL | (Blason) on appelle ainsi dans le Blason quatre croissans appointés en forme de rose à quatre feuilles ; ils ne sont d'usage qu'en Espagne.
|
| LUNENSE MARMOR | (Hist. nat.) nom que les anciens donnoient à une espece de marbre blanc plus connu sous le nom de marbre de Carrare. Il étoit très-estimé chez les anciens ; il est d'un blanc très-pur, d'un tissu très-serré & d'un grain très-fin ; il s'en trouve encore beaucoup en Italie ; il est plus dur que les autres especes de marbre, & a plus de transparence. Quelques auteurs l'ont confondu avec le marbre de Paros ; mais ce dernier n'est pas d'un tissu aussi solide, & n'est point si blanc que le marbre de Carrare, quoiqu'il ait plus d'éclat que lui. Em. Mendez d'Acosta, histoire naturelle des minéraux, page 190. (-)
|
| LUNETTE | S. f. (Dioptr.) instrument composé d'un ou de plusieurs verres, & qui a la propriété de faire voir distinctement ce qu'on n'appercevroit que foiblement ou point du tout à la vûe simple.
Il y a plusieurs especes de lunettes ; les plus simples sont les lunettes à mettre sur le nez, qu'on appelle autrement besicles, & qui sont composées d'un seul verre pour chaque oeil. Voyez BESICLES. L'invention de ces lunettes est de la fin du xiij. siecle ; on l'a attribuée sans preuve suffisante au moine Roger Bacon. On peut voir sur ce sujet le traité d'optique de M. Smith, & l'histoire des Mathématiques de M. de Montucla, tome I. page 424. Dans cette même histoire on prouve (voyez la page 433. & les additions) que l'inventeur de ces lunettes est probablement un florentin nommé Salvino de Gl'armati, mort en 1317, & dont l'épitaphe qui se lisoit autrefois dans la cathédrale de Florence, lui attribue expressément cette invention. Alexandre Despina, de l'ordre des freres Prêcheurs, mort en 1313 à Pise, avoit aussi découvert ce secret, comme on le voit par ce passage rapporté dans une chronique manuscrite ; ocularia ab aliquo primo facta, & communicare nolente, ipse fecit & communicavit.
Il est très-singulier que les anciens qui connoissoient les effets de la réfraction, puisqu'ils se servoient de spheres de verre pour brûler (voyez ARDENT), n'ayent pas connu l'effet des verres lenticulaires pour grossir. Il est même très-singulier que le hasard seul ne leur ait pas fait connoître cette propriété ; mais il l'est encore davantage qu'entre l'invention des lunettes simples, qui est d'environ 1300 (car il y a des preuves qu'elles étoient connues dès 1299), & l'invention des lunettes à plusieurs verres, ou lunettes d'approche, il se soit écoulé 300 ans ; car l'invention de ces dernieres est du commencement du xvij. siecle. Voyez l'article TELESCOPE, où nous détaillerons les propriétés de ces sortes de lunettes.
Il y a des lunettes à mettre sur le nez, qu'on appelle des conserves ; mais elles ne méritent véritablement ce nom, que lorsqu'elles sont formées de verres absolument plans, dont la propriété se borneroit à affoiblir un peu la lumiere sans changer rien d'ailleurs à la disposition des rayons. Dans ce cas, ils pourroient servir à une vûe qui seroit bonne d'ailleurs, c'est-à-dire, ni myope ni presbyte, mais qui auroit seulement le défaut d'être blessée par une lumiere trop vive. Ainsi les lunettes qu'on appelle conserves, ne méritent donc point ce nom, parce qu'elles sont presque toûjours formées de verres convexes, qui servent à remédier à un défaut réel de la vûe ; défaut qui consiste à ne pas voir distinctement les objets trop proches & trop petits ; ce défaut augmente à mesure qu'on avance en âge.
Les grandes lunettes d'approche s'appellent plus particulierement télescopes : elles sont formées de plusieurs verres convexes ; les petites lunettes d'approche, qu'on appelle aussi lorgnettes d'opéra, sont composées de deux verres, un objectif convexe, & un oculaire concave. Voyez OBJECTIF, OCULAIRE, LESCOPECOPE.
Nous avons parlé au mot FOYER, des variations que M. Bouguer a observées dans le foyer des grandes lunettes, par rapport aux différens observateurs & à la différente constitution de l'athmosphere. Les moyens qu'il propose de remédier à cet inconvénient, sont 1°. de faire ensorte que l'astre passe à peu de distance du centre du champ ; 2°. de se servir d'un objectif coloré ; 3°. de diminuer beaucoup l'étendue de l'objectif en couvrant les bords d'un diaphragme ; ce qui suppose un objectif bien centré. Voyez CENTRER. Voyez aussi un plus grand détail sur ces différens objets dans l'ouvrage de M. Bouguer, sur la figure de la terre, p. 208 & suiv. (O)
LUNETTES, (Hist. des invent. mod.) les lunettes, ou plutôt les verres à lunettes qu'on applique sur le nez ou devant les yeux pour lire, écrire, & en général, pour mieux découvrir les objets voisins que par le secours des yeux seuls, ne sont pas à la vérité d'une invention aussi récente que les lunettes d'approche ; car elles les ont précédé de plus de trois siecles, mais leur découverte appartient aux modernes, & les anciens n'en ont point eu connoissance.
Je sai bien que les Grecs & les Romains avoient des ouvriers qui faisoient des yeux de verre, de crystal, d'or, d'argent, de pierres précieuses pour les statues, principalement pour celles des dieux. On voit encore des têtes de leurs divinités, dont les yeux sont creusés : telles sont celles d'un Jupiter Ammon, d'une Bacchante, d'une idole d'Egypte, dont on a des figures. Pline parle d'un lion en marbre, dont les yeux étoient des émeraudes ; ceux de la Minerve du Temple de Vulcain à Athènes, qui, selon Pausanias, brilloit d'un verd de mer, n'étoient sans doute autre chose que des yeux de béril. M. Buonarotti avoit dans son cabinet quelques petites statues de bronze avec des yeux d'argent. On nommoit faber ocularius, l'ouvrier qui faisoit ces sortes d'ouvrages ; & ce terme se trouve dans les marbres sépulchraux ; mais il ne signifioit qu'un faiseur d'yeux postiches ou artificiels, & nullement un faiseur de lunettes, telles que celles dont nous faisons usage.
Il seroit bien étonnant si les anciens les eussent connues, que l'histoire n'en eût jamais parlé à propos de vieillards & de vûe courte. Il seroit encore plus surprenant que les Poëtes de la Grece & de Rome, ne se fussent jamais permis à ce sujet aucun de ces traits de satyre ou de plaisanterie, qu'ils ne se sont pas refusé à tant d'autres égards. Comment Pline qui ne laisse rien échapper, auroit-il obmis cette découverte dans son ouvrage, & particulierement dans le livre VII. ch. lvj. qui traite des inventeurs des choses ? Comment les médecins grecs & romains, qui indiquent mille moyens pour soulager la vûe, ne disent-ils pas un mot de celui des lunettes ? Enfin, comment leur usage qui est fondé sur les besoins de l'humanité, auroit-il pu cesser ? Comment l'art de faire un instrument d'optique si simple, & qui ne demande ni talent, ni génie, se seroit-il perdu dans la suite des tems ? Concluons donc que les lunettes sont une invention des modernes, & que les anciens ont ignoré ce beau secret d'aider & de soulager la vûe.
C'est sur la fin du xiij. siecle, entre l'an 1280 & 1300, que les lunettes furent trouvées ; Redi témoigne avoir eu dans sa bibliotheque un écrit d'un Scandro Dipopozzo, composé en 1298, dans lequel il dit : " je suis si vieux que je ne puis plus lire ni écrire sans verres qu'on nomme lunettes, senza occhiali ". Dans le dictionnaire italien de l'académie de la Crusca, on lit ces paroles au mot occhiali : " frere Jordanus de Rivalto, qui finit ses jours en 1311, a fait un livre en 1305, dans lequel il dit, qu'on a découvert depuis 20 ans l'art utile de polir des verres à lunettes ". Roger Bacon mort à Oxford en 1292, connoissoit cet art de travailler les verres ; cependant ce fut vraisemblablement en Italie qu'on en trouva l'invention.
Maria Manni dans ses opuscules scientifiques, Tome IV. & dans son petit livre intitulé de gl'occhiali del naso, qui parut en 1738, prétend que l'histoire de cette découverte est dûe à Salvino de gl'armati, florentin, & il le prouve par son épitaphe. Il est vrai que Redi, dans sa lettre à Charles Dati, imprimée à Florence en 1678, in-4°. avoit donné Alexandre Spina dominicain, pour l'auteur de cette découverte ; mais il paroît par d'autres remarques du même Redi, qu'Alexandre Spina avoit seulement imité par son génie ces sortes de verres trouvés avant lui. En effet, dans la bibliotheque des peres de l'Oratoire de Pise, on garde un manuscrit d'une ancienne chronique latine en parchemin, où est marquée la mort du frere Alexandre Spina à l'an 1313, avec cet éloge : quaecumque vidit aut audivit facta, scivit, & facere ocularia ab aliquo primò facta, & communicare nolente, ipse fecit, & communicavit. Alexandre Spina n'est donc point l'inventeur des lunettes ; il en imita parfaitement l'invention, & tant d'autres avec lui y réussirent, qu'en peu d'années cet art fut tellement répandu par-tout, qu'on n'employoit plus que des lunettes pour aider la vûe. De-là vient que Bernard Gordon, qui écrivoit en 1300 son ouvrage intitulé, lilium Medicinae, y déclare dans l'éloge d'un certain collyre pour les yeux, qu'il a la propriété de faire lire aux vieillards les plus petits caracteres, sans les secours des lunettes. (D.J.)
LUNETTE D'APPROCHE, (Hist. des inventions modernes) cet utile & admirable instrument d'optique, qui rapproche la vûe des corps éloignés, n'a point été connu des anciens, & ne l'a même été des modernes, sous le nom de lunettes d'Hollande, ou de Galilée, qu'au commencement du dernier siecle.
C'est en vain qu'on allegue pour reculer cette date, que dom Mabillon déclare dans son voyage d'Italie, qu'il avoit vû dans un monastere de son ordre, les oeuvres de Comestor écrites au treizieme siecle, ayant au frontispice le portrait de Ptolémée, qui contemple les astres avec un tube à quatre tuyaux ; mais dom Mabillon ne dit point que le tube fût garni de verres. On ne se servoit de tube dans ce tems là que pour diriger la vûe, ou la rendre plus nette, en séparant par ce moyen les objets qu'on regardoit, des autres dont la proximité auroit empêché de voir ceux-là bien distinctement.
Il est vrai que les principes sur lesquels se font les lunettes d'approche ou les télescopes, n'ont pas été ignorés des anciens géometres ; & c'est peut-être faute d'y avoir réfléchi, qu'on a été si long-tems sans découvrir cette merveilleuse machine. Semblable à beaucoup d'autres, elle est demeurée cachée dans ses principes, ou dans la majesté de la nature, pour me servir des termes de Pline, jusqu'à ce que le hazard l'ait mise en lumiere. Voici donc comme M. de la Hire rapporte dans les mémoires de l'acad. des Sciences, l'histoire de la découverte des lunettes d'approche ; & le récit qu'il en fait est d'après le plus grand nombre des historiens du pays.
Le fils d'un ouvrier d'Alcmaer, nommé Jacques Métius, ou plutôt Jakob Metzu, qui faisoit dans cette ville de la Nord-Hollande, des lunettes à porter sur le nez, tenoit d'une main un verre convexe, comme sont ceux dont se servent les presbytes ou vieillards, & de l'autre main un verre concave, qui sert pour ceux qui ont la vûe courte. Le jeune homme ayant mis par amusement ou par hazard le verre concave proche de son oeil, & ayant un peu éloigné le convexe qu'il tenoit au devant de l'autre main, il s'apperçut qu'il voyoit au travers de ces deux verres quelques objets éloignés beaucoup plus grands, & plus distinctement, qu'il ne les voyoit auparavant à la vûe simple. Ce nouveau phénomene le frappa ; il le fit voir à son pere, qui sur le champ assembla ces mêmes verres & d'autres semblables, dans des tubes de quatre ou cinq pouces de long, & voilà la premiere découverte des lunettes d'approche.
Elle se divulgua promtement dans toute l'Europe, & elle fut faite selon toute apparence en 1609 ; car Galilée publiant en 1610 ses observations astronomiques avec les lunettes d'approche, reconnoît dans son Nuncius sydereus, qu'il y avoit neuf mois qu'il étoit instruit de cette découverte.
Une chose assez étonnante, c'est comment ce célebre astronome, avec une lunette qu'il avoit faite lui-même sur le modele de celles de Hollande, mais très-longue, put reconnoître le mouvement des satellites de Jupiter. La lunette d'approche de Galilée avoit environ cinq pieds de longueur ; or plus ces sortes de lunettes sont longues, plus l'espace qu'elles font appercevoir est petit.
Quoiqu'il en soit, Képler mit tant d'application à sonder la cause des prodiges que les lunettes d'approche découvroient aux yeux, que malgré ses travaux aux tables rudolphines, il trouva le tems de composer son beau traité de Dioptrique, & de le donner en 1611, un an après le Nuncius sydereus de Galilée.
Descartes parut ensuite sur les rangs, & publia en 1637 son ouvrage de Dioptrique, dans lequel il faut convenir qu'il a poussé fort loin sa théorie sur la vision, & sur la figure que doivent avoir les lentilles des lunettes d'approche ; mais il s'est trompé dans les espérances qu'il fondoit sur la construction d'une grande lunette, avec un verre convexe pour objectif, & un concave pour oculaire. Une lunette de cette espece, ne feroit voir qu'un espace presque insensible de l'objet. M. Descartes ne songea point à l'avantage qu'il retireroit de la combinaison d'un verre convexe pour oculaire ; cependant sans cela, ni les grandes lunettes, ni les petites, n'auroient été d'aucun usage pour faire des découvertes dans le ciel, & pour l'observation des angles. Képler l'avoit dit, en parlant de la combinaison des verres lenticulaires : duobus convexis, majora & distincta praestare visibilia, sed everso situ. Mais Descartes, tout occupé de ses propres idées, songeoit rarement à lire les ouvrages des autres. C'est donc à l'année 1611, qui est la date de la Dioptrique de Képler, qu'on doit fixer l'époque de la lunette à deux verres convexes.
L'ouvrage qui a pour titre, oculus Eliae & Enoch, par le P. Reita capucin allemand, où l'on traite de cette espece de lunette, n'a paru que long-tems après. Il est pourtant vrai, que ce pere après avoir parlé de la lunette à deux verres convexes, a imaginé de mettre au-devant de cette lunette une seconde petite lunette, composée pareillement de deux verres convexes ; cette seconde lunette renverse le renversement de la premiere, & fait paroître les objets dans leur position naturelle, ce qui est fort commode en plusieurs occasions ; mais cette invention est d'une très-petite utilité pour les astres, en comparaison de la clarté & de la distinction, qui sont bien plus grandes avec deux seuls verres, qu'avec quatre, à cause de l'épaisseur des quatre verres, & des huit superficies qui n'ont toûjours que trop d'inégalités & de défauts.
Cependant on a été fort long-tems sans employer les lunettes à deux verres convexes : ce ne fut qu'en 1659, que M. Huyghens inventeur du micrometre, les mit au foyer de l'objectif, pour voir distinctement les plus petits objets. Il trouva par ce moyen le secret de mesurer les diametres des planetes, après avoir connu par l'expérience du passage d'une étoile derriere ce corps, combien de secondes de degrés il comprenoit.
C'est ainsi que depuis Métius & Galilée, on a combiné les avantages qu'on pourroit retirer des lentilles qui composent les lunettes d'approche. On sait que tout ce que nous avons de plus curieux dans les sciences & dans les arts, n'a pas été trouvé d'abord dans l'état où nous le voyons aujourd'hui : mais les beaux génies qui ont une profonde connoissance de la Méchanique & de la Géométrie, ont profité des premieres ébauches, souvent produites par le hasard, & les ont portées dans la suite au point de perfection dont elles étoient susceptibles. (D.J.)
LUNETTES, (Fortificat.) ce sont dans la Fortification des especes de demi-lunes, ou des ouvrages à-peu-près triangulaires, composés de deux faces qui forment un angle saillant vers la campagne, & qui se construisent auprès des glacis ou au-delà de l'avant-fossé. Voyez REDOUTES.
Les lunettes sont ordinairement fortifiées d'un parapet le long de leurs faces ; leur terreplein est au niveau de la campagne ; elles se placent communément vis-à-vis les angles rentrans du chemin couvert.
Pour construire une lunette A au-delà d'un avant-fossé, soit Pl. IV. de Fortif. fig. 3. ce fossé tracé vis-à-vis une place d'armes rentrante R du chemin couvert, on prendra des points a & e, sommets des angles rentrans de l'avant-fossé a b & e f de 10 ou 12 toises ; ensuite de ces points pris pour centre, & d'un intervalle de 30 ou 40 toises, on décrira deux arcs qui se couperont dans un point g duquel on tirera les lignes g b, g f, qui seront les faces de la lunette A.
La lunette a un fossé de 8 ou 10 toises de largeur, mené parallelement à ses faces, un parapet de 3 toises d'épaisseur, & de 7 ou 8 de hauteur. On éleve la banquette de ces ouvrages de maniere que le parapet n'ait que 4 piés & demi de hauteur audessus. La pente de la partie supérieure ou de la plongée du parapet, se dirige au bord de la contrescarpe du fossé de la lunette.
On arrondit la gorge de la lunette par un arc décrit de l'angle rentrant h du glacis pris pour centre, & de l'intervalle h e. La partie du glacis de la place vis-à-vis la lunette s'arrondit aussi en décrivant du point h & de l'intervalle h i un second arc parallele au premier.
Au-delà de l'avant-fossé on décrit un avant-chemin couvert qui l'enveloppe entierement & qui enveloppe aussi les lunettes. Elémens de fortificat.
LUNETTES, grandes, (Fortificat.) Voyez TENAILLONS.
LUNETTES, petites, (Fortificat.) ce sont dans la Fortification des especes de places d'armes retranchées ou entourées d'un fossé & d'un parapet qu'on construit quelquefois dans les angles rentrans du fossé des bastions & des demi-lunes. Ces lunettes sont flanquées par le bastion & par la face de la demi-lune, dont elles couvrent une partie de la face.
LUNETTE, (Hydr.) est une piece que l'on ajoute à un niveau dans les grandes & longues opérations, où la vue ne suffiroit pas pour découvrir facilement les objets.
LUNETTE, (Architect.) est une espece de voûte qui traverse les reins d'un berceau, & sert à donner du jour, à soulager la portée, & empêcher la poussée d'une voûte en berceau. Lunette se dit aussi d'une petite vue pratiquée dans un comble ou dans une fleche de clocher, pour donner un peu de jour & d'air à la charpente. On appelle encore lunette un ais ou planche percée qui forme le siége d'un lieu d'aisance.
LUNETTE, (Corroyeur) C'est un instrument de fer, dont les corroyeurs & autres ouvriers en cuir se servent pour ratisser & parer les cuirs ; elle est de figure sphérique, plate & très-tranchante par sa circonférence extérieure. Il y a au milieu une ouverture ronde assez grande, pour que l'ouvrier puisse y passer la main pour s'en servir. Voyez-en la fig. dans nos planches du Corroyeur, où l'on a aussi représenté un ouvrier qui pare un cuir avec la lunette.
LUNETTE d'une boîte de montre, (Horlog.) c'est cette partie qui contient le crystal. Voyez BOITE DE MONTRE & la fig. dans nos Pl. de l'Horlogerie.
LUNETTE, fer à lunette, (Maréchal.) est celui dont les éponges sont coupées. On se sert de cette espece de fer dans certaines occasions.
Lunettes, ronds de cuir qu'on pose sur les yeux du cheval pour les lui boucher.
Si l'on veut travailler dans un manege un cheval qui a les seimes, il faut le ferrer à lunettes ; mais si l'on veut le faire travailler à la campagne, il faut le ferrer à pantoufle. Voyez SEIME.
LUNETTE, en terme d'Orfévre en grosserie, c'est la partie d'un soleil destinée à recevoir l'hostie. Elle est fermée de deux glaces, & entourée d'un nuage d'où sortent des rayons. Voyez NUAGE & RAYONS.
LUNETTE, en terme de Peaussier, c'est un instrument dont ces ouvriers se servent pour adoucir les peaux du côté de la chair, & en coucher le duvet du même côté.
La lunette est un outil de fer fort mince, rond, & dont le diametre est d'environ dix pouces ; elle est évidée au centre de maniere à y placer commodément la main ; mais comme cet outil est fort mince, le diametre intérieur est garni de cuir pour ne point blesser l'ouvrier qui s'en sert. Le diametre extérieur est un peu coupant, pour racler aisément la peau, & en enlever toutes les inégalités. Voyez la fig.
LUNETTE, (Tourneur) partie du tour, est un trou quarré, dans lequel sont deux pieces de cuivre ou d'étain qu'on appelle collets, qui y sont retenus par une piece qu'on appelle chaperon, attachée à la poupée avec des vis. Voyez TOUR A LUNETTE & les figures.
LUNETTES, (Verrerie) c'est ainsi qu'on appelle certaines ouvertures pratiquées aux fourneaux. Voyez l'art VERRERIE.
|
| LUNETTIER | S. m. (Art méch.) ouvrier qui fait des lunettes, & qui les vend. Comme ce sont à Paris les maîtres miroitiers qui font les lunettes, ils ont pris de-là la qualité de maîtres miroitiers lunettiers. Les marchands merciers en font aussi quelque commerce ; mais ils n'en fabriquent point. Voyez MIROITIER.
|
| LUNEVILLE | (Géogr.) en latin Lunae-villa ou Lunaris villa, jolie ville de Lorraine, avec un beau château où les ducs de Lorraine, & présentement le Roi Stanislas tient sa cour. Ce prince a établi un bon hôpital & une école de cadets pour l'éducation de jeunes gentilshommes dans l'art militaire. Il a encore embelli cette ville à plusieurs autres égards. Elle est dans une plaine agréable, sur la Vezouze & sur la Meurte, à 5 lieues S. E. de Nancy, 25 O. de Strasbourg, 78 S. E. de Paris. Long. 24d. 10'. 6''. lat. 48d. 35'. 23''. (D.J.)
|
| LUNISOLAIRE | adj. (Astronomie) marque ce qui a rapport à la révolution du soleil & à celle de la lune, considérés ensemble. Voyez PERIODE.
Année lunisolaire est une période d'années formée par la multiplication du cycle lunaire, qui est de 19 ans, & du cycle solaire qui est de 28. Le produit de ces deux nombres est 532.
Cette période est appellée dionysienne, du nom de Denis le Petit, son inventeur. Quand elle est révolue, les nouvelles & les pleines lunes reviennent à très-peu-près aux mêmes jours du mois ; & chaque jour du mois se retrouve précisément aux mêmes jours de la semaine.
Dans l'ancien calendrier le jour de Pâques revenoit au même jour du mois au bout de la période dionysienne, parce qu'au bout de cette période la pleine lune de l'équinoxe tomboit au même jour du mois de Mars ou d'Avril, & qu'outre cela l'année avoit la même lettre dominicale. Voyez ANNEE & PERIODE. Chambers. (O)
|
| LUNO | (Hist. nat.) espece de graine qui croît en Afrique, au royaume de Congo ; elle est triangulaire, ce qui la fait regarder comme une espece de blé noir, ou blé sarrasin ; elle sert à la nourriture des habitans du pays.
|
| LUNULE | S. f. (Géométr.) figure plane en forme de croissant, terminée par des portions de circonférence de deux cercles qui se coupent à ses extrêmités.
Quoiqu'on ne soit point encore venu à bout de trouver la quadrature du cercle en entier, cependant les Géometres ont trouvé moyen de quarrer plusieurs parties du cercle : la premiere quadrature partielle qu'on ait trouvée, a été celle de la lunule : nous la devons à Hippocrate de Chio. Voyez GEOMETRIE.
Soit A E B (Pl. de Géométrie, fig. 8.) un demi-cercle, & G C = G B ; avec le rayon B C décrivez un quart de cercle A F B, A E B F A sera la lunule d'Hippocrate.
Or puisque le quarré B C est double de celui de G B (voyez HYPOTHENUSE) le quart de cercle A F B C sera égal au demi-cercle A E B ; ôtant donc de part & d'autre le segment commun A F B G A, la lunule A E B F A se trouvera égale au triangle rectiligne A C B, ou au quarré de G B. Chambers.
Voyez sur la lunule d'Hippocrate & sur Hippocrate même, les mémoires de l'Académie des sciences de Prusse, année 1748. Voyez aussi l'article GEOMETRIE.
Différens géometres ont prouvé que non-seulement la lunule d'Hippocrate étoit quarrable, mais encore que l'on pouvoit quarrer différentes parties de cette lunule ; ce détail nous meneroit trop loin. On peut consulter un petit écrit de M. Clairaut le cadet, qui a pour titre, diverses quadratures circulaires, elliptiques & hyperboliques. (O)
LUNULE, lunula, (Littér.) ornement que les patriciens portoient sur leurs souliers, comme une marque de leur qualité & de l'ancienneté de leur race. Martial nous le prouve lorsque pour caractériser une vieille noblesse il dit, liv. II. épig. 29, non hesterna sedet limatâ lingula plantâ.
Cet ornement, inventé par Numa, étoit, selon l'opinion la plus généralement reçue, une espece d'anneau de boucle d'ivoire qu'on attachoit sur la cheville du pié. Plutarque, dans ses questions romaines, regardoit cette boucle lunaire comme un symbole qui signifioit l'inconstance de la fortune, ou que ceux qui portoient de ces lunules seroient après leur mort élevés au-dessus de l'astre dont elles étoient l'image ; mais Isidore, Orig. liv. XIX. ch. xxxjv. prétend plus simplement que cet ornement représentoit la lettre C, pour conserver le souvenir de cent sénateurs établis par Romulus. (D.J.)
|
| LUNUS | (Art numer.) Le dieu Lunus, appellé par les Grecs, paroît sur plusieurs médailles de Sardes ; il est représenté avec un bonnet phrygien sur sa tête & une pomme de pin à la main : il porte quelquefois un croissant sur les épaules, comme sur deux médailles décrites par Haym. On voit d'un côté la tête du dieu Lunus, avec le bonnet phrygien & le croissant : on lit autour MHN ACKHNOC ; de l'autre côté, un fleuve couché & appuyé sur son urne, tient de la droite un roseau, & de la gauche une corne d'abondance, avec la légende KAPIANON B. NEKOPN, & à l'exergue, EPMOC. L'autre médaille dont parle Haym, a la même tête avec la même légende, & au revers un gouvernail & une corne d'abondance posés l'un sur l'autre en sautoir, avec la légende, KAPIANN B. NEKOPN. Ces deux médailles ont été frappées sous le regne de Septime Severe. Le nom d'ACKHNOC est une épithete du dieu Lunus, à qui les peuples de l'Asie donnoient différens surnoms, comme de APNAKO dans le Pont, de KAPO ou KAH en Carie, de KAMAPEITH à Nysa, d'APKAIO en Pisidie, & suivant ces médailles, d'AKHNO en Lydie. Haym pense que ce nom est composé d'un A privatif, & de KHNH, tentorium ; & qu'il signifie mensis sive Lunus sine tentorio, parce que la lune ne s'arrête jamais, & est toujours en mouvement. Tous ces noms paroissent être des mots barbares, dont il est inutile de rechercher l'étymologie dans la langue grecque. Quoi qu'il en soit, le culte du dieu Lunus étoit établi en Syrie, en Mésopotamie, dans le Pont, & en plusieurs autres provinces de l'Orient. Mém. des Inscript. tome XVIII. p. 135. (D.J.)
LUNUS, s. m. (Mythol. Littér. Médaill.) divinité payenne qui n'est autre chose que la lune ; c'est Spartien qui nous l'apprend dans la vie de Caracalla.
Dans plusieurs langues de l'Orient cet astre a un nom masculin, dans d'autres un féminin ; & dans quelques-unes, comme en hébreu, il a deux genres, un masculin & un féminin. De là vient que plusieurs peuples en ont fait un dieu, d'autres une déesse, & quelques-uns une divinité hermaphrodite.
On peut en voir les épreuves en lisant les Recherc. curieus. d'antiq. de M. Spon, car je n'ose adresser mes lecteurs à Saumaise, ils seroient trop effarouchés de l'érudition qu'il a pris plaisir de prodiguer à ce sujet dans ses notes sur Spartien, sur Trebellius Pollion, & sur Vopiscus.
C'est assez pour nous de remarquer que les Egyptiens sont les premiers qui de la même divinité ont fait un dieu & une déesse ; & leur exemple ayant été suivi par les autres nations, une partie des habitans de l'Asie & ceux de la Mésopotamie en particulier, honorerent la lune comme dieu, tandis que les Grecs, qui lui avoient donné place entre les déesses, l'adoroient sous le nom de Diane.
Mais entre les peuples qui mirent la lune au rang des divinités mâles, les habitans de Charres en Mésopotamie ne doivent pas être oubliés ; ils lui rendoient de si grands honneurs, que Caracalla fit un voyage exprès dans cette ville pour en être témoin.
Les médailles frappées en Carie, en Phrygie, en Pisidie, nous offrent assez souvent le Dieu Lunus représenté sous la forme d'un jeune homme, portant sur sa tête un bonnet à l'arménienne, un croissant sur le dos, tenant de la main droite une bride, de la main gauche un flambeau, & ayant un coq à ses pieds.
Tristan a eu raison de croire qu'une figure toute semblable qu'il trouva sur une médaille d'Hadrien, devoit être le dieu Lunus ; cet auteur n'a pas toujours aussi bien rencontré. C'est aussi sans doute le dieu Lunus qu'on voit sur une pierre gravée du cabinet du Roi : ce dieu est en habit phrygien, son bonnet, sa tunique, son manteau, sa chaussure, indiquent le pays où son culte a dû prendre naissance ; & le croissant qui est derriere sa tête le caractérise à ne pouvoir pas le méconnoître. Une longue haste sur laquelle il s'appuie, est une marque de sa puissance. Il porte dans sa main une petite montagne, ou parce que c'est derriere les montagnes que le dieu Lunus disparoît à nos yeux, ou parce que c'est toujours sur les hauteurs que se font les observations astronomiques. (D.J.)
|
| LUPANNA | (Géog.) île de la mer Adriatique dans l'état de la petite république de Raguse, proche de l'île de Mezo. Cette petite île a un assez bon port, & elle est très-bien cultivée par les Ragusains. (D.J.)
|
| LUPERCAL | S. m. (Littér.) nom de la grotte où la fable dit que Remus & Romulus avoient été alaités par une louve. Cette grotte étoit au pied du Mont Palatin, près de l'endroit où Evandre, natif d'Arcadie, avoit long-tems auparavant bâti un temple au dieu Pan, & établi les lycées ou les lupercales en son honneur. Ce temple prit ensuite le nom de lupercal, & les luperques instituées par Romulus, continuerent d'y faire leurs sacrifices au même dieu.
|
| LUPERCALES | S. f. pl. lupercalia, (Littér. rom.) fête instituée à Rome en l'honneur de Pan. Elle se célébroit, selon Ovide, le troisieme jour après les ides de Février.
Romulus n'a pas été l'inventeur de cette fête, quoiqu'en dise Valere-Maxime ; ce fut Evandre qui l'établit en Italie, où il se retira soixante ans après la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande divinité de l'Arcadie, Evandre, natif d'Arcadie, fonda la fête des lupercales en l'honneur de cette divinité, dans l'endroit où il bâtit des maisons pour la colonie qu'il avoit menée, c'est-à-dire sur le mont Palatin. Voilà le lieu qu'il choisit pour élever un temple au dieu Pan, ensuite il ordonna une fête solemnelle qui se célébroit par des sacrifices offerts à ce dieu, & par des courses de gens nuds portant des fouets à la main dont ils frappoient par amusement ceux qu'ils rencontroient sur leur route. Nous apprenons ces détails d'un passage curieux de Justin, lib. XLIII. cap. j. In hujus (montis Palatini) radicibus templum Lycaeo, quem Graeci Pana, Romani Lupercum appellant, constituit Evander, Ipsum dei simulachrum nudum, caprinâ pelle amictum est, quo habitu, nunc Romae lupercalibus decurritur.
Tout cela se passoit avant que Romulus & Rémus ayent pu songer à la fondation de Rome ; mais comme l'on prétendoit qu'une louve les avoit nourris dans l'endroit même qu'Evandre avoit consacré au dieu Pan, il ne faut pas douter que ce hasard n'ait engagé Romulus à continuer la fête des lupercales, & à la rendre plus célebre.
Evandre avoit tiré cette fête de la Grece avec son indécence grossiere, puisque des bergers nuds couroient lascivement de côté & d'autre, en frappant les spectateurs de leurs fouets. Romulus institua des luperques exprès pour les préposer au culte particulier de Pan ; il les érigea en colleges ; il habilla ces prêtres, & les peaux des victimes immolées leur formoient des ceintures, cincti pellibus immolatarum hostiarum jocantes obviam petiverunt, dit Denis d'Halicarnasse, lib. I. Les luperques devoient donc être vêtus & ceints de peaux de brebis, pour être autorisés, en courant dans les rues, à pouvoir insulter les curieux sur leur passage, ce qui faisoit ce jour-là l'amusement du petit peuple.
Cependant la cérémonie des lupercales tombant de mode sur la fin de la république, quoique les deux colléges des luperques subsistassent avec tous leurs biens, & que Jules-César eût créé un troisieme college des mêmes prêtres, Auguste ordonna que les lupercales fussent remises en vigueur, & défendit seulement aux jeunes gens qui n'avoient point encore de barbe, de courir les rues avec les luperques un fouet à la main.
On ne devine point la raison qui put déterminer Auguste à rétablir une fête ridicule, puisqu'elle s'abolissoit d'elle-même ; mais il est encore plus étrange de voir que cette fête vient à reprendre une telle vogue, qu'elle ait été continuée sous les empereurs chrétiens ; & que lorsqu'enfin le pape Gélase ne voulut plus la tolérer, l'an 496 de J. C. il se trouva des chrétiens parmi les sénateurs mêmes qui tâcherent de la maintenir, comme il paroît par l'apologie que ce pape écrivit contr'eux, & que Baronius nous a conservée toute entiere au tome VI. de ses annales, ad annum 496, n°. 28 & seq.
Je finis par remarquer avec Plutarque, que plusieurs femmes ne se sauvoient point devant les luperques, & que loin de craindre les coups de fouet de leur courroies, elles s'y exposoient au contraire volontairement, dans l'espérance de devenir fécondes si elles étoient stériles, ou d'accoucher plus heureusement si elles étoient grosses.
Le mot lupercale vient peut-être de lupus, un loup, parce qu'on sacrifioit au dieu Pan un chien, ennemi du loup, pour prier ce dieu de garantir les troupeaux contre les loups.
L'usage de quelques jeunes gens qui couroient dans cette fête presque nuds, s'établit, dit-on, en mémoire de ce qu'un jour qu'on célébroit les lupercales, on vint avertir le peuple que quelques voleurs s'étoient jettés sur les troupeaux de la campagne ; à ce récit plusieurs spectateurs se deshabillerent pour courir plus vîte après ces voleurs, eurent le bonheur de les atteindre & de sauver leur bétail.
On peut ici consulter Denys d'Halicarnasse, l. I. Tite-Live, lib. I. cap. v. Plutarque, dans la vie de Romulus, d'Antoine, & dans les questions romaines ; Ovide, fastes, liv. II. Justin, lib. XLIII. Varron, lib. V. Valere-Maxime, Servius sur l'Enéïde, lib. VIII. v. 342 & 663. Scaliger, Meursius, Rosinus, Vossius & plusieurs autres. (D.J.)
|
| LUPERQUES | S. m. pl. luperci, (Littér.) prêtres préposés au culte particulier du dieu Pan, & qui célébroient les lupercales. Comme on attribuoit leur institution à Romulus, ces prêtres passoient pour les plus anciens qui ayent été établis à Rome.
Ils étoient divisés en deux communautés, celle des Quintiliens & celle des Fabiens, pour perpétuer, dit-on, la mémoire d'un Quintilius & d'un Fabius, qui avoient été les chefs, l'un du parti de Romulus, & l'autre de celui de Rémus. Cicéron, dans son discours pour Coelius, traite le corps des luperques de société agreste, formée avant que les hommes fussent humanisés & policés. Cependant César, qui avoit besoin de créatures dans tous les ordres, fit ériger par son crédit & en son honneur, un troisieme college de luperques, auquel il attribua de bons revenus. Cette troisieme communauté fut nommée celle des Juliens, à la gloire du fondateur : c'est ce que nous apprennent Dion, liv. XLIV. & Suétone dans sa vie de César, ch. lxxvj.
Marc Antoine pour flatter son ami, se fit aggréger à ce troisieme collége ; & quoiqu'il fût consul, il se rendit, graissé d'onguens & ceint par le corps d'une peau de brebis, à la place publique, où il monta sur la tribune dans cet ajustement, pour y haranguer le peuple. Cicéron en plein sénat lui reprocha cette indécence, que n'avoit jamais commise avant lui, non-seulement aucun consul, mais pas même aucun prêteur, édile ou tribun du peuple. Marc-Antoine tâcha de justifier sa conduite par sa qualité de luperque, mais Cicéron lui répondit que la qualité de consul qu'il avoit alors devoit l'emporter sur celle de luperque, & que personne n'ignoroit que le consulat ne fût une dignité de tout le peuple, dont il falloit conserver par-tout la majesté, sans la deshonorer comme il avoit fait.
Pour ce qui regarde les cérémonies que les luperques devoient observer en sacrifiant, elles étoient sans doute assez singulieres, vu qu'entr'autres choses il y falloit deux jeunes garçons de famille noble qui se missent à rire avec éclat lorsque l'un des luperques leur avoit touché le front avec un couteau sanglant, & que l'autre le leur avoit essuyé avec de la laine trempée dans du lait. Voyez là-dessus Plutarque dans la vie de Romulus.
Quand aux raisons pour quoi ces prêtres étoient nuds avec une simple ceinture pendant le service divin, voyez Ovide, qui en rapporte un grand nombre au II. liv. des fastes. Il y en a une plaisante tirée de la méprise de Faunus, c'est-à-dire du dieu Pan, amoureux d'Omphale, qui voyageoit avec Hercule. Elle s'amusa le soir à changer d'habit avec le héros ; Faunus, dit Ovide, après avoir fait le récit de cette avanture, prit en horreur les habits qui l'avoient trompé, & voulut que ses prêtres n'en portassent point pendant la cérémonie de son culte. (D.J.)
|
| LUPIAE | (Géog. mod.) , selon Strabon, liv. VI. p. 282, & Lupia, selon Pline, liv. III. ch. vj. ancienne ville d'Italie dans la Calabre, sur la côte de la mer, entre Brindes & Otrante. C'étoit une colonie romaine : on croit que c'est présentement la Tour de Saint-Catalde.
|
| LUPIN | S. m. lupinus, (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur légumineuse ; il sort du calice un pistil, qui devient dans la suite une silique remplie de semences plates dans des especes de ce genre, & rondes dans d'autres. Ajoutez à ces caracteres que les feuilles sont disposées en éventail, ou en main ouverte sur leur pédicule. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
Parlons à présent des especes de lupins. M. de Tournefort en compte dix-sept, qui sont toutes agréables par la variété de leurs fleurs & de leurs graines. La plus commune que nous allons décrire, est le lupin cultivé à fleurs blanches, lupinus sativus, flore albo, C. B. P. 347. I. R. H. 392.
Sa racine est ordinairement unique, ligneuse & garnie de plusieurs fibres capillaires. Sa tige est haute d'une coudée ou d'une coudée & demie, médiocrement épaisse, droite, cylindrique, un peu velue creuse & remplie de moëlle. Après que les fleurs placées au sommet de cette tige sont séchées, il s'éleve trois rameaux au-dessous, dont chacun donne assez souvent deux autres rameaux, quelquefois trois de la même maniere, sur-tout lorsque le lupin a été semé dans le tems convenable, & que l'été est chaud.
Ses feuilles sont alternes ou placées sans ordre, portées sur des queues longues de deux ou trois lignes, composées le plus souvent de segmens oblongs, étroits, qui naissent de l'extrémité de la queue dans le même point, comme dans la quinte-feuille. On peut les nommer assez bien feuilles en éventails, ou feuilles en main ouverte. Elles sont d'un verd foncé, entieres à leur bord, velues en-dessous, & garnies d'un duvet blanc & comme argenté ; les bords de leurs segmens s'approchent & se resserrent au coucher du soleil, s'inclinent vers la queue & se réfléchissent vers la terre.
Les fleurs sont rangées en épic au sommet des tiges ; elles sont légumineuses, blanches, portées sur des pédicules courts. Il sort de leur calice un pistil, qui se change en une gousse épaisse, large, applatie, longue environ de trois pouces, droite, plus petite que la feve, pulpeuse, jaunâtre, un peu velue en-dehors, lisse en-dedans.
Cette gousse contient cinq ou six graines assez grandes, orbiculaires, un peu anguleuses, applaties. Elles renferment une plantule fort apparente, & sont creusées légerement en nombril du côté qu'elles tiennent à la gousse, blanchâtres en-dehors, jaunâtres en-dedans, & fort ameres.
On seme cette plante dans les pays chauds de la France, en Italie, en Espagne & en Portugal. La farine de sa graine est de quelque usage en médecine dans les cataplâmes résolutifs.
On cultive les lupins en Toscane, non-seulement pour servir de nourriture au peuple, mais encore pour engraisser les terres. On les employoit déjà au même usage du tems de Pline, qui les vante comme un excellent fumier pour engraisser les champs & les vignobles. On les seme en Angleterre parmi les panais pour la nourriture du bétail.
On cultive les plus belles especes de lupins à fleurs bleues, jaunes, pourpres, incarnates, pour des bordures de jardins, où elles donnent un coup-d'oeil agréable, en produisant pendant long-tems une succession de fleurs, lorsqu'on les seme en Avril, en Mai & Juin dans le même endroit où l'on veut les laisser à demeure ; voyez Miller qui vous apprendra les détails, tandis que je vais dire un mot de l'usage que les anciens ont fait de la graine, qu'ils nommoient lupin comme nous. (D.J.)
LUPIN, (Littér.) en latin lupinus ou lupinum, semence de lupin.
Du tems de Galien, on faisoit souvent usage des graines de lupin pour la table ; aujourd'hui on n'en mange plus. Lorsqu'on les macere dans l'eau chaude, ils perdent leur amertume & deviennent agréables au goût. On les mangeoit cuits avec de la saumure simple, ou avec de la saumure & du vinaigre, ou même assaissonnés seulement avec un peu de sel. Pline rapporte que Protogene travaillant à ce chef-d'oeuvre du Jalyse, pour l'amour duquel Démétrius manqua depuis de prendre Rhodes, ne voulut pendant longtems se nourrir que de lupins simplement apprêtés, de peur que d'autres mets ne lui rendissent les sens moins libres ; je ne conseillerois pas ce régime à tous les Artistes, mais je loue le principe qui guidoit le rival d'Apelle & l'ami d'Aristote.
Les comédiens & les joueurs à Rome se servoient quelquefois de lupins, au lieu d'argent ; & on y imprimoit une certaine marque pour obvier aux friponneries : cette monnoie fictive couroit entr'eux, pour représenter une certaine valeur qui ne passoit que dans leur société. De-là vient qu'Horace, ep. VII. l. I. dit qu'un homme sensé connoît la différence qu'il y a entre l'argent & les lupins.
Nec tamen ignorat quid distent aera lupinis.
Il y a un passage assez plaisant à ce sujet dans le Paenulus de Plaute, act. III. scene II. le voici :
Aga. Agite, inspicite, aurum est. Col. Profecto,
Spectatores, comicum !
Macerato hoc pingues fiunt auro, in barbariâ boves.
" Aga, c'est de l'or. Col. oui, ma foi, messieurs, c'est de l'or de comédie ; c'est de cet or dont on se sert en Italie pour engraisser les boeufs ".
Il paroît par une loi de Justinien, liv. I. cod. titre de Aleatoribus, que les joueurs se servoient souvent de lupins, au lieu d'argent, comme nous nous servons de jettons : " Si quelqu'un, dit la loi, a perdu au jeu des lupins ou d'autres marques, celui qui a gagné ne pourra s'en faire payer la valeur.
Je ne sai d'où vient l'origine de lupin ; mais je ne puis la tirer du grec , tristesse, parce que les anciens Grecs ne font point mention de ce légume ; il n'étoit connu qu'en Italie ; c'est donc plutôt à cause de son amertume, que Virgile appelle lupin, triste, triste. On corrigeoit, comme j'ai dit, ce défaut en faisant cuire la graine dans de l'eau bouillante que l'on jettoit ; ensuite on les égouttoit bien & on les apprétoit. (D.J.)
LUPIN, (Mat. méd.) on n'emploie que la semence de cette plante ; elle a une saveur herbacée, amere, très-desagréable.
Galien & Pline assûrent que de leur tems les lupins étoient un aliment assez ordinaire ; le dernier de ces auteurs rapporte que Protogene n'avoit vécu que de lupins pendant le tems qu'il étoit occupé à peindre un célebre tableau. Plusieurs modernes ont avancé au contraire avec Averroés, que la graine de lupin prise intérieurement étoit un poison, & ont rapporté des faits sur lesquels ils ont appuyé cette opinion : mais ces faits sont peu concluans, & s'il est vrai que les lupins avalés avec toute leur amertume naturelle ayent occasionné une irritation considérable dans les organes de la digestion, & même quelques agitations convulsives dans les sujets foibles ; il est au moins très-vraisemblable que ce légume n'a aucune qualité dangereuse, lorsqu'il a perdu son amertume, dont on le dépouille facilement en le faisant macérer dans de l'eau. Quoi qu'il en soit, nos paysans même les plus pauvres n'en mangent pas, nos Peintres ne s'avisent pas de se mettre au lupin pour toute nourriture lorsqu'ils exécutent les plus grands ouvrages, & on ne les ordonne point intérieurement comme remede.
On n'emploie les lupins qu'extérieurement, soit en décoction, soit en substance, & réduits en farine. La décoction de lupins, appliquée en fomentation, passe pour guérir les dartres, la teigne & les autres maladies de la peau. La farine de lupin est une des quatre farines résolutives. Voyez FARINES RESOLUTIVES, les quatre. (b)
|
| LUPINASTRE | S. m. lupinaster, (Botan.) nouveau genre de plante établi par Buxbaum, qui lui a donné ce nom à cause de sa ressemblance aux caracteres du lupin.
Les fleurs du lupinastre sont légumineuses, d'un pourpre bleu ; elles s'élevent hors du calice, forment une tête, & sont soutenues par un long pédicule qui sort des aisselles des feuilles ; le calice est divisé en plusieurs segmens ; les tiges ne montent qu'à la hauteur de sept ou huit pouces ; les feuilles sont en éventail, ou en main ouverte, longues, d'un verd bleuâtre, finement dentelées & élégamment cannelées. Elles naissent au nombre de six, sept ou huit portées sur une queue, qui part d'une membrane jaunâtre, dont la tige est revêtue ; les gousses sont longues, applaties ; les graines sont noires & taillées en forme de rein. Cette plante croit en abondance sur les bords du Volga. Voyez les Mémoires de Petersbourg, vol. II. p. 346. (D.J.)
|
| LUQUOISE | S. f. (Commerce) sorte d'étoffe de soie ; elle est montée à huit lisses, & elle a autant de lisses pour rabattre, qu'elle en a pour lever, de maniere qu'à chaque coup de la tête on fait baisser une lisse de rabat, & on passe la navette de la même couleur, ce qui fait un diminutif du lustrine. Voyez l'article LUSTRINE. La chaîne en est très-menue, ainsi que la trame.
|
| LUSACE | LA, Lusatia, & en allemand Lausnitz, (Géog.) province d'Allemagne dans la Saxe, bornée N. par le Brandebourg, E. par la Silésie, S. par la Bohéme, O. par la Misnie. On la divise en haute & en basse. La haute appartient à l'électeur de Saxe depuis 1636. Bautzen, ou Budissen en est la capitale. La basse est partagée entre le roi de Prusse, l'électeur de Saxe & le duc de Mersebourg. M. Spener prétend que la Lusace a été nommée par les anciens auteurs, pagus Luzizorum ; &, en effet, la description donnée par Dirmar de Lucizi pagus convient fort à ces pays. Comme la Lusace contient six villes, savoir Gorlitz, Bautzen, Zittau, Camitz, Luben & Guben, les Allemands l'appellent quelquefois die sechs Staedten, c'est-à-dire les six villes. L'empereur Henri I. l'érigea en marquisat, & Henri IV. l'annexa à la Bohème. Voyez Heiss, Hist. de l'empire, liv. VI. chap. viij.
Quoique la Lusace soit une assez grande province, on peut dire que M. Tschirnaus lui a fait honneur par sa naissance en 1651. Il a découvert, non sans quelques erreurs, les fameuses caustiques qui ont retenu son nom ; c'est-à dire qu'il a trouvé que la courbe formée dans un quart de cercle par des rayons réfléchis, qui étoient venus d'abord paralleles à un diametre, étoit égale aux 3/4 du diametre.
Les grandes verreries qu'il établit en Saxe, lui procurerent un magnifique miroir ardent ; portant trois piés rhinlandiques de diametre convexe des deux côtés, & pesant 160 livres. Il le présenta à M. le régent, duc d'Orléans, comme une chose digne de sa curiosité.
Non-seulement M. de Tschirnaus trouva l'art de tailler les plus grands verres, mais aussi celui de faire de la porcelaine, semblable à celle de la Chine, invention dont la Saxe lui est redevable, & qu'elle a portée depuis, par les talens du comte de Hoym, à la plus haute perfection.
Je ne sache qu'un seul ouvrage de M. de Tschirnaus, & l'exécution ne répond pas à ce que la beauté du titre annonce, Medicina mentis & corporis, Amst. 1687, in-4°. Les vrais principes de la médecine du corps n'ont pas été développés par notre habile lusacien ; & il n'a guere bien fondé la médecine de l'esprit, en l'étayant sur la Logique. Pétrone a mieux connu la Médecine quand il l'a définie, consolatio animi ; celui qui pratique cet art, n'a souvent que ce seul avantage. Il ne peut produire dans plusieurs cas que la consolation de l'esprit du malade, par la confiance qu'il lui porte.
M. de Tschirnaus est mort en 1708, & M. de Fontenelle a fait son éloge dans l'hist. de l'acad. des Sciences, ann. 1709, (D.J.)
|
| LUSERNE | S. f. medica, (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur légumineuse ; il sort du calice un pistil, qui devient ensuite un fruit en forme de vis ; il renferme des semences qui ressemblent à un rein. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LUSIGNAN | Luziniacum, (Géogr.) petite ville de France en Poitou, sur la Vienne, à 5 lieues S. O. de Poitiers, 23 N. E. de la Rochelle, 80 S. O. de Paris. Long. 17. 42. latit. 16. 28.
Tout auprès de cette petite ville étoit le château de Lusignan, ou plutôt de Lezignen, en latin Leziniacum Castrum, connu dès le xj. siecle, ayant dès-lors ses seigneurs particuliers, qui devinrent dans la suite comtes de la Marche & d'Angoulême. Jean d'Arras dans son roman, & Bouchet dans ses annales, nous assûrent que c'étoit l'ouvrage de la fée Mellusine ; & bien que tout cela soit fables, dit Brantome, si on ne peut mal parler d'elle. Ce château bâti réellement par Hugues II. seigneur de Lusignan, fut pris sur les Calvinistes en 1575, après quatre mois de siege, par le duc de Montpensier ; & ce prince obtint d'Henri III. de le raser de fond en comble.
Ainsi fut détruit, continue Brantome, " ce château si ancien & si admirable, qu'on pouvoit dire que c'étoit la plus belle marque de forteresse antique, & la plus noble décoration vieille de toute la France. ". (D.J.)
|
| LUSIN | S. m. (Marine) c'est un même cordage un peu plus gros que celui que l'on appelle merlin. On s'en sert à faire des enfléchures : on le fait de trois fils.
|
| LUSITANIE | LA, Lusitania, (Géog. anc.) c'étoit une des trois provinces qui composoient l'Espagne, mais ses limites ne furent pas toujours les mêmes, & d'ailleurs on a souvent confondu la province très-étendue de la Lusitanie, avec celle qu'habitoient les Lusitaniens proprement dits. Quoi qu'il en soit, ce pays produisoit non-seulement toutes les denrées nécessaires à la vie, mais de plus il abondoit en mines d'or.
La province de Lusitanie jointe à celle de Galice & des Asturies, payoit aux Romains vingt mille livres d'or tous les ans. On trouve encore des paillettes d'or dans le Tage. Polybe remarque qu'un veau, qu'un cochon du poids de cent livres, ne valoit en Lusitanie que cinq drachmes ; qu'on vendoit cent brebis pour deux drachmes, un boeuf pour dix, & que les animaux tués dans les forêts se donnoient pour rien.
Comme une partie de l'ancienne Lusitanie répond au Portugal, on nomme présentement en latin ce royaume Lusitania ; mais il faut se rappeller que c'est très-improprement, parce que leurs bornes sont fort différentes. (D.J.)
|
| LUSITANIENS | Lusitani, (Géog. anc.) anciens peuples de l'Espagne dans la Lusitanie ; ils tiroient peut-être leur nom de Lusus, préfet de Bacchus ; voici du moins quel étoit le génie de ces premiers peuples, au rapport de Strabon, liv. III. Ils aimoient mieux subsister de brigandages, que de labourer la terre fertile de leur pays ; ils vivoient d'ailleurs très-simplement & très-sobrement, n'usoient que d'un seul mets à leur repas, se baignoient dans l'eau froide, se chauffoient avec des cailloux rougis au feu, & ne s'habilloient que de noir. Ils commerçoient en échange, ou se servoient quelquefois de lames d'argent pour leurs achats, dont ils coupoient des morceaux. Ils exposoient leurs malades sur les chemins publics, afin que les passans qui sauroient des remedes à leur état, pussent les leur indiquer. Du reste, les Lusitaniens étoient pleins de valeur, & les Romains les soumirent moins par la force, que par la ruse & l'artifice.
|
| LUSO | (Géog.) petite riviere d'Italie, dans la Romagne ; elle a sa source vers le mont Feltre, près du duché d'Urbin, & se jette dans le golfe de Venise, entre Rimini & Cervia. Le Luso est l'ancien Rubicon, dont les auteurs ont tant parlé, & sur lequel Villani a fait une dissertation fort curieuse. Voyez RUBICON.
|
| LUSORIA | (Antiq. rom.) endroits particuliers que les empereurs faisoient construire dans l'enceinte de leurs palais, ou tout auprès, pour se donner le divertissement des jeux, des combats de gladiateurs ou de bêtes féroces, hors de la foule, &, pour ainsi dire, dans leurs domestiques.
Lampride, dans la vie d'Eliogabale, fait mention des Lusoria que les empereurs avoient à Rome. Domitien en avoit un à Albe, dont il est parlé dans Juvenal, sat. IV. vers. 99. & dans son ancien scholiaste. Lactance parle de celui de Valere Maximien, dans lequel il se plaisoit à faire déchirer des hommes par des ours furieux. A Constantinople, il y avoit deux de ces lusoria, l'un dans la quatorzieme région, & l'autre dans la premiere auprès du grand palais.
Ces lusoria étoient des diminutifs de vrais amphithéâtres. Ils étoient beaucoup plus petits & beaucoup moins couteux, mais destinés aux mêmes usages. Peut-être ont-ils servi de modeles aux petites arenes, dont la mémoire s'est conservée en un si grand nombre de villes. (D.J.)
|
| LUSTRAGE | S. m. (Manuf. en soie) machine composée d'un chassis fort, à la traverse duquel & d'un côté sont deux crochets fixes ; d'une écroue de deux pouces de diametre attachée à une grande roue, dans laquelle entre une vis de pareille grosseur, dont la tête traverse une coulisse mouvante, à laquelle sont fixés deux autres crochets vis-à-vis des deux autres, & de deux boulons de fer polis & tournés qu'on place dans les deux crochets de chaque côté. Cet assemblage sert à lustrer la soie, & sur-tout la grosse. Pour cet effet, on prend une quantité d'echevaux de soie teinte, qu'on met autour des boulons entre les deux crochets ; on a l'attention de les bien égaliser. Puis on tourne la roue qui, au moyen de l'écroue, tirant la coulisse & la vis, donne une si forte extension à la soie, qu'elle en augmente le brillant. On laisse la soie tendue pendant un certain tems, après quoi on la leve pour en mettre d'autre.
|
| LUSTRAL | JOUR, (Antiq. grec. & rom.) en grec , en latin lustricus dies ; voilà comme on appelloit chez les Grecs & les Romains le jour dans lequel les enfans nouveau-nés recevoient leur nom & la cérémonie de leur lustration. La plûpart des auteurs assurent que c'étoit pour les mâles le neuvieme jour après leur naissance, & le huitieme pour les femelles. D'autres prétendent que c'étoit le cinquieme jour après la naissance, sans aucune distinction pour le sexe ; & d'autres établissent que le jour lustral étoit le dernier jour de la semaine où l'enfant étoit né.
Quoi qu'il en soit, cette cérémonie se pratiquoit ainsi. Les accoucheuses, après s'être purifiées elles-mêmes, en lavant leurs mains, faisoient trois fois le tour du foyer avec l'enfant dans leurs bras ; ce qui désignoit d'un côté son entrée dans la famille, & de l'autre, qu'on le mettoit sous la protection des dieux de la maison à laquelle le foyer servoit d'autel ; ensuite on jettoit par aspersion quelques gouttes d'eau sur l'enfant.
On célébroit ce même jour un festin, avec de grands témoignages de joie, & on recevoit des présens de ses amis à cette occasion. Si l'enfant étoit un mâle, la porte du logis étoit couronnée d'une guirlande d'olive ; si c'étoit une femelle, la porte étoit ornée d'écheveaux de laine, symbole de l'ouvrage auquel le beau sexe devoit s'occuper. Voyez Potter, Archaeol. graec. lib. IV. cap. xiv. tit. I. & Lomeier, de lustrationibus veterum gentilium. (D.J.)
|
| LUSTRALE | EAU (Littér.) eau sacrée qu'on mettoit dans un vase à la porte des temples. Voyez EAU LUSTRALE. J'ajoute seulement que c'étoit parmi les Grecs une sorte d'excommunication, que d'être privé de cette eau lustrale. C'est pourquoi dans Sophocle, act. II. sect. j. Oedipe défend expressément de faire aucune part de cette eau sacrée au meurtrier de Laïus. (D.J.)
|
| LUSTRATION | S. f. (Antiq. grec. & rom.) en latin lustratio, cérémonies sacrées accompagnées de sacrifices ; par lesquelles cérémonies les anciens payens purifioient les villes, les champs, les troupeaux, les maisons, les armées, les enfans, les personnes souillées de quelque crime, par l'infection d'un cadavre ou par quelqu'autre impureté.
On faisoit les lustrations de trois manieres différentes ; ou par le feu, le soufre allumé & les parfums, ou par l'eau qu'on répandoit, ou par l'air qu'on agitoit autour de la chose qu'on vouloit purifier.
Les lustrations étoient ou publiques ou particulieres. Les premieres se faisoient à l'égard d'un lieu public, comme d'une ville, d'un temple, d'une armée, d'un camp. On conduisoit trois fois la victime autour de la ville, du temple, du camp, & l'on brûloit des parfums dans le lieu du sacrifice.
Les lustrations particulieres se pratiquoient pour l'expiation d'un homme, la purification d'une maison, d'un troupeau. A tous ces égards il y avoit des lustrations dont on ne pouvoit se dispenser, comme celles d'un camp, d'une armée, des personnes dans certaines conjonctures, & des maisons en tems de peste, &c. Il y en avoit d'autres dont on s'acquitoit par un simple esprit de dévotion.
Dans les armilustres qui étoient les plus célebres des lustrations publiques, on assembloit tout le peuple en armes, au champ de Mars, on en faisoit la revûe, & on l'expioit par un sacrifice au dieu Mars ; cela s'appelloit condere lustrum, & le sacrifice se nommoit solitaurilia ; parce que les victimes étoient une truie, une brebis, & un taureau. Cette cérémonie du lustre se faisoit ou devoit se faire tous les cinq ans le 19 Octobre ; mais on la reculoit fort souvent, sur-tout lorsqu'il étoit arrivé quelque malheur à la République, comme nous l'apprenons de Tite-Live. Eo anno, dit-il, lustrum propter capitolium captum & consulem occisum, condi religiosum fuit ; on se fit scrupule cette année de terminer le lustre à cause de la prise du capitole & de la mort d'un des consuls. Voyez LUSTRE.
Les anciens Macédoniens purifioient chaque année le roi, la famille royale, & toute l'armée, par une sorte de lustration qu'ils faisoient dans leur mois Xanthus. Les troupes s'assembloient dans une plaine, & se partageoient en deux corps, qui après quelques évolutions s'attaquoient l'un l'autre, en imitation d'un vrai combat. Voyez-en les détails dans Potter, Archaeol. graec. Lib. II. c. xx. t. I.
Dans les lustrations des troupeaux chez les Romains, le berger arrosoit une partie choisie de son bétail, avec de l'eau, brûloit de la sabine, du laurier & du soufre, faisoit trois fois le tour de son parc ou de sa bergerie, & offroit ensuite en sacrifice à la déesse Palès, du lait, du vin cuit, un gâteau, & du millet.
A l'égard des maisons particulieres, on les purifioit avec de l'eau & avec des parfums, composés de laurier, de genievre, d'olivier, de sabine, & autres plantes semblables. Si l'on y joignoit le sacrifice de quelque victime, c'étoit ordinairement celui d'un cochon de lait.
Les lustrations que l'on employoit pour les personnes, étoient proprement appellées des expiations, & la victime se nommoit hostia piacularis. Voyez EXPIATION.
Il y avoit encore une sorte de lustration ou de purification pour les enfans nouveaux nés, qu'on pratiquoit un certain jour après leur naissance, & ce jour s'appelloit chez les Romains lustricus dies, jour lustral. Voyez LUSTRAL, JOUR. (Antiq. grecq. & rom.)
Il paroît donc que lustration signifie proprement expiation ou purification. Lucain a dit purgare maenia lustro ; ce qui signifie purifier les champs en marchant tout-autour en forme de procession.
On peut consulter les auteurs des antiquités grecques & romaines qui ont rassemblé plusieurs choses curieuses sur les lustrations des payens ; mais Jean Lomeyer a épuisé la matiere dans un gros ouvrage exprès intitulé de lustrationibus veterum gentilium, à Utrecht 1681, in 4°. (D.J.)
|
| LUSTRE | S. m. (Botan.) le lustre, ou la girandole d'eau, est un genre de plante que M. Vaillant nomme en Botanique chara, & qu'il caractérise ainsi dans les Mém. de l'acad. des Scienc. ann. 1719.
Ses fleurs naissent sur les feuilles ; chaque fleur est incomplete , réguliere, monopétale & androgine : elles portent sur le sommet d'un ovaire dont les quartiers figurent une couronne antique. Par-là, cet ovaire devient une capsule couronnée, laquelle est monosperme. Les feuilles sont simples, sans queue, & disposées en rayons qui accollent la tige d'espace en espace. Celles d'où naissent les fleurs, sont découpées ; de maniere que les segmens d'un côté se trouvent directement opposés à ceux de l'autre, pour former ensemble comme des mors de pincettes, dans chacun desquels un ovaire est engagé.
M. Linnaeus prétend que le caractere de ce genre de plante consiste en ce que le calice est petit & composé de deux feuilles. Il est fort douteux que la fleur soit monopétale, & même qu'il y en ait une. Il n'y a point d'apparence d'étamines, ni de stile. Le germe du pistil est ovale, la graine est unique, & est d'une forme ovoïde & allongée.
Le chara & ses especes ont été mal rangés avant M. Vaillant parmi les equisetum ou prêles. Ces plantes n'ont d'autre rapport ensemble, qu'en ce que les feuilles du prêle & les branches de celui-ci sont disposées de la même maniere.
Le nom de lustre ou de girandole d'eau donné par M. Vaillant au chara, est fondé sur ce que ses verticilles ou rangs de feuilles chargés d'ovaires couronnés représentent assez bien ces sortes de chandeliers branchus, qu'on nomme lustres ou girandoles. (D.J.)
LUSTRE, s. m. (Littér : rom.) lustrum ; espace que les anciens & les modernes ont constamment regardé comme un intervalle de cinq ans. En effet, comme le cens devoit naturellement avoir lieu tous les cinq ans, cet espace de tems prit le nom de lustre, à cause d'un sacrifice expiatoire que les censeurs faisoient à la clôture du cens, pour purifier le peuple.
Si nous approfondissions cependant le véritable état de la chose, nous ne trouverions point de raison suffisante pour donner au lustre la signification précise de cinq ans ; nous verrions au contraire que le cens & le lustre furent célébrés le plus souvent sans regle, dans des tems incertains & différens, suivant l'exigence particuliere & les besoins de la république.
Ce fait résulte invinciblement & du témoignage des anciens auteurs, & des monumens antiques, tels que les fastes gravés sur le marbre & conservés au capitole, où l'on voit une suite de magistrats de la république, ainsi qu'un abrégé de leurs actions, depuis les premiers siecles de Rome. Par exemple, Servius Tullius qui établit le cens, adopta le lustre, & qui ne fit que quatre fois l'estimation des biens & le dénombrement des citoyens, commença à régner l'an 175, & son regne dura trente-quatre ans : Tarquin le superbe son successeur ne tint point de cens.
Les consuls P. Valerius & T. Lucretius rétablirent l'institution de Servius, & tinrent le cinquieme cens, l'an de Rome 245 ; les marbres du capitole manquent à cette époque, & l'on y voit une lacune qui comprend les sept premiers lustres, mais ils marquent que le huitieme fut fait l'an de Rome 279 ; desorte que les trois premiers lustres célébrés par les consuls, forment un intervalle de 34 ans.
Ce fut à la création des censeurs l'an de Rome 311, qu'on célébra le onzieme lustre qui à un an près, a le même intervalle que les trois derniers tenus par les consuls.
Le douzieme lustre, selon les marbres du capitole, se rapportent à l'an de Rome 390 ; ce qui montre que sous les censeurs créés afin de faire le dénombrement du peuple, & d'en estimer les biens, les neuf premiers lustres l'un dans l'autre, embrassent chacun d'eux à peu près l'espace de neuf années.
Le dernier lustre fut fait par les censeurs Appius Claudius & L. Pison l'an de Rome 703, & ce fut le 71e lustre. Si donc on compte les lustres, depuis le premier célébré par les censeurs jusqu'au dernier, on trouve entre chacun des 60 lustres intermédiaires, une intervalle d'environ six ans & demi : tel est le véritable état des choses. Il en résulte avec évidence, que quoique le tems & l'usage aient attaché l'idée d'un intervalle de cinq ans au mot lustre, c'est sans fondement que cet usage s'est établi.
Au reste, l'on n'a pas eu moins de tort d'écrire que Servius Tullius est l'auteur du lustre pris pour le sacrifice expiatoire du peuple. Servius Tullius n'inventa que le cens ou le dénombrement. Le lustre, la lustration, le sacrificium lustrale étoit d'usage avant ce prince ; je le prouve par ce passage de Tite-Live qui dit que Tullus Hostilius ayant gagné la bataille contre les habitans d'Albe, prépara un sacrifice lustral ou expiatoire pour le lendemain à la pointe du jour. Après que tout fut préparé selon la coutume, il fit assembler les deux armées, &c. Sacrificium lustrale in diem posterum parat, ubi illuxit. Paratis omnibus, ut assolet, vocari ad concionem utrumque exercitum jubet, &c.
Servius Tullius adopta seulement pour la clôture du cens le même sacrifice lustral, pratiqué avant lui par Tullus Hostilius, lors de sa bataille contre les Albains.
Si le mot lustrum, lustre, ne vient pas de lustrare, purifier, peut-être est-il dérivé de luere qui signifioit payer la taxe à laquelle chaque citoyen étoit imposé par les censeurs : c'est du moins le sentiment de Varron. (D.J.)
LUSTRE, (Chapeliers). On donne souvent le lustre aux chapeaux avec de l'eau commune, à quoi on ajoûte quelquefois un peu de teinture noire : le même lustre sert aux peaussiers, excepté qu'ils ne se servent jamais de teinture noire pour leurs fourrures blanches. Lorsqu'ils veulent donner le lustre à des fourrures très-noires, ils préparent quelquefois pour cela un lustre de noix de galle, de couperose, d'alun romain, de moëlle de boeuf, & d'autres ingrédiens. On donne le lustre aux draps, aux moëres, en les passant à la calandre, ou les pressant sous la calandre. Voyez CALANDRE.
LUSTRE, en terme de Boursiers, c'est une espece de vernis fait de blancs d'oeufs, de gomme, & d'encre, dont les boursiers se servent pour rendre leurs calottes de maroquin luisantes.
LUSTRE, (Corroyeurs). Les Corroyeurs s'y prennent de différentes façons pour donner le lustre à leurs cuirs, selon les différentes couleurs qu'ils veulent lustrer. Pour le noir, ils donnent le premier lustre avec le jus du fruit de l'épine-vinette, & le second avec un composé de gomme arabique, de biere douce, de vinaigre, & de colle de Flandre qu'ils font bouillir ensemble. Pour les couleurs, ils se servent d'un blanc d'oeuf battu dans de l'eau. On donne le lustre au maroquin avec du jus du fruit de l'épine-vinette & du jus d'orange ou de citron.
LUSTRE, (Pelletiers). Les Pelletiers se servent du même lustre que les Chapeliers, à l'exception qu'ils ne mettent point de teinture sur les fourrures blanches & sur celles qui sont d'une couleur claire. Quelquefois cependant ils composent un lustre pour les fourrures très-noires, & principalement pour celles qu'ils emploient aux manchons. Il y entre de la noix de galle, de la couperose, de l'alun de Rome, de la moëlle de boeuf, & quelques autres drogues.
|
| LUSTRÉ | adj. (Jardinage) se dit d'une anemone, d'une renoncule, d'une oreille d'ours, dont la couleur est luisante.
LUSTRER une glace, (Miroitier) c'est la rechercher avec le lustroir, après qu'on l'a entierement polie. On dit aussi moletter une glace, parce que les ouvriers donnent quelquefois au lustroir le nom de molette. Voyez GLACE & MOLETTE.
|
| LUSTRER | v. a. c'est donner du lustre. Voyez l'article LUSTRE.
LUSTRER, en terme de Boursier, c'est l'action de donner de l'éclat aux calottes, en les vernissant d'une certaine drogue faite exprès. Voyez LUSTRE.
|
| LUSTRINE | S. f. (Manufacture en soie) espece d'étoffe dont on connoîtra suffisamment la qualité, d'après ce que nous en allons dire.
On distingue plusieurs sortes de lustrine. Il y a la lustrine à poil, la lustrine sans poil, la lustrine courante, & la lustrine rebordée ou liserée & brochée.
De la lustrine sans poil. Quoique cette étoffe ne soit guere de mode aujourd'hui, cependant comme elle peut revenir, & qu'il s'en fabrique chez l'étranger, il ne sera pas inutile d'en donner une idée ; elle se fabrique à douze lisses, huit de satin, quatre de liage, & quatre de rabat. Voy. les articles LISSES & SATIN.
On entend par le rabat quatre lisses dont les fils sont passés sous la maille, comme au liage, avec cette différence, qu'à la premiere & à la seconde lisse, les fils sont passés sous la premiere lisse de rabat, & qu'à la troisieme & quatrieme ils sont passés sous la seconde lisse de rabat ; à la cinquieme & sixieme, sous la troisieme ; & à la septieme & huitieme, sous la quatrieme ; de maniere que les quatre lisses contiennent tous les fils de huit lisses de satin.
Par cette distribution on se propose d'exécuter sur cette étoffe une figure qui imite exactement le gros-de-Tours. Pour cet effet, la soie qui est tirée aux deux coups de navette de la premiere & seconde marches, est abaissée moitié net par deux lisses de rabat qu'on a soin de faire baisser sur chacun des deux coups qui sont passés sous la premiere & seconde marche, où il n'y a plus de liage par rapport au rabat ; observant de faire baisser les mêmes lisses sous la premiere & seconde marche, qui sont la premiere & la troisieme de rabat ; sous la troisieme & quatrieme marche, la seconde & la quatrieme de rabat ; sous la cinquieme & sixieme, la premiere & la troisieme ; enfin sous la septieme & la huitieme, la seconde & quatrieme, en se servant d'une seule navette pour aller & venir chaque coup, & la trame de la couleur de la chaîne.
De la lustrine courante. Si la lustrine est courante, à une seule navette, il ne faut que huit marches : si c'est à deux navettes qui fassent figures, comme aux satins en fin, il en faut douze ; & si elle est brochée & à deux navettes, il en faut seize & pas plus.
Armure d'une lustrine à une seule navette.
|
| LUSTRIN | (Manufacture en soie). Pour faire le lustriné, il faut deux chaînes de la même couleur & du même nombre de portées : l'une sert à faire le corps de l'étoffe en gros-de-Tours, par le moyen du remettage & de l'armure ; l'autre fait le fond façonné à la tire, & n'est point passée dans la remise ; on en fait en dorure comme en soie. La largeur de ceux de Lyon est de 11/24. Voyez ÉTOFFE DE SOIE.
On faisoit autrefois des lustrinés ; mais cette étoffe n'est plus en usage.
|
| LUSTROIR | S. m. (Manufacture de glace). On appelle ainsi dans les manufactures de glace, une petite regle de bois doublée de chapeau, de trois pouces de long, sur un pouce & demi de large, dont on se sert pour rechercher les glaces après qu'elles ont été polies, & pour enlever les taches qui ont échappé au polissoir. Cet instrument se nomme aussi molette. Voyez GLACE.
|
| LUT & LUTER | (Chimie) ce mot est tiré du latin lutum, boue, parce qu'un des luts le plus communément employés, est une boue ou de la terre détrempée.
On appelle lut toute matiere ténace qu'on applique aux vaisseaux chimiques, & qu'on y fait fortement adhérer, soit pour les munir contre l'action immédiate du feu, soit pour fermer les jointures des différens vaisseaux qu'on adapte les uns aux autres dans les appareils composés, soit enfin pour boucher les fentes des vaisseaux félés, en affermir & retenir les parties dans leur ancienne union, ou même les réunir lorsqu'elles sont entierement séparées.
Ce dernier usage n'est absolument que d'économie ; mais cette économie est presque de nécessité dans les laboratoires de chimie ; car s'il falloit mettre en rebut tous les vaisseaux, sur-tout de verre, félés & cassés, la consommation en deviendroit très-dispendieuse : les deux autres usages des luts sont presque absolument indispensables.
Premierement, quant aux luts destinés à prémunir les vaisseaux contre l'action immédiate du feu, ce n'est autre chose qu'un garni, voyez GARNI, un enduit de terre appliqué au vaisseau dans toute sa surface extérieure, & dont voici les avantages : ce ne sont que les vaisseaux fragiles, & fragiles par l'action du feu, & par conséquent ceux de verre & de terre, qu'on s'avise de luter, car appliquer un lut c'est luter. Voyez VAISSEAUX, (Chimie). Les vaisseaux de verre & de terre ne se rompent au feu que lorsqu'il est appliqué brusquement ou inégalement. Or un enduit d'une certaine épaisseur, d'une matiere incombustible & massive de terre, ne pouvant être échauffé ou refroidi, & par conséquent communiquer la chaleur & le froid qu'avec une certaine lenteur ; il est clair que le premier avantage que procure une bonne couche de lut, c'est de prémunir les vaisseaux contre un coup de feu soudain, ou l'abord brusque d'un air froid. Les intermedes appellés bains (voyez BAIN & INTERMEDE, Chimie), procurent exactement le même avantage ; aussi ne lute-t-on pas les vaisseaux qu'on expose au feu de ces bains dont la susceptibilité de chaleur n'est pas bornée, comme les bains de sable, de limaille, de cendres, &c. Mais ils ont dans les appareils ordinaires, l'inconvénient de ne diriger la chaleur vers le vaisseau que d'une maniere peu avantageuse, de n'en chauffer que la partie inférieure, ce qui restraint considérablement l'étendue du degré de feu qu'on peut commodément appliquer par le moyen de ces bains ; au-lieu que les vaisseaux lutés sont disposés, sur cette défense, le plus avantageusement qu'il est possible pour être exposés au feu de reverbere ou environnant, & en souffrir le degré extrême. Quand j'ai dit que les bains pulvérulens étoient d'un emploi moins commode & plus borné que le lut, j'ai ajoûté dans les appareils ordinaires ; car il y a moyen de disposer dans un fourneau de reverbere une capsule contenant une petite couche de sable, & de poser dessus une cornue ou une cucurbite non lutée avec tout l'avantage du lut dont nous avons parlé jusqu'à présent. Voyez l'article DISTILLATION. Je dis ce premier, car le lut en a un autre plus essentiel, plus particulier, dont nous ferons mention dans un instant. Il faut observer auparavant que quoiqu'il soit si supérieurement commode de travailler dans le feu très-fort avec les vaisseaux de verre & de terre lutés, & même dans le degré quelconque de feu mis avec les vaisseaux de verre lutés ; cependant les bons artistes n'ont pas absolument besoin de ce secours, du-moins pour les vaisseaux de terre ; & qu'il n'est point de bon ouvrier qui ne se chargeât d'exécuter, avec les vaisseaux de terre non lutés, les opérations qui se font ordinairement avec ces vaisseaux lutés, il n'auroit besoin pour cela que d'un peu plus d'assiduité auprès de son appareil, & de faire toujours le feu lui-même ; au-lieu que communément on se contente de faire entretenir le feu par les apprentifs & les manoeuvres. Il faut savoir encore que les vaisseaux de verre très-minces, tels que ceux qu'on appelle dans les boutiques phioles à médecine, peuvent sans être lutés se placer sans ménagement à-travers un brasier ardent.
Cet autre avantage plus essentiel du lut dont on enduit les vaisseaux de verre ou de terre destinés à essuyer un feu très-fort, c'est de les renforcer, de les maintenir, de leur servir pour ainsi dire de supplément ou d'en tenir lieu, lorsque les vaisseaux sont détruits en partie par la violence du feu. Ceci va devenir plus clair par le petit détail suivant : les cornues de verre employées à des distillations qui demandent un feu très-violent (à celle du nitre ou du sel marin avec le bol, par exemple), coulent ou se fondent sur la fin de l'opération ; si donc elles n'étoient soutenues par une enveloppe fixe indestructible, par une espece de second vaisseau, il est clair qu'une cornue qui se fond laisseroit répandre, tomber dans le foyer du fourneau les matieres qu'on y avoit renfermées, & qu'ainsi l'opération n'iroit pas jusqu'à la fin. Une bonne couche de lut bien appliquée, exactement moulée sur le vaisseau, devient dans ces cas le second vaisseau, & contient les matieres, qui dans le tems de l'opération, sont toujours seches jusqu'à ce qu'on les ait épuisées par le feu. On lute aussi quelquefois les creusets dans les mêmes vûes, lorsqu'on veut fondre dans ces vaisseaux des matieres très-fondantes, ou douées de la propriété des flux, (voyez FLUX & FONDANT, Chimie, Métal.) & qui attaquent, entament dans la fonte le creuset même, le pénetrent, le criblent, comme cela arrive souvent en procédant à l'examen des pierres & des terres par la fusion, selon la méthode du célebre M. Pott. Voyez LITHOGEOGNOSIE, PIERRES, TERRES.
Le lut à cuirasser les vaisseaux (le terme est technique, du-moins en latin ; loricare, luter, loricatio, action de luter) est diversement décrit dans presque tous les auteurs : mais la base en est toujours une terre argilleuse, dans laquelle on répand uniformément de la paille hachée, de la fiente de cheval, de la filasse, de la bourre, ou autres matieres analogues, pour donner de la liaison au lut, l'empêcher autant qu'il est possible, de se gerser en se dessechant. L'addition de chaux, de sable, de limaille de fer, de litarge, de sang, &c. qu'on trouve demandés dans les livres, est absolument inutile. Une argille quelconque, bien pétrie avec une quantité de bourre qu'on apprend facilement à déterminer par l'usage, & qu'il suffit de déterminer fort vaguement, fournit un bon lut, bien adhérent, & soutenant très-bien le feu. On y employe communément à Paris une espece de limon, connu sous le nom vulgaire de terre à four, & qui est une terre argilleuse mêlée de sablon & de marne. Cette terre est très-propre à cet usage ; elle vaut mieux que de l'argille ou terre de potier commune ; mais, encore un coup, cette derniere est très-suffisante.
Ce même lut sert à faire les garnis des fourneaux (voyez GARNI), à fermer les jointures des fourneaux à plusieurs pieces, & le vuide qui se trouve entre les cous des vaisseaux & les bords des ouvertures par lesquelles ces cous sortent des fourneaux ; à bâtir des domes de plusieurs pieces, ou à former avec des morceaux de briques, des débris de vaisseaux, des morceaux de lut secs, &c. des supplémens quelconques à des fourneaux incomplets, délabrés & dont on est quelquefois obligé de se servir ; enfin à bâtir les fourneaux de brique ; car comme dans la construction des fours de boulangers, des fourneaux de cuisine, &c. il ne faut y employer ni mortier ni plâtre. On peut se passer pour ce dernier usage de mêler des matieres filamenteuses à la terre.
Les luts à fermer les jointures des vaisseaux doivent être différens, selon la nature des vapeurs qui doivent parvenir à ces jointures ; car ce n'est jamais qu'à des vapeurs qu'elles sont exposées. Celui qu'on employe à luter ensemble les différentes pieces d'un appareil destiné à la distillation des vapeurs salines, & sur-tout acides, doit être tel que ces vapeurs ne puissent pas l'entamer. Une argille pure, telle que la terre à pipes de Rouen, & la terre qu'on employe à Montpellier & aux environs, à la préparation de la crême de tartre, fournit la base convenable d'un pareil lut : reste à la préparer avec quelque liqueur visqueuse, ténace, qui puisse la réduire en une masse liée, continue, incapable de contracter la moindre gersure, qui soit d'ailleurs souple, ductile, & qui ne se durcisse point assez en se dessechant, pour qu'il soit difficile de la détacher des vaisseaux après l'opération ; car la liaison grossiere & méchanique du lut à cuirasser seroit absolument insuffisante ici, où l'on se propose de fermer tout passage à la vapeur la plus subtile, & ce lut se desseche & se durcit au point qu'on risqueroit de casser les vaisseaux, en voulant enlever celui qui se seroit glissé entre deux.
Le meilleur lut de ce genre que je connoisse, est celui-ci, que j'ai toujours vû employer chez M. Rouelle, sous le nom de lut gras, & que M. Baron propose aussi dans ses notes sur la Chimie de Lémery.
Lut gras. Prenez de terre à pipes de Rouen, ou d'argille très-pure réduite en poudre très-fine, trois livres & demie ; de vernis de succin (voyez VERNIS & SUCCIN), quinze onces ; d'huile de lin cuite, sept à huit onces : incorporez exactement ces matieres en les battant long-tems ensemble dans le grand mortier de fer ou de bronze. Pour rendre ce mélange aussi parfait & aussi égal qu'il est possible, on déchire par petits morceaux la premiere masse qu'on a formée, en faisant absorber peu-à-peu tout le vernis & toute l'huile à l'argille ; on jette ces morceaux un à un dans le mortier, & en battant toujours, on les réunit à mesure qu'on les jette. On réitere cette manoeuvre cinq ou six fois. On apprend facilement par l'usage à déterminer les proportions des différens ingrédiens, que les artistes exercés n'ont pas besoin de fixer par le poids. Si après avoir fait le mêlange par estimation on ne le trouve pas assez collant, on ajoûte du vernis ; si on veut simplement le ramollir, on ajoûte de l'huile ; s'il manque de consistance, ou augmente la proportion de la terre.
Ce lut doit être gardé exactement enveloppé d'une vessie. Moyennant cette précaution, il se conserve pendant plusieurs années sans se dessécher. Mais s'il devient enfin trop sec, on le ramollit en le battant dans le mortier avec un peu d'huile de lin cuite.
Un lut qui est éminemment agglutinatif, mais que les acides attaquent, & que les vapeurs aqueuses même détruisent, qui ne peut par conséquent être appliqué que sur un lieu sec & à l'abri de toute vapeur ou liqueur, c'est celui qui résulte du mêlange de la chaux en poudre, soit vive, soit éteinte à l'air, & du fromage mou, ou du blanc d'oeuf. Un bande de linge bien imbibée de blanc d'oeuf, saupoudrée de chaux, humectée de nouveau avec le blanc d'oeuf, & chargée d'une nouvelle couche de chaux pétrie prestement avec le doigt, & étendue sur ce linge des deux côtés ; cette bande de linge ainsi préparée, dis-je, appliquée sur le champ & bien tendue sur les corps même les plus polis, comme le verre, y adhere fortement, s'y durcit bientôt, & forme un corps solide & presque continu avec celui auquel on l'applique. Ces qualités la rendent très-propre à affermir & retenir dans une situation constante les divers vaisseaux adaptés ensemble dans les appareils ordinaires de distillation, où l'on veut fermer les jointures le plus exactement qu'il est possible : c'est pour cela qu'après avoir bouché exactement le vuide de ces jointures avec du lut gras, on applique ensuite avec beaucoup d'avantage une bande de linge chargée de lut de blanc d'oeuf, sur les deux vaisseaux à réunir, de maniere que chacun des bords de la bande porte immédiatement sur le corps de l'un & l'autre vaisseau, & que la couche de lut soit embrassée & dépassée des deux côtés. Si on ne faisoit que recouvrir le lut, comme le prescrit M. Baron dans la note déjà citée, on ne rempliroit pas le véritable objet de l'emploi de ce second lut ; car ce qui rend le premier insuffisant, c'est qu'étant naturellement mou, & pouvant se ramollir davantage par la chaleur, il peut bien réunir très-exactement des vaisseaux immobiles, mais non pas les fixer, empêcher qu'au plus léger mouvement ils ne changent de situation, & ne dérangent par-là la position du lut, qui deviendra alors inutile.
Les jointures des vaisseaux dans lesquels on distille ou on digere à une chaleur légere des matieres qui ne jettent que des vapeurs aqueuses & spiritueuses, peu dilatées, faisant peu d'effort contre ces jointures, on se contente de les fermer avec des bandelettes de vessie de cochon mouillées, ou de papier chargées de colle ordinaire de farine.
Enfin les vaisseaux félés ou cassés se recollent ou se rapiécent avec les bandes de linge chargées de lut de chaux & de blanc d'oeuf ; sur quoi il faut observer, 1°. que des vaisseaux ainsi rajustés ne sauroient aller au feu ni à l'eau, & qu'ainsi ce radoub se borne aux chapiteaux, aux récipiens, aux poudriers, & aux bouteilles, qu'encore il ne faut point rincer en dehors ; 2°. que lorsque ces vaisseaux à recoller sont destinés à contenir des liqueurs, il est bon d'étendre d'abord le long de la fente une couche mince & étroite, un filet de lut gras, & d'appliquer par-dessus une large bande de linge, &c. (G)
|
| LUTH | S. m. (Luth.) instrument de musique à cordes ; comme il differe peu du théorbe, qui n'est à proprement parler qu'un luth à deux manches, nous renvoyons ce que nous avons à dire du luth à l'article THEORBE.
|
| LUTHÉRANISME | (Théol.) sentimens du docteur Luther & de ses sectateurs sur la Religion.
Le luthéranisme eut pour auteur, dans le xvj. siecle, Martin Luther, dont il a pris son nom. Cet hérésiarque naquit à Eisleben, ville du comté de Mansfeld en Thuringe, l'an 1483. Après ses études il entra dans l'ordre des Augustins en 1508 : il vint à Vittemberg & y enseigna la Philosophie dans l'université qui y avoit été établie quelques années auparavant. En 1512 il prit le bonnet de docteur en théologie : il commença en 1516 à s'élever contre la théologie scholastique, qu'il combattit cette année là dans des theses. En 1517 Léon X. ayant fait prêcher des indulgences pour ceux qui contribueroient aux dépenses de l'édifice de S. Pierre de Rome, il en donna la commission aux Dominicains : les Augustins prétendirent qu'elle leur appartenoit préférablement à eux ; & Jean Staupitz, leur commissaire général en Allemagne, donna ordre à Luther de prêcher contre ces quêteurs. Voyez INDULGENCE.
Luther, homme violent & emporté, & d'ailleurs fort vain & fort plein de lui-même, s'acquitta de cette commission d'une autre maniere que son supérieur apparemment n'avoit voulu. Des prédicateurs des indulgences, il passa aux indulgences même, & déclama également contre les uns & contre les autres. Il avança d'abord des propositions ambiguës ; engagé ensuite par la dispute, il les soutint dans un mauvais sens, & il en dit tant, qu'il fut excommunié par le pape l'an 1520. Il goûta si bien le plaisir flatteur de se voir chef de parti, que ni l'excommunication de Rome, ni la condamnation de plusieurs universités célébres, ne firent point d'impression sur lui. Ainsi il fit une secte que l'on a nommé luthéranisme, & dont les sectateurs sont appellés luthériens, du nom de Luther, qui approche du grec, & qu'il prit au lieu de celui de sa famille, qui étoit Loser ou Lauther. C'étoit la coutume des gens de lettres dans ce siecle de se donner des noms grecs, témoins Capnion, Erasme, Melanchton, Bucer, &c. Voyez NOMS.
En 1523 Luther quitta tout-à-fait l'habit religieux, & en 1525 il séduisit une religieuse nommée Catherine de Bere, la débaucha & l'épousa ensuite publiquement. Après avoir attiré l'Allemagne à ses sentimens, sous la protection du duc de Saxe Georges, il mourut à Eisleben, sa patrie, l'an 1546. Voyez REFORME.
Les premiers qui reçurent le luthéranisme furent ceux de Mansfeld & ceux de Saxe : il fut prêché à Kreichsaw en 1521 : il fut reçu à Groslar, à Rostoch, à Riga en Livonie, à Reutlinge & à Hall en Souabe, à Augsbourg, à Hambourg, à Trept en Poméranie en 1522, en Prusse en 1523 ; à Einbech, dans le duché de Lunebourg, à Nuremberg & à Breslaw en 1525 ; dans la Hesse en 1526 ; à Aldenbourg, à Strasbourg & à Brunswich en 1528 ; à Gottingen, à Lemgou, à Lunebourg en 1530 ; à Munster & à Paderborn en Westphalie en 1532 ; à Etlingen & à Ulm en 1533 ; dans le duché de Grubenhagen, à Hanovre & en Poméranie en 1534 ; dans le duché de Wirtemberg en 1535 ; à Cothus dans la basse Lusace en 1537 ; dans le comté de la Lippe en 1538 ; dans l'électorat de Brandebourg, à Brême, à Hall en Saxe, à LÉïpsic en Misnie, & à Quedlinbourg en 1539 ; à Embden dans la Frise orientale, à Hailbron, à Halberstad, à Magdebourg en 1540 ; au Palatinat dans les duchés de Neubourg, à Ragensbourg & à Wismar en 1540 ; à Buxtende, à Hildesheim & à Osnabrug en 1543 ; dans le bas Palatinat en 1546, dans le Mecklenbourg en 1552 ; dans le marquisat de Dourlach & de Hochberg en 1556 ; dans le comté de Bentheim en 1564 ; à Haguenau & au bas marquisat de Bade en 1568, & en 1570 dans le duché de Magdebourg. Jovet, tom. I. p. 460. 461.
Le luthéranisme a souffert plusieurs variations, soit pendant la vie, soit depuis la mort de son auteur. Luther rejettoit l'épître de S. Jacques, comme contraire à la doctrine de S. Paul touchant la justification, & l'apocalypse ; mais ces deux livres sont aujourd'hui reçus par les Luthériens. Il n'admettoit de sacremens que le Baptême & l'Eucharistie ; il croyoit l'impanation, c'est-à-dire que la matiere du pain & du vin reste avec le corps de Jesus-Christ, & c'est en quoi les Luthériens different des Calvinistes. Voyez CONSUBSTANTIATION.
Luther prétendoit que la messe n'est point un sacrifice ; il rejettoit l'adoration de l'hostie, la confession auriculaire, toutes les oeuvres satisfactoires, les indulgences, le purgatoire, le culte & l'usage des images. Luther combattoit la liberté, & soutenoit que nous sommes nécessités en toutes nos oeuvres, & que toutes les actions faites en péché mortel, & les vertus mêmes des payens sont des crimes ; que nous ne sommes justes que par l'imputation des mérites & de la justice de Jesus-Christ. Il blâmoit le jeûne & l'abstinence de la viande, les voeux monastiques & le célibat des personnes consacrées à Dieu.
Il est sorti du luthéranisme trente-neuf sectes toutes différentes ; savoir les Confessionistes appellés Miricains, les Antinomiens, les Samosatenses, les Inferains, les Antidiaphoristes, les Antiswenkfeldiens, les Antosandrins, les Anticalvinistes, les Imposeurs des mains, les Bissacramentaux, les Trisacramentaux, les Confessionistes, les Mous-philosophes, les Maionistes, les Adiaphoristes, les Quadrisacramentaux, les Luthero-Calvinistes, les Anmétistes, les Mediosandrins, les Confessionistes opiniâtres & Récalcitrants, les Sufeldiens, les Onandrins, les Stanoanriens, les Antisancariens, les Zuingliens simples, les Zuingliens significatifs, les Carlostatiens, les Tropistes évargiques, les Arrabonaires, les Sucéfeldiens spirituels, les Servetiens, les Davitiques ou Davidi-Georgiens, & les Memnonites. Jovet, tome I. p. 475. Dictionn. de Trévoux.
|
| LUTHÉRIEN | (Théol.) celui qui suit, qui professe le luthéranisme, les sentimens de Luther. Voyez LUTHERANISME.
Les Luthériens sont aujourd'hui de tous les Protestans les moins éloignés de l'Eglise catholique ; ils sont divisés en plusieurs sectes, dont les principales se trouvent aux articles suivans, & à leur rang dans le cours de cet ouvrage.
Luthérien mitigé, celui qui a adouci la doctrine de Luther, ou qui suit la doctrine de Luther adoucie. Melanchthon est le premier des luthériens mitigés.
Luthérien relâché, c'est un des noms que l'on donna à ceux qui suivirent l'interim & qui firent trois partis différens, celui de Melanchthon, celui de Pacius ou Pefeffinger, & l'université de Léipsic, & celui des théologiens de Franconie. Voyez INTERIM & ADIAPHORISTES.
Luthérien rigide, celui qui soutient encore l'ancien luthéranisme de Luther & des premiers luthériens.
Il n'y a, principalement sur la prédestination & la grace, plus ou presque plus de luthériens rigides. Le chef des luthériens rigides fut Flaccius Illyricus, le premier des quatre auteurs de l'histoire ecclésiastique divisée en centuries, & connue sous le nom de centuries ou centuriateurs de Magdebourg. Il ne pouvoit souffrir que l'on apportât quelque changement à la doctrine de Luther.
Luthero-Calviniste, celui ou celle qui soutient les opinions de Luther conjointement avec celles de Calvin, autant qu'on peut les concilier, ce qui est impossible en quelques points, sur-tout sur la présence réelle.
Luthero-Osiandrien, celui ou celle qui fait un mêlange de la doctrine de Luther & de Luc Osiander.
Luthero-Papiste, c'est le nom qu'on a donné aux luthériens qui se servoient d'excommunication contre les sacramentaires.
Luthero-Zuinglien, celui ou celle qui mêle les dogmes de Zuingle à ceux de Luther.
Les Luthero-Zuingliens eurent pour chef Martin Bucer, de Schelestadt en Alsace, où il naquit en 1491, & qui, de dominicain qu'il étoit, se fit, par une double apostasie, comme disent les Catholiques, luthérien.
Les Luthero-Zuingliens firent moins un mêlange de la doctrine de Luther & de Zuingle, qu'une société de luthériens & de zuingliens qui se toléroient mutuellement, & convinrent ensemble de souffrir les dogmes les uns des autres. Dictionn. de Trévoux.
LUTHERIEN, s. m. On appelle, en terme d'arts, luthérien un joueur de luth. Il n'y a jamais eu en cette partie d'homme plus fameux & plus distingué qu'Anaxenor. Non-seulement les citoyens de Thiane lui rendirent des honneurs extraordinaires, mais Marc-Antoine, qui étoit enchanté des talens de cet artiste, lui donna des gardes & le revenu de quatre villes ; enfin après sa mort on lui fit dresser une statue. Voyez pour preuve Strabon, liv. XXIV.
Jacob, connu sous le nom du Polonois, a été regardé comme le premier joueur de luth du xvij. siecle. Ballard imprima quantité de pieces de sa composition, parmi lesquelles les gaillardes sont celles que les Musiciens estiment davantage.
Les Gautiers marcherent sur les traces du Polonois, & ont été les derniers joueurs de luth de réputation. La difficulté de bien toucher cet instrument de musique à cordes, & son peu d'usage dans les concerts, l'ont fait abandonner. On lui a préféré le violon, qui est plus facile à manier, & qui produit d'ailleurs des sons plus agréables, plus cadencés & plus harmonieux. (D.J.)
|
| LUTIN | S. m. (Hist. des superst.) Un lutin est, dans l'esprit des gens superstitieux, un esprit malin, inquiétant, nuisible, qui ne paroît que de nuit, pour tourmenter & faire du mal, du dégât, du désordre.
Les noms de lutin, de phantôme, de spectre, de revenant & autres semblables, abondent dans les pays à proportion de leur stupidité & de leur barbarie. C'est pour cela qu'autrefois il y avoit dans presque toutes les villes du royaume, des noms particuliers des lutins de chacune de ces villes, dont on se servoit encore plus malheureusement pour faire peur aux enfans. C'étoit le moine-bouru à Paris, la mala-bestia à Toulouse, le mulet-odet à Orléans, le loup-garou à Blois, le roi Hugon à Tours, Fort-épaule à Dijon, &c. On faisoit de ces noms ridicules l'épouventail des femmellettes, ainsi que le cannevas de mille fables absurdes ; & il faut bien que cela fût très-répandu, puisque M. de Thou n'a pas dédaigné d'en parler dans son histoire. Ce qui prouve que nous vivons dans des tems plus éclairés, c'est que tous ces noms ont disparu : rendons-en grace à la Philosophie, aux études & aux gens de lettres. (D.J.)
|
| LUTRIN | S. m. terme d'église, pupitre sur lequel on met les livres d'église, & auprès duquel les chanteurs s'assemblent ; mais ce mot est principalement consacré au pupitre, qui est placé au milieu du choeur. Nos peres l'ont appellé leteri, lettri, létrin, du mot grec , dit Ducange, parce que c'étoit le lieu où on lisoit l'évangile. Entre les beautés de détail dont est rempli le poëme du lutrin de M. Despréaux, on doit compter celle de la description du lutrin même. Le poëte, après avoir parlé du choeur de l'église, ajoute :
Sur ce rang d'ais serrés qui forment sa clôture,
Fut jadis un lutrin d'inégale structure,
Dont les flancs élargis de leur vaste contour
Ombrageoient pleinement tous les lieux d'alentour :
Derriere ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre,
A peine sur son banc on discernoit le chantre ;
Tandis qu'à l'autre banc, le prélat radieux
Découvert au grand jour, attiroit tous les yeux, &c.
Boileau pouvoit se vanter d'avoir le talent d'annoblir en poésie les choses les plus communes, & c'est en cela, c'est dans le choix des termes & des tours que consiste son grand mérite. (D.J.)
|
| LUTTE | S. f. (Art gymnastique) combat de deux hommes corps à corps, pour éprouver leur force & voir qui terrassera son adversaire.
C'étoit un des plus illustres exercices palestriques des anciens. Les Grecs, qui l'ont cultivé avec le plus de soin & qui l'ont porté à la plus haute perfection, le nommoient , mot que nos Grammairiens modernes dérivent de , secouer, agiter, ou de , de la boue, à cause de la poussiere dont se frottoient les lutteurs : du-moins les autres étymologies rapportées par Plutarque ne sont pas plus heureuses. Quant au mot lucta des Latins, on ne sait s'il vient de lucere pris au sens de solvere, résoudre, relâcher, ou de luxare, démettre, déboëter, ou de quelqu'autre source.
Mais sans nous arrêter à ces futilités, recherchons l'origine de la lutte & ses préparatifs : après cela nous indiquerons les principales especes de luttes & les descriptions qui nous en restent ; ensuite nous déterminerons en quel tems les lutteurs furent admis aux jeux publics de la Grece ; enfin nous repasserons en revûe ceux qui s'y sont le plus distingués. Les auteurs latins de l'art gymnastique ont épuisé cette matiere ; mais M. Burette en particulier l'a traitée dans les mémoires de Littérature avec le plus de netteté & l'érudition la plus agréable : il va nous prêter ses lumieres.
La lutte chez les Grecs, de même que chez les autres peuples, ne se montra dans ses commencemens qu'un exercice grossier, où la pesanteur du corps & la force des muscles avoient la meilleure part. Les hommes les plus robustes & de la taille la plus avantageuse, étoient presque sûrs d'y vaincre, & l'on ne connoissoit point encore la supériorité que pouvoit donner dans cette espece de combat beaucoup de souplesse & de dextérité jointes à une force médiocre.
La lutte considérée dans cette premiere simplicité, peut passer pour un des plus anciens exercices ou des premieres manieres de se battre ; car il est à croire que les hommes devenus ennemis les uns des autres, ont commencé par se colleter & s'attaquer à coups de poings, avant que de mettre en oeuvre des armes plus offensives. Telle étoit la lutte dans les siecles héroïques & fabuleux de la Grece, dans ces tems feconds en hommes féroces, qui n'avoient d'autres lois que celle du plus fort.
On reconnoît à ce portrait ces fameux scélérats qui infestoient, par leurs brigandages, les provinces de la Grece, & dont quelques-uns contraignoient les voyageurs à lutter contr'eux, malgré l'inégalité de leurs forces, & les tuoient après les avoir vaincus. Hercule & Thésée travaillerent successivement à purger la terre de ces monstres, employant d'ordinaire pour les vaincre & pour les punir, les mêmes moyens dont ces barbares s'étoient servis pour immoler tant de victimes à leur cruauté. C'est ainsi que ces deux héros vainquirent à la lutte Antée & Cercyon, inventeurs de ce combat, selon Platon, & auxquels il en coûta la vie pour avoir osé se mesurer contre de si redoutables adversaires.
Thésée fut le premier, au rapport de Pausanias, qui joignit l'adresse à la force dans la lutte, & qui établit des écoles publiques appellées palestres, où des maîtres l'enseignoient aux jeunes gens. Comme cet exercice fit partie des jeux isthmiques, rétablis par ce héros, & qu'il fut admis dans presque tous ceux que l'on célébroit en Grece & ailleurs, les athletes n'oublierent rien pour s'y rendre habiles ; & le desir de remporter les prix les rendit ingénieux à imaginer de nouvelles ruses & de nouveaux mouvemens, qui en perfectionnant la lutte les missent en état de s'y distinguer. Ce n'est donc que depuis Thésée que la lutte, qui avoit été jusqu'alors un exercice informe, fut réduite en art, & se trouva dans tout son lustre.
Les frictions & les onctions, si communes dans les gymnases, parurent être dans l'art athlétique des préparatifs admirables pour ce combat en particulier. Comme il étoit question dans la lutte de faire valoir toute la force & toute la souplesse des membres, on eut recours aux moyens les plus efficaces pour réunir ces deux qualités. Les frictions en ouvrant les pores & en facilitant la transpiration, rendent la circulation du sang plus rapide, & procurent en même tems une distribution plus abondante des esprits animaux dans tous les muscles du corps. Or l'on sait que la force de ces organes dépend de cette abondance, jointe à la fermeté du tissu des fibres ; d'un autre côté, les onctions qui succédoient aux frictions produisoient deux bons effets : l'un d'empêcher, en bouchant les pores, une trop grande dissipation d'esprits, qui eût bientôt mis les athletes hors de combat ; l'autre de donner aux muscles, à leurs tendons, & aux ligamens des jointures, une plus grande flexibilité, & par-là de prévenir la rupture de quelques-unes de ces parties dans les extensions outrées auxquelles la lutte les exposoit.
Mais comme ces onctions, en rendant la peau des lutteurs trop glissante, leur ôtoit la facilité de se colleter & de se prendre au corps avec succès, ils remédioient à cet inconvénient, tantôt en se roulant dans la poussiere de la palestre, ce que Lucien exprime plaisamment en disant, les uns se vautrent dans la boue comme des pourceaux, tantôt en se couvrant réciproquement d'un sable très-fin, reservé pour cet usage dans les xistes & sous les portiques des gymnases. Ceux-ci, ajoute le même Lucien & dans le même style, prenant le sable qui est dans cette fosse, se le jettent les uns aux autres comme des coqs. Ils se frottoient aussi de poussiere après les onctions, pour essuyer & sécher la sueur dont ils se trouvoient tout trempés au fort de la lutte, & qui leur faisoit quitter prise trop facilement. Ce moyen servoit encore à les préserver des impressions du froid ; car cet enduit de poussiere mêlé d'huile & de sueur, empêchoit l'air de les saisir, & mettoit par-là ces athletes à couvert des maladies ordinaires à ceux qui se refroidissent trop promtement après s'être fort échauffés.
Les lutteurs ainsi préparés en venoient aux mains. On les apparioit deux à deux, & il se faisoit quelquefois plusieurs luttes en même tems. A Sparte, les personnes de différent sexe luttoient les unes contre les autres ; & Athénée observe que la même chose se pratiquoit dans l'île de Chio.
Le but que l'on se proposoit dans la lutte, où l'on combattoit de pié ferme, étoit de renverser son adversaire, de le terrasser, en grec ; de-là vient que la lutte s'appelloit , l'art de jetter par terre.
Pour y parvenir, ils employoient la force, l'adresse & la ruse ; ces moyens de force & d'adresse se réduisoient à s'empoigner réciproquement les bras, en grec ; à se retirer en avant, ; à se pousser & à se renverser en arriere, & ; à se donner des contorsions & à s'entrelacer les membres, ; à se prendre au collet, & à se serrer la gorge jusqu'à s'ôter la respiration, & ; à s'embrasser étroitement & se secouer, ; se plier obliquement & sur les côtés, ; à se prendre au corps & à s'élever en l'air, à se heurter du front comme les béliers, ; enfin à se tordre le cou, .
Tous ces mots grecs qu'on peut se dispenser de lire, & plusieurs autres que je supprime pour ne pas ennuyer le lecteur, étoient consacrés à la lutte, & se trouvent dans Pollux & dans Hésychius.
Parmi les tours de souplesse & les ruses ordinaires aux lutteurs, nommées en grec , je ne dois pas oublier celui qui consistoit à se rendre maître des jambes de son antagoniste ; cela s'exprimoit en grec par différens verbes, , qui reviennent aux mots françois, supplanter, donner le croc en jambe ; Dion, ou plutôt Xiphilin son abréviateur, remarque dans la vie d'Adrien, que cette adresse ne fut pas inutile aux soldats romains, dans un de leurs combats contre les Jaziges.
Telle étoit la lutte dans laquelle les athletes combattoient debout, & qui se terminoit par la chûte ou le renversement à terre de l'un des deux combattans. Mais lorsqu'il arrivoit que l'athlete terrassé entraînoit dans sa chûte son antagoniste, soit par adresse, soit autrement, le combat recommençoit de nouveau, & ils luttoient couchés sur le sable, se roulant l'un sur l'autre, & s'entrelaçant en mille façons jusqu'à ce que l'un des deux gagnant le dessus, contraignît son adversaire à demander quartier & à se confesser vaincu.
Une troisieme espece de lutte se nommoit , parce que les athletes n'y employoient que l'extrêmité de leurs mains sans se prendre au corps, comme dans les deux autres especes. Il paroît que l' étoit un prélude de la véritable lutte, par lequel les athletes essayoient réciproquement leurs forces, & commençoient à dénouer leurs bras.
En effet, cet exercice consistoit à se croiser les doigts, en se les serrant fortement, à se pousser en joignant les paumes des mains, à se tordre les poignets & les jointures des bras, sans seconder ces divers efforts par le secours d'aucun autre membre ; & la victoire demeuroit à celui qui obligeoit son concurrent à demander quartier. Pausanias parle de l'athlete léontisque, qui ne terrassoit jamais son adversaire dans cette sorte de combat, mais le contraignoit seulement en lui serrant les doigts de se confesser vaincu.
Cette sorte de lutte, qui faisoit aussi partie du pancrace, étoit connue d'Hippocrate, lequel, dans le II. livre du régime, l'appelle , & lui attribue la vertu d'exténuer le reste du corps & de rendre les bras plus charnus.
Comme nous ne pouvons plus voir ces sortes de combats, & que le tems des spectacles de la lutte est passé, le seul moyen d'y suppléer à quelques égards, c'est de consulter pour nous en faire une idée, ce que la gravure & la sculpture nous ont conservé de monumens qui nous représentent quelques parties de l'ancienne gymnastique, & sur-tout de recourir aux descriptions que les poëtes nous en ont laissées, & qui sont autant de peintures parlantes, propres à mettre sous les yeux de notre imagination les choses que nous ne pouvons envisager d'une autre maniere.
La description que fait Homere, Iliade, l. XXIII. vers. 708. & suivans, de la lutte d'Ajax & d'Ulysse, l'emporte sur tous les autres pour la force, pour le naturel & pour la précision. La lutte d'Hercule & d'Achéloüs, si fameuse dans la fable, a servi de matiere au tableau poétique qu'Ovide en a fait dans le neuvieme de ses métamorphoses. On peut voir aussi de quelle maniere Lucain dans sa pharsale, l. IV. vers. 610. & suivans, décrit la lutte d'Hercule & d'Antée. La lutte de Tydée & d'Agyllée, peinte par Stace dans sa Thébaïde, liv. VI. vers. 847. est sur-tout remarquable par la disproportion des combattans, dont l'un est d'une taille gigantesque, & l'autre d'une taille petite & ramassée.
Ces quatre portraits méritent d'autant mieux d'être consultés sur la lutte, qu'en nous présentant tous ce même objet dont le spectacle étoit autrefois si célebre, ils le montrent à notre imagination par différens côtés, & par-là servent à nous le faire connoître plus parfaitement ; desorte qu'en rassemblant ce que chacun renferme de plus particulier, on trouve presque toutes les circonstances qui caracterisoient cette espece d'exercice.
Le lecteur est encore le maître d'y joindre une cinquieme description, laquelle, quoiqu'en prose, peut figurer avec la poésie. Elle se trouve au XVI. livre de l'histoire éthiopique d'Héliodore, ingénieux & aimable romancier grec du iv. siecle. Cette peinture représente une lutte qui tient, en quelque sorte, du Pancrace, & qui se passe entre Théagene le héros du roman, & une espece de géant éthiopien.
Après avoir considéré la lutte en elle-même, & renvoyé les curieux à la lecture des descriptions qui nous en restent, indiquons dans quel tems on a commencé d'admettre cet exercice dans la solemnité des jeux publics, dont il faisoit un des principaux spectacles.
Nous apprenons de Pausanias que la lutte faisoit partie des jeux olympiques dès le tems de l'Hercule de Thebes, puisque ce héros en remporta le prix. Mais Iphitus ayant rétabli la cérémonie de ces jeux qui, depuis Hercule, avoit été fort négligée ; les différentes especes de combats n'y rentrerent que successivement, ensorte que ce ne fut que dans la xviij. olympiade qu'on y vit paroître des lutteurs ; & le lacédémonien Eurybate fut le premier qu'on y déclara vainqueur à la lutte. On n'y proposa des prix pour la lutte des jeunes gens que dans la xxxvij. olympiade, & le lacédémonien Hiposthene y reçut la premiere couronne. Les lutteurs & les pancratiens n'eurent entrée dans les jeux pythiques que beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans la xlviij. olympiade. A l'égard des jeux Néméens & des Isthmiques, Pausanias ni aucun auteur ne nous apprennent, de ma connoissance, en quel tems la lutte commença de s'y introduire.
Les prix que l'on proposoit aux lutteurs dans ces jeux publics, ne leur étoient accordés qu'à certaines conditions. Il falloit combattre trois fois de suite, & terrasser au-moins deux fois son antagoniste pour être digne de la palme. Un lutteur pouvoit donc sans honte être renversé une fois, mais il ne le pouvoit être une seconde, sans perdre l'espérance de la victoire.
Entre les fameux Athletes, qui furent plusieurs fois couronnés aux jeux de la Grece, l'histoire a immortalisé les noms de Milon, de Chilon, de Polydamas & de Théagene.
Milon étoit de Crotone, & fleurissoit du tems des Tarquins. Sa force étonnante & ses victoires athlétiques ont été célébrées par Diodore, Strabon, Athénée, Philostrate, Galien, Elien, Eustathe, Cicéron, Valere-Maxime, Pline, Solin, & plusieurs autres. Mais Pausanias est celui qui paroît s'être le plus intéressé à la gloire de cet illustre athlete, par le détail dans lequel il est entré dans le second livre de ses éliaques, sur ce qui le concerne. Il nous apprend entr'autres particularités, que Milon remporta six palmes aux jeux olympiques, toutes à la lutte, l'une desquelles lui fut adjugée lorsqu'il n'étoit encore qu'enfant ; qu'il en gagna une en luttant contre les jeunes gens, & six en luttant contre des hommes faits aux jeux pythiens ; que s'étant présenté une septieme fois à Olympie pour la lutte, il ne put y combattre, faute d'y trouver un antagoniste qui voulût se mesurer à lui.
Le même Historien raconte ensuite plusieurs exemples de la force incomparable de cet athlete. Il portoit sur ses épaules sa propre statue, faite par le sculpteur Daméas son compatriote. Il empoignoit une grenade, de maniere que, sans l'écraser, il la serroit suffisamment pour la retenir, malgré les efforts de ceux qui tâchoient de la lui arracher. Il n'y avoit que sa maîtresse, dit Elien en badinant, qui pût, en cette occasion, lui faire quitter prise.
Pausanias ajoute que Milon se tenoit si ferme sur un disque qu'on avoit huilé, pour le rendre plus glissant, qu'il étoit comme impossible de l'y ébranler. Lorsqu' appuyant son coude sur son côté, il présentoit la main droite ouverte, les doigts serrés l'un contre l'autre, à l'exception du pouce qu'il élevoit, il n'y avoit presque force d'homme qui pût lui écarter le petit doigt des trois autres. Cet athlete si robuste, ce vainqueur des Sybarites, fut néanmoins obligé de reconnoître que sa force étoit inférieure à celle du berger Titorme, qu'il rencontra sur les bords d'Evenus, s'il en faut croire Elien.
Le lutteur Chilon, natif de Patras en Achaïe, n'est guere moins fameux que Milon, par le nombre de ses victoires à la lutte. Il fut couronné deux fois à Olympie, une fois à Delphes, quatre fois aux jeux isthmiques, & trois fois aux néméens. Sa statue faite des mains de Lysippe, se voyoit encore à Olympie du tems de Pausanias. Il fut tué dans une bataille, & les Achéens lui éleverent une tombeau à leurs dépens, avec une inscription simple, qui contenoit les faits que je viens de rapporter.
Pausanias parle du pancratiaste Polydamas, nonseulement comme du plus grand homme de son siecle pour la taille, mais il raconte encore de ce célebre athlete des choses presque aussi surprenantes que celles qu'on attribue à Milon. Il mourut, comme lui, par trop de confiance en ses forces. Etant entré avec quelques camarades dans une caverne, pour s'y mettre à couvert de l'excessive chaleur, la voûte de la caverne prête à fondre sur eux, s'entr'ouvrit en plusieurs endroits. Les compagnons de Polydamas prirent la fuite ; mais lui moins craintif, ou plus téméraire, éleva ses deux mains, prétendant soutenir la hauteur de pierres qui s'écrouloient, & qui l'accabla de ses ruines.
Je finis ma liste des célebres lutteurs par l'athlete Théagene de Thasos, vainqueur au pancrace, au pugilat & à la course, une fois aux jeux olympiques, trois fois aux pythiens, neuf fois aux néméens, & dix fois aux isthmiques. Il emporta tant de prix aux autres jeux de la Grece, que ses couronnes alloient jusqu'au nombre de quatorze cent, selon Pausanias, ou de douze cent, selon Plutarque. (D.J.)
|
| LUTTER | (Géog.) petite ville d'Allemagne au duché de Brunswick, remarquable par la victoire que les Impériaux y remporterent sur Christian IV. roi de Danemarck, en 1626. Elle est à 2 lieues N. O. de Goslar. Long. 28. 8. latit. 52. 2.
|
| LUTTERWORTH | (Géog.) bourg à marché d'Angleterre en Leicestershire, à 72 milles N. O. de Londres. Long. 15. 26. latit. 52. 26.
Je n'ai parlé de ce bourg, que parce que c'est le lieu de la naissance, de la mort & de la sépulture de Jean Wiclef, décédé en 1384. Il s'étoit déclaré hautement pendant sa vie contre les dogmes de l'Eglise romaine. Son parti déjà considérable dans le royaume de la grande Bretagne, étoit étayé de la protection du duc de Lancastre, dont l'autorité n'étoit pas moins grande que celle du roi son frere. Wiclef expliquoit la manducation du corps de notre Seigneur, à-peu-près de la même maniere que Berenger l'avoit expliquée avant lui. Ses sectateurs, qu'on nomma Lolards, s'augmentoient tous les jours ; mais ils se multiplierent bien davantage par les persécutions qu'ils essuyerent sous Henri IV. & sous Henri V.
|
| LUTZELSTEIN | (Géog.) petite ville de la basse Alsace, à 6 lieues de Strasbourg, capitale de la principauté de même nom, appartenante à l'électeur palatin, qui en fait hommage au roi de France.
|
| LUTZEN | (Géog.) petite ville d'Allemagne dans la haute Saxe, & dans l'évêché de Mersebourg, fameuse par la bataille de 1632, où Gustave Adolphe, roi de Suéde, périt malheureusement. Elle est sur l'Elster, à 2 milles O. de Leipsick. Long. 30. 12. latit. 51. 20. (D.J.)
|
| LUVA | ou LUBOS, (Hist. mod.) c'est le nom qu'on donne aux chefs d'une nation guerriere & barbare appellée Galas, qui depuis très-long-tems sont les fléaux des Ethiopiens & des Abyssins, sur qui ils font des incursions très-fréquentes. Ces lubos sont des souverains dont l'autorité ne dure que pendant huit ans. Aussi-tôt que l'un d'eux a été élu, il cherche & se signaler par les ravages & les cruautés qu'il exerce dans quelque province d'Ethiopie. Son pouvoir ne s'étend que sur les affaires militaires ; pour les affaires civiles, elles se reglent dans les assemblées ou diètes de la nation, que le lubo a droit de convoquer, mais qui peut de son côté annuller ce qu'il peut avoir fait de contraire aux lois du pays. Il y a, dit-on, environ soixante de ces souverains éphémeres dans la nation des Galas ; ils font une très-pauvre figure dans leur cour, dont le pere Lobo raconte un usage singulier & peu propre à engager les étrangers à s'y rendre. Lorsque le lubo donne audience à quelque étranger, les courtisans qui l'accompagnent tombent sur lui, & lui donnent une bastonnade très-vive qui l'oblige à fuir ; lorsqu'il rentre, on le reçoit avec politesse. Le P. Lobo eut le malheur d'essuyer cette cérémonie ; en ayant demandé le motif, on lui dit que c'étoit pour faire connoître aux étrangers la valeur & la supériorité des Galas sur toutes les autres nations.
|
| LUXATION | S. f. terme de Chirurgie, déplacement d'un ou de plusieurs os de l'endroit où ils sont naturellement joints. Les luxations sont en général de deux especes par rapport à leurs causes ; les unes viennent de causes externes, comme chûtes, coups, sauts, extensions, &c. les autres viennent de causes internes, comme d'un relâchement des ligamens, de la paralysie des muscles, du gonflement des têtes des os, d'une fluxion d'humeurs qui s'est faite tout-à-coup dans l'articulation, & qui en a abreuvé les capsules ligamenteuses ou d'humeurs qui s'y sont accumulées peu-à-peu : tel est l'épanchement de la synovie, qui chasse la tête de l'os de sa cavité.
La luxation n'arrive proprement qu'aux os qui ont un mouvement manifeste, comme sont tous ceux dont la jonction est par diarthrose : ceux qui sont articulés par synarthrose, n'ayant qu'un mouvement fort obscur, sont plus sujets à être cassés qu'à se luxer : les os joints par charniere ou gynglime se luxent plus difficilement que ceux dont la jonction est faite par une seule tête & une seule cavité ; & ils sont plus sujets à la luxation incomplete qu'à la complete .
On entend par luxation complete celle où la tête d'un os est réellement hors de la cavité de celui qui la recevoit. On reconnoît cette luxation par une tumeur ou éminence que forme la tête de l'os déboîté dans un endroit qui n'est pas destiné à la loger ; & par un enfoncement que l'on sent dans l'endroit d'où l'os est sorti. Ces signes sont quelquefois difficiles à appercevoir, sur-tout à la cuisse, lorsqu'il y a gonflement. La luxation complete est aussi accompagnée d'une grande douleur, d'une abolition du mouvement & d'un raccourcissement du membre, si la luxation est en-haut ; car le membre est plus long dans la luxation qui se fait em-bas.
La luxation incomplete ou partiale, appellée aussi subluxation, est un arrangement des os dans leur contiguité, mais qui se touchent encore par quelque surface. Dans la luxation incomplete , outre la douleur & l'impuissance du membre, qui sont des signes communs & équivoques de luxation, l'on remarque 1°. que le lieu de l'articulation est plus éminent qu'il ne doit être ; 2°. que le membre ne change presque pas de figure, ni de longueur ; & 3°. que la partie n'est pas plus disposée à se mouvoir d'un côté que de l'autre, à cause que les muscles sont presque également tendus, parce que l'éloignement de l'os n'est pas assez grand pour changer considérablement la distance de leurs attaches ; ce qui n'est point de même dans la luxation complete . L'entorse est une espece de luxation incomplete . Voyez ENTORSE.
Une luxation est simple, lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucun accident ; & compliquée, lorsqu'elle se trouve avec plaie, inflammation, fracture, &c.
Le prognostic des luxations est relatif à leur espece, à leur cause, & aux accidens qui les compliquent.
La luxation exige la réduction le plus tôt qu'il est possible. Il y a des complications qui s'y opposent. Une fracture, une grande tension, une contorsion profonde ne permettent quelquefois pas de réduire une luxation. Si l'os du bras, par exemple, étoit fracturé dans sa partie moyenne supérieure, & luxé dans l'épaule, les extensions convenables pour réduire la luxation ne seroient pas sans inconvénient, & il faudroit absolument abandonner la luxation, à moins que la tête de l'os ne pressât fortement les gros vaisseaux ; ce qui mettroit le malade en danger, & détermineroit à tout tenter plûtôt que de différer la réduction.
Lorsqu'elle est possible, il faut faire les extensions & les contre-extensions convenables, qui s'exécutent par le secours des mains seulement, ou avec des lacs & des machines. Voyez EXTENSION, LACS, MACHINE pour les luxations.
Quand les extensions sont suffisantes, il faut conduire la tête de l'os dans sa cavité naturelle, en faisant lâcher doucement ceux qui tirent, afin que l'os se replace. Il n'est pas toujours nécessaire de pousser l'os : les muscles & les ligamens qui n'ont pas été trop forcés, le retirent avec action ; il est même quelquefois dangereux d'abandonner l'os à toute la force des muscles : on court risque, 1°. s'il y a un rebord cartilagineux, de le renverser en lâchant tout-à-coup, ce qui pourroit causer une ankylose, du-moins le mouvement du membre deviendroit-il fort difficile. 2°. Quand même la vîtesse du retour de l'os ne romproit pas le rebord cartilagineux, la tête de l'os feroit une contusion plus ou moins forte aux cartilages qui encroutent la tête & la cavité. Il est donc nécessaire de conduire l'os doucement dans sa cavité, au moins jusqu'à ce qu'on soit assûré qu'il en prend bien la route.
Il faut observer que cette route n'est pas toujours le plus court chemin que puisse prendre l'os pour rentrer, mais celui par lequel il est indiqué qu'il est sorti de sa cavité. On est obligé de suivre ce chemin, quand même il ne seroit pas le plus court ; tant parce qu'il est déjà frayé par la tête de l'os luxé, que parce qu'il conduit à l'ouverture qui a été faite à la poche ligamenteuse par la sortie de l'os. Il n'est pas bien prouvé que ce dogme soit aussi important dans la pratique qu'il est spécieux dans la théorie : on dit fort bien que si l'on ne suit pas le chemin frayé, on en fait un autre avec peine pour l'opérateur, & douleur pour le malade ; que la tête de l'os arrivant à sa cavité, ne trouve point d'ouverture à la capsule ligamenteuse ; qu'elle la renverse avec elle dans la cavité, ce qui empêche l'exacte réduction, & cause des douleurs, des gonflemens, inflammations, dépôts & autres accidens funestes. J'ai vu tous ces accidens dans la pratique, & ils ne venoient pas de cette cause ; j'ai réduit beaucoup de luxations ; je n'ai jamais apperçu qu'on pût distinguer cette route précise de l'os ; on le réduit toujours, ou plutôt il se réduit par la seule route qui peut lui permettre de rentrer, lorsque, par des mouvemens ou méthodiques, ou empyriques, on a levé les obstacles qui s'opposoient au remplacement. Nous parlerons de ces cas au mot machine pour la réduction des luxations.
On connoît que la réduction est faite lorsque dans l'opération on entend un certain bruit qui annonce le retour de la tête dans sa cavité, & que la bonne conformation, l'usage & le mouvement de l'articulation sont rétablis.
On applique ensuite l'appareil contentif de l'os moins que des topiques nécessaires pour remédier à la tension des parties, & les consoler de l'effort qu'elles ont souffert. Les bandages sont sur-tout nécessaires dans les luxations de cause interne, principalement à celles qui sont produites par la relaxation des ligamens ou la paralysie des muscles : dans ces cas le seul poids du membre met la tête de l'os hors de la cavité.
Après l'application de l'appareil, on met le membre en situation convenable. Le malade doit être couché dans les luxations du tronc & des extrêmités inférieures ; il n'est pas nécessaire qu'il le soit dans les luxations de la mâchoire inférieure, ou des extrêmités supérieures. Il faut ensuite que le chirurgien s'applique à corriger les accidens, suivant les diverses indications qu'ils prescrivent.
La nature différente des luxations, par rapport à la nature des parties, à la façon dont elles ont été lésées, aux causes du désordre, aux symptomes & accidens qu'il produit, exige des attentions diversifiées & des procédés particuliers qu'il faut voir dans les livres de l'art. Ambroise Paré parmi les anciens, & M. Petit parmi les modernes, dans son traité des maladies des os, sont les plus grands maîtres qu'on puisse consulter sur cette matiere. (Y)
Machine pour la réunion des tendons extenseurs des doigts & du poignet. Chirurgie, Pl. XX. fig. 6. Cette machine est composée de deux parties, une fixe, & l'autre mobile, unies ensemble par une charniere.
La partie fixe est une gouttiere de dix pans de long, de cinq pouces de large, & de deux pouces de profondeur.
A l'extérieure on voit trois pieces soudées ; au milieu & à l'extrêmité antérieure sont des especes d'anses quarrées, par où passent des liens qui assujettissent cette gouttiere à l'avant-bras. Entre ces deux anneaux il y a une crémaillere à quatre crans, dont l'usage est de loger le bec d'un crochet attaché à la piece mobile.
Cette seconde partie de la machine est une espece de semelle, cave intérieurement, convexe à l'extérieur, haute d'environ sept pouces, sur quatre pouces & demi de diametre.
Elle a sur les côtés deux petites fentes, qui servent à passer une bande qui tient la main appliquée sur la palette ; & à ses parties latérales & inférieures, on voit l'attache des crochets.
Pour se servir de cette machine, on la garnit d'un petit lit de paille d'avoine, couvert de quelques compresses, & d'un bandage à dix-huit chefs ; on met l'avant-bras sur ces préparatifs, la main étendue ; on panse la plaie, & on soutient la main au degré d'extension convenable, par la piece mobile qu'on fixe au degré d'élévation qu'on juge à propos.
Machine pour la réunion du tendon d'achille, inventée par M. Petit. Voyez Pl. XXXII. & XXXIII. Une espece de genouillere de cuir fort, & couverte d'un cuir plus pliant, sert de point d'appui à la force mouvante. La jambe étant pliée, on place dans le pli du jarret, le milieu de cette espece de genouillere. De deux branches qui la composent, la plus large garnie en dedans de chamois, comme d'un coussin, entoure le bas de la cuisse, au-dessus du genou. Elle y est assujettie par deux appendices d'un cuir pliant, qui, comme deux courroies, achevent le tour de la cuisse, & vont passer par deux boucles, au moyen desquelles on serre autant qu'il faut, & l'on assujettit cette partie du bandage. L'autre branche qui est un peu plus étroite, entoure la jambe au-dessus du mollet ; elle est matelassée à la partie qui porte sur les muscles gémeaux. Deux courroies & deux boucles la serrent & l'assujettissent comme la premiere. Par cette disposition les boucles & les courroies ne peuvent blesser la peau, & les gros vaisseaux sont à l'abri de la compression. Au milieu de la branche qui entoure la cuisse, est pour ainsi dire enchâssée & cousue une plaque de cuivre, sur le plan de laquelle s'élevent perpendiculairement deux montans, à-travers lesquels passe un treuil qui se meut sur son axe, au moyen d'une clé ou cheville quarrée qui sert de manivelle. Sur le treuil est attachée & s'emploie une courroie, laquelle est cousue par son autre bout au talon d'une pantoufle, qui reçoit le pié du blessé. La direction de cette courroie depuis le talon jusqu'au jarret, est donnée & conservée par un passant de cuir, cousu sur le milieu de la petite branche de la genouillere, vis-à-vis du treuil sur lequel elle est employée. Pl. XXXII. fig. 1. genouillere ; fig. 2. la pantoufle & sa courroie ; fig. 3. le treuil ; fig. 4. la manivelle. La Pl. XXXIII. fig. 1. montre la machine en situation.
A mesure que par la cheville quarrée qui passe dans l'axe du treuil, on le tourne dans le sens qu'il convient, on oblige le pié de s'étendre, & l'on approche les deux bouts du tendon. Mais lorsqu'ils seront au point d'attouchement nécessaire, le treuil, & par conséquent la courroie doivent être retenus & fixés en ce lieu. Cela se fait par une roue à crochet & un mentonnet à ressort, qui engrene dans les dents de cette roue ; par ce moyen on peut étendre ou relâcher plus ou moins la courroie, & fixer le pié au degré d'extension convenable. Une boucle au lieu du treuil, simplifieroit beaucoup la construction de cette machine ; mais elle en seroit moins parfaite dans l'usage.
Cette invention est des plus utiles & des plus ingénieuses. Ce bandage ne fait aucune compression sur les parties qui en reçoivent l'utilité ; le degré d'extension est immuable, non-seulement le pié est étendu, mais la jambe est contenue en même tems dans le degré de flexion, qui relâche les muscles gémeaux, & facilite le rapprochement du bout supérieur du tendon : ces muscles sont comprimés & gênés au point qu'on n'a rien à craindre de tressaillemens involontaires durant le sommeil, enfin ce bandage laisse la jambe & le talon à découvert, de maniere qu'on peut observer ce qui se passe, aussi souvent qu'on le veut, & appliquer les médicamens nécessaires, sans être obligé de toucher à ce bandage, avantage dont on sent tout le prix dans le cas de plaies. Rien n'étoit si dangereux que des plaies du tendon d'achille, & elles rentrent dans la classe des plus simples & des plus faciles à guérir, depuis l'heureuse découverte de cette machine, fruit du génie d'un des plus grands chirurgiens que la France ait eu.
Machine pour réduire les luxations, inventée par M. Petit, & décrite dans son traité des maladies des os. Elle est composée de deux parties (voyez la fig. 2. Pl. XXXIV) ; l'une fait le corps, & l'autre les branches.
Le corps est composé de deux jumelles de bois de chêne, droites & paralleles entr'elles, de deux piés onze pouces de longueur, & de deux pouces de largeur, sur dix-huit lignes d'épaisseur.
Ces jumelles sont éloignées l'une de l'autre de seize lignes ; il y a deux traverses qui les entretiennent, & y sont jointes par tenons, mortaises & chevilles.
A chaque jumelle, du côté qu'elles se regardent, on a pratiqué une rainure ou coulisse dans le milieu de leur épaisseur, pour loger de part & d'autre des languettes d'une moufle de bois.
Il y a deux mouffles, l'une est dormante, & a un tenon qui entre dans une mortaise pratiquée dans l'épaisseur de la traverse inférieure, où elle est retenue fixement par une cheville de fer, qui passant dans la traverse, en pénetre la mortaise, & le tenon de la moufle. L'autre moufle est mobile, & a deux languettes qui entrent dans les coulisses des deux jumelles, & qui lui donnent la liberté d'aller & de venir. A sa tête se trouve un trou, par lequel passe une corde en anse, qui sert à attacher par le milieu un lacs de soie, d'une aune de longueur, & d'une tresse ou d'un tissu triple. Les bouts de ce lacs sont noués d'un même noeud d'espace en espace, de façon que les noeuds sont à la distance de deux pouces les uns des autres. Celui qui est à l'extrêmité sert de bouton, & les espaces qu'ils laissent entr'eux font des boutonnieres, dans lesquelles on engage le premier noeud. On forme ainsi avec ce lacs une anse plus ou moins grande, dans laquelle on arrête celle d'un lacs qui, comme on le dira, s'attache au membre que l'on veut remettre.
La chape des deux mouffles est de bois quarré, & chacune d'elles a six poulies en deux rangées. Les trois de la premiere rangée ont un pouce de diametre ; celles de la seconde ont dix lignes, & toutes ont trois lignes d'épaisseur. Un cordon de soie ou de lin d'une ligne & demie de diametre, & de 27 ou 28 piés de longueur, est arrêté d'un bout à la chape de la moufle dormante, au-dessous de la rangée des petites poulies, passe ensuite avec ordre par toutes les petites poulies tant de l'une que de l'autre moufle, & enfin est arrêté par son autre bout à l'anneau d'un piton qui traverse le treuil. Voyez la méthode d'arranger les cordes au mot MOUFLE.
Le treuil est de bois tourné en bobine, porté par deux moutons de bois joints aux jumelles par deux tenons. Ce treuil a une roue dentelée en rochet, qui mesure les degrés d'extension.
Les branches de cette machine sont aussi composées de deux jumelles ; mais elles ne sont ni droites, ni paralleles entr'elles. Par-devant elles sont ceintrées en arc. Leur longueur est de deux piés trois pouces, y compris les tenons quarrés de quatre pouces neuf lignes de longueur, sur huit lignes de diametre. Ces tenons sortent de chaque côté du bout de la partie la plus forte ; ce qui sert de base aux branches. Chaque tenon entre dans le bout supérieur de chaque jumelle du corps de la machine, lequel bout est garni par un collet de fer qui le recouvre en entier, excepté le côté par où les jumelles se regardent.
Les extrêmités des jumelles des branches sont mousses & arrondies pour se loger facilement dans deux gaines qui sont aux extrêmités d'une espece de lacs nommé arcboutant. Ib. Pl. XXXIII. fig. 3.
Il est composé d'un morceau de coutil, de la longueur d'un pié, de trois pouces de largeur, fendu en boutonniere par le milieu suivant sa longueur. Cette fente ou boutonniere a neuf pouces ; & le surplus du coutil qui n'est point fendu, borne également les deux extrémités, au-dessous de chacune desquelles est pratiquée une poche ou gaîne, qui sert à loger les extrémités des branches de la machine. Toute cette piece de coutil est revêtue de chamois, pour ne point blesser le corps, ni le membre qui doit passer par la fente ou boutonniere.
La piece ou le lacs qui doit servir à tirer le membre luxé (fig. 4.), est composé d'un morceau de chamois doublé & cousu, ayant quatorze pouces de long, & deux & demi de large. Sur le milieu, dans sa longueur, est un cordon de soie à double tresse, de la longueur de trois quarts d'aune, large de dix lignes, passé dans les deux anses d'un lacs de tire-botte, revêtu de chamois. Le cordon de soie est cousu à la piece de chamois, sur le milieu & près des extrêmités, de maniere que cette couture n'empêche point qu'on éloigne ou qu'on rapproche l'une de l'autre, les anses du lacs de tire-botte revêtu de chamois, afin qu'il puisse convenir aux différentes grosseurs des membres auxquels on l'attache. Ce lacs qui a dix-huit pouces de longueur & un de large, fait une anse de neuf pouces ; la piece de chamois fait le tour du membre, & forme une compresse circulaire, afin que les lacs ne puissent blesser. Le cordon de soie fait deux tours sur le chamois, & on le lie d'un simple noeud ou d'une rose.
Pour se servir de cette machine, on la place toute montée au-dessous du membre. Quand on a posé l'arc-boutant & le lacs, on engage les bouts des branches dans les deux poches ou gaînes de l'arcboutant. On passe le lacs de la moufle mobile dans l'anse du lacs qui est attaché au membre, & on arrête ce lacs en passant le noeud de son extrêmité dans l'une de ses boutonnieres : on met alors à l'essieu du treuil la manivelle, & on tourne autant qu'il est nécessaire pour allonger & réduire le membre démis.
Cette machine peut être appliquée pour faire les extensions dans certaines fractures, en pressant différemment les lacs.
Pour se servir de cette machine aux luxations de la cuisse, M. Petit a ajouté deux especes de croissans aux branches (voyez fig. 5.), dont l'un appuie sur l'os des îles, & l'autre sur la partie moyenne de la cuisse. On prend une serviette dont on noue ensemble deux angles, pour en former une anse dans laquelle on passe la cuisse jusque dans l'aîne, on en attache l'anse au cordon de la moufle mobile, & on tourne la manivelle : par-là on fait trois efforts différens. Le croissant supérieur arcboute contre l'os de la hanche ; l'inférieur pousse le bas de la cuisse en-dedans, la serviette tire le haut du fémur en-dehors, & par le concours de ces trois mouvemens, sans qu'il soit nécessaire de faire d'autres extensions : on ne parle ici que de la luxation de la cuisse em-bas & en-dedans.
Il faut voir tous les détails dans l'auteur pour se mettre au fait des particularités dans lesquelles nous ne pouvons entrer. On trouve une machine destinée aux mêmes usages dans la chirurgie de Platner, mais si l'on fait bien attention aux regles posées par les meilleurs auteurs, & fondées en raison & en expérience, pour la réduction des luxations, on sentira combien peu l'on doit attendre de secours de toutes ces machines. La réduction des luxations dépend de plusieurs mouvemens combinés. Chaque espece de déplacement exige que le membre soit situé différemment, pour que les muscles qui sont accidentellement dans une tension contre nature, ne soient pas exposés à de nouvelles violences par l'effet des extensions nécessaires ; on risque de déchirer les muscles, & de les arracher dans une opération mal dirigée. Il faut sûrement plus de lumieres & d'adresse que de forces, pour faire à propos tout ce qu'il convient, suivant la situation de la tête de l'os qui peut être portée en-haut, em-bas, en-devant, en-arriere, en-dedans, en-dehors ; ce qui fait que les membres sont tantôt plus longs, tantôt plus courts, suivant l'espece de luxation. Comment donc pourroit-on réussir avec un instrument qui n'agit, & ne peut agir que suivant une seule & unique direction ? dès qu'il est constant qu'il faut combiner les mouvemens pour relâcher à propos certains muscles, en étendre d'autres avec des efforts variés en différens sens, à mesure que la tête de l'os se rapproche de sa cavité, pour y être replacée. C'est ce qui est exposé dans un plus grand détail, dans le discours préliminaire de la derniere édition du traité des maladies des os de feu M. Petit, en 1758. Voyez AMBI.
Machines pour arrêter les hémorrhagies, voyez TOURNIQUET.
Machine pour redresser les enfans bossus, Pl. VI. fig. 2. voyez RACHITIS.
Machines pour les hernies de l'ombilic, Pl. VI. fig. 3. & Pl. XXIX. voyez EXOMPHALE.
Machine pour les fractures compliquées de la jambe ; voyez BOITE. (Y)
LUXE, c'est l'usage qu'on fait des richesses & de l'industrie pour se procurer une existence agréable.
Le luxe a pour cause premiere ce mécontentement de notre état ; ce desir d'être mieux, qui est & doit être dans tous les hommes. Il est en eux la cause de leurs passions, de leurs vertus & de leurs vices. Ce desir doit nécessairement leur faire aimer & rechercher les richesses ; le desir de s'enrichir entre donc & doit entrer dans le nombre des ressorts de tout gouvernement qui n'est pas fondé sur l'égalité & la communauté des biens ; or l'objet principal de ce desir doit être le luxe ; il y a donc du luxe dans tous les états, dans toutes les sociétés : le sauvage a son hamac qu'il achete pour des peaux de bêtes ; l'européen a son canapé, son lit ; nos femmes mettent du rouge & des diamans ; les femmes de la Floride mettent du bleu & des boules de verre.
Le luxe a été de tout tems le sujet des déclamations des Moralistes, qui l'ont censuré avec plus de morosité que de lumiere, & il est depuis quelque tems l'objet des éloges de quelques politiques qui en ont parlé plus en marchands ou en commis qu'en philosophes & en hommes d'état.
Ils ont dit que le luxe contribuoit à la population.
L'Italie, selon Tite-Live, dans le tems du plus haut degré de la grandeur & du luxe de la république romaine, étoit de plus de moitié moins peuplée que lorsqu'elle étoit divisée en petites républiques presque sans luxe & sans industrie.
Ils ont dit que le luxe enrichissoit les états.
Il y a peu d'états où il y ait un plus grand luxe qu'en Portugal ; & le Portugal, avec les ressources de son sol, de sa situation, & de ses colonies, est moins riche que la Hollande qui n'a pas les mêmes avantages, & dans les moeurs de laquelle regnent encore la frugalité & la simplicité.
Ils ont dit que le luxe facilitoit la circulation des monnoies.
La France est aujourd'hui une des nations où regne le plus grand luxe, & on s'y plaint avec raison du défaut de circulation dans les monnoies qui passent des provinces dans la capitale, sans refluer également de la capitale dans les provinces.
Ils ont dit que le luxe adoucissoit les moeurs, & qu'il répandoit les vertus privées.
Il y a beaucoup de luxe au Japon, & les moeurs y sont toujours atroces. Il y avoit plus de vertus privées dans Rome & dans Athènes, plus de bienfaisance & d'humanité dans le tems de leur pauvreté que dans le tems de leur luxe.
Ils ont dit que le luxe étoit favorable aux progrès des connoissances & des beaux arts.
Quels progrès les beaux arts & les connoissances ont-ils fait chez les Sibarites, chez les Lydiens, & chez les Tonquinois ?
Ils ont dit que le luxe augmentoit également la puissance des nations & le bonheur des citoyens.
Les Perses sous Cyrus avoient peu de luxe, & ils subjuguerent les riches & industrieux Assyriens. Devenus riches, & celui des peuples où le luxe regnoit le plus, les Perses furent subjugués par les Macédoniens, peuple pauvre. Ce sont des sauvages qui ont renversé ou usurpé les empires des Romains, des califes de l'Inde & de la Chine. Quant au bonheur du citoyen, si le luxe donne un plus grand nombre de commodités & de plaisirs, vous verrez, en parcourant l'Europe & l'Asie, que ce n'est pas du-moins au plus grand nombre des citoyens.
Les censeurs du luxe sont également contredits par les faits.
Ils disent qu'il n'y a jamais de luxe sans une extrème inégalité dans les richesses, c'est-à-dire, sans que le peuple soit dans la misere, & un petit nombre d'hommes dans l'opulence ; mais cette disproportion ne se trouve pas toujours dans les pays du plus grand luxe, elle se trouve en Pologne & dans d'autres pays qui ont moins de luxe que Berne & Geneve, où le peuple est dans l'abondance.
Ils disent que le luxe fait sacrifier les arts utiles aux agréables, & qu'il ruine les campagnes en rassemblant les hommes dans les villes.
La Lombardie & la Flandre sont remplies de luxe & de belles villes ; cependant les laboureurs y sont riches, les campagnes y sont cultivées & peuplées. Il y a peu de luxe en Espagne, & l'agriculture y est négligée ; la plûpart des arts utiles y sont encore ignorés.
Ils disent que le luxe contribue à la dépopulation.
Depuis un siecle le luxe & la population de l'Angleterre sont augmentés dans la même proportion ; elle a de plus peuplé des colonies immenses.
Ils disent que le luxe amollit le courage.
Sous les ordres de Luxembourg, de Villars & du comte de Saxe, les François, le peuple du plus grand luxe connu, se sont montrés le plus courageux. Sous Sylla, sous César, sous Lucullus, le luxe prodigieux des romains porté dans leurs armées, n'avoit rien ôté à leur courage.
Ils disent que le luxe éteint les sentimens d'honneur & d'amour de la patrie.
Pour prouver le contraire, je citerai l'esprit d'honneur & le luxe des françois dans les belles années de Louis XIV. & ce qu'ils sont depuis ; je citerai le fanatisme de patrie, l'enthousiasme de vertu, l'amour de la gloire qui caractérisent dans ce moment la nation angloise.
Je ne prétends pas rassembler ici tout le bien & le mal qu'on a dit du luxe, je me borne à dire le principal, soit des éloges, soit des censures, & à montrer que l'histoire contredit les unes & les autres.
Les philosophes les plus modérés qui ont écrit contre le luxe, ont prétendu qu'il n'étoit funeste aux états que par son excès, & ils ont placé cet excès dans le plus grand nombre de ses objets & de ses moyens, c'est-à-dire dans le nombre & la perfection des arts, à ce moment des plus grands progrès de l'industrie, qui donne aux nations l'habitude de jouir d'une multitude de commodités & de plaisirs, & qui les leur rend nécessaires. Enfin, ces philosophes n'ont vu les dangers du luxe que chez les nations les plus riches & les plus éclairées ; mais il n'a pas été difficile aux philosophes, qui avoient plus de logique & d'humeur que ces hommes modérés, de leur prouver que le luxe avoit été vicieux chez des nations pauvres & presque barbares ; & de conséquence en conséquence, pour faire éviter à l'homme les inconvéniens du luxe, on a voulu le replacer dans les bois & dans un certain état primitif qui n'a jamais été & ne peut être.
Les apologistes du luxe n'ont jusqu'à présent rien répondu de bon à ceux qui, en suivant le fil des événemens, les progrès & la décadence des empires, ont vû le luxe s'élever par degrés avec les nations, les moeurs se corrompre, & les empires s'affoiblir, décliner & tomber.
On a les exemples des Egyptiens, des Perses, des Grecs, des Romains, des Arabes, des Chinois, &c. dont le luxe a augmenté en même tems que ces peuples ont augmenté de grandeur, & qui depuis le moment de leur plus grand luxe n'ont cessé de perdre de leurs vertus & de leur puissance. Ces exemples ont plus de force pour prouver les dangers du luxe que les raisons de ses apologistes pour le justifier ; aussi l'opinion la plus générale aujourd'hui est-elle que pour tirer les nations de leur foiblesse & de leur obscurité, & pour leur donner une force, une consistance, une richesse qui les élevent sur les autres nations, il faut qu'il y ait du luxe, il faut que ce luxe aille toujours en croissant pour avancer les arts, l'industrie, le commerce, & pour amener les nations à ce point de maturité suivi nécessairement de leur vieillesse, & enfin de leur destruction. Cette opinion est assez générale, & même M. Hume ne s'en éloigne pas.
Comment aucun des philosophes & des politiques, qui ont pris le luxe pour objet de leurs spéculations, ne s'est-il pas dit : dans les commencemens des nations, on est & on doit être plus attaché aux principes du gouvernement ; dans les sociétés naissantes, toutes les lois, tous les réglemens, sont chers aux membres de cette société, si elle s'est établie librement ; & si elle ne s'est pas établie librement, toutes les lois, tous les réglemens sont appuyés de la force du législateur, dont les vûes n'ont point encore varié, & dont les moyens ne sont diminués ni en force ni en nombre ; enfin l'intérêt personnel de chaque citoyen, cet intérêt qui combat presque partout l'intérêt général, & qui tend sans cesse à s'en séparer, a moins eu le tems & les moyens de le combattre avec avantage, il est plus confondu avec lui, & par conséquent dans les sociétés naissantes, il doit y avoir plus que dans les anciennes sociétés un esprit patriotique, des moeurs & des vertus.
Mais aussi dans le commencement des nations, la raison, l'esprit, l'industrie, ont fait moins de progrès ; il y a moins de richesses, d'arts, de luxe, moins de manieres de se procurer par le travail des autres une existence agréable ; il y a nécessairement de la pauvreté & de la simplicité.
Comme il est dans la nature des hommes & des choses que les gouvernemens se corrompent avec le tems ; & aussi dans la nature des hommes & des choses qu'avec le tems les états s'enrichissent, les arts se perfectionnent & le luxe augmente.
N'a-t-on pas vu comme cause & comme effet l'un de l'autre ce qui, sans être ni l'effet ni la cause l'un de l'autre, se rencontre ensemble & marche à peu-près d'un pas égal ?
L'intérêt personnel, sans qu'il soit tourné en amour des richesses & des plaisirs, enfin en ces passions qui amenent le luxe, n'a-t-il pas, tantôt dans les magistrats, tantôt dans le souverain ou dans le peuple fait faire des changemens dans la constitution de l'état qui l'ont corrompu ? ou cet intérêt personnel, l'habitude, les préjugés, n'ont-ils pas empêché de faire des changemens que les circonstances avoient rendu nécessaires ? N'y a-t-il pas enfin dans la constitution, dans l'administration, des fautes, des défauts qui, très-indépendamment du luxe, ont amené la corruption des gouvernemens & la décadence des empires ?
Les anciens Perses vertueux & pauvres sous Cyrus, ont conquis l'Asie, en ont pris le luxe, & se sont corrompus. Mais se sont-ils corrompus pour avoir conquis l'Asie, ou pour avoir pris son luxe, n'est-ce pas l'étendue de leur domination qui a changé leurs moeurs ! N'étoit-il pas impossible que dans un empire de cette étendue il subsistât un bon ordre ou un ordre quelconque. La Perse ne devoit-elle pas tomber dans l'abîme du despotisme ? or par-tout où l'on voit le despotisme, pourquoi chercher d'autres causes de corruption ?
Le despotisme est le pouvoir arbitraire d'un seul sur le grand nombre par le secours d'un petit nombre ; mais le despote ne peut parvenir au pouvoir arbitraire sans avoir corrompu ce petit nombre.
Athènes, dit-on, a perdu sa force & ses vertus après la guerre du Péloponnèse, époque de ses richesses & de son luxe. Je trouve une cause réelle de la décadence d'Athènes dans la puissance du peuple & l'avilissement du sénat ; quand je vois la puissance exécutrice & la puissance législative entre les mains d'une multitude aveugle, & que je vois en même tems l'aréopage sans pouvoir, je juge alors que la république d'Athènes ne pouvoit conserver ni puissance ni bon ordre ; ce fut en abaissant l'aréopage, & non pas en édifiant les théatres, que Périclès perdit Athènes. Quant aux moeurs de cette république, elle les conserva encore long-tems, & dans la guerre qui la détruisit elle manqua plus de prudence que de vertus, & moins de moeurs que de bon sens.
L'exemple de l'ancienne Rome, cité avec tant de confiance par les censeurs du luxe, ne m'embarrasseroit pas davantage. Je verrois d'abord les vertus de Rome, la force & la simplicité de ses moeurs naître de son gouvernement & de sa situation : mais ce gouvernement devoit donner aux romains de l'inquiétude & de la turbulence ; il leur rendoit la guerre nécessaire, & la guerre entretenoit en eux la force des moeurs & le fanatisme de la patrie. Je verrois que dans les tems que Carnéades vint à Rome, & qu'on y transportoit les statues de Corinthe & d'Athènes, il y avoit dans Rome deux partis, dont l'un devoit subjuguer l'autre, dès que l'état n'auroit plus rien à craindre de l'étranger. Je verrois que le parti vainqueur, dans cet empire immense, devoit nécessairement le conduire au despotisme ou à l'anarchie ; & que quand même on n'auroit jamais vu dans Rome ni le luxe & les richesses d'Antiochus & de Carthage, ni les philosophes & les chef-d'oeuvres de la Grece, la république romaine n'étant constituée que pour s'aggrandir sans cesse, elle seroit tombée au moment de sa grandeur.
Il me semble que si pour me prouver les dangers du luxe, on me citoit l'Asie plongée dans le luxe, la misere & les vices ; je demanderois qu'on me fît voir dans l'Asie, la Chine exceptée, une seule nation où le gouvernement s'occupât des moeurs & du bonheur du grand nombre de ses sujets.
Je ne serois pas plus embarrassé par ceux qui, pour prouver que le luxe corrompt les moeurs & affoiblit les courages, me montreroient l'Italie moderne qui vit dans le luxe, & qui en effet n'est pas guerriere. Je leur dirois que si l'on fait abstraction de l'esprit militaire qui n'entre pas dans le caractere des Italiens, ce caractere vaut bien celui des autres nations. Vous ne verrez nulle part plus d'humanité & de bienfaisance, nulle part la société n'a plus de charmes qu'en Italie, nulle part on ne cultive plus les vertus privées. Je dirois que l'Italie, soumise en partie à l'autorité d'un clergé qui ne prêche que la paix, & d'une république où l'objet du gouvernement est la tranquillité, ne peut absolument être guerriere. Je dirois même, qu'il ne lui serviroit à rien de l'être ; que les hommes ni les nations n'ont que foiblement les vertus qui leur sont inutiles ; que n'étant pas unie sous un seul gouvernement ; enfin qu'étant située entre quatre grandes puissances, telles que le Turc, la maison d'Autriche, la France & l'Espagne, l'Italie ne pourroit, quelles que fussent ses moeurs, résister à aucune de ces puissances ; elle ne doit donc s'occuper que des loix civiles, de la police, des arts, & de tout ce qui peut rendre la vie tranquille & agréable. Je conclurois que ce n'est pas le luxe, mais sa situation & la nature de ses gouvernemens qui empêchent l'Italie d'avoir des moeurs fortes & les vertus guerrieres.
Après avoir vu que le luxe pourroit bien n'avoir pas été la cause de la chûte ou de la prospérité des empires & du caractere de certaines nations ; j'examinerois si le luxe ne doit pas être relatif à la situation des peuples, au genre de leurs productions, à la situation, & au genre de productions de leurs voisins.
Je dirois que les Hollandois, facteurs & colporteurs des nations, doivent conserver leur frugalité, sans laquelle ils ne pourroient fournir à bas prix le fret de leurs vaisseaux, & transporter les marchandises de l'univers.
Je dirois que si les Suisses tiroient de la France & de l'Italie beaucoup de vins, d'étoffes d'or & de soie, des tableaux, des statues & des pierres précieuses, ils ne tireroient pas de leur sol stérile de quoi rendre en échange à l'étranger, & qu'un grand luxe ne peut leur être permis que quand leur industrie aura réparé chez eux la disette des productions du pays.
En supposant qu'en Espagne, en Portugal, en France, la terre fût mal cultivée, & que les manufactures de premiere ou seconde nécessité fussent négligées, ces nations seroient encore en état de soutenir un grand luxe.
Le Portugal, par ses mines du Brésil, ses vins & ses colonies d'Afrique & d'Asie, aura toujours de quoi fournir à l'étranger, & pourra figurer entre les nations riches.
L'Espagne, quelque peu de travail & de culture qu'il y ait dans sa métropole & ses colonies, aura toujours les productions des contrées fertiles qui composent sa domination dans les deux mondes ; & les riches mines du Mexique & du Potozi soutiendront chez elle le luxe de la cour & celui de la superstition.
La France, en laissant tomber son agriculture & ses manufactures de premiere ou seconde nécessité, auroit encore des branches de commerce abondantes en richesses ; le poivre de l'Inde, le sucre & le caffé de ses colonies, ses huiles & ses vins, lui fourniroient des échanges à donner à l'étranger, dont elle tireroit une partie de son luxe ; elle soutiendroit encore ce luxe par ses modes : cette nation longtems admirée de l'Europe en est encore imitée aujourd'hui. Si jamais son luxe étoit excessif, rélativement au produit de ses terres & de ses manufactures de premiere ou seconde nécessité, ce luxe seroit un remede à lui-même, il nourriroit une multitude d'ouvriers de mode, & retarderoit la ruine de l'état.
De ces observations & de ces réflexions je conclurois, que le luxe est contraire ou favorable à la richesse des nations, selon qu'il consomme plus ou moins le produit de leur sol & de leur industrie, ou qu'il consomme le produit du sol & de l'industrie de l'étranger ; qu'il doit avoir un plus grand ou un plus petit nombre d'objets, selon que ces nations ont plus ou moins de richesses : le luxe est à cet égard pour les peuples ce qu'il est pour les particuliers, il faut que la multitude des jouissances soit proportionnée aux moyens de jouir.
Je verrois que cette envie de jouir dans ceux qui ont des richesses, & l'envie de s'enrichir dans ceux qui n'ont que le nécessaire, doivent exciter les arts & toute espece d'industrie. Voilà le premier effet de l'instinct & des passions qui nous menent au luxe & du luxe même ; ces nouveaux arts, cette augmentation d'industrie, donnent au peuple de nouveaux moyens de subsistance, & doivent par conséquent augmenter la population ; sans luxe il y a moins d'échanges & de commerce ; sans commerce les nations doivent être moins peuplées ; celle qui n'a dans son sein que des laboureurs, doit avoir moins d'hommes que celle qui entretient des laboureurs, des matelots, des ouvriers en étoffes. La Sicile qui n'a que peu de luxe est un des pays les plus fertiles de la terre, elle est sous un gouvernement modéré, & cependant elle n'est ni riche ni peuplée.
Après avoir vû que les passions qui inspirent le luxe, & le luxe même, peuvent être avantageux à la population & à la richesse des états, je ne vois pas encore comment ce luxe & ces passions doivent être contraires aux moeurs. Je ne puis cependant me dissimuler que dans quelques parties de l'univers, il y a des nations qui ont le plus grand commerce & le plus grand luxe, & qui perdent tous les jours quelque chose de leur population & de leurs moeurs.
S'il y avoit des gouvernemens établis sur l'égalité parfaite, sur l'uniformité de moeurs, de manieres, & d'état entre tous les citoyens, tels qu'ont été à peu-près les gouvernemens de Sparte, de Crete, & de quelques peuples qu'on nomme Sauvages, il est certain que le desir de s'enrichir n'y pourroit être innocent. Quiconque y desireroit de rendre sa fortune meilleure que celle de ses concitoyens, auroit déjà cessé d'aimer les loix de son pays & n'auroit plus la vertu dans le coeur.
Mais dans nos gouvernemens modernes, où la constitution de l'état & des loix civiles encouragent & assurent les propriétés : dans nos grands états où il faut des richesses pour maintenir leur grandeur, leur puissance, il semble que quiconque travaille à s'enrichir soit un homme utile à l'état, & que quiconque étant riche veut jouir soit un homme raisonnable ; comment donc concevoir que des citoyens, en cherchant à s'enrichir & à jouir de leurs richesses, ruinent quelquefois l'état & perdent les moeurs ?
Il faut pour résoudre cette difficulté se rappeller les objets principaux des gouvernemens.
Ils doivent assurer les propriétés de chaque citoyen ; mais comme ils doivent avoir pour but la conservation du tout, les avantages du plus grand nombre, en maintenant, en excitant même dans les citoyens l'amour de la propriété, le desir d'augmenter ses propriétés & celui d'en jouir ; ils doivent y entretenir, y exciter l'esprit de communauté, l'esprit patriotique ; ils doivent avoir attention à la maniere dont les citoyens veulent s'enrichir & à celle dont ils peuvent jouir ; il faut que les moyens de s'enrichir contribuent à la richesse de l'état, & que la maniere de jouir soit encore utile à l'état ; chaque propriété doit servir à la communauté ; le bien-être d'aucun ordre de citoyens ne doit être sacrifié au bien-être de l'autre ; enfin le luxe & les passions qui menent au luxe doivent être subordonnées à l'esprit de communauté, aux biens de la communauté.
Les passions qui menent au luxe ne sont pas les seules nécessaires dans les citoyens ; elles doivent s'allier à d'autres, à l'ambition, à l'amour de la gloire, à l'honneur.
Il faut que toutes ces passions soient subordonnées à l'esprit de communauté ; lui seul les maintient dans l'ordre, sans lui elles porteroient à de fréquentes injustices & feroient des ravages.
Il faut qu'aucune de ces passions ne détruise les autres, & que toutes se balancent ; si le luxe avoit éteint ces passions, il deviendroit vicieux & funeste, & alors il ne se rapporteroit plus à l'esprit de communauté : mais il reste subordonné à cet esprit, à moins que l'administration ne l'en ait rendu indépendant, à moins que dans une nation où il y a des richesses, de l'industrie & du luxe, l'administration n'ait éteint l'esprit de communauté.
Enfin par-tout où je verrai le luxe vicieux, partout où je verrai le desir des richesses & leur usage contraire aux moeurs & au bien de l'état, je dirai que l'esprit de communauté, cette base nécessaire sur laquelle doivent agir tous les ressorts de la société s'est anéanti par les fautes du gouvernement, je dirai que le luxe utile sous une bonne administration, ne devient dangereux que par l'ignorance ou la mauvaise volonté des administrateurs, & j'examinerai le luxe dans les nations où l'ordre est en vigueur, & dans celles où il s'est affoibli.
Je vois d'abord l'agriculture abandonnée en Italie sous les premiers empereurs, & toutes les provinces de ce centre de l'empire romain couvertes de parcs, de maisons de campagne, de bois plantés, de grands chemins, & je me dis qu'avant la perte de la liberté & le renversement de la constitution de l'état, les principaux sénateurs, dévorés de l'amour de la patrie, & occupés du soin d'en augmenter la force & la population, n'auroient point acheté le patrimoine de l'agriculteur pour en faire un objet de luxe, & n'auroient point converti leurs fermes utiles en maisons de plaisance : je suis même assuré que si les campagnes d'Italie n'avoient pas été partagées plusieurs fois entre les soldats des partis de Sylla, de César & d'Auguste qui négligeoient de les cultiver, l'Italie même sous les empereurs, auroit conservé plus long-tems son agriculture.
Je porte mes yeux sur des royaumes où regne le plus grand luxe, & où les campagnes deviennent des déserts ; mais avant d'attribuer ce malheur au luxe des villes, je me demande quelle a été la conduite des administrateurs de ces royaumes ; & je vois de cette conduite naître la dépopulation attribuée au luxe, j'en vois naître les abus du luxe même.
Si dans ces pays on a surchargé d'impôts & de corvées les habitans de la campagne ; si l'abus d'une autorité légitime les a tenus souvent dans l'inquiétude & dans l'avilissement ; si des monopoles ont arrêté le débit de leurs denrées ; si on a fait ces fautes & d'autres dont je ne veux point parler, une partie des habitans des campagnes a dû les abandonner pour chercher la subsistance dans les villes ; ces malheureux y ont trouvé le luxe, & en se consacrant à son service, ils ont pu vivre dans leur patrie. Le luxe en occupant dans les villes les habitans de la campagne n'a fait que retarder la dépopulation de l'état, je dis retarder & non empêcher, parce que les mariages sont rares dans des campagnes misérables, & plus rares encore parmi l'espece d'hommes qui se réfugient de la campagne dans les villes : ils arrivent pour apprendre à travailler aux arts de luxe, & il leur faut un tems considerable avant qu'ils se soient mis en état d'assurer par leur travail la subsistance d'une famille, ils laissent passer les momens où la nature sollicite fortement à l'union des deux sexes, & le libertinage vient encore les détourner d'une union légitime. Ceux qui prennent le parti de se donner un maître sont toujours dans une situation incertaine, ils n'ont ni le tems ni la volonté de se marier ; mais si quelqu'un d'eux fait un établissement, il en a l'obligation au luxe & à la prodigalité de l'homme opulent.
L'oppression des campagnes suffit pour avoir établi l'extrême inégalité des richesses dont on attribue l'origine au luxe, quoique lui seul au contraire puisse rétablir une sorte d'équilibre entre les fortunes : le paysan opprimé cesse d'être le propriétaire, il vend le champ de ses peres au maître qu'il s'est donné, & tous les biens de l'état passent insensiblement dans un plus petit nombre de mains.
Dans un pays où le gouvernement tombe dans de si grandes erreurs, il ne faut pas de luxe pour éteindre l'amour de la patrie ou la faire haïr au citoyen malheureux, on apprend aux autres qu'elle est indifférente pour ceux qui la conduisent, & c'est assez pour que personne ne l'aime plus avec passion.
Il y a des pays où le gouvernement a pris encore d'autres moyens pour augmenter l'inégalité des richesses, & dans lesquels on a donné ; on a continué des privileges exclusifs aux entrepreneurs de plusieurs manufactures, à quelques citoyens pour faire valoir des colonies, & à quelques compagnies pour faire seuls un riche commerce. Dans d'autres pays, à ces fautes on a ajouté celle de rendre lucratives à l'excès les charges de finance qu'il falloit honorer.
On a par tous ces moyens donné naissance à des fortunes odieuses & rapides : si les hommes favorisés qui les ont faites n'avoient pas habité la capitale avant d'être riches, ils y seroient venus depuis comme au centre du pouvoir & des plaisirs, il ne leur reste à desirer que du crédit & des jouissances, & c'est dans la capitale qu'ils viennent les chercher : il faut voir ce que doit produire la réunion de tant d'hommes opulens dans le même lieu.
Les hommes dans la société se comparent continuellement les uns aux autres, ils tentent sans cesse à établir dans leur propre opinion, & ensuite dans celle des autres, l'idée de leur supériorité : cette rivalité devient plus vive entre les hommes qui ont un mérite du même genre ; or il n'y a qu'un gouvernement qui ait rendu, comme celui de Sparte, les richesses inutiles, où les hommes puissent ne pas se faire un mérite de leurs richesses ; dès qu'ils s'en font un mérite, ils doivent faire des efforts pour paroître riches ; il doit donc s'introduire dans toutes les conditions une dépense excessive pour la fortune de chaque particulier, & un luxe qu'on appelle de bienséance : sans un immense superflu chaque condition se croit misérable.
Il faut observer que dans presque toute l'Europe l'émulation de paroître riche, & la considération pour les richesses ont dû s'introduire indépendamment des causes si naturelles dont je viens de parler ; dans le tems de barbarie où le commerce étoit ignoré, & où des manufactures grossieres n'enrichissoient pas les fabriquans, il n'y avoit de richesses que les fonds de terre, les seuls hommes opulens étoient les grands propriétaires ; or ces grands propriétaires étoient des seigneurs de fiefs. Les lois des fiefs, le droit de posséder seuls certains biens maintenoient les richesses entre les mains des nobles ; mais les progrès du commerce, de l'industrie & du luxe ayant créé, pour ainsi dire, un nouveau genre de richesses qui furent le partage du roturier, le peuple accoûtumé à respecter l'opulence dans ses supérieurs, la respecta dans ses égaux : ceux-ci crurent s'égaler aux grands en imitant leur faste ; les grands crurent voir tomber l'hiérarchie qui les élevoit au-dessus du peuple, ils augmenterent leur dépense pour conserver leurs distinctions, c'est alors que le luxe de bienséance devint onéreux pour tous les états & dangereux pour les moeurs. Cette situation des hommes fit dégénérer l'envie de s'enrichir en excessive cupidité ; elle devint dans quelques pays la passion dominante, & fit taire les passions nobles qui ne devoient point la détruire mais lui commander.
Quand l'extrême cupidité remue tous les coeurs, les enthousiasmes vertueux disparoissent, cette extrème cupidité ne va point sans l'esprit de propriété le plus excessif, l'ame s'éteint alors, car elle s'éteint quand elle se concentre.
Le gouvernement embarrassé ne peut plus récompenser que par des sommes immenses ceux qu'il récompensoit par de légeres marques d'honneur.
Les impôts multipliés se multiplient encore, & pesent sur les fonds de terre & sur l'industrie nécessaire, qu'il est plus aisé de taxer que le luxe, soit que par ses continuelles vicissitudes il échappe au gouvernement, soit que les hommes les plus riches ayent le crédit de s'affranchir des impôts, il est moralement impossible qu'ils n'ayent pas plus de crédit qu'ils ne devroient en avoir ; plus leurs fortunes sont fondées sur des abus & ont été excessives & rapides, plus ils ont besoin de crédit & de moyens d'en obtenir. Ils cherchent & réussissent à corrompre ceux qui sont faits pour les réprimer.
Dans une république, ils tentent les magistrats, les administrateurs : dans une monarchie, ils présentent des plaisirs & des riches à cette noblesse, dépositaire de l'esprit national & des moeurs, comme les corps de magistrature sont les dépositaires des lois.
Un des effets du crédit des hommes riches quand les richesses sont inégalement partagées, un effet de l'usage fastueux des richesses, un effet du besoin qu'on a des hommes riches, de l'autorité qu'ils prennent, des agrémens de leur société, c'est la confusion des rangs dont j'ai déjà dit un mot ; alors se perdent le ton, la décence, les distinctions de chaque état, qui servent plus qu'on ne pense à conserver l'esprit de chaque état ; quand on ne tient plus aux marques de son rang, on n'est plus attaché à l'ordre général ; c'est quand on ne veut pas remplir les devoirs de son état, qu'on néglige un extérieur, un ton, des manieres qui rappelleroient l'idée de ces devoirs aux autres & à soi-même. D'ailleurs on ne conduit le peuple ni par des raisonnemens, ni par des définitions ; il faut imposer à ses sens, & lui annoncer par des marques distinctives son souverain, les grands, les magistrats, les ministres de la religion ; il faut que leur extérieur annonce la puissance, la bonté, la gravité, la sainteté, ce qu'est ou ce que doit être un homme d'une certaine classe, le citoyen revêtu d'une certaine dignité : par conséquent l'emploi des richesses qui donneroit au magistrat l'équipage d'un jeune seigneur, l'attirail de la mollesse & la parure affectée au guerrier, l'air de la dissipation au prêtre, le cortege de la grandeur au simple citoyen, affoibliroit nécessairement dans le peuple l'impression que doit faire sur lui la présence des hommes destinés à le conduire, & avec les bienséances de chaque état, on verroit s'effacer jusqu'à la moindre trace de l'ordre général, rien ne pourroit rappeller les riches à des devoirs, & tout les avertiroit de jouir.
Il est moralement nécessaire que l'usage des richesses soit contraire au bon ordre & aux moeurs. Quand les richesses sont acquises sans travail ou par des abus, les nouveaux riches se donnent promtement la jouissance d'une fortune rapide, & d'abord s'accoûtument à l'inaction & au besoin des dissipations frivoles : odieux à la plûpart de leurs concitoyens, auxquels ils ont été injustement préférés, aux fortunes desquels ils ont été des obstacles, ils ne cherchent point à obtenir d'eux ce qu'ils ne pourroient en espérer, l'estime & la bienveillance ; ce sont sur-tout les fortunes des monopoleurs, des administrateurs & receveurs des fonds publics qui sont les plus odieuses, & par conséquent celles dont on est le plus tenté d'abuser. Après avoir sacrifié la vertu & la réputation de probité aux désirs de s'enrichir, on ne s'avise guère de faire de ses richesses un usage vertueux, on cherche à couvrir sous le faste & les décorations du luxe, l'origine de sa famille & celle de sa fortune, on cherche à perdre dans les plaisirs le souvenir de ce qu'on a fait & de ce qu'on a été.
Sous les premiers empereurs, des hommes d'une autre classe que ceux dont je viens de parler, étoient rassemblés dans Rome où ils venoient apporter les dépouilles des provinces assujetties ; les patriciens se succedoient dans les gouvernemens de ces provinces, beaucoup même ne les habitoient pas, & se contentoient d'y faire quelques voyages ; le questeur pilloit pour lui & pour le proconsul que les empereurs aimoient à retenir dans Rome, sur-tout s'il étoit d'une famille puissante ; là le patricien n'avoit à espérer ni crédit ni part au gouvernement qui étoit entre les mains des affranchis, il se livroit donc à la mollesse & aux plaisirs ; on ne trouvoit plus rien de la force & de la fierté de l'ancienne Rome, dans des sénateurs qui achetoient la sécurité par l'avilissement ; ce n'étoit pas le luxe qui les avoit avilis, c'étoit la tyrannie ; comme la passion des spectacles n'auroit pas fait monter sur le théâtre les sénateurs & les empereurs, si l'oubli parfait de tout ordre, de toute décence & de toute dignité n'avoit précédé & amené cette passion.
S'il y avoit des gouvernemens où le législateur auroit trop fixé les grands dans la capitale ; s'ils avoient des charges, des commandemens, &c. qui ne leur donneroient rien à faire ; s'ils n'étoient pas obligés de mériter par de grands services leurs places & leurs honneurs ; si on n'excitoit pas en eux l'émulation du travail & des vertus ; si enfin on leur laissoit oublier ce qu'ils doivent à la patrie, contens des avantages de leurs richesses & de leur rang, ils en abuseroient dans l'oisiveté.
Dans plusieurs pays de l'Europe, il y a une sorte de propriété qui ne demande au propriétaire ni soins économiques, ni entretien, je veux parler des dettes nationales, & cette sorte de biens est encore très-propre à augmenter, dans les grandes villes, les desordres qui sont les effets nécessaires d'une extrême opulence unie à l'oisiveté.
De ces abus, de ces fautes, de cet état des choses dans les nations, voyez quel caractere le luxe doit prendre, & quels doivent être les caracteres des différens ordres d'une nation.
Chez les habitans de la campagne, il n'y a nulle élévation dans les sentimens, il y a peu de ce courage qui tient à l'estime de soi-même, au sentiment de ses forces ; leurs corps ne sont point robustes, ils n'ont nul amour pour la patrie, qui n'est pour eux que le théâtre de leur avilissement & de leurs larmes : chez les artisans des villes il y a la même bassesse d'ame, ils sont trop près de ceux qui les méprisent pour s'estimer eux-mêmes ; leurs corps énervés par les travaux sédentaires, sont peu propres à soutenir les fatigues. Les lois qui dans un gouvernement bien reglé font la sécurité de tous, dans un gouvernement où le grand nombre gémit sous l'oppression, ne sont pour ce grand nombre qu'une barriere qui lui ôte l'espérance d'un meilleur état ; il doit desirer une plus grande licence plutôt que le rétablissement de l'ordre : voilà le peuple, voici les autres classes.
Celle de l'état intermédiaire, entre le peuple & les grands, composée des principaux artisans du luxe, des hommes de finance & de commerce, & de presque tous ceux qui occupent les secondes places de la société, travaille sans cesse pour passer d'une fortune médiocre à une plus grande ; l'intrigue & la friponnerie sont souvent ses moyens : lorsque l'habitude des sentimens honnêtes ne retient plus dans de justes bornes la cupidité & l'amour effréné de ce qu'on appelle plaisirs, lorsque le bon ordre & l'exemple n'impriment pas le respect & l'amour de l'honnêteté, le second ordre de l'état réunit ordinairement les vices du premier & du dernier.
Pour les grands, riches sans fonctions, décorés sans occupations, ils n'ont pour mobile que la fuite de l'ennui, qui ne donnant pas même des goûts, fait passer l'ame d'objets en objets, qui l'amusent sans la remplir & sans l'occuper ; on a dans cet état non des enthousiasmes, mais des enjouemens pour tout ce qui promet un plaisir : dans ce torrent de modes, de fantaisies, d'amusemens, dont aucun ne dure, & dont l'un détruit l'autre, l'ame perd jusqu'à la force de jouir, & devient aussi incapable de sentir le grand & le beau que de le produire : c'est alors qu'il n'est plus question de savoir lequel est le plus estimable de Corbulon ou de Thraséas, mais si on donnera la préférence à Pilade ou à Batylle, c'est alors qu'on abandonne la Médée d'Ovide, le Thieste de Varus, & les pieces de Térence pour les farces de Labérius ; les talens politiques & militaires tombent peu à peu, ainsi que la philosophie, l'éloquence, & tous les arts d'imitation : des hommes frivoles qui ne font que jouir, ont épuisé le beau & cherchent l'extraordinaire ; alors il entre de l'incertain, du recherché, du puérile dans les idées de la perfection ; de petites ames qu'étonnent & humilient le grand & le fort, leur préferent le petit, le bouffon, le ridicule, l'affecté ; les talens qui sont le plus encouragés sont ceux qui flattent les vices & le mauvais goût, & ils perpétuent ce desordre général que n'a point amené le luxe, mais qui a corrompu le luxe & les moeurs.
Le luxe desordonné se détruit lui-même, il épuise ses sources, il tarit ses canaux.
Les hommes oisifs qui veulent passer sans intervalle d'un objet de luxe à l'autre, vont chercher les productions & l'industrie de toutes les parties du monde : les ouvrages de leurs nations passent de mode chez eux, & les artisans y sont découragés : l'Egypte, les côtes d'Afrique, la Grece, la Syrie, l'Espagne, servoient au luxe des Romains sous les premiers empereurs, & ne lui suffisoient pas.
Le goût d'une dépense excessive répandu dans toutes les classes des citoyens, porte les ouvriers à exiger un prix excessif de leurs ouvrages. Indépendamment de ce goût de dépense, ils sont forcés à hausser le prix de la main-d'oeuvre, parce qu'ils habitent les grandes villes, des villes opulentes, où les denrées nécessaires ne sont jamais à bon marché : bien-tôt des nations plus pauvres & dont les moeurs sont plus simples, font les mêmes choses ; & les débitant à un prix plus bas, elles les débitent de préférence. L'industrie de la nation même, l'industrie du luxe diminue, sa puissance s'affoiblit, ses villes se dépeuplent, ses richesses passent à l'étranger, & d'ordinaire il lui reste de la mollesse, de la langueur, & de l'habitude à l'esclavage.
Après avoir vu quel est le caractere d'une nation où regnent certains abus dans le gouvernement ; après avoir vu que les vices de cette nation sont moins les effets du luxe que de ces abus, voyons ce que doit être l'esprit national d'un peuple qui rassemble chez lui tous les objets possibles du plus grand luxe, mais qui sait maintenir dans l'ordre un gouvernement sage & vigoureux, également attentif à conserver les véritables richesses de l'état & les moeurs.
Ces richesses & ces moeurs sont le fruit de l'aisance du grand nombre, & sur-tout de l'attention extrême de la part du gouvernement à diriger toutes ses opérations pour le bien général, sans acceptions ni de classes ni de particuliers, & de se parer sans cesse aux yeux du public de ces intentions vertueuses.
Partout ce grand nombre est ou doit être composé des habitans de la campagne, des cultivateurs ; pour qu'ils soient dans l'aisance, il faut qu'ils soient laborieux ; pour qu'ils soient laborieux, il faut qu'ils aient l'espérance que leur travail leur procurera un état agréable ; il faut aussi qu'ils en aient le desir. Les peuples tombés dans le découragement, se contentent volontiers du simple nécessaire, ainsi que les habitans de ces contrées fertiles où la nature donne tout, & où tout languit, si le législateur ne sait point introduire la vanité & à la suite un peu de luxe. Il faut qu'il y ait dans les villages, dans les plus petits bourgs, des manufactures d'ustensiles, d'étoffes, &c. nécessaires à l'entretien & même à la parure grossiere des habitans de la campagne : ces manufactures y augmenteront encore l'aisance & la population. C'étoit le projet du grand Colbert, qu'on a trop accusé d'avoir voulu faire des François une nation seulement commerçante.
Lorsque les habitans de la campagne sont bien traités, insensiblement le nombre des propriétaires s'augmente parmi eux : on y voit diminuer l'extrême distance & la vile dépendance du pauvre au riche ; de-là ce peuple a des sentimens élevés, du courage, de la force d'ame, des corps robustes, l'amour de la patrie, du respect, de l'attachement pour des magistrats, pour un prince, un ordre, des lois auxquelles il doit son bien-être & son repos : il tremble moins devant son seigneur, mais il craint sa conscience, la perte de ses biens, de son honneur & de sa tranquillité. Il vendra chérement son travail aux riches, & on ne verra pas le fils de l'honorable laboureur quitter si facilement le noble métier de ses peres pour aller se souiller des livrées & du mépris de l'homme opulent.
Si l'on n'a point accordé les priviléges exclusifs dont j'ai parlé, si le système des finances n'entasse point les richesses, si le gouvernement ne favorise pas la corruption des grands, il y aura moins d'hommes opulens fixés dans la capitale, & ceux qui s'y fixeront n'y seront pas oisifs ; il y aura peu de grandes fortunes, & aucune de rapide : les moyens de s'enrichir, partagés entre un plus grand nombre de citoyens, auront naturellement divisé les richesses ; l'extrême pauvreté & l'extrême richesse seront également rares.
Lorsque les hommes accoutumés au travail sont parvenus lentement & par degrés à une grande fortune, ils conservent le goût du travail, peu de plaisirs les délasse, parce qu'ils jouissent du travail même, & qu'ils ont pris long-tems, dans les occupations assidues & l'économie d'une fortune modérée, l'amour de l'ordre & la modération dans les plaisirs.
Lorsque les hommes sont parvenus à la fortune par des moyens honnêtes, ils conservent leur honnêteté, ils conservent ce respect pour soi-même qui ne permet pas qu'on se livre à mille fantaisies désordonnées ; lorsqu'un homme par l'acquisition de ses richesses a servi ses concitoyens, en apportant de nouveaux fonds à l'état, ou en faisant fleurir un genre d'industrie utile, il sait que sa fortune est moins enviée qu'honorée ; & comptant sur l'estime & la bienveillance de ses concitoyens, il veut conserver l'une & l'autre.
Il y aura, dans le peuple des villes & un peu dans celui des campagnes, une certaine recherche de commodités & même un luxe de bienséance, mais qui tiendra toujours à l'utile ; & l'amour de ce luxe ne dégénérera jamais en une folle émulation.
Il y regnera dans la seconde classe des citoyens un esprit d'ordre & cette aptitude à la discussion que prennent naturellement les hommes qui s'occupent de leurs affaires : cette classe de citoyens cherchera du solide dans ses amusemens même : fiere, parce que de mauvaises moeurs ne l'auront point avilie ; jalouse des grands qui ne l'auront pas corrompue, elle veillera sur leur conduite, elle sera flattée de les éclairer, & ce sera d'elle que partiront des lumieres qui tomberont sur le peuple & remonteront vers les grands.
Ceux-ci auront des devoirs ; ce sera dans les armées & sur la frontiere qu'apprendront la guerre ceux qui se consacreront à ce métier, qui est leur état ; ceux qui se destineront à quelques parties du gouvernement, s'en instruiront long-tems avec assiduité, avec application ; & si des récompenses pécuniaires ne sont jamais entassées sur ceux même qui auront rendu les plus grands services ; si les grandes places, les gouvernemens, les commandemens ne sont jamais donnés à la naissance sans les services ; s'ils ne sont jamais sans fonctions, les grands ne perdront pas dans un luxe oisif & frivole leur sentiment & la faculté de s'éclairer : moins tourmentés par l'ennui, ils n'épuiseront ni leur imagination ni celle de leur flatteur, à la recherche des plaisirs puérils & de modes fantastiques ; ils n'étaleront pas un faste excessif, parce qu'ils auront des prérogatives réelles & un mérite véritable dont le public leur tiendra compte. Moins rassemblés, & voyant à côté d'eux moins d'hommes opulens, ils ne porteront point à l'excès leur luxe de bienséance : témoins de l'intérêt que le gouvernement prend au maintien de l'ordre & au bien de l'état, ils seront attachés à l'un & à l'autre ; ils inspireront l'amour de la patrie & tous les sentimens d'un honneur vertueux & sévere ; ils seront attachés à la décence des moeurs, ils auront le maintien & le ton de leur état.
Alors ni la misere ni le besoin d'une dépense excessive n'empêchent point les mariages, & la population augmente ; on se soutient, ainsi que le luxe & les richesses de la nation : ce luxe est de représentation, de commodité & de fantaisie : il rassemble dans ces différens genres tous les arts simplement utiles & tous les beaux arts ; mais retenu dans de justes bornes par l'esprit de communauté, par l'application aux devoirs, & par des occupations qui ne laissent personne dans le besoin continu des plaisirs, il est divisé, ainsi que les richesses ; & toutes les manieres de jouir, tous les objets les plus opposés ne sont point rassemblés chez le même citoyen. Alors les différentes branches de luxe, ses différens objets se placent selon la différence des états : le militaire aura de belles armes & des chevaux de prix ; il aura de la recherche dans l'équipement de la troupe qui lui sera confiée : le magistrat conservera dans son luxe la gravité de son état ; son luxe aura de la dignité, de la modération : le négociant, l'homme de finance auront de la recherche dans les commodités : tous les états sentiront le prix des beaux arts, & en jouiront ; mais alors ces beaux arts ramenent encore l'esprit des citoyens aux sentimens patriotiques & aux véritables vertus : ils ne sont pas seulement pour eux des objets de dissipation, ils leur présentent des leçons & des modeles. Des hommes riches dont l'ame est élevée, élevent l'ame des artistes ; ils ne leur demandent pas une Galatée maniérée, de petits Daphnis, une Madeleine, un Jérôme ; mais ils leur proposent de représenter Saint-Hilaire blessé dangereusement, qui montre à son fils le grand Turenne perdu pour la patrie.
Tel fut l'emploi des beaux arts dans la Grece avant que les gouvernemens s'y fussent corrompus : c'est ce qu'ils sont encore souvent en Europe chez les nations éclairées qui ne se sont pas écartées des principes de leur constitution. La France fait faire un tombeau par Pigalle au général qui vient de la couvrir de gloire : ses temples sont remplis de monumens érigés en faveur des citoyens qui l'ont honorée, & ses peintres ont souvent sanctifié leurs pinceaux par les portraits des hommes vertueux. L'Angleterre a fait bâtir le château de Bleinheim à la gloire du duc de Marlboroug : ses poëtes & ses orateurs célebrent continuellement leurs concitoyens illustres, déja si récompensés par le cri de la nation, & par les honneurs que leur rend le gouvernement. Quelle force, quels sentimens patriotiques, quelle élévation, quel amour de l'honnêteté, de l'ordre & de l'humanité, n'inspirent pas les poésies des Corneille, des Adisson, des Pope, des Voltaire ! Si quelque poëte chante quelquefois la mollesse & la volupté, ses vers deviennent les expressions dont se sert un peuple heureux dans les momens d'une ivresse passagere qui sujets n'ôte rien à ses occupations & à ses devoirs.
L'éloquence reçoit des sentimens d'un peuple bien gouverné ; par sa force & ses charmes elle rallumeroit les sentimens patriotiques dans les momens où ils seroient prêts à s'éteindre. La Philosophie, qui s'occupe de la nature de l'homme, de la politique & des moeurs, s'empresse à répandre des lumieres utiles sur toutes les parties de l'administration, à éclairer sur les principaux devoirs, à montrer aux sociétés leurs fondemens solides, que l'erreur seule pourroit ébranler. Ranimons encore en nous l'amour de la patrie, de l'ordre, des lois ; & les beaux arts cesseront de se profaner, en se dévouant à la superstition & au libertinage ; ils choisiront des utiles aux moeurs, & ils les traiteront avec force & avec noblesse.
L'emploi des richesses dicté par l'esprit patriotique, ne se borne pas au vil intérêt personnel & à de fausses & de puériles jouissances : le luxe alors ne s'oppose pas aux devoirs de pere, d'époux, d'ami & d'homme. Le spectacle de deux jeunes gens pauvres qu'un homme riche vient d'unir par le mariage, quand il les voit contens sur la porte de leur chaumiere, lui fait un plaisir plus sensible, plus pur & plus durable, que le spectacle du grouppe de Salmacis & d'Hermaphrodite placé dans ses jardins. Je ne crois pas que dans un état bien administré & où par conséquent regne l'amour de la patrie, les plus beaux magots de la Chine rendent aussi heureux leurs possesseurs que le seroit le citoyen qui auroit volontairement contribué de ses trésors à la réparation d'un chemin public.
L'excès du luxe n'est pas dans la multitude de ses objets & de ses moyens ; le luxe est rarement excessif en Angleterre, quoiqu'il y ait chez cette nation tous les genres de plaisirs que l'industrie peut ajouter à la nature, & beaucoup de riches particuliers qui se procurent ces plaisirs. Il ne l'est devenu en France que depuis que les malheurs de la guerre de 1700 ont mis du désordre dans les finances & ont été la cause de quelques abus. Il y avoit plus de luxe dans les belles années du siecle de Louis XIV. qu'en 1720, & en 1720 ce luxe avoit plus d'excès.
Le luxe est excessif dans toutes les occasions où les particuliers sacrifient à leur faste, à leur commodité, à leur fantaisie, leurs devoirs ou les intérêts de la nation ; & les particuliers ne sont conduits à cet excès que par quelques défauts dans la constitution de l'état, ou par quelques fautes dans l'administration. Il n'importe à cet égard que les nations soient riches ou pauvres, éclairées ou barbares, quand on n'entretiendra point chez elles l'amour de la patrie & les passions utiles ; les moeurs y seront dépravées, & le luxe y prendra le caractere des moeurs : il y aura dans le peuple foiblesse, paresse, langueur, découragement. L'empire de Maroc n'est ni policé, ni éclairé, ni riche ; & quelques fanatiques stipendiés par l'empereur, en opprimant le peuple en son nom & pour eux, ont fait de ce peuple un vil troupeau d'esclaves. Sous les regnes foibles & pleins d'abus de Philippe III. Philippe IV. & Charles II. les Espagnols étoient ignorans & pauvres, sans force de moeurs, comme sans industrie ; ils n'avoient conservé de vertus que celles que la religion doit donner, & il y avoit jusque dans leurs armées un luxe sans goût & une extrême misere. Dans les pays où regne un luxe grossier, sans art & sans lumieres, les traitemens injustes & durs que le plus foible essuie partout du plus fort, sont plus atroces. On sait quelles ont été les horreurs du gouvernement féodal, & quel fut dans ce tems le luxe des seigneurs. Aux bords de l'Orénoque les meres sont remplies de joie quand elles peuvent en secret noyer ou empoisonner leurs jeunes filles, pour les dérober aux travaux auxquels les condamnent la paresse féroce & le luxe sauvage de leurs époux.
Un petit émir, un nabab, & leurs principaux officiers, écrasent le peuple pour entretenir des serrails nombreux : un petit souverain d'Allemagne ruine l'agriculture par la quantité de gibier qu'il entretient dans ses états. Une femme sauvage vend ses enfans pour acheter quelques ornemens & de l'eau-de-vie. Chez les peuples policés, une mere tient ce qu'on appelle un grand état, & laisse ses enfans sans patrimoine. En Europe, un jeune seigneur oublie les devoirs de son état, & se livre à nos gouts polis & à nos arts. En Afrique, un jeune prince negre passe les jours à semer des roseaux & à danser. Voilà ce qu'est le luxe dans des pays où les moeurs s'alterent ; mais il prend le caractere des nations, il ne le fait pas, tantôt efféminé comme elles, & tantôt cruel & barbare. Je crois que pour les peuples il vaut encore mieux obéir à des épicuriens frivoles qu'à des sauvages guerriers, & nourrir le luxe des fripons voluptueux & éclairés que celui des voleurs héroïques & ignorans.
Puisque le desir de s'enrichir & celui de jouir de ses richesses sont dans la nature humaine dès qu'elle est en société ; puisque ces desirs soutiennent, enrichissent, vivifient toutes les grandes sociétés ; puisque le luxe est un bien, & que par lui-même il ne fait aucun mal, il ne faut donc ni comme philosophe ni comme souverain attaquer le luxe en lui-même.
Le souverain corrigera les abus qu'on peut en faire & l'excès où il peut être parvenu, quand il réformera dans l'administration ou dans la constitution les fautes ou les défauts qui ont amené cet excès ou ces abus.
Dans un pays où les richesses se seroient entassées en masse dans une capitale, & ne se partageroient qu'entre un petit nombre de citoyens chez lesquels regneroit sans doute le plus grand luxe, ce seroit une grande absurdité de mettre tout-à-coup les hommes opulens dans la nécessité de diminuer leur luxe ; ce seroit fermer les canaux par où les richesses peuvent revenir du riche au pauvre ; & vous réduiriez au desespoir une multitude innombrable de citoyens que le luxe fait vivre ; ou bien ces citoyens, étant des artisans moins attachés à leur patrie qu'à l'agriculture, ils passeroient en foule chez l'étranger.
Avec un commerce aussi étendu, une industrie aussi universelle, une multitude d'arts perfectionnés, n'espérez pas aujourd'hui ramener l'Europe à l'ancienne simplicité ; ce seroit la ramener à la foiblesse & à la barbarie. Je prouverai ailleurs combien le luxe ajoute au bonheur de l'humanité ; je me flatte qu'il résulte de cet article que le luxe contribue à la grandeur & à la force des états, & qu'il faut l'encourager, l'éclairer & le diriger.
Il n'y a qu'une espece de lois somptuaires qui ne soit pas absurde, c'est une loi qui chargeroit d'impôts une branche de luxe qu'on tireroit de l'étranger, ou une branche de luxe qui favoriseroit trop un genre d'industrie aux dépends de plusieurs autres ; il y a même des tems où cette loi pourroit être dangereuse.
Toute autre loi somptuaire ne peut être d'aucune utilité ; avec des richesses trop inégales, de l'oisiveté dans les riches, & l'extinction de l'esprit patriotique, le luxe passera sans cesse d'un abus à un autre : si vous lui ôtez un de ses moyens, il le remplacera par un autre également contraire au bien général.
Des princes qui ne voyoient pas les véritables causes du changement dans les moeurs, s'en sont pris tantôt à un objet de luxe, tantôt à l'autre : commodités, fantaisies, beaux-arts, philosophie, tout a été proscrit tour-à-tour par les empereurs romains & grecs ; aucun n'a voulu voir que le luxe ne faisoit pas les moeurs, mais qu'il en prenoit le caractere & celui du gouvernement.
La premiere opération à faire pour remettre le luxe dans l'ordre & pour rétablir l'équilibre des richesses, c'est le soulagement des campagnes. Un prince de nos jours a fait, selon moi, une très-grande faute en défendant aux laboureurs de son pays de s'établir dans les villes ; ce n'est qu'en leur rendant leur état agréable qu'il est permis de le leur rendre nécessaire, & alors on peut sans conséquence charger de quelques impôts le superflu des artisans du luxe qui reflueront dans les campagnes.
Ce ne doit être que peu-à-peu & seulement en forçant les hommes en place à s'occuper des devoirs qui les appellent dans les provinces, que vous devez diminuer le nombre des habitans de la capitale.
S'il faut séparer les riches, il faut diviser les richesses ; mais je ne propose point des loix agraires, un nouveau partage des biens, des moyens violens ; qu'il n'y ait plus de privileges exclusifs pour certaines manufactures & certains genres de commerce ; que la finance soit moins lucrative ; que les charges, les bénéfices soient moins entassés sur les mêmes têtes ; que l'oisiveté soit punie par la honte ou par la privation des emplois ; & sans attaquer le luxe en lui-même, sans même trop gêner les riches, vous verrez insensiblement les richesses se diviser & augmenter, le luxe augmenter & se diviser comme elles, & tout rentrera dans l'ordre. Je sens que la plûpart des vérités renfermées dans cet article, devroient être traitées avec plus d'étendue ; mais j'ai resserré tout, parce que je fais un article & non pas un livre : je prie les lecteurs de se dépouiller également des préjugés de Sparte & de ceux de Sybaris ; & dans l'application qu'ils pourroient faire à leur siecle ou à leur nation de quelques traits répandus dans cet ouvrage, je les prie de vouloir bien, ainsi que moi, voir leur nation & leur siecle, sans des préventions trop ou trop peu favorables, & sans enthousiasme, comme sans humeur.
|
| LUXEMBOURG | LE DUCHE DE, (Géog.) l'une des 17 provinces des Pays-bas, entre l'évêché de Liége, l'électorat de Treves, la Lorraine & la Champagne. Elle appartient pour la majeure partie à la maison d'Autriche, & pour l'autre à la France, par le traité des Pyrénées : Thionville est la capitale du Luxembourg françois. Il est du gouvernement militaire de Metz & de Verdun, & pour la justice du parlement de Metz.
Le Comté de Luxembourg fut érigé en duché par l'empereur Charles IV, dont le regne a commencé en 1346. On a trouvé dans cette province bien des vestiges d'antiquités romaines, simulachres de faux-dieux, médailles & inscriptions. Le pere Wiltheim avoit préparé sur ces monumens un ouvrage dont on a desiré la publication, mais qui n'a point vû le jour.
LUXEMBOURG, (Géog.) anciennement Lutzelbourg, en latin moderne Luxemburgum, Lutzelburgum, ville des Pays-bas autrichiens, capitale du duché du même nom. Elle a été fondée par le Comte Sigefroi, avant l'an 1000 ; car ce n'étoit qu'un château en 936.
Elle fut prise par les François en 1542 & 1543. Ils la bloquerent en 1682, & la bombarderent en 1683 : Louis XIV. la prit en 1684, & en augmenta tellement les fortifications, qu'elle est devenue une des plus fortes places de l'Europe. Elle fut rendue à l'Espagne en 1697, par le traité de Ryswick. Les François en prirent de nouveau possession en 1701 ; mais elle fut cédée à la maison d'Autriche par la paix d'Utrecht. Elle est divisée en ville haute, & en ville basse, par la riviere d'Else ; la haute ou ancienne ville est sur une hauteur presque environnée de rochers ; la neuve ou basse est dans la plaine, à 10 lieues S. O. de Treves, 40 S. O. de Mayence, 15 N. O. de Metz, 65 N. E. de Paris. Long. 23. 42. lat. 49. 40.
|
| LUXEU | ou LUXEUIL, Luxovium, (Géog.) petite ville de France en Franche-Comté, au pié d'une célebre abbaye de même nom, à laquelle elle doit son origine ; elle est au pié du mont de Vosge, à six lieues de Vezoul. Long. 24. 4. lat. 47. 40.
|
| LUXIM | ou LIXIM, Luximum, (Géog.) petite ville de la principauté de Platzbourg, à 4 lieues de Saverne. Long. 26. 2. lat. 48. 49. (D.J.)
|
| LUXURE | S. f. (Morale) ce terme comprend dans son acception toutes les actions qui sont suggérées par la passion immodérée des hommes pour les femmes, ou des femmes pour les hommes. Dans la religion chrétienne, la luxure est un des sept péchés capitaux.
|
| LUZIN | S. m. (Marine) espece de menu cordage qui sert à faire des enfléchures.
|
| LY | (Hist. mod.) mesure usitée parmi les Chinois, qui fait 240 pas géométriques ; il faut dix ly pour faire un pic ou une lieue de la Chine.
|
| LYAEUS | (Littér.) surnom de Bacchus chez les Latins qui signifie la même chose que celui de liber ; car si liber vient de liberare, délivrer, Lyaeus vient du grec , détacher, quia vinum curis mentem liberat & solvit, parce que le vin nous délivre des chagrins. Pausanias appelle Bacchus Lysius, qui est encore la même chose que Lyaeus. (D.J.)
|
| LYCANTHROPE | ou LOUP-GAROU, (Divin.) homme transformé en loup par un pouvoir magique, ou qui par maladie a les inclinations & le caractere féroce d'un loup.
Nous donnons cette définition conformément aux idées des Démonographes, qui admettent de deux sortes de lycanthropes ou de loups-garoux. Ceux de la premiere espece sont, disent-ils, ceux que le diable couvre d'une peau de loup, & qu'il fait errer par les villes & les campagnes en poussant des hurlemens affreux & commettant des ravages. Il ne les transforme pas proprement en loups, ajoutent-ils, mais il leur en donne seulement une forme fantastique, ou il transporte leurs corps quelque part, & substitue dans les endroits qu'ils ont coutume d'habiter & de fréquenter, une figure de loup. L'existence de ces sortes d'êtres n'est prouvée que par des histoires qui ne sont rien moins qu'avérées.
Les loups-garoux de la seconde espece sont des hommes atrabilaires qui s'imaginent être devenus loups par une maladie que les Médecins nomment en grec , & , mot composé de , loup, & , homme, Delrio, lib. II.
Voici comme le pere Malebranche explique comment un homme s'imagine qu'il est loup garou : " un homme, dit-il, par un effort déréglé de son imagination, tombe dans cette folie qu'il se croit devenir loup toutes les nuits. Ce déreglement de son esprit ne manque pas à le disposer à faire toutes les actions que font les loups, ou qu'il a ouï dire qu'ils faisoient. Il sort donc à minuit de sa maison, il court les rues, il se jette sur quelque enfant s'il en rencontre, il le mord & le maltraite, & le peuple stupide & superstitieux s'imagine qu'en effet ce fanatique devient loup, parce que ce malheureux le croit lui-même, & qu'il l'a dit en secret à quelques personnes qui n'ont pû s'en taire.
S'il étoit facile, ajoute le même auteur, de former dans le cerveau les traces qui persuadent aux hommes qu'ils sont devenus loups, & si l'on pouvoit courir les rues, & faire tous les ravages que font ces misérables loups-garoux, sans avoir le cerveau entierement bouleversé, comme il est facile d'aller au sabbat dans son lit & sans se réveiller, ces belles histoires de transformations d'hommes en loups, ne manqueroient pas de produire leur effet comme celles qu'on fait du sabbat, & nous aurions autant de loups-garoux, que nous avons de sorciers. Voyez SABBAT.
Mais la persuasion qu'on est transformé en loup, suppose un bouleversement de cerveau bien plus difficile à produire que celui d'un homme qui croit seulement aller au sabbat.... Car afin qu'un homme s'imagine qu'il est loup, boeuf, &c. Il faut tant de choses, que cela ne peut être ordinaire ; quoique ces renversemens d'esprit arrivent quelquefois ou par une punition divine, comme l'Ecriture le rapporte de Nabuchodonosor, ou par un transport naturel de mélancholie au cerveau, comme on en trouve des exemples dans les auteurs de Médecine ". Recherches de la vérité, tome premier, livre XI. chapitre vj.
|
| LYCANTHROPIE | S. f. (Médecine) , nom entierement grec, formé de , loup, & , homme : suivant son étymologie, il signifie un loup qui est homme. Il est employé en Médecine, pour désigner cette espece de mélancholie dans laquelle les hommes se croyent transformés en loups ; & en conséquence, ils en imitent toutes les actions ; ils sortent à leur exemple de leurs maisons la nuit ; ils vont roder autour des tombeaux, ils s'y enferment, se mêlent & se battent avec les bêtes féroces, & risquent souvent leur vie, leur santé dans ces sortes de combats. Actuarius remarque qu'après qu'ils ont passé la nuit dans cet état, ils retournent au point du jour chez eux, & reprennent leur bon sens ; ce qui n'est pas constant : mais alors même ils sont rêveurs, tristes, misantropes ; ils ont le visage pâle, les yeux enfoncés, la vûe égarée, la langue & la bouche seches, une soif immodérée, quelquefois aussi les jambes meurtries, déchirées, fruits de leurs débats nocturnes. Cette maladie, si l'on en croit quelques voyageurs, est assez commune dans la Livonie & l'Irlande. Donatus Ab alto mari dit en avoir vû lui-même deux exemples ; & Forestus raconte qu'un lycanthrope qu'il a observé, étoit sur-tout dans le printems toujours à rouler dans les cimetieres, lib. X. observ. 25. Le démoniaque dont il est parlé dans l'Ecriture-sainte (S. Marc. ch. v.), qui se plaisoit à habiter les tombeaux, qui couroit tout nud, poussoit sans cesse des cris effrayans, &c. & le Lycaon, célebre dans la fable, ne paroissent être que des mélancholiques de cette espece, c'est-à-dire des lycanthropes. Nous passons sous silence les causes, la curation, &c. de cette maladie, parce qu'elles sont absolument les mêmes que dans la mélancholie, dont nous traiterons plus bas. Voyez MELANCHOLIE. Nous remarquerons seulement quant à la curation, qu'il faut sur-tout donner à ces malades des alimens de bon suc analeptiques, pendant l'accès les saigner abondamment. Oribase recommande comme un spécifique, lorsque l'accès est sur le point de se décider, de leur arroser la tête avec de l'eau bien froide ou des décoctions somniferes ; & lorsqu'ils sont endormis, de leur frotter les oreilles & les narines avec l'opium (synops. lib. IX. c. x.) Il faut aussi avoir attention de les enchaîner pour les empêcher de sortir la nuit, & d'aller risquer leur vie parmi les animaux les plus féroces, si l'on n'a pas d'autre moyen de les contenir.
|
| LYCAONIE | Lycaonia, (Géog. anc.) province de l'Asie mineure, entre la Pamphilie, la Cappadoce, la Pisidie & la Phrygie, selon Cellarius. La Lycaonie voisine du Taurus, quoiqu'en partie située sur cette montagne, fut reputée par les Romains appartenir à l'Asie au-dedans du Taurus ; Asiae intra Taurum. Strabon prétend que l'Isaurique faisoit une partie de la Lycaonie : la notice de l'empereur Léon le Sage, & celle d'Hiéroclès, ne s'accordent pas ensemble sur le nombre des villes épiscopales de cette province, qui eut cependant l'avantage d'avoir S. Paul & S. Barnabé pour apôtres, comme on le lit dans les actes, ch. xiv. v. 16.
Nous ignorons quel a été dans les premiers tems l'état & le gouvernement de la Lycaonie ; nous savons seulement que le grand roi, c'est-à-dire le roi de Perse, en étoit le souverain, lorsqu'Alexandre porta ses armes en Asie, & en fit la conquête. Sous les successeurs d'Alexandre, ce pays souffrit diverses révolutions, jusqu'à ce que les Romains s'en rendirent maîtres. Dans la division de l'empire, la Lycaonie fit partie de l'empire d'orient, & se trouva sous la domination des empereurs grecs.
Depuis ce tems-là, ce pays fut possédé par divers souverains grands & petits, & usurpé par plusieurs princes ou tyrans, qui le ravagerent tour-à-tour. Sa situation l'exposa aux incursions des Arabes, Sarrasins, Persans, Tartares, qui l'ont désolé, jusqu'à ce qu'il soit tombé entre les mains des Turcs, qui le possedent depuis trois cent ans.
La Lycaonie, qu'on nomme à présent Grande Caramanie, ou pays de Cogny, est située à-peu-près entre le 38 & le 40 degré de latitude septentrionale, & entre le 50 & le 52 degré de latitude. Les villes principales de la Lycaonie, sont Iconium, aujourd'hui Cogni, Thébase, située dans le mont Taurus, Hyde située sur les confins de la Galatie & de Cappadoce, &c.
Quand à la langue lycaonienne, dont il est parlé dans les actes des Apôtres, XIV. 10. en ces mots : ils éleverent la voix parlant lycaonien, nous n'en avons aucune connoissance. Le sentiment le plus raisonnable, & le mieux appuyé sur cette langue, est celui de Grotius, qui croit que la langue des Lycaoniens étoit la même que celle des Cappadociens, ou dumoins en étoit une sorte de dialecte.
|
| LYCAONIENS | Lycaones, (Géog. anc.) outre les habitans de la province de Lycaonie, il y avoit des peuples lycaoniens, différens des Asiatiques, & qui vinrent d'Arcadie s'établir en Italie, selon Denys d'Halicarnasse, l. I. c. iv. Il ajoute que cette transmigration d'Arcadiens arriva sous Oenotrus leur chef, fils de Lycaon II. & qu'alors ils prirent en Italie le nom d'Oenotriens. (D.J.)
|
| LYCÉE | , (Hist. anc.) c'étoit le nom d'une école célebre à Athènes, où Aristote & ses sectateurs expliquoient la Philosophie. On y voyoit des portiques & des allées d'arbres plantés en quinconce, où les Philosophes agitoient des questions en se promenant ; c'est de-là qu'on a donné le nom de Péripatéticienne ou de Philosophie du Lycée à la philosophie d'Aristote. Suidas observe que le nom de Lycée venoit originairement d'un temple bâti dans ce lieu, & consacré à Apollon Lycéon ; d'autres disent que les portiques qui faisoient partie du Lycée, avoient été élevés par un certain Lycus fils d'Apollon ; mais l'opinion la plus généralement reçue, est que cet édifice commencé par Pisistrate, fut achevé par Périclès.
LYCEES, fêtes d'Arcadie, qui étoient à-peu-près la même chose que les lupercales de Rome. On y donnoit des combats, dont le prix étoit une armure d'airain ; on ajoute que dans les sacrifices on immoloit une victime humaine, & que Lycaon étoit l'instituteur de ces fêtes. On en célebroit encore d'autres de même nom à Argos, en l'honneur d'Apollon Lycogene, ainsi surnommé ou de ce qu'il aimoit les loups, ou comme d'autres le prétendent, de ce qu'il avoit purgé le pays d'Argos des loups qui l'infestoient.
LYCEES, s. f. plur. , (Littér.) il y avoit deux fêtes de ce nom dans la Grece : l'une se faisoit en Arcadie à l'honneur de Pan, & ressembloit en plusieurs choses aux lupercales des Romains. Elle en différoit seulement, en ce qu'il y avoit une course où, selon M. Potter, on donnoit au vainqueur une armure complete de fonte. L'autre fête appellée Lycées se célebroit chez les Argiviens, & avoit été fondée par Danaüs en l'honneur d'Apollon, auquel ce roi bâtit un temple sous le nom d'Apollon Lycéen.
LYCEE mont, Lycaeus, (Géog. anc.) montagne du Péloponnèse, dans l'Arcadie méridionale, entre l'Alphée & l'Eurotas. Les Poëtes l'ont chanté, & Pausanias, l. VIII. c. xxxix. débite des merveilles sur les vertus de la fontaine du Lycée ; sur la ville Lycosure qu'on y voyoit, & qu'il estimoit une des plus anciennes du monde, soit dans le continent, soit dans les îles ; sur le temple de Pan, placé dans un autre endroit du Lycée, sur une plaine de cette montagne consacrée à Jupiter Lycéen, & qui étoit inaccessible aux hommes. Enfin, il ajoute : " au sommet du Lycée, est une élévation de terre, d'où l'on peut découvrir tout le Péloponnèse ; un autel décore cette terrasse : devant cet autel sont deux piliers surmontés par des aigles dorés ; le temple d'Apollon Parrhasien est à l'orient ; le champ de Thison est au nord, &c. ". C'est ainsi que cet aimable historien nous inspire le desir de monter avec lui sur le Lycée, ou plutôt nous donne des regrets de la ruine de tant de belles choses. (D.J.)
|
| LYCÉEN | (Littérat.) surnom de Jupiter, tiré du mont Lycée, où les Arcadiens prétendoient que ce souverain des dieux avoit été nourri par trois belles nymphes, dans un petit canton nommé Crétée ; il n'étoit pas permis aux hommes, dit Pausanias, d'entrer dans l'enceinte de ce canton consacré à Jupiter lycéen ; & toute bête poursuivie par des chasseurs s'y trouvoit en sûreté, lorsqu'elle venoit à s'y refugier. Sur la croupe de la montagne étoit l'autel de Jupiter lycéen, où ses prêtres lui sacrifioient avec un grand mystere. Il ne m'est pas permis, ajoute Pausanias, de rapporter les cérémonies de ce sacrifice ; ainsi laissons, continue-t-il, les choses comme elles sont, & comme elles ont toujours été : ces derniers mots sont la formule dont les anciens usoient pour éviter de divulguer ou de censurer les mysteres d'un culte étranger. (D.J.)
|
| LYCHNIS | (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur en oeillet, composée de plusieurs pétales qui sont disposés en rond, qui ont ordinairement la forme d'un coeur, & qui sortent d'un calice fait en tuyau ; ces pétales ont chacun deux ou trois petites feuilles qui forment une couronne par leur position ; il sort du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit qui le plus souvent est terminé en couronne, & qui s'ouvre par le sommet ; ce fruit est enveloppé du calice ; il n'a souvent qu'une cavité ; il renferme des semences arrondies ou anguleuses, & qui ont quelquefois la forme d'un rein ; elles sont attachées à un placenta. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LYCHNITES | (Hist. nat.) nom que les anciens donnoient quelquefois au marbre blanc de Paros, dont sont faites les plus belles statues de l'antiquité. Voyez PAROS.
C'est son éclat qui lui avoit apparemment fait donner le nom de lychnites, parce qu'il brilloit comme une lampe. Quelques auteurs ont cru que les anciens désignoient sous ce nom une espece d'escarboucle qui se trouvoit, disoit-on, aux environs d'Orthosia, & dans toute la Carie. Voyez Pline, Hist. nat. lib. XXXVII. cap. vij.
|
| LYCHNOMANCIE | (Divin.) espece de divination qui se faisoit par l'inspection de la flamme d'une lampe. Ce mot est grec, & vient de , lampe, & de , divination.
On ignore le détail des cérémonies qui s'y pratiquoient. Il y a grande apparence que c'étoit la même chose que la lampadomancie. Voyez LAMPADOMANCIE.
|
| LYCIARQUE | S. m. (Littér.) grand magistrat annuel de Lycie, qui présidoit aux affaires civiles & religieuses de toute la province. Le lyciarque, dit Strabon, liv. XIV. étoit créé dans le conseil composé des députés de 23 villes de la Lycie. Quelques-unes de ces villes avoient trois voix, d'autres deux, & d'autres une seulement, suivant les charges qu'elles supportoient dans la confédération. Voy. LYCIE.
Les lyciarques étoient tout-à-la-fois les chefs des tribunaux pour les affaires civiles, & pour les choses de la religion ; c'étoient ceux qui avoient soin des jeux & des fêtes que l'on célébroit en l'honneur des dieux, dont ils étoient inaugurés pontifes, en même tems qu'ils étoient faits lyciarques. Leur nom indiquoit leur puissance, commandant de Lycie. Voyez Saumaise sur Solin, & sur-tout le savant traité des époques Syro-Macédoniennes du cardinal de Noris, dissert. III. (D.J.)
|
| LYCIE | Lycia, (Géog. anc.) province maritime de l'Asie-mineure, en-deçà du Taurus, entre la Pamphylie à l'orient, & la Carie à l'occident. Le fleuve Xante, ce fleuve si fameux dans les écrits des poëtes, divisoit cette province en deux parties, dont l'un étoit en-de-là du fleuve, & l'autre au-deçà. Elle reçut son nom de Lycus, fils de Pandion, frere d'Egée, & oncle de Thésée.
La Lycie a été très-célebre par ses excellens parfums, par les feux de la chimere, & par les oracles d'Apollon de Patare ; mais elle doit l'être bien davantage, par la confédération politique de ses 23 villes. Elles payoient les charges dans l'association, selon la proportion de leurs suffrages. Leurs juges & leurs magistrats étoient élus par le conseil commun ; s'il falloit donner un modele d'une belle république confédérative, dit l'auteur de l'esprit des lois, je prendrois la république de Lycie.
Les géographes qui ont traité de ce pays réduit en province sous Vespasien, n'en connoissoient guere que les côtes. La notice de l'empereur Léon le sage, & celle d'Hieroclès, ne s'accordent pas ensemble sur le nombre des villes épiscopales de la Lycie. La premiere en compte 38, & la seconde 30. On appelle aujourd'hui cette province Aidine, & elle fait une partie méridionale de la Natolie. (D.J.)
LYCIE, mer de, lycium mare, (Géog.) c'étoit la partie occidentale de ce que nous nommons aujourd'hui mer de Caramanie. Elle avoit à l'orient la mer de Pamphilie, & à l'occident la mer Carpatienne. (D.J.)
|
| LYCIUM | (Hist. anc. des drog.) suc tiré d'un arbre épineux de la Lycie, ou d'un arbrisseau des Indes nommé louchitis par Dioscoride. Voilà les deux especes de lycium mentionnées dans les écrits des anciens Grecs, & que nous ne connoissons plus. Voyez ce qu'on a dit à la fin de l'article CACHOU.
On a substitué dans les boutiques, au lycium des anciens, le suc d'acacia vrai, ou celui du fruit d'acacia nostras, qu'on épaissit sur le feu en consistance solide. (D.J.)
|
| LYCODONTES | (Hist. nat.) nom donné par M. Hill aux pierres que l'on nomme communément bufonites ou crapaudines. Voyez ces articles.
|
| LYCOMIDES | LES, (Littér.) famille sacerdotale d'Athènes, consacrée au culte de Cérès éleusinienne ; c'étoit dans cette famille que résidoit l'intendance des mysteres de la déesse, pour laquelle divinité le poëte Musée composa l'hymne qu'on y chantoit. Il étoit heureux d'être de la famille des lycomides ; ainsi Pausanias en parle plus d'une fois dans ses ouvrages. (D.J.)
|
| LYCOPHTALMUS | (Hist. nat.) Les anciens donnoient ce nom à une espece d'onyx dans laquelle ils croyoient trouver de la ressemblance avec l'oeil d'un loup.
|
| LYCOPODION | (Chimie & Mat. méd.) Voyez PIE DE LOUP.
|
| LYCOPOLIS | (Géog. anc.) c'est-à-dire, ville des loups ; Strabon nomme deux Lycopolis, toutes deux en Egypte, l'une sur les bords du Nil, & l'autre dans les terres, à une assez grande distance de ce fleuve ; cette seconde donnoit le nom au nome ou territoire lycopolite, dont elle étoit la métropole. La premiere Lycopolis pourroit bien être la Munia ou Minio moderne. Voyez MUNIA. (D.J.)
|
| LYCOPUS | (Hist. nat. Bot.) genre de plante à fleur monopétale ; mais elle est labiée, & presque campaniforme ; on distingue à peine la levre supérieure de l'inférieure ; desorte qu'au premier aspect cette fleur semble être divisée en quatre parties ; il sort du calice un pistil attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré de quatre embryons qui deviennent dans la suite autant de semences arrondies & enveloppées dans une capsule qui a été le calice de la fleur. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez PLANTE.
|
| LYCORÉE | (Géog. anc.) Lycorea, quartier de la ville de Delphes en Grece, dans la Phocide, où Apollon étoit particulierement honoré. C'étoit le reste d'une ville antérieure à Delphes même, dont elle devint une partie. Etienne le géographe dit que c'étoit un village du territoire de Delphes ; Lucien prétend que Lycorée étoit une montagne sur laquelle Deucalion fut à couvert du déluge.
|
| LYCORMAS | (Géog. anc.) riviere de Grece, dans l'Etolie ; on l'appella dans la suite Evenus, & puis Chrisorrhoas. C'est le Calydonius amnis d'Ovide, & le Centaureus de Stace : son nom est la Fidari. (D.J.)
|
| LYCURGÉES | S. f. pl. (Antiq. greques) , fêtes des Lacédémoniens en l'honneur de Lycurgue, auquel ils éleverent un temple après son décès, & ordonnerent qu'on lui fît des sacrifices anniversaires, comme on en feroit à un dieu, dit Pausanias ; ils subsistoient encore, ces sacrifices, du tems de Plutarque. On prétendoit que lorsque les cendres de Lycurgue eurent été apportées à Sparte, la foudre consacra son tombeau. Il ne laissa qu'un fils qui fut le dernier de sa race ; mais ses parens & ses amis formerent une société qui dura des siecles ; & les jours qu'elle s'assembloit, s'appellerent lycurgides. Lycurgue fort supérieur au législateur de Rome, fonda par son puissant génie une république inimitable, & la Grece entiere ne connut point de plus grand homme que lui. Les Romains prospérerent en renonçant aux institutions de Numa, & les Spartiates n'eurent pas plutôt violé les ordonnances de Lycurgue, qu'ils perdirent l'empire de la Grece, & virent leur état en danger d'être entierement détruit. (D.J.)
|
| LYCUS | (Géog. anc.) ce mot est grec, & veut dire un loup : on l'a donné à quantité de rivieres, par allusion aux ravages qu'elles causoient lorsqu'elles sortoient de leur lit. Aussi compte-t-on en particulier dans l'Asie mineure, plusieurs rivieres de ce nom : comme 1°. Lycus, riviere dans la Phrygie, sur laquelle étoit située la Laodicée, qui prit le nom de Laodicée sur le Lycus. 2°. Lycus, riviere dans la Carie, qui tiroit sa source du mont Cadmus. 3°. Lycus, riviere dans la Mysie, au canton de Pergame, qui avoit sa source au mont Dracon, & se jettoit dans la Caïque. 4°. Lycus, riviere dans le Pont, où elle mêloit ses eaux avec celles de l'Iris : son nom moderne est Tosanlus, & autrement la riviere de Tocat. 5°. Lycus riviere dans la Cappadoce, ou plutôt dans le Pont cappadocien. 6°. Lycus, riviere dans l'Assyrie, qui se jette dans le Tigre ; Ninive n'en étoit pas éloignée. 7°. Lycus, riviere dans la Syrie, près du golfe d'Issus. 8°. Lycus, riviere dans l'île de Chypre. 9°. Lycus, riviere dans la Phénicie, entre l'ancienne Biblos & Bérythe. (D.J.)
|
| LYDDE | (Géog. anc.) en hébreu Lud ou Lod, en grec Lydda ou Diospolis, & aujourd'hui Loudde, selon le P. Nau, dans son voyage de la Terre-sainte liv. I. chap. vj. ancienne ville de la Palestine, sur le chemin de Jérusalem à Césarée de Philippe. Elle étoit à 4 ou 5 lieues E. de Joppé, appartenoit à la tribu d'Ephraïm, & tenoit le cinquieme rang entre les onze toparchies ou seigneuries de la Judée. Saint Pierre étant venu à Lydde, disent les actes des apôtres, c. ix. v. 33. y guérit un homme paralytique, nommé Enée.
Cette ville est actuellement bien pauvre. Le revenu qu'on en tire, ainsi que de ses environs, est assigné en partie pour l'entretien de l'hôpital de Jérusalem, en partie pour quelques fraix de la caravane de la Mecque. C'est le metouallo, ou intendant du sépulchre, qui recueille avec grande peine ces revenus, car il a affaire à des paysans & à des arabes qui ne donnent pas volontiers. (D.J.)
|
| LYDIE | (Géog. anc.) Lydia, province de l'Asie mineure, qui a été aussi nommée Méonie. Elle s'étendoit le long du Caistre, aujourd'hui le petit Madre, & confinoit avec la Phrygie, la Carie, l'Ionie & l'Eolide. On trouvoit en Lydie le mont Tmolus, & le Pactole y prenoit sa source. Les notices de Léon le Sage & d'Hiéroclès different entr'elles, sur le nombre des villes épiscopales ; le premier en compte 27, & le second 23.
M. Sévin a donné dans le recueil de l'académie des Inscriptions, l'histoire des rois de Lydie ; & M. Fréret y a joint de savantes recherches sur la chronologie de cette histoire. J'y renvoie le lecteur, & je me contenterai de remarquer que le royaume de Lydie, fut détruit par Cyrus roi de Perse, 545 ans avant J. C. après une guerre de quelques années, terminée par la prise de Sardes, capitale des Lydiens, & par la captivité de Crésus, qui fut le dernier roi de ce pays-là. (D.J.)
|
| LYDIEN | en Musique, étoit le nom d'un des anciens modes des Grecs, lequel occupoit le milieu entre l'éolien & l'hyperdorien.
Euclide distingue deux modes lydiens ; celui-ci, & un autre qu'il appelle grave, & qui est le même que le mode éolien. Voyez MODE.
LYDIENS, Jeux, (Littér.) nom qu'on donnoit aux exercices & amusemens que les Lydiens inventerent. Ces peuples asiatiques, après la prise de leur capitale, se réfugierent la plupart en Etrurie, où ils apporterent avec eux leurs cérémonies & leurs jeux.
Quelques romains ayant pris goût pour les jeux de ces étrangers, en introduisirent l'usage dans leur pays, où on les nomma lydi, & par corruption ludi. Il paroît que ces ludi étoient des jeux d'adresse comme le palet, dont on attribue la premiere invention aux Lydiens, & des jeux de hasard, comme les dés. Ces derniers devinrent si communs sous les empereurs, que Juvénal déclame vivement dans ses satyres, contre le nombre de ceux qui s'y ruinoient. (D.J.)
|
| LYDIUS LAPIS | (Hist. nat. Minér.) nom donné par les anciens à une pierre noire, fort dure, dont ils se servoient pour s'assurer de la pureté de l'or ; son nom lui avoit été donné parce que cette pierre se trouvoit dans la riviere de Tmolus en Lydie. On nommoit aussi cette pierre lapis heraclius, & souvent les auteurs se sont servis de ces deux dénominations pour désigner l'aimant, aussi-bien que la pierre de touche ; ce qui a produit beaucoup d'obscurité & de confusion dans quelques passages des anciens. Au reste il pourroit se faire que les anciens eussent fait usage de l'aimant pour essayer l'or, dumoins, est-il constant que toutes les pierres noires, pourvû qu'elles aient assez de consistance, & de dureté, peuvent servir de pierre de touche. Voyez TOUCHE, pierre de. (-)
|
| LYGDINUM MARMOR | ou LYGDUS LAPIS, (Hist. nat.) Les anciens nommoient ainsi une espece de marbre ou d'albâtre, d'une blancheur admirable, & qui surpassoit en beauté le marbre même de Paros, & tous les autres marbres les plus estimés. Il est composé de particules spathiques, ou de feuillets luisans, que l'on apperçoit sur-tout lorsqu'on vient à le casser, dans l'endroit de la fracture ; ce qui fait que le tissu de cette pierre ne paroît point compacte comme celui des marbres ordinaires ; & même il n'a point leur solidité, il s'égraine facilement, & se divise en petites masses. On en trouvoit des couches immenses en Egypte & en Arabie ; il y en a aussi en Italie. Les blocs que l'on tire de cette pierre ne sont point considérables, parce que son tissu fait qu'elle se fend & se gerse facilement : les anciens en faisoient des vases & des ornemens.
Il y a lieu de croire que cette pierre étoit formée de la même maniere que les stalactiques, & qu'elle ne doit pas être regardée comme un vrai marbre, mais plutôt comme un vrai spathe. Pline dit qu'on le tiroit du mont Taurus en Asie ; & Chardin dans son voyage de Perse, dit qu'on trouvoit encore une espece de marbre blanc & transparent dans une chaîne de montagnes. Voyez Hill & Eman. Mendez d'Acosta, Hist. nat. des fossiles. (-)
|
| LYGIENS | (Géog. anc.) Lygii, Ligii, Lugii, Logiones, ancien peuple de la grande Germanie. Tacite, de morib. German. dit, qu'au-delà d'une chaîne de montagnes qui coupe le pays des Sueves, il y a plusieurs nations, entre lesquelles les Lygiens composent un peuple fort étendu, partagé en plusieurs cantons. Leur pays fait présentement partie de la Pologne, en deçà de la Vistule, partie de la Silésie, & partie de la Bohème. (D.J.)
|
| LYGODESMIENNE | adj. (Litter.) surnom donné à Diane Orthienne, parce que sa statue étoit venue de la Tauride à Sparte, empaquetée dans des liens d'osier : c'est ce que désigne ce nom, composé de , osier, & , lien. (D.J.)
|
| LYMAX | (Géog. anc.) riviere du Péloponnèse, dans l'Arcadie ; elle baignoit la ville de Phigalé, & se dégorgeoit dans le Néda. Les Poëtes ont feint que les Nymphes qui assisterent aux couches de Rhée, lorsqu'elle eut mis au monde Jupiter, laverent la déesse dans cette riviere pour la purifier. Le mot grec signifie purification. (D.J.)
|
| LYMBES | S. m. (Théolog.) terme consacré aujourd'hui dans le langage des Théologiens, pour signifier le lieu où les ames des SS. patriarches étoient détenues, avant que J. C. y fût descendu après sa mort, & avant sa résurrection, pour les délivrer & pour les faire jouir de la béatitude. Le nom de lymbes ne se lit, ni dans l'Ecriture, ni dans les anciens peres, mais seulement celui d'enfers, inferi, ainsi qu'on le voit dans le symbole, descendit ad inferos. Les bons & les méchans vont dans l'enfer, pris en ce sens ; mais toutefois il y a un grand cahos, un grand abîme entre les uns & les autres. J. C. descendant aux enfers ou aux lymbes, n'en a délivré que les saints & les patriarches. Voyez ci-devant ENFER, & Suicer dans son dictionnaire des PP. grecs, sous le nom AH, tom. I. pag. 92. 93. 94. & Martinius dans son lexicon philologicum, sous le nom LYMBUS ; & M. Ducange, dans son dictionnaire de la moyenne & basse latinité, sous le même mot LYMBUS ; & enfin les Scholastiques sur le quatrieme livre du maître des sentences, distinct. 4. & 25. On ne connoît pas qui est le premier qui a employé le mot lymbus, pour désigner le lieu où les ames des saints patriarches, & selon quelques-uns, celles des enfans morts sans baptême sont détenues : on ne le trouve pas en ce sens dans le maître des sentences ; mais ses commentateurs s'en sont servis. Voyez Durand, in 3. sent. dist. 22. qu. 4. art. 1. & in. 4. dist. 21. qu. 1. art. 1. & alibi saepiùs. D. Bonavent. in. 4. dist. 45. art. 1. qu. 1. respons. ad argument. limbus. Car c'est ainsi qu'il est écrit, & non pas lymbus ; c'est comme le bord & l'appendice de l'enfer. Calmet, diction. de la Bibl. tom. II. pag. 574.
|
| LYME | (Géog.) petite ville à marché en Angleterre, en Dorsetshire, sur une petite riviere de même nom, avec un havre peu fréquenté, & qui n'est connu dans l'histoire que parce que le duc de Monmouth y prit terre, lorsqu'il arriva de Hollande, pour se mettre à la tête du parti, qui vouloit lui donner la couronne de Jacques II. Lyme envoie deux députés au Parlement, & est à 120 milles S. O. de Londres. Long. 14. 48. lat. 50. 46. (D.J.)
|
| LYMPHAEA | S. m. pl. (Littérat.) espece de grottes artificielles, ainsi nommée du mot lympha, eau, parce qu'elles étoient formées d'un grand nombre de canaux & de petits tuyaux cachés, par lesquels on faisoit jaillir l'eau sur les spectateurs, pendant qu'ils s'occupoient à admirer la variété & l'arrangement des coquilles de ces grottes. Les jardins de Versailles abondent en ces sortes de jeux hydrauliques.
|
| LYMPHATIQUES | (Anatom.) vaisseaux lymphatiques, sont des petits vaisseaux transparens qui viennent ordinairement des glandes, & reportent dans le sang une liqueur claire & limpide appellée lymphe. Voyez LYMPHE.
Quoique ces vaisseaux ne soient pas aussi visibles que les autres, à cause de leur petitesse & de leur transparence, ils ne laissent pas d'exister dans toutes les parties du corps ; mais la difficulté de les reconnoître a empêché de les décrire dans plusieurs parties.
Les vaisseaux lymphatiques ont à des distances inégales, mais peu considérables, deux valvules semilunaires, l'une vis-à-vis de l'autre, qui permettent à la lymphe de couler vers le coeur, mais l'empêchent de rétrograder.
Ils se trouvent dans toutes les parties du corps, & leur origine ne peut guere être un sujet de dispute ; car il est certain que toutes les liqueurs du corps, à l'exception du chyle, se séparent du sang dans les vaisseaux capillaires, par un conduit qui est différent du conduit commun où coule le reste du sang. Mais soit que ces conduits soient longs ou courts, visibles ou invisibles, ils donnent néanmoins passage à une certaine partie du sang, tandis qu'ils la refusent aux autres. Voyez SANG.
Or, les glandes par lesquelles la lymphe passe, doivent être de la plus petite espece, puisqu'elles sont invisibles, même avec les meilleurs microscopes. Mais les vaisseaux lymphatiques, à la sortie de ces glandes, s'unissent les uns aux autres, & deviennent plus gros à mesure qu'ils approchent du coeur. Cependant ils ne se déchargent pas dans un canal commun, comme font les veines ; car on trouve quelquefois deux ou trois vaisseaux lymphatiques, & même davantage, qui sont placés l'un à côté de l'autre, qui ne communiquent entr'eux que par de petits vaisseaux intermédiaires & très-courts, qui se réunissent, & aussi-tôt après se séparent de nouveau. Dans leur chemin, ils touchent toujours une ou deux glandes conglobées, dans lesquelles ils se déchargent de leur lymphe. Quelquefois un vaisseau lymphatique se décharge tout entier dans une glande ; d'autres fois il envoie seulement deux ou trois branches, tandis que le tronc principal passe outre, & va joindre les vaisseaux lymphatiques qui viennent des côtés opposés de la glande, & vont se décharger dans le reservoir commun.
Les glandes de l'abdomen qui reçoivent les vaisseaux lymphatiques de toutes les parties de cette cavité, comme aussi des extrêmités inférieures, sont les glandes inguinales, les sacrées, les iliaques, les lombaires, les mesentériques & les hépatiques, &c. qui toutes envoient de nouveaux vaisseaux lymphatiques, lesquels se déchargent dans le reservoir du chyle, comme ceux du thorax, de la tête & des bras, se déchargent dans le canal thorachique, dans les veines jugulaires & dans les souclavieres. Voyez GLANDE & CONGLOBEE.
Il est un autre genre de vaisseaux, auxquels on a donné le nom de lymphatiques : car comme il y a dans les corps animés des particules blanches, le sang, a-t-on dit, n'y pénetre donc pas ; il faut donc qu'il y ait des arteres qui ne se chargent que de la lymphe, c'est-à-dire des sucs blancs ou aqueux. M. Ruysch a sur-tout observé ces arteres lymphatiques dans les membranes de l'oeil, & il n'est pas le seul ; Hovius a vu les mêmes vaisseaux : ce sont, selon lui, des arteres lymphatiques. Nuck les a décrites avant cet écrivain qui a été son copiste, ou qui a copié la nature avant lui. Voyez les lettres sur le nouveau système de la voix, & sur les arteres lymphatiques.
|
| LYMPHE | (Chimie) ou nature de la lymphe. Voy. SANG, (Chimie), & SUBSTANCES ANIMALES, (Chimie).
|
| LYN | (Géogr.) ville à marché & fortifiée d'Angleterre, dans le comté de Norfolck ; elle envoie deux députés au parlement, & est située à l'embouchure de l'Ouse, où elle jouit d'un grand port de mer, à 75 milles N. E. de Londres. Long. 17. 50. lat. 52. 43. (D.J.)
|
| LYNCE | (Hist. nat.) pierre fabuleuse formée, disoit-on, par l'urine du lynx ; on prétendoit qu'elle devenoit molle lorsqu'on l'enfouissoit en terre, & qu'elle se durcissoit dans les lieux secs. Sa couleur étoit mêlée de blanc & de noir. On dit qu'en la mettant en terre elle produisoit des champignons. Boece de Boot croit que c'est le lapis fungifer, ou la pierre à champignons.
|
| LYNCESTES | (Géog. anc.) Lyncestae, Strabon dit Lyncistae ; peuple de la Macédoine ; leur province nommée Lyncestides, étoit au couchant de l'Ematie, ou Macédoine propre. La capitale s'appelloit Lyncus. Tite-Live en parle liv. XXVI. chap. xxv. (D.J.)
|
| LYNCURIUS LAPIS | (Hist. nat.) les naturalistes modernes sont partagés sur la pierre que les anciens désignoient sous ce nom. Theophraste dit qu'elle étoit dure, d'un tissu solide comme les pierres précieuses, qu'elle avoit le pouvoir d'attirer comme l'ambre, qu'elle étoit transparente & d'une couleur de flamme, & qu'on s'en servoit pour graver des cachets.
Malgré cette description, Woodward & plusieurs autres naturalistes ont cru que le lapis lyncurius des anciens étoit la belemnite, quoiqu'elle ne possede aucune des qualités que Theophraste lui attribue. Gesner & M. Geoffroy se sont imaginés que les anciens vouloient par-là désigner l'ambre ; mais la définition de Theophraste, qui dit que le lapis lyncurius attiroit de même que l'ambre, & qui compare ces deux substances, détruit cette opinion.
M. Hill conjecture avec beaucoup de raison, d'après la description de Theophraste, que cette pierre étoit une vraie hyacinthe, sur laquelle on voit que les anciens gravoient assez volontiers. Les anciens ont distingué plusieurs especes de lapis lyncurius, telles que le lyncurius mâle & le lyncurius femelle, le lyncurius fin. M. Hill pense que c'étoit des hyacinthes qui ne différoient entr'elles que par le plus ou moins de vivacité de leur couleur. Voyez Theophraste, traité des pierres, avec les notes de Hill ; & voyez HYACINTHE. (-)
|
| LYNX | S. m. (Hist. nat.) lynx ou loup-cervier, animal quadrupede ; il a environ deux piés & demi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, qui n'est longue que d'un demi pié. Cet animal a beaucoup de rapport au chat, tant pour la figure que pour la conformation. Il y a sur la pointe des oreilles un bouquet de poils noirs en forme de pinceau long d'un pouce & demi. Toutes les parties supérieures de l'animal, & la face externe des jambes ont une couleur fauve, roussâtre, très-foible, mêlée de blanc, de gris, de brun & de noir ; les parties inférieures & la face interne des jambes sont blanches avec des teintes de fauve & quelques taches noires ; le bout de la queue est noir, & le reste a les mêmes couleurs que les parties inférieures du corps ; les doigts sont au nombre de cinq dans les piés de devant, & de quatre dans ceux de derriere. Il y a des lynx en Italie & en Allemagne ; ceux qui sont en Asie ont de plus belles couleurs ; il y a aussi de la variété dans celles des lynx d'Europe. On a donné à ces animaux le nom de loup-cervier, parce qu'ils sont très-carnassiers & qu'ils attaquent les cerfs. Voyez QUADRUPEDE.
LYNX, pierre de (Mat. med.) Voyez BELEMNITE.
LYNX, (Mythol.) animal fabuleux consacré à Bacchus. Tout ce que les anciens nous ont dit de la subtilité de la vue de ce quadrupede, en supposant même qu'ils eussent dit vrai, ne vaut pas cette seule réflexion de la Fontaine, fable VII. liv. I.
Voilà ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, & taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, & rien aux autres hommes.
|
| LYON | (Géogr.) grande, riche, belle, ancienne & célebre ville de France, la plus considérable du royaume après Paris, & la capitale du Lyonnois. Elle se nomme en latin Lugdunum, Lugudunum, Lugdumum Segusianorum, Lugdumum Celtarum, &c. Voyez LUGDUNUM.
Lyon fut fondée l'an de Rome 712, quarante-un ans avant l'ere chrétienne, par Lucius Munatius Plancus, qui étoit consul avec Aemilius Lepidus. Il la bâtit sur la Saône, au lieu où cette riviere se jette dans le Rhône, & il la peupla des citoyens romains qui avoient été chassés de Vienne par les Allobroges.
On lit dans Gruter une inscription où il est parlé de l'établissement de cette colonie ; cependant on n'honora pas Lyon d'un nom romain ; elle eut le nom gaulois Lugdun, qu'avoit la montagne aujourd'hui Forvieres, sur laquelle cette ville fut fondée. Vibius Sequester prétend que ce mot Lugdun signifioit en langue gauloise, montagne de corbeau. Quoi qu'il en soit, la ville de Lyon est presque aussi souvent nommée Lugudunum dans les inscriptions antiques des deux premiers siecles de notre ere. M. de Boze avoit une médaille de Marc-Antoine, au revers de laquelle se voyoit un lion, avec ce mot partagé en deux, Lugu-duni.
Lyon fondée, comme nous l'avons dit, sur la montagne de Forvieres, nommée Forum-vetus, & selon d'autres Forum-veneris, s'aggrandit rapidement le long des collines, & sur le bord de la Saône ; elle devint bientôt une ville florissante & l'entrepôt d'un grand commerce. Auguste la fit capitale de la Celtique, qui prit le nom de province lyonnoise. Ce fut de Lyon, comme de la forteresse principale des Romains au-deçà des Alpes, qu'Agrippa tira les premiers commencemens des chemins militaires de la Gaule, tant à cause de la rencontre du Rhône & de la Saône qui se fait à Lyon, que pour la situation commode de cette ville, & son rapport avec toutes les autres parties de la Gaule.
Il n'y a rien eu de plus célebre dans notre pays, que ce temple d'Auguste, qui fut bâti à Lyon par soixante peuples des Gaules, à la gloire de cet empereur, avec autant de statues pour orner son autel.
On ne peut point oublier qu'après que Caligula eut reçu dans Lyon l'honneur de son troisieme consulat, il y fonda toutes sortes de jeux, & en particulier cette fameuse académie Athaenaeum, qui s'assembloit devant l'autel d'Auguste, Ara Lugdunensis. C'étoit là qu'on disputoit les prix d'éloquence greque & latine, en se soumettant à la rigueur des lois que le fondateur avoit établies. Une des conditions singulieres de ces lois étoit que les vaincus non-seulement fourniroient à leurs dépens les prix aux vainqueurs, mais de plus qu'ils seroient contraints d'effacer leurs propres ouvrages avec une éponge, & qu'en cas de refus, ils seroient battus de verges, ou même précipités dans le Rhône. De-là vient le proverbe de Juvenal, sat. 2. v. 44.
Palleat ut nudis pressit qui calcibus anguem,
Aut Lugdunensem rhetor dicturus ad aram.
Le temple d'Auguste, son autel, & l'académie de Caligula, dont parlent Suétone & Juvenal, étoient dans l'endroit où est aujourd'hui l'abbaye d'Aisnay, nom corrompu du mot Athaenaeum.
Lyon jouissoit de tant de décorations honorables, lorsque cent ans après sa fondation, elle fut détruite en une seule nuit, par un incendie extraordinaire, dont on ne trouve pas d'autres exemples dans les annales de l'histoire. Seneque, épist. 91. à Lucius, dit avec beaucoup d'esprit, en parlant de cet embrasement, qu'il n'y eut que l'intervalle d'une nuit, entre une grande ville & une ville qui n'existoit plus ; le latin est plus énergique : inter magnam urbem, & nullam, una nox interfuit. Cependant Néron ayant appris cette triste nouvelle, envoya sur le champ une somme considérable pour rétablir cette ville, & cette somme fut si bien employée, qu'en moins de vingt ans Lyon se trouva en état de faire tête à Vienne, qui suivoit le parti de Galba contre Vitellius.
On voit encore à Lyon quelques pauvres restes des magnifiques ouvrages dont les Romains l'avoient embellie. Le théâtre où le peuple s'assembloit pour les spectacles étoit sur la montagne de Saint-Just, dans le terrein qui est occupé par le couvent & les vignes des Minimes. On y avoit construit des aqueducs pour conduire l'eau du Rhône dans la ville, avec des réservoirs pour recevoir ces eaux. Il ne subsiste de tout cela qu'un réservoir assez entier, qu'on appelle la grotte Berelle, quelques arcades ruinées & des amas de pierres.
Le palais des empereurs & des gouverneurs, lorsqu'ils se trouvoient à Lyon, étoit sur le penchant de la même montagne, dans le terrein du monastere des religieuses de la Visitation. L'on ne sauroit presque y creuser que l'on n'y trouve encore quelque antiquaille. On peut ici se servir de ce mot antiquaille, parce qu'une partie de la colline en a retenu le nom.
Lorsque dans le cinquieme siecle les Gaules furent envahies par des nations barbares, Lyon fut prise par les Bourguignons, dont le roi devint feudataire de Clovis sur la fin du même siecle. Les fils de Clovis détruisirent cet état des Bourguignons, & se rendirent maîtres de Lyon. Mais cette ville dans la suite des tems changea plusieurs fois de souverains ; & ses archevêques eurent de grands différends avec les seigneurs du Lyonnois, pour la jurisdiction. Enfin les habitans s'étant affranchis de la servitude, contraignirent leur archevêque de se mettre sous la protection du roi de France, & de reconnoître sa souveraineté. C'est ce qui arriva sous Philippe le Bel en 1307 ; alors ce prince érigea la seigneurie de Lyon en comté, qu'il laissa à l'archevêque & au chapitre de S. Jean ; & c'est-là l'origine du titre de comtes de Lyon que prennent les chanoines de cette église.
En 1563, le droit de justice que l'archevêque avoit, fut mis en vente, & adjugé au roi, dernier enchérisseur. Depuis ce tems-là toute la justice de Lyon a été entre les mains des officiers du Roi.
Cette ville a présentement un gouverneur, un intendant, une sénéchaussée & siége présidial, qui ressortissent au parlement de Paris ; un échevinage, un arsenal, un bureau des trésoriers de France, une cour des monnoies & quatre foires renommées.
L'archevêché de Lyon vaut environ cinquante mille livres de rente. Quand il est vacant c'est l'évêque d'Autun qui en a l'administration, & qui jouit de la régale ; mais il est obligé de venir en personne en faire la demande au chapitre de saint Jean de Lyon. L'archevêque de Lyon a aussi l'administration du diocèse d'Autun pendant la vacance, mais il ne jouit pas de la régale.
Comme plusieurs écrivains ont donné d'amples descriptions de Lyon, j'y renvoie le lecteur, sans entrer dans d'autres détails. Je remarquerai seulement, que cette ville se trouvant au centre de l'Europe, si l'on peut parler ainsi, & sur le confluent de deux rivieres, la Saône & le Rhône ; une situation si heureuse la met en état de fleurir & de prospérer éminemment par le négoce. Elle a une douanne fort ancienne & fort considérable ; mais il est bien singulier que ce n'est qu'en 1743, que les marchandises allant à l'étranger ont été déchargées des droits de cette douanne. Cette opération si tardive, dit un homme d'esprit, prouve assez combien longtems les François ont été aveuglés sur la science du commerce.
Lyon est à six lieues N. O. de Vienne, vingt N. O. de Grenoble, vingt-huit S. O. de Genève, trente-six N. d'Avignon, quarante S. O. de Dijon, soixante N. O. de Turin, cent S. E. de Paris. Long. suivant Cassini, 22d. 16'. 30''. lat. 45d. 45'. 20''.
On sait que l'empereur Claude fils de Drusus, & neveu de Tibere, naquit à Lyon dix ans avant J.C. mais cette ville ne peut pas se glorifier d'un homme dont la mere, pour peindre un stupide, disoit qu'il étoit aussi sot que son fils Claude. Ses affranchis gouvernerent l'empire, & le deshonorerent ; enfin lui-même mit le comble au desastre en adoptant Néron pour son successeur au préjudice de Britannicus. Parlons donc des gens de lettres, dont la naissance peut faire honneur à Lyon, car elle en a produit d'illustres.
Sidonius Apollinaris doit être mis à la tête, comme un des grands évêques & des célebres écrivains du cinquieme siecle. Son pere étoit préfet des Gaules sous Honorius. Apollinaire devint préfet de Rome, patrice, & évêque de Clermont. Il mourut en 480, à cinquante-deux ans. Il nous reste de lui neuf livres d'épitres & vingt-quatre pieces de poésies, publiées avec les notes de Jean Savaron & du pere Sirmond.
Entre les modernes, Messieurs Terrasson, de Boze, Spon, Chazelles, Lagni, Truchet, le pere Ménétrier, &c. ont eu Lyon pour patrie.
L'abbé Terrasson (Jean) philosophe pendant sa vie & à sa mort, mérite notre reconnoissance par son élégante & utile traduction de Diodore de Sicile. Malgré toutes les critiques qu'on a faites de son Sethos, on ne peut s'empêcher d'avouer qu'il s'y trouve des caracteres admirables & des morceaux quelquefois sublimes ; il mourut en 1750. Deux de ses freres se sont livrés à la prédication avec applaudissement ; leurs sermons imprimés forment huit volumes in-12. L'avocat Terrasson ne s'est pas moins distingué par ses ouvrages de jurisprudence. Il étoit l'oracle du Lyonnois, & de toutes les provinces qui suivent le droit romain.
M. de Boze (Claude Gros de) habile antiquaire & savant littérateur, s'est distingué par plusieurs dissertations sur les médailles antiques, par sa bibliotheque de livres rares & curieux, & plus encore par les quinze premiers volumes in 4°. des mémoires de l'académie des Inscriptions, dont il étoit le secrétaire perpétuel. Il mourut en 1754 âgé de soixante-quatorze ans.
Le public est redevable à M. Spon (Jacob) des recherches curieuses d'antiquités in-folio, d'une relation de ses voyages de Grece & du Levant, imprimés tant de fois, & d'une bonne histoire de la ville de Genève. Il mourut en 1685 âgé seulement de trente-huit ans.
Chazelles (Jean Matthieu de) imagina le premier qu'on pouvoit conduire des galeres sur l'Océan ; ce qui réussit. Il voyagea dans la Grece & dans l'Egypte ; il mesura les pyramides, & remarqua que les quatre côtés de la plus grande sont exposés aux quatre régions du monde ; c'est-à-dire à l'orient, à l'occident, au midi & au nord. Il fut associé à l'académie des Sciences, & mourut à Marseille en 1710 âgé de cinquante-trois ans.
M. de Lagny (Thomas Fantet de) a publié plusieurs mémoires de Mathématiques dans le recueil de l'académie des Sciences, dont il étoit membre. Il mourut en 1734 âgé de soixante-quatorze ans. Voyez son éloge par M. de Fontenelle.
Truchet (Jean) célebre méchanicien, plus connu sous le nom de P. Sébastien, naquit à Lyon en 1657, & mourut à Paris en 1729. Il enrichit les manufactures du royaume de plusieurs machines très-utiles, fruit de ses découvertes & de son génie ; il inventa les tableaux mouvans, l'art de transporter de gros arbres entiers sans les endommager ; & cent autres ouvrages de Méchanique. En 1699, le roi le nomma pour un des honoraires de l'académie des Sciences, à laquelle il a donné comme académicien quelques morceaux, entr'autres une élégante machine du système de Galilée, pour les corps pesans, & les combinaisons des carreaux mi-partis, qui ont excité d'autres savans à cette recherche.
Le R. P. Ménétrier (Claude François) jésuite, décédé en 1705, a rendu service à Lyon sa patrie, par l'histoire consulaire de cette ville. Il ne faut pas le confondre avec les deux habiles antiquaires de Dijon, qui portent le même nom, Claude & Jean-Baptiste le Menestrier, & qui ont publié tous les deux des ouvrages curieux sur les médailles d'antiquités romaines.
Je pourrois louer le poëte Gacon (François) né à Lyon en 1667, s'il n'avoit mis au jour que la traduction des odes d'Anacréon & de Sapho, celle de la comédie des oiseaux d'Aristophane, & celle du poëme latin de du Fresnoy sur la Peinture. Il mourut en 1725.
Vergier (Jacques) poëte lyonnois, est à l'égard de la Fontaine, dit M. de Voltaire, ce que Campistron est à Racine, imitateur foible, mais naturel. Ses chansons de table sont charmantes, pleines d'élégance & de naïveté. On sait quelle a été la triste fin de ce poëte ; il fut assassiné à Paris par des voleurs en 1720, à soixante-trois ans.
Enfin Lyon a donné de fameux artistes ; par exemple, Antoine Coysevox, dont les ouvrages de sculpture ornent Versailles ; Jacques Stella, qui devint le premier peintre du Roi, & qui a si bien réussi dans les pastorales ; Joseph Vivien, excellent dans le pastel, avant le célebre artiste de notre siecle, qui a porté ce genre de peinture au dernier point de perfection, &c. (D.J.)
|
| LYONNOIS | LE (Géog.) grande province de France, & l'un de ses gouvernemens. Elle est bornée au nord par le Mâconnois & par la Bourgogne ; à l'orient par le Dauphiné ; au sud par le Vivarais & le Vélay ; & du côté du couchant, les montagnes la séparent de l'Auvergne. Cette province comprend le Lyonnois proprement dit, dont la capitale est Lyon, le Beaujolois & le Forez. Elle produit du vin, du blé, des fruits & de bons marrons. Ses rivieres principales sont le Rhône, la Saône & la Loire.
Les peuples de cette province s'appelloient anciennement Segusiani, & furent sous la dépendance des Edui, c'est-à-dire de ceux d'Autun (in clientelâ Aeduorum, dit César), jusqu'à l'empire d'Auguste qui les affranchit ; c'est pourquoi Pline les nomme Segusiani liberi. Dans les annales du regne de Philippe & ailleurs, le Lyonnois est appellé Pagus lugdunensis, in regno Burgundiae.
|
| LYONNOISE | LA (Géog. anc.) en latin provincia Lugdunensis, une des régions ou parties de la Gaule ; l'empereur Auguste qui lui donna ce nom, la forma d'une partie de ce qui composoit du tems de Jules-César, la Gaule celtique. Dans la suite la province lyonnoise fut partagée en deux. Enfin sous Honorius, chacune de ces deux Lyonnoises fut encore partagée en deux autres ; desorte qu'il y avoit la premiere, la seconde, la troisieme & la quatrieme Lyonnoise, autrement dite Lyonnoise sénonoise. (D.J.)
|
| LYRE | S. f. (Astr.) constellation de l'hémisphere septentrional. Voyez ÉTOILE & CONSTELLATION.
Le nombre de ces étoiles dans les catalogues de Ptolémée est de Tycho & de dix, & dans le catalogue anglois de dix-neuf.
Lyre, (Musique anc.) en grec , en latin lyra, testudo, instrument de musique à cordes, dont les anciens faisoient tant d'estime, que d'abord les Poëtes en attribuerent l'invention à Mercure, & qu'ils la mirent ensuite entre les mains d'Apollon.
La lyre étoit différente de la cithare, 1°. en ce que les côtés étoient moins écartés l'un de l'autre ; 2°. en ce que sa base ressembloit à l'écaille d'une tortue, animal dont la figure, dit-on, avoit donné la premiere idée de cet instrument. La rondeur de cette base ne permettoit pas à la lyre de se tenir droite comme la cithare, & il falloit, pour en jouer la serrer avec les genoux. On voit par-là qu'elle avoit quelque rapport à un luth posé debout, & dont le manche seroit fort court : & il y a grande apparence que ce dernier instrument lui doit son origine. En couvrant d'une table la base ou le ventre de la lyre on en a formé le corps du luth, & en joignant par un ais les deux bras ou les deux côtés de la premiere, on en a fait le manche du second.
La lyre a fort varié pour le nombre des cordes. Celle d'Olympe & de Terpandre n'en avoit que trois, dont ces Musiciens savoient diversifier les sons avec tant d'art, que, s'il en faut croire Plutarque, ils l'emportoient de beaucoup sur ceux qui jouoient d'une lyre plus composée. En ajoutant une quatrieme corde à ces trois premieres, on rendit le tétracorde complet, & c'étoit la différente maniere dont on accordoit ces quatre cordes, qui constituoit les trois genres, diatonique, chromatique & enharmonique.
L'addition d'une cinquieme corde produisit le pentacorde, dont Pollux attribue l'invention aux Scythes. On avoit sur cet instrument la consonnance de la quinte, outre cela de la tierce & de la quarte que donnoit déja le tétracorde. Il est dit du musicien Phrynis, que de sa lyre à cinq cordes il tiroit douze sortes d'harmonies, ce qui ne peut s'entendre que de douze chants ou modulations différentes, & nullement de douze accords, puisqu'il est manifeste que cinq cordes n'en peuvent former que quatre, la deuxieme, la tierce, la quarte & la quinte.
L'union des deux tétracordes joints ensemble, de maniere que la corde la plus haute du premier devient la base du second, composa l'eptacorde, ou la lyre à sept cordes, la plus en usage & la plus célebre de toutes.
Cependant, quoiqu'on y trouvât les sept voix de la musique, l'octave y manquoit encore. Simonide l'y mit enfin, selon Pline, en y ajoutant une huitieme corde, c'est-à-dire en laissant un ton entier d'intervalle entre les deux tétracordes.
Long-tems après lui, Timothée Milésien, qui vivoit sous Philippe roi de Macédoine vers la cviij. olympiade, multiplia les cordes de la lyre jusqu'au nombre de douze, & alors la lyre contenoit trois tétracordes joints ensemble, ce qui faisoit l'étendue de la douzieme, ou de la quinte par-dessus l'octave.
On touchoit de deux manieres les cordes de la lyre, ou en les pinçant avec les doigts, ou en les frappant avec l'instrument nommé plectrum, , du verbe ou , percutere, frapper. Le plectrum étoit une espece de baguette d'ivoire ou de bois poli, plutôt que de métal, pour épargner les cordes, & que le musicien tenoit de la main droite. Anciennement on ne jouoit point de la lyre sans plectrum ; c'étoit manquer à la bienséance que de la toucher avec les doigts ; & Plutarque, cité par Henri Etienne, nous apprend que les Lacédémoniens mirent à l'amende un joueur de lyre pour ce sujet. Le premier qui s'affranchit de la servitude du plectrum fut un certain Epigone, au rapport de Pollux & d'Athénée.
Il paroît par d'anciens monumens & par le témoignage de quelques auteurs, qu'on touchoit des deux mains certaines lyres, c'est-à-dire qu'on en pinçoit les cordes avec les doigts de la main gauche, ce qui s'appelloit jour en-dedans, & qu'on frappoit ces mêmes cordes de la main droite armée du plectrum ce qui s'appelloit jour en-dehors. Ceux qui jouoient sans plectrum, pouvoient pincer les cordes avec les doigts des deux mains. Cette maniere de jouer étoit pratiquée sur la lyre simple, pourvu qu'elle eût un nombre de cordes suffisant, & encore plus sur la lyre à double cordes. Aspendius, un des plus fameux joueurs de lyre dont l'histoire fasse mention, ne se servoit que des doigts de la main gauche pour toucher les cordes de cet instrument, & il le faisoit avec tant de délicatesse, qu'il n'étoit presque entendu que de lui-même ; ce qui lui fit appliquer ces mots, mihi & fidibus cano, pour marquer qu'il ne jouoit que pour son unique plaisir.
Toutes ces observations que je tire de M. Burette sur la structure, le nombre des cordes, & le jeu de la lyre, le conduisent à rechercher quelle sorte de concert pouvoit s'exécuter par un seul instrument de cette espece ; mais je ne puis le suivre dans ce genre de détail. C'est assez de dire ici que la lyre à trois ou quatre cordes n'étoit susceptible d'aucune symphonie ; qu'on pouvoit sur le pentacorde jouer deux parties à la tierce l'une de l'autre ; enfin que plus le nombre des cordes se multiplioit sur la lyre, plus on trouvoit de facilité à composer sur cet instrument des airs qui fissent entendre en même tems différentes parties. La question est de savoir si les anciens ont profité de cet avantage, & je crois que s'ils n'en tirerent pas d'abord tout le parti possible, du moins ils y parvinrent merveilleusement dans la suite.
De-là vient que les poëtes n'entendent autre chose par la lyre que la plus belle & la plus touchante harmonie. C'est par la lyre qu'Orphée apprivoisoit les bêtes farouches, & enlevoit les bois & les rochers ; c'est par elle qu'il enchanta Cerbere, qu'il suspendit les tourmens d'Ixion & des Danaïdes, c'est encore par elle qu'il toucha l'inexorable Pluton, pour tirer des enfers la charmante Euridice.
Aussi l'auteur de Télémaque nous dit, d'après Homere, que lorsque le prêtre d'Apollon prenoit en main la lyre d'ivoire, les ours & les lions venoient le flatter & lécher ses piés, les satyres sortoient des forêts, pour danser autour de lui ; les arbres même paroissoient émus, & vous auriez cru que les rochers attendris alloient descendre du haut des montagnes aux charmes de ses doux accens ; mais il ne chantoit que la grandeur des dieux, la vertu des héros & le mérite des rois, qui sont les peres de leurs peuples.
L'ancienne tragédie grecque se servoit de la lyre dans ses choeurs. Sophocle en joua dans sa piece nommée Thamyris, & cet usage subsista tant que les choeurs conserverent leur complicité grave & majestueuse.
Les anciens monumens de statues, de bas-reliefs & de médailles nous représentent plusieurs figures différentes de lyres, montées depuis trois cordes jusqu'à vingt, selon les changemens que les Musiciens firent à cet instrument.
Ammien Marcellin rapporte que de son tems, & cet auteur vivoit dans le iv. siecle de l'ere chrétienne, il y avoit des lyres aussi grosses que des chaises roulantes : Fabricantur lyrae ad speciem carpentorum ingentes. En effet, il paroît que dès le tems de Quintilien, qui a écrit deux siecles avant Ammien Marcellin, chaque son avoit déjà sa corde particuliere dans la lyre. Les musiciens, c'est Quintilien qui parle, ayant divisé en cinq échelles, dont chacune a plusieurs degrés, tous les sons qu'on peut tirer de la lyre, ils ont placé entre les cordes qui donnent les premiers tons de chacune de ces échelles, d'autres cordes qui rendent des sons intermédiaires, & ces cordes ont été si bien multipliées, que, pour passer d'une des cinq maîtresses-cordes à l'autre, il y a autant de cordes que de degrés.
On sait que la lyre moderne est d'une figure approchante de la viole, avec cette différence, que son manche est beaucoup plus large, aussi-bien que ses touches, parce qu'elles sont couvertes de quinze cordes, dont les six premieres ne font que trois rangs ; & si on vouloit doubler chaque rang comme au luth, on auroit vingt-deux cordes ; mais bien loin qu'on y songe, cet instrument est absolument tombé de mode. Il y a cependant des gens de goût, qui prétendent que, pour la puissance de l'expression sur le sentiment, le clavessin même doit lui céder cette gloire.
Ils disent que la lyre a sur le clavessin les avantages qu'ont des expressions non-interrompues sur celles qui sont isolées. Le premier son de la lyre dure encore, lorsque le second son commence ; à ce second son, il s'en joint un troisieme, & tous ces sons se font entendre en même tems. Il est vrai que, sans beaucoup de science & de délicatesse, il est très-difficile de porter à l'ame l'impression puissante de cette union de sons confuse ; & voilà ce qui peut avoir dégradé la lyre : mais il n'en étoit pas vraisemblablement de même du jeu de Terpandre, de Phrynis & de Timothée ; ces grands maîtres pouvoient, par un savant emploi des sons continus, mouvoir les ressorts les plus secrets de la sensibilité. (D.J.)
|
| LYRIQUE | (Littér.) chose que l'on chantoit ou qu'on jouoit sur la lyre, la cithare ou la harpe des anciens.
Lyrique se dit plus particulierement des anciennes odes ou stances qui répondent à nos airs ou chansons. C'est pour cela qu'on a appellé les odes poésies lyriques, parce que quand on les chantoit, la lyre accompagnoit la voix. Voyez ODE.
Les anciens étoient grands admirateurs des vers lyriques, & ils donnoient ce nom, selon M. Barnés, à tous les vers qu'on pouvoit chanter sur la lyre. Voyez VERS.
On emploia d'abord la poésie lyrique à célébrer les louanges des dieux & des héros. Musa dedit fidibus divos puerosque deorum, dit Horace ; mais ensuite on l'introduisit pour chanter les plaisirs de la table, & ceux de l'amour : & juvenum curas & libera vina referre, dit encore le même auteur.
Ce seroit une erreur de croire avec les Grecs qu'Anacréon en ait été le premier auteur, puisqu'il paroît par l'écriture que plus de mille ans avant ce poëte, les Hébreux étoient en possession de chanter des cantiques au son des harpes, des cymbales & d'autres instrumens. Quelques auteurs ont voulu exclure de la poésie lyrique les sujets héroïques, M. Barnés a montré contr'eux que le genre lyrique est susceptible de toute l'élévation & la sublimité que ces sujets exigent. Ce qu'il confirme par des exemples d'Alcée, de Stésichore & d'Horace, & enfin par un essai de sa façon qu'il a mis à la tête de son ouvrage sous le titre d'Ode triomphale au duc de Marlboroug. Il finit par l'histoire de la poésie lyrique, & par celle des anciens auteurs qui y ont excellé.
Le caractere de la poésie lyrique est la noblesse & la douceur ; la noblesse, pour les sujets héroïques ; la douceur, pour les sujets badins ou galans ; car elle embrasse ces deux genres, comme on peut voir au mot ODE.
Si la majesté doit dominer dans les vers héroïques ; la simplicité, dans les pastorales ; la tendresse, dans l'élégie ; le gracieux & le piquant, dans la satyre ; la plaisanterie, dans le comique ; le pathétique, dans la tragédie ; la pointe, dans l'épigramme : dans le lyrique, le poëte doit principalement s'appliquer à étonner l'esprit par le sublime des choses ou par celui des sentimens, ou à le flatter par la douceur & la variété des images, par l'harmonie des vers, par des descriptions & d'autres figures fleuries, ou vives & véhémentes, selon l'exigence des sujets. Voyez ODE.
La poésie lyrique a de tout tems été faite pour être chantée, & telle est celle de nos opéras, mais supérieurement à toute autre, celle de Quinault, qui semble avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui l'ont précédé ou suivi. Par conséquent la poésie lyrique & la musique doivent avoir entr'elles un rapport intime, & fondé dans les choses mêmes qu'elles ont l'une & l'autre à exprimer. Si cela est, la musique étant une expression des sentimens du coeur par les sons inarticulés, la poésie musicale ou lyrique est l'expression des sentimens par les sons articulés, ou ce qui est la même chose par les mots.
M. de la Mothe a donné un discours sur l'ode, ou la poésie lyrique, où parmi plusieurs réflexions ingénieuses, il y a peu de principes vrais sur la chaleur ou l'enthousiasme qui doit être comme l'ame de la poésie lyrique. Voyez ENTHOUSIASME & ODE.
|
| LYRNESSE | (Géog. anc.) Lyrnessus, en grec , ville d'Asie dans le territoire de Troie : le champ où elle étoit bâtie portoit le nom d'une ville appellée Thébé. Adramyte se forma des ruines de Lyrnesse, selon Hiéroclès. (D.J.)
|
| LYSER LE | (Géog.) petite riviere d'Allemagne ; elle a sa source dans l'évêché de Saltzbourg, & se jette dans la Drave à Ortnbourg. (D.J.)
|
| LYSIARQUE | S. m. (Hist. anc.) nom d'un ancien magistrat qui étoit le pontife de Lycia, ou le surintendant des jeux sacrés de cette province.
Strabon observe que le lysiarque étoit créé dans un conseil composé des députés de vingt-trois villes, c'est-à-dire de toutes les villes de la province, dont quelques-unes avoient trois voix, d'autres deux, & d'autres une seulement.
Le cardinal Noris dit que le lysiarque présidoit en matiere de religion. En effet le lysiarque étoit à-peu-près la même chose que les asiarques & ciriarques, qui, quoiqu'ils fussent les chefs des conseils & des états des provinces, étoient cependant principalement établis pour prendre soin des jeux & des fêtes qui se célébroient en l'honneur des dieux, dont on les instituoit les prêtres en même tems qu'on les créoit. Voyez ASIARQUES ou CIRIARQUES.
|
| LYSIMACHIE | S. f. (Botan.) J'allois presque ajoûter les caracteres de ce genre de plante par Linnaeus ; mais pour abréger, je me contenterai de décrire la grande lysimachie jaune, qui est la principale espece.
Elle est nommée lysimachia lutea, major, quae Dioscoridis, par C. B. P. 245. Tournefort, I. R. H. 141. lysimachia lutea, J. B. 2. 90. Raii histor. lysimachia foliis lanceolatis, caule corymbo terminato, par Linnaeus, fl. lapon. 51. Les Anglois l'appellent great yellaw willow-herb, terme équivoque ; les François la nomment lysimachie jaune, corneille, souci d'eau, percebosse, chassebosse ; le seul premier nom lui convient, il faut abroger tous les autres qui sont ridicules.
La racine de cette plante est foible, rougeâtre, rampante à fleur de terre ; elle pousse plusieurs tiges à la hauteur de deux ou trois piés, droites, cannelées, brunes, velues, ayant plusieurs noeuds : de chacun d'eux sortent trois ou quatre feuilles, quelquefois cinq, plus rarement deux, oblongues, pointues, semblables à celles du saule à larges feuilles, d'un verd brun en-dessus, blanchâtres & lanugineuses en-dessous.
Ses fleurs naissent aux sommets des branches, plusieurs à côté les unes des autres ; elles n'ont qu'un seul pétale, divisé en cinq ou six parties jaunes ; elles sont sans odeur, mais d'un goût aigre. Quand les fleurs sont passées, il leur succede des fruits qui forment une espece de coquille sphéroïde, ils s'ouvrent par la pointe en plusieurs quartiers, & renferment dans leur cavité, des semences fort menues, d'un goût assez astringent.
Cette plante prospere dans les endroits humides & marécageux, proche des ruisseaux, & au bord des fossés ; elle fleurit en Juin & Juillet.
Césalpin a remarqué qu'elle a quelquefois deux, trois, quatre, ou cinq feuilles opposées aux noeuds des tiges. Son observation est véritable, & constitue les variétés de cette plante ; elle n'a point d'autre qualité que d'embellir la campagne de ses bouquets de fleurs, qui se mêlant avec ceux de la salicaire, dont nous parlerons en son lieu, forment un agréable coup d'oeil. On dit que son nom lui vient de Lysimaque fils d'un roi de Sicile, qui la découvrit le premier ; mais c'est qu'on a bien voulu faire honneur à ce prince de cette découverte imaginaire.
Nos Botanistes ont commis bien d'autres fautes ; ils ont nommé lysimachie jaune cornue une espece d'onagra ; lysimachie rouge, une espece de salicaire ; lysimachie bleue, une espece de véronique, &c. (D.J.)
LYSIMACHIE, (Géog. anc.) ville de la Thrace, qui prit ensuite le nom d'Hexamilium : on l'appelle aujourd'hui Hexamili, selon Sophien ; ou Policastro, selon Nardus. (D.J.)
|
| LYSIMACHUS | (Hist. nat.) pierre ou espece de marbre dans lequel on voyoit des veines d'or ou de la couleur de ce métal ; Pline dit qu'il ressembloit au marbre de Rhodes.
|
| LYSPONDT | (Commerce) sorte de poids qui pese plus ou moins, suivant les endroits où l'on s'en sert.
A Hambourg le lyspondt est de quinze livres, qui reviennent à quatorze livres onze onces un gros un peu plus de Paris, d'Amsterdam, de Strasbourg & de Besançon où les poids sont égaux. A Lubeck, le lyspondt est de seize livres poids du pays, qui font à Paris quinze livres trois onces un gros un peu plus.
A Copenhague, le lyspondt est de seize livres poids du pays, qui rendent quinze livres douze onces six gros un peu plus de Paris.
A Dantzick, le lyspondt est de dix-huit livres, qui en font seize de Paris.
A Riga, le lyspondt est de vingt livres, qui font seize livres huit onces de Paris. Dictionn. de Comm. tome III. page 206.
|
| LYSSA | (Littérat.) , signifie rage, desespoir. Euripide en a fait une divinité, qu'il met au nombre des furies ; l'emploi particulier de celle-ci consistoit à souffler dans l'esprit des mortels la fureur & la rage. Ainsi Junon dans ce poëte ordonne à sa messagere Iris de conduire promtement Lyssa, coëffée de serpens, auprès d'Hercule, pour lui inspirer ces terribles fureurs qui lui firent enfin perdre la vie. (D.J.)
|
| LYSTRES | (Géog. anc.) Lystra, ville d'Asie dans la Lycaonie ; il en est parlé dans les Actes, chap. xiv. & xxvij. c'étoit la patrie de S. Timothée. Les apôtres S. Paul & S. Barnabé y ayant guéri un homme boiteux depuis sa naissance, y furent pris pour deux divinités. (D.J.)
|
| LYTHAN | S. m. (Hist. anc.) mois de l'année des Cappadociens. Selon un fragment qu'on trouve dans Ussérius, ce mois répondoit au mois de Janvier des Romains.
|
|
|
|